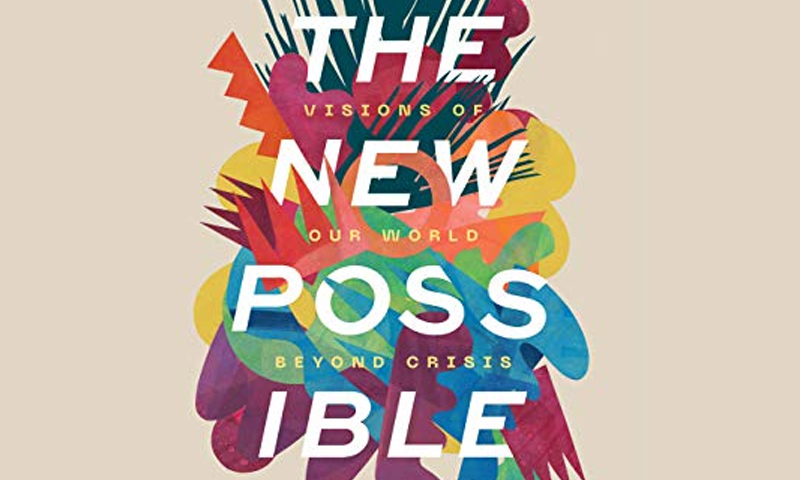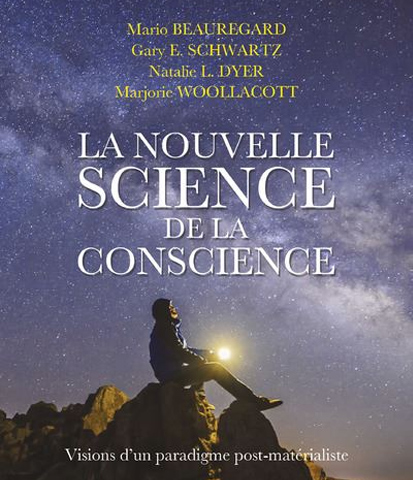par jean | Sep 9, 2023 | Hstoires et projets de vie |
 Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants.
Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants.
« Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants » (1), c’est le livre de Christina de Stefano.
« C’est une biographie fascinante d’une pionnière du féminisme, des pédagogies nouvelles et des recherches sur le cerveau de l’enfant » (page de couverture).
Aujourd’hui, à un moment où l’humanité est confrontée à de graves menaces, il est bon de penser au mouvement de fond qui se poursuit depuis plus d’un siècle : une reconnaissance grandissante de la conscience des êtres humains et des êtres vivants jusque là méconnue par l’égocentrisme patriarcal, des femmes, des enfants et, à la limite, du règne animal. Mais, il n’y a pas de doute, la prise de conscience du potentiel du petit enfant, l’accompagnement respectueux de son développement, constitue une émergence de paradigme, une véritable révolution. A cet égard, Maria Montessori est la grande pionnière, tout en s’inscrivant dans le vaste mouvement de l’éducation nouvelle tel qu’il est apparu et se manifeste encore aujourd’hui comme un « printemps de l’éducation » (2).
Maria Montessori est celle qui, au début du XXe siècle, a dépassé les obstacles des conditions et des mentalités qui barraient la route à la reconnaissance d’une voie nouvelle, en proclamant et en démontrant que « l’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir ». Reconnaître le potentiel de l’enfant, c’est ne pas lui imposer, d’en haut, une instruction stéréotypée, des méthodes contraignantes, mais observer et accompagner son développement, son mouvement dans une approche personnalisée et la proposition d’un environnement matériel et social approprié. Reconnaître la dimension de l’enfant, c’est apprécier également sa dimension spirituelle. Le petit enfant est un « embryon spirituel ».
Si la pédagogie Montessori n’a pas occupé tout le champ de l’éducation et reste pionnière, sa présence s’est étendue : 200 écoles en France suite à une forte croissance dans les dernières décennies, et 20 000 dans le monde. Maria Montessori a écrit plusieurs livres. Son ouvrage : « l’enfant » fut pour nous une révélation (3), et, sur le web, il y a maintenant de nombreux sites qui présentent la pédagogie Montessori (4).
La pédagogie Montessori est toujours inspirante aujourd’hui. Dans le champ de l’éducation nouvelle, elle inspire des innovations comme celles de Céline Alvarez (5) retracées sur ce blog. Des recherches récentes, impliquant les neurosciences rejoignent les constats de Maria Montessori sur la dimension spirituelle de l’enfant. « L’enfant est un être spirituel » (6). Depuis la fin du XXe siècle, la pédagogie Montessori a même inspiré une nouvelle approche de la catéchèse chrétienne : « Godly Play » (7). On peut ajouter que l’éducation Montessori, à travers certaines de ses caractéristiques : l’attention à la dimension sensorielle, l’écoute, le respect commencent à inspirer aujourd’hui la communication entre adultes (8).
Ce livre de Christina de Stefano est un ouvrage de référence bien étayé, appuyé sur des notes et une bibliographie abondante. Et c’est aussi un livre très accessible réparti dans une centaine de courts chapitres et se déroulant en cinq parties : la construction de soi (1870-1900) ; la découverte d’une mission (1901-1907) ; les premiers disciples (1908-1913) ; la gestion du succès (1914-1934) ; l’éducation cosmique (1934-1952). En constant mouvement, dans des contextes différents d’un pays à un autre, de l’Italie aux Etats-Unis, de l’Espagne aux Pays-Bas et jusqu’à un long séjour en Inde, la personnalité de Maria Montessori apparaît dans sa complexité. Nous nous centrerons sur l’élaboration de « la méthode Montessori » fondée sur l’observation des enfants, ce que nous appellerons : l’invention montessorienne. Cette invention est la résultante de la formation d’une personnalité originale, une forte personnalité qui tranche avec la société dominante de l’époque. Il y a eu là toute une période de préparation. L’invention montessorienne a ensuite suscité des échos, si plus particulièrement dans certains pays, de fait dans le monde entier. Maria Montessori a communiqué sa vision et répandu son message en suscitant l’engagement et le dévouement d’un grand nombre de personnes. C’est une période de diffusion et d’expansion.
La préparation
Née en 1870, Maria Montessori a grandi comme fille unique dans une famille de la classe moyenne italienne, chérie par ses parents. « Son père travaille au ministère des Finances, sa mère se consacre à son éducation. Elle lui inculque les valeurs de la solidarité et lui fait tricoter des habits chauds destinés à des œuvres de bienfaisance. Elle l’encourage à s’occuper des pauvres et à tenir compagnie à une voisine handicapée par sa bosse. Peut-être, est-ce pour cela que la fillette caresse l’idée de devenir médecin » (13).
Maria supporte très mal l’école élémentaire. A cette époque, « immobile à son pupitre, on écoute la maitresse pendant des heures et on répète la leçon en chœur » (p 11). « Cette fillette extravertie est, malgré son jeune âge, dotée d’un grand charisme » (p 11). Elle poursuit ensuite ses études dans une école technique où elle réussit sa scolarité. Son père voudrait qu’elle s’inscrive à l’école normale pour devenir institutrice. Mais elle s’y refuse et déclare vouloir devenir ingénieur. « C’est un choix insolite, car les rares jeunes filles qui poursuivent leurs études le font pour enrichir leur culture avant de se marier ou, à la rigueur, pour entrer dans l’enseignement » (p 17).
Mais, encore plus surprenant à l’époque, elle voulut s’engager dans des études de médecine. Si l’esprit progressiste de sa mère la soutient, son père y est défavorable. « A l’époque, dans les milieux bourgeois, on protège jalousement les filles à marier, qui ne sortent jamais de chez elles sans être accompagnées. Il est donc proprement inouï d’imaginer une fille assise seule au milieu d’étudiants de sexe masculin » (p 19). Cependant Maria Montessori parvient à surmonter la barrière sociale et culturelle et à franchir les obstacles. Après avoir accompli des études préparatoires, en février 1992, elle intègre la faculté de médecine. A l’époque, certains professeurs ont des personnalités fortes et des idées avancées. Ils sont engagés dans une action médicale en milieu populaire. Maria les accompagne dans ce bénévolat. « Ayant grandi dans un environnement bourgeois et protégé, Maria n’était pas préparée à ce qu’elle découvre… C’est son « approche du peuple » (p 31). Très marquée par les cours d’un professeur sur la relation entre éducation et folie, elle décide de faire une thèse en psychiatrie sous sa direction. « Entre les cours, l’internat, dans les hôpitaux et l’étude des patients de la clinique psychiatrique en vue de sa thèse, la dernière année d’université de Maria est très intense. Elle obtient son diplôme en juillet 1896 » (p 34).
Maria Montessori va donc entrer dans un univers médical. Elle est assistante dans un hôpital. Et, tous les jours, en sortant de l’hôpital, « elle continue à faire du bénévolat auprès des déshérités de la ville. C’est au contact des enfants pauvres, qui sont les derniers de la société, que nait son attention à l’égard de l’enfance » (p 39).
Il lui arrive de fréquenter l’asile d’aliénés de Rome. C’est un endroit où règne la violence. Au cours de l’une de ses visites, elle découvre les enfants de l’asile. « Jugés incurables et donc enfermés à vie, ces enfants représentent peut-être ce que ce lieu épouvantable a de plus terrible » (p 44). « Maria comprend qu’elle a trouvé là une cause pour laquelle se battre ». Elle s’interroge à partir de la réaction d’une servante. « Si la réaction des enfants ne dépendait pas tant de leur désir de manger que celui d’interagir avec quelque chose » (p 44).
« Jusqu’alors, Maria a été une jeune femme médecin engagée dans les causes sociales et féministes. A partir de là, elle empruntera une voie qui la conduira très loin à parcourir le monde et à prêcher une nouvelle approche de l’enfant. Dans cette salle d’asile de Rome, son intuition lui dit que les petits déficients ont besoin d’un traitement spécifique qui les stimule et les élève » (p 45). Elle demande à en emmener quelques-uns hors de l’asile pour faire des expériences avec eux.
Elle s’intéresse à la pédagogie. « C’est ainsi quelle découvre le travail d’ Edouard Seguin, un français qui, au milieu du XIXe siècle, a mis au point une éducation particulière aux résultats surprenants… Seguin est le grand inspirateur de Maria Montessori et le créateur du matériel didactique à partir duquel elle a élaboré sa méthode » (p 45).
Edouard Seguin a été assistant du Docteur Itard devenu célèbre pour sa tentative d’éduquer « l’enfant sauvage de l’Aveyron ». Itard a pris en charge cet enfant en mettant en œuvre une méthode expérimentale, « faite de patience, d’observation et d’une grande créativité » (p 47). Dans ce sillage, Seguin se voit confier en 1840, ce qui est sans doute la première classe spécialisée de l’histoire, un groupe de jeunes déficients internés à l’asile de Paris. « Débordant d’enthousiasme, Seguin travaille, jour et nuit, pour essayer de communiquer avec eux. Il a décidé de bâtir une éducation complète, systématique, qui part de la sollicitation des sens pour ensuite s’étendre au développement des idées et des concepts abstraits… Pour ce faire, il invente tout un matériel éducatif… ». (p 48). En 1846, il publie un livre qui rapporte son travail. En raison de l’opposition manifestée par le milieu médical français, il émigre aux Etats-Unis.
A la fin des années 1890, un tournant majeur intervient dans la vie de Maria Montessori. Ce fut une rencontre amoureuse avec un collègue médecin Giuseppe Montesano. « Elle, socialiste, dans un sens, lui avec une éthique juive, son important sens moral, sa rigueur… elle trouva dans la douceur de Montesano l’élément complémentaire à son tempérament fort » (p 42). Ils travaillent ensemble. Mais Maria n’envisage pas un mariage. A cette époque, « la condition de la femme mariée est incompatible avec un travail hors du foyer » (p 52). Maria Montessori perçoit le mariage comme un assujettissement. Or elle tombe enceinte. La situation est critique. « A cette époque et dans son milieu, une grossesse hors mariage détruirait sa carrière et sa réputation » (p 51). Finalement à l’initiative de sa mère, les deux familles s’entendent pour masquer l’incident. L’accouchement a lieu à domicile le 31 mars 1898. L’acte de naissance indique que l’enfant est né de père et de mère inconnus. Il est confié à une nourrice éloignée. Maria Montessori accepte donc de se séparer de son nouveau-né. Elle demande au père, Giuseppe Montesano de « prendre soin de leur enfant à distance et de promettre de ne jamais se marier » (p 54 ). Ce dernier manifeste de la bonne volonté, mais il subit les pressions de sa famille et la situation se dégrade. « Tout a basculé en l’espace de quelques semaines. Le 29 septembre 1901, Giuseppe reconnaît légalement son fils. Le 6 octobre 1901, il épouse une autre femme » (p 74). Ce fut un grand chagrin pour Maria. « Ses proches évoquent un moment terrible : elle reste couchée par terre, en pleurs, pendant des jours (p 75)… Elle met fin à tout contact avec Montesano, notamment sur le plan professionnel. « Pour Maria Montessori, commence une longue traversée du désert, au terme de laquelle sa mission lui apparaitra clairement. Celle-ci la conduira à parcourir le monde en tant que théoricienne d’une nouvelle vision de l’enfant » (p 76).
En conséquence de ce grand choc, la vie de Maria Montessori s’est profondément transformée. Elle s’est abreuvée dans une foi intérieure. Cette intériorisation ne l’a pas détournée de ses engagements les plus avancés, sa grande activité au service du féminisme. Et elle a patiemment reconstruit sa situation professionnelle. Ainsi, quelques années plus tard, en 1907, elle a pu développer une grande expérience pédagogique qui va engendrer une nouvelle vision de l’éducation et de la pédagogie, « La Maison des enfants » à San Lorenzo, un quartier démuni de Rome.
En 1901, « plongée dans un silence profond, Maria Montessori traverse un grand moment de crise » (p 79) : un grand chagrin et la perte d’un premier enracinement professionnel. C’est dans ce contexte que Maria Montessori développe « une grande foi ». « La foi catholique, qui, jusque là, faisait simplement partie de sa culture, devient un refuge et une nouvelle manière de regarder la vie, une dimension qui explique et éclaire tout, y compris la souffrance » (p 79). Maria fait de longues retraites spirituelles et fréquente une congrégation religieuse. « Cette période de ferveur religieuse l’aide à contenir sa peine et à rassembler ses forces. Pendant un certain temps, elle mène « une vie de recueillement absolu ». « J’étais animée par une grande foi, et bien qu’ignorant si je pourrais un jour expérimenter la vérité de mon idée, j’abandonnais toute autre activité comme si je me préparais pour une mission inconnue » se souviendra-t-elle par la suite (p 80). Si sa foi s’exprime dans un contexte catholique, elle garde un caractère personnel. Elle inspire son engagement pédagogique et n’exclut pas une confrontation avec les idées conservatrices, tant sur le plan social que sur le plan religieux « En elle, coexistent un profond sentiment religieux, la conviction d’avoir une mission personnelle, le militantisme féministe, un esprit progressiste et indigné, ainsi que la curiosité à l’égard de toute idée nouvelle » (p 98).
Durant des années, l’engagement féministe de Maria Montessori ne s’est pas démenti. En 1906 déjà, elle est choisie comme déléguée italienne au Congrès international des femmes à Berlin. Très engagée dans l’action sociale, « Maria Montessori était devenue la secrétaire de l’association : « Per la donna »(Pour la femme) crée par un groupe de militantes pour promouvoir un programme très radical : éducation populaire, suffrage féminin, loi pour la recherche de paternité, égalité salariale entre les hommes et les femmes. Comme délégué, Maria a le profil idéal : elle est jeune ; elle est une des première femme médecin en Italie ; c’est une bonne oratrice » (p 35). En 1899, elle représente l’Italie au Congrès international de femmes à Londres. Cependant, après le grand choc qu’elle a subi dans sa vie personnelle, son activité en ce domaine ne se tarit pas. « Elle est en première ligne pour le droit de vote des femmes… Maria dit toujours ce qu’elle pense, y compris quand elle est en désaccord avec les positions de l’Eglise » (p 95).
Au cours de ces années, Maria Montessori reconstruit patiemment son insertion professionnelle. Ainsi, en septembre 1902, elle présente sa candidature pour enseigner l’anthropologie à l’université. « Elle imagine un cours où l’anthropologie serait appliquée à l’éducation, dans le but de fonder une pédagogie réellement scientifique. Au cœur de son projet se trouve un projet révolutionnaire : la classe comme laboratoire d’observation » (p 82).
Elle entreprend de nouvelles études à l’université. Et, à partir d’une nouvelle recherche, elle se qualifie pour enseigner l’anthropologie à la faculté des sciences (p 89). En 1906, elle est appelée à enseigner à la Scuola Pedagogica (École pédagogique) à Rome. « Dans le cours qui lui est confié, intitulé : « anthropologie pédagogique », Maria continue d’expliquer ses idées novatrices sur l’école : la classe laboratoire, l’enfant au centre, l’enseignant comme un scientifique qui observe ». Son inspiration spirituelle apparaît : « Ce qui fait véritablement un enseignant, c’est son amour pour l’enfant. Car c’est l’amour qui transforme le devoir social de l’éducation en conscience plus élevée d’une mission » (p 91).
L’invention montessorienne
Ainsi, à travers les expériences, les rencontres, les réflexions, la pensée de Maria Montessori a muri. Elle va pouvoir l ’exercer dans une expérience fondatrice, la création d’une école expérimentale dans un des quartiers les plus mal famés de Rome : San Lorenzo (p 101). En 1904, un organisme nouveau intervient dans ce quartier. Il fait assainir l’ensemble, achève la construction des immeubles, installe des fontaines. Il attribue les appartements et suit leur entretien. Cependant, dans la journée, en l’absence des parents, les immeubles restent aux mains des tout jeunes. « Abandonnés à eux-mêmes, ces derniers se déplacent en bandes et font des dégâts partout où ils passent » (p 102). Talamo, le directeur du plan de rénovation, « pense résoudre le problème en créant un réseau d’écoles maternelles où les jeunes enfants seront accueillis jusqu’au retour de leurs parents, du travail, et de leurs frères et sœurs plus âgés, de l’école ». Il demande à Maria Montessori de coordonner et de diriger ce projet. Elle accepte à condition de disposer d’une liberté totale. « Elle veut transformer le défi de San Lorenzo en une occasion d’expérimenter ses idées sur des enfants qui n’ont encore jamais été en contact avec l’école… En l’absence d’argent, l’école n’est pas organisée comme une école traditionnelle. Pas d’estrade, pas de pupitres, pas d’institutrices qui appliquent les principes appris à l’école normale. Cette école sera d’une nouveauté absolue, où Maria pourra tout structurer à sa manière. Elle décide d’appliquer la leçon de Seguin aux enfants normaux et d’observer ce qui se passe » (p 104).
En l’espace de quelques semaines, elle met le projet sur pied en s’appuyant sur différents courants de la société romaine. Le 6 janvier 1907, Maria Montessori inaugure la première école qui accueille une cinquantaine d’enfants de deux à six ans. C’est un grand jour. Inspirée, Maria évoque une parole biblique : « Lève-toi, sois éclairée ; car ta lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se lève sur toi » (Esaïe 60.1). L’école est au rez-de-chaussée de l’immeuble. Elle est formée d’une grande pièce, de sanitaires et d’une cour. Au début, elle est aménagée avec des meubles de récupération… Très vite, Maria fait fabriquer des meubles adaptés à la taille des enfants. « Chaque détail est pensé pour leur autonomie ». « Une amie de Maria, invitée à visiter l’établissement s’est écrié avec enthousiasme : « Mais c’est la maison des enfants ». Ainsi, nait le nom qui, en quelques années, fera le tour du monde et évoquera, à tous, la méthode Montessori » (p 106).
« Maria choisit la fille de la concierge comme institutrice. Elle lui dit de se contenter d’observer et de lui rapporter chaque événement. Elle veut que, dans ce laboratoire pédagogique, tout se révèle de manière naturelle… Les enfants doivent avoir une liberté de mouvement totale… ». « S’appuyant sur l’observation et sur son instinct, elle identifie chaque fois un nouvel élément » (p 107). Ainsi, un jour présentant aux enfants un nouveau né paisible et silencieux, elle les invite à un exercice de silence qui devient un des rituels de la maison des enfants. « Maria Montessori n’élève jamais la voix, elle n’impose pas son autorité. Elle s’assied et attend que les enfants viennent vers elle. Elle répète qu’il faut tout respecter chez eux, y compris le fait que leur corps leur appartient. (p 108). « Dans la Maison des enfants, le corps n’est pas seulement respecté, mais valorisé. Les enfants peuvent déplacer les chaises et les tables tout seuls et aller et venir dans la classe comme bon leur semble. A l’époque, cette approche est révolutionnaire. Maria a l’intuition, confirmée un siècle plus tard, que le mouvement fait partie du processus d’apprentissage » (p 109).
Pour reproduire le matériel de Seguin, Maria Montessori doit trouver les bons artisans. « C’est la première fois qu’elle utilise le matériel didactique avec ces enfants normaux. Les enfants normaux, eux, travaillent seuls. Cette différence représente une première innovation fondamentale vis-à-vis de Seguin » (p 110). « Elle adopte une position proche de celle d’une observatrice extérieure. Cela lui permet de revoir l’ensemble, de repenser la manière d’interagir avec les enfants. Cette étape cruciale la conduira très loin de Seguin, à une nouvelle approche de l’esprit enfantin. Elle montre le matériel et son fonctionnement aux enfants, elle les laisse travailler, tout en les observant ou mieux, comme elle aime le dire, en méditant… Peu à peu, les éléments de sa future méthode prennent forme… deux éléments centraux apparaissent : la nature différente du maître, qui dirige sans s’imposer et la nature différente de l’enfant qui travaille sans se fatiguer (‘Étudier n’use pas, ne fatigue pas, au contraire cette activité nourrit et soutient’) » (p 111). Elle découvre certains aspects de l’activité enfantine comme le rangement. La vie quotidienne entre dans la classe comme l’hygiène et le repas.
Sans cesse, Maria Montessori observe les enfants. Une réalité lui apparaît ; « Elle sent que les enfants recèlent une énorme capacité d’attention qui se manifeste dès qu’on lui place un cadre pensé pour eux et non pour les adultes. Grace à cet état particulier de son esprit, l’enfant apprend de manière plus profonde et définitive ». (p 115). Dès lors, « le pivot fondamental de l’éducation consiste à aider l’enfant à révéler sa véritable nature habituellement enfouie parce qu’elle est opprimée par une école pensée pour les adultes » (p 115). De fait, les enfants travaillent naturellement pour apprendre. Cet apprentissage est actif et intense. Ainsi, lorsque les enfants sont placés dans un environnement adapté, « ils cessent en peu de temps d’être agités et bruyants et se transforment en personnes paisibles, calmes, heureuses de travailler » (p 136). Un siècle plus tard, nous dit l’auteur, les neurosciences « confirment ces observations en identifiant « des fonctions exécutives » : contrôle inhibiteur, mémoire de travail, flexibilité cognitive (p136). Placé dans de bonnes conditions, plus personne n’a besoin de forcer l’enfant à se concentrer en classe. « Quand vous avez résolu le problème de la concentration de l’enfant, vous avez résolu le problème de l’éducation en entier » (p 136). C’est la voie d’une « auto-éducation ». L’auteure met en évidence la conjugaison d’une approche scientifique et d’une approche spirituelle chez Maria Montessori : « Sa conception métaphysique de la vie passe directement dans son approche de l’enfant, être spirituel par excellence, mais aussi dans son attitude en classe. Quand elle est avec les enfants, elle semble être en méditation, observatrice attentive à toutes les surprises… » (p 137).
La réussite de la Maison des enfants est saluée dans la presse. Maria Montessori poursuit le mouvement en créant une deuxième Maison des enfants. Elle choisit une jeune maitresse à laquelle elle donne le nom de directrice. Car elle demande à celle-ci « d’enseigner peu, d’observer beaucoup, et, par dessus tout, de diriger les activités psychiques des enfants et leur développement physiologique » (p 119). Par ailleurs, ce mouvement pédagogique est aussi un mouvement social. Ces écoles « participent à la libération des femmes qui travaillent ».
Dans les premières maisons des enfants, Maria Montessori ne s’est pas préoccupée de la lecture et de l’écriture parce que ces enseignements ont lieu à l’école élémentaire. « Ce sont les enfants de San Lorenzo qui, au bout de quelques mois passés à travailler avec le matériel sensoriel, en demandent plus. Ayant grandi dans un environnement analphabète, ils sentent que les mots écrits sont une clé pour leur avenir » (p 121). Maria développe une initiative. Elle fabrique des lettres mobiles en papier émeri. L’enfant peut suivre la lettre rugueuse du doigt, et ce faisant, il apprend le geste de l’écriture avant même de savoir ce qu’il signifie » (p 122). Les enfants de San Lorenzo accueillent les lettres rugueuses avec enthousiasme. Ils aiment crier le nom de chaque lettre. Ils passent des journées entières sur les lettres en carton. « Ils y travaillent pensifs, concentrés, suivant de leur doigt les lignes rugueuses, murmurant les sons à voix basses, mettant les lettres côte à côte » (p 122). A Noël 1907, deux mois après le début du travail avec les lettres rugueuses, il advient à San Lorenzo l’événement que Maria Montessori baptisera « l’explosion de l’écriture ». Un enfant invité à dessiner une cheminée avec une craie, poursuivit soudain en écrivant un mot. Un grand enthousiasme personnel, puis collectif, accompagna cette prise de conscience. La lecture vint donc en second. Selon Maria Montessori, l’apprentissage précoce de l’écriture représente seulement la partie émergée d’un processus bien plus large : la mise en lumière de la capacité naturelle d’auto-éducation des enfants quand ils se trouvent dans l’environnement adapté ». « L’explosion de l’écriture attire l’attention du monde et transforme en quelques années le système appliqué dans un quartier pauvre de Rome en un phénomène planétaire » (p 126).
Réception et diffusion
Aujourd’hui, la pédagogie Montessori est largement connue. Encore relativement peu pratiquée, elle gagne du terrain et, pour beaucoup, elle est source d’inspiration. La biographie de Maria Montessori, réalisée par Christina de Stefano nous permet de comprendre comment cette pédagogie a pu émerger dans une culture au départ peu propice, à travers l’œuvre pionnière d’une personne qui a initié à la fois une nouvelle pratique éducative et une nouvelle vision de l’enfant. Cette innovation, en rupture avec la culture dominante, constitue une « invention » sociale. C’est l’invention montessorienne. A partir de la création de la Maison des enfants de San Lorenzo, la diffusion de l’innovation va se poursuivre et s’étendre dans le monde entier à travers la diffusion de la vision et de la méthode par Maria Montessori. Ce livre se poursuit en relatant la campagne engagée par Maria Montessori pendant des décennies jusqu’à son décès en 1952.
Après un compte-rendu approfondi des chapitres montrant l’émergence de la pédagogie Montessori, nous nous bornerons à donner un bref aperçu de la campagne pour sa promotion à laquelle l’auteure consacre une bonne partie de ce livre.
Au cours des années, Maria Montessori a rencontré et attiré un grand nombre de personnes. Si bien que la troisième partie du livre est intitulé : « Le premiers disciples ». Et ce fut le cas en Italie et très vite à l’international. L’auteure nous décrit les éducatrices qui se sont engagées avec une passion militante. Maria anime un réseau. Elle y sera ensuite accompagnée par son fils Mario avec lequel elle a pu renouer une relation maternelle à partir de 1913 (le fils retrouvé : p 178-181). D’année en année, de pays en pays, les rencontres de Maria témoignent du potentiel d’attraction de l’idéal montessorien. Maria Montessori développe une œuvre de formation. Elle suscite la production d’un matériel éducatif. Cette dernière activité engendre parfois des conflits d’intérêt. Selon l’auteur, la forte personnalité de Maria Montessori peut lui attirer des reproches d’autoritarisme.
Le livre retrace un parcours international. L’action de Maria Montessori s’est exercée en Italie, et, pendant un temps, en Catalogne. Sa vision se répand dans le monde entier et elle est particulièrement bien accueillie dans certains pays. Ce fut le cas aux Etats-Unis durant un long séjour en 1914-1915, et à l’autre bout, en Inde, où elle réside pendant plusieurs années durant la seconde guerre mondiale.
Dans la poursuite de son action, Maria Montessori s’adapte aux différents terrains. Ainsi composa-t-elle avec le fascisme italien à ses débuts. Elle s’est impliquée dans la religion catholique pendant des années tout en gardant une distance vis-à-vis des conservatismes. Elle entretient des relations avec des personnalités très variées quant à leurs convictions philosophiques et religieuses. Dans certaines situations, elle recherche et conjugue les appuis de milieux différents, de congrégations catholiques à une franc-maçonnerie progressiste. Son grand voyage en Inde a été sollicité par le courant théosophique.
« Avec le temps, la vision de Maria Montessori s’élargit de plus en plus. Il ne s’agit plus seulement de changer l’école, mais aussi la société et donc le monde » (p 295). « Pendant les années 1930, Maria Montessori cesse d’être seulement une éducatrice, quoique géniale et très en avance sur son temps, pour devenir philosophe. » (p 297). « C’est à cette époque qu’elle commence à évoquer le concept d’éducation cosmique – éduquer à une vision d’ensemble grandiose, où chaque homme est lié aux autres et à la planète entière – qu’elle développe dans la dernière phase de sa vie » (p 295). « Son côté mystique n’a pas disparu, tant s’en faut, depuis qu’elle a renoncé à chercher le soutien des autorités catholiques. Il trouve d’autres voies d’expression, plus personnelles et plus libres et converge toujours vers une vision extrêmement respectueuse de l’enfant » (p 296). Sa foi chrétienne est toujours là : « Nous dépendons de l’enfant ; toute notre personnalité vient de lui. Plus que cela, il s’agit, pour ceux qui peuvent le comprendre, d’une réalisation chrétienne, car la supernature de l’enfant nous guide vers le Royaume de cieux. Premier citoyen de ce royaume, il le fut seulement dans les lignes de l’Evangile, sans que cela pénètre l’esprit, la conscience des chrétiens » (p 312).
Durant les dernières années, après un long séjour en Inde où elle fut accueillie comme « la Grande Âme », (p 302-304), elle s’établit aux Pays-Bas où elle continue à répondre aux sollicitations en provenance du monde entier.
Jusqu’à son départ, Maria Montessori est toujours en mouvement. Sur tous les plans, elle traverse et dépasse les frontières comme dans sa réponse à une question dans laquelle on lui demandait quelle était sa patrie : « Mon pays est une étoile qui tourne autour du soleil et qui s’appelle la terre » (p 315).
Au terme de cette lecture, on constate combien l’auteure de cette biographie, Christina de Stefano a su nous restituer le parcours de Maria Montessori dans sa dynamique et sa complexité. Elle a bien tiré parti « d’une correspondance inédite et de témoignages directs ». Elle nous rapporte une œuvre géniale tout en gardant son esprit critique. Ce livre est ainsi un ouvrage de référence sur Maria Montessori. Et dans une succession de chapitres courts, il se lit d’un trait.
Cependant, ici, nous avons centré notre analyse : mieux comprendre l’émergence de la pédagogie montessorienne. Nous pouvons suivre effectivement une maturation. L’éclosion de la « Maison des enfants est précédée par la redécouverte de Seguin par Maria Montessori et par ses expériences auprès d’enfants déficients. Elle est la résultante d’un engagement social précoce et constant. Elle témoigne d’un esprit d’observation qui s’inscrit dans un parcours scientifique.
Cependant la Maison des enfants est une innovation qui tranche avec la réalité éducative de l’époque. On y voit le surgissement d’une pratique éducative nouvelle. Cette pratique est la conséquence directe d’une nouvelle représentation de l’enfant, le fruit d’un état d’esprit propice à l’émerveillement et empreint de bienveillance et de respect. Ainsi, dans ces premières années, nous assistons à une véritable invention sociale.
On assiste là à un changement de regard. Ce changement permet de découvrir la vraie nature de l’enfant. C’est une vision psychologique et une vision spirituelle. Apprenons à observer, apprenons à regarder, apprenons à nous émerveiller.
J H
- Christina di Stefano. Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants. Les Arènes, 2022.
- Et si nous éduquions nos enfants à la joie ? Pour un Printemps de l’éducation. https://vivreetesperer.com/et-si-nous-eduquions-nos-enfants-a-la-joie-pour-un-printemps-de-leducation/
- Maria Montessori. L’enfant. Ce livre, fréquemment réédité est une belle introduction à la pensée de Maria Montessori. Il fut pour nous comme une révélation
- La pédagogie Montessori : https://www.montessori-france.asso.fr/page/155447-la-pedagogie-montessori-une-aide-a-la-vie
- Pour une éducation nouvelle, vague après vague : https://vivreetesperer.com/pour-une-education-nouvelle-vague-apres-vague/ Libérer le potentiel du jeune enfant dans un environnement relationnel : https://vivreetesperer.com/liberer-le-potentiel-du-jeune-enfant-dans-un-environnement-relationnel/
- L’enfant : un être spirituel : https://vivreetesperer.com/lenfant-un-etre-spirituel/
- Éducation et spiritualité : https://vivreetesperer.com/education-et-spiritualite/
- Godly play : Une nouvelle approche de la catéchèse : https://www.temoins.com/godly-play-une-nouvelle-approche-de-la-catechese/
- Welcome to DoBeDo. Re-enchanting life through stories, relationship, playfulness and openness to change : https://www.do-be-do.org/
par jean | Sep 9, 2023 | Emergence écologique |
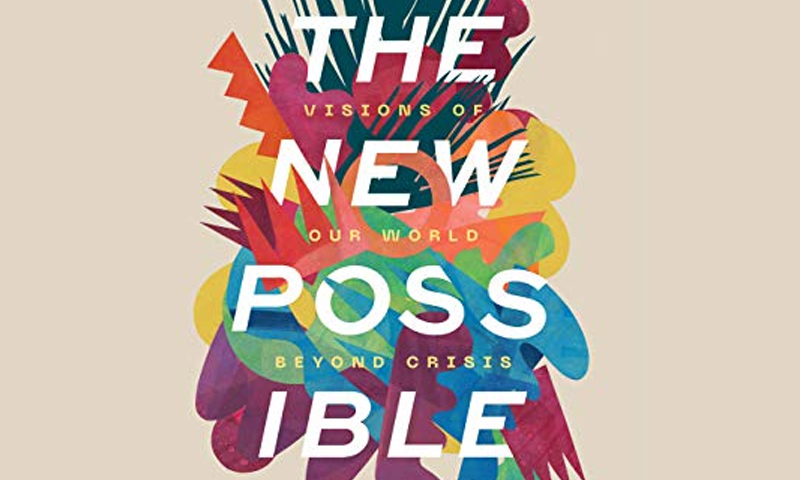
Selon Jeremy Lent
En 2020, l’effroi suscité par l’épidémie de Covid s’est allié aux appréhensions engendrées par d’autres menaces comme le dérèglement climatique. Aujourd’hui, une guerre vient s’ajouter au malheur du temps. Cependant, cette tourmente interpelle. Elle invite les chercheurs et les militants à imaginer et à promouvoir un monde nouveau.
C’est ainsi qu’en 2021, un recueil d’essais est paru aux États-Unis sous le titre : « The new possible » (« Le nouveau possible ») (1). Le sous-titre en précise le contenu : « Visions de notre monde au-delà de la crise ».
Cet ouvrage a été conçu dans le contexte américain, mais il est intéressant de constater qu’il ne se borne pas à mettre en cause de graves dysfonctionnements aux États-Unis, mais envisage les problèmes de beaucoup d’autres pays. Bien plus, le champ du livre s’étend au monde entier. Ainsi, plusieurs personnalités des peuples premiers sont appelées à s’exprimer. Ici convergent une réflexion sociologique et économique, des gestes militants et le recours à différentes traditions de sagesse. Le livre s’ordonne en plusieurs parties : la terre ; Nous ; le changement ; la richesse ; le travail ; la nourriture ; l’éducation ; l’amour ; la communauté, et il rassemble les contributions d’une trentaine d’auteurs.
Nous avons choisi de rapporter un des chapitres de ce livre : « Envisager une civilisation écologique » (« Envisioning an ecological civilization ». L’auteur, Jeremy Lent, a écrit plusieurs ouvrages de synthèse sur l’évolution de la culture humaine et la recherche de sens : « The patterning instinct. A cultural history of humanity. Search of meaning » et « The web of meaning. Integrating science and traditional wisdom to find our place in the universe ». Comment l’humanité a-t-elle évolué dans sa recherche de sens ? Quelle vision émerge aujourd’hui ?
Quitter le néolibéralisme
Jérémie Lent dresse un bilan des dégâts et des injustices engendrés par le néolibéralisme. Ainsi, aux États-Unis, les communautés pauvres ont été davantage atteintes mortellement par la pandémie que les communautés aisées. Il y a bien une origine au mal actuel. Depuis les années 1980, le néolibéralisme propage une conception dangereuse de l’homme selon laquelle « les hommes sont essentiellement individualistes, égoïstes, matérialistes et calculateurs. En conséquence, le capitalisme de marché serait le meilleur cadre pour les entreprises humaines » (p 4). « Le néolibéralisme est logiquement le résultat d’une conception de monde fondée sur la séparation : les gens sont séparés les uns des autres, les humains sont séparés de la nature, et la nature elle-même n’est plus qu’une ressource économique » (p 4).
Menace d’effondrement
Dans la recherche d’un progrès matériel, nous consommons les richesses de la nature plus vite qu’elle ne se reconstituent.
Notre civilisation fonctionne en « consommant 40% des ressources de la terre au-dessus du rythme soutenable » (p 4).
Transformer nos valeurs
Avec Jeremy Lent, faisons d’abord le point : « La description des êtres humains comme des individus égoïstes, la perception de la nature comme une ressource à exploiter, et l’idée que seule la technologie peut répondre à nos plus gros problèmes, voilà de profondes erreurs qui ont conduit notre civilisation vers un désastre »(p 5).
« Nous avons besoin de changer le fondement de notre civilisation : passer d’une civilisation fondée sur l’accumulation des richesses à une autre fondée sur la santé des systèmes vivants, une civilisation écologique » (p 6). Ce sera là une mutation majeure comparable aux deux grands bonds de l’humanité : la mutation agricole qui a commencé il y a 12 000 ans et la révolution scientifique du XVIIe siècle.
Une civilisation écologique
Jérémie Lent met en valeur la vertu de l’entraide. « Les systèmes vivants sont caractérisés à la fois par la compétition et la coopération.
Cependant, les transitions majeures de l’évolution qui ont amené la vie à son état actuel d’abondance, sont toutes le résultat d’un accroissement spectaculaire de la coopération. La clé de ces pas d’évolution – et du fonctionnement efficient de tous les écosystèmes – est la symbiose : le processus dans lequel les deux parties en relation donnent et reçoivent réciproquement… » (p 6). « Les contributions de chaque partie créent un ensemble plus grand que la somme des parties ». La symbiose permet aux écosystèmes de s’entretenir presque infiniment ». « L’interconnection de différents organismes en symbiose se manifeste dans un autre principe fondateur de la nature : l’harmonie ». « L’harmonie apparaît quand les différentes forces d’un système sont en équilibre » (p 6-7). Un tableau apparaît. « Chaque système dépend de la vitalité des autres ».
Cette constatation « nous amène à formuler un objectif ultime de la civilisation écologique : créer les conditions pour que tous les humains puissent fleurir comme une part d’une terre vivante et prospère. Jeremy Lent transpose le phénomène de la symbiose en termes humains : « les principes fondateurs de la justice et de l’équité ». Une civilisation écologique assurera « la promotion de la dignité humaine en fournissant les conditions pour permettre à chacun de vivre en sécurité et en bien-être ». Par ailleurs, la civilisation écologique reconnaitra la diversité dans tous ses registres. « Elle sera fondée sur l’axiome que le plein potentiel d’un système peut être réalisé seulement quand il est intégré – un état d’unité dans la différenciation où la prospérité de chaque constituant contribue au bien-être de l’ensemble » (p 7). Par-dessus tout, une civilisation écologique suscitera une symbiose englobant la société humaine et le monde naturel ».
La civilisation écologique en pratique
Entrer dans une civilisation écologique requiert une transformation fondamentale de l’économie. Entre autres, on passera d’une économie fondée sur la croissance perpétuelle du Produit National Brut à une société mettant l’accent sur la qualité de la vie en développant les indicateurs correspondants. Depuis le début du XIXe siècle, la plupart des économistes ont considéré deux domaines seulement de l’activité économique : les marchés et le gouvernement… Une civilisation écologique prendra en compte ces deux domaines, mais ajoutera deux secteurs : l’économie domestique et les communs. « En particulier, les communs deviendront une part centrale de l’activité économique (3) ». Jeremy Lent rapporte l’origine du terme : la terre partagée par les paysans en Angleterre. Mais dans un contexte plus large, « les communs comprennent toutes les sources de subsistances et de bien-être qui échappent à l’appropriation de la propriété privée et de l’état : l’air , l’eau, la lumière du soleil, et même les créations humaines comme le langage, les traditions culturelles et la connaissance scientifique » (p 8). C’est une richesse commune (« a shared human commonwealth » (p 9). On reconnaitra le droit de chaque être humain à participer à cette richesse commune. Jeremy Lent évoque ici « un revenu de base universel ». Les recherches en ce sens ont montré les aspects positifs d’une telle innovation. Dans cette transformation, quelle attitude vis-à-vis des grandes entreprises internationales ? Elles devront se soumettre à une charte écologique et sociale. La même approche écologique entrainera la transformation de l’agriculture et du tissu urbain. Jeremy Lent envisage également une transformation de la gouvernance vers « un modèle polycentrique où les décisions locales, régionales et globales seront prises aux niveaux où leurs effets se font le plus sentir » (p 10).
En marche
Si cette vision porte un idéal à atteindre, Jérémy Lent nous présente « les innombrables organisations pionnières à travers le monde qui plantent déjà les semences pour une civilisation affirmant la vie » (p 10). L’auteur cite des initiatives aux États-Unis, en Bolivie, en Espagne. Il montre « comment la vision écologique se répand à travers les institutions religieuses et culturelles établissant un terrain commun avec le traditions indigènes qui maintiennent leur connaissance et leur genre de vie pendant des millénaires ». Il évoque la « charte de la terre » initiée à La Haye en 2000 et adoptée depuis par plus de 2 000 organisations à travers le monde auxquelles se sont joints certains gouvernements. Et bien sûr, il cite l’encyclique ‘Laudato si’.
Sur le plan économique et politique, des organisations apparaissent telles que la « Wellbeing Economy Alliance » et la « Global Commons Alliance ». « Peut-être encore plus important, un mouvement populaire affirmant la vie se répand globalement ». (p 11)
Le livre : « The new possible » fait lui-même écho à la transformation en cours.
Ce texte de Jeremy Lent nous apporte une vue d’ensemble sur la mutation en cours. Il en esquisse le sens. De son point d’observation, il vient confirmer l’extension d’un mouvement écologique à travers le monde entier. Ce point de vue vient donc nous encourager et nous affermir.
J H
- Philip Clayton, Kellie M Archie, Jonah Sachs, Evan Steiner, ed. The new possible. Visions of our world beyond crisis. Wipf and Stock Publishers, 2021
- Voir le blog de Jeremy Lent, author and integrator : https://www.jeremylent.com/
- La promotion des communs apparaît récemment au cœur du livre de Gaël Giraud : Gaël Giraud. Composer le monde en commun, Seuil, 2022
par jean | Août 7, 2023 | ARTICLES, Emergence écologique |
Ecothéologie et pentecôtisme
 Dans la prise de conscience écologique, une nouvelle vision théologique est apparue au point de porter un nom : écothéologie. Michel Maxime Egger nous en a montré les différents visages (1). Nous savons aussi comment le théologien Jürgen Moltmann a sous-titré son livre : « Dieu dans la création » paru dès 1988 : « Traité écologique de la création » et poursuivi ensuite constamment son œuvre en ce domaine (2). En 2015, le pape François publie dans ce domaine une encyclique retentissante : « Laudato si’ » (3). Dans la dernière décennie, ce mouvement est également apparu dans le champs pentecôtiste, du moins chez certains théologiens anglophones. Sachant l’expansion actuelle du pentecôtisme dans le monde, ce fait est important d’autant que certaines manifestations politiques du pentecôtisme dans certains pays ont pu être contestées. A J Swoboda est pasteur et professeur de théologie, notamment à la faculté Fuller (4). Il se déclare un environnementaliste pentecôtiste : « Le soin porté à la création est un aspect intégral de l’œuvre relationnelle du Saint Esprit dans le monde » (5). A J Swoboda a écrit sur cette questions plusieurs livres qui font référence : « Tongues and trees. Towards a Pentcostal Ecological Theology » (6) ; « Introducing Evangelical Ecotheology. Foundations in Scripture, Theology, History and Praxis ». Aussi a-t-il édité un recueil d’écrits théologiques : « Blood cries out. Pentecostals, Ecology and the Groans of Creation » (Pentecostals, Peacemaking and Social Justice) (7).
Dans la prise de conscience écologique, une nouvelle vision théologique est apparue au point de porter un nom : écothéologie. Michel Maxime Egger nous en a montré les différents visages (1). Nous savons aussi comment le théologien Jürgen Moltmann a sous-titré son livre : « Dieu dans la création » paru dès 1988 : « Traité écologique de la création » et poursuivi ensuite constamment son œuvre en ce domaine (2). En 2015, le pape François publie dans ce domaine une encyclique retentissante : « Laudato si’ » (3). Dans la dernière décennie, ce mouvement est également apparu dans le champs pentecôtiste, du moins chez certains théologiens anglophones. Sachant l’expansion actuelle du pentecôtisme dans le monde, ce fait est important d’autant que certaines manifestations politiques du pentecôtisme dans certains pays ont pu être contestées. A J Swoboda est pasteur et professeur de théologie, notamment à la faculté Fuller (4). Il se déclare un environnementaliste pentecôtiste : « Le soin porté à la création est un aspect intégral de l’œuvre relationnelle du Saint Esprit dans le monde » (5). A J Swoboda a écrit sur cette questions plusieurs livres qui font référence : « Tongues and trees. Towards a Pentcostal Ecological Theology » (6) ; « Introducing Evangelical Ecotheology. Foundations in Scripture, Theology, History and Praxis ». Aussi a-t-il édité un recueil d’écrits théologiques : « Blood cries out. Pentecostals, Ecology and the Groans of Creation » (Pentecostals, Peacemaking and Social Justice) (7).
Le ‘Jour de la Terre’
L’instauration d’un ‘Jour de la Terre’ aux Etats-Unis en 1970, initiative suivie internationalement, témoigne d’une éclosion de la prise de conscience écologique. C’était un jour de méditation et d’action pour restaurer la relation humaine avec la terre. Le fondateur et le visionnaire du ‘jour de la Terre’ fut John McConnell Jr. Dans son livre : « Blood cries out », (7) A J Swoboda nous décrit cette personnalité dans son parcours spirituel, nous signifiant par là que la préoccupation écologique a pu être présente en quelqu’un fortement marquée par une inscription familiale pentecôtiste. Les parents de McConnell ont été membres fondateurs de la charte des assemblées de Dieu en 1914. Son propre grand-père fut même un participant au grand réveil de la Rue Azuza à Los Angeles en 1906. Ainsi le ‘Jour de la Terre’ a commencé avec de fortes convictions religieuses. McConnell ,voyant la crise écologique à travers sa culture religieuse, « envisageait un jour où les chrétiens pourraient montrer la puissance de la prière, la valeur de leur charité et leur préoccupation pratique pour la vie et les gens de la terre ». Ce rappel historique est une entrée en matière qui légitime une approche théologique pentecôtiste de l’écologie.
Univers écologique et univers pentecôtiste : tout est relation
Brandon Rhodes était étudiant à l’université d’Oregon (Etats-Unis) et il y fréquentait deux univers : l’écologie et le pentecôtisme (6). Dans la communauté pentecôtiste, il se voit proclamer l’importance de la relation : « Le Royaume de Dieu porte entièrement sur les relations ». A travers leur vie ensemble, les étudiants pentecôtistes « apprenaient à voir et à nommer l’œuvre de l’Esprit dans leur vie et dans leurs relations quotidiennes ». Cependant, dans ses études en écologie, Brandon Rhodes s’éveillait à « l’interconnexion de toutes choses, comme les champignons qui s’emploient à constituer un réseau relai entre les arbres de la forêt. Quand un feu, une sécheresse ou une tronçonneuse frappe un arbre, la forêt entière en frisonne de conscience. En écologie, la relation, c’est tout. Cette prise de conscience a profondément influencé la manière dont je voyais la terre ». « La Création brille de vie, de relation et déborde d’un saint mystère ». « Avec le temps, cette résonance entre l’écologie et le pentecôtisme me devint tout-à-fait évidente. Le Royaume de Dieu porte entièrement sur la relation et il en va de même pour l’écologie. Le royaume de Dieu dans l’Esprit est écologique et vice versa. Je le ressentais d’une manière palpable dans cet environnement verdoyant des montagnes de l’Oregon ».
A la recherche d’une rencontre entre la réflexion théologique et l’expérience
Brandon Rhodes constata pourtant que le pastorat pentecôtiste percevait rarement la connexion entre les deux approches, et plus généralement la valeur de l’écologie. Ce fut donc avec joie qu’il accueillit la parution du livre de A J Swoboda, un ouvrage qui établissait un pont par dessus la division entre écologie et pentecôtisme. Et, encore mieux, il rencontra l’auteur habitant dans le même voisinage. Le livre de Swoboda : « Tongues and trees : toward a pentecostal ecological theology » formule sa thèse de doctorat pour un public plus large. Cependant, Brandon Rhodes s’interroge sur le format académique qui peut donner l’impression que le message descend d’en haut vers des réalités sociales qui montent d’en bas. « Le défi majeur pour Swoboda est de transmettre des idées académiques de haut en bas vers une tribu à la base, celle de l’église pentecôtiste. A J Swoboda trace bien quelques pistes comme « imposer les mains à la terre pour sa guérison, ou bien prêcher des eschatologies créationnelles ». Mais Brandon Rhodes reste en partie sur sa faim.
« Un épilogue plus développé en terme de pratiques pentecôtistes, expériences écologiques, incursions liturgiques, comportements mystiques à l’intention de l’église locale aurait idéalement arrondi ce travail ».
Un témoignage et un parcours de recherche
Brandon Rhodes partage avec nous sa vision de foi. « Le pentecôtisme, ce n’est pas seulement une manière de prêcher, chanter, se rassembler et prier. C’est fondamentalement développer des cœurs ouverts à l’activité de l’Esprit. C’est une imagination active se demandant où Jésus peut être à l’œuvre à travers l’Esprit ».
« Cependant ce comportement pentecôtiste tourné vers l’Esprit refuse d’être commodément institutionnalisé, planifié, préemballé pour une consommation ecclésiale ».
« Swoboda semble appeler l’écothéologie à nourrir notre capacité de voir la création comme une arène où se montre la vie de Dieu. Si je le lis fidèlement en pentecôtiste, il désire nous amener à devenir des magiciens verts plutôt que des écothéologiens – des guides mystiques à même de nous faire voir la magie dont ce monde est abreuvé par le Saint Esprit. L’Esprit holistique, baptisant la création, vers où « Tongues and Trees » dirige le pentecôtisme, est vivant et actif dans le monde ». Brandon Rhodes nous appelle « à avoir des yeux pour le voir et à répondre dans la repentance ».
Aperçus
Suite à son analyse, Brandon Rhodes présente un résumé détaillé du livre : « Tongues and Trees ». En voici quelques extraits.
Swoboda présente les apports des différentes dénominations à l’écothéologie. En ce qui concerne le pentecôtisme, il perçoit certaines dispositions favorables. « D’abord, le pentecôtisme met l’accent sur ce que Miroslav Wolf appelle : « la matérialité du salut » ce qui historiquement s’est prêté à une attention pour des questions de justice sociale – une disposition qui s’ouvre tout naturellement à honorer le monde matériel et, dans de nombreux cas, là où la dégradation écologique accroit les injustices existantes. Deuxièmement, l’accent pentecôtiste sur l’Esprit se prête au témoignage biblique de l’Esprit de Dieu vivifiant et même baptisant toute la création. Ainsi nous devons attendre les charismes non seulement de l’église charismatique, mais du reste du royaume de la création.
Swoboda résume son bilan des écothéologies charismatiques en deux points majeurs : « D’abord si l’Esprit de Dieu crée et vit dans la création et le peuple de Dieu, les deux sont en voie de restauration à la relationalité. La relationalité est la force même de la théologie et de la pratique pentecôtiste. Ultimement, c’est la force des théologies Esprit/création. L’accent pentecôtiste sur une église interconnectée – par – l’Esprit, nous enjoint de joindre la ‘conversation’. J’ai trouvé dans mon enseignement de l’écologie l’interconnexion de la terre elle-même. Deuxièmement, Swoboda conclut de cette recherche que notre tâche future est de nourrir une imagination pneumatologique concernant le « care » écologique.
Le développement de l’approche écologique transforme notre vision du monde. Elle nous incite à considérer qu’il y plus grand que nous et que nous nous inscrivons dans un tissu de relations. Cette vision nous invite à entrer dans une vision spirituelle où la Pentecôte apparaît comme une figure privilégiée. On comprend qu’un théologien pentecôtiste assume l’approche écologique en espérant que cette attitude se répande dans sa dénomination comme elle s’étend dans d’autres églises.
Rapporté par J H
- Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
- Dieu dans la création : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
- Convergences écologiques :Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François et Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
- A J Swoboda Ph D : https://www.bushnell.edu/faculty/a-j-swoboda/
- A J Swoboda : I am a pentecostal environmentalist : https://faithandleadership.com/aj-swoboda-im-pentecostal-environmentalist
- Book Review, Tongues and trees. Toward a pentecostal ecological theology : https://christandcascadia.com/2014/08/01/book-review-tongues-and-trees-toward-a-pentecostal-ecological-theology/
- A J Swoboda. Blood cries out : https://www.amazon.com/Blood-Cries-Out-Pentecostals-Peacemaking/dp/1625644620
par jean | Août 7, 2023 | Emergence écologique |
Découvrir les merveilles de la forêt à travers un esprit de découverte alliant un savoir ancestral aux découvertes scientifiques les plus récentes
La voix des arbres
Par Diana Beresford-Kroeger
 Nous entrons aujourd’hui dans la découverte de merveilles du monde vivant jusque là inconnues. Ainsi, nous portons un regard nouveau sur les animaux, et plus récemment encore sur les végétaux, en particulier le monde de la forêt (1). Certaines personnes peuvent particulièrement nous en entretenir, car, elles-mêmes, sont engagées avec passion dans un chemin de découverte. C’est le cas de Diana Beresford-Kroeger, auteure d’un livre : « To speak for the Tree », traduit et publié en français sous le titre : « La voix des arbres. Une vie au service des arbres, du savoir des druides aux plus récentes découverts de la botanique » (2). Cette œuvre est le fruit d’un parcours original qui nous est résumé ainsi : « Une jeune orpheline en Irlande dans les années 1950 que les femmes de la vallée de Lisheens ont prise sous leurs ailes pour lui transmettre un savoir ancestral. Un esprit brillant, une scientifique accomplie, à la double compétence en biochimie médicale et en botanique. Une amoureuse passionnée de la forêt. Diana Beresford-Kroger est tout cela à la fois, et son itinéraire résolument atypique l’amène à opérer la synthèse de son héritage celte et des connaissances scientifiques actuelles pour réconcilier l’homme et la forêt. Depuis des années, elle consacre toute son énergie à préserver la biodiversité forestière, aussi bien en apportant sa caution scientifique à différentes luttes que dans l’espace de son arboretum canadien ,où elle s’acharne à regrouper et à hybrider des espèces particulièrement adaptées au changement climatique… » (page de couverture).
Nous entrons aujourd’hui dans la découverte de merveilles du monde vivant jusque là inconnues. Ainsi, nous portons un regard nouveau sur les animaux, et plus récemment encore sur les végétaux, en particulier le monde de la forêt (1). Certaines personnes peuvent particulièrement nous en entretenir, car, elles-mêmes, sont engagées avec passion dans un chemin de découverte. C’est le cas de Diana Beresford-Kroeger, auteure d’un livre : « To speak for the Tree », traduit et publié en français sous le titre : « La voix des arbres. Une vie au service des arbres, du savoir des druides aux plus récentes découverts de la botanique » (2). Cette œuvre est le fruit d’un parcours original qui nous est résumé ainsi : « Une jeune orpheline en Irlande dans les années 1950 que les femmes de la vallée de Lisheens ont prise sous leurs ailes pour lui transmettre un savoir ancestral. Un esprit brillant, une scientifique accomplie, à la double compétence en biochimie médicale et en botanique. Une amoureuse passionnée de la forêt. Diana Beresford-Kroger est tout cela à la fois, et son itinéraire résolument atypique l’amène à opérer la synthèse de son héritage celte et des connaissances scientifiques actuelles pour réconcilier l’homme et la forêt. Depuis des années, elle consacre toute son énergie à préserver la biodiversité forestière, aussi bien en apportant sa caution scientifique à différentes luttes que dans l’espace de son arboretum canadien ,où elle s’acharne à regrouper et à hybrider des espèces particulièrement adaptées au changement climatique… » (page de couverture).
Harmonie celte. La vallée de Lisheens
Diana a eu un père anglais et une mère irlandaise. Son père et sa mère se séparent. A l’âge de 12 ans, Dina perd sa mère dans un accident. Elle se retrouve seule, orpheline. Elle échappe à la menace, enfermée dans un pensionnat de mauvaise réputation, car un oncle accepte de la prendre sous sa responsabilité jusqu’à sa majorité à 21 ans. La relation avec celui-ci ira en s’améliorant dans le temps. Adolescente, elle bénéficie de la grande bibliothèque de son oncle et une conversation s’établit avec lui. Par ailleurs, sa réputation scolaire va croissante. A la fin de ses études secondaires, elle entrera à l’université. Cependant, Diana fait état des souffrances, de la solitude et de la peur, qui ont marqué ses jeunes années. En contre point, les vacances d’été qu’elle a passées dans la vallée de Lisheens ont été pour elle une planche de salut, car non seulement elle y a trouvé une chaleur affective, mais elle y a accédé à une sagesse, la sagesse celte encore présente dans le refuge de cette vallée.
« Aujourd’hui encore, Liesheens tient un place unique dans le paysage de mon esprit. Une générosité presque tangible y imprégnait l’atmosphère. J’ai eu la chance d’en bénéficier pendant le temps que j’ai passé là-bas avec Nellie (sa grand-tante) et Pat. En matière d’hospitalité, les lois (celtes) des brehons s’appliquaient toujours avec la même vigueur, or, en vertu de ces lois, en tant qu’orpheline, je devenais enfant de tous. Même le plus pauvre des pauvres se devait de me donner quelque chose… Après la mort de mes parents, mes liens avec les habitants de la vallée sont devenus plus profonds. Les gens me regardaient différemment. Ils me saluaient avec une chaleur qui me faisait monter les larmes aux yeux » (p 36-37).
« Pendant mon enfance, cette vallée rurale était peut-être le site le plus riche et le mieux conservé de la culture celte dans tout le pays (p 38). Diana en décrit différents aspects : les artefacts en pierre, l’alphabet ogham, la langue gaélique. « D’habitude, le transfert de savoir d’une génération à l’autre n’avait lieu que dans le cadre de la famille ». Ici, on fit une exception pour Diana. Elle apprit par la voix douce de sa tante le projet de lui donner une éducation celte. « Elle m’a expliqué que j’allais bénéficier de ce qu’elle appelait « une tutelle brehonne », un arrangement grâce auquel on m’enseignerait tout ce que je devais savoir pour être autonome en tant que jeune fille, bientôt femme. J’aurais de nombreux professeurs qui m’enverraient chercher le moment venu. Elle serait la première et nos leçons devaient commencer sur le champ » (p 41).
Effectivement, Nellie emmena Diana dans des chemins et dans des lieux où poussaient de multiples plantes et de multiples fleurs. Elle cueillit une feuille parmi bien d’autres et la présenta à Diana en lui demandant de la sentir, de la mémoriser et en l’appelant par son nom. Elle poursuivit son instruction en lui présentant une plante médicinale « Il s’agit d’un remède important pour de nombreux maux. On s’en sert pour guérir les rhumes en hiver et pour éloigner les insectes ou traiter les piqûres en été. C’est une herbe très ancienne qu’on utilisait il y a bien longtemps dans les cérémonies et dont les propriétés sont puissantes… Elle passa à une autre plante avant de se lancer dans l’exposé de ses propriétés médicinales. C’est ainsi que s’est déroulée une promenade pharmaceutique… » (p 42). Déconcertée au départ, Diana s’est mise à apprendre petit à petit. « Entre les leçons de Nellie, ou à l’occasion celles de Pat, s’intercalaient d’autres leçons avec des professeurs répartis dans toute la vallée. L’effectif final dépassait les vingt personnes et l’infirmière, Madame Creedon, qui connaissait tout le monde à l’entour, était la grande organisatrice de mon planning » (p 43). Les leçons portaient sur différents sujets : poésie, propriétés des ‘simples’, compétences pratiques, psychologie de la vie quotidienne, méditation celte par le silence… Et puis, il y avait l’école de la vue : une relation heureuse avec les animaux de la ferme, et parfois un conseil thérapeutique comme celui qui lui permit de se débarrasser de verrues. Diana recevait des leçons très variées. « Ce n’est qu’en grandissant que certaines leçons ont pris un sens renouvelé pour des raisons diverses. Les unes m’ont appris des vérités profondes sur moi-même, des compétences et des manières d’approcher le monde qui m’ont propulsée vers mes plus grandes réussites. D’autres m’ont montré qu’on pouvait avoir un vision plus globale de la nature… » (p 63). En apprenant l’alphabet oghamique, Diana a découvert que la plupart des lettres portaient le nom d’un arbre. Dans la deuxième parie de son livre, elle entreprend une description des arbres et de leurs qualités en se référant aux lettres de cet alphabet.
« A la fin de la troisième année d’enseignement, Nellie m’a emmenée au cabinet de l’infirmière… Quand nous sommes arrivés, il y avait là tous les gens de la vallée qui avaient contribué à mon éducation au cours de ma tutelle. C’était une cérémonie de fin d’études. Au milieu de la salle et de toutes ces vieilles personnes chères à mon cœur, je me suis sentie enveloppée d’amour, baignée dans une chaleur inouïe. J’étais capable de tout réussir, une certitude dont j’aurais besoin plus tard. Mary Cronin était là pour mettre un point final à ma tutelle en se penchant sur mon avenir. Mary était la prophétesse locale. Le don de clairvoyance se transmettait dans sa famille… A la fin, elle ouvrit les bras pour englober toute la salle et j’ai compris qu’elle m’indiquait ainsi que ces derniers mots venaient de tous les présents, de toute la vallée et de la tradition celte. « Diana, tu as reçu une charge sacrée », a-t-elle dit d’une voix brisée par l’émotion. « Nous sommes vieilles, nous ne vivrons pas éternellement. A notre mort, tu seras la dernière voix de l’ancienne Irlande. Il n’y en aura plus après toi » (p 84).
Une recherche intégrative
Une approche interdisciplinaire prenant en compte les savoirs ancestraux
Scolairement excellente, après ses études secondaires, Diana est entrée à l’Université de Cork. Elle a opté « pour un double cursus en biochimie médicale et en botanique ». Et très vite, elle exprime un grand enthousiasme pour des découvertes qui traduisent un lien entre les savoirs reçus dans son éducation celte et les connaissances botaniques. « Mon deuxième TD de Botanique portait sur Chondras crispus, une algue rouge connue sous le nom de « mousse d’Irlande ». La voir là sur la table du labo, c’était comme tomber sur un vieil ami dans un nouveau décor. Ma grand-tante Nellie m’avait parlé de cette algue à Lisheens… Elle m’avait appris qu’au temps de la grande Famine, au milieu du XIXe siècle, les gens étaient particulièrement exposés à la tuberculose à cause de la malnutrition. Chondras crispus, disait-elle, recelait le remède à ce mal. Il fallait arracher la plante du rocher et la faire bouillir entière, et elle libérait alors un mucilage visqueux aux puissantes vertus curatives efficaces dans le traitement de la tuberculose… En disséquant l’algue, j’ai constaté qu’elle contenait effectivement du mucilage. A la fin du TD, je me suis précipité à la bibliothèque de médecine. Et j’y ai appris que la substance gélatineuse issue du Chondras crispus avait de puissantes propriétés antibiotiques… » (p 89-90).
Ce fut là le premier croisement entre les savoirs reçus par Diana dans la vallée celte et son enseignement universitaire. Et cela a compté pour elle. « Il est difficile de décrire le sentiment que m’a procuré la confirmation des enseignements de Nellie. J’aimais beaucoup mes professeurs de Lisheens, mais je n’avais pas totalement exclu l’idée qu’ils m’avaient transmis de vieilles superstitions. J’avais besoin de vérifier par moi-même ce qu’ils m’avaient appris… Lire dans un volume de la faculté de médecine que Chondras crispus contenait bel et bien des actifs que Nellie avait évoqués, après avoir moi-même tiré de cette algue la substance dont elle m’avait parlé, voilà qui constituait la première preuve irréfutable que les leçons dispensées pendant ma tutelle étaient fondées sur des faits. J’en tirai du soulagement, un sentiment d’accomplissement et la joie que l’on éprouve face à la vérité de la nature ». Diana a compris là quelle serait sa mission. « Le savoir que j’avais reçu à Lisheens se transmettait oralement. Il n’existait sous aucune autre forme. Or, dans la bibliothèque de médecine, je retrouvais ces mêmes connaissances, obtenues et présentées de manière totalement différente, puisque consignées dans un livre. A cet instant, j’ai compris que je pouvais servir de pont entre ces deux mondes, celui de mes ancêtres et le monde scientifique. Cette prise de conscience extrêmement motivante me donna envie de mettre à l’épreuve tout ce qu’on m’avait enseigné à Lisheens (p 91).
Diana s’est donc engagée, au fur et à mesure, dans cette recherche. « Mon double cursus m’a équipée de l’association idéale pour éprouver les connaissances de Lisheens. J’ai pu très tôt déceler les liens entre le monde médical et le monde botanique » (p 92). Diana s’est intéressé aux propriétés biochimiques des plantes et elle a établi un lien avec ses nouvelles connaissances en biochimie humaine. Elle a poursuivi ensuite son approche intégrative expérimentée lors de son premier cycle universitaire. « Le modèle de recherche grossier que j’ai créé pour moi-même au premier cycle est celui dont je me suis servi pendant toute ma carrière universitaire. Les sources de connaissance sur lesquelles il est fondé – les savoirs celtiques ancestraux, la botanique classique et la biochimie médicale – ont façonné ma pensée. Quand j’étudie une plante, mon esprit a tendance à travailler dans deux directions à la fois. A partir de ma compréhension du végétal, je vais vers le corps humain, et à partir de ma compréhension du corps humain, je vais vers le végétal. Je n’ai jamais échoué à trouver un ou plusieurs points où se rejoignent ces deux directions. Chaque plante est intimement liée aux êtres humains et à notre santé. Les gens de Lisheens le savaient aussi bien que d’autres choses encore. De ces toutes premières recherches jusqu’à aujourd’hui, j’ai pu confirmer scientifiquement presque tout ce qu’ils m’ont enseigné lors de ma tutelle. La seule chose qui ait échappé à mon entendement, c’est la télépathie, ces liens invisibles dont ils m’ont dit qu’ils existaient entre les esprits humains. Je travaille encore dessus » (p 93).
Diana réussit brillamment son premier cycle universitaire et elle se pose alors la question de son orientation. Elle en a envisagé deux : « poursuivre vers un diplôme de médecine – la suite logique de ma formation de biochimie – ou passer en maitrise » (p 98). Finalement, « elle a opté pour un master dans la continuité de ses études de biochimie et de botanique. C’était la voie qui m’offrait la vision et la compréhension les plus larges possibles du monde naturel. Mon sujet de recherche portait sur les hormones qui régulent les plantes et sur la résistance au gel de toutes les espèces… Je voulais comprendre les limites du monde végétal et l’une des clés pour cela consistait à comprendre l’action régulatrice des hormones chez les plantes ». Diana développait une vision globale : « La biochimie de l’humanité liée à celle des arbres et des plantes, ce qu’on pouvait voir dans les hormones ». Et, de même, elle a pris connaissance du processus de la photosynthèse et de son rôle crucial dans le maintien de l’équilibre climatique. « Que se passerait-il si les plantes – disons les forêts – disparaissaient de la planète ? La réponse est évidente : la vie s’éteindrait » (p 102-103). Dans les serres de l’université, « Diana a mesuré la taille, la croissance et les proportions d’un vaste éventail d’espèces placées dans différentes conditions environnementales. Elle examinait le plus largement possible la façon dont les plantes réagissent aux modifications de leur environnement… » (p 101). Ces premières recherches terminées en 1965, « ont permis d’identifier des caractéristiques permettant de déterminer les espèces les mieux équipées pour survivre dans un monde en transformation. J’ai moi-même suivi ce guide pour sélectionner et sauvegarder des espèces patrimoniales de plantes et d’arbres rares sur la ferme que j’habite aujourd’hui » (p 105).
Les excellents résultats universitaires de Diana lui permettaient de postuler à de nombreux postes. Elle a accepté une bourse fédérale américaine pour étudier la chimie nucléaire sur le campus de Storrs, université du Connecticut. Ella a choisi ensuite pour son doctorat l’Université Carleton à Ottawa au Canada. Le champ d’étude serait les hormones chez les plantes. « Me basant sur ma compréhension préexistante de la biochimie médicale, j’ai élargi mon champ d’investigation au delà de la botanique et comparé la fonction des hormones chez les plantes et les êtres humains. L’action de ces substances avaient été étudiées chez les hommes, mais leur existence chez les arbres n’était pas connue… J’ai prouvé que ces voies métaboliques existaient chez les plantes, plus chez certaines que chez d’autres, et surtout chez les arbres » (p 211). Ainsi, selon Diana, « les arbres contiennent les mêmes substances que notre cerveau ». Après avoir obtenu son doctorat, Diana a travaillé dans une ferme expérimentale, puis à la faculté de médecine d’Ottawa.
L’itinéraire professionnel de Diana a donc été riche et fécond. Et néanmoins, elle a du « faire face aux frustrations familières à toute femme tentant de s’imposer au milieu professionnel dans les années 1970 et 1980 » (p 115). Cependant elle va s’installer définitivement au Canada. Elle se dit « redevable aux peuples autochtones d’Amérique du Nord qui, globalement, ont gardé intact le continent » ; à son arrivée, le Canada lui est apparu comme « un pays d’une grande beauté où l’eau était abondante… Ici le système botanique était phénoménal. J’avais envie de crier au monde que ce pays était fabuleux… » (p 110). C’est là, dans une soirée à Carleton qu’elle rencontre celui qui va devenir son mari Christian Kroeger. « Nous sommes sortis ensemble, nous avons acheté un terrain, nous nous sommes mariés et nous nous sommes mis au travail, marteau en main, pour construire cette ferme où nous vivons maintenant depuis plus de quarante ans » (p 114).
La voix des arbres et des forêts
Diana va s’installer dans ce lieu et, avec Christian, elle va y réaliser un nouvel écosystème en partant à la recherche d’espèces en voie de disparition pour les accueillir dans cet ensemble. En se libérant de ses contraintes professionnelles, elle va consacrer à cette tâche toute son énergie. « Arrivée à un point où je ne supportais plus la situation à mon travail, je suis rentrée et j’ai dit à Christian que j’en avais assez des brimades, du harcèlement sexuel et de la mesquinerie typique des sciences à l’université. Nous avions déjà construit une maison, et planté des jardins et un verger » (p 115).
Lors de son mariage avec Christian en 1974, Diana s’était vu offrir par ses collègues les fruitiers rustiques qu’elle avait sollicité. Pour le développent du jardin potager, elle avait recours à « un large éventail de semences patrimoniales. « Quand nous avions tous les deux un peu de temps libre, nous nous lancions dans des expéditions pour dénicher des plantes locales dans l’est de l’Ontario… Je voulais des arbres aussi proches que possibles de la forêt primaire. ». Ils recherchaient tout particulièrement les lieux sauvages qui avaient ainsi échappé à l’éradication systématique des colons. « C’est là qu’on trouvait encore des arbres indigènes de qualité ». « Quand Christian et moi cherchions des fruitiers à ajouter à notre verger, nous nous mettions en quête de vestiges de ferme dans des secteurs inhabités identifiés comme des terres agricoles sur de vieilles cartes et toutes mes roses proviennent de boutures prélevées dans des cimetières oubliés… j’ai également créé mon allée de ‘simples’ perdus d’Amérique du Nord. La philosophie biochimique qui préside à ce secteur du jardin est basée sur les aérosols, ou composés organiques volatils, libérés par les plantes, fondement scientifique de bon nombre de vieux remèdes autochtones. Leurs propriétés curatives m’intéressent particulièrement en tant que scientifique… » (p 123).
Diana et Christian ont parlé avec de vieux fermiers. Ils sont partis à la recherche d’espèces d’arbres perdues de vue.
« Toutes les Premières nations connaissaient le Prela trifoliata et s’en servaient dans leur médecine traditionnelle. Cet arbre contient un actif synergique qui stimule les principaux organes et augmente leur métabolisme… » (p 126). Elle a entamé une enquête pour le retrouver. Pas de réponse. « Cet arbre avait autrefois une immense valeur et je pense qu’il pouvait toujours en avoir une pour l’avenir, mais au lieu de cette puissance positive, capable de soigner, nous avons une soustraction, un trou en forme d’arbre – et du remède qui allait avec » (p 127). Cinq ans plus tard, dans une invitation au Texas, Diana a rencontré une riche personne qui possédait des terres au Nouveau Mexique, et notamment des terres rocailleuses. Or Prelea pousse dans la rocaille. Diana lui demanda donc si on pouvait trouver un Prelea dans son domaine. Et finalement, à la grand joie de Diana, on en a effectivement trouvé un au Nouveau Mexique.
Avec son mari, Diana est parvenu à développer un écosytéme bien pensé et bien géré. « Je peux dire aujourd’hui que l’intégralité de nos soixante-cinq hectares est pensée de façon à encourager la vie. Les haies que nous avons plantées en périphérie attirent des oiseaux et des insectes qui trouvent amplement de quoi se nourrir et se loger quand ils arrivent, ainsi qu’un répit face à l’offensive chimique qu’ils subissent presque partout ailleurs. Des détails tels que l’emplacement des nichoirs sur notre promenade des Merles bleus ou la décision de laisser les pics maculés tranquilles, s’inscrivent dans une démarche cohérente. En contemplant le tout, on pourrait facilement croire qu’un plan unique a présidé à l’aménagement de notre ferme. Ce n’est pas faux. Dès le début, le plan consistait à tendre vers le plan inhérent de la nature… J’ai commencé à sauver des espèces parce que je les estimais trop importantes pour qu’on les laisse disparaitre. Quand j’ai choisi d’insister sur les résistances au gel et à la sécheresse, c’est parce que le travail fait pendant mon master m’avait convaincu que la déforestation mènerait tout droit au changement climatique » (p 137).
Un jour, Diana a pris conscience de l’originalité de ce processus. « Un matin, je me suis réveillée devant le spectacle d’un cardinal rouge qui me fixait depuis une branche de l’abricotier couvert de fleurs roses en étoile. J’ai alors vécu un instant d’harmonie, ou j’ai mesuré pour la première fois tout ce que j’avais construit en partenariat avec le monde naturel… J’ai inventé le terme « bioplanification » pour décrire ma démarche… Le « bioplan » est un « schéma directeur de toute l’interconnexion de la vie dans la nature ». C’est la toile visible et invisible qui relie le saule au pic maculé, au papillon, à l’ichneumon, et qui les relie tous à nous… La bioplanification, c’est l’acte de faciliter et d’encourager le bioplan. Dans un jardin ou sur une ferme, cela implique de réaligner le jardin pour faciliter son utilisation comme habitat naturel » (p 138).
Comme nous avons pu nous en rendre compte jusqu’ici, Diana accorde une grande importance aux arbres. Elle en connaît les vertus. Face au changement climatique, elle proclame l’importance des forêts (p 140-141). Diana consacre un chapitre à ce qu’elle appelle l’arbre mère. Elle évoque là de grands arbres qui entretiennent tout un écosystème, des oiseaux qui viennent se poser dans leurs branches jusqu’aux plantes qui poussent à l’ombre de leur feuillage. « Ce sont des points focaux d’activité et de vitalité… Les arbres mères sont des individus dominants dans n’importe quel système forestier. Ils produisent acides aminés, acides gras, protéines végétales et sucres complexes qui nourrissent le monde naturel… Bon nombre d’arbres mères protègent le sol qu’ils occupent en produisant un arsenal de composés allélochimiques qui, dès le printemps, se déversent automatiquement dans la terre. Cela permet à l’arbre de préparer son propre terrain à recevoir les minéraux dont il a besoin. L’arbre mère adulte diffuse dans l’air qui l’entoure des aérosols incitatifs ou dissuasifs. Il peut nourrir et protéger d’autres individus sous sa canopée. Il est un des meneurs de cette communauté que nous appelons forêt, et partout sur terre, les forêts représentent la vie » (p 149).
Un engagement
La vie de Diana se manifeste dans la recherche et dans l’expérimentation, mais aussi dans la promotion d’une vision et dans une action militante. Elle intervient pour protéger la forêt. Elle rend hommage à ceux qui en prennent soin. Ainsi raconte-t-elle comment dans un colloque consacré à la forêt, elle a fait l’éloge des peuples autochtones du Canada, des Premières Nations (p 154).
Cet engagement s’inscrit dans une vision spirituelle.
« J’ai eu la chance immense de naître juste à temps pour recevoir une instruction celtique… C’est armée de cette vision spirituelle de la nature que je suis entrée dans les cercles universitaires et j’ai découvert qu’elle n’y était pas la bienvenue. On m’a dit que la science et le sacré ne faisait pas bon ménage. Chez les universitaires, un scientifique n’est pas censé se fier au savoir des cultures autochtones. C’est cette attitude, entre autres, qui m’a éloignée des institutions scientifiques et éducatives et poussée dans la marge ; j’y ai œuvré de longues années avant de trouver un public avec qui partager ce que j’avais appris, ce que j’avais toujours su et ce que j’avais à dire. A présent, toutefois, je sais que cette foi dans la valeur spirituelle et scientifique des forêts n’est pas condamnée à rester à la marge de notre culture. Un mouvement de masse peut naître… » (p 160).
Ainsi, le livre de Diana s’achève par une vision mobilisatrice. « Une divinité que nous comprenons tous se manifeste dans la nature. Quand on marche en forêt, qu’elle soit petite ou grande, on arrive dans un certain état d’esprit et on en ressort plus calme. On a cette sensation d’arpenter une cathédrale, et on n’est plus jamais le même. On sort du bois en sachant qu’il nous est arrivé quelque chose de plus grand. La science nous permet d’expliquer en partie cette expérience sacrée. Nous savons à présent que les alpha – et le bêta – pinènes produits par la forêt améliorent l’humeur et affectent le cerveau à travers le système immunitaire, que les pinènes libérés dans l’air par les arbres sont absorbés par notre corps, qu’ils nous recentrent et nous inspirent de la pitié par rapport à ceux que nous voyons. Une simple marche en forêt agit comme des vacances sur l’esprit et sur l’âme, et permet à votre imagination et à votre créativité de fleurir. A mon sens, c’est un miracle et il nous reste tant d’autres miracles à découvrir. Nous éprouverons la joie de ces miracles. Nous sauverons les forêts et notre planète… » (p 164).
Un livre original
Ce livre nous présente un parcours particulièrement original puisque, pour une part essentielle, il témoigne du passage d’une civilisation traditionnelle à la culture moderne. La civilisation celte nous apparaît aujourd’hui comme une grande civilisation. Elle a même réussi à se maintenir pendant de siècles à l’ouest de l’Europe. Diana Beresford-Kroeger a pu en recueillir la substance avant qu’elle ne disparaisse sous la pression de la culture scientifico-technique occidentale. Cette dernière cependant entre aujourd’hui dans une crise profonde, parce que ses dérives ont entrainé et entrainent de redoutables dérèglements. Si un courant se lève pour promouvoir un âge de vivant, il se heurte aux crispations de la culture moderne individualiste et à une mentalité technico scientifique analytique et réductionniste. La philosophe Corinne Pelluchon exprime clairement cette réalité : « Le potentiel de destruction attaché au rationalisme moderne doit être examiné ave la plus grande attention… Dans les dérives, Corinne Pelluchon envisage une raison se réduisant à une rationalité instrumentale, oubliant d’accorder attention à la dimension des fins : « ce qui vaut », et un dualisme séparant l’humain du vivant » (3).
De fait, l’approche écologique présente une dimension holistique. Les conceptions du monde qui prévalent dans de nombreuses sociétés, non occidentales, ne s’alignent pas sur la pensée mécaniste qui s’attarde en Occident. A cet égard, le parcours de Diana Beresford-Kroeger est extraordinairement éclairant. En effet, elle nous prouve la validité et la consistance de savoirs ancestraux fondés sur une expérience collective de longue durée et elle nous invite à reconnaître des valeurs spirituelles et éthiques en phase avec une recherche de sens renouvelée. On pourrait croiser cette approche avec celle de certains anthropologues.
Cependant, l’apport de Diana montre également l’efficacité et l’utilité de disciplines scientifiques comme la biochimie et, bien sur, la botanique. Et aujourd’hui, le scientisme est en recul. Comme le montre Vinciane Despret dans son livre : « Le loup habitera avec l’agneau » (4), aujourd’hui, en éthologie, le méthodologies rigides sont contestées. Pionnière de la recherche sur les chimpanzés, Jane Goodhall s’est distinguée par son ouverture, sa reconnaissance du vivant (5) et elle vient de recevoir le prix Templeton ; ce prix, décerné depuis plusieurs dizaines d’années montre que science et spiritualité peuvent faire bon ménage. Diane Beresford-Kroeger évoque « une expérience sacrée » en présence de la forêt. Jane Goodhall éprouvait un sentiment comparable dan la forêt de Gombé. Aujourd’hui, à l’âge du vivant, la spiritualité va de pair avec l’écologie. Ainsi, théologien, sociologue et acteur dans la vie civile, Michel Maxime Egger a écrit un livre intitulé : « Ecospiritualité » (6) : « L’écospiritualité affirme que l’écologie et la spiritualité forment un tout parce que sans une nouvelle conscience et un sens du sacré, il ne sera pas possible de faire la paix avec la Terre ». Et il nous appelle à « réenchanter notre relation avec le vivant » (7).
Le témoignage de Diana Beresford-Krueger apporte une note originale dans cette littérature. C’est d’abord l’histoire d’une vie qui a souffert de sa condition d’orpheline et qui ayant trouvé un réconfort dans une vallée d’Irlande peut nous entretenir de la grandeur de la civilisation celte juste avant qu’elle ne disparaisse. Elle nous lègue ainsi le trésor de ses savoirs et de ses pratiques, mais en en montrant la fécondité et l’actualité grâce aux études scientifiques qu’elle a pu entreprendre et à la recherche de grande ampleur qui s’en est suivie et qui a mis en valeur l’apport des arbres et des forêts
Jean Hassenforder
- Peter Wohlleben. La vie secrète des arbres. Les Arènes, 2017
- Diana Beresford-Kroeger. La voix des arbres. Une vie au service des arbres, du savoir des druides aux plus récentes découvertes de la botanique. Tana éditions, 2023. Les éditions Tana publient des livres concernant la pratique écologique
- Des lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/des-lumieres-a-lage-du-vivant/
- Une vision nouvelle des animaux : https://vivreetesperer.com/une-vision-nouvelle-des-animaux/
- Jane Goodhall : Une recherche pionnière sur les chimpanzés, une ouverture spirituelle, un engagement écologique : https://vivreetesperer.com/jane-goodall-une-recherche-pionniere-sur-les-chimpanzes-une-ouverture-spirituelle-un-engagement-ecologique/
- Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
- Réenchanter notre relation avec le vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/
par jean | Juil 5, 2023 | ARTICLES, Vision et sens |
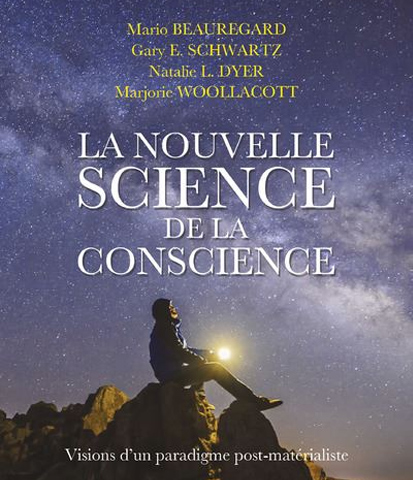 Pour une science post-matérialiste
Pour une science post-matérialiste
Le terme matérialisme évoque des sens différents selon le contexte auquel on l’applique. Ainsi, dans la vie quotidienne, on peut désigner comme « matérialiste », « une personne qui cherche des jouissance et des biens matériels » (définition google). Ainsi, beaucoup de gens dans notre société ont pu être perçus à la fois comme individualistes et matérialistes. Aujourd’hui, on peut constater, au plan social, le développement d’attitudes et de comportements en réaction contre ce matérialisme pratique. En ce sens, le sociologue américain Ronald Inglehart désigne, en terme de post-matérialiste, une évolution culturelle dans les pays économiquement avancés dans laquelle les gens cherchent moins à satisfaire des besoins physiques élémentaires et davantage des besoins immatériels tels que l’estime, l’épanouissement de la personne ou les satisfactions esthétiques.
Cependant, sur un autre registre, le matérialisme désigne une philosophie d’après laquelle « il n’existe d’autre substance que la matière », « une doctrine qui rejetant l’existence d’un principe spirituel ramène toute la réalité à la matière et à ses modifications » (Google). L’origine de cette philosophie remonte à l’antiquité où elle figurait en regard d’autres écoles philosophiques. Cependant, dans la foulée du progrès scientifique, une métaphysique matérialiste a influé sur l’activité scientifique si bien qu’on peut évoquer un « matérialisme scientifique ». Dans le chapitre d’un livre qui œuvre en faveur du développement d’un paradigme post-matérialiste, ‘La nouvelle science de la conscience’ (1), Mario Beauregard répond à une question préalable : Qu’est-ce que le matérialisme scientifique aujourd’hui ? : « Peu de scientifiques sont conscients que ce que l’on appelle « la vision scientifique du monde » repose sur un certain nombre de postulats métaphysiques – c’est-à-dire des hypothèses sur la nature de la réalité – qui ont été proposées pour la première fois par certains philosophes présocratiques. Ces postulats comprennent le matérialisme – l’idée selon laquelle tout ce qui existe est constitué exclusivement de particules et de champs matériels / physiques (les termes « matérialisme » et « physicalisme » peuvent être utilisés de manière interchangeable dans ce chapitre) – et le réductionnisme, le concept selon lequel les choses complexes ne peuvent être appréhendées qu’en les réduisant aux interactions des parties qui les constituent, ou à des choses plus simples et plus fondamentales telles que de minuscules particules matérielles. Le « mécanisme », l’idée que le monde fonctionne comme une machine, représente un autre de ces postulats. Au cours du XXe siècle, ces postulats se sont durcis, puis transformés en dogmes et en un système de croyances connus sous le nom de « matérialisme scientifique » (p 18). Cette idéologie exerce une influence dans le domaine des neurosciences. « Selon ce système de croyances, l’esprit et la conscience – et tout ce que nous vivons subjectivement (par exemple, nos souvenirs, nos émotions, nos objectifs et nos épiphanies spirituelles)… ne sont rien de plus que des processus électriques et chimiques dans le cerveau : ces processus cérébraux étant en définitive réductibles à l’interaction entre des éléments physiques fondamentaux. Une autre implication de ce système de croyances est que nos pensées et nos intentions ne peuvent avoir aucun effet sur nos cerveaux et nos corps, sur nos actions et le monde physique, puisque l’esprit ne peut impacter directement les systèmes physiques et biologiques. En d’autres termes, nous les êtres humains, ne sommes rien d’autres que des machines biophysiques complexes. En conséquence, notre conscience et notre spiritualité disparaissent automatiquement lorsque nous mourrons » (p 18).
Cependant, aujourd’hui, de plus en plus de découvertes viennent contredire les théories matérialistes. On peut envisager « une vague d’éveil pour une science et une société post-matérialiste » (p 63). « La science connaît actuellement un changement fondamental. Le matérialisme sur lequel elle s’est appuyée pendant plusieurs siècles fait aujourd’hui place à un nouveau paradigme dans lequel la conscience est considérée comme étant causale et fondamentale » (page de couverture).
Un mouvement pour une science post-matérialiste
De nombreux scientifiques se conjuguent aujourd’hui pour promouvoir un paradigme post-matérialiste. « L’Académie pour l’avancement des sciences post-matérialistes » a organisé en février 2014 en Arizona, un « Sommet international sur la science, la spiritualité et la société post-matérialiste ». Des scientifiques couvrant des domaines d’expertise allant de la biologie et des neurosciences à la psychologie, la médecine et la recherche psi ont participé à cet événement déterminant. Il en est résulté « un manifeste pour une science post-matérialiste » (2) auquel plus de 300 scientifiques et philosophes du monde entier ont apporté leur soutien » (p 14). Pendant le sommet, plusieurs participants ont décidé de réaliser « une anthologie des perspectives et des preuves relative à la science post-matérialiste », ouvrage publié en français sous le titre : « La nouvelle science de la conscience » (1). « Coordonné par Mario Beauregard et Guy E Schwartz, cet ouvrage appréhende les concepts post-matérialistes relatifs à l’esprit, au corps et à la santé. En s’appuyant sur de nombreuses preuves, il aborde l’organisation et les fonctions spécifiques des phénomènes non physiques, ouvrant la voie à la possibilité de considérer leur nature et leur influence dans le cadre d’une future science globale » (page de couverture).
Une recherche pionnière : Mario Beauregard
Dans un premier chapitre, Mario Beauregard nous introduit à une « prochaine grande révolution scientifique ». Ce chercheur travaille depuis longtemps en ce sens et nous avions rapporté une de ses conférences dans un article : « Comment nos pensées influencent la réalité » (3) et présenté un de ses livres : « Brain wars » (4).
En s’inscrivant dans la perspective du changement des paradigmes énoncée par Thomas S Kuhn, Mario Beauregard écrit : « Les scientifiques qui travaillent actuellement dans le domaine de la recherche sur la conscience et qui s’intéressent au problème : « esprit-cerveau », se trouvent dans une situation similaire à celle des physiciens au début du XXe siècle. Ils sont indéniablement confrontés à une quantité croissante de preuves d’anomalies qui ne peuvent être élucidées par les théories de la pensée matérialiste » (p 21). Mario Beauregard nous présente ensuite quelques unes de ces preuves.
« Les différentes preuves examinées ici sont regroupées en deux catégories. La catégorie I comprend les preuves comme quoi une explication matérialiste, bien que couramment présentée, est moins appropriée qu’une explication post-matérialiste. Cette catégorie comprend les phénomènes suggérant que l’esprit ne soit limité ni par l’espace, ni par le temps. La catégorie II comprend des preuves qui sont rejetées d’emblée par les théories de la pensée matérialiste, mais qui viennent soutenir une perspective post-matérialiste, celle-ci étant incompatible avec la perspective matérialiste selon laquelle l’esprit et la conscience sont produits uniquement par le cerveau » (p 22). Ces différents éléments de preuve apparaissent dans la complexité de leur nature et de leur mise en œuvre, aussi notre compte-rendu sera sommaire en renvoyant le lecteur à la description formulée dans ce chapitre.
L’esprit au delà de l’espace et du temps
« L’un des éléments de preuve concerne les phénomènes dit « psi » qui comprennent la perception extra-sensorielle (PES), et la psychokinésie (PK). La perception extra-sensorielle désigne l’acquisition d’informations sur des événements ou des objets extérieurs par des moyens autres que la médiation d’un vecteur de communication sensorielle connu. Cela comprend la télépathie – l’accès aux pensées d’une autre personne sans l’utilisation d’aucun de nos vecteurs sensoriels connus, la clairvoyance – la perception d’évènements ou d’objets qui ne peuvent être perçus par les sens connus, et la précognition – la connaissance d’un événement futur qui ne peut être déduit à partir d’informations connues dans le présent. La psychokinésie (PK) se réfère à l’influence de l’esprit sur un système physique qui ne peut être totalement expliqué par la médiation d’un moyen physique connu » (p 22). Depuis plusieurs décennies, des expériences répétées à travers des dispositifs sophistiqués ont prouvé la réalité de ces phénomènes.
L’esprit au delà du cerveau
D’autres phénomènes concernent « l’esprit au delà du cerveau » : les expériences de la mort imminente pendant un arrêt cardiaque et la mort clinique ; recherches sur la réincarnation et les vies antérieures ; recherches sur la médiumnité ; communications sur le lit de mort ». « Les expériences de mort imminente (EMI) sont des expériences intenses et réalistes qui transforment généralement profondément la vie des personnes qui ont été proches de la mort psychologiquement et physiologiquement. Les principales caractéristiques des EMI sont un souvenir clair de l’expérience, une activité mentale décuplée, et la conviction que l’expérience vécue est plus réelle que celle de la conscience ordinaire à l’état de veille. L’expérience hors du corps (EHC) est une autre caractéristique typique des EMI ; la personne a l’impression réelle d’être sortie de son corps et d’observer les évènements qui se déroulent autour d’elle, ou parfois dans un lieu éloigné. Les EMI sont fréquemment évoquées lors d’un arrêt cardiaque… Étant donné que les structures cérébrales qui soutiennent l’expérience consciente et les fonctions mentales supérieures ( par exemple la perception, la mémoire et la conscience) sont gravement endommagées, on ne s’attend pas à ce que les survivants d’un arrêt cardiaque aient des expériences mentales claires et lucides dont ils se souviendront… Il convient de noter que les personnes ayant vécu une EMI déclarent avoir perçu des choses qui coïncident avec la réalité alors qu’elles étaient cliniquement mortes » (p 25). Un autre chapitre du livre, sous la plume de Pim Van Lommel, médecin cardiologue réputé, est consacré aux expériences de mort imminente, « une forte indication en faveur de la conscience non locale » (p 191-209).
L’auteur évoque également le cas de « jeunes enfants ayant rapporté des vies antérieures ». « Au cours des cinquante dernières années, plus de 2500 cas de ce genre ont été étudiés ». « La plupart de ces enfants ont des souvenirs de vie antérieure entre deux et cinq ans… Environ 80% des supposés souvenirs de vie antérieure des enfants évoquent des morts violentes… Beaucoup d’enfants ont des marques de naissance qui coïncident avec des blessures qui seraient associées à leur vie antérieure… il arrive souvent que l’on parvienne à identifier la personne à laquelle l’enfant fait référence… » (p 26-27). L’auteur propose des interprétations : « Il est possible que ces enfants se souviennent de vies antérieures qu’ils ont vécues comme ils le suggèrent ou qu’ils accèdent aux informations d’un individu décédé par des moyens inconnus (c’est-à-dire la théorie du super-psi appelée également « super ESP », la récupération d’informations par le canal psychique » (p 28).
Une autre approche de recherche est engagée auprès de médiums, « personnes déclarant pouvoir communiquer avec les personnes décédées », en présumant la bonne de foi de certains d’entre eux. Des protocoles sophistiqués ont été utilisés par certains chercheurs comme le Dr Gary E Schwartz, auteur d’un chapitre technique sur ce thème dans ce même livre. « Les résultats montrent qu’avec des essais réalisés en triple aveugle dans des conditions rigoureuse, certains médiums peuvent recevoir des informations justes et précises sur des personnes décédées. » (p 29).
Mario Beauregard mentionne également « les communications sur le lit de mort ou DBC (Deathbed communication) », une autre source de preuve suggérant que la conscience et la personnalité peuvent perdurer après la mort physique. Il s’agit de toute communication entre le patient et des amis ou des parents décédés… Ce type d’expériences a été rapporté dans diverses cultures à travers l’histoire. Les DBC incluent des aspects auditifs, visuels et kinesthésiques et se manifestent souvent pat des processus communicatifs non verbaux… Un type fréquent de DBC inclue des rencontre avec des présumés esprits de personnes décédées qui semblent accueillir l’expérienceur dans l’au-delà et converser avec lui/elle d’une façon interactive… Des recherches menées auprès d’infirmières et de médecins en soins palliatifs suggèrent que ces expériences sont relativement courantes… Il existe des cas de DBC qui ne peuvent être expliqués comme de simples hallucinations… : dans de tels cas, la personne mourante semble voir une personne qu’elle croyait vivante, mais qui est en fait décédée récemment, et exprime de la surprise » (p 30).
Une nouvelle vision postmatérialiste
« Prises ensemble, les différentes preuves empiriques montrent clairement que l’idée que l’esprit et la conscience sont produits par le cerveau est erronée et obsolète… Vers la fin du XIXe siècle, le psychologue américain, William James a suggéré que le cerveau pouvait jouer un rôle permissif et transmissif concernant les fonctions mentales et la conscience. Il a en outre émis l’hypothèse que le cerveau pouvait agir comme un filtre qui limite / contraint / restreint l’accès à des formes de conscience élargie. Cette hypothèse a également été défendue par les philosophes Ferdinand Schiller et Henri Bergson… » (p 31). « Cette hypothèse de la transmission apporte un cadre théorique utile… ».
« Le moment est venu de nous libérer des chaines et des œillères de l’ancien paradigme matérialiste et d’élargir notre vision de l’Univers et du vivant. Même si nous n’avons pas encore toutes les réponses, il est toutefois possible d’esquisser les grandes lignes d’un paradigme post-matérialiste » (p 31). Mario Beauregard nous présente, de son point de vue, quelques éléments clés de ce nouveau paradigme.
1° « L’esprit est irréductible et son statut ontologique est aussi primordial que celui de la matière, de l’énergie et de l’espace-temps. De plus, l’esprit ne peut être issu de la matière et réduit à quelque chose de plus élémentaire. A ce propos, le philosophe David Chalmers et le cosmologiste, Andrei Linde ont tous deux soutenu que la conscience est un constituant fondamental de l’univers. Il semble plausible que les processus / phénomènes mentaux, y compris l’intériorité subjective, existent à des degrés divers et à tous les niveaux d’organisation de l’univers… A ce sujet, le physicien Freeman Dyson suggère que puisque les atomes se comportent en laboratoire comme des agents actifs et non comme de la matière inanimée… ils doivent posséder la capacité réflexive de faire des choix… au niveau moléculaire, il est prouvé que les molécules composées de quelques protéines simples ont la capacité d’interagir de manière complexe, comme si elles possédaient leur propre intelligence… Dans cette perspective, chaque niveau d’organisation comprend un aspect physique (extérieur) et un aspect mental/ expérientiel (intérieur) (p 32-33).
2° « Comme le révèlent les phénomènes psi, il existe une profonde interaction entre le monde mental (psyché) et le monde physique (physis) qui ne sont pas vraiment séparés – ils ne le sont qu’en apparence. En fait, la psyché et la physis sont profondément interconnectées, car elles sont des aspects (ou des manifestations) complémentaires issus d’une base commune. On peut concevoir que cette base représente un niveau transcendant de l’esprit / conscience qui constitue le principe fondamental qui sous-tend l’ensemble de la réalité… » (p 33).
3° « L’esprit / volonté agit comme une force, c’est-à-dire qu’il peut impacter l’état du monde physique et agir de manière non locale. Cela implique qu’il n’est pas limité à des points spécifiques dans l’espace tels que les cerveaux et les corps, ni à des points spécifiques dans le temps comme le moment présent. Les preuves présentées dans ce chapitre de façon succincte indiquent également que les phénomènes mentaux exercent une influence sur le fonctionnement du cerveau et du corps ainsi que sur le comportement… » (p 34).
4° « Le cerveau agit comme un émetteur récepteur de l’activité mentale, c’est-à-dire que l’esprit fonctionne grâce au cerveau mais n’est pas produit par lui. Le fait que les fonctions mentales soient perturbées lorsque le cerveau est endommagé ne prouvent pas que l’esprit et la conscience soient produits par le cerveau… Dans l’idée que le cerveau puisse être une interface pour l’esprit, cet organe peut être comparé à un poste de télévision qui reçoit des signaux de diffusion et les convertit en images et en sons ». Si il est endommagé, il y a des perturbations dans la réception. « De même, une lésion dans une région spécifique du cerveau peut perturber les processus mentaux médiés par cette structure cérébrale, cependant cette perturbation n’implique pas que ces processus soient réductibles à l’activité neuronale dans cette région du cerveau » (p 34-35).
Pour une science post-matérialiste
Mario Beauregard a participé à la rédaction du manifeste pour une science post-matérialiste (2). Une bonne partie de son argumentation se retrouve dans ce manifeste. La perspective est vaste Elle s’inspire également de la révolution intervenue en physique dans le surgissement de la mécanique quantique : « A la fin du XIXe siècle, les physiciens découvrirent des phénomènes empiriques qui ne pouvaient être expliqués par la physique classique. Durant les années 1920 et au début des années 1930, cela a conduit au développement d’une nouvelle branche révolutionnaire de la physique, appelée : mécanique quantique. La mécanique quantique a mis en question les fondations matérielles de l’univers en montrant que les atomes et les particules subatomiques n’étaient pas des objets réellement solides – ils n’existent pas avec certitude à des emplacements spatiaux définis et à des moments définis. Plus important, la mécanique quantique a introduit notre esprit dans sa structure conceptuelle de base puisqu’il a été trouvé que les particules étant observées et l’observateur –le physicien et la méthode utilisée pour l’observation – sont liés. Suivant une interprétation de la mécanique quantique, ce phénomène implique que la conscience de l’observateur est décisive pour l’existence des évènements physiques observés et que les évènements mentaux peuvent affecter le monde physique. Les résultats d’expériences récentes soutiennent cette interprétation. Ces résultats suggèrent que le monde physique n’est plus la première ou la seule composante de la réalité et que celle-ci ne peut être pleinement comprise sans faire référence à l’esprit ». Le manifeste se poursuit en mettant l’accent sur l’influence que la pensée peut exercer sur le comportement et la santé. Et il poursuit l’argumentation apportée ici par Mario Beauregard. Au total, le manifeste proclame que l’adoption du paradigme post-matérialiste aura des effets bénéfiques pour l’ensemble de la civilisation humaine. C’est dans la même perspective que s’achève le chapitre de Mario Beauregard.
« Individuellement et collectivement, le paradigme post-matérialiste a des implications d’une portée considérable. Ce paradigme réenchante le monde et modifie profondément notre vision de nous-mêmes en nous rendant notre dignité et notre pouvoir en tant qu’êtres humains. Le paradigme post-matérialiste favorise également des valeurs positives telles que la compassion, le respect, la bienveillance, l’amour et la paix, car il nous fait prendre conscience que les frontières entre nous-mêmes et les autres sont perméables. Ce faisant, ce paradigme favorise une prise de conscience de la profonde interconnexion entre la nature et nous au sens large, y compris tous les niveaux d’organisation de l’univers. Ces niveaux peuvent englober des domaines non physiques et spirituels. A ce sujet, il convient de rappeler que le paradigme post-matérialiste reconnaît les expériences spirituelles qui se réfèrent à une dimension fondamentale de l’expérience humaine et qui sont fréquemment rapportées dans toutes les cultures… Et enfin, ce paradigme favorise également une prise de conscience concernant les questions environnementales et la nécessité de préserver notre biosphère, en mettant l’accent sur le lien profond qui nous unit à la nature » (p 35).
Une ouverture
Ce livre nous présente différentes approches du nouveau paradigme scientifique post-matérialiste. Dans sa présentation des phénomènes qui permettent d’envisager l’esprit au delà du cerveau, on constate l’universalité de ces phénomènes répandus dans toutes les cultures. Il en découle une universalité de la réalité spirituelle dont ils témoignent. Cette universalité peut embarrasser certains groupes religieux voulant s’approprier un monopole de « la vie après la vie ». En regard, un récent livre de la théologienne chrétienne Lytta Basset nous offre une approche inclusive dans son livre : « Cet Au-delà qui nous fait signe ». (5). Cette approche de l’Au-delà apparaît comme une révolution spirituelle. Le paradigme post-matérialiste nous présente une réalité interconnectée. Ainsi, « il existe une profonde interaction entre le monde mental et le monde physique qui ne sont pas vraiment séparés ». « La conscience apparaît comme un constituant fondamental de l’univers ». « Le nouveau paradigme favorise une prise de conscience de la profonde interconnexion entre la nature et nous, au sens large, y compris tous le niveaux d’organisation de l’univers » « C’est dans une perspective analogue que, selon le théologien Jürgen Moltmann, nous envisageons l’œuvre de Dieu dans la création (6). Ici, la création apparaît comme une « communauté dans laquelle toutes les créatures communiquent chacune à sa manière entre elles et avec Dieu ». Mario Beauregard envisage les incidences considérables de l’approche scientifique post-matérialiste sur notre culture. Sur le plan conceptuel, le matérialisme scientifique s’opposait à l’approche religieuse et à la perspective du salut. Ici cet obstacle est levé. « Le paradigme post-matérialiste reconnait les expériences spirituelles qui se réfèrent à un dimension fondamentale de l’expérience humaine ». Le nouveau paradigme « réenchante le monde ». C’est une perspective dans laquelle peut s’inscrire Michel Maxime Egger dans son livre : « Réenchanter notre relation au vivant » (7). Ce livre nous apporte une grande ouverture
J H
- Mario Beauregard, Gary R Schwartz, Natalie L Dyer, Marjorie Woollacott. La nouvelle science de la conscience. Visions d’un paradigme, post-matérialiste. Guy Trédaniel, 2021
- Manifesto for a post-materialist science : https://opensciences.org/files/pdfs/Manifesto-for-a-Post-Materialist-Science.pdf
- Mario Beauregard . Comment nos pensées influencent la réalité : https://vivreetesperer.com/comment-nos-pensees-influencent-la-realite/
- Potentiel de l’esprit humain et dynamique de la conscience : https://vivreetesperer.com/potentiel-de-lesprit-humain-et-dynamique-de-la-conscience/
- Une révolution spirituelle. Une nouvelle approche de l’Au-delà : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/
- Dieu dans la création : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
- Réenchanter notre relation au vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/
 Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants.
Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants.