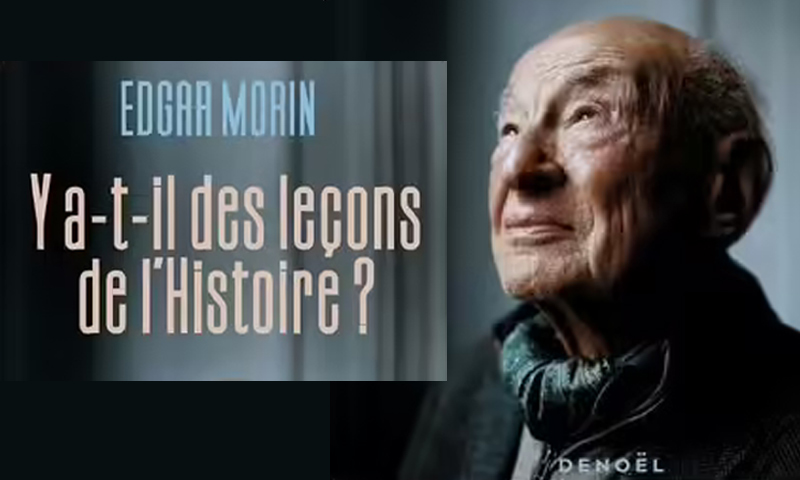En ces temps troublés où apparaissent des menaces imprévues, gardant le souvenir d’époques plus calmes, ces bouleversements nous inquiètent. Nous sommes d’autant plus amenés à poser un regard sur le passé, un regard sur l’histoire. Or un livre vient de paraitre : « Y a-y-il des leçons de l’histoire ? (1) En seize leçons et une centaine de pages, il propose les réflexions d’une grande personnalité de la recherche en sciences sociales : Edgar Morin, sociologue et philosophe. Théoricien de la pensée complexe, Edgar Morin est notamment l’auteur de ‘la Méthode’, une « somme en six volumes qui se veut une méthodologie de la transdisciplinarité » (wikipedia). Cependant, à l’âge de cent-quatre ans, l’auteur n’a pas seulement un savoir universitaire sur l’histoire, il en a une expérience personnelle, celle d’un siècle.
Si l’auteur a particulièrement étudié la complexité, on retrouve au premier chef cette réalité en histoire. « Les causes des évènements historiques sont toujours multiples et enchevêtrées » (p 19). Il cite l’exemple de la décadence de l’empire romain.
L’histoire peut être étudiée selon des approches différentes. Ainsi l’auteur met l’accent sur « la grande influence des mythes de l’histoire » (p 23) A cet égard, il mentionne l’expansion des religions monothéistes. Il met l’accent sur « la réalité historique de l’imaginaire » (p 69).
Edgar Morin attire l’attention sur les limites d’une approche rationnelle de l’histoire. « La rationalité de l’histoire n’est souvent qu’une post-rationalisation » (p 45). « Le regard sur l’histoire est tiraillé entre deux réalités contradictoires, que peu d’historiens se risquent à assumer ensemble : celle du caractère rationnel des processus historiques et celle de l’irrationalité – sound and fury – et du rôle majeur des ‘grands hommes’ qui impriment leurs marques sur leur temps, mais aussi sur une longue durée. Ainsi, Alexandre le Grand anéantit-il l’empire perse, conquit-il l’Egypte et une partie de l’Asie, changea-t-il le monde antique en y introduisant la civilisation hellénistique ». « La tendance rationnalisatrice est particulièrement affirmée en France avec l’Ecole des Annales animée par Lucien Fèbvre, Marc Bloch, puis Fernand Braudel. Les mérites de cette école furent de mettre en relief les déterminants économiques, sociaux, voire idéologiques… Le défaut des Annales fut de négliger le rôle des évènements et des fortes personnalités. Je fus un protagoniste du retour de l’évènement dans l’histoire en organisant un numéro de ma revue ‘Communications’ sous ce titre… J’y rappelais que le monde physique est soumis à d’innombrables évènements… que l’histoire de la vie comporte des évènements eux-mêmes innombrables… et qu’il était donc absurde de ne pas prendre en compte les évènements de l’histoire humaine non moins innombrables que dans le monde physique et le monde vivant » (p 46-47). L’auteur souligne également le rôle et l’influence des guerres.
Edgar Morin conteste également une idée absolue du progrès. « L’idée que le progrès est la loi absolue de l’histoire s’est imposée au cours du XIXe siècle. Elle a été clairement formulée par Condorcet, adoptée par l’Occident comme vérité de l’histoire, puis répandue dans le monde. L’auteur reconnait les grands progrès techniques accomplies depuis le début de l’histoire de l’humanité. « Au cours des siècles, les puissances scientifiques, techniques, économiques ont suscité de plus en plus de bien-être et de bien-vivre pour la partie la plus privilégiée de la population. Mais, fait extraordinaire, deux guerres mondiales, des massacres de masse, Hiroshima, ou des fanatismes délirants n’ont ébranlé que provisoirement cette croyance en le progrès qui s’est imposée à nouveau lors des Trente glorieuses. Cette nouvelle ère de développement de la société de consommation et de bien-être réservée à une part croissante, mais partielle de la population, a créé une amélioration fragile. Une forme d’industrialisation de la vie s’est opérée dans les programmes, la chronométrisation, la réduction à l’économie de tout ce qui est humain, et, on l’a oublié, l’affectivité, le bonheur, le malheur, la joie, la tristesse, c’est-à-dire les réalités humaines essentielles » (p 77). « La croyance dans le progrès s’est atténuée lorsque est apparue la conscience que le progrès scientifico-technico-économique tendait vers la dégradation écologique de la planère, mais aussi la dégradation de sociétés et de civilisations humaines » (p 78).
Il y a de puissantes tendances dans l’histoire, si puissantes parfois qu’il semble difficile à l’initiative humaine d’en infléchir le cours. Bienvenu est le propos d’Edgar Morin lorsqu’il intitule une de ses leçons : « Un seul individu peut changer le cours de l’histoire mondiale » (p 55). « L’histoire est une combinaison de forces anonymes, d’évènements décisifs et d’interventions non moins déterminantes d’individus investis d’autorité : empereurs, chefs, rois, généraux, ministres, voire rebelles ou régicides. Le temps de crise et les guerres favorisent l’apparition de grands hommes, de grandes femmes ou du moins de personnalités dont les virtualité (qui sans cela seraient restées latentes), s’actualisent de façon exceptionnelle ». Ils modifient le cours de l’histoire ‘en stratèges le plus souvent militaires ou politiques’. Ainsi, « la personnalité de De Gaulle ne fut-elle pas décisive par trois fois dans l’histoire de France ? ». Le courage politique de Churchill a eu un rôle décisif dans le déroulement de la seconde guerre mondiale : « Si Churchill n’avait pas été élu Premier ministre en remplacement du frêle Chamberlain, à la suite de la défaite anglaise en Hollande et en Belgique, le Royaume-Uni aurait probablement accepté les propositions de paix d’Hitler, laissant ce dernier devenir maitre de l’Europe » (p 56). A côté de ces personnalités positives, il y malheureusement un grand nombre de criminels mégalomanes. « La mégalomanie peut être une maladie du pouvoir » (p 58). « Mussolini, Staline, Hitler, Mao ont organisé leur propre culte et ont été quasiment divinisés ».
‘L’improbable peut advenir’. Edgar Morin rapporte son expérience. « Ces cent dernières années, que d’épisodes inattendus, voire imprévisibles : le pacte germano-soviétique de 1939 entre deux ennemis apparemment irréductibles, la bataille de Stalingrad en 1942, le rapport Khrouchtchev, le putsch des généraux d’Alger en 1958, le retour de De Gaulle au pouvoir, le terrorisme islamique, etc. » (p 20). Il y a de nombreuses trajectoires imprévisibles dans l’histoire contemporaine. C’est le cas quand on considère l’histoire récente d’Israël. L’expansion illégitime de l’état israélien a débouché sur un désastre : les massacres de Gaza. Ainsi, par un renversement de l’histoire, « le peuple qui a le plus souffert de persécution est devenu une nation dominatrice, colonisatrice, persécutrice » (p 33). L’auteur nous propose un autre exemple d’une trajectoire inattendue : « le destin incroyable de la révolution russe » (p 37). « Mon dernier exemple du triomphe de l’inattendu et du rôle capital du mythe dans l’Histoire est celui de la révolution d’octobre en Russie ». « La révolution fut d’une haute improbabilité… ». Puis « l’échec humain du socialisme comme société égalitaire et fraternelle, patent dès les débuts de l’URSS, fut totalement masqué par l’idéologie… La dictature du prolétariat fut en fait une dictature tentaculaire du Parti ». « Deuxième triomphe de l’inattendu : en 1991, ce régime s’effondra de lui-même après soixante-dix ans de pouvoir… l’échec historique le plus total » (p 39).
Il arrive que le vent tourne juste au moment où le ciel s’obscurcit. Ce fut le cas à la fin de l’année 1941 au moment où l’Allemagne hitlérienne était en passe de dominer toute l’Europe. « En deux jours, le probable, la prise de Moscou et la victoire nazie, devint improbable, et l’improbable devint probable : l’URSS disposait désormais du soutien matériel et militaire des Etats-Unis entrés en guerre après Pearl Harbour » (p 87).
A une époque tourmentée où des périls ont surgi de part et d’autre, nous pouvons être surpris et désemparés. En sociologie et philosophe, mais aussi en homme d’expérience, dans ce livre, Edgar Morin vient nous rappeler la complexité de l’histoire. Ses points de vue ne sont pas nécessairement incontestables, mais il nous apprend à considérer les menaces et à les envisager dans la vigilance. Cependant, si nous voulons regarder le positif, il nous enseigne aussi que des hommes ont pu l’emporter sur des forces contraires et qu’on peut échapper à ce qui paraissait une impasse. C’est un livre qui accroit notre capacité de faire face.
J H
- Edgar Morin. Y a -t-il des leçons de l’histoire ? Denoël, 2025
Sur ce blog, voir aussi :
Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François, Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
Pourquoi la fraternité, selon Edgar Morin. Pour des oasis de fraternité : https://vivreetesperer.com/pour-des-oasis-de-fraternite/