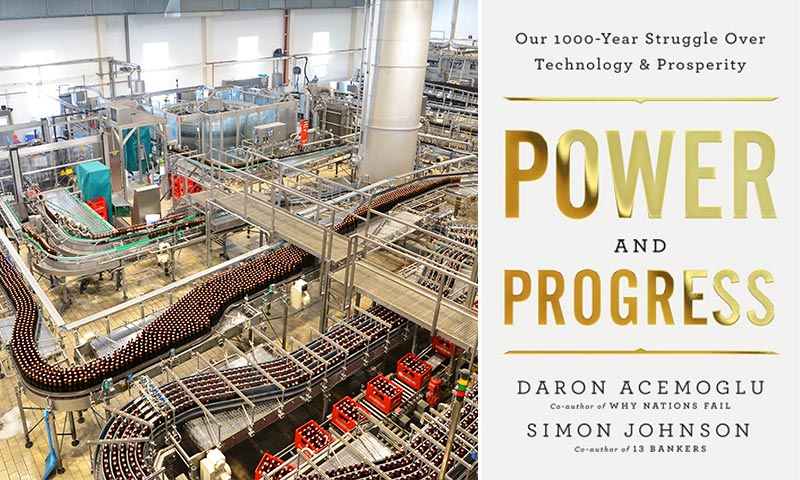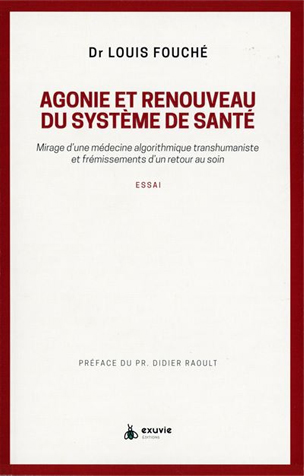par jean | Juin 9, 2024 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |
Une nouvelle pensée économique selon Eloi Laurent
Pour réaliser les transformations économiques requises urgemment par la crise écologique, nous avons besoin de considérer l’économie sous un jour nouveau. C’est pourquoi Eloi Laurent nous propose un livre intitulé : « Économie pour le XXIe siècle. Manuel des transitions justes » (1). Eloi Laurent est enseignant-chercheur à l’OFCE/Sciences Po et à Ponts Paris Tech et à l’international ; il a enseigné dans les universités Harvard et Stanford. Il est donc bien placé pour constater « la perplexité croissante des étudiants » vis-à-vis de l’enseignement d’une « économie aveugle à l’écologie comme s’il s’agissait de deux mondes parallèles ».
« Économiste engagé dans le débat public, il jette ici un regard critique et constructif sur sa discipline ». « Ce manuel innovant propose une économie pour le XXIe siècle, qui intègre défis écologiques et enjeux sociaux : une économie qui part de la biosphère plutôt que de la traiter comme une variable d’ajustement ; une économie qui place au centre la crise des inégalités sociales plutôt que l’obsession de la croissance ; une économie organique en prise avec le vivant dont nous dépendons ; une économie en dialogue avec les autres disciplines. En somme, une économie mise au service des transitions justes qui ont pour but de préserver notre planète et nos libertés » (page de couverture).
Comme la prise de conscience écologique nous a appelé à étudier sur ce blog des pistes de transformation dans différents domaines, depuis l’économie (2) et la socio-politique (3) ou l’environnementalisme (4) jusqu’à la philosophie (5) et la spiritualité (6), cet ouvrage est particulièrement bienvenu car il nous offre un chemin qui allie la prise en compte des effets mortifères des inégalités et des politiques écologiques pour tracer le chemin de ‘transitions justes’.
Ce livre s’organise en deux grandes parties .« La première partie présente un cadre, une méthode et des outils pour insérer l’économie entre la réalité écologique et les principes de justice. La seconde partie applique cette approche social-écologique à toutes les grandes questions de notre temps : la biodiversité, les écosystèmes, l’énergie, le climat, etc… et donne à voir tous les leviers d’action pour mener à bien des transitions justes : Nations unies, Union européenne, gouvernement français, territoires, entreprises, communautés » (page de couverture). On se reportera à ces différents champs d’étude. Nous introduirons ici le lecteur à la manière dont Eloi Laurent présente les attendus de la nouvelle économie et l’approche sociale-écologique au cœur de cette vision nouvelle
Ce que l’économie savait, ce qu’elle a oublié, ce qu’elle peut encore nous apprendre.
Pour réussir la transition écologique, il serait bon de pouvoir éclairer et guider les changements économiques nécessaires par des savoirs économiques. C’est là que l’auteur met en évidence le manque de pertinence des sciences économiques actuelles. « L’économie standard s’est enfermée au cours des dernières décennies du siècle précédent dans une approche beaucoup trop étroite de la coopération sociale et du développement humain, fixée sur des obsessions abstraites telle que l’efficacité, la rentabilité ou la croissance, qui la rendent trop inopérante aujourd’hui. Ce faisant, elle a méprisé sa propre richesse, ignoré son écodiversité, et négligé de s’interroger sur les conditions de possibilité de l’activité économique » (p 10).
Or, en remontant aux origines, puis dans l’histoire de l’économie politique, on découvre que celle-ci a longtemps tenu grand compte des ressources naturelles et de l’environnement.
« Contrairement aux apparences contemporaines, il apparait que l’analyse économique a développé très tôt une double préoccupation pour la justice et pour la question écologique et même pour l’articulation de ces deux thématiques » (p 15). L’auteur remonte aux origines. L’économie a été inventée en Grèce, il y a 2500 ans par Xénophon, propriétaire administrant un domaine agricole, et par Aristote dans sa ‘Politique’. Chez Aristote, l’économie, c’est « la discipline de la sobriété au service des besoins essentiels. C’est donc une discipline qui concilie les besoins des humains avec les contraintes de leur environnement. Quand l’économie devient ‘économie politique’ à l’époque moderne, les premiers « économistes font de la nature la source de la richesse et l’origine du pouvoir ». (p 15-16). C’est au XVIIIe siècle qu’une pensée économique émerge à nouveau. « Les premiers économistes sont les physiocrates, un groupe de philosophes et de responsables politiques français. Ils ont été les premiers à construire un modèle cohérent de représentation de l’économie où les ressources naturelles jouaient un rôle central. Les physiocrates nous aident à comprendre le lien essentiel entre ressources naturelles, pouvoir politique et justice sociale. Cette analyse se prolonge avec les travaux de l’école classique anglaise » (p 16-19). L’auteur évoque ici David Ricardo et John Stuart Mill. Alors qu’en 1848, la première révolution industrielle atteint son pinacle, John Stuart Mill envisage un ralentissement de la croissance, un ‘état stationnaire’. « Où tendons nous ? A quel but définitif la société marche-t-elle avec son progrès industriel ?… Les économistes n’ont pas manqué de voir plus ou moins distinctement que l’accroissement de la richesse n’est pas illimité ; qu’à la fin de ce qu’on appelle l’état progressif se trouve l’état stationnaire… ». Et, dès cette époque, il pressent et envisage la question écologique : « Si la terre doit perdre une grande partie de l’agrément qu’elle doit aux objets, que détruirait l’accroissement continu de la richesse et de la population… j’espère sincèrement pour la postérité qu’elle se contentera de l’état stationnaire longtemps avant d’y être forcée par la nécessité ». Eloi Laurent commente ainsi : « La nature révolutionnaire du questionnement de John Stuart Mill sur les finalités mêmes de l’économie capitaliste libérale réside dans sa compréhension de l’impact profond que les sociétés humaines ont déjà, de son temps, sur la biosphère ». D’une manière positive, John Stuart Mill précise : « Ce ne sera que quand, avec de bonnes institutions, l’humanité sera guidée par une judicieuse prévoyance, que les conquêtes faites sur les forces de la nature par l’intelligence et l’énergie des explorateurs scientifiques deviendront la propriété commune de l’espèce et un moyen d’améliorer et d’élever le sort de tous » (p 41-42).
Eloi Laurent nous montre ensuite le tournant intervenu dans les sciences économiques au XXe siècle. D’après Dani Rodrik, « l’économie serait différente des autres sciences sociales (et pour tout dire supérieure), du fait de sa maitrise des modèles, autrement dit de représentations simplifiées et opératoires des comportements humains, lesquels permettraient d’identifier des relations causales. L’économie du XXe se serait ainsi progressivement singularisée par l’amélioration de ses techniques quantitatives, prenant appui sur la formalisation mathématique pour développer l’économétrie, la théorie des jeux jusqu’à l’économie computationnelle et le big data d’aujourd’hui. En réalité, la question des instruments apparait secondaire dans l’émancipation de l’économie au XXe siècle. La véritable rupture n’est pas formelle mais substantielle : c’est la rupture avec la philosophie, l’éthique et la justice » (p 42). L’auteur rappelle que les enjeux de répartition et les principes de justice étaient au cœur de l’œuvre des pères fondateurs de ce qu’on a appelé ‘l’économie politique’. Mais force est de constater que ces enjeux ont été marginalisés et finalement presque oblitérés dans les dernières décennies du XXe siècle. Cet aveuglement progressif dans les travaux de l’école néoclassique a été aggravé par la focalisation sur le court terme par l’approche keynésienne.
L’auteur met en évidence « la relégation de l’enjeu de la justice par rapport à celui de l’efficacité » dans les publications en économie à partir de la fin du XIXe siècle. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que « l’économie des inégalités a fait un retour remarqué ».
Eloi Laurent nous propose également une histoire du développement de l’économie de l’environnement à partir du milieu du XIXe siècle. Au début des années 1960, une économie écologique émerge comme une réponse au défi de la soutenabilité déjà cristallisé par la publication du rapport Brundtland publié dans le cadre d’une commission des Nations Unies en 1987, qui définit pour la première fois le ‘développement soutenable’ (ou durable) comme « un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (p 50).
Cependant, malgré les recherches sur l’économie de l’environnement pendant un siècle et demi, cette discipline est encore négligée dans le domaine de l’économie. « Dans leur grande majorité, les économistes ignorent les questions environnementales, au double sens de l’inculture et de l’indifférence » (p 50). Cette affirmation s’appuie sur un examen de la littérature économique contemporaine. « Ce désintérêt est d’autant plus préjudiciable que la transition écologique est désormais un enjeu de sciences sociales : les sciences dures ont largement œuvré pour révéler l’ampleur et l’urgence des crises écologiques ». Aujourd’hui, « ce sont les sciences sociales, dont l’économie, qui détiennent la clé des problèmes que les sciences dures ont révélés » (p 56).
Une approche sociale-écologique
Pour des transitions justes.
Un constat s’impose aujourd’hui : les ravages provoqués par la montée croissante des inégalités. « Nos sociétés sont devenues de plus en plus inégalitaires., fragmentées et polarisées au cours des quarante dernières années tandis que les dégradations environnementales s’accéléraient pour atteindre des niveaux inédits. La crise des inégalités et les crises écologiques marchent du même pas. Les 35 pays considérés comme les plus riches, qui ne représentent que 15% de la population mondiale sont ainsi responsables de75% de la consommation démesurée des ressources naturelles depuis 1970. Et la moitié des émissions de CO2 depuis 1990 est le fait de seulement 10% des humains » (p 8). « Nos systèmes sociaux – à commencer par nos systèmes économiques – sont devenus autodestructeurs et l’avidité d’une partie des humains est devenue préjudiciable à la poursuite de l’avenir de l’humanité. C’est pourquoi nous devons trouver un moyen d’inverser la spirale social-écologique vicieuse dans laquelle nous sommes pris » (p 9).
C’est dans cette perspective qu’Eloi Laurent met en évidence le rapport réciproque entre les inégalités et les effets de la crise écologique.
« ° La non-transition écologique – c’est-à-dire la situation actuelle dans laquelle les crises écologiques s’aggravent sans trouver de réponse adéquate – est génératrice d’inégalités sociales qui touchent d’abord les plus démunis.
° La nécessaire réduction des inégalités sociales peut atténuer les crises écologiques et réciproquement les politiques de transition écologique peuvent réduire les inégalités sociales et améliorer le bien-être des plus démunis.
° On peut concevoir des politiques social-écologiques qui, aujourd’hui, comme dans la durée, réduisent simultanément les inégalités sociales et les dégradations environnementales » (p 100).
Eloi Laurent consacre un chapitre à l’approche social-écologique (p 74-98). Il y aborde en premier les questions relatives à la gestion des communs : « De la tragédie des communs à la gouvernance des communs ». Mal gouvernés, les communs peuvent dégénérer. C’est ainsi qu’en 1968, Garett Hardin évoque ‘la tragédie des communs’. L’image est celle de « bergers épuisant le pâturage qu’ils partagent sans le posséder, faute de s’en répartir équitablement l’usage ». Hardin propose comme remède « soit de privatiser la ressource naturelle, soit d’instituer ‘une coercition réciproque par acceptation mutuelle’, autrement dit de recourir à un autorité centrale qui monopolisera le pouvoir de choisir et qui ressemble fort à un gouvernement dictatorial » (p 75). Pendant les décennies qui suivirent, l’article de Hardin « fut annexé par une pensée néolibérale en plein essor qui en fait l’emblème de sa lutte en faveur de la propriété exclusive comme seul outil rationnel de gestion des ressources » (p 75).
Cependant, si on a décrit deux solutions à la ‘tragédie des communs’ : la centralisation politique ou la privatisation, une troisième option apparait : « une révolution des communs dont Ostrom est le porte-étendard ». « Les travaux d’Ostrom et de ses nombreux coauteurs vont démontrer que les institutions qui permettent la préservation des ressources par la coopération sont engendrées par les communautés humaines elles-mêmes et pas par l’État, ni par le marché. Des centaines de gouvernances décentralisées évitent, partout dans le monde et depuis des millénaires, la tragédie des communs en permettant l’exploitation soutenable de toutes sortes de ressources : eau, forêts, poissons, etc » (p 78). En exemple, le partage de l’eau depuis le début de l’agriculture, il y a 10000 ans… « Ces principes de gouvernement écologique émanent des communautés humaines elles-mêmes, pas d’une autorité extérieure ». Toutes les informations sont ainsi à portée et nourrissent l’action. Quant à elle, la privatisation engendre l’inégalité.
« Dans ce cadre d’analyse, on voit clairement l’importance de la relation – horizontale, mais souvent négligée – entre préservation naturelle et confiance. Ce n’est donc pas un hasard si Ostrom a aussi contribué de manière décisive à la littérature sur la confiance en lien avec la coopération » (p 78). « Selon Ostrom, les individus qui coopèrent sont capables d’apprendre des autres ; Ils se souviennent des comportements de coopération et plus généralement de la fiabilité des personnes auxquelles ils ont affaire ; ils utilisent leur mémoire et d’autres indices… pour évaluer la fiabilité de leurs partenaires dans l’échange, avant de leur accorder leur confiance ; ils s’efforcent de se bâtir une réputation de fiabilité… ils adoptent des horizons temporels qui excèdent le passé immédiat… La coopération est une quête de connaissances partagées » (p 79). Ainsi, « grâce à Ostrom, on sait maintenant que des institutions communes enracinées dans des principes de justice, même réduites à leur plus simple expression, favorisent les comportements coopératifs. La théorie des communs d’Ostrom constitue donc la première matrice de l’approche sociale-écologique » (p 80).
L’approche sociale-écologique considère la relation réciproque entre dynamique sociale et dynamique environnementale en se concentrant sur le caractère imbriquée des deux crises qui caractérisent le début du XXIe siècle. A cet égard, l’approche sociale-écologique fonctionne à double sens : les inégalités sociales alimentent les crises écologiques tandis que les crises écologiques aggravent à leur tour les inégalités sociales » (p 80).
« L‘impact social des crises écologiques n’est pas le même pour les différents individus et groupes compte tenu de leur statut socio-économique » (p 81). L’auteur étudie l’incidence des riches et des pauvres sur l’environnement. « Du côté des riches, le sociologue Thomas Veblen a montré dans sa ‘Théorie de la classe de loisir’ que le désir de la classe moyenne d’imiter les modes de vie des classes les plus favorisées peut conduire à une épidémie culturelle de dégradations environnementales ». C’est l’attrait d’une ‘consommation ostentatoire’. Dans un autre registre, Indira Gandhi faisait remarquer que dans les pays les plus démunis, « la pauvreté conduit à des dégradations environnementales du fait de l’urgence sociale ». La richesse des pays pauvres du monde résidant d’abord dans les ressources naturelles, ils sont contraints à y puiser excessivement. « L’éradication de la pauvreté est donc souhaitable non seulement socialement, mais aussi sur le plan environnemental, à condition qu’elle ne prenne pas la forme d’un rattrapage consumériste, mais s’inscrive dans une redéfinition de la richesse globale » (p 83). « Les inégalités augmentent le besoin d’une croissance économique néfaste pour l’environnement et socialement inutile… Si l’accumulation de richesse dans un pays donné est accaparée par une petite fraction de la population, le reste de la population réclamera une croissance économique supplémentaire pour que son niveau de vie ne stagne pas ». Et, dans l’état actuel des choses, ce surplus de croissance « se traduira par davantage de dégradations environnementales ».
Comment réduire les inégalités ? « Par définition, il existe deux manières de les réduire: du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Réduire les niveaux des groupes des plus riches de la population mondiale (les 10% qui émettent un peu moins de la moitié du CO2 mondial, d’après les analyses du GIEC en 2022) via une fiscalité adéquate se traduira logiquement par d’importantes réductions d’émission. De plus, les biens de ‘luxe’ engendrent beaucoup plus d’émissions de carbone que les biens de ‘nécessité’ (p 86).
Dans ce cadre, veiller à une transition juste : « Dans l’Union européenne, alors que les émissions par habitant ont baissé en moyenne de l’ordre de 25% entre 1990 et 2013, les émissions de 1% des plus riches ont augmenté de 7% (principalement sous l’effet du transport aérien et, dans une moindre mesure, terrestre) tandis que celles des 50% des plus pauvres ont baissé de 32%. Nous vivons donc une transition injuste dans le continent le plus avancé dans l’atténuation de la crise climatique » (p 87).
De plus, « Les inégalités augmentent l’irresponsabilité écologique des plus riches à l’intérieur de chaque pays et entre les nations ». On constate ainsi que le dommages environnementaux (activités polluantes, déchets) sont souvent affectés aux zones pauvres. « Les inégalités, qui affectent la santé des individus et des groupes, diminuent la résilience social-écologique des communautés et des sociétés, et affaiblissent leur capacité collective à s’adapter à l’accélération du changement environnemental global ». « Un important corpus de recherches… a confirmé l’impact négatif des inégalités sociales sur la santé physique et mentale aux niveaux local et national (via le stress, la violence, un moindre accès aux soins de santé etc.) » (p 91). Selon Paul Farmer, l’inégalité constitue un « fléau moderne » sur le plan sanitaire aussi redoutable que les agents infectieux. De même, la dynamique des inégalités sociales influe sur la résilience ou au contraire la vulnérabilité des populations exposées à de grands chocs. Et de plus, « Les inégalités entravent l’action collective visant à préserver les ressources naturelles… De nombreuses études ont montré comment l’inégalité nuit à la gestion durable des ressources communes car elle perturbe, démoralise et désorganise le communautés humaines » (p 92). De même, « les inégalités réduisent l’acceptabilité politique des préoccupations environnementales et la possibilité de compenser les effets socialement régressifs potentiels des politiques environnementales » (p 94).
Les horizons de la transition juste
« L’approche sociale-écologique, dont on vient de détailler les deux facettes, trouve depuis quelques années une traduction institutionnelle porteuse d’avenir dans l’idée de ‘transition juste’ qui monte en puissance dans le champ académique et dans la sphère politique. Ainsi, lors de la Cop 26 (novembre 2021), plusieurs chefs d‘état et de gouvernement ont co-signé une déclaration sur « la transition internationale juste » (p 96). Eloi Laurent nous rapporte l’évolution de cette notion. « Elle est née au début des années 1990 dans les milieux syndicalistes américains comme un projet social défensif visant à protéger les travailleurs des industries fossiles des conséquences des politiques climatiques sur leurs emplois et leurs retraites ». Ce projet a trouvé par la suite un écho dans d’autres contextes. « Dans cette perspective défensive, ce sont les politiques de transition qu’il s’agit de rendre justes. Or l’amplification des chocs écologiques (inondations, sécheresses, pandémies, etc.), indépendamment des politiques d’atténuation qui seront mises en œuvre pour y faire face, appelle une définition plus large et plus positive de la transition juste. Cet élargissement a été entamé sous l’influence de la Confédération internationale des syndicats, puis de la confédération européenne des syndicats, qui ont fait évoluer la transition juste vers une tentative de conciliation de la lutte contre le dérèglement climatique et la réduction des inégalités sociales, autour du thème des « emplois verts »… Eloi Laurent se réjouit de cette évolution, mais appelle à aller encore plus loin. « Il convient d’élargir encore le projet de transition juste en précisant ses exigences et surtout en s’efforçant de la rendre opératoire de manière démocratique… La transition juste ne doit plus seulement s’entendre comme un accompagnement social ou une compensation financière des politiques d’atténuation des crises écologiques, mais plus largement comme une stratégie de transition social-écologique intégrée » (p 97).
Eloi Laurent formule en conclusion trois exigences:
1) analyser systématiquement les chocs écologiques et les politiques correspondantes, sous l’angle de la justice sociale…
2) accorder la priorité dans les politiques de transition juste au bien-être humain dynamique éclairé par des enjeux de justice en vue de dépasser l’horizon de la croissance économique… Ce dépassement de la croissance économique est en train de devenir un élément de consensus dans la communauté globale environnementale
3) construire ces politiques de transition juste de manière démocratique en veillant à la compréhension, à l’adhésion et à l’engagement des citoyens… » (p 98).
Eloi Laurent présente ensuite la palette des transitions justes.
En économiste ouvert à un vaste horizon, Eloi Laurent nous apprend beaucoup sur la transition, un leitmotiv de notre époque. C’est ainsi que nous avons découvert son approche dans un podcast du journal Le Monde : « Comment rendre la transition heureuse », une approche qui nous a paru particulièrement ajustée (7). En présentant ce livre : « Manuel des transitions justes », nous n’en rendons compte que d’une petite part, car cet ouvrage aborde toute une gamme de questions relatives à la transition depuis : « la transition vers la préservation du monde vivant », « la transition vers la coopération et le bien-être » jusqu’à la « transition vers la pleine santé ». Il nous apparait ainsi comme une pièce marquante d’un des quelques thèmes que nous abordons sur ce blog. Certes, son propos est dense, mais il est accessible et, manifestement, il aborde la question majeure de la transition écologique sous un angle qui nous parait à la fois éthique et réaliste, cette « transition juste » qui se déploie dans une approche « social-écologique ».
J H
(1) Eloi Laurent. Économie pour le XXIe siècle. Manuel des transitions justes. La Découverte, 2023
(2) Sortir de l’obsession de l’efficience pour entrer dans un nouveau rapport avec la nature : https://vivreetesperer.com/sortir-de-lobsession-de-lefficience-pour-entrer-dans-un-nouveau-rapport-avec-la-nature/ Vers une civilisation écologique : https://vivreetesperer.com/vers-une-civilisation-ecologique/
Vers une économie symbiotique : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
(3) Face à une accélération et à une chosification de la société : https://vivreetesperer.com/face-a-une-acceleration-et-a-une-chosification-de-la-societe/
Comment la puissance technologique n’engendre pas nécessairement le progrès : https://vivreetesperer.com/comment-la-puissance-technologique-nengendre-pas-necessairement-le-progres/
(4) L’humanité peut-elle faire face au dérèglement des équilibres naturels ? : https://vivreetesperer.com/lhumanite-peut-elle-faire-face-au-dereglement-des-equilibres-naturels/
(5) Les lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/des-lumieres-a-lage-du-vivant/
(6) Réenchanter notre relation au vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/ Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
(7) Comment rendre la transition heureuse ? le Monde. Eloi Laurent : https://podcasts.lemonde.fr/chaleur-humaine/202404090500-climat-comment-rendre-la-transition-heureuse

par jean | Avr 16, 2024 | Société et culture en mouvement |
Selon David Graeber et David Wengrow
Il y a différents possibles
L’histoire contribue à former notre vision du monde. C’est dire l’importance des conceptions qui l’inspirent. Ainsi, quelle est la trajectoire de l’humanité ? Passons-nous de petites communautés plutôt égalitaires et conviviales à une société plus savante, plus riche, plus complexe, mais aussi plus inégalitaire et hiérarchisée ? Une violence humaine jugée congénitale ne peut-elle être maitrisée que par un ordre social imposé rigoureusement ? Ou bien, l’observation du passé humain, ne fait-il pas apparaitre une grande diversité de formes et d’organisations sociales qui témoignent d’une grande créativité ? Une nouvelle approche historique permet-elle d’écarter toute fatalité et d’envisager différents possibles ?
En voulant répondre à ces questions, un livre publié en 2021 sous le titre : « The dawn of everything. A new history of humanity », puis traduit et paru en français en 2023, sous le titre : « Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité » (1) est devenu un best-seller international. Ce livre a été le fruit d’un travail de longue haleine de deux chercheurs : David Graeber, anthropologue américain, un temps figure de proue du mouvement : « Occupy Wall Street », malencontreusement décédé en 2020, et David Wengrow, archéologue britannique, professeur d’archéologie comparée à Londres. Ce volume de plusieurs centaines de pages rassemble et réalise la synthèse des nombreuses recherches mises en œuvre durant les deux ou trois dernières décennies et tirant parti de nouveaux moyens techniques d’investigation.
A la mesure de son originalité, cet ouvrage a suscité un grand nombre de commentaires particulièrement dans le monde anglophone, tant dans la grande presse comme le Guardian (2) ou le Washington Post (3) que dans des publications à vocation d’étude et de recherche, commentaires où se manifestent différentes attitudes, de l’approbation et l’enthousiasme à une critique variée tant académique qu’idéologique. En France, internet nous donne accès à un article de La Croix (4) qui met bien en valeur l’originalité de ce livre : « Il n’y a pas une seule voie de civilisation qui condamnerait l’humanité à vivre dans les inégalités et une institution politique hiérarchisée. Mais mille manières de créer des systèmes de vivre-ensemble qui peuvent passer par des organisations horizontales souples et cependant sophistiquées. Avant nos villes modernes, existaient ainsi, dans différents endroits du globe, de la Mésopotamie à l’Amérique précolombienne, de vastes communautés aux relations complexes, qui ne se sont pas senties contraintes, pour subsister, de constituer un État central avec des classes distinctes ». Notre propos ici n’est pas de présenter un résumé d’un livre aussi volumineux, aussi riche et aussi ambitieux, mais seulement d’attirer l’attention sur la vision nouvelle qui nous est ainsi offerte. On notera à cet égard une interview de David Wengrow sur France Culture (5), une piste qui nous permet d’entrer dans l’esprit de cette recherche.
Histoire de l’humanité : faut-il revoir notre copie ?
« Histoire de l’humanité : faut-il revoir notre copie » ? C’est le titre donné par France Culture à un entretien avec David Wengrow (5), un titre qui nous parait bien rendre compte du sens de la grande œuvre qui nous appelle à voir l’histoire de l’humanité sous un jour nouveau en montrant le manque de pertinence des mythes fondateurs proposés par Jean-Jacques Rousseau et Thomas Hobbes, tant en les replaçant dans leur contexte historique qu’en montrant comment les recherches novelles de l’archéologie et de l’anthropologie mettent en évidence un autre déroulé à partir de faits différents.
A un moment où l’histoire de l’humanité est l’objet de nouveaux livres par des auteurs tels que Francis Fukuyama ou Yuval Noah Harari, considérez-vous votre livre comme une nouvelle pierre à l’édifice ou comme une approche de déconstruction des interprétations dominantes ? demande son interlocutrice à David Wengrow. C’est bien la voie de la déconstruction, répond l’auteur. Ces livres récents s’inspirent encore de Thomas Hobbes ou de Jean-Jacques Rousseau qui sont pour nous hors de propos selon les preuves et les découvertes dans nos disciplines : l’archéologie et l’anthropologie. Nous cherchons ainsi à mieux comprendre les premières phases de l’histoire humaine. David Wengros décrit et critique les récits fondateurs de Jean Jacques Rousseau et de Thomas Hobbes. Et, « lorsque des gens extrapolent des théories politiques à partir de ces récits, les résultats sont plutôt déprimants et même paralysants ». Ces récits comportent des visions pessimistes.
Ainsi, l’invention de l’agriculture est perçue négativement. On a pu la qualifier de « pire terreur de l’histoire ». « C’est de là qu’est venue la propriété privée et la concurrence et finalement le gouvernement centralisé. Lorsqu’on regarde les preuves issues de la recherche, nous voyons une réalité totalement différente. Tout d’abord, nous voyons, moins qu’une révolution, des processus qui ont pris des millénaires. Lorsque les êtres humains, dans les différentes parties du monde, expérimentaient les possibilités de l’agriculture », des approches différentes se manifestaient. « En d’autres termes, ce qui est perdu dans ce récit traditionnel de l’histoire humaine, c’est précisément la capacité de nos ancêtres lointains de prendre la mesure de leurs propres décisions. Nous essayons d’enlever ce sentiment d’inévitabilité ». David Wengrow estime que les sociétés humaines ont eu la capacité d’effectuer des choix, des choix raisonnés, « des choix formés par des principes moraux et éthiques. Aussi loin que nous pouvons remonter dans les preuves concernant les sociétés humaines, nous voyons des gens faire ce genre de choix ».
L’auteur peut s’appuyer sur de nombreux exemples. « Lorsque nous remontons à 20000 ou 30000 ans, là où, selon les récits traditionnels, on s’attendrait à voir de sociétés simples, égalitaires, en petits groupes, dans ces parties du monde où nous avons des preuves archéologique, ces sociétés ressemblent davantage à un carnaval, à des expérimentations sociales. Dans différentes parties de l’Europe, nous avons des preuves de rituels où des individus particuliers, des individus qui étaient inhabituels physiquement, on le voit d’après les restes humains, des individus souvent handicapés, sont enterrés avec une très grande richesse, comme des rois ou des reines. Le « comme si » est important parce que nous n’avons aucune preuve qu’à l’époque, il puisse y avoir eu des royaumes. Et donc, au sein de cette zone de théâtre rituel, les gens expérimentaient et créaient des formes, des hiérarchies qui, dans la durée de ce rituel, étaient réelles ». L’auteur met en évidence des variations saisonnières. Par exemple, dans les plaines de l’Amérique du nord, au cours de la saison de la chasse aux bisons, se formait une force de police. Mais elle se dissolvait à la fin du rituel de la chasse. Les membres de ces forces de police n’en faisaient partie qu’à titre provisoire. « C’est un exemple parmi beaucoup d’autres de la créativité politique que nous trouvons dans les sociétés qui ne pratiquent pas l’agriculture ». Par ailleurs, à propos de l’apparition de l’agriculture ou celle des villes, « cette idée que ces transformations, ces ruptures, qu’en quelques instants, tout avait changé, et qu’après, rien ne pouvait fonctionner de la même manière, cette idée ne tient plus la route face à l’examen scientifique ».
L’interlocutrice interroge ensuite David Wengrow sur la manière dont il questionne le rôle de l’état qu’on aurait surévalué, en donnant trop d’importance aux structures verticales. Cette organisation-là ne découle-t-elle pas directement de la naissance des villes ? L’auteur répond que « les musées ont une grande responsabilité à ce sujet. « Lorsqu’on va dans un des grands musées du monde, au Louvre, au British Museum, au Metropolitan, il semble qu’au moins pendant les 5000 dernières années, la planète entière était sous le contrôle des monarques surhumains… toutes ces sculptures… Je suis le grand roi de tout… Bon, on y croit… mais si on regarde l’éventail des grandes sociétés sur terre, il y a 4000 ans, il n’y avait qu’une toute petite zone sous le contrôle de ces sociétés très hiérarchisées. Que faisaient tous les autres ? On n’en sait pas grand-chose. On commence à en savoir plus et, d’une manière ou d’une autre, il est clair que, pour la plupart du temps, les gens organisaient leur société d’une autre façon. Ce que nous essayons dans le livre, c’est d’apprendre un peu mieux quelles étaient les alternatives et pourquoi aussi elles semblent éloignées de nous aujourd’hui ».
L’auteur s’intéresse également au cas de la bureaucratie. Certaines approches, sur le registre de la psychologie ou du management, nous disent que la bureaucratie a été créée pour traiter les problèmes d’échelle, de communication au sein des sociétés humaines « Toutefois, si nous considérons les recherches archéologiques nous voyons des administrations spécialisées qui apparaissent, il y a des millénaires, avant l’apparition des villes dans de petits établissements de quelques centaines d’individus. Tout le monde se connaissait. Les gens étaient probablement liés par des liens familiaux. C’est une image tellement différente de celle qui nous est donnée habituellement. Il faut faire la différence entre l’administration impersonnelle telle que nous la connaissons aujourd’hui, ce genre de bureaucratie qui nous transforme en numéros de téléphone par exemple, et d’autres types de bureaucratie qui ont existé dans l’histoire et qui n’avaient pas ce type d’effets déshumanisants ». Ainsi, en regard d‘un empire inca bureaucratique, « si vous remontez avant les incas ou si vous considérez des sociétés qui ont évité d’être contrôlées par eux, il y avait des administrations locales et elles utilisaient des outils administratifs afin d’exercer des activités de soutien. Si quelqu’un était malade ou si il y avait une mauvaise récolte, le travail serait redistribué pour soutenir une famille dans la disette… C’est un exemple d’administration qui contrairement à aujourd’hui ne dépersonnalise pas, mais s’adresse aux différences individuelles ».
L’interlocutrice élargit la conversation. Elle fait appel à un autre chercheur qui rapporte les erreurs commises en voulant imposer une monoculture ordonnée à une agriculture africaine diversifiée pour respecter les équilibres naturels, et à partir de cet exemple d’étroitesse de vue, elle pose la question à David Wengrow : « Comment décentrer notre regard ? Où faut-il regarder aujourd’hui pour comprendre ce qui se passe dans l’humanité ? ». L’auteur répond en s’appuyant sur l’exemple des sommets sur le climat : « Qui a la vision la plus claire et la plus innovante pour protéger un environnement fragile ? C’est souvent précisément les populations autochtones ». Aujourd’hui, « nous, en Europe, nous sommes en train de rejouer une rencontre avec des populations non européennes avec des systèmes de connaissance non européens qui ont débuté, il y a des siècles, et, dans notre livre, nous faisons remonter ces premières rencontres coloniales à l’âge des Lumières, et nous montrons comment, à travers ces rencontres, un mélange s’est fait jour de concepts européens et autochtones qui, essentiellement, a été effacé de nos visions modernes de l’histoire. Lorsque l’on parle des Lumières et de son héritage, nous présentons cet héritage comme une vision interne de ce processus qui se concentre sur l’Europe et peut-être aussi sur l’héritage de la Grèce antique. En fait, dans le livre, nous parlons de dettes cachées, des dettes camouflées que la culture européenne doit à d’autres cultures. Le fait de reconnaitre ces dettes peut en soi ouvrir nos yeux vers différentes façons de comprendre notre passé et aussi vers notre capacité, en tant qu’espèce, de découvrir de nouvelles capacités…. Lorsque on pense à des alternatives vis-à-vis de notre système actuel, on ferait bien de regarder au-delà de l’histoire très traumatisée des deux derniers siècles, prendre en compte cette image beaucoup plus large des capacités humaines, des possibilités humaines. La science et l’histoire le prouvent aujourd’hui ».
Revisiter l’histoire
De grands récits historiques ont été écrits à partir d’une certaine représentation des origines de l’humanité et des périodes ultérieures. Tel que l’exprime le titre de leur ouvrage : « Au commencement était … », c’est bien à partir d’une remise en cause des représentations dominantes de ces origines et d’une nouvelle vision de la préhistoire que David Graeber et David Wengrow nous proposent une nouvelle histoire de l’humanité.
Les auteurs commencent donc par entreprendre une critique rigoureuse des thèses de Jean-Jacques Rousseau et de Thomas Hobbes. Les auteurs nous rapportent les conditions dans lesquelles Jean-Jacques Rousseau a écrit et publié en 1754 « le discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes ». « En voici la trame générale. Il fut un temps où les hommes, aussi innocents qu’au premier jour, vivaient de chasse et de cueillette au sein de tout petits groupes – des groupes qui pouvaient être égalitaires justement parce qu’ils étaient si petits. Cet âge d’or prit fin avec l’apparition de l’agriculture, et surtout avec le développement des premières villes. Celles-ci marquèrent l’avènement de la « civilisation » et de « l’État », donnant naissance à l’écriture, à la science et à la philosophie, mais aussi à presque à tous les mauvais côtés de l’existence humaine – le patriarcat, les armées de métier, les exterminations de masse, sans oublier les casse-pieds de bureaucrates qui nous noient dans la paperasse tout au long de notre vie. Il va de soi que nous simplifions à outrance, mais on a bien l’impression que ce scénario de base est là pour refaire surface » (p 14).
Il existe une autre version de l’histoire, mais « elle est encore pire ». C’est celle de Hobbes. « A bien des égards, le « Léviathan » de Thomas Hobbes publié en 1651, fait figure de texte fondateur de la théorie politique moderne. Hobbes y soutient que les hommes étant ce qu’ils sont – des êtres égoïstes – l’état de nature originel devrait être tout le contraire d’un état d’innocence. On y menait certainement une existence « solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève ». En d’autres termes, c’était la guerre – une guerre de tous contre tous, Pour les tenants de cette théorie, ce n’est qu’aux dispositifs répressifs dont Rousseau déplore justement l’existence (gouvernements, tribunaux, administrations, forces de police) que nous en sommes sortis. La longévité de cette interprétation n’a rien à envier à celle de la vision rousseauiste… En vertu de cette conception, la société humaine repose sur la répression collective de nos plus bas instincts, un impératif qui se fait plus urgent à mesure que les populations se rassemblent en plus grand nombre au même endroit… » Et, au total, « les sociétés humaines, n’ont jamais fonctionné selon d’autres principes que la hiérarchie, la domination et l’égoïsme cynique qui les accompagnent. Seulement, leurs membres auraient fini par comprendre qu’il était plus avantageux pour eux de faire passer leurs intérêts à long terme avant leurs instincts immédiats – ou mieux encore à élaborer des lois les obligeant à cantonner leurs pires pulsions à des domaines qui revêtent une certaine utilité sociale…». (p15).
Les deux thèses, celle de Rousseau et celle de Hobbes nous paraissent déboucher sur des impasses en terme de résignation vis-à-vis des travers de l’inégalité sociale et d’un hiérarchisation abusive. Dans le premier cas, la complexification de la société est censée entrainer des conséquences néfastes. Dans le second cas, le mal est congénital. « Les deux versions ont de terribles conséquences politiques » (p 16), écrivent les auteurs. Mais leur opposition s’affirme également au niveau de la recherche anthropologique : « Elles donnent du passé une image inutilement ennuyeuse. Elles sont tout simplement fausses » (p 16).
Les auteurs rappellent alors les immenses progrès de la recherche en ce domaine et comment ils ont rassemblé les éléments ethnographiques et historiques accessibles. « Notre ambition dans ce livre est de commencer à reconstituer le puzzle… Un changement conceptuel est également nécessaire. Il nous faut questionner la conception moderne de l’évolution des sociétés humaines, à commencer par l’idée selon laquelle elles devraient être classées en fonction des modes de développement définis par des technologies et des modes d’organisation spécifiques : les chasseurs cueilleurs , les cultivateurs, les sociétés urbaines industrialisées, etc. En fait, cette idée plonge ses racines dans la violente réaction conservatrice qu’a provoquée, au début du XVIIIe siècle, la montée des critiques contre la civilisation européenne » (p 17).
Cet ouvrage met en évidence un nouveau paysage. « Il est désormais acquis que les sociétés humaines préagricoles ne se résument pas à de petits clans égalitaires. Au contraire, le monde des chasseurs-cueilleurs avant l’apparition de l’agriculture était un monde d’expérimentations sociales audacieuses, beaucoup plus proche d’un carnaval des formes politiques que des mornes abstractions suggérées par la théorie évolutionniste. L’agriculture, elle, n’a pas entrainé l’avènement de la propriété privée, pas plus qu’elle n’a marqué une étape irréversible dans la marche vers l’inégalité. En réalité, dans bien des communautés où l’on commençait à cultiver la terre, les hiérarchies sociales étaient pour ainsi dire inexistantes. Quant aux toutes premières villes, loin d’avoir gravé dans le marbre les différences de classe, elles étaient étonnamment nombreuses à fonctionner selon des principes résolument égalitaires, sans faire appel à de quelconques despotes, politiciens-guerriers bourrés d’ambition ou même petits chefs autoritaires » (p 16).
Ainsi, à partir de l’examen d’un grand nombre de situations, les auteurs peuvent affirmer que « l’histoire de l’humanité est moins déterminée par l’égal accès aux ressources matérielles (terres, calories, moyens de production…) si cruciales soient-elles, que par l’égale capacité à prendre part aux décisions touchant à la vie collective – la condition préalable étant évidemment que l’organisation de celle-ci soit ouverte aux discussions ». D’ailleurs, s’exclament-ils, « cette faculté d’expérimentation sociale et d’autocréation – cette liberté en somme – n’est-elle pas ce qui nous rend fondamentalement humain ? » Les auteurs se perçoivent dans une dynamique. « Nous sommes tous des projets, des chantiers d’autocréation collective. Et si nous décidions d’aborder le passé de l’humanité sous cet angle, c’est à dire de considérer tous les humains, par principe, comme des êtres imaginatifs, intelligents, espiègles et dignes d’être appréhendés comme tels ? Et si, au lieu de raconter comment notre espèce aurait chuté de haut d’un prétendu paradis égalitaire, nous nous demandions plutôt comment nous nous sommes retrouvés prisonniers d’un carcan conceptuel si étroit que nous ne parvenons plus à concevoir la possibilité même de nous réinventer ? » (p 21-22)
La « critique indigène » comme ferment d’une réflexion nouvelle sur la société européenne et d’un nouveau récit historique
Les auteurs consacrent un des premiers chapitres à « la critique indigène et le mythe du progrès ». Dès le début du XVIIIe siècle, parvient en France une information sur la vie et l’organisation sociale des populations autochtones d’Amérique du Nord. En contraste apparaissent les maux de société française. Cette « critique indigène » nourrit un bouillonnement d’idées. Une autojustification s’élabore à travers l’attribution de ces maux comme contrepartie à la complexité de la « civilisation » et au « progrès ».
Ce livre fait apparaitre le rôle joué par la découverte de civilisations étrangères et leur exemple dans l’élaboration européenne de la pensée des Lumières alors que celle-ci est
souvent présentée comme une production interne. « Du jour au lendemain, quelques-uns des plus puissants royaume d’Europe se retrouvèrent maitre d’immenses territoires. Les philosophes européens, eux, furent subitement exposés aux civilisations chinoises et indiennes, ains qu’à une multitude de conceptions sociales, scientifiques et politiques dont ils n’avaient jamais soupçonné l’existence. De ce flux d’idées nouvelles naquit ce qu’il est convenu d’appeler les « Lumières » (p 47). Cependant l’attention des auteurs va se porter particulièrement sur les relations avec les populations autochtones d’Amérique du nord, par l’entremise des colons et des missionnaires au Québec. C’est dans ce contexte que « l’académie de Dijon a jugé opportun de poser la question des origines de l’inégalité qui a suscité le célèbre écrit de Jean-Jacques Rousseau. Cet épisode « nous plonge dans la longue histoire des débats intra-européens sur la nature des sociétés du bout du monde – en l’occurrence celles des forêts de l’est de l’Amérique du nord. Nombre de ces conversations renvoyaient d’ailleurs à des échanges entre européens et amérindiens à propos de l’égalité, de la liberté, de la rationalité ou encore des religions révélées. – des sujets dont beaucoup deviendraient centraux dans la philosophie politique des Lumières » (p 49). Les écrits des missionnaires jésuites aux Québec ont été largement diffusés en France et ils rapportent la pensée critique des amérindiens sur la société française, une critique d’abord centrée sur la façon dont les institutions malmenaient la liberté, puis, après qu’ils eussent acquis une meilleure connaissance de la civilisation européenne, sur l’idée d’égalité. Si les récits des missionnaires et la littérature de voyage étaient si populaires en Europe, c’est précisément qu’ils exposaient leurs lecteurs à ce type de critique, leur ouvrant de nouveaux horizons de transformation sociale » (p 57). Les auteurs exposaient en détail les pratiques sociales des amérindiens qui amenaient ceux-ci à critiquer les comportements des colonisateurs. Ainsi, « dans ces échanges, indiens d’Amérique et européens étaient d’accord sur un constat : le premiers vivaient dans des sociétés fondamentalement libres, les seconds en étaient très loin » (p 62).
Ce livre accorde une importance particulière à un français, Lahontan, qui était entré en relation et en conversation avec un chef politique et philosophe indigène, Kandiaronk. Or, Lahontan, de retour en Europe, publia trois ouvrages sur ses aventures canadiennes. « Le troisième, publié en 1703, et intitulé : « Dialogue avec un sauvage » se composait de quatre conversations avec Kandiaronk. Le sage Wenda y portait un regard extrêmement critique sur les mœurs et les idées européennes en matière de religion, de politique, de santé et de sexualité » (p 71-72). Il s’y exprime notamment les reproches suivants : « les incessantes chamailleries, le manque d’entraide, la soumission à l’autorité, mais avec un éléments nouveau : l’institution de la propriété » (p 75). Ces échanges sont nombreux et portent sur différents thèmes. Ainsi Kandiaronk fait ressortir l’attrait que la société amérindienne peut exercer sur les européens : « Si Lahontan décidait d’embrasser le mode de vie amérindien il s’en trouverait bien plus content, passé un petit temps d’adaptation. (Il n’avait pas tort sur ce point : presque tous les colons adoptés par des communautés indigènes ont refusé par la suite de retourner vivre dans leur société d’origine) » (p 79). De fait, les livres de Lahontan ont connu un succès considérable. Ils ont exercé un grand impact. « Les réflexions de Kandiaronk n’ont cessé d’être réimprimées et rééditées pendant plus d’une centaine d’années et elles ont été traduites en allemand, en anglais, en néerlandais et en italien » (p 82).
Cependant, d’autres écrivains vantaient les aspects positifs d’autres pays exotiques. Ainsi, « Madame de Graffigny, célèbre femme de lettres, publie en 1747 un livre populaire : « Lettre d’une Péruvienne » où l’on découvre la société française à travers les yeux de Zila, princesse inca enlevée par des conquistadores espagnols… Zila critiquait tout autant le système patriarcal que la vanité et l’absurdité de la société européenne ». (p 83). Madame de Graffigny entra, à cette occasion, en correspondance avec plusieurs de ses amis, l’un de ses correspondants était le jeune Turgot, économiste en herbe, mais futur homme d’état à la fin du siècle avant la Révolution française. Les auteurs mettent l’accent sur sa réponse, très circonstanciée et très critique. C’est là en effet qu’ils voient apparaitre un récit « où le concept du progrès économique matériel a commencé à prendre la forme d’une théorie générale de l’histoire » (p 83). Et les auteurs font ressortir leur pensée à ce sujet par un sous-titre très engagé : « Où Turgot se fait démiurge et renverse la critique indigène pour poser les jalons des principales théories modernes de l’évolution sociale (ou comment un débat sur la liberté se mue en un débat sur l’égalité ) ». Dans sa réponse à Madame de Graffigny, Turgot écrit : « Tout le monde chérit les idées de liberté et d’égalité (dans l’absolu). Toutefois, il est indispensable d’adopter une vision plus globale. La liberté et l’égalité dont jouissent les sauvages ne sont pas les marques de leur supériorité, mais de leur infériorité., car elles ne peuvent régner que dans des communautés où toutes les familles sont fondamentalement autosuffisantes, c’est-à-dire où tout le monde vit dans un état de pauvreté. A mesure que les sociétés évoluent, les technologies progressent. Les différences innées de talent et de capacité, qui existent partout et toujours, se renforcent pour former la base d’une division du travail de plus en plus élaborée. On passe alors d’organisations simples comme celle des Wendas à notre « civilisation commerciale complexe où la prospérité de tous (la société) ne peut être obtenue que par l’appauvrissement et la dépossession de certains. Si regrettable qu’elle soit, cette inégalité est inévitable… La seule alternative serait une intervention massive de l’État à la manière inca – autrement dit l’instauration d’une sorte d’égalité forcée qui ne pourrait qu’étouffer l’esprit d’initiative, et donc déboucherait sur une catastrophe économique et sociale » (p 84). Quelques années plus tard, Turgot allait présenter ces mêmes idées au cours d’une série de conférences sur l’histoire mondiale… Ces conférences lui offrirent l’occasion d’approfondir son argumentation en lui donnant la forme d’une théorie générale des phases de développement économique » (p 84-85). Ainsi, il distingue des stades successifs : les chasseurs, puis le pastoralisme, puis l’agriculture, enfin la civilisation commerciale urbaine moderne. « On voit bien que c’est une réponse directe à la force de la critique indigène que furent énoncées pour la première fois en Europe les théories de l’évolution sociale… » (p 85). C’est dans ce contexte que les thèses de Jean-Jacques Rousseau sont apparues et se sont développées pour se maintenir ensuite lors de l’histoire ultérieure.
Un grand apport
Notre vision du monde dépend, pour une part importante, de la manière dont nous représentons son histoire. On comprend pourquoi plusieurs livres ont été publiés récemment dans ce domaine. L’incidence de ces thèses sur les comportements n’est pas immédiate, mais elle y contribue. Dans un monde où le poids et l’impact de structures d’oppression est grand, on peut avoir tendance à baisser les bras. Des institutions bien installées peuvent-elles être changées ? Sommes-nous enfermés dans des pratiques répétitives ? Face aux dangers actuels, la lenteur de nos réactions est-elle inévitable ?
Le livre de David Graeber et de David Wengrow est important parce que leur histoire de l’humanité nous montre qu’elle révèle différents possibles.
« Ce que nous avons voulu faire, c’est adopter une approche dans le présent – par exemple en envisageant la civilisation minoenne ou la culture Hopewell non pas comme des accidents de parcours sur une route qui menait inexorablement aux États et aux empires, mais comme des possibilités alternatives, des bifurcations que nous n’avons pas suivies. Après tout, ces choses-là ont réellement existé même si nous avons l’indécrottable habitude de les reléguer à la marge plutôt que de les placer au cœur de la réflexion… ». Ainsi, on peut nourrir d’amers regrets sur les évènements tragiques qui ont abondé dans notre passé, mais il est bon de savoir qu’il n’y a pas de fatalité. « Les possibilités qui s’ouvrent à l’action humaine aujourd’hui sont bien plus vastes que nous ne le pensons souvent ». Ne pouvons-nous pas rêver positivement avec les auteurs ? : « Imaginons que notre espèce se maintienne à la surface de la Terre et que nos descendants dans ce futur, que nous ne pouvons pas connaître, jettent un regard en arrière. Peut-être que des aspects que nous considérons aujourd’hui comme des anomalies (les administrations à taille humaine, le villes régies par des conseils de quartier, les gouvernements où la majorité des postes à responsabilité sont occupés par des femmes, les formes d’aménagement du territoire qui font la part belle à la préservation plutôt qu’à l’appropriation et à l’extraction) leur apparaitront comme des percées majeures qui ont changé le cours de l’histoire tandis que les pyramides ou les immenses statues de pierre feront figure de curiosités historiques. Qui sait ? » (p 659-660).
Certes, cette représentation de l’histoire sera accueillie différemment selon la vision du monde des lecteurs.
Dans la « Christian Scholar’s Review, Benjamin McFarland (6) reconnait l’originalité et l’importance des découvertes rapportées par David Graeber et David Wengrow. Son examen du livre s’opère sur un registre scientifique, mais aussi un registre théologique. A cet égard, il se réfère à la théorie de René Girard. « La violence mimétique est dissimulée et transférable si bien qu’il est difficile de la reconnaitre même dans une histoire bien documentée ». Il y a là une question théologique. Dans quelle mesure sommes-nous libres ? « Graeber et Wengrow mettent l’accent sur la liberté, mais négligent la contrainte ». Cependant, comme chrétien, Benjamin McFarland est reconnaissant de ce que ce livre « restaure nos ancêtres dans leur pleine humanité ». il estime que « ces exemples historiques pourraient aider l’église à imaginer une communauté radicalement différente. Les chrétiens peuvent apprendre des communautés à travers l’histoire y compris les arrangements et les attitudes concernant l’argent et la technologie. Mais je suspecte toutes les sociétés humaines de cacher de l’oppression et de la violence (juste comme l’église l’a fait historiquement et présentement). Pendant deux mille ans, le blé et l’ivraie ont grandi ensemble ». Ajoutons ici une note personnelle : la lecture de cet ouvrage nous apprend qu’il est impossible d’assigner des frontières à l’œuvre de Dieu non seulement dans l’espace, mais dans le temps.
Pour notre part, l’approche de David Graeber et David Wengrow ouvre des fenêtres en mettant en évidence les expériences positives à travers l’histoire et en mettant ainsi en évidence une gamme de possibles. En nous inspirant de la théologie de l’espérance de Jürgen Moltmann (6), nous excluons la fatalité, nous reconnaissons l’Esprit à l’œuvre et nous accueillons le futur de Dieu inspirant le présent.
« L’espérance eschatologique ouvre chaque présent à l’avenir de Dieu. On imagine que cela puisse trouver sa résonance dans une société ouverte au futur. Les sociétés fermées rompent la communication avec les autres sociétés. Les sociétés fermées s’enrichissent aux dépens des sociétés à venir. Les sociétés ouvertes sont participatives et elles anticipent… ». Il y a bien là une ouverture aux possibles.
Par définition, une histoire de l’humanité a pour conséquence d’élargir notre horizon. Mais, en l’occurrence, c’est particulièrement le cas. En effet, cet ouvrage fait apparaitre des civilisations jusque-là inconnues et surgir des modes de vie et des pratiques ignorées. Il donne droit de cité à des groupes humains méconnus. Il modifie nos angles de vue. Ainsi, il élargit considérablement notre champ de vision.
Il intervient dans un contexte où le décentrement du regard s’impose. Nous sommes appelés à nous défaire d’un point de vue surplombant l’histoire de l’occident pour l’inscrire à une juste place dans l’histoire du monde. Le mouvement est en cours. Des historiens sont en train de faire apparaitre des histoires méconnues comme celle de l’Afrique par exemple.
Les phénomènes de domination sont de plus en plus reconnus. Cet ouvrage apporte à ce mouvement une contribution majeure. Il accroit notre compréhension des peuples autochtones en Amérique du Nord et de leurs rapports avec les européens et il nous appelle à revisiter l’histoire du XVIIIe siècle et de la pensée des Lumières.
Il nous met également en garde vis-à-vis des effets simplificateurs de cette pensée. Ce fut l’idée que les peuples traditionnels, « non modernes », ne pouvaient « avoir leurs propres projets de société ou leurs propres inventions historiques. Ces peuples étaient forcément trop niais pour cela (n’ayant pas atteint le stade de la « complexité sociale ») ou bien vivaient dans un monde mystique imaginaire. Les plus charitables affirmaient qu’ils ne faisaient que s’adapter à leur environnement avec le niveau technologique qui était le leur » (p 628).
Au total, cette grande œuvre nous montre une histoire nouvelle de l’humanité qui met en valeur la créativité sociale comme la créativité technique de civilisations anciennes jusque ici oubliées, inconnues et méconnues. Le texte, en page de couverture, nous invite à une lecture approfondie de ce livre en exaltant son originalité et sa portée : « Les auteurs nous invitent à nous débarrasser de notre carcan conceptuel et à tenter de comprendre quelles sociétés nos ancêtres cherchaient à créer. Leur ouvrage dévoile un passé humain infiniment plus intéressant que ne le suggèrent les lectures conventionnelles. Un livre monumental d’une extraordinaire portée intellectuelle… » (page de couverture).
J H
- David Graeber. David Wengrow. Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité. Les liens qui libèrent, 2023, 745 p
- The Guardian. The dawn of everything. https://www.theguardian.com/books/2021/oct/18/the-dawn-of-everything-a-new-history-of-humanity-by-david-graeber-and-david-wengrow-review-have-we-got-our-ancestors-wrong
- Washington Post. The dawn of everything : https://www.washingtonpost.com/outlook/after-200000-years-were-still-trying-to-figure-out-what-humanity-is-all-about/2021/11/23/2b29ff86-4bc8-11ec-b0b0-766bbbe79347_story.html
- La Croix. Au commencement était : https://www.la-croix.com/France/Au-commencement-etait-nouvelle-histoire-lhumanite-2021-12-11-1201189722
- France Culture. Faut-il revoir notre copie ? Interview de David Wengrow : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/david-wengrow-7576492
- Jürgen Moltmann. Le Dieu vivant et la plénitude de vie : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie/
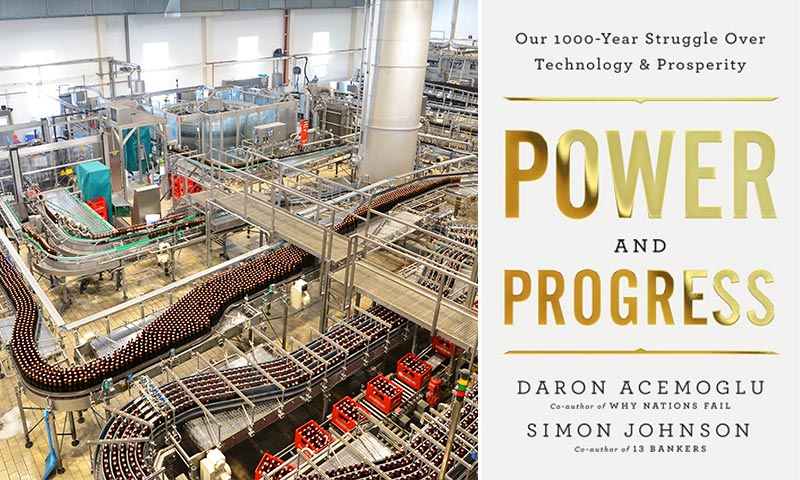
par jean | Déc 25, 2023 | Société et culture en mouvement |
Des exemples de l’histoire aux menaces actuelles.
Power and progress
Par Daron Acemoglu et Simon Johnson
Il n’y a pas très longtemps, tout ce qui paraissait un progrès technologique excitait l’enthousiasme comme la promesse d’une abondance dans une société prospère d’où disparaitrait la pauvreté et la misère. Aujourd’hui, on se rend compte qu’au cours des quatre dernières décennies, les sociétés occidentales et particulièrement la société américaine, ont pris le chemin inverse, en devenant beaucoup plus inégalitaires. Et on prend également conscience que la course au développement économique bouleverse notre écosystème planétaire et dérégule le climat par un usage forcené des énergies fossiles. Aujourd’hui, la conscience écologique suscite une réaction à l’échelle planétaire. Face à des ambitions démesurées, la prudence s’impose et on en appelle même aux mérites de la sobriété.
Deux chercheurs américains au MIT, Daron Acemoglu et Simon Johnson, directement confrontés à la course effrénée à l’automatisation qui bouleverse les équilibres de l’économie américaine, viennent d’écrire un livre qui situe nos problèmes actuels dans une histoire longue où l’on constate qu’en maintes périodes, les acquis du progrès technologique ont été confisqués par un groupe dominant aux dépens des travailleurs ayant porté cette innovation. Les auteurs nous apportent cependant une bonne nouvelle : à d’autres périodes, des forces sociales se sont élevées dans la société et ont permis un développement équilibré au bénéfice de tous. Ce livre : « Power and Progress. Our Thousand-year struggle over technology and prosperity” (1) nous montre comment garder notre autonomie par rapport aux dévoiements de processus économiques contrôlés à leur profit par des élites égoïstes ». « Le progrès n’est pas automatique, mais il dépend des choix que nous faisons en matière de technologie. De nouvelles manières d’organiser la production et la communication peuvent, soit servir les intérêts étroits d’une élite, soit devenir le fondement d’une prospérité étendue ». Ce problème est d’actualité « à un époque où les technologies digitales et l’intelligence artificielle accroissent l’inégalité et minent la démocratie à travers une automatisation excessive, une collecte massive des données et une surveillance intrusive ». « Il n’est pas obligé qu’il en soit ainsi. ‘Power and Progress’ démontre que la voie de la technologie peut être mise sous contrôle. Les formidables avancées informatique du dernier demi-siècle peuvent devenir des outils d’autonomisation et de démocratisation, mais pas si les décisions majeures demeurent dans les mains de quelques leaders technologiques animés par une hubris » (page de couverture). Ce livre, jusqu’à présent non traduit en français, est présenté en cette langue par un expert. On pourra se reporter à son article : « La chaire» a lu pour vous : https://www.chaireeconomieduclimat.org/points-de-vue/la-chaire-a-lu-pour-vous-power-and-progress-our-thousand-year-struggle-over-technology-and-prosperity-de-daron-acemoglu-et-simon-johnson/
Aussi, nous nous bornerons ici à présenter quelques aperçus significatifs de ce livre.
Comment des bénéfices de progrès technologiques substantiels ont été captés par une élite politique ou religieuse
Les auteurs remontent loin dans le passé pour mettre en évidence, la manière dont des progrès technologiques majeurs ont été captés par des élites politiques ou religieuses. Il y a environ douze mille ans, est apparu un processus menant à une agriculture installée, permanente, fondée sur des plantes et des espèces domestiquées. Des genres différents de société apparurent. Mais il y a 7000 ans, un régime particulier se développa dans le Croissant fertile. Le fondement était une agriculture avec une seule récolte. Les inégalités économiques s’intensifièrent et une haute hiérarchie sociale apparut, consommant beaucoup. En Égypte, pyramides et tombes se développèrent dans le cadre d’une élite comparable. C’est là que les auteurs mettent en évidence l’introduction des grains de céréales comme « un exemple d’innovation technologique ». Or, sous les auspices d’états centralisés, la condition des paysans semble avoir été pire que celle de leurs ancêtres. De fait, « les choix technologiques dans les premières civilisations ont favorisé les élites et appauvri la plupart des gens ». Les auteurs décriront une situation comparable au Moyen âge anglais. « Dans les deux cas, le système politique plaçait un pouvoir disproportionné dans les mains d’une élite. La coercition jouait un rôle bien sûr, mais le pouvoir de persuasion de la religion et les leaders politiques étaient souvent un facteur décisif » (p 115-120).
« Cependant, ni la monoculture du grain, ni l’organisation hautement hiérarchisée qui extorquait le surplus aux fermiers, n’a été ordonnée ou dictée par la nature des récoltes correspondantes. Même la culture de céréales n’a pas toujours produit l’inégalité et la hiérarchie comme l’illustrent les plus égalitaires vallées de l’Indus et la civilisation mésoaméricaine. La culture du riz dans l’Asie du Sud-est a pris place dans le contexte de sociétés moins hiérarchiques… (p 122).
« Contrairement à une opinion répandue, il y a eu un changement et une amélioration technologique significative dans la productivité économique de l’Europe au Moyen Age… Cependant, il y a quelque chose de tout à fait sombre à cette époque. La vie des gens travaillant la terre resta dure et le niveau de vie des paysans peut même avoir décliné dans certaines parties de l’Europe. La technologie et l’économie ont progressé d’une manière qui s‘est révélée nuisible pour la plus grande part de la population » (p 100-101). En Angleterre, le développement des moulins a été une innovation décisive. A la fin du XIe siècle, il y a environ 6000 moulins à eau en Angleterre et ce nombre a doublé durant les deux siècles suivants et leur productivité s’est accrue. La productivité agricole s’est également accrue. Malheureusement, il n’y a pas eu une élévation correspondante des revenus chez les paysans. Le surplus a été, de fait, majoritairement consommé par « la hiérarchie religieuse qui a construit des cathédrales, des monastères et des églises » (p 103). Cette construction a été couteuse. Le contrôle féodal a exercé une coercition : « Comme les nouvelles machines se déployaient et que la productivité augmentait, les seigneurs féodaux ont exploité plus intensément la paysannerie ».
Les auteurs nous rapportent ensuite comment s’est déroulée, au XVIIIe siècle en Angleterre, la pression en faveur de la clôture des terres, les « enclosures ». « Cette histoire a montré clairement que cette réorganisation technologique de la production, même lorsqu’elle était proclamée dans l’intérêt du progrès et du bien commun, avait pour conséquence de mettre davantage à bas ceux qui étaient déjà dépourvus de pouvoir ».
Les auteurs envisagent ensuite deux moments de l’histoire très différents où le progrès technologique n’a pas profité aux travailleurs, mais a participé à leur asservissement : l’introduction de l’égraineuse de grains de coton dans les plantations américaines à la fin du XVIIIe siècle ; le développement du machinisme agricole dans les années 1920 en Union soviétique. « Le secteur cotonnier a fleuri Etats-Unis grâce aux nouvelles connaissances comme l’égraineuse de coton et d’autres innovations aux dépens des esclaves noirs travaillant dans les grandes plantations. L’économie soviétique a grandi rapidement dans les années 1920 en utilisant le machinisme, tel que les tracteurs et les moissonneuses batteuses, appliqué aux champs de céréales. Cependant, la croissance s’est produite au détriment de millions de petits paysans » (p 133).
Lorsque la prospérité accompagne le progrès technologique
Les auteurs nous présentent dans ce livre une histoire du progrès technologique. Ils consacrent ainsi le chapitre 5 à la grande révolution industrielle qui a métamorphosé le visage économique de la Grande-Bretagne au XVIIIe et XIXe siècle. Ce fut l’invention bouleversante de la machine à vapeur. Ce livre nous rapporte cette épopée industrielle, le développement des mines de charbon, la fulgurante expansion des chemins de fer et une dynamique d’invention et de réalisation de nouvelles machines.
Un changement technologique et économique aussi conséquent et radical apparait dans l’histoire comme un phénomène original. Les auteurs s’interrogent donc sur les facteurs originaux de cette irruption. Ils mettent l’accent sur un facteur « souvent sous-estimé » : « l’émergence d’une classe moyenne nouvellement enhardis : entrepreneurs et hommes d’affaires. Leurs vies et leurs aspirations étaient enracinés dans les changements institutionnels qui avaient commencé à donner du pouvoir à ce milieu social depuis le XVIe et le XVIIe siècle. La Révolution industrielle peut avoir été propulsée par les ambitions de gens nouveaux essayant d’améliorer leur richesse et leur standing social, ce qui était loin d’une vision inclusive » (p 45-46).
En effet, au début de la Révolution industrielle, si des hommes ont participé à un enthousiasme innovant, « la première phase de cette Révolution a été appauvrissante et affaiblissante pour la plupart des gens. C’était la conséquence d’un fort parti pris d’automatisation et dans le manque de voix ouvrière en regard de la fixation des salaires. Ce ne sont pas seulement les moyens de subsistance qui ont été affectés négativement par l’industrialisation mais aussi la santé et l’autonomie d’une bonne part de la population.
Cette affreuse image a commencé à changer dans la seconde partie du XIXe siècle quand des gens ordinaires se sont organisés et ont provoqué des réformes politiques et économiques. Les changements sociaux ont modifié l’orientation de la technologie et fait monter les salaires. Ce fut seulement une petite victoire pour une prospérité partagée et les pays occidentaux auront à cheminer plus longuement sur un chemin contesté, technologique et institutionnel, pour réaliser une prospérité partagée » (p 56).
Selon les auteurs, l’emploi dépend des modes d‘industrialisation. Au début de la révolution industrielle, l’automatisation de la filature et du tissage a nui à l’emploi. Au contraire, dans la période ultérieure, le développement des chemins de fer a suscité toute une gamme d’emploi.
« Les avancées dans les chemins de fer suscitèrent beaucoup de nouvelles tâches dans l’industrie des transports et les emplois requéraient toute une gamme de capacités de la construction à la vente de tickets, maintenance, ingénierie, et management » (p 196). Des contrepoids sont apparus permettant le partage des bénéfices du progrès technologique. « Un machinisme et des méthodes de production se sont développés et ont accru la productivité de l’industrie britannique, en même qu’elle étendait aussi la gamme de tâches et d’opportunités pour les travailleurs. Mais le progrès technologique n’est jamais suffisant en lui-même pour élever les salaires. Les travailleurs ont besoin de développer un plus grand pouvoir de négociation vis-à-vis des employeurs ». C’est en 1871 que les syndicats devinrent pleinement légaux en Grande-Bretagne (p 202).
Il y a d’autres périodes où le progrès technologique a contribué à une diversification et à une multiplication des emplois. Les auteurs étudient en ce sens le développement de l’électrification et celui de la production d’automobiles aux Etats–Unis. Ils envisagent la grande période de progrès technologique, de croissance économique et de bien-être social qu’ont été les trois décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale. « Les Etats-Unis et les nations industrielles ont fait l’expérience d’une croissance économique rapide qui a été largement partagée par la plupart des groupes démographiques. Ces tendances économiques ont été de pair avec d’autres améliorations sociales, incluant l’expansion de l’éducation, les soins de santé et l’augmentation de l’espérance de vie. Ce changement technologique n’a pas seulement automatisé le travail mais il a aussi créé de nouvelles opportunités pour les travailleurs et ceci s’est inscrit dans un cadre institutionnel qui a renforcé les contre-pouvoirs » (p 36).
« Quelle a été la sauce secrète de la prospérité partagée dans les décennies ayant suivi la seconde guerre mondiale ? La réponse réside en deux éléments : une direction de la technologie qui a créé de nouvelles tâches et emplois pour des travailleurs de tous les niveaux de qualification et un cadre institutionnel permettant aux travailleurs de partager les gains de productivité entre employés et employeurs » (p 240). Les auteurs traitent de cette histoire aux Etats-Unis en montrant comment elle a notamment bénéficié des réformes du New Deal et il aborde cette histoire équivalente de progrès en Europe dans le contexte de la reconstruction après la guerre et un esprit social tel qu’il a été exprimé en Angleterre dans le Rapport Beveridge qui proclame « l’abolition du besoin » (p 249).
Faire face aujourd’hui à la nouvelle crise économique qui est venue s’inscrire dans la révolution digitale à travers un accroissement des inégalités et la menace d’une automatisation dévastatrice.
Née aux Etats-Unis et portant d’extraordinaires promesses, la révolution digitale y a été détournée à la fin du XXe siècle. « Les technologies digitales sont devenues le cimetière de la prospérité collective. L’augmentation des salaires a baissé, la part du travail dans le revenu national a diminué fortement et l’inégalité des salaires a surgi autour de 1980. Bien que de nombreux facteurs, incluant la globalisation et l’affaiblissement du mouvement syndical, aient contribué à cette transformation, le changement opéré dans la technologie est le plus important. Les technologies digitales ont automatisé le travail et désavantagé le travail par rapport au capital et les travailleurs peu qualifiés par rapport aux diplômés universitaires » (p 257). Dans la plupart des économies industrialisées, la part du travail a diminué. Aux Etats-Unis, la régression a pris un tour particulièrement défavorable. Un fossé s’est à nouveau accru entre les salaires des blancs et des noirs. L’inégalité s’est considérablement accrue.
Les auteurs en imputent la cause principale à un automatisation massive. Dans les décennies précédant la seconde guerre mondiale, l’automatisation est également rapide, « mais elle était contrebalancée par d’autres changements technologiques qui augmentaient la demande de travail.
La recherche récente montre que depuis 1980, l’automatisation s’est accélérée significativement et qu’il y a moins de tâches et de technologies nouvelles qui créent des opportunités pour les gens. Ces changements entrent pour beaucoup dans la détérioration de la position des travailleurs dans l’économie…
L’automatisation a été aussi un accélérateur majeur de l’inégalité en affectant des tâches remplies particulièrement par des travailleurs peu ou moyennement qualifiés » (p 261).
Les auteurs soulignent qu’il n’y a pas là une fatalité. « La technologie a accru les inégalités à cause des choix que des entreprises ou de puissants acteurs ont effectué. La globalisation n’est pas séparée de cette question… De fait, il y a eu une synergie entre automatisation et globalisation avec le même souci de réduire les coûts du travail et le nombre de travailleurs moins qualifiés. Ce processus a été facilité à la fois par le manque de contre-pouvoirs dans le milieu du travail et par l’évolution politique depuis 1980 (p 263). Les auteurs dressent un tableau des pressions exercées par les grandes entreprises et les milieux d’affaire et ils mettent en évidence les idéologies correspondantes telles que la « doctrine Friedman ». Dans d’autres pays, les dérives ont été moins marquées. Les auteurs mentionnent les cas de l’Allemagne et du Japon où on a combiné l’automatisation et la création de tâches nouvelles (p 286).
Les auteurs critiquent une nouvelle ‘utopie digitale’ : « la transformation de l’éthique des hackers en une utopie digitale corporative est largement liée à une poursuite de l’argent et du pouvoir social » (p 289). C’est une idéologie de la ‘disruption’, une forme sauvage d’innovation qui détruit les anciens équilibres. « Ce biais technologique est très largement un choix, et un choix construit socialement. Alors les choses ont commencé à devenir bien pires économiquement, politiquement et socialement, alors que les nouveaux visionnaires trouvent un nouvel outil pour refaire la société : l’intelligence artificielle » (p 296).
Pourquoi considérer l’intelligence artificielle avec réserve et avec prudence
Dans la perspective de l’histoire récente de l’usage d’internet, l’emballement de certains vis-à-vis de la promotion de l’intelligence artificielle parait suspect.
Les auteurs consacrent un chapitre à l’intelligence artificielle en en montrant les usages potentiels, les apports, les risques et aussi les limites. Nous renvoyons à ce chapitre écrit avec maitrise et expertise ; ‘Artificial struggle’ (p 297-338). Nous en rendrons compte ici par une courte présentation des auteurs. « Ce chapitre explique que la vision d’internet post-1980 qui nous a égarés, en est venue aussi à définir comment concevoir la nouvelle phase des technologies digitales, ‘l’intelligence artificielle’ et comment l’intelligence artificielle exacerbe les tendances vers l’inégalité économique.
En contraste des proclamations effectuées par beaucoup de leaders de la tech, nous verrons aussi que dans la plupart des tâches humaines, les technologies actuelles de l’intelligence artificielle apportent seulement des bénéfices limités. De plus, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la surveillance au lieu de travail ne propulse pas seulement l’inégalité, mais elle prive également les travailleurs de leur pouvoir d’action (disempower). Pire, un usage courant de l’intelligence artificielle risque de renverser des décennies de gain économique dans les pays en développement en exportant globalement l’automatisation. De tout cela, rien n’est inévitable. Ce chapitre développe une argumentation selon laquelle l’intelligence artificielle, et même l’accent sur l’intelligence de la machine, reflète une approche très spécifique du développement des technologies digitales, une approche qui a de profonds effets dans la répartition des richesses, en bénéficiant à quelques personnes et en laissant le reste derrière.
Plutôt que de se focaliser sur l’intelligence des machines, il serait plus profitable de lutter pour une utilité des machines (‘machine usefulness’) en envisageant combien les machines peuvent être très utiles aux humains, par exemple en complétant les capacités des travailleurs. Comme elle s’est mise en œuvre dans le passé, l’utilité des machines conduit à quelques-unes des applications les plus importantes et les plus productives des technologies digitales, mais qui ont été de plus en plus mises de côté par l’intelligence de la machine et l’automatisation » (p 37).
Cependant l’intelligence artificielle se déploie à un autre niveau, au niveau de la société elle-même. Et elle y pose problème, car « la collecte et la moisson massive de données utilisant l’intelligence artificielle sont en voie d’intensifier la surveillance des citoyens par les gouvernements et les entreprises. En même temps, les modèles d’affaire fondés sur la publicité s’appuyant sur la puissance de l’intelligence artificielle propagent la désinformation et amplifient l’extrémisme ». Les auteurs nous mettent ainsi en garde vis-à-vis de l’intelligence artificielle. « Son utilisation courante n’est bonne ni pour l’économie, ni pour la démocratie et ces deux problèmes malheureusement se renforcent l’un l’autre ». (p 37)
Dans la situation critique dans laquelle nous nous trouvons, comment réorienter la technologie ?
Les auteurs ne se bornent pas à un diagnostic critique de la situation. Déjà, à travers l’examen de l’histoire longue auquel ils ont procédé, nous avons compris que le progrès technologique n’est pas une panacée, que ses effets dépendent d’un contexte plus général, des orientations qui sont prises, d’un choix de société. Bref, le progrès technologique n’est pas la réponse à tous nos problèmes. Et on peut, on doit ne pas considérer son orientation présente comme une fatalité.
Dans le dernier chapitre du livre, les auteurs nous apprennent et nous invitent à rediriger le changement technologique (‘redirecting technology’).
Aujourd’hui rediriger le changement technologique, c’est en premier, faire face à la menace existentielle du changement climatique. Or, à cet égard, il y a eu « de remarquables avancées dans les technologies de l’énergie renouvelable ».
Finalement, « Aujourd’hui, les énergies du soleil et du vent sont produites à meilleur marché que les énergies fossiles » (p 389). La différence est devenue significative. Comment ce changement a-t-il pu intervenir ? Les auteurs mettent l’accent sur le rôle du ‘changement de narratif’ ; du développement du mouvement écologique qui s’en est suivi et l’a accompagné, et des mesures qui en sont résultées.
« Du point de vue du défi posé par les technologies digitales, on peut apprendre beaucoup de la manière dont la technologie est redirigée dans le secteur de l’énergie. La même combinaison – changer le narratif, développer des pouvoirs faisant contrepoids et développer et mettre en œuvre des politiques spécifiques – voilà ce qui peut également marcher pour rediriger la technologie digitale» (p 392). Les auteurs posent les problèmes de la technologie digitale en ces termes : « La puissance concentrée des entreprises digitales nuit à la prospérité parce qu’elle limite le partage des gains réalisés grâce au changement technologique. Mais son effet le plus pernicieux se manifeste dans l’orientation de la technologie qui se dirige excessivement vers l’automatisation, la surveillance, la collecte des données et la publicité. Pour regagner une prospérité partagée, nous devons rediriger la technologie et cela signifie une version de la même approche que celle qui a fonctionné pour les progressistes, il y a plus d’un siècle » (p 393). « Cela doit commencer par changer le narratif et les normes ». On retrouve dans ce chapitre les mises en garde et les orientations qui parcourent cet ouvrage avec comme grandes recommandations : changer le narratif, bâtir des pouvoirs faisant contre-poids et développer des techniques, des régulations et des politiques pour traiter des aspects spécifiques du biais social de la technologie » (p 38). Voilà un ouvrage auquel nous pouvons nous référer pour mieux comprendre les enjeux actuels de la technologie digitale et faire face aux menaces présentes.
J H
- Daron Acemoglu, Simon Johnson. Power and Progress. One thousand-year struggle over technology and prosperity. London, Basic Books, 2023.

par jean | Déc 25, 2023 | Société et culture en mouvement |
L’effondrement est-il fatal, ou bien, au contraire, rien n’est joué.
La science contre les théories de l’effondrement.
Aujourd’hui, face aux menaces du dérèglement des équilibres naturels engendré par un accroissement effréné de la production industrielle, la prise de conscience écologique se développe et elle s’accompagne de la mise en évidence des dangers encourus. Certes, une mobilisation est en cours pour développer de nouvelles pratiques économiques et un nouveau genre de vie. Cependant, autant l’alarme est nécessaire pour favoriser cette mobilisation, autant elle peut se prêter à des excès qui engendrent la peur au point que celle-ci débouche sur le désespoir, le fatalisme, la résignation. C’est ainsi qu’au cours des dernières années, s’est développé un courant de pensée influant qui envisage l’avenir en terme d’effondrement. Dans un livre : « « Comment tout peut s’effondrer », des chercheurs, par ailleurs reconnus, Pablo Servigne et Raphaël Stevens se proposent d’aborder dans une perspective scientifique l’effondrement systémique global de la civilisation industrielle et des grands équilibres des écosytèmes, en désignant cette approche sous le vocable de « collapsologie ». Si l’alarme nécessaire vis-à-vis des menaces de dérèglement des équilibres naturels, peut susciter une eco-anxiété et, en réponse, un nouveau mode de pensée (1), elle peut dégénérer en se focalisant sur la crainte d’un effondrement, car une telle fascination engendre le fatalisme. C’est pourquoi, un chercheur, bien connu sur ce blog, Jacques Lecomte, vient d’écrire un livre où il s’élève contre ‘l’effondrisme’ : « La science contre les théories de l’effondrement ». Le titre principal, ‘Rien n’est joué’ (2) manifeste son refus du fatalisme. Expert français en psychologie positive, Jacques Lecomte a appris comment la focalisation sur le négatif entrainait un enfermement dans ce registre. Et à l’inverse, il y a une dynamique du bien. C’est pourquoi Jacques Lecomte a écrit un beau livre sur « la bonté humaine » (3). Par la suite, il a mis en évidence les expériences positives des « entreprises humanistes » (4 ). Et enfin, désirant encourager la confiance, il a publié en 2017,un livre visant à enrayer le pessimisme collectif : ‘Le monde va beaucoup mieux que vous ne croyez’ (5). On comprend donc pourquoi aujourd’hui Jacques Lecomte s’attelle à la tâche de réfuter les thèses de « l’effondrisme ».
Jacques Lecomte partage notre souci de sauvegarder la Terre. Il n’est pas climatosceptique. Au contraire, « c’est précisément parce que l’état de notre environnement me préoccupe fortement que je m’intéresse aux solutions déjà existantes. Car il y a urgence face au réchauffement climatique d’origine humaine, à la destruction de la nature et à de nouvelles formes de pollution ». Mais, selon l’auteur, « les effondristes contemporains affirment au contraire qu’il n’y a pas de solutions aux problèmes, que les seules actions envisageables consiste à s’adapter à une situation environnementale insoluble » (p 10). « L’objectif de ce livre est d’évaluer la qualité scientifique de ce courant de pensée ». Pour Jacques Lecomte, cette intervention n’allait pas de soi. « J’ai pour habitude, dans mes écrits, conférences et formations de valoriser des informations positives, non de critiquer. De plus, en commençant l’écriture de ce livre, j’étais embarrassé de contester les propos de personnes dont je partage la préoccupation environnementale et l’aspiration à une société plus fraternelle. Mes lectures m’ont cependant amené progressivement à cette conviction : le discours effondriste est non seulement scientifiquement faux, mais il a de plus des effets néfastes psychologiques, politiquement et environnementalement. Comprendre cela a été pour moi l’argument décisif. S’il pouvait limiter la vague actuelle d’éco-anxiété et redonner de l’espoir et l’envie d’agir fortement pour améliorer notre monde, j’en serais ravi. La première raison d’être de ce livre est donc de montrer à celles et ceux qui le liront que rien n’est joué, qu’il est encore possible d’agir efficacement » (p 11).
Jacques Lecomte a donc entrepris un travail considérable d’analyse des textes en les confrontant avec d’autres recherches et avec les données pouvant être mises en évidence. Et par exemple, la prédiction de telle pénurie de matières premières à telle date s’est-elle réalisée ?
Le livre se compose de deux parties : la critique des points fondamentaux de l’approche effondriste ; une analyse des modes de pensée entrainant des dérives dans les conclusions. Nous nous limiterons ici à une courte présentation de la remise en cause de conclusions effondristes.
Les pionniers de l’effondrisme. Prophéties ratées et cruauté politique
Quels sont les auteurs auxquels les penseurs de l’effondrisme se référent et dont ils s’inspirent ? En quoi leurs théories sont-elles profondément critiquables ?
« Nous ne pouvons comprendre les effondristes contemporains que si nous analysons en premier lieu les pensées et les actes des précurseurs dont ils se disent héritiers. Ces auteurs sont généralement présentés par les effondristes comme des sources scientifiquement et moralement fiables. Il s’agit principalement de Thomas Malthus, Paul Ehrlich, Garrett Hardin, Denis Meadow et ses collègues, Jared Diamond » (p 21). Jacques Lecomte nous montre à travers des citations de personnalités effondristes combien ils sont influencés par la pensée Malthusienne. Le livre majeur de Malthus, publié en 1798, est intitulé : « Essai sur le principe de population ». L’idée centrale de ce livre est que « la population humaine augmente à un rythme bien plus rapide que notre capacité à produire l’alimentation nécessaire ». Jacques Lecomte rappelle les incidences cruelles de la pensée malthusienne qui impute leur sort aux pauvres et n’hésite pas à considérer la mortalité comme un moyen de limiter la population. Sa théorie a inspiré des mesures grossièrement antisociales dans l’Angleterre du XIXe siècle. A partir des données existantes, Jacques Lecomte réfute les thèses de Malthus : « Il n’y a pas augmentation exponentielle de la population… La production alimentaire suffit à nourrir la population mondiale… Les famines ne résultent pas des pénuries alimentaires, mais de choix politiques… C’est la pauvreté qui entraine la croissance démographique, non l’inverse… L’aide sociale n’incite pas les pauvres à se reproduire… » (p 26-28). L’auteur décrit « les terribles conséquences des pratiques malthusiennes » comme la grand famine en Irlande (1845-1850) et la grande famine en Inde (1876-1875) (p 30-31).
Ce tableau est si sombre qu’on peut se demander comment des auteurs peuvent aujourd’hui évoquer son inspiration « Malthus a été le premier auteur à introduire la notion de rareté en économie. C’est surtout à ce titre qu’il est suivi par des auteurs contemporains qui s’affirment malthusiens ou néo-malthusiens… » Les emprunts à sa pensée varient également. « Malthus se préoccupait surtout de la production alimentaire tandis que les continuateurs actuels soulignent que les ressources naturelles sont limitées. C’est l’interprétations que soulignent Pablo Servigne et Raphaël Stevens… en nous rappelant que nous ne pouvons pas croître indéfiniment dans un monde fini ». Mais, nous dit Jacques Lecomte : « On ne peut présenter Malthus comme un écologiste avant l’heure, alors que sa préoccupation était toute autre, et ses propositions particulièrement brutales » (p 24).
Lorsqu’on s’oppose à une croissance sans frein génératrice du désordre naturel, on considère souvent le rapport Meadows, le rapport du Club de Rome publié en 1972 ; les ‘limites de la croissance’ comme un avertissement précurseur. Jacques Lecomte nous montre en quoi le rapport Meadows est cependant critiquable. « Certes les auteurs du rapport Meadows décrivent des impacts néfastes de l’action humaine (déchets nucléaires, pollution de l’eau et de l’air, pesticides), mais cela reste secondaire dans l’ouvrage. L’alerte environnementale constitue moins d’un dixième du propos. Comme beaucoup d’autres écrits effondristes contemporains, ce document met essentiellement en garde contre le risque de proche effondrement de notre société industrielle par manque de matières premières… » (p 47). Cependant, on constate maintenant que les prévisions du rapport ne se sont pas réalisées. « Les dates prévues de pénurie de matières premières devant conduire à l’effondrement se sont toutes révélées fausses » (p 49). De fait, on peut voir de ‘multiples biais méthodologiques’ dans ce rapport (p 60-55). Les erreurs de prévision ne sont pas sans conséquences. « Le fondement malthusien du rapport conduisait à dire qu’il y a sur terre trop de personnes, comparé aux ressources restreintes de la planète ». Un chercheur chinois a propagé cette vision en Chine et « la politique de l’enfant unique » en a été une « tragique application » (p 62-63).
Jacques Lecomte évoque un autre auteur qui est maintenant renommé et exerce une influence auprès des auteurs effondristes. Jared Diamond est devenu célèbre en publiant en 2005 un ouvrage intitulé ‘Effondrement’ dans lequel il affirme que « plusieurs facteurs expliquent la disparition ou la fragilisation de certaines civilisations telles que les Incas, les habitants de l’Ile de Pâques, les Vikings… Ces causes sont principalement des dommages environnementaux, des changements climatiques, des voisins hostiles, des rapports de dépendance avec des partenaires commerciaux et les réponses apportées par chaque société à ces problèmes. Le sous-titre ‘Comment les société décident de leur disparition ou de leur survie’ précise bien les intentions de l’auteur » (p 64). Ce livre a rencontré un grand succès. « Il est devenu un best-seller mondial très souvent cité par les auteurs catastrophistes qui insistent sur les dommages environnementaux comme source d’effondrement ». Or, ces explications sont maintenant contestées. « Des dizaines d’experts, des centaines de pages ont remis en question l’ensemble de l’édifice élaboré par Diamond. En 2010, un groupe d‘universitaires s’est réuni à l’université de Cambridge pour analyser le concept d’effondrement en histoire et en archéologie. Un consensus a émergé selon lequel l’effondrement sociétal est un concept fuyant qui résiste à tout tentative de définition simple et les vrais effondrements sociaux sont rares. Ce que constatent les spécialistes, ce sont plus des déclins et des transformations que des chutes brusques. Certes, ces chercheurs ne nient pas que des désastres surviennent, mais ils notent une considérable résilience des peuples en réponse à toutes sortes de difficultés et changements environnementaux » (p 64). « La résilience est la règle plutôt que l’exception lorsque ces sociétés ont dû faire face à des problèmes extrêmes » (p 65). Jacques Lecomte étudie ensuite le cas emblématique de l’Ile de Pâques dans le Pacifique. « Diamond affirme que les habitants de l’île ont pratiqué un « écocide » en détruisant leur forêt ce qui a conduit à leur propre destruction » (p 66). Or, d’autres chercheurs ont contesté les arguments de Diamond. Ainsi, ce n’est pas le transport des grandes statues de l’Ile de Pâques qui a nécessité et entrainé la déforestation. Et l’effondrement de la population n’a pas eu lieu avant l’arrivée des européens. Ces critiques sont trop souvent ignorées par les medias qui continuent à faire l’apologie du livre de Diamond (p 66-70).
En conclusion de ce chapitre, Jacques Lecomte réitère sa critique du rapport Meadows en s’inspirant d’un autre modèle, celui du rapport Bariloche, qui, à l’encontre d‘une croissance zéro, met en évidence les besoins des pays non occidentaux. « Les problèmes les plus importants que le monde moderne doit affronter ne sont pas d’ordre physique, mais sociopolitique et proviennent d‘une distribution inégale du pouvoir tant sur le plan international qu’au sein des pays eux-mêmes » (p 72). « Une autre vision – humaniste – du monde est possible » conclut Jacques Lecomte (p 71).
Une autre composante de l’effondrisme : une annonce de la pénurie de matières premières
Jacques Lecomte consacre un chapitre à réfuter la thèse d’une pénurie imminente de matières premières : « La pénurie imminente de matières premières constitue la pièce maîtresse de l’effondrisme. Enlevez pétrole, charbon, gaz, métaux et minerais, et notre civilisation moderne s’effondre… Le pic de matières premières, c’est-à-dire le moment où la production mondiale atteint son maximum, puis décline, est donc au cœur de ce discours. Or affirmer que nous sommes au bord d’une pénurie mondiale de matières premières résulte d’une lecture biaisée des données scientifiques existantes ». L’auteur peut ainsi relever un grand nombre de prédictions alarmistes qui se sont révélées fausses. « Depuis 1860, on observe de multiples alertes sans fondement ». Bien plus, Jacques Lecomte renverse cette perspective : une gestion économe des ressources est un moyen de lutter contre une croissance effrénée. « Le vrai problème n’est pas que nous allons manquer de pétrole et de minerais, mais que nous en avons beaucoup trop à disposition. L’enjeu majeur n’est dons pas l’imminence de la pénurie de matières premières, mais la décision de laisser dans le sol des quantités considérables de ces produits » (p 75-76). Les nombreuses analyses de ce chapitre se fondent sur des études de cas particulièrement documentées. L’approche est logique : « Croire ou se faire croire à la pénurie imminente de matières premières, c’est perpétuer le système actuel. Un monde reposant essentiellement sur une énergie carbonée et c’est inacceptable d’un point de vue environnemental » (p 102). « La transition énergétique par contrainte liée au pic des matières premières est un mythe. En revanche, l’essor de cette transition par décision est possible… » (p 103).
Le climat. « Comment les effondristes maltraitent les rapports du GIEC et se trompent sur les peuples du sud ».
Nous voici en présence du problème majeur : la menace d’un bouleversement climatique. Sur ce point, nous avons tous besoin d’un éclairage objectif et porteur d’un espoir mobilisateur. L’apport de Jacque Lecomte va se révéler précieux.
« Le changement climatique est le problème environnemental majeur. Nous sommes alertés depuis plus de trente ans par les rapports successifs du CIEC (groupe intergouvernemental sur l’évolution de climat), ce réseau international d’experts, dont la mission est d’évaluer et de diffuser l’état des connaissances sur le réchauffement climatique et ses conséquences » (p 105). Les travaux du GIEC sont devenus de plus en plus précis et assurés. « Le consensus scientifique sur l’origine humaine du réchauffement climatique est aujourd’hui impressionnant ». On peut constater que la plupart de ses prédictions climatiques se révèlent exactes (p 106). Jacques Lecomte remarque alors que les messages du GIEC peuvent être déformés aussi bien par les effondristes que par les climatosceptiques. Il sait critiquer certains articles envisageant «une terre bientôt inhabitable » (p 111-117) en montrant combien leurs références sont peu fiables et en mentionnant les oppositions qui leur sont faites. Dans certains cas, Jacques Lecomte redresse quelques images catastrophiques qui viennent alimenter notre eco-anxiété telles qu’un probable engloutissement du Bangladesh ou des îles des océans Indien et Pacifique sous les eaux.
« Le Bangladesh est l’un des pays les plus sujets aux catastrophes naturelles, indépendamment même du changement climatique. Environ 80% du Bangladesh est composé de l’immense delta du Bengale alimenté par trois fleuves… Chaque année, entre un cinquième et un tiers du pays est inondé et ce taux peut s’élever jusqu’à 70%. Il s’agit d’inondations temporaires. La plus grande partie du pays est située à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer et les vastes zones côtières à moins de 1 mètre… » (p 118). Toutefois, ces inondations sont à la fois destructrices et productrices en dépôt d’alluvions. Selon le GIEC, la mer s’élèvera de 26 cm à 98 cm en 2100. Mais les conséquences sont évaluées différemment selon les auteurs. Jacques Lecomte réfute un scénario dramatique. Il se réfère à un géographe anglais expert du Bengale, Hugh Brammer. « Selon lui, la géographie physique et la zone côtière du Bangladesh sont plus diverses et dynamiques qu’on ne le pense généralement. C’est une erreur de penser que cette élévation va submerger la côte » (p 119). Et, en raison des alluvions apportés par les fleuves, on note même des gains de terre au long des années. Par ailleurs, les habitants de ce pays ne sont pas passifs. On peut constater de nombreuses innovations. Et, par exemple, « de vastes bâtiments sur pilotis en béton ont été construits ». Ils servent de refuge en cas d’inondation. En même temps, les services d’alerte sont perfectionnés. On observe dans ce pays une grande ingéniosité. On y compte, par exemple, de multiples innovations agricoles comme des variétés de riz résistantes à la salinité… Una attention particulière est portée aux « charlands », ces iles qui se forment grâce à l’accumulation des sédiments. « Lorsque le « charland » est stabilisé, l’État met en place un système permettant à des familles de devenir propriétaires du lieu qu’elles occupent. La gestion des ressources naturelles est communautaire ». A la lecture de cette description, notre représentation change. « En parlant de 60 millions de Bangladais privés de terre, les effondristes nous les présentent comme une masse indifférenciée et impuissante, alors qu’il s’agit de personnes actives et efficaces, généralement structurées en communautés solidaires. Confrontés à l’adversité depuis toujours, les Bangladais ont su faire preuve de créativité et obtiennent de remarquables résultats » (p 124).
Jacques Lecomte nous permet également de reconnaitre le potentiel de résistance des îles du Pacifique menacées par la montée du niveau de la mer. De fait, les phénomènes naturels ne comportent pas uniquement des aspects négatifs. Ainsi « les vagues transportent, puis déposent sur la côte du sable, du gravier, et des parties de coraux… ». D’autre part, les coraux sont des organismes réactifs. Un expert peut écrire : « L’accumulation de données scientifiques montre que les îles réagissent à l’élévation du niveau de la mer. De nombreuses possibilités d’adaptation permettent aux habitants des îles de continuer à mener une bonne vie. Le défi est de savoir comment y arriver, ce qui est politique… » (p 128). « On ne doit pas minimiser l’importance de la résilience et des actions des communautés locales » souligne Jacques Lecomte.
Au total, ce chapitre nous parait analyser en profondeur les problèmes en recherchant, en même temps, les voies de solution. Ainsi, intitule-t-il son dernier texte ‘Face aux mythes déprimants et stigmatisants, une réalité porteuse d’espérance’. Là encore, il apporte un exemple positif. Face aux tensions et aux conflits suscités par le problème du partage de l’eau, il nous décrit « les fréquents exemples de diplomatie de l’eau ». C’est par la négociation et la coopération que les problèmes partagés ont le plus de probabilités d’être réglés » (p 150).
La biodiversité. Dramatiser la crise est aussi néfaste que la nier
« La nature est en danger. C’est incontestable ». « Une partie de la biodiversité est clairement en grande difficulté ». L’auteur en donne quelques exemples : « la réduction des écosystèmes sauvages » ; « l’effondrement de nombreuses espèces d’amphibiens » ; « le déclin des insectes » ; « le déclin des oiseaux communs d’Europe et d’Amérique du Nord ». Comment Jacques Lecomte envisage-t-il la situation ? « Tout cela est préoccupant. Il n’y a donc nul besoin de noircir le tableau pour en percevoir la gravité. C’est malheureusement ce qui est souvent fait, que ce soit par des experts, des militants, ou des journalistes. J’analyse dans les pages qui suivent des arguments fréquemment mis en avant par des partisans d’une vision catastrophique. L’information objective sur les problèmes diffère nettement de l’extrémisme catastrophique » (p 165). L’auteur critique notamment la prédiction d’une prochaine « extinction ce masse ». Il y a un immense écart entre les prédictions catastrophiques d’espèces devant s’éteindre (jusqu’à un million) et la réalité (quelques centaines en plusieurs siècles) (p 166). De fait il y a des espèces perdantes, mais aussi des gagnantes grâce à l’action militante » (p 169). Ainsi, si il y a une perte massive de certains oiseaux familiers en Europe ( alouette, étourneau, moineau domestique), il y aussi des espèces rares et menacées qui se portent mieux. « Par exemple, la population des grues cendrées a été multipliée par 5. Les oiseaux rares européens sont en pleine renaissance. De forts progrès qui consacrent des années d’efforts des naturalistes et des politiques de protection » (p 171). Au total, « il n’y a donc pas un effondrement généralisé de la biodiversité, mais plutôt trois situations. Une majorité d’espèces sont stables. Il y a le groupe minoritaire des espèces perdantes et les espèces gagnantes » (p 170). L’auteur fait apparaitre des biais dans l’examen des espèces menacées. Ainsi, « lorsqu’une espèce entre dans la catégorie ‘préoccupation mineure’, elle ne peut plus jamais s’améliorer, même si sa population augmente considérablement » (p 184). En France, de nombreux mammifères sont en grande augmentation, tels les chevreuils, les cerfs, les chamois, les castors, les sangliers. Les castors se sont multipliés par 100 en un siècle (p 185). Sur de nombreuses pages, l’auteur procède à un examen détaillé des informations sur des pertes jugées catastrophiques. Par un travail minutieux, la confrontation de recensements, il met en évidence des abus de dramatisation. Il montre notamment les réussites des législations protectrices, par exemple dans le cas des rhinocéros d’Afrique et des loutres de mer (p 204-208).
Ainsi apparait un tableau moins sombre que celui qui nous est présenté par les médias.
On peut se demander si cette moindre dramatisation ne risque pas d’engendrer une démobilisation. Jacques Lecomte s’est posé cette question et il y répond. « Pour ma part, en écrivant ce chapitre, ne serais-je pas en train de tirer contre mon propre camp, celui des amoureux de la nature ? Je ne le pense pas pour trois raisons ; d’objectivité et de crédibilité, d’efficacité ; de vision existentielle. » (p 211). « Si on nous donne l’impression que la situation est désespérée, on pensera qu’il est trop tard pour changer de cours. Ce qui est faux. Quand on prend des mesures énergiques, on obtient des résultats… Les recherches en sciences humaines montrent que la communication par les expériences positives et l’espoir est plus efficace que la communication par la catastrophe. Informer prioritairement sur la baisse de la biodiversité, voire sur les risques d’extinction d’espèces, était certainement utile, il y a une cinquantaine d’années, et cette démarche a conduit à prendre des mesures, dont certaines se sont révélées très efficaces. Mais la situation n’est plus la même aujourd’hui, car, à côté des menaces pesant sur la nature, nous disposons d’une histoire riche de multiples succès, qu’il est nécessaire de faire connaitre pour les multiplier » (p 211). « Une dernière raison pour laquelle j’assume pleinement l’orientation de ce chapitre est existentielle. Je considère que s’émerveiller de la renaissance de la nature est une source de sens à la vie bien plus puissante que d’être obnubilé par sa destruction » (p 213). Le chapitre se conclut par une réflexion stratégique. Comment améliorer la conservation de la nature et la protection de la biodiversité ? De plus en plus, en partageant les expériences de réussite des actions entreprises.
Comment se produisent les déformations dans l’appréhension du réel qui abondent dans la pensée effondriste ?
Jacques Lecomte consacre la seconde partie de son livre à une confrontation avec la pensée effondriste et, en d’autres termes, avec la collapsologie. On se reportera particulièrement au chapitre sur les biais cognitifs. Une citation de Karl Popper exprime bien les intentions qui instruisent ce chapitre : « Si nous ne prenons pas une attitude critique, nous trouverons toujours ce que nous désirons ; nous rechercherons, et nous trouverons la confirmation ; nous éviterons et nous ne verrons pas tout ce qui peut être dangereux pour nos théories favorites. De cette façon, il n’est que trop aisé d’obtenir ce qui semble une preuve irrésistible en faveur d’une théorie qui, si on l’avait approché d’une façon critique, aurait été réfutée ».
Ce livre porte sur des questions fondamentales. Comment faire face aux menaces vis-à-vis de la poursuite de notre humanité dans son environnement naturel ? Et donc comment évaluer cette menace et développer de bonnes stratégies ? Dans cette recherche, ce livre est très original dans sa quête d’objectivité et son approche positive. En s’affrontant à la collapsologie et à la pensée effondriste, il nous prémunit vis-à-vis de la tentation du défaitisme, il vient nous encourager dans l’espérance. Oui, « s’émerveiller de la renaissance de la nature est une source de sens à la vie ».
Cependant, ce livre se caractérise par un travail considérable dans la confrontation des données et la recherche des sources. il nous apprend à évaluer l’information dans un monde où cette démarche est difficile. Et, à cette intention, il mobilise une immense documentation. A cet égard, c’est un outil de travail pour tous ceux qui travaillent dans les médias. Il y a trop d’idées toutes faites dans une fascination de la dramatisation. Cet ouvrage est donc un livre de référence. Ici, Jacques Lecomte poursuit son œuvre qui est de nous éclairer dans une approche positive.
J H
- L’espérance en mouvement : https://vivreetesperer.com/lesperance-en-mouvement/
- Jacques Lecomte. Rien n’est joué ; La science contre les théories de l’effondrement. Les Arènes, 2023
- La bonté humaine : https://vivreetesperer.com/la-bonte-humaine/
- Vers un nouveau climat de travail dans des entreprises humanistes et conviviales : https://vivreetesperer.com/vers-un-nouveau-climat-de-travail-dans-des-entreprises-humanistes-et-conviviales-un-parcours-de-recherche-avec-jacques-lecomte/
- En 2017, Jacques Lecomte avait déjà publié un livre visant à introduire un regard positif dans l’observation des réalités contemporaines : « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez » : https://vivreetesperer.com/et-si-tout-nallait-pas-si-mal/
par jean | Juin 4, 2023 | Société et culture en mouvement |
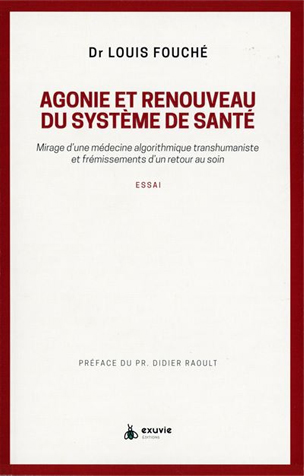 Pour un retour du soin face au mirage d’une médecine algorithmique transhumaniste
Pour un retour du soin face au mirage d’une médecine algorithmique transhumaniste
Selon Dr Louis Fouché
A notre insu, nous pouvons parfois être soumis à l’emprise d’une culture techniciste animée par une raison instrumentale et portée par une technocratie calculatrice. Si cette réalité apparaît aujourd’hui, jusqu’au risque d’une culture totalitaire, elle est le produit d’une transformation progressive qui remonte loin dans le temps. Certes, la prise de conscience écologique s’inscrit en face de ce danger, mais il nous faut entrevoir toutes les dimensions du problème. De fait, cette menace peut être perçue dans différents aspects de la vie. A cet égard, les transformations actuelles du système de santé peuvent être envisagées comme un révélateur de tendances profondes qui comportent de graves dangers. C’est le thème d’un livre du Docteur Louis Fouché : « Agonie et renouveau du système de santé. Mirage d’une médecine algorithmique transhumaniste et frémissement d’un retour au soin » (1).
Face à un technicisme déshumanisant, comment protéger et promouvoir une médecine mettant en priorité le soin et le souci de l’autre ? Le propos du docteur Louis Fouché est radical, mais il dévoile une réalité qui n’a pas encore donné lieu à une prise de conscience largement répandue. En fait, le docteur Louis Fouché est apparu sur la scène publique à l’occasion de la crise suscitée par l’épidémie du Covid. Il est alors entré en résistance vis-à-vis des directives sanitaires officielles. Médecin anesthésiste, il a manifesté beaucoup de courage en s’y opposant jusqu’à être contraint à suspendre son activité professionnelle avec le sacrifice financier correspondant. Dans ce contexte, il a animé un réseau d’entraide. Son livre témoigne de cette expérience. Cependant, plutôt que de s’enfermer dans une rancœur, même si il s’exprime parfois dans des termes choquants, il nous paraît chercher à comprendre les facteurs de la dérive et les pistes à explorer pour développer une médecine « intégrale et intégrative » dans des contextes humains appropriés.
Ce livre se présente donc en ces termes :
« Héritier de la pensée complexe, chère à Edgar Morin et Henri Laborit, le Dr Louis Fouché cherche la confrontation des regards, la fécondité du dissensus. Anthropologie, philosophie, éthique, sociologie, permaculture et non-violence nourrissent une réflexion renouvelée sur notre rapport à la Santé et au vivant.
Notre système de soins est à la croisée des chemins : consumérisme transhumaniste toxique, administré par quelques multinationales ; ou médecine intégrale et intégrative qui met la nature, les professionnels du soin et les patients en lien, pour une sagesse du vivant. A nous de choisir…
La crise du système de santé, mise à nue par le Covid, est une des volutes de la crise systémique profonde que nous devons traverser. Quand tout pousse à désespérer, quand des tutelles corrompues finissent d’achever nos institutions, ce livre est une porte vers l’émancipation, l’autonomie et la responsabilité » (page de couverture).
Si les analyses de Louis Fouché nous paraissent substantielles tant par l’expérience que par la culture de son auteur, nous ne les suivons pas sans réserve, mais surtout nous pouvons en contester l’interprétation.
Certes, la corruption peut affecter de grandes entreprises, de grandes institutions publiques peuvent être sous influence, mais on ne peut en déduire nécessairement un plan concerté visant à une domination mondiale. On pourrait davantage envisager une contagion des mentalités : la propagation d’une culture techniciste et technocratique telle que l’auteur la décrit. Au total, nous ne disposons pas en ce domaine d’une expertise suffisante pour avancer des évaluations.
Autre réserve : les propos de l’auteur sont empreints de passion, ce qui nous entraine et interpelle utilement, mais, dans ce mouvement, on peut regretter d’y voir parfois des jugements offensants ou ce qui nous apparait comme des exagérations. Il serait toutefois dommage que ces quelques réserves nous empêchent de saisir la portée de cet ouvrage qui nous apporte un éclairage majeur sur des dérives redoutables en cherchant ensuite des pistes de réponse dans une perspective constructive et généreuse. Nous essaierons de rapporter ce livre, non en terme d’un examen systématique, mais en empruntant le chemin de l’auteur à travers des passages significatifs.
L’apparition du Docteur Fouché sur la scène publique
Dans l’introduction du livre, l’éditeur explique son engagement en faveur de l’auteur et de son ouvrage. A quel titre le Dr Louis Fouché a-t-il été entendu durant la période critique du Covid ?
« Ce ne saurait être strictement son expertise en anesthésie et réanimation qui a interpellé le public lors de ses prises de parole. Ce qui a été entendu, c’est une synthèse et une mise en perspectives à la fois complexes et intelligibles, respectueuses de l’intelligence de chacun et humbles dans leur exposé. Le fruit en somme de ce qu’il avait patiemment additionné comme formations, expériences et réflexions, et qui venaient là créer une entaille dans le narratif prêt à consommer des discours officiels. Le docteur Louis Fouché n’est pas apparu avec la crise, c’est la crise qui a fait émerger tout un travail de l’ombre, des années de lecture, de patience, d’assemblages de concepts, de regards croisés, de mises en applications pratiques et de tous les détours qui les accompagnent… Et lorsque la parole émerge, elle prend immédiatement forme et résonne différemment aux oreilles, car elle a déjà modelé le réel » (p 10).
Une expérience et une conscience des failles et des dysfonctionnements du système de santé
De fait, c’est bien avant la crise du Covid que le Dr Louis Fouché a perçu les dérives du système de santé. Et ces dérives allaient à l’encontre de la « nécessaire humanité dans le soin ». Dès 2017, il avait demandé à s’inscrire dans un master II d’éthique et anthropologie médicales et il avait gagné en expérience dans les rencontres au cours de cette formation. Dans sa demande d’inscription, il avait clairement posé les problèmes : « Dans mes multiples casquettes professionnelles, je butte sur de multiples incohérences permanentes. Je dois soigner, mais je dois surtout « faire des actes ». Je dois « faire des économies ». Je suis égaré dans l’absence de bien commun clairement identifié… L’hôpital est encombré de complications insolubles, induites par des gouvernances technocratiques, dont les rouages sont opaques et les finalités inavouables. Le hiatus est de plus en plus flagrant entre un système de santé qui industrialise le soin et la réalité que je perçois chaque jour de la réalité des patients. La Haute Autorité de Santé le dit presque en ces termes : « Nous sommes là pour liquider le modèle artisanal de la médecine ». « Epur », chaque jour, je constate que c’est bien cet « artisanat » qui fait le soin. C’est bien la relation, et comment nous l’habitons, bref, notre éthique qui fait le soin, pas les « process » (p 23). Son mémoire de fin d’études avait été bien apprécié. Il y dénonçait notamment « les ravages d’une idéologie entrepreneuriale numérique appliquée à la santé humaine » et « la toute puissance algorithmique numérique en Santé » (p 25). Nous retrouverons ces thèmes tout au long du livre.
Une profession trop fermée
Louis Fouché nous raconte comment il a ressenti durant sa formation de médecin un manque d’ouverture. « Il serait bon d’avoir du recul. Et pourtant, tout médecin que je suis, je n’ai jamais eu d’histoire de la médecine dans mes cours de faculté. Il n’y a pas eu d’histoire des sciences non plus. Pas d’épistémologie. Pas de questionnement sur l’histoire du Vrai. Aucun retour sur les compétitions économiques ayant structuré les marchés de la santé. On y apprend la génétique, la biophysique, la biochimie, la biologie moléculaire. On nous apprend tous les détails. Mais jamais, on ne nous donne une vue d’ensemble… ». Il y a là un enfermement qui paraît stupéfiant. « Pas de philosophie, de sociologie ou de psychologie… Il n’y a pas de regards croisés avec d’autres médecines… ». Louis Fouché ne se résout pas à vivre et à penser dans cet univers clos. « Pourtant, il y a d’autres univers de soin, non ? Qu’est-ce que la médecine ayurvédique indienne ? Qu’est-ce que la médecine chinoise traditionnelle plurimillénaire ?… Pourquoi les guérisseurs africains connaissent-ils tous la botanique et les plantes qui guérissent ? Pourquoi quand il y a un malade, veulent-ils guérir tout entier le village ? Au fait, pourquoi n’apprend-on rien de la botanique et des plantes médicinales ?… » (p 36). Aujourd’hui, à la suite de la crise du Covid, Louis Fouché repose toutes ces questions et milite pour une médecine « intégrale et intégrative ».
Et il s’interroge également sur la manière dont la médecine s’est professionnalisée. A partir de l’exemple anglais, ne peut-on pas y voir plutôt un corporatisation ? (p 38). L’auteur examine également le cas américain. Au début des années 1900, au nom d’une certaine conception de la scientificité, le rapport Flexner préconise la « réorganisation et la centralisation des institutions médicales » au bénéfice d’une « médecine médicamenteuse ». Il en est résulté un recul du soin naturel, un poids croissant de l’industrie pharmaceutique, un recul drastique du nombre de médecins (p 39-40). Ces différentes observations concourent à mettre en évidence aujourd’hui des manques et des dérives dans la profession médicale. Dans sa veine radicale, Louis Fouché écrit : « La logique à l’œuvre, c’est la conquête méthodique des marchés… Nous sommes en train, de détruire le système de soin pour réattribuer le monopole du marché des soins aux multinationales de la finance et de la data ».
Une entrée en résistance
Face à l’épidémie de Covid, on observe un ensemble de réactions. C’est une situation complexe qui n’est pas exposable dans ce cadre. On notera seulement ici le choc ressenti par le docteur Louis Fouché au vu de certaines directives sanitaires. « Ce qui était raconté par le pouvoir et les médias ne correspondait pas à ce que je constatais dans mon service de réanimation. Intubez précocement. Mais les malades survivaient mieux si je les laissais sans ventilation invasive… Pas de traitement précoce. Mais tous ceux qui en avaient eu un guérissaient mieux. Les pontes avaient donné des consignes. Constat de réalité : ils avaient 40% de létalité dans leur réanimation quand nous en avions 5 à 20% en faisant autrement. Et pourtant, on n’a pas pu en parler Aucune possibilité de communiquer. Ils ont raison. Tais-toi. Point à la ligne. Pas de discussion » (p 30). Nous voyons en la réaction du docteur Fouché une exigence de conscience. « Il y eu un appel à parler. Une injonction à dire. Si toi, au contact des malades en réanimation, tu ne dis pas… Qui diras ? Alors, j’ai crié ce que je voyais. Et puis j’ai crié à l’aide. Et le plus surprenant, ça a été d’en trouver… Et nous avons essayé de nous entraider. Nous avons essayé de comprendre. Nous n’avons pas renoncé » (p 31). En conséquence, le docteur Louis Fouché a été sanctionné. Il a été contraint à la suspension, à l’été 2021.
La disruption, entraine une rupture
Notre société est caractérisée par un changement technique accéléré (2) lequel entraine l’économie et influe sur la vie sociale. L’auteur accorde une grande attention aux effets des ruptures qui peuvent ainsi intervenir en les caractérisant sous le terme de disruption. « La disruption est l’accélération sans précédent du rythme de la mutation technique. Il en résulte une incapacité pour le groupe d’en contrôler les usages et les règles. Corollairement, les systèmes techniques et leurs maitres (la classe des banquiers, des ingénieurs et des marchands) induisent la dislocation des systèmes sociaux et des individus » (p 66).
Louis Fouché expose les méfaits de disruption sous différents angles. Ainsi, sur le plan économique, elle s’inscrit dans les théories de Schumpeter. « Elles postulent que la destruction est créatrice… Détruire, c’est permettre de reconstruire. C’est faire changer de main la matière et donc générer du profit. Dans un postulat capitalistique, l’accélération de la rotation du capital… permet de générer du profit à l’infini. Comprenez bien, car c’est toute une économie de la prédation sur les ressources sans cesse accélérée qui trouve là une justification » (p 43). Cependant, l’innovation disruptive se développe dans une volonté de pouvoir. L’auteur y voit « la mainmise, sans partage, ni régulation d’aucune sorte, sur un marché ». Et, selon lui, il y a tentative d’appropriation des « systèmes institutionnels régulateurs ». Il y a donc là une menace totalitaire. « La disruption correspond à une façon iconoclaste de considérer un écosystème, en trouvant sa faille logicielle et organisationnelle, en vue d’en tirer le meilleur profit et d’effondrer les organisations traditionnelles de ce système » (p 44-45).
Cependant, Louis Fouché envisage également les effets de l’innovation de rupture accélérée, la disruption, sur les mentalités et sur les valeurs qu’elles portent. Le secteur de la santé offre un exemple des chamboulements induits par l’accélération technique. L’adoption d’une invention, d’une nouvelle technique requiert son acceptation par tous ceux qui sont concernés. « Un nouveau système technique doit être « métabolisé » par un groupe socio-culturel pour en faire jaillir le meilleur bien commun. Le groupe socio- culturel et les individus se trouvent transformés au passage. Dans la disruption, le rythme de mutation technique accéléré empêche ce métabolisme » (p 71). Si la mutation technique dépasse les capacités adaptives, le « Nous » se disloque. « La technique s’impose au réel. Le groupe se retrouve « toujours en retard ». Et puisqu’il est en retard, il perd sa capacité à rêver le bien commun qui pourrait advenir. Il y a perte des repères du « Nous », perte de sa raison d’être » (p 77). A cet égard, Lois Fouché peut nous fait part de son expérience en milieu hospitalier. Il y a constaté l’imposition de règles mécaniques et d’une uniformisation normative. «Quand les systèmes techniques visent à établir une automaticité algorithmique des processus, il s’ensuit une prolétarisation croissante des humains ». Les procédures se multiplient et l’artisanat se mue en routine. L’auteur porte un regard critique vis à vis de processus qui visent à remplacer l’artisan par une chaine de montage, et puis de remplacer l’ouvrier par des robots. Et, in fine, de remplacer le salarié par des algorithmes de traitement de données de masse. Il faut éradiquer l’imprévu. Et l’imprévu, c’est le vivant… » (p 73).
Si l’on en revient à l’épidémie du Covid, le docteur Louis Fouché en garde l’amère expérience d’un service de réanimation bouleversé par des règles technocratiques imposées d’en haut sans aucune pertinence par rapport à la réalité des patients. « Petit à petit, nous avons été expropriés de notre pratique médicale » (p 77). En quelque sorte, la communauté du « Nous » s’est disloquée et chacun a travaillé dans l’isolement. « La disruption résulte en la destruction du lien social et l’isolement progressif des individus atomisés » (p 79).
« Il y a dislocation du tissu social, destruction des appartenances et interdépendances antérieures, et mise en place d’une crispation totalitaire, pour tenter de maintenir, par la sclérose du mensonge, le Nous en effilochement » (p 81).
Technocratie et santé industrialisée
Le docteur Louis Fouché ressent une pression technocratique grandissante et il en décrit les caractéristiques et les effets dans un chapitre : « Technocratie et santé industrialisée ». Il entre d’emblée dans une interpellation au vif du sujet : « Pour planter le décor : cette exclamation de M Claude Le Pen, professeur en économie de la santé, en 2014, au Collège de France : « Nous sommes là pour liquider sans regret le modèle artisanal de la Médecine » ». Dit autrement, commente l’auteur : « Nous sommes là, nous économistes de la santé, représentant la Haute autorité de santé, pour mettre en place un marché industrialisé, normatif, rationalisé et évalué de production et de consommation de biens et services de soins. Voilà les ambitions des organisateurs du système de santé » (p 47). Et dès lors, le pouvoir s’exerce d’en haut. La décision politique se fond par ailleurs avec des motivations économiques. « Le régulateur officiel, en l’espèce l’Etat, prend en fait des décisions sous l’influence d’un régulateur occulte ». Selon Louis Fouché, ce régulateur occulte, « c’est l’ensemble des industriels du médicament, des multinationales de la finance et de la data ». « Le lexique et les méthodes de rationalisation managériale et productiviste de l’industrie s’imposent au soin » (p 50). « Il se produit l’envahissement du champ sanitaire par le champ managérial et organisationnel qui entend plier à ses modalités rationnelles, perfectionnistes, l’ensemble des strates du monde des soignants » (p 51). Pourrait-il en résulter un gain économique ? Le commentaire de l’auteur ne va pas dans ce sens. « Car on assiste à une multiplication de la fameuse tarification à l’acte. Plus on réalise d’actes, plus on gagne de l’argent… Il se produit une augmentation inarrêtable des actes… » (p 51). L’auteur décrit la dérive financière et incrimine le profit que certains en retirent. Dans cette évolution, le rôle des médecins se dégrade : « Le système de santé doit produire des soins industriellement avec efficience. Les soignants y deviennent des rouages d’une logique techno-industrielle et numérique. La Haute Autorité de santé, haute et autoritaire, impose administrativement aux soignants une praxis conforme à une justification d’efficience et d’équité » (p 54). « L’adossement du système de soins à un système technique industriel réduit la pratique soignante au pilotage d’un système technique » (p 54). A lire ce livre, on ressent une impression de déshumanisation. L’auteur se livre à une critique implacable d’un système où les bonnes intentions sont détournées et où le pouvoir revient à un milieu animé par des préoccupations administratives, techniques et commerciales. Ce système apparait comme de plus en plus omniprésent, jusqu’à influencer la production des savoirs. On se reportera à l’analyse détaillée de la critique de Louis Fouché qui, dans sa logique, peut paraître extrême. Il envisage un système où « une interdépendance est inéluctablement bâtie par le modèle industriel entre le monde du soin et le monde marchand de production technique des remèdes et des savoirs » (p 59).
L’expansion du numérique
Nous assistons aujourd’hui à une expansion massive du numérique. Comment ne pas en percevoir aujourd’hui les innombrables bienfaits ? Bien sûr, il y a toujours un revers de la médaille.
En garde vis-à-vis de l’accélération technique, Louis Fouché analyse la part d’effets nocifs de la numérisation dans le domaine de la santé. « Les prémices d’industrialisation formelle du soin ont permis la remise en cause de l’utilité même de l’humain comme agent du Soin. L’idéologie dominante propose désormais le modèle d’une Santé fondée sur le traitement algorithmique du big data numérique. Il s’agit en l’espèce d’accéder encore à un surcroît automatisé d’efficacité logistique opérationnelle » (p 87). La disruption numérique vient porter atteinte à la praxis des soignants. « Les soignants comme les soignés sont pris de vitesse par une technique qui vise l’efficience et le profit comme premières cibles… » (p 97). Les reproches de l’auteur vis-à-vis de effets de l’irruption du numérique dans le système de santé s’inscrivent dans une critique radicale d’« un monde rationalisé automatique » et de la menace totalitaire correspondante. Et il prend pour cible l’utopie du philosophe anglais Hobbes qui « avait proposé que la cité idéale soit comme un mécanisme d’horlogerie où tous les rouages s’imbriquent sans heurt… jubilation perfectionniste et mécaniciste qui voudrait que l’erreur disparaisse. Ce monde automatique à la « nous sommes tous des rouages » (p 98).
La menace de l’idéologie transhumaniste
Certes, nous traversons aujourd’hui une crise profonde, si profonde qu’elle est qualifiée d’« agonique » par Louis Fouché. Et il impute cette crise à une idéologie désignée comme « transhumaniste » Le transhumanisme est une forme réitérée de « l’hubris des philosophe grecs » « Volonté de puissance, folie des grandeurs, il s’est donné pour objectif de détruire la part faillible et fragile en l’humain pour faire advenir le transhumain en perfection » (p 32). « Le transhumanisme est une idéologie. Sa rationalité est tout entière tenue à faire advenir un monde automatique où l’humain augmenté serait libéré de la contingence » (p 32). L’auteur voit dans la disruption qui bouscule l’héritage du passé, « le mode opératoire de l’avènement de l’idéologie transhumaniste ». Louis Fouché perçoit ainsi une menace globale : « Transhumanisme, mode opératoire disruptif, outil transformatif numérique sont dans une même généalogie. Ces concepts réunis composent un antihumanisme radical » (p 33). Il y a là en quelque sorte une menace vis-à-vis de la nature humaine : « Le transhumanisme vient tuer le vivant en nous » (p 34). « Peut-on combattre cette rationalité de la perfection lisse au nom de l’attachement à un humain faillible, souffrant, mais digne et bien vivant » (p 34).
Un monde qui s’égare ?
C’est à partir de sa condition de médecin anesthésiste, de médecin hospitalier que le Docteur Louis Fouché a pris conscience des perturbations qui affectent notre société à partir de l’exemple des problèmes du système de santé. Et plus précisément, la défaillance de ce système vis–à-vis de la crise du Covid a joué pour lui un rôle de révélateur. En conscience, il est entré en résistance. Mais, à partir de là, sa réflexion s’est encore élargie. Sa réflexion dépasse maintenant de beaucoup la situation du système de santé, elle porte sur l’évolution de la société et de l’économie. Son livre traite certes de l’agonie et du renouveau du système de santé, mais ce thème y est inscrit plus généralement dans une analyse de la crise économique et sociale, et au delà encore, écologique. Son interpellation est radicale.
Il nous a semblé que nous ne pouvions pas ignorer cette interpellation, car elle correspond à des problèmes majeurs de notre époque.
Certes nous gardons une réserve par rapport aux interprétations de l’auteur. Nous n’entrons pas dans un style très polémique où la colère affleure et s’exprime dans des accusations catégoriques et des généralisations abusives. Entre autre : « C’est triste, mais l’histoire de notre médecine, n’est qu’une histoire de pognon et de pouvoir… » (p 40) ou « Le mandat des directeurs d’hôpitaux publics n’est pas que les gens soient bien soignés. Le mandat est de détruire l’hôpital public pour faire advenir la e-santé aux mains des multinationales de la data » (p 98). La véhémence de certains propos de l’auteur est contre productive.
Cependant, les menaces évoquées par Louis Fouché sont, au moins pour certaines, bien réelles. Ses analyses nous paraissent souvent pertinentes. Cependant, ce livre soulève de grandes questions. D’une part les dérives actuelles ne sont souvent que l’amplification de phénomènes plus anciens. Ainsi, la désappropriation des travailleurs de leurs pratiques de travail, la séparation entre direction, conception et exécution, remontent au XIXe siècle. Le même problème se pose à l’ère du numérique. Et, de même, dans le registre écologique, le pillage de la planète est une réalité de longue date. Face à des tendances qui s’inscrivent dans la longue durée, comment changer de cap et changer de cap rapidement. Des philosophes et des sociologues s’expriment à ce sujet (3). Mais le problème est aussi spirituel. C’est bien le cas lorsqu’on doit faire face à la montée de l’« hubris ». D’autre part, de grands changements comportent à la fois une part positive et une part négative. Comment pourrait-on méconnaitre les apports du numérique ?
Louis Fouché n’est pas indifférent à ces questions puisque, dans la dernière partie de son livre, il esquisse des pistes de renouveau.
Sortir de l’impuissance
Conscient des périls, cette lecture nous enseigne parfois d’autres menaces. La radicalité des propos de Louis Fouché nous indiquent peu de points d’appui d’autant qu’il induit de la suspicion vis à vis de nombreuses instances. Pourtant, dans la dernière partie de son ouvrage, il communique sa vitalité en traçant de nombreuses pistes.
Dns une première séquence, il apporte un état des lieux. C’est le constat d’un sentiment d’impuissance largement répandu. Puisqu’on constate que la technique ne résout pas la souffrance, « il ne reste plus rien qu’un être à la dérive sans abri et sans histoire. L’individu est découplé du réel, enchevêtré dans d’innombrables et factices réseaux sociaux numériques Il ne sait plus écrire un récit symbolique et social qui fasse sens. Le bout de la rupture entre le réel et sa narration est le totalitarisme numérique. Nous y sommes. Lost in Metaverse » (p 161).
Après avoir réitéré sa critique d’un monde ultra technique où l’humain perd sa consistance, l’auteur s’engage dans une proposition. « Y a- il un renouveau salutaire ? Voilà ce que nous allons tenter d’explorer dans cette dernière partie. Rien ne sert de démonter à tout prix la faillite du système. La plupart de nos contemporain, intuitivement, la ressente déjà. Les souffrances psychologiques et relationnelles traversées aujourd’hui sont proprement faramineuses. Il suinte, dans tous les faux bonheurs consuméristes, une solitude, une tristesse et une angoisse étouffantes… Dans les sociétés occidentales post-industrielles, coexistent à des niveaux variés, mais pour une majorité d’entre nous, une anxiété flottante sans objet, un mécontentement flottant sans objet, une perte de sens à l’existence et au travail, une perte de lien social et un isolement individualiste » (p 152). Cet état induit une fragilité sociale et politique. « Ces conditions réunies sont le terreau d’un mécanisme de masse totalitaire ». Cette insatisfaction peut se focaliser sur un objet commun dans un nous collectif.
Cependant, nous dit Louis Fouché, il ne suffit pas de comprendre en adoptant la posture d’un spectateur. Cette posture induit « une aspiration par la société du spectacle » (p 153). Il y un autre écueil : « Certains sont tentés de baisser les bras… Nous sommes impuissants quand nous somme isolés. C’est humain, mais c’est une dynamique suicidaire. On doit se mettre en lien » (p 154).
A partir de son expérience dans ses rencontres au cours de la crise du Covid, Louis Fouché peut encourager. Pendant cette crise, certains ont réagi. « Ils se sont réunis et ils ont accueilli leurs souffrances mutuelles. C’est le premier de tous les mécanismes thérapeutiques : l’écoute empathique. Avant même d’agir, savoir qu’on n’est pas seul, qu’on n’est pas fou, est le début de la mise en action » (p 156). L’auteur appelle à « aller vers le lien et l’appel du Réel ». « Réussir à sortir d’un paradigme où l’on reste à contrôler et prédire, pour aller vers l’imprévu de ressentir et s’ajuster » (p 156). Louis Fouché rapporte son action pour permettre l’expression et le partage de nombreuses expériences positives en cours aujourd’hui, des alternatives innovantes : la réalisation d’un documentaire : « Tous résistants dans l’âme ». « Un pas pour que les gens osent raconter la beauté et la transformation en cours autour d’eux. Ce faisant, j’espère qu’émergera un autre récit dominant que celui des multinationales » (p 156). Louis Fouché examine les différentes motivations de nos actions. Et, par exemple, il évoque la figure psychologique du triangle de Karpman : « des rôles qui oscillent entre celui de victime et celui de bourreau en passant par celui de sauveur » (p 160). Pour sortir de ce triangle infernal, revenir à la souveraineté. « Qu’est ce qui est en mon pouvoir, et à quel endroit je peux agir juste pour faire advenir le monde que je veux ? » (p 161). C’est un appel à la responsabilité. « Il en va dans ces considérations sur l’espoir et la souveraineté d’un enjeu de réenpuissancement. Il s’agit de reprendre sa puissance d’agir par un regard tourné sur les enjeux et les responsabilités. Il ne s’agit pas de vaincre. Il ne s’agit pas d’avoir raison. Il ne s’agit pas d’aller lutter contre. Il s’agit déjà de transformer ses propres attentes, son propre regard. Et de précipiter dans la matière une action juste par un changement d’intentions, d’émotions et d’espérances. « Be the change you want to see in the world » (Gandhi) (p 162).
Pistes d’action
En fonction de ses analyses et de ses idéaux, l’auteur nous propose des pistes d’action dans plusieurs chapitres successifs : « agir juste, une affaire institutionnelle, une affaire technique, quelle gouvernance ? transformation culturelle et récit positif ». En énonçant ces pistes, l’auteur s’inscrit dans l’histoire d’un non conformisme et il cherche à éviter le piège de la récupération par un ordre social et technique omniprésent. Nous renvoyons à la lecture de ces chapitres.
Louis Fouchè rappelle l’histoire du machinisme au XIXe siècle, où les ouvriers se voyaient dépossédés de leurs qualifications par l’arrivée des machines. Ils s’y opposèrent dans le mouvement luddiste. « L’irruption de la machine industrielle a suscité une désappropriation… Au-delà des bénéfices productivistes, et l’accroissement du confort matériel à bas coût du consommateur, il y a la destruction d’une classe manufacturière » (p 165). L’auteur pointe d’autres désappropriations dans le monde d’aujourd’hui. Il évoque des mouvements néoluddistes « résolument techno-critiques ». Le commentaire est nuancé : « L’action sur le cours profond des choses peut sembler faible, mais elle participe à un éveil des consciences sur les conséquences de la technique habituellement tenues sous le boisseau » (p 169).
« La pratique de l’obsolescence programmée est « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise en marche d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement »… Concept machiavélique, s’il en est, des tenants de la destruction créatrice… Il porte en lui toute l’absurdité du système capitaliste consumériste… » (p 170). Cependant, face à cette absurdité, la riposte est décisive. En France, en 2015, l’obsolescence programmée est devenue un délit entrainant jusqu’à deux ans de prison. Surtout, « il y a une source immense d’espoir : l’avancement d’une culture de la pérennité matérielle. Les pays en voie de développement, comme de très nombreux mouvements écologistes ou de bon sens, privilégient le réusage, le recyclage et la réparation. Paradoxalement, le meilleur outil de diffusion de cette culture est justement la technique numérique moderne. Aujourd’hui des sites internet entiers sont consacrés aux low-tech lab, aux recycleries, aux ressourceries qui voient le jour un peu partout » (p 171).
L’auteur évoque également le boycott. « Les mouvements d’action collective de consommateurs visant à infléchir le comportement d’une entreprise ou d’une institution sont prometteurs. Ils permettent de rééquilibrer les rapports de force entre une communauté, ses tutelles et les entreprises marchandes » (p 176). Il y a une histoire du boycott, tel le boycott réussi de la marche du sel engagée en 1930 par Gandhi en Inde. Mais comme le souligne l’auteur, il y a une condition préalable. « Le premier travail en amont du boycott et le plus essentiel est de réunir une communauté » (p 179).
Louis Fouché constate qu’on ne peut se passer de structures protectrices à condition qu’elles soient participatives. « Les collectifs citoyens créent des alternatives aux structures institutionnelles défaillantes ou déshumanisées. Mais ces alternatives ne doivent pas rester des alternatives. Elles doivent dessiner les contours d’une institution désirable ». Il faut travailler à permettre que tous ceux qui veulent quitter le système puissent le faire. La question est posée sur différents registres, y compris la monnaie.
L’auteur pose également la question de la gouvernance. Au niveau national, des choix idéologiques conditionnent les politiques. Au plan international, l’auteur a conscience de la forte demande de régulation internationale. Mais il redoute une corruption systémique. Des conditions doivent être posées. « Il est indispensables d’avoir des espaces et des institutions internationales, mais il faut bien définir leur mandat. Leur rôle est de permettre la rencontre, le dialogue et la négociation, les coopérations, les échanges… Elles ne sont qu’une table qui permet la diplomatie ». L’auteur est par contre très méfiant vis-à-vis des autorités supranationales. « Il est, en revanche, probablement dangereux de vouloir fondre les cultures, les langues, les visions du monde dans un même idéal et sous un même ordre législatif et social » (p 197).
Dans la transformation culturelle en cours, nous avons besoin d’un « récit positif » qui puisse nous inspirer. La prise de conscience écologique fait bouger les lignes. Louis Fouché évoque ces changements à sa manière. Et il se rallie à la vision de la permaculture. « Dans le paysage écologique finalement très complexe, la permaculture semble bien la vision la plus sage et la plus intégrale. La permaculture serait une façon de penser les problèmes dans une logique écosystémique » (p 206). Ces principes de réflexion issus d’une expérimentation agricole, de par leur nature écosystémique, ont touché tous les champs de l’activité humaine. L’auteur énonce ces principes (p 205) qui s’accompagnent de « trois fondamentaux éthiques : Prendre soin de la terre, prendre soin de l’humain, partager équitablement ». La permaculture prend en compte les différents niveaux de réalité. « La logique écologique a conduit progressivement à penser les problèmes, en particulier sanitaires, comme des interactions écosystémiques intégrées complexes. Dans la permaculture, la notion d’écosystème est centrale dans les rouages de compréhension. C’est une logistique plus exigeante et élargie qui contient déjà en son sein une régulation morale et un appel au non-réagir. La transformation est déjà en cours… » (p 213).
Louis Fouché nous fait part d’un exemple spectaculaire de l’application des principes permaculturels dans le domaine de la santé. C’est l’entreprise Buurtzorg aux Pays-Bas, fondée par Jos de Blok en 2006 (4). Avant Buurtzorg, le système de soins infirmiers aux Pays-Bas avait la même trajectoire d’hyper-rationalisation bureaucratique de service de soins qu’en France. Les infirmiers avaient en général un planning établi par le siège pour optimiser leur temps de transport. Le patient n’avait pas d’infirmier défini. Les soins étaient normalisés et le temps de réalisation de l’acte minuté… Ce système a généré une insatisfaction grandissante chez les patients. Jos de Blok a quitté ce système dépersonnalisé. Il a mis en place une entreprise avec quelques amis en 2006… « Ils ont revu leurs façons de concevoir le soin. Au lieu de réaliser le soin prescrit par le médecin, ils ont commencé par prendre une collation avec le patient et discuter avec lui de son réseau social et de ses besoins réels. Puis rapidement, ils ont entrepris de densifier le réseau d’aide autour des personnes et de valoriser leurs ressources propres… ». Revenue à une raison d’être qui faisait sens, s’étant réapproprié sa façon de faire, l’entreprise a adopté « le système de petites équipes autonomes sans hiérarchie de maximum douze personnes, en charge localement d’autogérer leurs plannings, leur gouvernance, leur matériel, leurs dépenses » (p 214-215). L’entreprise s’est massivement développée jusqu’à regrouper 10 000 infirmiers. Un audit a montré que cette organisation faisait économiser 40% des actes médicaux prescrits, diminuait de 30% les hospitalisations en urgence… 50% du temps paramédical était économisé… » (p 215).
Dans le mouvement de la pensée, « depuis la fin des années 2000, a réémergé l’idée des communs. Il s’agirait d’une voix médiane entre la propriété et le collectivisme… La proposition du mouvement des communs est une réappropriation des biens communs par les communautés locales ». Louis Fouché évoque les « communs de soin et de santé intégrant aussi bien les patients et les soignants à une échelle locale » (p 217).
Tout au long de ce livre, Louis Fouché se confronte aux menaces engendrées par un modèle économique marchand, mais aussi par celles qu’il attribue à l’expansion du numérique.
Cependant, les apports du numérique ne sont-ils pas considérables ? Comment pourrait-on les refuser ? Or l’auteur répond à cette question dans une séquence : « la technique comme pharmakon » (p 186-189). « Pharmakon, c’est le poison… et le remède. L’idée du pharmakon correspond à celle des cornucopiens qui voient dans la technique une source d’abondance. Si la technique est le poison, elle devrait aussi le remède… La technique va résoudre les problèmes qu’elle a créés. » (p 186). L’auteur est dubitatif vis-à-vis de cette prétention. « Je pense que nous avons atteint un seuil de contre-productivité ». « Pourtant, je dois le concéder, la résistance dans la crise du Covid n’aurait pas existé sans les réseaux sociaux ». Dès lors, la réflexion se fait nuancée. « Ressentir et s’ajuster, et non pas essayer d’imposer une utopie au réel. Nous en reparlerons avec la non-violence et la prudence. Quand tout s’effondre, il s’agit de bâtir ensemble une bulle de cohérence autour de nous pour passer l’épreuve. Et pour la bâtir, tous les morceaux intéressants du réel peuvent être récupérés » (p 188). Cependant, Louis Fouché met en garde vis-à-vis de « l’extension totalisante du numérique ». Il « décrie une utilisation pseudo-rationalisée de la technique, puisqu’elle ne change pas l’intentionnalité fondamentale sous-jacente de ne jamais se heurter à la limite » (p 188). « En synthèse, une seconde vision du pharmakon est qu’il faut utiliser la technique à de justes fins. Pour cela, il faut redonner une hétéronomie à la technique en travaillant sur les usages mis en place par les citoyens, puis sur les conceptions symboliques des créateurs eux-mêmes, sur leur intention. Ceci ne peut se lire en première lecture qu’en mettant des freins politiques et législatifs sur le pouvoir économique » (p 193).
Vers un nouveau système de santé
Dans ce livre, Louis Fouché entre dans une nouvelle conception de la santé et du soin qui s’inscrit dans « la logique permaculturelle », la logique écologique ; et de par son engagement lors de la crise du Covid, il est au cœur des processus collaboratifs qui ont alors émergé. L’innovation fleurit dans les marges. Un paysage nouveau est en train d’émerger. Un horizon est en train d’apparaître. Louis Fouché peut s’exclamer : « Voilà rien moins qu’un système de santé à établir. C’est un magnifique défi » (p 219).
La logique permaculturelle renouvelle note regard. D’une certaine manière, les mouvements de médecine holistique, tels que proposés par les anthroposophes ou la plupart des ethnomédecines traditionnelles, sont dans cette ligne là. Il s’agit de concevoir l’humain en interaction et intégré dans le plus grand pour pouvoir l’aider à rester en santé… la coopération des médecins est porteuse d’espoir, mais nécessite des outils d’évaluation d’impact pertinents… » (p 207).
Il est important de prendre en considération tous les éléments. « Si vous comptez les kilos perdus dans les six mois post sleeve gastrectomie versus régime seul chez un obèse, la sleeve gastrectomie va devenir la méthode de référence. Arracher et agrafer l’estomac sera meilleur à court terme que de créer un réseau social de qualité, de rééduquer à une alimentation saine, de passer quelques lois interdisant aux industriels les distributeurs automatiques des ‘nuts’, le sur-sucrage des produits préparés, de réfléchir sur le contenu culturel, philosophique et spirituel de la personne avec lenteur et patience… L’obésité n’a pas à voir qu’avec perdre des kilos dans le minimum de temps. Le côté obscur est toujours plus rapide, plus facile, plus tentant. Mais le côté obscur n’est pas le bon chemin » (p 208).
C’est la force des ethnomédecines traditionnelles. Elles ont pour elles la sagesse du temps long. « Toutes ont en commun d’être non scientifiques, hautement symboliques, très attachées à la dimension sociale et relationnelle du déséquilibre de santé. Et toutes ont en commun de rechercher l’homéostasie avec le monde. Elles réémergent et c’est une chance ». Ainsi Louis Fouché nous parle d’une rencontre où « il y avait un ethnomédecin chinois traditionnel, un médecin ayurvédique de Pondichéry, un médecin de Daramsala en Inde en exil avec le Dalaï Lama, un druide celtique, un guérisseur africain ivoirien, un médecin anthroposophe, un homéopathe, des médecins généralistes allopathiques, un anthropologue, un réanimateur. Quelle richesse ! Quel foisonnement d’intelligences et de partages !… Médecine lente et basse-technologie permaculturelle » (p 209).
Louis Fouché réfléchit à la manière permaculturelle de dépenser le moins d’énergie pour le meilleur résultat. Une pratique low-tech. C’est une orientation : « Refaire avec le sens clinique, avec l’observation patiente. Redonner du sens à l’interprétation du réel par le praticien. J’avais ainsi proposé, il y a cinq ans, la mise en place de projets médicaux de réanimation et d’anesthésie low-tech » (p 209). L’auteur raconte comment un groupe d’internistes à Paris s’est mis à donner un cycle de cours sur « les signes » aux médecins réanimateurs. Leur parcours pédagogique visait à réhabiliter les investigations au lit du malade, à resensibiliser à l’observation clinique » (p 210). L’auteur rapporte comment l’humain reprend ses droits par rapport à une pression techniciste. « En réanimation, la sédation évolue d’un cocktail meurtrier à fortes doses d’hypnotiques, de morphiniques et de curares, encore utilisés par certains services arriérés, vers une sédation light où le patient coopère et participe au soin. A preuve, le Covid où la ventilation et la prise en charge techniciste lourde ont démontré leur faiblesse et leur toxicité versus une approche physiologique peu invasive avec oxygénothérapie à haut débit. Les décisions de limitation thérapeutique sont désormais prises en concertation avec les familles, le personnel et même le patient… On utilise de plus en plus les critères créés par les patients et non par les médecins. On utilise des « patients traceurs » pour aller regarder ce que l’évaluation comptable ne sait pas regarder. Ils racontent leurs vécus d’hospitalisation et ouvrent des perspectives de progression inattendues puisqu’ils parlent tous des insuffisances du lien et de l’accompagnement humain… Au cœur même du monstre, il y a un élan, un appel à plus d’humanité… » (p 211-212).
Une culture de la coopération commence à se développer. Ainsi « apparaissent de nombreuses initiatives de soin mettant en réseau des professionnels d’horizons variés… La rencontre avec la médecine institutionnelle de tous ces acteurs est une condition de la survenue d’une médecine permacole. Les patients eux-mêmes sont en train de monter en compétence de manière extrêmement rapide. Les didacticiels, les formations en ligne, les ateliers se multiplient pour que les savoir-faire et les savoirs anciens soient transmis. Je constate avec un étonnement croissant que toute une partie de la population aspire à l’autonomie en Santé et utilise des pratiques comme le Tai Chi, le Qi Gong, le yoga ou la méditation. Il me semble que ce mouvement est désormais prégnant et qu’aucune multinationale au monde ne saura l’arrêter » (p 210-211).
Ainsi, Louis Fouché voit dans toute cette évolution un profond changement de mentalité qui s’inscrit dans la montée de la culture écologique. « La logique écologique a conduit progressivement à penser les problèmes en particulier sanitaires, comme des interactions écosystémiques intégrés complexes. Dans la permaculture, la notion d’écosystème est centrale dans les rouages de la compréhension. C’est une logique plus exigeante et élargie qui contient déjà en son sein une régulation morale et un appel au non agir » (p 213).
Cependant, dans ce contexte en mouvement, comment favoriser l’avènement d’un nouveau système ? « Pouvons-nous inventer des communs de soin et de santé à des échelles locales intégrant aussi bien les patients et les soignants, sans intervention de l’Etat ou des multinationales ? » L’auteur en donne un exemple : « les Oasis Pleine Santé » qui sont en train d’émerger. « En lien avec les collectifs locaux sur les territoires de Forcalquier et de Lyon, elles proposent un système de soins, avec une autre logique financière et sanitaire… Je participe à bâtir patiemment et pierre par pierre, un réseau de ces initiatives locales bigarrées. Elles émergent des collectifs issus de la crise du Covid et des soignants suspendus comme des citoyens ayant à cœur de retrouver leur autonomie en santé. Le réseau qui se tisse doucement a pour nom : Une Nôtre Santé. Il est articulé avec RéinfoSanté qui veut devenir une sorte d’université citoyenne de création du savoir en Santé pour le grand public » (p 217).
Et voici qu’en quelques lignes, Louis Fouché nous présente sa vision d’un nouveau système de santé : « Élaborer du savoir, mettre en place une praxis des soins autonomes et avec un gouvernance locale. Proposer la coopération de différents soignants autour d’un patient, avec le soutien économique de toute la communauté locale. Faire intervenir les patients eux-mêmes dans les processus de salutogenèse comme cela a été fait souvent en pathologie psychiatrique et en addictologie… Revenir à des éléments de soin low-tech et à des outils de santé façonnables localement. Conserver de notre médecine en effondrement ce qui fait sens comme l’anesthésie et la chirurgie. Voilà rien moins qu’un système de santé entier à établir. C’est un magnifique défi. Et il ne sera relevé que par un Nous réconcilié, en commun » (p 217-219).
Une aspiration spirituelle
Dans ce livre, Louis Fouché nous interpelle : A quoi tenons-nous ? Quelle vie voulons nous vivre ? Nous croyons nous en relation ? « Les sociologues appellent parfois le récit commun unifiant : « protension collective positive ». Il s’agit de trouver ce vers quoi le Nous a envie d’aller ensemble. Il s’agit de trouver les quelques valeurs, les quelques intentions qui rassemblent les Je atomisés en une humanité qui cherche à vivre ensemble » (p 221). L’auteur énonce quelques-unes de ces valeurs. Il nous appelle à considérer la société dans laquelle nous vivons. Nous avons vécu pendant des décennies dans un développement économique ininterrompu. Aujourd’hui, nous prenons conscience que la croissance ne peut être indéfinie. Les ressources s’épuisent. Alors il nous fait envisager une décroissance. « La décroissance est une baisse du niveau de matérialité nécessaire à la vie humaine. Comment l’homme s’y adapte est toute la question » (p 221). Si nous restons dans une demande de « toujours plus », comme le monde ne pourra offrir ce « toujours plus », plus dure sera la chute (p 222). Si nous subissons une grande frustration, il y aura parallèlement de fortes tensions . « La décroissance subie promet la guerre de tous contre tous. Au contraire, la décroissance volontaire est un chemin non violent de transformation »… « La logique de la sobriété heureuse consiste à travailler sur le désir individuel et collectif ». L’auteur évoque la pensée de Pierre Rabhi. « Dans l’ensemble, il s’agit de travailler individuellement à un changement dans ses attentes par un retour aux besoins fondamentaux. Ce retour permettra de définir clairement les priorités. Il est entendu que la société dans son ensemble changera par cette augmentation de conscience individuelle. L’imaginaire des décroissants rejoint celui de Gandhi dans sa célèbre phrase : « Be the change you want to see in the world » (p 222 ). « La sobriété heureuse est souvent associée au concept d’« insurrection des consciences » et « au pouvoir créateur de la vie civile ». En cela, elle prétend à une portée à la fois spirituelle et politique » (p 222).
Mais avons-nous des exemples historiques d’un tel changement ? Louis Fouché nous apprend qu’effectivement, « la décroissance volontaire a déjà été historiquement formulée et expérimentée. L’exemple le plus célèbre reste celui du christianisme d’état de la fin de l’empire romain. Une partie de la classe aristocratique et bourgeoise dominante, lassée de ses orgies et de la vassalisation oppressive des colonies, décide de poursuivre des objectifs non matérialistes. Elle revient de manière volontaire au dénuement. Les mouvements anachorète, puis monastique ouvrent cette ère mystique de la transition vers le Moyen Age » (p 223).
La question du récit commun désirable convoque nécessairement la question de la spiritualité. Certes, ce terme fait question pour certains embarrassés par des souvenirs religieux encombrants. C’est sans doute pourquoi le titre de ce chapitre est formulé interrogativement : « Ecospiritualité laïque ? ». Cependant Louis Fouché insiste : « Par nature, l’intention que je peux porter sur demain est de nature spirituelle. Je crois que l’Occident entre dans une époque franciscaine. Saint François d’Assise, c’est celui qui a renoncé à toutes les entraves du confort. Il est l’ami de toute chose et de tout être. Dans les Fioretti et les principales prières de François d’Assise, il y a une cosmogonie intégrée de l’homme avec l’univers. La vie est sacrée. La Création est sacrée. Elle contient le divin dans chaque fibre de l’univers et de chaque être » (p 224). Il y a là une vision à l’opposé du « cartésianisme à l’œuvre dans l’imaginaire occidental depuis les Lumières ».
« En synthèse, la Sobriété heureuse est une protension collective positive pour amoindrir les conséquences individuelles et collectives de l’effondrement. Elle constitue un travail incontournable sur l’intention individuelle dont l’espoir est d’avoir une portée socio-politique. La crise que nous traversons est en train de recréer du Sacré à tour de bras. Le vivant que l’on pourchasse partout au nom du profit et de l’efficience est sacré. L’humain est un être parmi d’autres, à nul autre pareil, dans un biotope dont il procède et dont il a besoin. A vouloir le sacrifier, on le rend sacré » (p 225).
Ce chapitre se poursuit par l’éloge de deux vertus : la prudence et la non-violence. Comme sagesse pratique appliquée, « La prudence cherche une juste mesure de l’action dans l’incertitude et la contingence du réel ». Et, autre apport, « Dans l’action comme dans la pensée, la prudence est l’intelligence du courage ». « La prudence est une sorte de sagesse conceptuelle de l’action. La prudence indique la précaution élémentaire. Il y a aussi un petit air de lenteur dans les plis du concept. Une sorte de lenteur qui observe le réel avant de prendre sa décision » (p 226).
Louis Fouché s’exprime comme un adepte de la non-violence. Il nous en décrit l’esprit et la pratique. « Rien n’est jamais gagné ou perdu. L’arène met simplement en place la nécessité d’une rencontre. Et là nait le rapport de force. Celui qui amène dans la danse la volonté de l’autre est celui dont la volonté est la plus stable. Elle reste au centre. Et l’autre reste dans mon centre. Si mon centre vacille, l’autre me balaie et m’effondre. Quelle est ma volonté ? Quel est mon centre ? C’est l’autre qui m’aide à le trouver. C’est par les attaques incessantes de l’adversaire qui cherche à me détourner de moi-même, que j’apprends qui je suis » (p 228).
Dans sa conclusion, Louis Fouché reprend au départ son expression d’indignation en évoquant une déchéance humaine. Et puis, le vent tourne. Louis Fouché évoque une parole motrice des « Dialogues avec l’ange » : « Celui qui aide, parle. La parole de consolation et d’amour plane au dessus de vous. Sans l’Amour, rien ne peut s’accomplir, ni Connaissance, ni Paix, ni Félicité. La Connaissance éclaire, le Silence remplit, le Rayon apporte la chaleur, mais seul, l’Amour relie ». Alors, je dois œuvrer aussi fort que je peux, pour qu’autre chose advienne… Pour que le courage tienne… » (p 232-233). Louis Fouché convoque la résistance et il évoque un processus dans lequel les hommes s’éveillent et se rassemblent.
Ce texte nous donne accès à l’idéal de Louis Fouché, à ce qui l’anime en profondeur. C’est une certaine vision de l’humain, une manière d’envisager la vie bonne…
« On veille à l’héritage. On chérit la beauté. On contemple et on console le moribond qui meurt. On admire, on écoute, avec intelligence, l’expérience inédite que l’aîné nous partage. Tous entourent et cajolent ceux qui sont en souffrance. Celui qui souffre encore ne peut être seul. Les sages nous transmettent des vérités cachées. On rétame. On répare. Toujours, on rafistole… Et surtout, l’on maintient la précieuse flamme, la joyeuse santé. Le corps est une nef. Qui conduit au sacré. Des mystères délivrent à tous des lumières. On initie chacun pour qu’il soit dissemblable. Et, Je, unique au monde, s’assemble à la tribu. La fête est bouleversante… » (p 233-234). Dans cette inspiration poétique, nous voyons une inspiration spirituelle
A l’écoute de questions de fond pour l’avenir de notre société
Nous découvrons de plus en plus la diversité et l’ampleur des crises qui affectent nos sociétés. En réponse, la première requête est d’en étudier le contexte et de comprendre les données correspondantes et quelles en sont les incidences et les interprétations. C’est ce que nous essayons de faire sur ce blog en toute modestie dans les limites de nos capacités. Et, à chaque fois, nous nous demandons quel pas en avant nous pouvons réaliser, quelle ouverture proposer. Il y a des domaines où nous ne aventurons pas parce que nous manquons des compétences correspondantes. Nous évitons également les questions qui soulèvent des polémiques exacerbées parce que ce contexte rend difficile une approche honnête et nuancée (5).
Nous avons donc beaucoup hésité à présenter le livre du docteur Louis Fouché : « Agonie et renouveau du système de santé ». Car, assurément, l’auteur est très contesté. Son engagement dans une opposition vis à vis des directives sanitaires officielles lors de la crise du Covid a suscité de vives critiques non seulement à l’endroit de ses positions, mais aussi, dans la guerre idéologique qui a fait rage jusqu’à aujourd’hui, vis à vis de sa personne. Nous reportant à Wikipedia, nous n’y avons pas trouvé le portrait nuancé que nous attendions, mais plutôt un procès généralisé contre un médecin considéré comme « un diffuseur majeur de fausses informations sur la crise sanitaire » (6). Cependant, l’écoute des interviews en vidéo nous a paru infirmer les opinions très négatives circulant à son sujet (7). Certes, on pouvait naturellement être en désaccord sur certains points. On pouvait également trouver son langage excessif et même parfois choquant. Mais, le ressenti est également important. Et ici, nous ressentions chez cet homme de l’honnêteté, du courage, de l’expérience, de la compétence, une manière d’être pouvant susciter de la sympathie. Nous avons donc lu son livre. Cette lecture a éveillé une prise de conscience de la puissance avec laquelle un technicisme numérisé se répand aujourd’hui et peut porter atteinte au bon sens humain. En étudiant le parcours du système de santé en France, Louis Fouché nous introduit dans des enjeux de civilisation, tant dans l’examen des menaces que dans la perspective des opportunités. Avec lui, nous découvrons des dynamiques positives jusqu’à un éclairage spirituel à la fin du livre. Nous ne nous sommes pas sentis autorisés à passer sous silence un ouvrage peu conventionnel, mais interpelant jusque dans son approche visionnaire.
La personnalité de Louis Fouché est apparue au grand public à l’occasion de l’épidémie du Covid . Il en va de même pour le préfacier de l’ouvrage, le docteur Didier Raoult. Dans la peur qu’elle a suscitée, l’épidémie a suscité un choc violent. Dans ce contexte, les directives sanitaires officielles se sont imposées. Elles ont été portées par les pouvoirs publics et par l’accueil d’une majorité de la population. Des voix critiques ou contestataires n’ont pas été entendues. Le camp majoritaire s’est imposé dans une forme de guerre idéologique. Cependant, une résistance est apparue en terme d’objection de conscience. Aujourd’hui, le débat autour de ces politiques est en train de s’ouvrir. Le livre de Louis Fouché est une contribution à ce débat en l’inscrivant dans un cadre beaucoup plus vaste.
Cet ouvrage met en évidence la menace constituée par la montée d’un technicisme numérisé en phase avec une économie capitaliste et un pouvoir marchand. La critique des abus de la technique avait déjà été portée par des auteurs comme Jacques Ellul et Ivan Illitch. Elle s’inscrit ici dans une actualité vive, mais elle se déploie également dans une analyse historique rejoignant le rejet du machinisme au XIXe siècle. Puisque l’auteur, à juste titre, prend en compte le temps long, les questions que nous lui adressons, portent sur ce registre.
Certes, nous pouvons aujourd’hui percevoir la menace totalitaire d’un technicisme numérique s’exerçant dans le contexte d’un écart entre direction et exécution, de la puissance des émotions médiatiques, du pouvoir de l’argent. Notre inventivité pour répondre à cette menace doit être d’autant plus grande que cette menace vient de loin en remontant le passé. Il nous faut changer le cap et l’allure d’un grand navire. Sur le registre écologique, la question se pose de la même façon. Et d’autre part, dans la dérive actuelle, nous ne devons pas oublier les acquis de l’évolution passée : les libertés chèrement acquises par rapport aux oppressions politiques et religieuses (3), mais aussi les gains réalisés en réponse à des besoins vitaux. Bref, il nous faut garder le sens des proportions.
Si, à partir de l’exemple du système de santé, cet ouvrage nous montre une puissance destructrice à l’œuvre, la pression de la « disruption », et si, en l’occurrence, il envisage l’agonie et l’effondrement de ce système de santé, il s’achève dans l’anticipation d’un renouveau. L’auteur nous permet d’entrevoir ainsi les forces à l’œuvre. Source d’espoir, il nous donne à voir qu’un esprit nouveau est déjà l’œuvre. Si elle n’a pas encore atteint les objectifs souhaités, la pensée écologique est déjà à l’œuvre et elle modifie la manière de poser les problèmes afin des les résoudre. Ainsi, « dans la pensée écosystémique, les problèmes ne sont plus seulement vus dans une perspective locale et immédiate, mais sur l’ensemble d’un système vivant dans le temps » (p 205). Issue d’un nouvelle manière d’envisager la culture de la terre, la permaculture devient une approche méthodologique polyvalente. Louis Fouché écrit ainsi que « la logique permacultuelle promet de grands espoirs en Santé si elle commence à être étudiée et appliquée » (p 207). Dans cet âge du Vivant, nous changeons d’échelle, nous entrons dans une vision holistique.
C’est bien dans une vision relationnelle que se présente aujourd’hui la spiritualité. Dans son livre pionnier : « Something there » (8), David Hay envisage la spiritualité comme « une conscience relationnelle ». Une analyse de conversation avec des enfants montre combien ceux-ci se sentent reliés à la nature, aux autres personnes, à eux-mêmes et à Dieu ». Aujourd’hui, à la suite du grand théologien Jürgen Moltmann, dans la Communion Divine, l’Esprit Saint nous apparaît comme « l’Esprit qui donne la vie ». « Dans les années 1980 déjà, dans son livre : « Dieu dans la création », Jürgen Molmann écrit : « Si l’Esprit Saint est répandu sur toute la création, il fait de la communauté entre toutes les créatures, avec Dieu et entre elles, cette communauté de la création dans laquelle toutes les créatures communiquent chacune à sa manière entre elles et avec Dieu » (9). « En Lui, nous avons le mouvement, la vie et l’être » (Actes 1.28) ». Sa présence est active pour susciter une humanité fraternelle (10) ; C’est dans le même veine que se situait la théologie de François d’Assise appréciée par Louis Fouché : « une cosmogonie intégrée de l’homme tissée avec l’univers. La vie est sacrée. La Création est sacrée. Elle contient le divin dans chaque fibre de l’univers et de chaque être » (p 224). « Le corps est une nef. Qui conduit au sacré » écrit Louis Fouché dans sa conclusion (p 234). N’est-ce pas le respect de l’humain qui inspire la résistance de Louis Fouché à l’encontre d’une emprise techniciste et mécaniste à son encontre. « Le transhumanisme vient tuer le vivant en nous » (p 35).
J H
(1) Dr Louis Fouché. Agonie et renouveau du système de santé. Mirage d’une médecine algorithmique transhumaniste et frémissement d’un retour au soin. Note de l’éditeur. Préface par Didier Raoult. Exuvie, octobre 2022. Ce livre est présenté par son auteur dans une interview You Tube : « Origine et éthique d’un médecin engagé » : https://www.youtube.com/watch?v=ynqcf5SwcMs
Louis Fouché est également l’auteur du livre : « Tous résistants dans l’âme » (14 octobre 2021) et du film qui porte le même titre
(2) Face à une accélération et à une chosification de la société : https://vivreetesperer.com/face-a-une-acceleration-et-a-une-chosification-de-la-societe/
(3) Des Lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/des-lumieres-a-lage-du-vivant/
(4) A travers les méandres de l’histoire, une humanité meilleure qu’il n’y paraît : https://vivreetesperer.com/a-travers-les-meandres-de-lhistoire-une-humanite-meilleure-quil-ny-parait/
(5) Le courage de la nuance : https://vivreetesperer.com/le-courage-de-la-nuance/
(6) Wikipedia : Louis Fouché : https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Fouch%C3%A9
(7) Louis Fouché. Le nouveau monde. Intreview Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ld_iQMzerjk
(8) La vie spirituelle comme une conscience relationnelle. Une recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
(9) Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-dieu-present-dieu-avec-nous-dans-un-univers-interrelationnel-holistique-anime/
(10) Il y en a assez pour chacun : https://vivreetesperer.com/il-y-en-a-assez-pour-chacun/
par jean | Mar 8, 2023 | Société et culture en mouvement |
 Réparons le monde. Humains, animaux, nature
Réparons le monde. Humains, animaux, nature
Selon Corine Pelluchon
A une époque où nous sommes confrontés à la mémoire des abimes récents de notre civilisation et aux menaces dévastatrices qui se multiplient, nous nous posons des questions fondamentales : comment en sommes-nous arrivés là ? Comment sortir de cette dangereuse situation ? Ainsi, de toute part, des chercheurs œuvrant dans des champs très divers de la philosophie à la théologie, de l’histoire, de la sociologie à l’économie et aux sciences politiques tentent de répondre à ces questions. Nous avons rapporté quelques unes de ces approches (1).
Parmi les voix qui méritent d’être tout particulièrement entendues, il y a celle de la philosophe Corine Pelluchon. Son dernier livre, tout récent, « L’espérance où la traversée de l’impossible » (janvier 2023), nous fait entrer dans une perspective d’espérance. C’est une occasion pour découvrir ou redécouvrir une œuvre qui s’est développée par étapes successives, dans une intention persévérante et qui débouche sur une synthèse cohérente et une vision dynamique.
Agrégée de philosophie en 1997, Corine Pelluchon soutient en 2003 une thèse intitulée : « La critique des Lumières modernes chez Leo Strauss » (2). Leo Strauss est un philosophe et un historien de la philosophie, juif allemand immigré aux Etats-Unis à partir de 1937 (3). Leo Strauss a critiqué la modernité à partir de la philosophie classique (Platon et Aristote) et des grands penseurs médiévaux : Saint Thomas, Maïmonide et Al-Fârâbi (4). La thèse de Corine Pelluchon témoigne de son intérêt précoce pour les questions relatives aux Lumières et sera publiée en 2005 sous le titre : « Leo Strauss, une autre raison, d’autres Lumières : essai sur la crise de la rationalité contemporaine ». Cette philosophe s’est engagée très tôt dans une recherche en milieu hospitalier français. Elle constate la réalité et les effets de la dépendance, et face à une idéologie absolutisant l’autonomie et la performance, elle appelle au respect de la dignité des patients (« l’autonome brisée. Bioéthique et philosophie » 2008) (5). Elle met en évidence l’importance de la vulnérabilité et écrit un livre : « Eléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature » (2011). Le champ de sa pensée s’élargit et embrasse non seulement les humains, mais aussi les animaux qui sont des êtres sensibles. En 2017, elle écrit un manifeste en faveur de la cause animale : « Manifeste animaliste. Politiser la cause animale ». La question de la relation est centrale. Il y a « une éthique de la considération » (2018). En 2021, Corine Pelluchon fait le point sur l’évolution historique dans laquelle s’inscrit notre problème de civilisation : « Les lumières à l’âge du vivant » (6), et, en 2020, elle avait publié un livre récapitulant les apports de ses différentes approches : « Réparons le monde. Humains, animaux, nature » (7). On pouvait y lire, en page de couverture, un texte qui rend bien compte de la dynamique et de la visée de son œuvre : « Notre capacité à relever le défi climatique et à promouvoir plus de justice envers les autres, y compris les animaux, suppose un remaniement profond de nos représentations sur la place de l’humain dans la nature. Prendre au sérieux notre vulnérabilité et notre dépendance à l’égard des écosystèmes permet de saisir que notre habitation de la terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, l’écologie, la cause animale et le respect dû aux personnes vulnérables sont indissociables, et la conscience du lien qui nous unit aux vivants fait naitre en nous le désir de réparer le monde ».
Nous nous bornerons ici à présenter quelques aperçus du livre : « Les Lumières à l’âge du vivant », en suggérant au lecteur de se reporter à quelques excellentes interviews en vidéo de Corine Pelluchon, telle que : « Raviver les lumières à l’âge du vivant » (8).
Remonter aux origines. Les Lumières à poursuivre, mais à amender
Si la crise écologique actuelle suscite beaucoup de questions sur la manière dont elle a été générée par une vision du monde subordonnant la nature à la toute puissance de l’homme, on peut remonter loin à cet égard et incriminer différentes idéologies. Certains mettent ainsi en cause l’héritage des Lumières. Ici, en reconnaissant les manques, puis les dérives, Corine Pelluchon rappelle la dynamique positive des Lumières. « Les Lumière sont à la fois une époque, un processus et un projet… Les philosophes de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle étaient conscients d’assister à l’avènement de la modernité laquelle est indissociable de l’exigence de « trouver dans la conscience ses propres garanties » et de fonder l’ordre social, la morale et la politique sur la raison » (p 13-14). « Pour penser aux Lumières aujourd’hui, il importe de réfléchir au sens que peuvent avoir, dans le contexte actuel, l’universalisme, l’idée de l’unité du genre humain, l’émancipation individuelle ainsi que l’organisation de la société sur les principes de liberté et d’égalité… » (p 18). « Cela ne signifie pas que le procès des Lumières, c’est-à-dire les critiques qui lui sont adressées, dès le début du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, à gauche comme à droite, n’aient aucune pertinence. L’interrogation sur notre époque est inséparable de la prise de conscience des échecs des Lumières et de leurs aveuglements. Ces échecs et le potentiel de destruction attaché au rationalisme moderne doivent être examinés avec la plus grande attention si l’on veut accomplir les promesses de Lumières… » (p 18-19). Dans les dérives, Corine Pelluchon envisage une raison se réduisant à une rationalité instrumentale, oubliant d’accorder attention à la dimension des fins : « ce qui vaut » et un dualisme, séparant l’humain du vivant. Cependant, « Il nous faut aller au delà de la critique et de la déconstruction des impensés des Lumières… Il est nécessaire de promouvoir de nouvelles Lumières. Celles-ci doivent avoir un contenu positif et présenter un projet d’émancipation fondé sur une anthropologie et une ontologie prenant en compte les défis du XXIe siècle qui sont à la fois politiques et écologiques et liés à notre manière de cohabiter avec les autres humains et non-humains » (p 21).
Du schème de la domination au Schème de la considération
Qu’est-ce qu’un Schème selon Corine Pelluchon ? « Nous appelons Schème l’ensemble des représentations ainsi que les choix sociaux, économiques, politiques et technologiques, qui forment la matrice d’une société et organisent les rapports de production, assignent une valeur à certains activités, et à certains objets et s’immiscent dans les esprits conditionnant les comportements et colonisant les imaginaires… Parler du Schème d’une société revient à dire que nous avons à faire à un ensemble cohérent qui, tout en étant le fruit de choix conscients et inconscients, individuels et collectifs, impose un modèle de développement et imprègne une civilisation » (p 102-103).
Ici, l’auteure s’engage dans son analyse. « Le Schème d’une société comme la notre est celui de la domination qui implique un rapport de prédation à la nature, la réification du soi et des vivants et l’exploitation sociale. A notre époque, ce schème prend surtout la forme du capitalisme qui est une organisation structurée autour du rendement maximal et la subordination de toutes les activités à l’économie définie par l’augmentation du capital » (p 103).
Cependant, en retraçant l’histoire du processus de domination, l’auteure constate que la domination était présente au début des Lumières dans le rapport avec la nature et qu’ensuite, elle n’a pas été réduite. « Les Lumières n’ont pas pu tenir leurs promesses parce que l’alliance de la liberté, de l’égalité, de la justice et de la paix s’enracinent dans la fraternité qui suppose que l’on se sente relié aux autres et responsables d’eux. En opposant la raison à la nature, en faisant le contrat social sur une philosophie de la liberté où chacun se définit contre les autres, où l’intérêt bien entendu ne peut assurer qu’une paix superficielle…, on ne peut constituer une communauté politique… La rivalité, la compétition et l’avantage mutuel ne saurait garantir une paix durable (p 58). Aujourd’hui, « la violence est à la racine de notre civilisation et elle est toujours latente » (p 65). « Il y a un lien entre la domination de la nature, l’assujettissement des animaux et l’autodestruction de l’humanité » (p 63).
La sortie du Schème de la domination ne demande pas seulement un changement social, mais il requiert aussi « une décolonisation de notre imaginaire ». Il implique également la proposition d’un Schème alternatif : le Schème de la considération ». « La considération, qui est inséparable du mouvement d’approfondissement de la connaissance de soi comme être charnel, relié par sa naissance et sa vulnérabilité, aux autres êtres et au monde commun, rend le Schème de la domination inopérant en lui substituant une autre manière d’être au monde et un autre imaginaire. Ces derniers ont, eux aussi, une force structurante et ils font s’évanouir le besoin de dominer autrui, l’obsession du contrôle et les comportement de prédation à l’égard de la nature et des autres vivants. Alors que la domination est toujours liée à un rapport violent aux autres et qu’elle s’enracine dans l’insécurité intérieure du sujet qui cherche à s’imposer…, la considération désigne la manière globale ou la manière d’être propre à un individu véritablement autonome. Il sait qui il est et n’a nul besoin d’écraser autrui pour exister. Et, parce qu’il assume sa vulnérabilité et sa finitude, il comprend que sa tâche, pour le temps qui lui est imparti, est de contribuer à réparer le monde en faisant en sorte que les autres puissent y contribuer le mieux possible et en coopérant avec eux pour transmettre une planète habitable ». Ainsi, la considération donne l’intelligence du Bien et transforme l’autonomie qui devient courage et s’affirme dans la non-violence. Celle-ci n’est pas seulement l’absence d’agressivité ; elle implique aussi de déraciner la domination… » (p 150). L’auteure envisage concrètement ce changement de mentalité. « La considération comporte assurément des degrés. Culminant dans l’amour du monde commun… elle s’exprime d’abord et le plus souvent sous la forme de convivance et de solidarité à l’égard de ses semblables. Cependant, si la convivance n’est que le premier degré de la considération, elle enseigne aux individus à élargir la conception qu’ils ont d’eux-mêmes… Le regard que les individus portent sur le monde change… » (p 150-151). « Pour être capable de remettre en question les structures mentales et sociales associées au Schème de la domination et pour oser innover en ce domaine, il faut avoir fait la moitié du chemin, accéder déjà à la considération » (p 151).
La considération s’inscrit dans une vision de l’homme et une vision du monde. « La considération modifie de l’intérieur la liberté, qui devient une liberté avec les autres, et non contre eux. Et parce qu’elle s’appuie non pas sur une notion abstraite, comme la notion kantienne de personne, mais sur un sujet charnel et engendré faisant l’expérience de son appartenance à un monde plus vieux que lui et de la communauté de destin le reliant aux autres vivants, elle promeut une société à la fois plus inclusive et plus écologique. Dans le Schème de la considération, la liberté du sujet ou sa souveraineté ne s’opposent pas aux normes écologiques ; elle les réclame » (p 153). De même, le Schème de la considération, inspire un projet de société écologique et démocratique, il soutient le pluralisme. « Les voies de la considération sont nécessairement plurielles, car chacun exprime sa vision du monde commun de manière singulière, et la considération, qui permet à l’individu d’être à la fois plus libre, plus éclairé et plus solidaire, encourage sa créativité » (p 154).
Selon Corine Pelluchon, il y a « une incompatibilité absolue entre le Schème de la domination et celui de la considération. D’autre part, ce changement de Schème est un processus radical, mais ne saurait être assimilé à une révolution au sens politique du terme. Il passe par un remaniement profond de nos représentations et de nos manières d’être conduisant à déraciner la domination. Celle-ci ne se réduit pas aux relations de pouvoir ; elle désigne une attitude globale liée au besoin d’écraser autrui pour exister et caractérise un rapport au monde consistant à manipuler et à réifier le vivant afin de mieux le contrôler et de s’en servir, au lieu d’interagir avec lui en respectant ses normes propres et son milieu » (p 314). La sortie du Schème de la domination est une condition de la transition écologique et de l’entrée dans un âge du vivant. « De même que, pour les Lumières passées, la condition du progrès était que les individus soient éclairés, de même un comportement écologiquement responsable et une véritable politique écologique impliquent que les personnes s’affranchissent du Schème de la domination » (p 317).
Les Lumières à l’âge du vivant
L’émergence d’un âge du vivant se manifeste aujourd’hui à travers une multitude de signes. La menace du dérèglement climatique comme le rapide recul de la biodiversité apparaissent maintenant au grand jour. C’est aussi une prise en conscience en profondeur de la réalité du vivant et de l’inscription humaine dans cette réalité.
Corine Pelluchon milite pour la cause animale. Son livre : « Réparons le monde » y est, pour un part, consacrée. Une éthique animale est en train d’apparaître. « La capacité d’un être à ressentir le plaisir, la douleur et la souffrance et à avoir des intérêts à préserver ainsi que des préférences individuelles suffisent à leur attribuer un statut moral… Le terme de sentience qui vient du latin « sentiens (ressentant) est utilisé en éthique animale pour désigner la capacité d’un être à faire des expériences et à ressentir la douleur, le plaisir et la souffrance de manière subjective. Un être sentient est individué… » (p 24-25). On pourra se reporter à ce chapitre sur la cause animale qui présente les vagues successives qui sont intervenues en ce sens. Aujourd’hui, la souffrance des animaux entretenue à l’échelle industrielle apparaît comme une monstruosité. « Les souffrances inouïes dont les animaux sont les victimes innocentes sont aujourd’hui le miroir de la violence extrême à laquelle l’humanité est parvenue »…
L’auteure inscrit sa réflexion dans son insistance à considérer la vulnérabilité des êtres vivants : « La conscience de partager la terre avec les autres vivants et d’avoir une communauté de destin avec les animaux qui, comme nous, sont vulnérables, devient une évidence quand nous nous percevons comme des êtres charnels et engendrés » (p 69). Ce thème est également abordé dans son livre sur « Les Lumières à l’âge du vivant ». Elle évoque « les difficultés à penser l’altérité et à tirer véritablement les enseignements de notre condition charnelle ». « Cet impensé est aussi ce que la pensée du progrès a refoulé. Celle-ci est construite sur la mise à distance du corps, sur sa maitrise, et sur la domination de la nature et des autres vivants qu’elle objective pour en ramener le fonctionnement à des causes sur lesquelles il est possible d’agir. L’opposition entre l’esprit et le corps, la culture et la nature, l’homme et l’animal, la liberté et l’instinct, l’existence et la vie, est caractéristique du rationalisme qui s’est imposé avant et après l’« aufklarung » en dépit des efforts de certains de ses représentants pour réhabiliter le sensible et le corps et s’opposer aux découpages propres à la tradition occidentale… Le cœur du problème réside dans le rejet de l’altérité. Ne reconnaissant pas la positivité de la différence… l’homme tente de réduire le vivant à un mécanisme. De même, l’altérité du corps ou, ce qui, en lui, nous échappe et souligne nos limites , génère de la honte et un sentiment d’impuissance que nous refoulons… » (p 54).
Ces différents questionnements témoignent d’un contexte nouveau. C’est une approche d’un âge du vivant. Comment pouvons réaliser la transition entre les siècles passés et ce nouvel âge ? Comment Corinne Pelluchon envisage-t-elle le passage des Lumières classiques à de nouvelles Lumières ?
« La considération qui se fonde sur l’expérience de notre appartenance au monde commun et sur la perception de ce qui nous unit aux autres vivants élargit notre subjectivité, et fait naitre le désir de prendre soin de la terre et des autres. Cette transformation qui est intérieure mais a des implications économiques et politiques majeures prend du temps. Elle s’effectue d’abord dans le silence des consciences et touche en premier lieu une minorité avant de se généraliser et de se traduire par des restructurations économiques et par une évolution de la gouvernementalité » (p 315). « En s’appuyant sur une phénoménologie de notre habitation de la terre qui met à jour notre corporéité et notre dépendance à l’égard des écosystèmes et des autres êtres humains et non humains, les Lumières à l’âge du vivant surmontent le dualisme nature/culture et promeuvent un universel non hégémonique, évitant le double écueil du dogmatisme et du relativisme. Ces nouvelles Lumières sont essentiellement écologiques et la crise du rationalisme contemporain ainsi que les traumatisme du passé les distinguent de celles du XVIIè et XVIIIè siècles… La phénoménologie propre aux Lumière à l’âge du vivant refaçonne complètement le rationalisme et souligne à la fois l’unité du monde et la diversité des êtres et des cultures » (p 311-312). Corine Pelluchon rapporte les vertus de cette approche phénoménologique : « La phénoménologie des nourritures permet de décrire l’humain dans la matérialité de son existence, dans sa condition charnelle et terrestre, ouvrant par là la voie à un universalisme non hégémonique et ouvert à de nombreuses interprétations. Au lieu de se référer à des valeurs qu’elle chercherait à imposer en les déclarant universelles, la phénoménologie part de l’existant dans un milieu à la fois biologique et social, naturel, technologique et culturel, et met à jour des structures de l’existence ou existentiaux. Elle offre ainsi des repères pour penser la condition humaine et fonder une éthique et une politique à partir de principes universalisables que l’on peut adapter aux différents contextes culturels » (p 321).
En marche
Ce livre va très loin dans l’analyse puisqu’il aborde de nombreux sujets qui n’ont pas été repris dans cette présentation, comme : « Technique et monde commun » ou « L’Europe comme héritage et comme promesse ». Il se propose d’éclairer le projet de société en voie d’émergence. « La mission de la philosophie est à la fois grande et petite : éclairer le lien entre le passé et le présent, souligner les continuités et les ruptures, créer des concepts qui sont comme des cairns et changer les significations attribuées d’ordinaire aux mots, renouveler l’imaginaire ». « Car le projet consistant à mettre en place les changements sociaux, économiques et politiques pour habiter autrement la Terre témoigne d’une révolution anthropologique qui passe par une compréhension profonde de la communauté de vulnérabilité nous unissant aux autres êtres. Il est donc nécessaire de l’adosser à une pensée politique qui soit elle-même solidaire d’une réflexion philosophique sur la condition humaine » (p 326).
Cet ouvrage, nous dit l’auteure, « cherche à accompagner un mouvement qui prend naissance dans la société et dont il existe des signes avant-coureurs, comme on le voit avec l’importance que revêtent aujourd’hui l’écologie et la cause animale, et avec le désir de nombreuses personnes de donner un sens à leur vie impliquant plus de convivialité et de solidarité » (p 326). Face aux obstacles et aux menaces, une dimension d’espérance est présente dans ce livre. « Elle provient de la certitude qu’un mouvement de fond existe déjà : l’âge du vivant » (p 325).
En commentaire
Dans ce livre, Corine Pelluchon nous apporte un éclairage sur l’évolution historique intervenue au cours de ces derniers siècles, de ce qui a été appelé le siècle des Lumières à ce début du XXIe siècle où, dans la tempête, se cherchent une nouvelle société, une nouvelle économie, une nouvelle civilisation en forme d’un nouvel âge, un âge du vivant. Elle nous offre une analyse qui s’appuie sur des connaissances approfondies et est éclairée par un renouvellement des perspectives à partir de l’approche philosophique que l’auteure a empruntée pour éclairer successivement de nouveaux champs, ce qui lui permet aujourd’hui de nous offrir une vision synthétique. C’est donc un livre de première importance sur un thème capital.
Les propositions de l’auteur s’appuient sur une réflexion philosophique, une approche phénoménologique, une interprétation historique. Elle se tient à distance d’une inspiration religieuse. « Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à réfléchir à ce qui peut donner de l’épaisseur à notre existence individuelle. En montrant que l’horizon du rationalisme est le fond commun, qui constitue une transcendance dans l’immanence – puisqu’il nous accueille à notre naissance, survivra à notre mort individuelle et dépasse donc notre vie présente – nous articulons l’éthique et le politique à un plan spirituel, c’est à dire à une expérience de l’incommensurable, sans passer par la religion, mais en nous appuyant sur notre condition engendrée et corporelle qui témoigne de notre appartenance à ce monde plus vieux que nous-mêmes et dont nous sommes responsables. C’est ce que nous avons appelé la transdescendance » (p 35-36).
Un des apports de l’ouvrage est sa mise en évidence du Schème de la domination et de ses conséquences. L’auteure accompagne l’histoire de ce Schème à travers les dérives de la raison instrumentale. Cependant, le phénomène de la domination est majeur dans l’histoire de l’humanité. Il a certes abondé durant la chrétienté, mais l’Evangile a porté un message radical à son encontre. Rappelons la parole de Jésus : « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu de vous… » (Matthieu 20. 25-28). La proclamation de Jésus : « Vous êtes tous frères » (Matthieu 23.8) est puissamment relayée dans les premières communautés chrétiennes. Cette inspiration, restée en sourdine pendant des siècles n’est-elle pas appelée, elle aussi, à reprendre vigueur à l’âge du vivant ?
Et lorsque Corine Pelluchon nous rappelle la corporéité de l’homme, ne doit-on pas en chercher la méconnaissance, non seulement dans une raison absolutisée, mais aussi dans une conception platonicienne reprise dans un regard religieux principalement tourné vers l’au-delà. Dans ce domaine comme en d’autres, des théologiens retissent une proposition évangélique. Ainsi Jürgen Moltmann plaide pour une « spiritualité des sens ». Cependant, c’est bien l’incarnation, une fondation théologique, qui appelle les chrétiens à prendre en compte la corporéité.
Si l’idéologie de la domination de l’homme sur la nature n’est pas l’apanage des seules Lumières, si une interprétation de la Genèse biblique a pu être incriminée, une nouvelle théologie envisage un dessein d’harmonie entre Dieu, la nature et l’homme. Nous avons présenté en ce sens la théologie pionnière de Jürgen Moltmann (9). L’encyclique Laudato Si’ porte cette inspiration à vaste échelle (10). De même, l’écospiritualité se développe aujourd’hui rapidement (11).
Ce mouvement participe à l’émergence de cet âge du vivant qui nous est annoncé par Corine Pelluchon .
Au début de sa postface (p 325), Corine Pelluchon nous invite à l’espérance : « Cet ouvrage est traversé par l’espérance. Celle-ci ne doit pas être confondue avec l’optimisme, ni avec un vain espoir… L’espérance, qui est une vertu théologique, apparaît dans la Bible aux moments les plus critiques ou après des épreuves redoutables, comme on le voit dans le psaume 22, lorsque David se plaint d’avoir été abandonné par Dieu avant de le louer. Elle se caractérise par un rapport particulier au temps : quelque chose qui va venir, qui n’est pas encore là, mais qui est annoncé et qui, en ce sens, est déjà présent. Ainsi, la dimension d’espérance qui est manifeste dans ce livre provient de la certitude qu’un mouvement de fond existe déjà : l’âge du vivant » (p 325). Pour nous, ce texte rejoint le thème de « l’attente créatrice » (12) inscrit par Jürgen Moltmann dans la théologie de l’espérance.
J H
- Enlever le voile : https://vivreetesperer.com/enlever-le-voile/ Une vision d’espérance dans un monde en danger : https://www.temoins.com/une-vision-desperance-dans-un-monde-en-danger/ Un chemin de guérison pour l’humanité. La fin d’un monde. L’aube d’une renaissance : https://vivreetesperer.com/un-chemin-de-guerison-pour-lhumanite-la-fin-dun-monde-laube-dune-renaissance/ Pourquoi et comment innover face au changement accéléré du monde ?: https://vivreetesperer.com/pourquoi-et-comment-innover-face-au-changement-accelere-du-monde/ Comprendre la mutation actuelle de notre société requiert une vision nouvelle du monde : https://vivreetesperer.com/comprendre-la-mutation-actuelle-de-notre-societe-requiert-une-vision-nouvelle-du-monde/ Un essentiel pour notre vie quotidienne et pour notre vie sociale : https://vivreetesperer.com/un-essentiel-pour-notre-vie-quotidienne-et-pour-notre-vie-sociale/ Le film Demain : https://vivreetesperer.com/le-film-demain/ « Animal » de Cyril Dion : https://vivreetesperer.com/animal-de-cyril-dion/ Vers une économie symbiotique : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/ Sortir d’une obsession de l’efficience pour rentrer dans un nouveau rapport avec la nature : https://vivreetesperer.com/sortir-de-lobsession-de-lefficience-pour-entrer-dans-un-nouveau-rapport-avec-la-nature/
- Corine Pelluchon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Corine_Pelluchon
- Leo Strauss : https://fr.wikipedia.org/wiki/Leo_Strauss
- Leo Strauss, filière néo-conservatrice ou conservatisme philosophique : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2009-5-page-873.htm
- L’autonomie brisée : https://journals.openedition.org/assr/21178
- Corine Pelluchon. Les Lumières à l’âge du vivant. Postface inédite. Seuil, 2022 (Essais)
- Corine Pelluchon. Réparons le monde. Humains, animaux, nature. Rivages Poche, 2020
- Raviver les Lumières à l’âge du vivant : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=corine+pelluchon&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&tbs#fpstate=ive&vld=cid:4fd0f3df,vid:HRRgb6_JEYc
- Un avenir écologique pour la théologie moderne : https://vivreetesperer.com/un-avenir-ecologique-pour-la-theologie-moderne/
- Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, Pape François et Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
- Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/ Réenchanter notre relation au vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/
- « L’histoire présente des situations qui visiblement contredisent le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons nous y opposer. Mais il existe également des situations qui correspondent au royaume de Dieu et à sa justice. Nous devons les soutenir et les créer lorsque c’est possible. Il existe également dans le temps présent des paraboles du royaume futur et nous y voyons des préfigurations… Nous entrevoyons déjà quelque chose de la guérison et de la nouvelle création de toutes choses que nous attendons. Nous le traduisons par une attente créatrice… » (Jürgen Moltmann). De Commencements en commencements. Empreinte. Dans le chapitre : « La force vitale de l’espérance », (p 115).