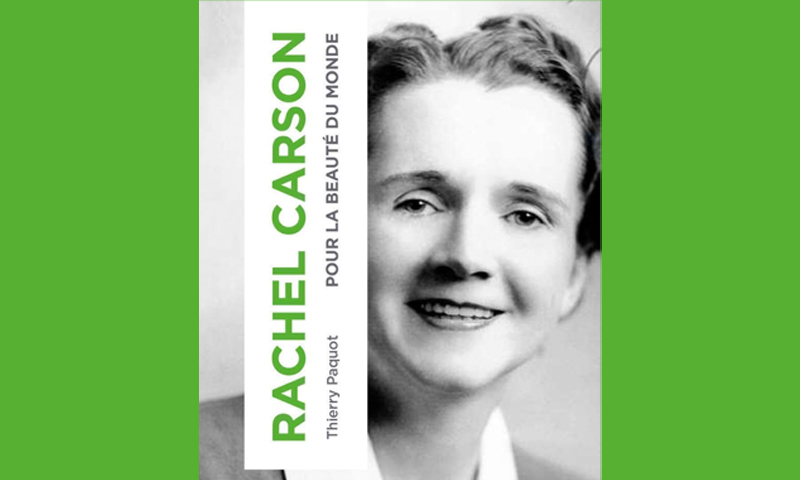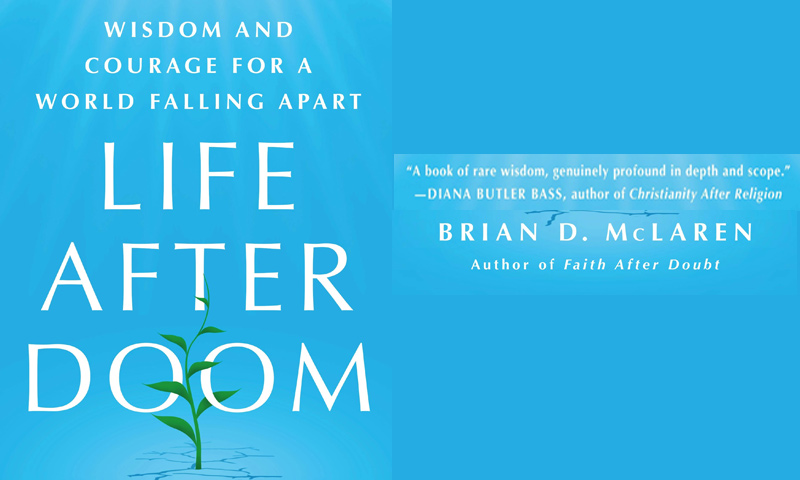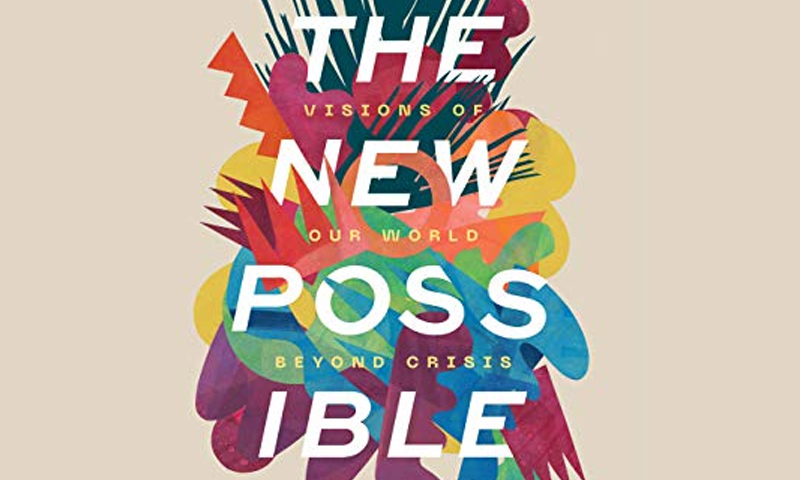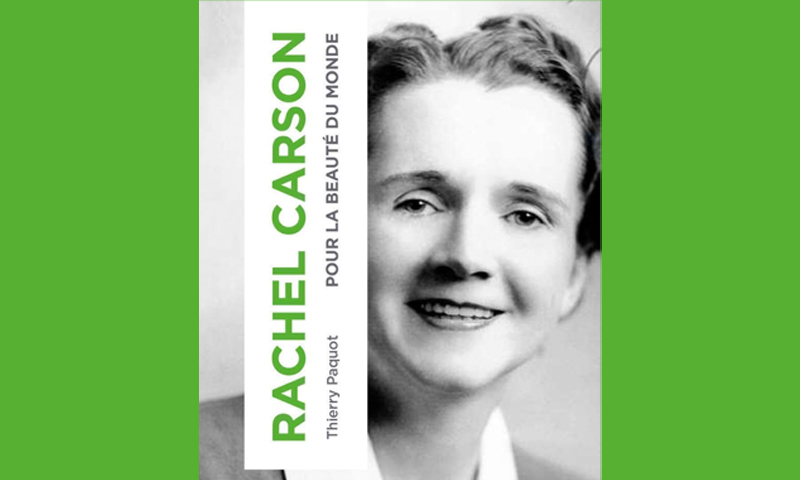
par jean | Oct 17, 2025 | Emergence écologique |
Au début des années 1960, un livre nous vint des Etats-Unis, en traduction sous le titre: « le printemps silencieux ». Dans cet après-guerre, le progrès technique battait son plein. La technique était en vogue et elle paraissait salutaire. Cependant, parce que l’auteure Rache Carson savait évoquer la beauté de la nature avec émerveillement, elle faisait s’autant mieux ressortir les conséquences ravageuses d’un polluant insecticide, le DDT. Biologiste marine, elle était compétente pour démontrer le péril et, malgrè la violente opposition des intérêts, elle fut entendue et le pesticide fut interdit.
Aujourd’hui, la campagne de Rachel Carson nous parait emblématique, car ce fut la première à mettre en cause, à grand bruit, les dangers de la pollution. Aussi, dans le péril actuel, tant le recul de la biodiversité que le dérèglement du climat, il n’est pas étonnant que son exemple inspirant soit retracé par plusieurs livres tel que : « Rachel Carson. Pour le beauté du monde » (1), par Thierry Paquot, lui-même philosophe social à partir d’une profession d’urbaniste. Cependant, notre intérêt a été particulièrement éveillé par l’attention portée à Rachel Carson dans un livre de Helen De Cruz que nous avons présenté sur ce blog : « Wonder Struck. How wonder and awe shape the way we think » (2). Cet ouvrage intervenait à la suite du livre qui, à la suite d’une démarche scientifique et d’une grande enquête, met en évidence le phénomène de la « awe », un émerveillement ébloui : « Awe. The New science of everyday wonder…. » (3). Dans « Wonder Struck », Helen de Cruz consacre une section à l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder) chez Rachel Carson ( p 159-164).
Le parcours de Rachel Carson
Dans son livre : « Rachel Carson. Pour la beauté du monde », Thierry Paquot retrace les étapes du parcours de Rachel Carson : Du plein air au laboratoire ; Exploratrice de l’univers marin ; Ce pesticide qui a rendu muet le printemps ; Un impact retentissant avant un long silence.
Observer et admirer
Née en 1907, Rachel Carson grandit dans une ferme en Pennsylvanie, auprès d’une mère cultivée qui l’initie à une littérature mettant en valeur la nature. « Ainsi donne-t-elle à lire à sa fille le « Handbook of nature study » d’Anna Bostford Comstock. Cette entomologiste et illustratrice, fille d’un quaker, est une grande admiratrice de Ralph Waldo Emerson et d’Henri David Thoreau » (p 15). C’est une indication sur le contexte culturel d l’éducation de Rachel. L’auteur, Thierry Paquot, la décrit ainsi : « C’est une petite fille qui s’intéresse à tout, et qui ne craint pas la solitude, qu’elle recherche pour mieux faire corps avec la nature. Elle se promène dans la campagne et s’initie aux sciences naturelles, apprenant le nom des arbres, des plantes et des fleurs et aussi celui des oiseaux, souvent en compagnie de sa mère. Elle sait s’occuper en lisant, écrivant, rêvant et observant tout autour d’elle. Ce qui la ravit surtout est d’inventer des histoires qu’elle écrit ensuite » ( p 17). Certaines sont même publiées dans un mensuel pour enfants : St Nicholas Magazine. Rachel entreprendra des études universitaires, d’abord en littérature anglaise, puis en s’orientant vers la biologie. Rachel Carson optera ensuite pour une carrière scientifique en dépit de préjugés défavorables à l’égard des femmes. En 1936, « elle devient la deuxième femme assistante-biologiste marin engagée par le Bureau des pêches. Elle va y mêler recherche et vulgarisation, tout en écrivant pour des journaux… ».
Rachel Carson s’est particulièrement distinguée par la publication de plusieurs livres sur l’univers de la mer envisagée tant dans son aspect scientifique que dans un ressenti poétique. Ce furent : « Under the sea wind » en 1941, « The sea around us” en 1951 et “the edge of the sea”en 1955. Le livre : “The sea around us” (Cette mer qui nous entoure ) a rencontré un grand succès, « numéro 1 de la liste des meilleures ventes du New York Times durant quatre-vingt-six semaines » et a été rapidement traduit en de nombreuses langues. Elle nous raconte l’apparition de la mer et son expansion comme une épopée, la montée du vivant. « Cet ouvrage est un récit choral de tous les êtres vivants qui font, défont et refont l’univers marin, sachant que « cette mer qui nous entoure » est aussi entourée par les activités humaines qui viennent en perturber les fragiles équilibres … Rachel Carson assemble les informations les plus précises et actuelles pour décrire un monde qu’elle pense comme une totalité, dans laquelle tous les éléments constitutifs sont interdépendants entre eux. N’est-ce point la définition de l’écologie, par Ernst Haeckel en 1866 ? » ( p 38). L’auteur nous rapporte également la vision spirituelle de Rachel Carson : « Croyant, comme moi à l’évolution, je crois simplement que c’est la méthode par laquelle Dieu a créé et continue de créer la vie sur terre. Et c’est une méthode si merveilleusement conçue que l’étudier en détail, revient à augmenter – et certainement jamais à diminuer – à la fois sa révérence et sa crainte à la fois envers le Créateur et à l’égard du processus » ( p 38). Thierry Paquot commente également le dernier livre de Rachel Carson : « The edge of the sea » (Là ou finit la mer : le rivage et ses merveilles), un ouvrage qui « clôt sa trilogie marine » : « C’est son texte le plus littéraire et le plus personnel, celui que je préfère en raison de son écriture émotionnelle, qui ne dédaigne pas pour autant les détours scientifiques sans la platitude scolaire fréquente des énoncés pédagogiques ».
Dénoncer les méfaits du DDT et des pesticides : un engagement pour le vivant
La connaissance et l’amour de la nature chez Rachel Carson l’ont portée à s’engager. Consciente de la grandeur et de la beauté de la toile du vivant, elle a ressenti les menaces à son égard et elle s’est engagée de toutes ses forces contre les méfaits des pesticides, en l’occurence du DDT en grande vogue à l’époque.
Thierry Paquot nous montre comment elle a recueilli des concours et rassemblé les preuves de la dégradation du vivant par le DDT. Ses arguments résonnent en anticipation aux recherches actuelles établissant les méfaits des pesticides. « Pour son étude, elle rencontre de nombreux médecins et biologistes, dont les spécialistes des « cancers professionnels et environnementaux » … Elle rassemble une très riche documentation, son livre comporte quarante pages de références bibliographiques… Une partie de ses informations a été collectées par une ornithologue amateure du Massachusetts…Elle recueille une abondante documentation de Marjorie Spock, poète et écologiste, pédagogue de l’anthroposophie, maraichère en agriculture biodynamique lorsque le DDT est aspergé sur ses terres… » ( p 51-52)
Rachel Carson a eu à faire à de fortes parties tant est grand à l’époque le prestige du DDT et puissants les intérêts qui le soutiennent. « Le DDT massivement prescrit contre les insectes porteurs du paludisme, du typhus, de la peste bubonique au cours des premières années de la guerre, devient après-guerre le traitement de choc de l’organisation mondiale de la santé (OMS) » (p 56). Puis, il commence à se répandre dans l’agriculture et c’est là qu’apparaissent les dangers de son utilisation, dangers que Rachel Carson va identifier : « l’une des caractéristiques les plus fâcheuses du DDT et des produits imilaires est de passer d’un organisme dans un autre en suivant la chaine alimentaire. En voici un exemple : un champ de luzerne est traité au DDT ; cette luzerne est donnée en pâté aux poules ; les œufs pondus par les poules contiennent du DDT » ( p. 56). « L’équilibre propre à la nature » est bouleversé. « Le tir de barrage chimique… s’abat sur la trame de la vie, sur ce tissu si fragile et délicat en un sens, mais aussi d’une élasticité et d’une résistance admirable… ». Rachel Carson propose « un autre chemin pour une terre habitable demain ». Ainsi, courageusement, car par ailleurs, elle fait face à la maladie, Rachel Carson écrit un livre qu’elle dédie à Albert Schweitzer, grand médecin et homme de paix. Ce livre, « Le printemps silencieux » commence par un constat érigé en des termes émouvants : « Ce fut un printemps sans voix. A l’aube qui résonnait naguère du chant des grives, des colombes, des geais, des roitelets et de cent autres chanteurs, plus un son désormais ne se faisait entendre. Le silence régnait sur les champs, les bois et les marais… Qu’est ce qui a déjà réduit au silence les voix du printemps ans d’innombrables villes américaines ? Ce livre essaie de l’expliquer » ( p 63). « Le printemps silencieux » va rencontrer « un succès planétaire ». « On peut distinguer deux phases dans la réception de Rachel Carson. : d’abord un accueil très favorable à son livre un soutien et une caution des milieux scientifiques… puis une phase d’oubli, due certainement à une contre-offensive des lobbies. Il faudra alors attendre l’émergence des écologistes pour qu’elle devienne une de leurs références et qu’elle en vienne même à toucher un plus large public » ( p 70).
Comment Rachel Carson témoigne du pouvoir de transformation de l’émerveillement et d l’admiration : « awe and wonder ».
« awe » and « wonder » : l’émerveillement et l’admiration
La présentation de la mer par Rachel Carson témoigne de son admiration et de son émerveillement vis-à vis des merveilles de la nature. Cette réalité peut être éclairée aujourd’hui par la découverte récente de l’existence du phénomène de la « awe », un émerveillement ébloui qui apparait dans certaines situations. Aux Etats-Unis en effet, à la fin du dernier millénaire, la psychologie a commencé à porter son attention aux émotions. Et puis, lorsque cette recherche a commencé à aborder le champ des émotions positives, en 1903, Dacher Keltner et un de ses collègues, Jonathan Haig, ont commencé à travailler pour mettre en évidence et définir l’émotion de la « awe ». Puis Dacher Keltner s’est engagé avec le professeur Yang Bei dans une grande enquête internationale à l’échelle mondiale en vue de rassembler de récits de personnes décrivant une expérience de « awe » selon la définition choisie : « Etre en présence de quelque chose de vaste et de mystérieux qui transcende votre compréhension habituelle du monde » (4). Par la suite, dans son livre : « Wonderstruck », une philosophe, Helen De Cruz a poursuivi cette recherche sur un autre plan. « Wonder » and « awe » sont au cœur des questions les plus profondes de la vie. Helen De Cruz démontre que « wonder » et « awe » sont des émotions motrices et que l’humanité a délibérément entretenu ces émotions dans des champs culturels tels que la religion, la science et la culture » (page de couverture). Comment Helen De Cruz envisage-telle « wonder » et « awe » ? « Dans ce livre, je considérerai « awe » et « wonder » comme distinctes, mais comme des émotions apparentées psychologiquement. La « awe » est une émotion où nous ressentons ou conceptualisons l’immensité, reliée à un besoin d’accommodement cognitif. L’immensité peut être physique (la dimension) ou conceptuelle (la complexité)… « Wonder » est l’émotion qui s’élève du terrain inconnu qui se tient juste au-delà des marges de notre compréhension courante. Comme la « awe », elle suscite un besoin d’accommodement cognitif, mais elle ne requiert pas une dimension d’immensité… Helen De Cruz associe « wonder » et « awe » parce qu’elles sont étroitement connectées dans la pensée occidentale. Des mots comme le grec ancien « thauma » ou le terme médiéval « admiratio » recouvrent à la fois « awe » et « wonder ». Les psychologues contemporains les traitent également ensemble ». Quelles sont leurs caractéristiques communes ? L’auteure en distingue deux. Ce sont des émotions épistémiques, c’est-à-dire des émotions qui nous motivent et nous incitent à explorer notre environnement et à apprendre davantage à son sujet . Ce sont également des émotions self-transcendantes . « Elles nous aident à nous mouvoir au-delà de la centration sur nous-mêmes et de nos propres préoccupations ».
« awe » et « wonder », émerveillement et admiration chez Rachel Carson
Dans son livre, Helen De Cruz cherche comment l’émerveillement et l’admiration forgent la manière dont nous pensons : la philosophie, la psychologie, la science, la religion. Cependant, elle considère également que ces deux grandes dispositions contribuent également à la transformation du monde.
L’auteure évoque des articles de psychologie qui mette en évidence les bienfaits psychiques engendrés par la « awe », par l’émerveillement. Cependant, nous dit-elle, les problèmes qui nous affectent comme l’anxiété et le stress, ne viennent pas seulement de nous-mêmes. « Ils sont provoqués par des problèmes sociaux plus généraux. Considérons, par exemple le phénomène répandu de l’anxiété climatique ou plus largement de l’éco-anxiété ». Nous voulons préserver un monde vivable pour les générations futures. L’auteure cite une militante écologiste, Jacquelyn Gill, qui écrit : « Quand les choses son dures, je me tourne souvent vers le monde naturel pour y trouver inspiration, force et même joie. Partager le sens de l’émerveillement avec d’autres, me donne le sentiment d’être plus connectée et plus fondée, m’apporte mon sens de la vie. Cela me rappelle aussi pourquoi je lutte » ( p 158). D’autres chercheurs partagent cette attitude. L’auteure pose une question : « Comment l’admiration et l’émerveillement (awe and wonder ) peuvent être des sources d’espérance ? » Elle s’inspire des vues de Rachel Carson sur l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder ), particulièrement comme elle les a exprimées dans son livre : « The sense of wonder » (1965). Elle veut montrer que Rachel Carson perçoit le sens de la merveille comme une vertu et une émotion transformante. « Je montrerai que l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder) peuvent nous apporter deux visions majeures : que nous sommes connectés avec le reste du monde et que les choses pour lesquelles nous éprouvons de l’émerveillement et de l’admiration sont intrinsèquement valables » ( p 158).
Les trois livres de Rachel Carson , « une trilogie de la mer » et d’autre œuvres précoces sont remarquées pour leur qualité lyrique et le sens de la merveille qu’ils évoquent. L’écriture de Rachel Carson est fortement associée avec l’émerveillement pour la nature » ( p 159).
L’auteure évoque aussi le livre « le printemps silencieux où la peur se manifeste. « le printemps silencieux » est moins lyrique que le reste de l’oeuvre de Rachel Carson . Mais il commence par une fable apocalyptique inoubliable : « Il y avait une fois une ville au cœur de l’Amérique où toute vie semblait en harmonie avec l’environnement » Tout paraissait bien jusqu’ à ce qu’un étrange fléau apparut dans le secteur et que tout commença à changer. Quelque charme maléfique s’était installé sur la communauté. Des maladies mystérieuses balayaient des troupeaux de poulets. Les vaches et les moutons tombaient malades et mouraient. Une ombre de mort régnait partout ». Et elle poursuit : « Il y avait un calme étrange. Les oiseaux, par exemple – où étaient-ils allés ? Beaucoup de gens en parlaient, intrigués et troublés… Les quelques oiseaux aperçus quelque part étaient moribonds. Ils tremblaient violemment et ne pouvaient plus voler. C’était un printemps sans voix… » ( p 160). Helen de Cruz commente ce texte en ces termes : « L’usage efficace de la rhétorique et du sublime scientifique est une caractéristique de l’œuvre de Rachel Carson. Dans ce cas, ce n’est pas une évocation, comme d’habitude de la majesté et de la force de la nature, mais de sa fragilité face aux interventions humaines inconsidérées…. Les premières œuvres de Carson sur la mer communiquaient un sens de la merveille, cherchant à aller au-delà d’un simple exposé de faits sur la nature et comment la contrôler, en vue plutôt de la réenchanter. De l’autre côté, le « Printemps silencieux » nous secoue hors de l’enchantement du techno-optimisme… » ( p 161). Rachel Carson pointe à un mauvais usage de la technologie. En contraste, elle propose une science éclairée, « une famille de disciplines sensibles aux intrications dans la toile de la vie, la relation qui tient tout dans une vie unique et en une communauté en évolution. Cette vision demande que nos actions soit animées par une éthique environnementale » ( p 161).
« L’entrelacement de l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder), du sublime et de la préoccupation morale de Rachel Carspn pour l’environnement sont les traits notables de sa philosophie. » Pendant qu’elle concevait le Printemps silencieux, elle préparait déjà un livre sur la « wonder », un livre sur la merveille. Cependant, le « Printemps silencieux prit le pas comme projet d’écriture, parce que Rachel Carson y vit une nécessité face à une menace urgente. Elle allait vers la fin de sa vie. Elle souffrait d’un cancer du sein qui finira par la tuer. Au lieu d’un gros livre ambitieux sur la merveille, sur la wonder, elle nous laisse un mince volume intitulé : « the sense of wonder ». C’est une édition illustrée posthume d’un essai que Carson écrivit pour le magazine : « Women’s home companion ». Elle y décrit la joie dont elle a fait l’expérience : « Une soirée d’automne orageuse, alors que mon neveu Roger était âgé de 20 mois, je l’enveloppais dans une couverture et l’emmenait en bas sur la plage dans un lieu sombre et pluvieux ». Ils entendaient le bruit tumultueux des vagues. « Ensemble, nous riions de pure joie, – lui, un bébé rencontrant pour la première fois le tumulte sauvage de l’océan ; moi avec le sel de l’amour d’une moitié de vie pour la mer »… Rachel Carson croyait que l’émerveillement et l’admiration étaient des émotions que les enfants possèdent naturellement bien qu’elles puissent diminuer avec le temps si elles ne sont pas nourries et cultivées (p 162). Elle croyait également que l’émerveillement et l’admiration non seulement nous font sentir bons, mais que ces émotions sont aussi une source de force en temps de difficultés (4). L’auteure commente ainsi : » Ceux qui demeurent, parmi les beautés et les mystères de la terre, ne sont jamais seuls et las de la vie. Quelque soient les vexations et les soucis de leurs vies personnelles, leurs pensées peuvent trouver des chemins qui les mènent vers un contentement intérieur et une ardeur de vivre renouvelée. Ceux qui contemplent la beauté de la terre trouvent des réserves de force qui dureront aussi longtemps que leurs vies ».
Dans la vision de Rachel Carson, l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder ) sont transformatrices. Ces émotions nous aident à voir le monde différemment et, en voyant le monde différemment, nous changeons aussi. S’émerveiller est un antidote à notre attitude destructrice de contrôler la nature pour notre propre intérêt. « Rachel Carson écrit : « Il semble raisonnable de croire – et je crois – que plus clairement nous pouvons centrer notre attention sur les merveilles de notre univers et moins de gout nous aurons pour la destruction de notre race. L’émerveillement et l’humilité sont des émotions saines et elles ne font pas bon ménage avec un appétit de destruction ». ( p 163).
Helen de Cruz voit en l’émerveillement le potentiel d’une vertu.
Pour une personne qui manifeste la vertu correspondante, un état de chose requiert des actions et des obligations. « La vertu vous harmonise avec l’environnement d’une manière particulière ». Dans ce chapitre consacré à la puissance de transformation intérieure de la « awe », de l’émerveillement, Helen de Cruz donne ainsi Rachel Carson en exemple.
Cette biographie, cette histoire de vie nous renvoie ainsi à la prise de conscience de la « awe » et de ses effets, une prise de conscience assez récente telle que nous l’avons découverte dans la recherche de Dacher Keltner, puis dans Helen De Cruz. Si, au moment de la parution du « Printemps silencieux », Rachel Carson nous apparait comme une militante héroïque de l’écologie, à travers sa vie et à travers son œuvre, elle manifeste la puissance de la awe, la puissance de l’émerveillement.
J H
- Thierry Pacot. Rachel Carson. Pour la beauté du monde. Calype éditions. 2023
- Wonderstruck : https://vivreetesperer.com/comment-ladmiration-et-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-induisent-la-culture-et-faconnent-la-maniere-dont-nous-pensons/
- The new science of everyday wonder: https://vivreetesperer.com/comment-la-reconnaissance-et-la-manifestation-de-ladmiration-et-de-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-peut-transformer-nos-vies/
- Voir aussi : L’enfant: un être spirituel : https://vivreetesperer.com/cooperer-et-se-faire-confiance/
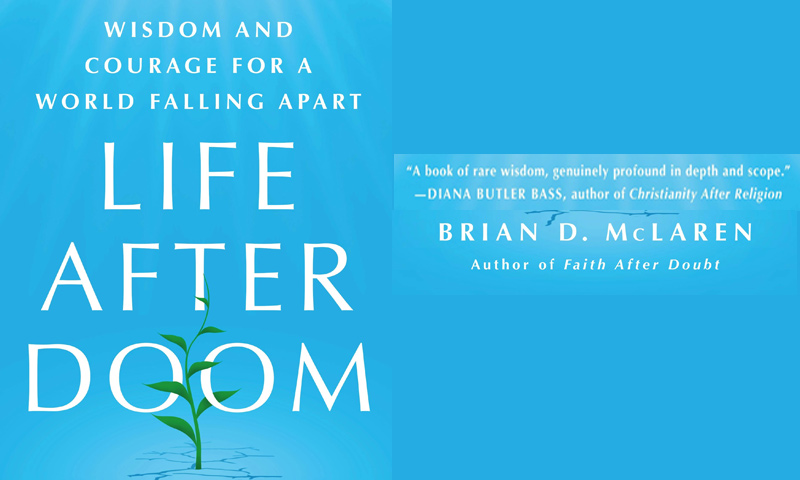
par jean | Déc 5, 2024 | Emergence écologique |
« Life after Doom » par Brian McLaren
Si la conscience écologique s’est éveillée dans l’univers chrétien francophone, il est important d’envisager la question à une échelle internationale. Or un livre évoquant dans une perspective chrétienne la menace d’un effondrement écologique et civilisationnel : « life after Doom » (1) vient de paraitre dans l’univers anglophone. La voix qui s’élève ainsi n’est pas celle d’un inconnu, mais celle de Brian McLaren, une personnalité chrétienne américaine engagée depuis deux décennies dans une lutte pour le renouvellement d’une Eglise déphasée par rapport aux interpellations du monde d’aujourd’hui. Pasteur, ayant fait mouvement pour sortir d’une orbite conservatrice, Brian McLaren s’inscrit dans une pratique œcuménique (2), devient un des principaux leaders de l’Eglise émergente aux Etats-Unis et, au cours de la dernière décennie, s’engage internationalement dans la vision d’une « grande migration spirituelle » (3), un nouveau genre de vie chrétien.
Le cheminement de Brian McLaren
Brian McLaren raconte la manière dont il est sorti d’une emprise conservatrice, et étape après étape, il a développé une conscience écologique.
Brian McLaren nous raconte combien son grand-père était une bonne personne et combien il l’aimait. C’était un homme ayant beaucoup d’expérience et profondément croyant dans une forme chrétienne conservatrice. Or, chaque hiver, ses grands-parents partaient de New-York pour gagner la Floride. Ce fut à cette occasion que Brian McLaren, âgé d’une dizaine d’années posa une question à son grand-père et en reçu une réponse dont il garda un souvenir marquant. Alors qu’ils passaient devant des pompes à balancier extrayant du pétrole. Brian lui demanda : « Qu’est- ce qui va arriver lorsqu’ils auront pomper tout ce pétrole ? Et son grand-père lui répondit : « Cet épuisement ne se produira jamais. Le Seigneur en a mis assez pour ce dont nous avons besoin sur la terre et que cela dure jusqu’à la seconde venue du Christ ». Bien qu’étant fort influencé par son milieu familial, Brian se rendait compte que son grand-père raisonnait en fonction de son époque. La terre lui paraissait immensément grande Et Dieu l’avait conçu pour tous nos besoins. Quant à lui, Brian venait de découvrir la première photo de la terre vue de l’espace C’était une sphère merveilleuse, mais petite. « Il lui paraissait évident que dans cette petite sphère, il y avait seulement une quantité finie de pétrole – et du reste » ( p 17). Par la suite, Brian est devenu professeur d’anglais, puis pasteur dans une congrégation chrétienne innovante. Un autre fait marquant lui apparut lors d’une de ses prédications.
Ce jour-là, Brian prêchait sur notre responsabilité spirituelle à l’égard de la terre. Un étudiant en sciences environnementales vint le trouver à la fin du culte en le félicitant d’avoir abordé un thème généralement ignoré. Il remarqua cependant que Brian n’avait pas abordé la question du réchauffement climatique. De fait, il n’en était pas encore informé et ce fut un choc pour lui d’en faire la découverte. Il en parle comme d’un évènement significatif dans sa vie : « Ma vie ne fut plus jamais la même » ( p 18). Sept ans après, sa préoccupation en ce domaine le conduisit à écrire un livre sur cette question. Il eut de plus en plus le sentiment que, dans beaucoup d’églises, l’intérêt se portait sur des problèmes internes, tout à fait mineurs par rapport aux grandes questions écologiques et sociales. Il se rendit compte que la focalisation sur le salut personnel était un orientation déséquilibrée qui ne tenait pas compte de l’accent que Jésus porte à le venue du règne de Dieu dans le « Notre Père » ( p 19). Alors, à l’âge de cinquante ans en 2006, il s’engagea dans un projet qui déboucha sur la publication du livre : « Tout doit changer ». Le titre qu’il avait proposé à l’éditeur était révolutionnaire : « Jésus et la machine du suicide ». Il prenait conscience que « la civilisation humaine que nous connaissions était en train de se détruire elle-même. « Nous étions sur une trajectoire suicidaire, écocide menant à un effondrement de l’écosystème global » ( p 20). A l’époque, des experts commençaient à évoquer des possibilités d’effondrement. Brian McLaren trouva alors que cet aspect était trop déprimant pour qu’il l’aborde dans son livre. Mais il garda cette perspective pour lui-même. Visitant de nombreuses églises, il se rendit compte qu’elles évitaient d’entrer dans la préoccupation du risque d’effondrement de la civilisation ( p 21) . Alors, au cours des dernières années, il est entré dans une démarche d’interpellation.
Cependant, il se rend compte que beaucoup de gens n’ont pas conscience de ce qui se passe actuellement. Pourtant, il imagine que, tout comme lui, certains se soucient de la situation actuelle et pressentent la menace. C’est à leur intention que Brian McLaren a écrit ce livre : « Life after Doom ». il veut essayer de dresser un état des lieux en affrontant les craintes correspondantes. Et, en ce sens, il veut essayer « de nous guider aussi profondément qu’il le puisse, dans l’état actuel de la compréhension par les scientifiques et autres experts sur les réalités qui amènent tant d’entre nous à éprouver un sentiment croissant de perte » ( p 23).
Une conscience de la menace
Pourquoi, l’humanité est-elle aujourd’hui menacée ? : « Notre civilisation globale, comme elle est actuellement structurée, est instable et insoutenable Ecologiquement, notre civilisation pompe trop de la terre et y rejette trop de détritus pour permettre une désintoxication de la terre. Economiquement, les systèmes financiers sont complexes, interconnectés, fragiles et profondément dépendants d’une croissance économique continue. Sans cette croissance économique continue, les systèmes financiers trébucheraient vers un effondrement. Mais, avec la croissance économique, nous hâtons l’effondrement écologique. De plus, nos systèmes économiques mondiaux, distribuent de plus en plus d’argent et de pouvoir à ceux qui en ont déjà, créant un petit réseau d’élites qui vivent dans le luxe et se partagent un grand pouvoir politique tandis qu’une grande masse de gens vivent dans la pauvreté ou tout proches avec peu de pouvoirs politique ». En conséquence, les instabilités politiques vont croitre. « Nos systèmes démocratiques seront tendus jusqu’à un point de rupture ».
Cette analyse permet de comprendre la gravité de la situation qui amène Brian McLaren à envisager quatre scénarios potentiels d’effondrement du plus modéré : l’évitement, au plus catastrophique : effondrement extinction.
Comment affronter et traverser cette épreuve dans la foi et l’espérance ?
Brian McLaren se donne pour but de nous aider à faire face à nos réactions lorsque nous prenons conscience de l’ampleur des menaces auxquelles nous sommes confrontés.
Il y a là une approche très concrète et, en même temps, une perspective, un horizon. Dans cette conjoncture, l’auteur nous encourage à prendre soin de notre esprit à travers le partage et la contemplation ( p 51-54). Il nous invite à ne pas nous enfermer dans la peine, mais savoir voir en regard du bon et du beau. Si l’espérance est contrariée, Brian McLaren évoque « une espérance contre toute espérance » selon l’expression de Paul (Romains 4.18). ( p 93-94).
L’auteur nous invite à une nouvelle manière de voir. C’est apprendre à voir autrement. C’est adopter un nouveau regard, en l’occurrence découvrir les sagesses autochtones depuis toujours en phase avec la nature, avec le vivant. Si l’on considère que le peuple hébreu fut aussi un peuple autochtone alors nous lirons la Bible avec un regard nouveau ( p 133-149). Cette approche originale nous parait un apport majeur du livre (4).
Face à cet avenir troublé, Brian McLaren nous invite à entrer dans un chemin de résilience. Ici, nous pouvons nous inspirer d’exemples historiques de résilience. Ainsi, pendant la chute de l’empire romain, la vie monastique fut un lieu de résistance et de refuge. De même, « nous pouvons apprendre des peuples colonisés ou réduits à l’esclavage.. Comment ont-ils survécu à une brutale oppression pendant des siècles ? » ( p 217). De même, en considérant l’histoire, on peut s’inspirer de l’exemples de belles personnalités qui ont su résister à la puissance du mal. L’auteur cite Dietrich Bonhoeffer et Martin Luther King ( p 223-224). Et encore, nous dit Brian McLaren, « Il suffit de deux ou trois pour créer une île de santé mentale dans un monde qui se défait » ( p 233).
Traverser les troubles de ce temps, cela demande aussi de nous mettre en liberté : (setting free) pour pouvoir nous engager plus agilement. La dernière séquence du livre est intitulée : « a path of agile engagement ». C’est une capacité à être pleinement vivant. Brian McLaren nous invite ainsi à savoir reconnaitre et apprécier la beauté, une beauté qui abonde autour de nous dans tous les registres de la Vie. A partir de la vue d’un rouge-gorge construisant son nid, ne peut-on pas imaginer la même activité chez d’innombrables oiseaux. « Chaque oiseau que je vois est un évangéliste de bonnes nouvelles » ( p 254). « La beauté abonde » répète Brian. Ne nous laissons pas abuser par toutes les informations qui portent la laideur et induisent la colère et la peur. Sachons apprécier les gestes de bonté et de générosité. Même dans une période d’effondrement, ii y a aura des gens pour se rassembler dire la vérité, célébrer la bonté… « Il y a tant de bonté dans le monde… une beauté abondante qui vaut la peine de vivre… Quel que soit ce qui s’est passé hier ou se passera demain, juste maintenant, la beauté abonde pour ceux qui apprennent à la voir » (p 261-262).
Brian McLaren évoque le Royaume de Dieu comme une migration spirituelle autour de Jésus ( p 257). Il rappelle les paroles de Jésus qui mettent en garde vis-à-vis de l’égocentrisme et de l’avarice. Lorsque Jésus parle du Royaume de Dieu, il évoque un genre de vie plus élevé, plus vaste, plus profond ici et maintenant – qui inclut les plantes (les fleurs sauvages), les animaux (les oiseaux) et les humains. Cet écosystème plus élevé ne prête pas attention aux sondages ou aux prévisions économiques. Il se poursuivra quand les systèmes humains s’effondreront » ( p 281).
Brian McLaren rappelle le discours de Martin Luther King commençant par ces mots : « j’ai fait un rêve ». Si nous affrontons la perspective de l’effondrement, concentrons- nous sur la vie et rappelons-nous le rêve. Parlons au sujet du rêve » ( p183).
Brian McLaren envisage le monde en terme d’énergie. A cet égard, on peut envisager une énergie de l’amour. Si l’humanité est en pleine turbulence, chacun de nous peut néanmoins émettre sa propre lumière répondant à la demande de Jésus : « Vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5.14) . ( p 292).
Comme on peut l’apprécier à cette lecture Brian McLaren nous ouvre successivement des échappées de lumière.
En publiant ce livre : « Life after Doom », Brian McLaren veut nous avertir des menaces auxquelles nous sommes confrontés, pour que nous puissions réagir.
Mais il a bien conscience de l’anxiété qu’il va susciter. Aujourd’hui, cette anxiété est déjà bien présente chez beaucoup de ceux qui ont conscience des retards dans la lutte contre le réchauffement climatique. Des initiatives se développent pour permettre aux participants d’affronter cette anxiété. A cet égard, nous avons rapporté le livre de Joana Macy et Chris Johnstone : « L’espérance en mouvement. Comment faire face au triste état de notre monde sans devenir fou » (5). Le livre de Brian McLaren se donne également pour but de nous aider à faire face à nos réactions lorsque nous prenons conscience de l’ampleur des menaces auxquelles nous sommes confrontés.
Venant d’un chrétien engagé, « Life after Doom » nous apporte une voix originale également parce qu’elle vient d’un univers culturel différent du paysage français. Ce livre contribue à nous ouvrir un chemin dans un situation où les menaces abondent.
J H
- Brian McLaren. Life after Doom. Wisdom and courage for a World falling apart. Hodder and Stoughton, 2024 Présentation sur Témoins : https://www.temoins.com/la-vie-face-a-leffondrement/
- Qu’est-ce qu’une orthodoxie généreuse ? https://www.temoins.com/une-theologie-pour-leglise-emergente-quest-ce-quune-qorthodoxie-genereuseaampqu/
- La grande migration spirituelle : https://www.temoins.com/la-grande-migration-spirituelle/
- Comment lire la Bible selon la culture des peuples autochtones : https://www.temoins.com/comment-lire-la-bible-selon-la-culture-des-peuples-premiers/
- L’espérance en mouvement : https://vivreetesperer.com/lesperance-en-mouvement/

par jean | Sep 2, 2024 | ARTICLES, Emergence écologique |
La société jardinière
La société jardinière : c’est le titre du livre de Damien Deville, un géographe et anthropologue, qui y rapporte sa découverte des jardins potagers implantés dans la ville d’Ales, un exemple des jardins urbains qui, en France et dans le monde, répondent à un besoin de subsistance dans différents contextes. On peut situer cette activité jardinière dans une histoire qui débute à la fin du XIXe siècle dans l’œuvre de l’abbé Lemire pour le développement des jardins familiaux. Plus généralement, cette activité jardinière en milieu urbain a connu dans les dernières décennies une remarquable impulsion dans le mouvement qui s’est répandu en France sous le vocable : ‘Les Incroyables comestibles’ (1) Et aujourd’hui, à travers diverses initiatives, certaines villes sont à la recherche de la réalisation d’une autonomie alimentaire (2).
Certes, évoquer une société jardinière éveille en nous le rêve d’une société pacifiée, mais ce n’est pas une pure utopie puisqu’il y aujourd’hui des expériences concrètes d’activités jardinières en milieu urbain. Dans son livre : ‘La société jardinière’ (3), Damien Deville nous décrit l’une d’entre elle, dans une ville profondément perturbée par la désindustrialisation, Ales à la porte de Cévennes. « Là, pour les anciennes populations ouvrières, se vit une façon de retour à la terre. Là, chacun plante, bêche ; tout le monde échange outils, semences, et savoir-faire. Si bien qu’à la motivation économique, forcément première, viennent se mêler des préoccupations d’ordre social, écologique, ou paysager. Cernant les contours d’une écologie de la précarité, l’auteur souligne comment de simples lopins de terre deviennent d’authentiques lieux d’émancipation. Partant, il ébauche le modèle de ce que pourrait être la société si elle était jardinière » (page de couverture).
Parcours d’une innovation sociale
L’apparition de jardins familiaux en milieu urbain remonte à la fin du XIXe siècle.
« C’est à Hazebrook, capitale de Flandre intérieure, que nait au milieu du XIXe siècle celui qui restera dans les mémoires comme le père fondateur des jardins familiaux : l’abbé Lemire ». L’auteur esquisse sa biographie. Jeune prêtre à Hazebrook, « touché par la misère de la commune, par les besoins des uns et les rêves des autres, l’abbé Lemire s’attacha rapidement aux besoins des habitants » En retour, il reçut un soutien populaire. Élu député en 1893, il mena une carrière politique indépendante par rapport à l’Église. Élu maire d’Hazebrook en 1914, il fit face aux périls de la guerre et mena une politique sociale très active si bien qu’il devint ‘un héros local’. « Attaché à la dignité des ouvriers, et persuadé que le lien à la terre est un besoin fondamental des humains, l’abbé cultiva une politique dont lui seul se faisait le gardien. Et c’est dans cette perspective que l’abbé fonda en 1896, le mouvement : La Ligue française du coin de terre et du foyer. Ce mouvement existe toujours. Il a survécu à l’abbé et continue de tracer une partie des territoires français. Il se nomme désormais Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs » (p 29). L’auteur rapporte comment son influence s’est répandue au début du XXe siècle, atteignant la ville d’Ales. Là, se conjuguant à l’époque avec la société Sant-Vincent-de- Paul, la Ligue suscite, en 1916, de premiers jardins. « A destination d’abord des femmes et des excusés du front, les jardins devinrent rapidement un soutien, une épaule, un guide. Greniers à fruits et légumes, ils participèrent à la résilience alimentaire des familles s’implantant dans plusieurs quartiers ». Puis, « les ouvriers de la mine en devinrent les premiers bénéficiaires. Jusque dans les années 1950, la surface jardinée à Ales s’étendit, année après année, pour atteindre un point d’orbite avec plus de 400 jardins cultivés sur la commune » (p 34).
Cependant, la situation des jardins familiaux à Alès participe à une conjoncture nationale. « Les temps changèrent. Les Trente Glorieuses et le faste des projets urbains dont elles se firent l’étendard sonnèrent le glas de l’aventure jardinière. Les champs, les pâtures et les vergers furent recouverts de chapes de béton… Les jardins familiaux ont rapidement perdu force et espace dans un flot répété d’urbanisation qui dura jusque dans les années 2000 » (p 35). Cependant, à la fin du XXe siècle, toute la France a été impactée par la désindustrialisation et le choc a été particulièrement violent à Ales. « En 1986, après plusieurs années de licenciements massifs, le dernier puits de mine d’Alès cessa définitivement ses activités. La métallurgie, autre fleuron, connut le même déclin… » (p 37)
Comme pour d’autres villes françaises, Ales doit chercher une autre voie. « Ales dut se réinventer et, au tournant des années 1990, la ville décide de s’orienter vers de nouvelles filières, vers une économie de services diversifiés. Parallèlement, Ales cherche à s’enraciner de nouveau dans le paysage cévenol » (p 38). Elle cherche à ancrer de nouveau la ville dans le paysage. « Ces politiques d’embellissement ne sont pas sans effet sur l’histoire des jardins… Elles ont permis à de nouveaux potagers d’émerger dans des quartiers populaires : des fleurs et des choux ont poussé là où il n’y avait que du béton… » (p 39). L’auteur décrit les différentes logiques à l’œuvre dans la politique locale. La vie des jardins s’inscrit dans une histoire locale.
Jardins et jardiniers à Ales
Damien Deville a observé ces jardins et la manière dont ils témoignent d’une grande créativité. Il a parlé avec ces hommes et entendu leurs parcours dans la diversité des histoires de vie. Il met en lumière les nouvelles relations qui s’établissent ainsi.
Le jardinage à Ales se déroule en plusieurs lieux. « les jardins du Chemin des Sports » sont issus d’une autre histoire que les jardins de la fédération des jardins familiaux, portant une image de marque. Bricolés sur des terrains oubliés, épousant la forme de réseaux souterrains, s’échangeant de manière informelle d’un jardinier à l’autre par un bouche-à-oreille judicieusemant maintenu dans des cercles restreints, arpentés par des personnes venant, pour l’essentiel, des quartiers populaires de la ville, ils correspondent à ce qu’Ananya Roy désigne par « urbanisme subalterne ». Ce sont des espaces urbains oubliés des grandes annales de la géographie et des politiques de la commune où s’invente la vie quotidienne des dépossédés… » (p 49). A la différence d’autres jardins potagers, bien reconnus, « se donnant à voir et s’offrant à la reconnaissance des habitants, les jardins du chemin des Sports, relèvent plutôt de bastions enfouis dans la verdure… Ils s’effacent derrière une image austère et précaire » (p 50). Lorsqu’on entre dans ces jardins, on y découvre un paysage coloré et une végétation luxuriante abondamment décrite par l’auteur « Tomates bronzées au soleil, plants de haricots parcourant des fils noués à des tuteurs, des framboisiers le long des murs dansent de leurs ombres, tandis que des plantes aromatiques, tantôt cultivées en pot, tantôt laissées en pleine terre parsèment le jardin… » (52). « Ce qui saute aux yeux, c’est une quête centrale de productivité. L’espace consacré aux fruits et aux légumes est agencé de manière à produire le plus possible. Lorsque la parcelle se fait étroite, les jardiniers rivalisent d’ingéniosité pour gagner quelques centimètres et conquérir les hauteurs » (p 53). L’auteur décrit des dispositifs ingénieux comme « une immense pyramide entrelacée de fils et de barres de fer… au service des plantes : fèves, haricots, courges grimpantes… » (p 54). Ici, le peuple des jardiniers a une origine caractérisée. « La plupart sont retournés à la terre pour se doter d’une certaine autonomie alimentaire. Les jardiniers du chemin des Sports sont des marqués. Ce sont d’anciens serruriers et ouvriers des aciéries, des employés du public ou des retraités à petits revenus. Leurs trajectoires familiales ont été percutées par la fermeture des industries alésiennes, par la série d’emplois précaires qui s’en est suivie, puis, plus récemment par la fuite des offres d’emploi et de services vers les grandes métropoles » (p 55). Ainsi s’est développé un genre de vie à vocation utilitaire. « La débrouille est devenu un art de vivre… Toutes les personnes rencontrées au fil de notre enquête l’ont partagé sans s’en cacher : devenir jardinier fut une adaptation nécessaire à différentes formes de précarité… L’agencement spatial du chemin des Sports autant que le choix des matériaux s’entendent ainsi, en premier lieu, au regard de conditions matérielles d’existence » (p 57). Cependant, tout ne résume pas à une recherche de subsistance. Les jardins témoignent aussi d’une inventivité artistique. « Les planches de culture sont parées d’objets de toutes sortes : des pots richement décorés, des épouvantails faits main, des souvenirs s’intègrent aux cultures potagères… Les jardins répondent autant aux besoins quotidiens de qui les arpente et les façonne qu’à ses aspirations, son savoir-faire, sa créativité. Car, dans sa manière d’agencer l’espace, le jardinier cherche à le rendre agréable à regarder et à vivre… C’est que les ‘espaces subalternes’ ne sont pas seulement des zones de débrouillardise et d‘adaptation, ils sont encore des agencements populaires traversés par tout ce qui fait la créativité, les joies et les envies des âmes humaines » (p 60).
Ces jardins engendrent une vie sociale et ils en sont l’expression. Ainsi Damien Deville nous présente des portraits de jardiniers. Il fait aussi écho à une mémoire collective : « Le jardin de Max, au cœur de l’association des jardins familiaux, dans le quartier de la Prairie, est un bel exemple de cette mémoire collective. Du haut de ses 70 ans, Max est un ancien de la Fédération des jardins familiaux d’Ales. Ici tout le monde le connait. Son papa était un jardinier très actif dans la communauté. Max éprouve pour lui une grande admiration : « son travail, son parcours de vie, le pilier qu’il était dans les jardins familiaux d’Ales » le ramène à sa propre enfance autant qu’aux heures de gloire qu’a connues la ville ». L’auteur rappelle ces souvenirs. « Ils se lisent à même le jardin de Max, démontrant combien les jardins sont des outils de réappropriation de récits urbains… Son jardin est également un mémorial à la figure de son père, Henri… Féru de bons conseils, son père était le premier à organiser des barbecues collectifs, à donner des coups de main aux voisins, à diffuser de bonnes pratiques et à échanger quelques légumes. Tant et si bien que le nom du papa revient souvent, indélébile dans les mémoires collectives » (p 76-77).
Damien Deville décrit la géographie sociale de la région : « Les zones de relégation sont en centre-ville, tandis que les espaces de gentrification se situent dans les quartiers périphériques, caractérisés par des villas cosy ou dans les villages au charme d’antan. Face à cette campagne qui se ferme aux personnes les plus pauvres, les jardins sont ces lieux où se forge une nouvelle réciprocité. Et là encore, c’est un jardinier, d’origine maghrébine, qui m’a mis la puce à l’oreille ». L’auteur nous décrit le parcours de Moustapha. « Moustapha est arrivé sur le tard dans les jardins familiaux privés du quartier de la Prairie, sur le chemin des sports. Il a repris la parcelle d’un voisin devenu trop âgé pour s’en occuper. Les Cévennes, l’homme ne les a jamais connues auparavant. Il a mené l’intégralité de s vie professionnelle en Algérie avant de rejoindre ses enfants à Ales pour sa retraite. Resté pendant longtemps sans allocation, Moustapha a dû se débrouiller pour arrondir ses fins de mois que sa petite retraite affiliée au régime algérien ne lui permettait pas de combler. Le jardin est arrivé dans sa vie à point nommé » (p 85). C’est, avec lui, que l’auteur découvre une ouverture de ce milieu urbain vers les campagnes voisines. « C’est en échangeant avec les autres jardiniers que Moustapha s’est rendu compte que les montagnes qui l’entouraient regorgeaient de trésors : d’aiguilles de pin pour amender ses cultures, de champignons à vendre auprès de sa communauté, d’éleveurs où aller chercher le mouton pour l’Aïd à des prix réduits. Moustapha s’est mis, par lui-même, à découvrir les coins cachés des campagnes avoisinantes » (p 86). Cependant, la relation de Moustapha avec les Cévennes s’étend au-delà puisqu’en fin de semaine, il fréquente en famille « des lieux de baignade où ses petits-enfants jouent maintenant l’été ». « Son jardin a été une fenêtre sur le monde, un livre pour réapprendre le milieu dans lequel il évolue au quotidien, et en faire naitre des usages à des fins d’émancipation personnelle ou familiale » (p 86). Mais l’auteur perçoit ce même attrait pour les Cévennes chez d’autres jardiniers. « Le jardinier algérien n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Tous, d’une manière ou d’une autre, pratiquent la campagne avoisinante. Pour certains, cela est lié à un héritage familial. Pour d’autres jardiniers récemment arrivés, c’est toujours le jardin qui nourrit les perspectives des montagnes et des villages alentour. Les usages qu’en font les jardiniers sont pluriels en fonction des envies et de la personnalité de chacun, mais ils participent dans tous les cas à une réappropriation spatiale et collective d’un territoire qui devient, enfin, de nouveau partagé » (p 86). Ainsi les jardiniers interviennent dans la vie collective. « Les Cévennes s’ouvrent à nouveau aux classes populaires. De cette réconciliation, dont la ville d’Ales a tellement besoin, les jardins en sont le premiers étendards… C’est une invitation à penser le territoire autrement » (p 87).
La société jardinière
La société jardinière : quelle expression évocatrice ! Il y a tant de formes de société que l’on déplore et que l’on redoute ! Une société jardinière, cela évoque pour le moins un respect et un amour de la nature et un état d’esprit constructif par le genre même de la tâche entreprise. Une société jardinière, c’est aussi une société nourricière et on peut imaginer qu’elle requiert et engendre la coopération.
Géographe, Damien Deville pense également en sociologue et en historien. Ainsi, si sa recherche a pour objet la ville d’Ales, il inscrit les jardins potagers en milieu urbain dans une histoire qui remonte à la fin du XIXe siècle. Mais, concentré sur son objet, il n’aborde pas la vague toute récente, celle des « incroyables comestibles » à travers laquelle la culture de fruits et de légumes s’est répandue à l’intérieur même d’un grand nombre d’agglomérations (1). Et aujourd’hui, des villes et des territoires s’engagent dans la recherche d’une autonomie alimentaire. Ainsi François Rouillay et Sabine Becker préconisent le développement de « paysages nourriciers », y incluant la « végétalisation des villes » (3) ;
A partir de l’étude des jardins potagers dans la ville d’Ales, Damien Deville nous montre, lui aussi, comment on peut « penser autrement la ville et l’urbain ». C’est bien de ‘vivre autrement’ (p 117-118) qu’il s’agit.
Déjà, dans un monde qui nous bouscule, la vie jardinière permet un enracinement. Ainsi, « les jardins alésiens sont cultivés par des personnes peu diplômées, laissées à l’arrière-plan des grands récits de l’histoire. La plupart ont quitté l’école tôt pour tenter leurs chances dans les grandes industries du territoire. Certaines ont été percutées par des évènements traumatisants. D’autres encore, arrivées sur le tard à Ales, parlent mal le français et s’intègrent avec peine. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui ont su, face aux crises urbaines, s’adapter et construire des interfaces inédits ave la ville. Leurs jardins sont fleuris ; ils remettent des couleurs dans les rues. Ils sont poreux aux autres réseaux urbains, catalysant relations et occasions. Ils sont ces espaces où se réinventent une certaine idée de prestance et de présence à soi, des oasis dessinant un autre bien vivre » (p 119).
Dans les jardins se réalise également une rencontre entre le monde végétal et ceux qui en prennent soin. « Ces jardins sont avant tout des mondes végétaux ». L’auteur fait l’éloge du déploiement des plantes et de leur vitalité. Elles s’agencent comme en une danse. Or, « le jardinier accompagne cette danse. Ses choix sont primordiaux et conditionnent le développement des plantes. Finalement, c’est bien cette rencontre inédite entre les plantes d’un côté, et le caractère du jardinier de l’autre, qui traduit l’évolution des lieux et des récits qui s’y écrivent. L’humain devient ici un être hybride, inondé et inspiré par les plantes qu’il a vu naitre, ou qui sont revenues naturellement dans son jardin » (p 121-123).
Damien Deville voit là se développer une dynamique de relation. « A l’image de ce lien unique au végétal, les jardins participent à l’émancipation globale des jardiniers par leur capacité à catalyser sans cesse les relations qui composent les individus » (p 123). L’auteur voit dans cette activité jardinière un potentiel de relation. « Les jardins guident d’autres possibles urbains quand ils permettent à chaque ville de devenir une terre de relations » (p 123). L’auteur décrit les terres des Cévennes abandonnées. « La seule solution pour sauver le vivant, c’est de retourner y habiter et de faire de la relation une œuvre » (p 125). Dans le même esprit, Damien Deville sort des limites de l’hexagone et évoque un paysan du Burkina Fasso qui a résisté à la désertification et arrêté le désert en plantant des arbres, Yacouba Sawadogo, à l’histoire duquel il a consacré un livre (4).
« Si Yacuba était parti comme les autres, habitants dans les années 1980, le désert aurait cassé la porte et continué vers le village voisin. C’est parce qu’il est resté, tout en tissant autrement sa relation avec le territoire, qu’il a pu sauver le vivant… ».
Ainsi, « Ales et les Cévennes, autant que le Burkina Fasso, invitent à un nouveau front scientifique et politique. Trouver les égards que l’on doit au vivant, pour reprendre l’expression du philosophe Baptiste Morizot, demande, non pas de fuir certains territoires, pour se concentrer sur d’autres, mais bien de réfléchir aux manières de vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écosystémiques. L’humain a été une machine à détruire, mais les initiatives se multiplient… ». Damien Deville en évoque certaines dans la Drôme, dans les Cévennes, en Bretagne. « Tous ces exemples forgent au quotidien une nouvelle manière de faire lien, et reconstruisent des filières d’activité dans l’environnement local. Ils permettent aussi aux citoyens et citoyennes de se réapproprier le territoire et de participer aux décisions locales. En un mot, ils façonnent un droit pour toutes et tous à habiter le territoire et à le coconstruire au quotidien » (p 128).
En considérant l’activité jardinière, Damien Deville y perçoit un « monde ordinaire » dans une fécondité méconnue. Il met en valeur la manière dont les jardins génèrent des relations quotidiennes. « Les économistes Cécile Renouard et Gaël Giraud ont créé un indicateur qui pourrait bien inspirer les territoires d’ici et d’ailleurs, ‘l’indicateur de capacité relationnelle’. Ce dernier mesure la qualité des relations qu’entretiennent les personnes entre elles, et leur capacité de s’autonomiser à partir de ces mêmes relations… ». « Pensé dans le cadre ouest-africain, cet indicateur insiste sur la qualité du tissu social et sur les relations interpersonnelles comme autant de dimensions du développement humain ». Ainsi, des pauvres ‘financièrement’ peuvent être néanmoins tellement entourés qu’ils ne manquent de rien, et inversement. « La relation est finalement plus importante que le seul revenu. Penser en ces termes le développement permet d’accorder de nouveau de l’importance à ce qui est invisibilisé dans les grands récits de développement. Les jardins d’Ales changent le visage d’un quartier et les dynamiques sociales et écologiques d’une ville ». Dans son analyse, Damien Deville se réfère à Michel de Certeau. « Dans son livre maître : « L’invention du quotidien », l’historien et sociologue Michel de Certeau analysait déjà les actes ordinaires comme une production permanente de culture et de partage. Selon lui, les citadins ne se contentent pas de consommer : ils produisent et inventent le quotidien par d’innombrables mécanismes de créativité et par des politiques sociales originales. Pour emprunter l’expression de Claude Levi-Strauss, les citadins « bricolent » avec les espaces qu’ils fréquentent et les contraintes d’un modèle sociétal pour s’inventer un parcours de vie qui participe de leur émancipation. Ils créent de la relation » (p 131).
Un mouvement innovant
« Qu’elle favorise le retour des oiseaux et des hérissons, protège les villes des vagues caniculaires offrant de l’ombre et refroidissant l’air, l’agriculture urbaine a, en nos temps assombris de l’Anthropocène, le vent en poupe » (p 7). En s’inscrivant dans un courant de recherche en plein développement, Damien Deville analyse les fonctions et les configurations de l’agriculture urbaine.
« Laboratoires d’un monde possible, les jardins potagers des grandes métropoles européennes – qui produisent assez peu et se déploient sur des espaces restreints – s’offrent comme des lieux où s’expérimente une éducation renouvelée, plus douce, plus responsable, aux techniques de jardinage et aux arts de la table » (p 8). Cependant, la plupart des jardins répondent à une fonction plus élémentaire, celle de ressource alimentaire. « La Havane, Bobo-Dioulasso, Hanoï ou encore Rabat, autant de villes pour lesquelles les jardins potagers demeurent des greniers participant de l’autonomie alimentaire des familles » (p 8). « Dans les villes du sud de l’Europe, telles qu’Athènes ou Porto, frappées par la crise économique de 2008, des familles ayant subi des pertes économiques importantes ont mobilisé les jardins comme des espaces d’adaptation » (p 14). Récemment, sous l’impulsion de l’association A9 présidé par Rodolphe Gozegba de Bombembe, théologien, des lopins de terre autour des habitations sont mobilisés en jardin potager dans la ville de Bangui, en République Centre-Africaine (5). Dans son livre, Damien Deville étudie particulièrement le rôle des jardins potagers dans des villes moyennes appauvries par la désindustrialisation, en concentrant sa recherche sur l’exemple de la ville d’Alès. A cette occasion, il milite pour « une décentralisation guidée par la diversité des territoires et la qualité des relations que nouent les uns et les autres » (p 135). Si on ajoute le mouvement pour l’agriculture urbaine en vue d’une autonomie alimentaire dans une perspective écologique, on comprendra que le développement des jardins en ville n’est pas un phénomène mineur, mais qu’il s’inscrit dans une recomposition de grande ampleur.
Damien Deville a bien choisi le titre de son livre : la société jardinière, non seulement parce qu’il y étudie, sous toutes ses coutures, le développement des jardins en ville, mais parce que il présente, sous cette appellation, un phénomène de société en y percevant un potentiel d’exemplarité humaine. Oui, la société jardinière, n’est-ce pas une vision d’avenir ?
J H
- Comment les « Incroyables comestibles se sont développés en France ? : https://vivreetesperer.com/incroyable-mais-vrai-comment-les-incroyables-comestibles-se-sont-developpes-en-france/
- En route pour l’autonomie alimentaire : https://vivreetesperer.com/en-route-pour-lautonomie-alimentaire/
- Damien Deville. La société jardinière. Le Pommier, 2023
- Yacouba Sawadogo. Damien Deville. L’homme qui arrêta le désert. Tana éditions, 2022 (Le temps des imaginaires)
- Centre-Afrique : l’agriculture urbaine pour lutter contre la faim : https://www.temoins.com/centrafrique-lagriculture-urbaine-pour-lutter-contre-la-faim/
par jean | Oct 2, 2023 | Emergence écologique |
 Dans le mouvement de le transition intérieure, co-créer une culture régénératrice.
Dans le mouvement de le transition intérieure, co-créer une culture régénératrice.
Conséquence d’une ambition démesurée de l’humanité en recherche de richesse et de puissance, exploitant sans vergogne les ressources de la planète, malgré des avertissements personnels et collectifs remontant à plusieurs décennies, la crise climatique appelle aujourd’hui un changement de cap, un changement de paradigme, un changement de vision. Ce changement radical requiert une mobilisation des esprits fondée sur une nouvelle manière de voir le monde et débouche sur un changement économique et social. C’est un processus qui s’effectue dans le temps. C’est pourquoi nous devons envisager une transition. Et lorsqu’il s’agit de promouvoir un nouvel état d’esprit, une autre façon de sentir et d’agir, une nouvelle manière d’envisager l’avenir, on peut parler de « transition intérieure ». Michel Maxime Egger, Tylie Grosjean, Elie Wattrelet viennent d’écrire un « Manuel de transition intérieure » (1) publié en 2023 aux Editions Actes Sud en partenariat avec le mouvement Colibris dans la collection ‘Domaine du possible’. Ce livre, de près de 500 pages, est un ouvrage de référence qui se décline en plusieurs séquences : fondements, métamorphoses, intégration, praxis, ressources pour aller plus loin… Et il affiche en premier un titre hautement significatif, le terme : « Reliance ». Comme déjà, à plusieurs reprises (2), nous constatons que tout se tient, tout se relie et nous sommes invités à affronter les perturbations qui compromettent cette unité potentielle, dans un travail de reliance. Ce livre couvre un champ très vaste et nous nous arrêterons ici sur un des aspects: « Une culture du soin pour un monde plus sain ».
Une culture du soin dans un monde plus sain (p 180-181).
Promouvoir la transition intérieure, « implique de remettre le soin au cœur de notre façon d’être au monde en tant qu’individu, collectif et société ». Le mouvement de la transition accorde au soin une grande attention. « Il est alors possible de contribuer à la co-création d’une société de soin, souvent nommée société du care » (3) Pour la politologue féministe, Joan Tonto, « le care est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible ». La philosophe Cynthia Fleury évoque également une « société du care ». Assez naturellement, la notion de soin renvoie au secteur de la santé et de tous les métiers associés au « prendre soin ». Cependant, ici on élargit la perspective en englobant toutes les composantes de la société. Et, considérant le courant du développement personnel, on y perçoit une approche trop individualiste « avec pour risque de s’adapter au monde tel qu’il est, sans jamais s’interroger sur son bien fondé, sa légitimité, ses travers et ses conséquences… ». A l’inverse, dans la transition intérieure, les démarches visant à prendre soin de soi, des autres, et du monde, sont clairement indiquées, dans la conscience critique et aussi politique de leur impact sur la toile du vivant ».
Co-créer une culture régénératrice (p 181-183).
Nous vivons dans l’ambiance d’une vie pressée qui ne favorise pas une vie pacifiée. « Une société qui fonctionne en sollicitant exagérément les êtres humains et les écosystèmes qu’elle s’approprie génère forcément des phénomènes d’épuisement. Le consumérisme saisit la biosphère et l’être humain. Il les épuise en excédant leurs limites et capacités de régénération ». Comme nous nous inscrivons dans ce genre de vie, nous sommes influencés par ces travers jusque dans nos efforts pour y remédier. « Le monde de la transition n’échappe pas à cette logique ; si le système nous exténue, nous pouvons aussi nous épuiser à tenter d’en sortir et de créer du neuf ». Comment vivons-nous ces dépressions et pouvons-nous en tirer parti ? « Un grand nombre de transitionnaires vivent leurs burn-out et d’autres soucis de santé comme des signaux d’alarme, des opportunités pour franchir des étapes d’évolution plus radicales. En découvrant ‘le potentiel de métamorphose’ des épuisements, nous pouvons progressivement les accueillir et nous laisser transformer par eux, avec un soutien du collectif ». Cependant, il est important d’envisager également les causes structurelles de ces épuisements : « les logiques de rentabilité et de course à la performance, qui sont inhérentes à nos cultures modernes occidentales. Elles sont aussi à dénoncer et à déconstruire ». Comme l’écrit Martine Simon, « L’enjeu d’obtenir des résultats coûte que coûte domine dans notre culture tandis que l’enjeu de prendre soin est relégué à tenter de réparer les dégâts ». Dans une perspective inspirée par la permaculture, trois orientations : « prendre soin, prendre soin pour obtenir des résultats, et obtenir des résultats qui prennent soin ». Il n’y a pas de travaux de seconde zone. « Prendre la mesure de l’importance du care pour la vie humaine nous rappelle que nous dépendons tous des services d’autrui pour satisfaire des besoins primordiaux ».
Vers un soin de soi juste et engagé (p 183-187)
La conscience de l’importance de ‘prendre soin de soi’ s’est aujourd’hui répandue. Les auteurs envisagent également cette attitude dans une perspective plus large : « ‘Le prendre soin de soi’ doit être envisagé dans ses dimensions politiques ». Certaines personnes y voient une passivité redoutable. « Idéalement, le care intégrerait et transcenderait à la fois la lutte et le repos en démontant ainsi les frontières qui les séparent ». ‘Prendre soin de soi’ peut être vécu de diverses manières. Ce nouvel adage n’est pas sans travers : « Quand nous tentons de maintenir les apparences en renvoyant une image de réussite ou d’individu autonome, quand nous cherchons à nous remettre sur pied pour faire plus de la même chose, nous peinons à créer les conditions pour nous sentir mieux et contribuer à un véritable changement ». Nous voici ici appelés également à un rapport nouveau à l’écoulement du temps. Le militantisme en faveur de la transition peut lui-même être entaché par une excitation dans la recherche d’une rapidité dans l’obtention des résultats. « Dans nos projets novateurs, nous plaçons parfois inconsciemment la même exigence de rentabilité ou la même soif de reconnaissance qu’avant. C’est le cas aussi lorsque nous intégrons les pratiques de transition intérieure avec fébrilité : nous faisons beaucoup de choses pour apprendre à ‘être’ ». « Il n’est pas toujours facile d’accepter que la pacification de notre relation au temps… prenne justement du temps ». Les auteurs évoquent, entre autre, « la notion de temps juste proposée par le journaliste Carl Honoré. On peut notamment explorer différentes formes de ‘slow’ en adoptant des rythmes adaptés à chaque contexte. Cela suppose, à chaque instant, une écoute de plus en plus fine de la vie qui s’exprime en nous et autour de nous. Cela demande aussi de connaître et choisir de consacrer du temps à ce qui nous nourrit et nous régénère ».
Nous entrainer à l’ouverture du cœur (p 188-192)
Etre ouvert de cœur, c’est être attentif aux autres, c’est-à-dire ne pas s’enfermer dans un train de vie fondé sur ses propres forces. C’est donc accepter de reconnaître notre vulnérabilité. « Quand on a appris à se protéger en s’isolant, un lien est à retisser pour se sentir à nouveau en sécurité avec l’autre. Même sans avoir vécu un traumatisme particulier, il importe de transformer les croyances qui associent la vulnérabilité à la passivité et à la faiblesse. Nous découvrons alors très souvent, que son acceptation nous donne de la force. Accepter et reconnaitre notre vulnérabilité nous permet peu à peu d’oser demander du soutien à un entourage de confiance…
Que ce soit au cœur du soin, de la santé, et plus généralement dans une relation avec les autres, Cynthia Fleury (4) nous invite à poser une double exigence : « rendre la vulnérabilité capacitaire et porter l’existence de tous comme un enjeu propre dans toutes les circonstances de la vie ». En défendant une approche plus globale du soin, elle encourage par exemple à prendre en compte la vulnérabilité d’un patient « sans jamais la renforcer, ni la considérer comme synonyme d’incapacité ».
Dans un magnifique témoignage, Pascale Frère, médecin spécialiste en hématologie, explique l’importance d’avoir pu s’ouvrir à sa propre vulnérabilité au fil des épreuves de la vie. Dans ses épreuves, elle a compris que « le cœur ouvert du soignant amenait autant de guérison que la technique d’exécution du geste, car la vie circulant chez le soignant contactait la mienne, cette part de douceur dont j’avais même oublié l’existence ». Ces prises de conscience lui ont permis de « retrouver la voie d’une médecine humaniste, réinvitant dans la relation thérapeutique une qualité de présence tissée d’amour et de compassion ».
Nous rencontrer pour évoluer ensemble vers de nouveaux comportements dans la voie de la transition intérieure requiert une ambiance « d’empathie et de douceur ». Ainsi « la richesse de ce qui est partagé dans la profondeur se met au service tant des personnes que du collectif. L’empathie, cette posture qui nous rend « capable de nous mettre à la place de l’autre », y contribue. L’éloge de la douceur vient nous éveiller à une réalité parfois encore méconnue. « Dans cette société qui dévalorise les enjeux du soin, il peut paraître dérisoire d’encourager la douceur et la tendresse… Comme si ces qualités étaient réservées à la sphère privée… On n’aurait ni le temps, ni les moyens pour le reste du monde ». Pour Anne Dufourmantelle, « être doux avec les choses et avec les êtres… c’est ne pas vouloir ajouter de la souffrance à l’exclusion, à la cruauté et inventer l’espace d’une humanité sensible, d’un rapport à l’autre qui accepte sa faiblesse… ». « Attenter à la douceur est un crime sans nom que notre époque commet souvent au nom de ses divinités : l’efficacité, la rapidité, la rentabilité ». « La philosophe et psychanalyste n’hésite pas à affirmer que le déni du besoin de douceur se manifeste à travers nos dépressions. « Le manque de douceur est endémique. Il a créé un isolement aussi puissant qu’un charme ». « L’angoisse vient dans le corps quand il est déserté par la douceur »… Il y a donc dans la douceur une puissance de vie : « La douceur est une force de transformation secrète prodiguant la vie, reliée à ce que les anciens appelaient justement puissance ».
Stimuler l’entraide et l’altruisme (p 192-194)
La culture de la compétition fait obstacle à la culture du care. Mais, en regard, il apparait aujourd’hui que l’entraide est un processus naturel puissamment répandu dans la nature. Ainsi, à partir de nombreuses recherches, dans un livre innovant, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle (5) ont montré que les êtres vivants ont une puissante tendance à s’associer. « L’entraide est non seulement un principe du vivant, mais un mécanisme de son évolution » : « Les organismes qui s’entraident sont ceux qui survivent le mieux ». Les êtres humains n’échappent pas à cette réalité. Ainsi, dans certaines catastrophes, on a pu observer des comportements d’entraide. En plus de l’entrainement à l’entraide au « cœur de l’engagement et de l’action, nous pouvons choisir dans les collectifs, des pratiques transformant ces gestes en réflexion ».
Cette propension à l’entraide peut être envisagée dans la perspective de « reliance » qui est la trame de ce livre. « Quand nous nous appuyons délibérément sur notre connexion à la toile du vivant, nous pouvons de plus en plus prendre soin de nous en prenant soin du monde et prendre soin du monde en prenant soin de nous. Nous cultivons alors des habiletés au service de la vie qui rejaillissent aussi positivement sur nous, même si c’est plus tard et de façon indirecte. Cette loi de la réciprocité au cœur de l’entraide, avec son mouvement cyclique, donner – recevoir – rendre, participe à un équilibre vivant : nous sommes nourris en retour par cette façon d’être au monde. Il devient ainsi possible de co-créer et déployer notre créativité en composant avec les inévitables temps où nos fragilités affleurent ».
Accroitre notre résilience. Promouvoir la santé (p 195-200)
« Le mot « résilience » issu de la physique, de la psychologie et de l’écologie, évoque la capacité à affronter, supporter et traverser des chocs, des crises et des tensions extérieures en gardant son intégrité ». La transition intérieure étudiée dans ce livre implique la résilience.
Développer la résilience, c’est chercher à entretenir un équilibre dynamique, c’est aussi changer notre regard sur la santé.
Nous pouvons considérer une alternance entre des périodes où nous engageons toutes nos forces dans le soin et d’autres où nous prenons soin de nous-même. « L’articulation entre le chemin personnel, l’engagement pour le collectif, et le choix du mode de vie sera d’autant plus fluide qu’elle sera associée à des temps d’intégration et de respiration ». « Selon les moments et les contextes, nous sommes amenés à consacrer plus ou moins de temps et d’attention à l’une ou l’autre voie de restauration des quatre liens à soi, aux autres, au vivant, et au plus grand que soi. L’interconnexion profonde entre ces dimensions fera que chaque porte d’entrée vers un des liens pourra se mettre au service de la guérison des autres. Par ces aspirations, la transition intérieure permet d’évoluer en soutenant la vie en soi et autour de soi, d’une manière qui soit adaptée à chaque contexte et à chaque instant ».
Nous voici également appelés à changer notre regard sur la santé. « Dans la mesure où elle nous invite à prendre soin de la santé conjointe de la psyché humaine et de l’âme de la Terre, la transition intérieure implique un changement de regard sur la santé ».
Au total, nous sommes invités à envisager une approche globale, une approche holistique. « Pour l’Organisation mondiale de la santé, (OMS), la santé est un concept très large, dépendant de nombreuses variables. Plus qu’à l’absence de maladie, elle renvoie à la recherche d’un bien-être à la fois physique, psychique et social – nous ajoutons : écologique. Privilégier une vision holistique permet de s’attacher au lien entre des symptômes : d’aller aux racines, de laisser une place à la psyché, aux systèmes familiaux et sociaux, aux écosystèmes plus ou moins dégradés dont dépend le patient, aux liens corps-âme-esprit. Une approche globale et préventive de la santé ouvre aussi la possibilité de recréer – au besoin avec le soutien de collectifs et de thérapeutes – les conditions d’une bonne hygiène de vie : alimentation saine et respectueuse, exercice physique ou encore qualité de sommeil préservée ».
C’est évidemment « une approche nouvelle en regard d’une médecine classique qui évolue encore souvent dans des champs très étroits ». « La pandémie a mis en évidence les limites d’une approche de santé publique centrée avant tout sur des dimensions techno-industrielles. Non seulement la politique de « tout au vaccin » n’était pas complétée par des invitations à renforcer nos systèmes immunitaires, mais en plus elle rejetait des formes de soins alternatifs ».
Notre époque troublée compromet la santé psychique. « Dans les temps qui viennent, il sera de plus en plus indispensable de prendre soin de notre santé psychique sans recourir à des camisoles chimiques. Un enjeu, durant cette transition, est d’apprendre à composer avec deux tendances qui alimentent des cercles vicieux de mal-être : la pathologisation et la stigmatisation. Quand le mouvement d’alternance propre à la vie n’est pas reconnu parce qu’il ne serait pas dans la norme, ses manifestations spontanées sont volontiers pathologisées ».
N’enfermons pas les gens dans des catégories. Ainsi Anne Dufourmantelle, en parlant des personnes dites « bipolaires », « dénonce à la fois leur stigmatisation par le corps social et le traitement inhospitalier de leur « folie ordinaire » et de leur souffrance morale par la psychiatrie contemporaine… ». La psychanalyste rejoint d’autres praticiens qui s’engagent en faveur d’une éthique médicale et thérapeutique. L’anthropologie clinique met en évidence que « les formes pathologiques sont tributaires des formes symboliques à l’œuvre dans une culture ». De même, si on perçoit aujourd’hui la diversité des fonctionnements neurologiques, « heureusement de plus en plus d’écoles alternatives s’ouvrent aujourd’hui à la notion d’intelligences multiples et proposent des approches éducatives mieux adaptées à ces diversités ».
Cette vision d’une culture du soin débouche sur une réflexion sur les modes d’accompagnement dans les cheminements de la transition intérieure. Comme nous avons pu le constater, cette vision est inspirée par des apports récents de psychologues, de philosophes, de sociologues que nous avons déjà souvent croisés sur ce blog. Ce texte vient donc à nouveau rendre compte d’un mouvement de pensée et d’action qui se manifeste aujourd’hui de plus en plus et qui appelle notre compréhension et notre soutien
J H
- Michel Maxime Egger. Tylie Grosjean. Elie Wattelet. Reliance. Manuel de transition intérieure. Actes Sud Colibris. 2023 (Domaines du possible)
- Tout se tient. Relions-nous ; https://vivreetesperer.com/tout-se-tient/ La vie spirituelle comme une conscience relationnelle. La recherche de David Hay : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/ Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient :
- https://vivreetesperer.com/?s=dieu+vivant+dieu+pr%C3%A9sent
- La grande connexion : https://vivreetesperer.com/la-grande-connexion/
- Une voix différente. Pour une société du care : https://vivreetesperer.com/une-voix-differente/
- De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin . Le soin est un humanisme https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/
- Face à la violence, l’entraide, puissance de vie dans la nature et dans l’humanité : https://vivreetesperer.com/face-a-la-violence-lentraide-puissance-de-vie-dans-la-nature-et-dans-lhumanite/
Voir aussi :
Des Lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/?s=corine+peluchon
Réenchanter notre relation au vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/
par jean | Sep 9, 2023 | Emergence écologique |
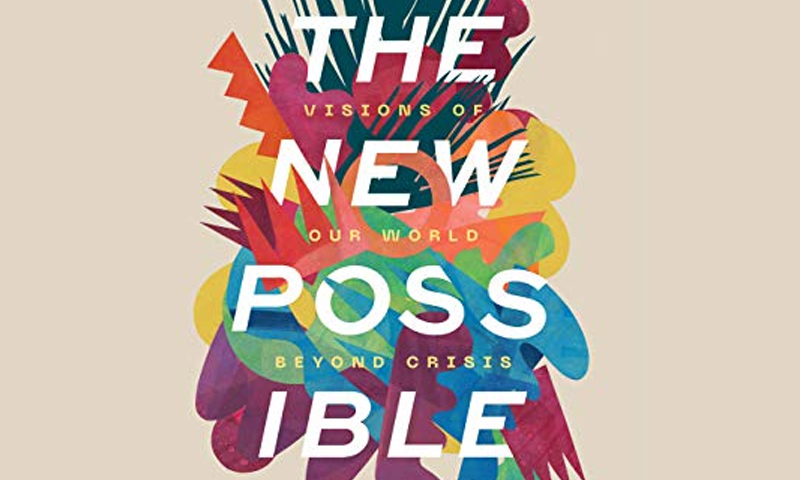
Selon Jeremy Lent
En 2020, l’effroi suscité par l’épidémie de Covid s’est allié aux appréhensions engendrées par d’autres menaces comme le dérèglement climatique. Aujourd’hui, une guerre vient s’ajouter au malheur du temps. Cependant, cette tourmente interpelle. Elle invite les chercheurs et les militants à imaginer et à promouvoir un monde nouveau.
C’est ainsi qu’en 2021, un recueil d’essais est paru aux États-Unis sous le titre : « The new possible » (« Le nouveau possible ») (1). Le sous-titre en précise le contenu : « Visions de notre monde au-delà de la crise ».
Cet ouvrage a été conçu dans le contexte américain, mais il est intéressant de constater qu’il ne se borne pas à mettre en cause de graves dysfonctionnements aux États-Unis, mais envisage les problèmes de beaucoup d’autres pays. Bien plus, le champ du livre s’étend au monde entier. Ainsi, plusieurs personnalités des peuples premiers sont appelées à s’exprimer. Ici convergent une réflexion sociologique et économique, des gestes militants et le recours à différentes traditions de sagesse. Le livre s’ordonne en plusieurs parties : la terre ; Nous ; le changement ; la richesse ; le travail ; la nourriture ; l’éducation ; l’amour ; la communauté, et il rassemble les contributions d’une trentaine d’auteurs.
Nous avons choisi de rapporter un des chapitres de ce livre : « Envisager une civilisation écologique » (« Envisioning an ecological civilization ». L’auteur, Jeremy Lent, a écrit plusieurs ouvrages de synthèse sur l’évolution de la culture humaine et la recherche de sens : « The patterning instinct. A cultural history of humanity. Search of meaning » et « The web of meaning. Integrating science and traditional wisdom to find our place in the universe ». Comment l’humanité a-t-elle évolué dans sa recherche de sens ? Quelle vision émerge aujourd’hui ?
Quitter le néolibéralisme
Jérémie Lent dresse un bilan des dégâts et des injustices engendrés par le néolibéralisme. Ainsi, aux États-Unis, les communautés pauvres ont été davantage atteintes mortellement par la pandémie que les communautés aisées. Il y a bien une origine au mal actuel. Depuis les années 1980, le néolibéralisme propage une conception dangereuse de l’homme selon laquelle « les hommes sont essentiellement individualistes, égoïstes, matérialistes et calculateurs. En conséquence, le capitalisme de marché serait le meilleur cadre pour les entreprises humaines » (p 4). « Le néolibéralisme est logiquement le résultat d’une conception de monde fondée sur la séparation : les gens sont séparés les uns des autres, les humains sont séparés de la nature, et la nature elle-même n’est plus qu’une ressource économique » (p 4).
Menace d’effondrement
Dans la recherche d’un progrès matériel, nous consommons les richesses de la nature plus vite qu’elle ne se reconstituent.
Notre civilisation fonctionne en « consommant 40% des ressources de la terre au-dessus du rythme soutenable » (p 4).
Transformer nos valeurs
Avec Jeremy Lent, faisons d’abord le point : « La description des êtres humains comme des individus égoïstes, la perception de la nature comme une ressource à exploiter, et l’idée que seule la technologie peut répondre à nos plus gros problèmes, voilà de profondes erreurs qui ont conduit notre civilisation vers un désastre »(p 5).
« Nous avons besoin de changer le fondement de notre civilisation : passer d’une civilisation fondée sur l’accumulation des richesses à une autre fondée sur la santé des systèmes vivants, une civilisation écologique » (p 6). Ce sera là une mutation majeure comparable aux deux grands bonds de l’humanité : la mutation agricole qui a commencé il y a 12 000 ans et la révolution scientifique du XVIIe siècle.
Une civilisation écologique
Jérémie Lent met en valeur la vertu de l’entraide. « Les systèmes vivants sont caractérisés à la fois par la compétition et la coopération.
Cependant, les transitions majeures de l’évolution qui ont amené la vie à son état actuel d’abondance, sont toutes le résultat d’un accroissement spectaculaire de la coopération. La clé de ces pas d’évolution – et du fonctionnement efficient de tous les écosystèmes – est la symbiose : le processus dans lequel les deux parties en relation donnent et reçoivent réciproquement… » (p 6). « Les contributions de chaque partie créent un ensemble plus grand que la somme des parties ». La symbiose permet aux écosystèmes de s’entretenir presque infiniment ». « L’interconnection de différents organismes en symbiose se manifeste dans un autre principe fondateur de la nature : l’harmonie ». « L’harmonie apparaît quand les différentes forces d’un système sont en équilibre » (p 6-7). Un tableau apparaît. « Chaque système dépend de la vitalité des autres ».
Cette constatation « nous amène à formuler un objectif ultime de la civilisation écologique : créer les conditions pour que tous les humains puissent fleurir comme une part d’une terre vivante et prospère. Jeremy Lent transpose le phénomène de la symbiose en termes humains : « les principes fondateurs de la justice et de l’équité ». Une civilisation écologique assurera « la promotion de la dignité humaine en fournissant les conditions pour permettre à chacun de vivre en sécurité et en bien-être ». Par ailleurs, la civilisation écologique reconnaitra la diversité dans tous ses registres. « Elle sera fondée sur l’axiome que le plein potentiel d’un système peut être réalisé seulement quand il est intégré – un état d’unité dans la différenciation où la prospérité de chaque constituant contribue au bien-être de l’ensemble » (p 7). Par-dessus tout, une civilisation écologique suscitera une symbiose englobant la société humaine et le monde naturel ».
La civilisation écologique en pratique
Entrer dans une civilisation écologique requiert une transformation fondamentale de l’économie. Entre autres, on passera d’une économie fondée sur la croissance perpétuelle du Produit National Brut à une société mettant l’accent sur la qualité de la vie en développant les indicateurs correspondants. Depuis le début du XIXe siècle, la plupart des économistes ont considéré deux domaines seulement de l’activité économique : les marchés et le gouvernement… Une civilisation écologique prendra en compte ces deux domaines, mais ajoutera deux secteurs : l’économie domestique et les communs. « En particulier, les communs deviendront une part centrale de l’activité économique (3) ». Jeremy Lent rapporte l’origine du terme : la terre partagée par les paysans en Angleterre. Mais dans un contexte plus large, « les communs comprennent toutes les sources de subsistances et de bien-être qui échappent à l’appropriation de la propriété privée et de l’état : l’air , l’eau, la lumière du soleil, et même les créations humaines comme le langage, les traditions culturelles et la connaissance scientifique » (p 8). C’est une richesse commune (« a shared human commonwealth » (p 9). On reconnaitra le droit de chaque être humain à participer à cette richesse commune. Jeremy Lent évoque ici « un revenu de base universel ». Les recherches en ce sens ont montré les aspects positifs d’une telle innovation. Dans cette transformation, quelle attitude vis-à-vis des grandes entreprises internationales ? Elles devront se soumettre à une charte écologique et sociale. La même approche écologique entrainera la transformation de l’agriculture et du tissu urbain. Jeremy Lent envisage également une transformation de la gouvernance vers « un modèle polycentrique où les décisions locales, régionales et globales seront prises aux niveaux où leurs effets se font le plus sentir » (p 10).
En marche
Si cette vision porte un idéal à atteindre, Jérémy Lent nous présente « les innombrables organisations pionnières à travers le monde qui plantent déjà les semences pour une civilisation affirmant la vie » (p 10). L’auteur cite des initiatives aux États-Unis, en Bolivie, en Espagne. Il montre « comment la vision écologique se répand à travers les institutions religieuses et culturelles établissant un terrain commun avec le traditions indigènes qui maintiennent leur connaissance et leur genre de vie pendant des millénaires ». Il évoque la « charte de la terre » initiée à La Haye en 2000 et adoptée depuis par plus de 2 000 organisations à travers le monde auxquelles se sont joints certains gouvernements. Et bien sûr, il cite l’encyclique ‘Laudato si’.
Sur le plan économique et politique, des organisations apparaissent telles que la « Wellbeing Economy Alliance » et la « Global Commons Alliance ». « Peut-être encore plus important, un mouvement populaire affirmant la vie se répand globalement ». (p 11)
Le livre : « The new possible » fait lui-même écho à la transformation en cours.
Ce texte de Jeremy Lent nous apporte une vue d’ensemble sur la mutation en cours. Il en esquisse le sens. De son point d’observation, il vient confirmer l’extension d’un mouvement écologique à travers le monde entier. Ce point de vue vient donc nous encourager et nous affermir.
J H
- Philip Clayton, Kellie M Archie, Jonah Sachs, Evan Steiner, ed. The new possible. Visions of our world beyond crisis. Wipf and Stock Publishers, 2021
- Voir le blog de Jeremy Lent, author and integrator : https://www.jeremylent.com/
- La promotion des communs apparaît récemment au cœur du livre de Gaël Giraud : Gaël Giraud. Composer le monde en commun, Seuil, 2022
par jean | Août 7, 2023 | ARTICLES, Emergence écologique |
Ecothéologie et pentecôtisme
 Dans la prise de conscience écologique, une nouvelle vision théologique est apparue au point de porter un nom : écothéologie. Michel Maxime Egger nous en a montré les différents visages (1). Nous savons aussi comment le théologien Jürgen Moltmann a sous-titré son livre : « Dieu dans la création » paru dès 1988 : « Traité écologique de la création » et poursuivi ensuite constamment son œuvre en ce domaine (2). En 2015, le pape François publie dans ce domaine une encyclique retentissante : « Laudato si’ » (3). Dans la dernière décennie, ce mouvement est également apparu dans le champs pentecôtiste, du moins chez certains théologiens anglophones. Sachant l’expansion actuelle du pentecôtisme dans le monde, ce fait est important d’autant que certaines manifestations politiques du pentecôtisme dans certains pays ont pu être contestées. A J Swoboda est pasteur et professeur de théologie, notamment à la faculté Fuller (4). Il se déclare un environnementaliste pentecôtiste : « Le soin porté à la création est un aspect intégral de l’œuvre relationnelle du Saint Esprit dans le monde » (5). A J Swoboda a écrit sur cette questions plusieurs livres qui font référence : « Tongues and trees. Towards a Pentcostal Ecological Theology » (6) ; « Introducing Evangelical Ecotheology. Foundations in Scripture, Theology, History and Praxis ». Aussi a-t-il édité un recueil d’écrits théologiques : « Blood cries out. Pentecostals, Ecology and the Groans of Creation » (Pentecostals, Peacemaking and Social Justice) (7).
Dans la prise de conscience écologique, une nouvelle vision théologique est apparue au point de porter un nom : écothéologie. Michel Maxime Egger nous en a montré les différents visages (1). Nous savons aussi comment le théologien Jürgen Moltmann a sous-titré son livre : « Dieu dans la création » paru dès 1988 : « Traité écologique de la création » et poursuivi ensuite constamment son œuvre en ce domaine (2). En 2015, le pape François publie dans ce domaine une encyclique retentissante : « Laudato si’ » (3). Dans la dernière décennie, ce mouvement est également apparu dans le champs pentecôtiste, du moins chez certains théologiens anglophones. Sachant l’expansion actuelle du pentecôtisme dans le monde, ce fait est important d’autant que certaines manifestations politiques du pentecôtisme dans certains pays ont pu être contestées. A J Swoboda est pasteur et professeur de théologie, notamment à la faculté Fuller (4). Il se déclare un environnementaliste pentecôtiste : « Le soin porté à la création est un aspect intégral de l’œuvre relationnelle du Saint Esprit dans le monde » (5). A J Swoboda a écrit sur cette questions plusieurs livres qui font référence : « Tongues and trees. Towards a Pentcostal Ecological Theology » (6) ; « Introducing Evangelical Ecotheology. Foundations in Scripture, Theology, History and Praxis ». Aussi a-t-il édité un recueil d’écrits théologiques : « Blood cries out. Pentecostals, Ecology and the Groans of Creation » (Pentecostals, Peacemaking and Social Justice) (7).
Le ‘Jour de la Terre’
L’instauration d’un ‘Jour de la Terre’ aux Etats-Unis en 1970, initiative suivie internationalement, témoigne d’une éclosion de la prise de conscience écologique. C’était un jour de méditation et d’action pour restaurer la relation humaine avec la terre. Le fondateur et le visionnaire du ‘jour de la Terre’ fut John McConnell Jr. Dans son livre : « Blood cries out », (7) A J Swoboda nous décrit cette personnalité dans son parcours spirituel, nous signifiant par là que la préoccupation écologique a pu être présente en quelqu’un fortement marquée par une inscription familiale pentecôtiste. Les parents de McConnell ont été membres fondateurs de la charte des assemblées de Dieu en 1914. Son propre grand-père fut même un participant au grand réveil de la Rue Azuza à Los Angeles en 1906. Ainsi le ‘Jour de la Terre’ a commencé avec de fortes convictions religieuses. McConnell ,voyant la crise écologique à travers sa culture religieuse, « envisageait un jour où les chrétiens pourraient montrer la puissance de la prière, la valeur de leur charité et leur préoccupation pratique pour la vie et les gens de la terre ». Ce rappel historique est une entrée en matière qui légitime une approche théologique pentecôtiste de l’écologie.
Univers écologique et univers pentecôtiste : tout est relation
Brandon Rhodes était étudiant à l’université d’Oregon (Etats-Unis) et il y fréquentait deux univers : l’écologie et le pentecôtisme (6). Dans la communauté pentecôtiste, il se voit proclamer l’importance de la relation : « Le Royaume de Dieu porte entièrement sur les relations ». A travers leur vie ensemble, les étudiants pentecôtistes « apprenaient à voir et à nommer l’œuvre de l’Esprit dans leur vie et dans leurs relations quotidiennes ». Cependant, dans ses études en écologie, Brandon Rhodes s’éveillait à « l’interconnexion de toutes choses, comme les champignons qui s’emploient à constituer un réseau relai entre les arbres de la forêt. Quand un feu, une sécheresse ou une tronçonneuse frappe un arbre, la forêt entière en frisonne de conscience. En écologie, la relation, c’est tout. Cette prise de conscience a profondément influencé la manière dont je voyais la terre ». « La Création brille de vie, de relation et déborde d’un saint mystère ». « Avec le temps, cette résonance entre l’écologie et le pentecôtisme me devint tout-à-fait évidente. Le Royaume de Dieu porte entièrement sur la relation et il en va de même pour l’écologie. Le royaume de Dieu dans l’Esprit est écologique et vice versa. Je le ressentais d’une manière palpable dans cet environnement verdoyant des montagnes de l’Oregon ».
A la recherche d’une rencontre entre la réflexion théologique et l’expérience
Brandon Rhodes constata pourtant que le pastorat pentecôtiste percevait rarement la connexion entre les deux approches, et plus généralement la valeur de l’écologie. Ce fut donc avec joie qu’il accueillit la parution du livre de A J Swoboda, un ouvrage qui établissait un pont par dessus la division entre écologie et pentecôtisme. Et, encore mieux, il rencontra l’auteur habitant dans le même voisinage. Le livre de Swoboda : « Tongues and trees : toward a pentecostal ecological theology » formule sa thèse de doctorat pour un public plus large. Cependant, Brandon Rhodes s’interroge sur le format académique qui peut donner l’impression que le message descend d’en haut vers des réalités sociales qui montent d’en bas. « Le défi majeur pour Swoboda est de transmettre des idées académiques de haut en bas vers une tribu à la base, celle de l’église pentecôtiste. A J Swoboda trace bien quelques pistes comme « imposer les mains à la terre pour sa guérison, ou bien prêcher des eschatologies créationnelles ». Mais Brandon Rhodes reste en partie sur sa faim.
« Un épilogue plus développé en terme de pratiques pentecôtistes, expériences écologiques, incursions liturgiques, comportements mystiques à l’intention de l’église locale aurait idéalement arrondi ce travail ».
Un témoignage et un parcours de recherche
Brandon Rhodes partage avec nous sa vision de foi. « Le pentecôtisme, ce n’est pas seulement une manière de prêcher, chanter, se rassembler et prier. C’est fondamentalement développer des cœurs ouverts à l’activité de l’Esprit. C’est une imagination active se demandant où Jésus peut être à l’œuvre à travers l’Esprit ».
« Cependant ce comportement pentecôtiste tourné vers l’Esprit refuse d’être commodément institutionnalisé, planifié, préemballé pour une consommation ecclésiale ».
« Swoboda semble appeler l’écothéologie à nourrir notre capacité de voir la création comme une arène où se montre la vie de Dieu. Si je le lis fidèlement en pentecôtiste, il désire nous amener à devenir des magiciens verts plutôt que des écothéologiens – des guides mystiques à même de nous faire voir la magie dont ce monde est abreuvé par le Saint Esprit. L’Esprit holistique, baptisant la création, vers où « Tongues and Trees » dirige le pentecôtisme, est vivant et actif dans le monde ». Brandon Rhodes nous appelle « à avoir des yeux pour le voir et à répondre dans la repentance ».
Aperçus
Suite à son analyse, Brandon Rhodes présente un résumé détaillé du livre : « Tongues and Trees ». En voici quelques extraits.
Swoboda présente les apports des différentes dénominations à l’écothéologie. En ce qui concerne le pentecôtisme, il perçoit certaines dispositions favorables. « D’abord, le pentecôtisme met l’accent sur ce que Miroslav Wolf appelle : « la matérialité du salut » ce qui historiquement s’est prêté à une attention pour des questions de justice sociale – une disposition qui s’ouvre tout naturellement à honorer le monde matériel et, dans de nombreux cas, là où la dégradation écologique accroit les injustices existantes. Deuxièmement, l’accent pentecôtiste sur l’Esprit se prête au témoignage biblique de l’Esprit de Dieu vivifiant et même baptisant toute la création. Ainsi nous devons attendre les charismes non seulement de l’église charismatique, mais du reste du royaume de la création.
Swoboda résume son bilan des écothéologies charismatiques en deux points majeurs : « D’abord si l’Esprit de Dieu crée et vit dans la création et le peuple de Dieu, les deux sont en voie de restauration à la relationalité. La relationalité est la force même de la théologie et de la pratique pentecôtiste. Ultimement, c’est la force des théologies Esprit/création. L’accent pentecôtiste sur une église interconnectée – par – l’Esprit, nous enjoint de joindre la ‘conversation’. J’ai trouvé dans mon enseignement de l’écologie l’interconnexion de la terre elle-même. Deuxièmement, Swoboda conclut de cette recherche que notre tâche future est de nourrir une imagination pneumatologique concernant le « care » écologique.
Le développement de l’approche écologique transforme notre vision du monde. Elle nous incite à considérer qu’il y plus grand que nous et que nous nous inscrivons dans un tissu de relations. Cette vision nous invite à entrer dans une vision spirituelle où la Pentecôte apparaît comme une figure privilégiée. On comprend qu’un théologien pentecôtiste assume l’approche écologique en espérant que cette attitude se répande dans sa dénomination comme elle s’étend dans d’autres églises.
Rapporté par J H
- Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
- Dieu dans la création : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
- Convergences écologiques :Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François et Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
- A J Swoboda Ph D : https://www.bushnell.edu/faculty/a-j-swoboda/
- A J Swoboda : I am a pentecostal environmentalist : https://faithandleadership.com/aj-swoboda-im-pentecostal-environmentalist
- Book Review, Tongues and trees. Toward a pentecostal ecological theology : https://christandcascadia.com/2014/08/01/book-review-tongues-and-trees-toward-a-pentecostal-ecological-theology/
- A J Swoboda. Blood cries out : https://www.amazon.com/Blood-Cries-Out-Pentecostals-Peacemaking/dp/1625644620