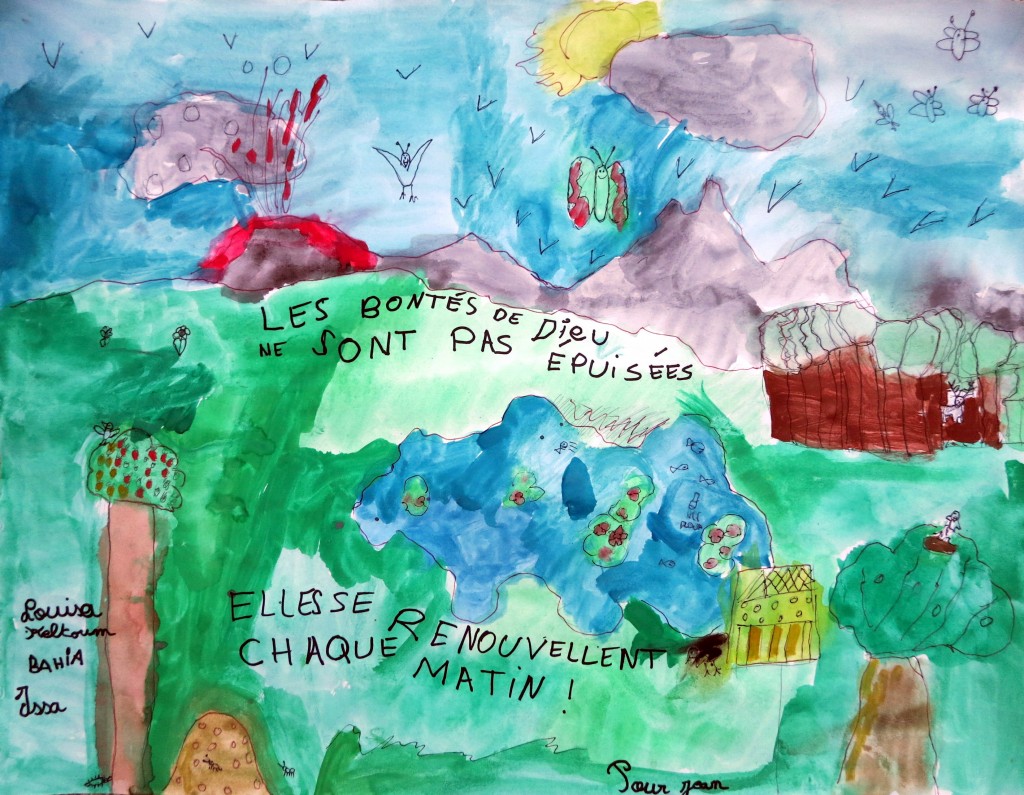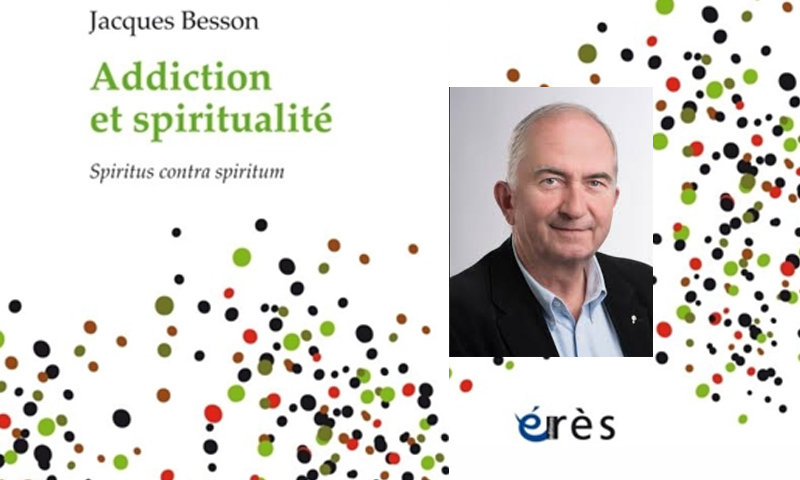
Spiritualité et psychiatrie
La vision spirituelle du médecin psychiatre, Jacques Besson dans la découverte de nouveaux horizons : les neurosciences, les synchronicités, la lutte contre les addictions, l’usage des psychédéliques, le chamanisme…
Auteur d’un livre sur : Addiction et spiritualité (1), Jacques Besson, médecin psychiatre, addictologue, ancien chef du département de psychiatrie communautaire du département de psychiatrie du centre hospitalier universitaire vaudois, professeur honoraire de l’Université de Lausanne, a été fréquemment interviewé dans des vidéos sur You tube (2). Il y met en évidence des relations sensibles entre spiritualité, présence d’une conscience, lutte contre les addictions, usage des psychédéliques, expérience de mort imminente, expérience du chamanisme. En même temps, Jacques Besson se présente comme un croyant enraciné dans une foi chrétienne d’inspiration protestante. En écoutant Jacques Besson, nous découvrons des réalités qui se manifestent aujourd’hui et sur la signification desquelles nous nous interrogeons. A partir de son expérience et des connaissances, il nous apporte un éclairage précieux. Voici donc quelques aperçus à partir d’une interview de jacques Besson par Didier Reinach : « Spiritualité et créativité de soi – l’esprit du bonheur » (3).
Cheminement professionnel et spirituel de Jacques Besson
Au départ, l’intervieweur rappelle les intérêts de Jacques Besson : « la psychiatrie communautaire, la santé mentale, les rapports entre la psychiatrie, la religion, la spiritualité et les neurosciences ». Il pose donc une première question : « Pourquoi la spiritualité est-elle un chemin de guérison ? » Et il l’interroge sur ses motivations : « Qu’est-ce qui te pousse, qu’est-ce qui te porte à introduire la dimension spirituelle ? ». La réponse porte d’abord sur les racines : « Je viens d’une longue tradition protestante. Comme enfant, j’ai eu des visions, des intuitions, des aspirations sur l’invisible, sur la lumière du monde. Cela m’a toujours intrigué et passionné. Depuis l’âge de cinq ans environ, je m’intéresse à l’individu, à la question de l’esprit ». Jacques Besson s’est donc dirigé vers la médecine ; puis, il s’est intéressé à la neurologie. Il est passé ensuite à la psychiatrie, puis à la psychanalyse. Et de la psychanalyse, il s’est dévoué pour des populations vulnérables, pour la médecine des pauvres au Centre Saint-Martin qui a accueilli des milliers toxicomanes. C’était une médecine communautaire, généreuse. De là, Jacques Besson est devenu un expert en addictologie, une science interdisciplinaire qui rassemble un ensemble de savoirs pour faire face à la complexité du problème de l’addiction. Il s’est engagé dans des psychothérapies et c’est là qu’il s’est rendu compte petit à petit que « la question du sens était centrale ». Jacques Besson a également été médecin dans l’Armée du Salut. Il a vu là un témoignage magnifique et il y a beaucoup appris. C’est là qu’il a rencontré « les alcooliques anonymes », un mouvement spirituel et non religieux qui a commencé dans les années 1930, où les participants se remettent à une puissance supérieure, à plus grand qu’eux-mêmes, pour leur rétablissement. Les « alcooliques anonymes » ont actuellement plusieurs dizaines de millions d’adeptes en traitement qui vont bien. Jacques Besson, bien au fait de la biologie moléculaire, a considéré les bienfaits engendrés par l’approche des alcooliques anonymes : les différentes étapes, le lâcher-prise et la conscience dans l’univers. Il s’est alors demandé : est-ce qu’il y aurait une neuroscience des alcooliques anonymes ? La réponse est oui. Il y a eu beaucoup de recherches en imagerie sur l’impact de la prière, de la méditation. Dans les années 1990, au cours d’une année sabbatique à Harvard, il a pu suivre les débuts de l’imagerie fonctionnelle cérébrale et il a découvert la puissance de l’instrument. « Entre addiction et spiritualité, il y a un rapport très étroit. D’un côté, l’addiction est une impasse de sens. De l’autre côté, la spiritualité est une ouverture à plus grand que soi. Donc la spiritualité est un instrument puissant pour la prévention et le rétablissement des addictions ». Après avoir fait une thèse sur la correspondance échangée entre Freud et le pasteur Pfister où les fondements du dialogue entre psychanalyse et religion étaient posés, Jacques Besson s’est engagé dans une étude de la pensée de Carl Jung et, pendant une dizaine d’années, il s’est formé à la psychanalyse jungienne en autodidacte, puisque celle-ci n’est pas agréée dans l’enseignement officiel. Il y a trouvé les ingrédients dont il avait besoin pour établir un lien entre science et spiritualité. « Il peut y avoir une science de l’esprit qui est plus grande que celle du cerveau ou de la psychologie, et la question de l’inconscient collectif, la question du Dieu inconscient, la question de ce qui nous transcende et de ce qui nous traverse sont des questions qui ont habité les humains depuis toujours et Jung a été un investigateur de génie sur ces questions ». Par la suite, Jacques Besson s’est tourné vers l’œuvre du sociologue médical, rescapé d’Auschwitz, Aaron Antoniovsy. Il a observé la vie dans les camps et « il en a tiré la conclusion que les humains avaient besoin de sens et de cohérence, de cohérence permettant d’aligner le somatique, le psychique et le spirituel, et d’être droit dans ses bottes, d’avoir un sens dans la vie. Voilà ce qui est générateur de ce qu’il a appelé lui-même la salutogenèse. La salutogenèse, à travers ses origines latines entend le salut à la fois comme santé et comme salut. La salutogenèse est le concept génial qui créé la promotion de la santé. Les médecins obsédés par les causes des maladies s’intéressent beaucoup moins aux attracteurs de santé et je me suis passionné pour le ‘solutionnisme’, c’est à dire conjuguer toutes les approches disponibles dans un champ comme les addictions où la médecine était très pauvre et pouvoir venir ainsi à l’aide de populations vulnérables ».
Mais, si l’on peut distinguer des groupes vulnérables, « nous sommes tous aujourd’hui vulnérables d’une certaine manière… Nous avons tous des carences, nous avons tous des maltraitances… la condition humaine fait que la vie est imparfaite et que nous sommes sur un chemin entre l’inaccompli et l’accompli. C’est une voie mystique qui ne me fait pas peur parce qu’elle est compatible avec la vision scientifique d’un monde évolutionnaire ».
Aujourd’hui, « l’humanité est traumatisée et elle n’accède pas, pas encore, aux instruments de guérison, cet alignement entre le physique, le psychique et le spirituel, entre la science de la nature, la science humaine et, peut-être la science de l’esprit. Donc, j’ai toujours cherché cette cohérence, cet alignement… Je n’ai jamais quitté cette ligne et je suis ‘le capitaine de mon âme’ » (cette expression en écho à celle du poème récité en priant, par Nelson Mandela dans sa prison).
L’être humain et la spiritualité
L’entretien se poursuit au sujet de la nature humaine. Nous ressentons aujourd’hui les effets nocifs du matérialisme. « Ce matérialisme, dans lequel nous sommes désespérément plongés, nous coupe de ce que les peuples premiers savaient très bien… C’est que le monde est un. Nous sommes dans une totalité ». En demandant à ses étudiants en médecine : où est l’esprit, Jacques Besson les amenait à penser qu’il n’était pas seulement dans le cerveau, dans le corps, mais que, pour vivre, l’être humain avait besoin d’un langage, de relations, d’une culture ; « il faut une humanité, il faut une planète, il faut un univers. Pour un seul être humain, il faut la totalité de l’univers et le grand mystère, c’est que chaque être humain représente une singularité ». Mais cette singularité se vit en complémentarité, dans un ensemble. « Plus on va vers soi-même, disent les sages du premier millénaire chrétien, plus on s’approche de Dieu, mais il s’agit de soi-même, au sens de Jung, c’est à dire d’une individuation. Il s’agit de bien comprendre le rapport entre le soi et la totalité ».
C’est un apport de la psychanalyse jungienne qui, elle-même, peut être envisagée comme une étape pour aller plus haut. A partir d’un épisode vécu et rapporté par Jung, du ‘rêve d’un scarabée par un patient et l’apparition de cet insecte à la fenêtre’, la conversation s’engage sur le phénomène des synchronicités. Jacques Besson a vécu de nombreuses synchronicités dans sa carrière et « il est convaincu que ce phénomène introduit une fenêtre sur un rapport différent au temps, au temps qui nous dépasse, au temps vertical, le grand temps, celui qui s’est déployé avec le big bang… ». L’accueil des synchronicité requiert « une grande ouverture au monde, à l’univers, à la conscience, qui est bien plus grande que ce qu’on peut imaginer, et pour les scientifiques, beaucoup d’humilité », vertu trop peu répandue… « Il faut être bien conscient des limites de la science pour accéder à un monde plus grand… La foi et la science ne s’oppose pas. On peut être scientifique et mystique. La science s’occupe des ‘comments’. Elle propose des modèles. La métaphysique propose des intuitions, des visions ».
La conversation se poursuit sur les ressources du cerveau humain. « Le cerveau a de nombreuses fonctions… Le cerveau est un univers à lui tout seul. C’est un microcosme. L’univers du cerveau est un univers infiniment complexe ». Ainsi, s’il y a un infiniment petit et un infiniment grand, « comme l’a intuitivement prédit, le génial Blaise Pascal, l’homme est le milieu de toutes choses et l’être humain est entre les deux infinis, le petit et le grand, et je suis arrivé à la conclusion qu’il détient le troisième infini qui est l’infiniment complexe… La science se préoccupe d’objectiver. La ligne de la science, c’est bien l’objectivité, mais nous autres, êtres humains, nous vivons aussi d’une subjectivité et la science du sujet est extrêmement importante. C’est la science de la conscience précisément… La totalité implique d’avoir recours à la science et à la conscience, à la science et à la spiritualité ».
Spiritualité, soin, médecine
Une question de l’interviewer : Est-ce que la spiritualité peut soigner des égos blessés, des égos malades ? Jacques Besson répond en évoquant « une nouvelle science qui a fait d’énormes progrès depuis une quinzaine d’années : la psycho-traumatologie. La psycho-traumatologie est l’étude interdisciplinaire des traumatismes psychiques. Nous avons tous un certain capital de santé mentale et nous pouvons supporter ainsi un certain nombre de souffrances. Mais s’il y a effraction, un abus trop fort, une agression trop violente, la blessure psychique qui en résulte est un traumatisme. La question du traumatisme est très importante parce qu’elle participe au diagnostic d’une vulnérabilité particulière chez certaines personnes qui peut être investiguée et surtout peut être traitée.
Puis, une grande question se pose : pourquoi moi ? Pourquoi à moi, m’est-il arrivé tel accident, tel malheur ? Et le ‘pourquoi moi’, est un grand mystère. C’est une blessure parce que c’est incompréhensible. Le monde est imparfait. L’arrivée d’un accident nous dépasse et la spiritualité nous aide à redonner du sens, à recouvrir notre âme… C’est la technique chamanique. C’est l’extraction d’esprit et le recouvrement d’âme. Les chamans sont spécialistes du trauma à leur manière. L’extraction d’esprit, c’est se détourner de ce qui nous a blessé, peut-être l’extraire ou tout au moins s’en détacher. Le recouvrement d’âme, c’est aller vers plus grand que soi. Et voilà un mouvement salutogénique. Et voilà, les peuples premiers ont cette intuition qu’il y un rétablissement possible. La santé mentale est le fruit d’une plasticité. Et cela, c’est tout l’espoir que peut avoir un psychiatre, un psychiatre psychothérapeute en l’occurrence. Le cerveau est plastique. C’est à dire que les connexions s’adaptent à l’environnement, à la culture. Les neurones dialoguent entre eux et se connectent. Et cela laisse de la trace.
Donc, du coup, l’expérience spirituelle, cela laisse de la trace. Pour en donner un exemple, la méditation en pleine conscience, qui s’est occidentalisé récemment, se révèle modifier la connectivité cérébrale, ainsi que montre les nouvelles techniques d’imagerie. On devient plus autonome affectivement et cognitivement, plus souple. Ce sont des encouragements très forts pour relier la médecine psychiatrique, la médecine somatique et la psychothérapie. Depuis plusieurs années, j’ai eu la chance d’introduire la santé spirituelle à la faculté de médecine, notamment à la suite de la rencontre publique avec le Dalaï Lama en 2013.
Je lui ai posé la question des trois ordres de la médecine et il m’a répondu avec beaucoup de chaleur que c’était une question qu’il fallait absolument explorer en Occident, car, pour la médecine tibétaine, il est évident que le premier rang de la santé est la santé spirituelle. En découle la santé psychique dont découle la santé physique. Or, en Occident, nous faisons très exactement le contraire. Nous avons jeté les bases d’une santé somatique, nous avons élaboré correctement une psychiatrie qui tient la route, mais nous somme encore très loin de la singularité du sujet, de la question du lien, de la question du sens qui sont les vraies questions qui mobilisent la salutogenèse et le rétablissement ».
Une création de sens ? suggère l’interviewer. C’est inné ou cela se travaille ? demande-t-il. « Les deux à la fois » répond Jacques Besson. « Je crois qu’il y a du divin dans l’homme, pour citer les Pères de l’Église ». En reprenant une expression latine, « l’homme est capable de Dieu. C’est-à-dire, il a une intuition du beau, du bien, du vrai, du juste, et il peut suivre ce chemin. C’est un possible. Alors cela nécessite évidemment un travail. Le Bouddha a dit : « Le bonheur est sur le chemin ». Alors, cheminons.
Psychédéliques, chamanisme, médecine ouverte
Jacques Besson envisage son approche de la guérison sous différents angles. Ainsi, dans un cadre psychiatrique, il participe à « la réhabilitation des psychédéliques (champignons hallucinogènes, Lsd, certaines formes d’ecstasy) », à des fins thérapeutiques. Historiquement, ces substances ont été stigmatisées après le premier développement de leur usage aux Etats-Unis, mais on observe aujourd’hui un retour parce qu’on a compris que ce n’est pas le même groupe de drogues que les opiacés, la cocaïne ; un groupe différent qui a la capacité de perturber l’ordre psychique, mais à petites dose, bien contrôlées et dans un cadre thérapeutique, cela peut permettre de modifier un ordre établi dans le sens d’ouvrir certaines mémoires qui étaient dans des tiroirs. Lorsqu’un traumatisme désorganisateur infecte une existence, il vaut mieux le sortir, l’aérer. Et cela, c’est l’extraction d’esprit et le recouvrement d’âme opérés par les chamans, c’est ce que la psychanalyse essaie de faire laborieusement avec de longs processus, c’est ce que l’hypnose essaie de faire par des conditionnements, mais les psychédéliques sont aujourd’hui le moyen le plus prometteur pour accéder aux souvenirs traumatiques dans un contexte sécurisé et élargir la conscience… On pense que les psychédéliques ont le pouvoir d’accroitre la plasticité neuronale, et notamment les champignons, ce que les peuples premiers savaient très bien. Aujourd’hui les médicaments les plus prometteurs en psychiatrie sont ceux qui ont été les plus ostracisés et maudits quand j’étais jeune. Le cannabis ouvre des perspectives intéressantes en médecine curative et les psychédéliques ouvrent des pistes intéressantes pour la santé mentale ».
Jacques Besson critique les préjugés engendrés par un matérialisme réductionniste vis-à-vis des pratiques des peuples premiers. « J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui se sont intéressées scientifiquement au chamanisme. Ainsi le docteur Olivier Chambon en France qui a écrit un texte de référence : « Psychothérapie et chamanisme ». Il évoque la psychologie transpersonnelle, notamment Stéphane Gros. Ce sont des psychologues qui acceptent qu’on puisse communiquer d’inconscient à inconscient et communiquer avec plus grand que soi. Le chamanisme, c’est aussi une communication avec un monde plus grand. Le chamane et à la fois prêtre et médecin. Aujourd’hui, nous avons rejeté le prêtre et garder le médecin.
Il est grand temps de réconcilier le prêtre et le médecin, le spirituel et le scientifique ». il y a un fossé à combler. Cependant, en médecine scientifique, on enseigne la psychologie médicale, les fondements de la relation médecin-malade, l’alliance thérapeutique et il y a maintenant une science établie de l’effet placebo. Le médecin revient au prêtre par des voies détournées. Et il utilise très largement, souvent inconsciemment, le chemin de la suggestion (suggestion que Freud n’aimait pas trop). Pour ma part, je pense que le médecin de famille est un homme de confiance. Il a le manteau du druide. Il fait de la suggestion. Et c’est une bonne chose ! Les médicaments parfois peuvent avoir un effet placebo sans le savoir ». Jacques Besson évoque une recherche sur les antidépresseurs qui montre qu’il n’y a que 5% de variance entre le placebo et le médicament. « Cela rend modeste quand on pense qu’on a dépensé des milliards pour des antidépresseurs.
« Je crois qu’il faut être juste et humble. Il y a un ordre somatique de la médecine. Il y a des gènes. Il y a des molécules. Il y a un déterminisme biologique. Il y a une génétique. Mais il y a aussi une épigénétique. Les gènes dialoguent avec l’environnement. Le sujet a une histoire dans sa nature, dans son contexte. Et c’est toute la force de l’ordre psychique. Nous avons une éducation, un environnement, une culture, des valeurs et cela produit de la plasticité ». Il y a des intuitions. L’intuition est une dimension de l’appareil psychique qui n’est pas étudiée en psychothérapie. Elle est souvent destinée aux « bonnes femmes » alors que la femme a beaucoup plus d’intuition que l’homme.
C’est probablement avec les femmes que l’on a eu les plus grandes découvertes de la sacralité. Certes, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, mais ces différences ne sont pas absolues. « Il y a l’ordre psychique, les apprentissages, les valeurs qui ont été transmises. Mais je pense que la réponse la plus appropriée est dans la psyché, les archétypes, l’animus et l’anima… La santé psychique, c’est le dialogue, le mariage entre l’animus et l’anima. C’est la rencontre des opposés. Pour atteindre la totalité, l’individuation, il faut avoir marié l’anima et l’animus… ». Cette analyse se poursuit au niveau de l’univers. « La rencontre du ciel et de la terre se fait pour que l’homme puisse accéder à plus grand que lui. Henri Bergson disait : « la terre est un incubateur de Dieu ». Tout se passe comme si la matière voulait être spiritualisée… ». C’est une vision de réconciliation.
Puis, Jacques Besson évoque l’amour des autres comme l’amour de soi. » Pour les bouddhistes, pas de sagesse sans compassion. Pour les chrétiens, pas de vérité sans charité. La conscience ne suffit pas… il faut passer par le don de soi ; par la créativité, par le nouveau. Si nous sommes dans un univers évolutionnaire, alors nous faisons partie de l’évolution. Nous avons une responsabilité. Nous sommes des co-créateurs ».
« La méditation, la prière, la sagesse des peuples premiers et la religion peuvent nous apporter quelque chose. La spiritualité n’a pas besoin d’être religieuse ; mais je pense qu’il y a des religions qui peuvent être spirituelles. Personnellement, j’ai beaucoup d’admiration pour le soufisme… Soyons humble. Gandhi a dit : « celui qui va au fond de sa religion, va au fond de toutes les religions ». Le noyau dur des religions, c’est la spiritualité, c’est la sacralité, c’est le rapport entre la vérité et la charité. C’est cela le noyau dur ».
Quelles lectures éclairantes ? Une inspiration biblique
L’intervieweur demande à Jacques Besson de nous conseiller. Et, entre autres, quelles lectures comptent pour lui ? La réponse va à l’encontre de la mode. C’est « lire la Bible ». « Parce que c’est, quand même, un livre incroyable. Ce sont des centaines d’auteurs qui écrivent ensemble dans des moments différents, dans des contextes différents, pour exprimer une forme de vérité profonde dont ils ont eu l’inspiration, la révélation pour le bien de la communauté. Il y a, bien sûr, des chapitres plus difficiles, mais lire la Bible avec la psychologie des profondeurs, avec de l’éveil, avec un regard chamanique, c’est très riche de sens, de lien, d’expérience d’autres humains, d’autres situations. Quand Moïse va chercher les tables de la loi et qu’il trouve les « couillons » avec le veau d’or, c’est une modernité effrayante. Et le Christ sur sa croix qui est plus fort que la mort – après, on peut l’interpréter de plusieurs manières – c’est actuel, je pense. Si on ne s’occupe pas trop de la mort, on devient tellement plus vivant. Il faut vivre l’instant ». Et donc, si la Bible n’est plus toujours appréciée, Jacques Besson s’écrie : « moi, je la lis ». Certains passages le touchent davantage ; « Ma petite préférence va à l’Évangile de Jean. Dans l’Ancien Testament, j’aime beaucoup le Livre de Job, le malheur de l’innocent… Il y a les psaumes qui sont merveilleux aussi et bien sûr les Évangiles. Septante trois guérisons du Christ. Le Christ est un exorciste. C’est un immense chaman. Le Saint-Esprit, vu par la spiritualité et les neurosciences, c’est le Grand Esprit, c’est l’âme du monde ». Paracelse est cité en évoquant ‘la lumière, l’âme du monde’. « Lisez Paracelse, lisez Jung, lisez la Bible, regardez la biographie de Gandhi ».
Interrogé sur l’esprit qui l’anime, Jacque Besson revient à son enfance : « Quand j’avais quatre ans, mon grand-père est mort dans des conditions assez tristes et ma mère a fait une assez grave dépression ; je me suis mis à avoir peur du noir. C’était assez angoissant. Un jour que ma nourrice s’occupait de moi, elle a remarqué que j’avais peur du noir et elle s’est adressée à moi avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d’humanité, elle m’a dit : Jacques, il ne faut pas avoir peur du noir. Non, il ne faut pas avoir peur du noir parce que, dans le monde, il y a une lumière invisible. Oui, c’est une lumière qui éclaire et qui réchauffe le cœur des enfants. C’est un enfant aussi qui la donne. Il s’appelle Jésus. Cela m’a intéressé : il y aurait une lumière invisible et un autre enfant qui la donne. Et il est d’un autre ordre… Donc, à partir de quatre-cinq ans, je me suis intéressé à cette figure. On m’a envoyé à l’école du dimanche. Je me suis passionné pour les personnages de la Bible : Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et les pharaons, Moïse, David, Goliath et puis, après, le Christ. J’ai toujours eu cette intuition qu’il y a du visible dans l’invisible. Et plus tard, j’ai découvert, avec les Pères du premier millénaire chrétien ce qu’ils appellent l’intelligible, non pas au sens de l’intelligence, mais au sens que dans l’invisible, il y a des choses qu’on peut comprendre, auxquelles on peut accéder, c’est une grâce divine. Alors, toute ma vie a été éclairée, d’un côté par mon intérêt sincère et rigoureux pour la science et mon intérêt sincère et rigoureux pour la spiritualité. Et, un jour j’ai découvert, je crois que c’est Jean Calvin qui l’a dit, « la science permet l’émerveillement ». J’avais une passerelle….
Cette contribution de Jacques Besson nous parait particulièrement éclairante et innovante. Elle reconnait et prend en compte des réalités émergentes comme par exemple les résultats de l’imagerie cérébrale, les synchronicités et le chamanisme. Des courants de pensée et de recherche, encore minoritaires sont pris en compte. Un nouveau paysage apparait.
Cette contribution nous parait doublement précieuse. A l’encontre d’un matérialisme encore puissant, elle instaure une nouvelle compréhension de la nature humaine et de l’ordre du monde d’autant qu’en plus des phénomènes mentionnés dans cet interview, on peut en ajouter d’autres comme les expériences de mort imminente présentées par l’auteur dans une autre vidéo. En même temps, elle installe la spiritualité dans la préservation et le recouvrement de la santé.
On peut ajouter un autre apport qui nous parait précieux dans la configuration religieuse actuelle où certains courants fondamentalistes manifestent une étroitesse d’esprit en considérant négativement des phénomènes émergeants jusqu’à les condamner et à les rejeter avec violence au nom d’une interprétation littérale de la Bible. Or, ici, Jacques Besson conjugue la reconnaissance de ces phénomènes avec un témoignage de foi chrétienne et une lecture de la Bible à la fois instruite et enthousiaste.
Ainsi, à tous égards, cette contribution nous parait appeler une particulière attention.
Rapporté par J H
1.Jacques Besson. Addiction et spiritualité. Spiritus contre spiritum. Erès, 2017. « L’auteur propose un voyage depuis l’aube de l’humanité en compagnie des substances psycho-actives jusqu’à l’épidémie addictive contemporaine. Il montre comment l’addiction représente une pathologie du lien et du sens. Les relations entre addiction et spiritualité sont explorées par les dernières recherches neuroscientifiques sur la méditation et la prière, dans ce qui est devenu une nouvelle science, la neurothéologie »
2. La CONSCIENCE , moteur de la prochaine REVOLUTION : https://www.youtube.com/watch?v=-bA52VG7wZg
Expériences de mort imminente : la science face à une énigme : https://www.youtube.com/watch?v=REoY0EwwnMM
3.Spiritualité et créativité de soi. L’esprit du bonheur : https://www.youtube.com/watch?v=M7C1FXvMzSA
Voir aussi :
The Awakened brain ( Cerveau et spiritualité) : https://vivreetesperer.com/the-awakened-brain/
La nouvelle science de la conscience : https://vivreetesperer.com/la-nouvelle-science-de-la-conscience/
Comment nos pensées influencent notre réalité : https://vivreetesperer.com/comment-nos-pensees-influencent-la-realite/
Les expériences spirituelles : https://vivreetesperer.com/les-experiences-spirituelles/
Une révolution spirituelle. Une approche nouvelle de l’au-delà (Lytta Basset) : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/
Jésus le guérisseur (Tobie Nathan) : https://vivreetesperer.com/jesus-le-guerisseur/