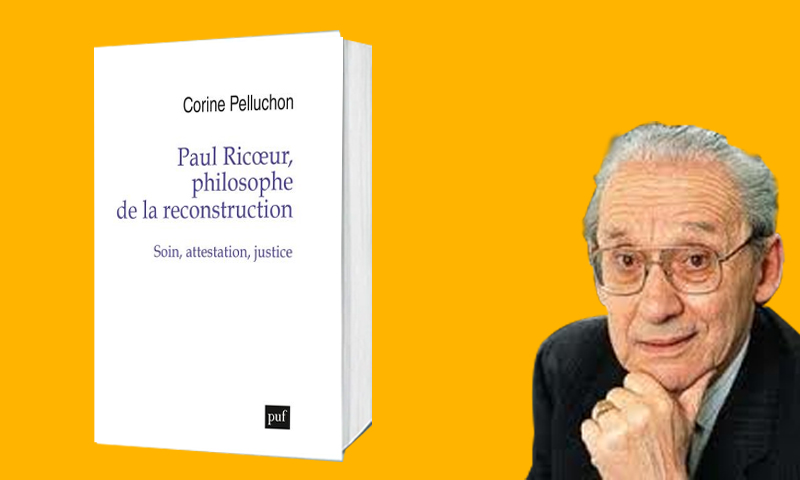par jean | Août 19, 2025 | ARTICLES, Hstoires et projets de vie |
Une éducation au Cameroun
Je suis née à Yaoundé, au Cameroun, où j’ai grandi au sein d’une famille polygamique. Mon père avait trois épouses et je suis la benjamine d’une fratrie nombreuse. J’ai grandi dans un foyer où régnaient le respect, le partage et le pardon. Ces valeurs étaient profondément ancrées dans la foi chrétienne de mon père, qui a fréquenté différentes églises.
Très jeune, mes parents m’ont transmis le sens du devoir et des responsabilités. Chaque grande vacance, je retournais dans mon village où je cultivais une parcelle de terre que mes parents m’avaient confiée. En récompense de mon travail, mon père m’offrait les frais de scolarité. Cette expérience m’a appris que rien n’est acquis sans effort, et que la réussite est toujours une question de mérite.
Étant la plus jeune, on me sollicitait souvent pour rendre service. J’y prenais plaisir, et c’est ainsi que, dès l’enfance, j’ai ressenti le désir d’aider les autres.
Le début de ma vie adulte
Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire, j’ai travaillé comme secrétaire dans plusieurs services à Yaoundé. Plus tard, je suis venue en France pour rendre visite à ma sœur, aide-soignante elle-même. Ses conseils, nourris par son expérience, m’ont poussée à rester en France et à envisager une reconversion professionnelle.
Mon intégration n’a pas été immédiate, mais au fil du temps, j’ai suivi diverses formations, dont celle d’aide-soignante, qui m’a permis de me reconnecter à mes valeurs fondamentales.
Devenir aide-soignante
J’ai choisi le métier d’aide-soignante car il incarne les principes qui me tiennent à cœur : l’empathie, le partage et l’entraide. Les valeurs professionnelles associées à ce métier – le respect, la responsabilité, la bienveillance – ont renforcé ma motivation.
Lors de ma formation, les périodes de stage ont été décisives. J’y ai découvert les réalités du terrain : la dépendance, le handicap, la fin de vie. Ces expériences m’ont permis de comprendre la profondeur et la complexité de ce métier.
Mon parcours professionnel
Depuis l’obtention de mon diplôme, je travaille dans un EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), où je suis en poste depuis plusieurs années.
Ce parcours m’a permis de développer un grand nombre de compétences :
- La bientraitance
- La méthode Humanitude
- Les règles d’hygiène et de sécurité
- L’ergonomie
- Le respect de l’autonomie, de la dignité, des croyances et des valeurs
- L’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne
Chaque résident est unique. Je m’adapte à chacun, car le soin doit être personnalisé.
Bien sûr, des difficultés existent : les urgences vitales, le manque d’effectif parfois, le stress… Mais grâce au soutien de ma hiérarchie et à l’esprit d’équipe de mes collègues, ces obstacles sont surmontables.
L’un des aspects les plus délicats reste le décès des résidents. Malgré la distance professionnelle, nous nous attachons aux personnes que nous accompagnons. Dans ces moments, le soutien d’une psychologue nous est proposé
Mais ce métier m’apporte aussi de nombreuses joies. Voir un sourire après un soin, entendre un remerciement sincère, ou simplement sentir qu’on a pu soulager quelqu’un, me procure une immense satisfaction. Il m’arrive même de chanter spontanément pendant les soins, tant je ressens parfois une joie profonde dans l’acte de soigner.
Vers la profession d’infirmière
Aujourd’hui, je poursuis mon évolution professionnelle en entamant des études d’infirmière, avec le soutien de mon établissement. Forte de mon expérience concrète auprès des patients, je souhaite élargir mes compétences, tant sur le plan relationnel que paramédical.
Je suis convaincue que la qualité de la relation entre soignant et soigné a un impact direct sur le moral, et donc sur la santé.
Un fil conducteur
En regardant mon parcours, je réalise combien mon éducation a façonné ma vocation. En tant que benjamine, j’ai appris à écouter, à observer, à suivre les conseils de mes aînés. J’ai grandi dans le respect des autres, le sens du partage, l’amour du prochain et l’entraide.
Toutes ces valeurs ont facilité mon intégration dans le métier d’aide-soignante.
Aujourd’hui encore, l’amour des autres reste ma plus grande motivation.
Lucie

par jean | Mai 16, 2025 | ARTICLES, Hstoires et projets de vie |
Dans la routine des EHPADs, on peut entrevoir des moments de lumière, Il y a des paroles, des sourires, des gestes qui réconfortent. La vie circule à travers des relations bienveillantes. Cependant, il y a certains soignants qui, tout particulièrement, irradient la confiance. Ces porteurs de vie et de soin répandent la joie parmi les démunis. Quelques portraits de personnes, quelques évocations de pratiques en témoignent ici
Notre ADN, c’est l’amour
Lid est une aide-soignante confirmée qui a décidé d’entreprendre des études d’infirmière. Nous évoquerons donc sa pratique au passé.
il y avait chez Lid une aisance. Elle abordait chacun avec respect. Une prévenance qui se manifestait jusque dans la toilette, auparavant une petite annonce de sa part comme une demande d’accord avant de commencer :1 2 3. Dans une vraie écoute, elle couvrait l’ensemble des besoins. Une relation ouverte permettait en dialogue où les préoccupations pouvaient affleurer et y trouver un apaisement.
Au travail dans cet EHPAD, Lid en connaissait les ressources et les obligations et elle exerçait sa fonction avec une conscience professionnelle assumée. Elle ne se contentait pas des tâches classiques. Elle se comportait comme une accompagnante, attentive aux besoins latents. Ainsi, dans un environnement complexe, elle permit à une des personnes à sa charge de changer de régime alimentaire. Pour réaliser cette opération, il lui avait fallu croire à un nouveau possible et négocier avec les parties concernées. Bref, Lid n’était pas seulement une sauvegarde, elle était un recours.
Face à des situations diverses et parfois très lourdes, si la fatigue l’atteignait à certains moments, il y avait chez Lid un dynamisme qui s’entendait parfois par des voix et des rires audibles dans le couloir de l’étage. Le matin, à son arrivée, on pouvait se dire : lid est bien là. C’était comme si la vie se manifestait à nouveau. Oui, Lid était une personne vivante.
Un jour proche de la Saint Valentin, elle aborda le sujet et, si la réaction en retour put lui paraitre mi-figue, mi-raisin, elle s’exprima plus avant, en évoquant la force de l’amour au sens le plus large. Et c’est là qu’elle s’exclama en parlant des aide-soignantes : Notre ADN, c’est l’amour ! Merci Lid ! vous serez une bonne infirmière…
J H
Le sourire de Nat
Pour éclairer la vie en EHPAD, on peut écrire de petits portraits de soignants qui, par leur attitudes, répandent une bonne humeur. Et par exemple, nous pensons à Nat, une aide-soignante dynamique d’origine africaine.
En s’occupant des résidents, il nous parait que transparait chez elle une grande conscience professionnelle et comme le sentiment d’une mission. Un jour, dans une conversation, je l’ai entendu dire avec enthousiasme : « Je suis une soignante ». Elle sait combien les personnes âgées sont vulnérables et combien, en conséquence il est important de veiller immédiatement aux dérives. Dans une courte conversation lors d’un passage pour apporter le gouter, j’ai pu entendre avec bonheur qu’elle reconnaissait naturellement l’importance de la manifestation d’une présence des aide-soignantes pour des gens isolés dans un ehpad. « Une attention ! un sourire ! ». Et oui, elle sait combien le moral a une influence sur la santé. Les tempéraments sont différents et, dans le travail, sont appelés à se compléter.
Nat est vive et enthousiaste. Il est bon et beau également, de pouvoir, à certains moments, observer chez elle un sourire rayonnant. Merci Nat
J H
Elle apprivoisait le temps et l’espace
Aide-soignante en service de nuit dans un EHPAD : une pratique remarquable
Partir d’une étude de cas pour analyser et comprendre les pratiques, c’est aussi pouvoir mettre ainsi en évidence un comportement positif, contribuer à en répandre les bienfaits. Bien sûr, telle pratique est liée au profil de la personne, à ses qualités, à ses dons et elle n’est donc pas reproductible telle quelle, mais en montrant un déroulé d’actes concrets, on peut dégager une orientation qui est susceptible d’attirer et de se répandre
Relégué dans cet EHPAD, depuis plusieurs années et devant porter le nuit une protection vis-à-vis de l’urine, celle-ci devant être suivie pour éviter les débordements éventuels, j’ai donc pu observer les comportements du personnel, les étapes principales étant un contact le soir avant le coucher et le change de la protection en fin de nuit. La situation se complique si, pour une raison ou pour une autre : insuffisance de la protection ou abondance d’urine, des fuites se produisent pendant la nuit.
Cependant, une aide-soignante de nuit dans un EHPAD a beaucoup d’autre rôles puisqu’elle est en charge de l’état général des assistés et des perturbation correspondantes : manque de sommeil, anxiété etc
Au cours des mois, nous avons vu bien des intervenant(e)s souvent de passage en vacation et nous pouvons essayer de décrire la pratique dominante.
Dans l’ensemble, on peut distinguer deux variétés. Dans la première variété (majoritaire), le passage du soir s’accompagne de quelques paroles, parfois un début de dialogue. Dans les gestes techniques, on note une attitude de prévenance. Je puis garder un souvenir positif de certaines relations. La seconde variété est dépourvue de sens relationnel : le soir, un bonjour formel, des gestes techniques accomplis sans prévenance et quasiment sans parole, l’assisté ressentant parfois une absence de considération, voire sa réduction à un objet à traiter.
Sur ce fond général, est apparue, en fin d’année 2023, une aide-soignante innovante et relationnelle. Ce fut un changement remarquable et remarqué. C’est parce qu’il nous parait exemplaire que nous essayons ici de le présente en terme d’étude de cas
Nous nous permettrons de l’appeler ici par son prénom : Vanessa. Vanessa est donc apparue en se présentant, puis en amorçant un dialogue. Ce pouvait être au sujet du vécu de la journée, et par la suite, ce moment de dialogue a pu être apaisant pour l’assisté.
Et ce dialogue portait naturellement sur les requis de l’assistance. Il y eut une séquence ou des fuites se manifestaient en fin de nuit. L’aide fut adaptée aux circonstances, ici par un suivi attentif, un change de protection vers 1 heure du matin.
Cette assistance s’est caractérisée également par son attention au temps : annoncer le moment des passages, et même le jour de la prochaine séquence d’intervention, en terme familier : « à jeudi ! ». Ces au revoir s’accompagnaient souvent d’un petit geste de salut. Cette intervention apprivoisait le temps.
Elle apprivoisait aussi l’espace, en l’inscrivant dans une dimension plus vaste, plus « communautaire », le tout étant symbolisé par un geste très fort symboliquement : en quittant la chambre, « Voudriez-vous que je laisse la porte entrouverte ? ». A travers cette demande et la réponse positive qui s’en suivait, se créait un espace commun fondé sur la confiance, une confiance qui s’étendait à la nuit. C’est bien cela, l’écoute attentive, la prévenance de Vanessa entrainaient la confiance. Quel bonheur ! Quelle différence avec un univers impersonnel !
Cependant, à quelques indices, j’ai pu constater aussi combien cette attitude s’inscrivait dans une vision professionnelle. A plusieurs reprises, non seulement, Vanessa est intervenue rapidement lorsqu’un incident lui fut signalé, mais elle me remercia de l’avoir prévenu. Rendu résigné par l’expérience, je fus surpris par son encouragement à téléphoner en cas de fuite de la protection. C’était une expression d’une haute conception de la responsabilité collective. Elle manifestait qu’il y avait bien une présence dans la nuit. Par ailleurs, un incident de voisinage m’a permis de constater qu’elle savait se faire respecter en tant que professionnelle. Je peux ainsi présumer que la pratique décrite ci-dessus s’inscrit dans un professionnalisme, une vision à la fois personnelle et collective de sa fonction.
Cette description peut paraitre louangeuse. Si je suis effectivement reconnaissant vis-à-vis de cette aide-soignante, j’ai voulu rédiger ce bilan en terme de description, la plus objective possible, comme une étude de cas, pour que cette étude permette une réflexion pour l’amélioration des pratiques. Si cet exemple est remarquable, il doit pouvoir inspirer sans décourager. Chaque personne est singulière. Globalement,
nous avons noté qu’une variété majoritaire des pratiques observées est acceptable . On doit mesurer le mérite de ce travail patient dans un contexte qui entraine de la fatigue et où les prestations doivent se maintenir dans la durée. Voici de quoi être reconnaissant. Cette étude ne doit donc pas susciter une quelconque culpabilité et des réactions en retour.
Mon écriture ici n’allait pas de soi. Si nous avons voulu rassembler nos observations pour apporter une description cohérente, c’est pour faire connaitre une pratique remarquable parce qu’elle nous parait pouvoir amener à réfléchir et à inspirer dans le dialogue
Il y a des aides-soignantes remarquables. J’en ai rencontré
J H
Il y a de belles âmes parmi les soignantes en EHPAD
Au cours d’une conversation, ce fut une bonne surprise d’entendre Léo, une aide- soignante chaleureuse parler de son parcours en s’exclamant qu’elle avait rencontrer de belles âmes en EHPAD
Léo-Paul-Dine, venue de Haïti dans les années 1990 a grandi et vécu en France, en surmontant les épreuves qu’elle y a rencontrées. Elle a choisi la profession d’aide-soignante et elle nous dit pourquoi : « C’est un métier de cœur. Pour exercer cette profession, il faut avoir de l’humain en soi ». Effectivement, rencontrer Léo, c’est vivre une relation bienfaisante.
Engagée dans la profession d’aide-soignante, avec quelques pauses dans d’autres emplois, Léo a rencontré des situations très diverses. Et, par exemple, elle raconte que pendant trois ans, en aide à domicile, elle a eu en charge une femme qui était sourde, muette et aveugle. De plus, cette femme avait été abandonnée à la naissance, élevée à l’assistance publique. Léo a communiqué avec elle par le toucher. Elle la tenait par la main et ainsi elle l’orientait. Autre situation, dans un EHPAD, face à un conflit entre fils et mère. Léo raconte comment il y avait là deux copines d’enfance qui vivaient là au même étage face à face. L’une d’elle avait un enfant, mais lorsque celui-ci venait, il l’ignorait en parlant seulement à sa copine. Car il disait avoir souffert de sa mère et lui reprochait d’être cruelle. Cette femme rejetait sa haine sur nous. Lorsque copine est décédée, le fils n’est plus revenu. La mère est décédée sans avoir plus jamais revu son fils. Pour les aide-soignantes, cette situation a été difficiles é supporter, mais Léo a respecté ces personnes.
Au cours de ces années et dans différents emplois, Léo a rencontré beaucoup de soignants et de patients, et parmi elles, de belles personnes. Mais qu’est-ce qu’une belle personne ? Selon Léo, « Une belle personne, c’est une personne qui travaille avec le cœur., qui ne fait pas semblant. C’est une personne qui est juste ».
Léo se rappelle de « Marie, ASH, qui faisait son travail avec le cœur, qui avait le cœur en or, qui apportait une lumière. Les résidents l’aimaient beaucoup. Les autres soignants aussi.
Rosette avait une vie personnelle assez compliquée, mais elle faisait du bon boulot et on avait du plaisir à travailler avec elle. On rigolait avec elle C’était une très bonne collègue.
Suzelle, aide-soignante, était d’une justesse et d’une précision incroyable Lorsqu’on bossait derrière elle, le travail était toujours fait correctement.
Toutes ces personnes aimaient ce qu’elles faisaient et nous étions dans la même pensée. Il y avait toujours de l’entraide. Elles étaient faciles à vivre. C’était des soignantes appréciées de tous les résidents et du personnel ».
Au final, Léo nous parle des conditions de travail. Les « belles personnes », dont elle nous a parlé, sont très efficaces. « Ce sont de bons éléments. Malheureusement, les structures ne savent pas les fidéliser ».
Venant d’une personne qui aime son métier et sait observer, une interpellation à écouter. Plus encore, Léo nous ouvre à la gratitude en partageant une dynamique de vie et en évoquant toutes ces » belles personnes » qui y participent.
Rapporté par J H
Et encore…
A ces textes jusqu’ici non publiés, nous en ajouterons un autre paru sur Vivre et espérer
Une infirmière dans une écoute active
Dans cet EHPAD, les infirmières passent chaque matin apporter les médicaments. Ce peut être une routine. Je me souviens du jour où une nouvelle infirmière apparut en se présentant avec enthousiasme : « Je m’appelle Yo ». Ce fut le point de départ d’un parcours en confiance et en dialogue ouvert par l’attitude de Yo témoignant de convictions profondes telles qu’elle les exprime dans son article :
« Pour moi, infirmière, c’est être dans une écoute active, avoir de l’empathie, tout en étant authentique…. De par ma culture africaine, le respect, la proximité, l’intimité sont des éléments fondamentaux. Quand dans un EHPAD, un ainé me parle, je prends l’habitude de me taire et d’écouter. Cela me permet de donner une réponse. Je suis donc dans une écoute active dans laquelle je mobilise mes connaissances et puis ainsi apporter une réponse adaptée. Je continue à apprendre constamment…
Les journées sont souvent longues et épuisantes, mais, en fin de parcours, je me réjouis d’avoir été au service de personnes vulnérables et de leur avoir apporté, outre les soins, réconfort et soutien. Cela donne un sens à ma vocation de soignante, ce que j’ai toujours voulu faire. C’est un accomplissement de ma vie selon tout ce que je crois : un ordre divin, qui, par mon entreprise, prend soin de ses créatures ».
De Yaoundé à Paris. D’aide-soignante à infirmière. Une vie au service du care et de la santé :
https://vivreetesperer.com/de-yaounde-a-paris/
Textes initiés et rassemblés par J H
On pourra consulter également :
De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin : Cynthia Fleury. Le soin est un humanisme : https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/
L’apport de l’immigration africaine à la culture du care : https://vivreetesperer.com/apport-de-limmigration-africaine-a-la-culture-du-care/
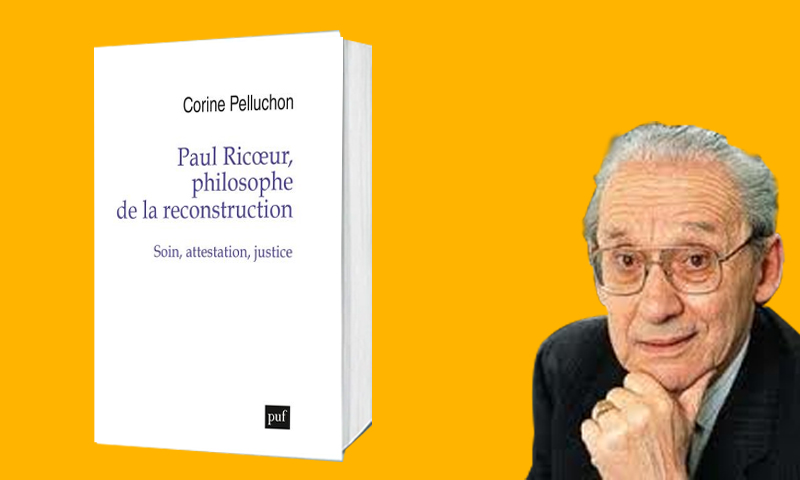
par jean | Mar 8, 2025 | ARTICLES, Hstoires et projets de vie |
Une identité qui se manifeste à travers la narration, d’après la philosophie de la reconstruction de Paul Ricoeur : « Soi-même comme un autre »
Comment nous percevons nous, nous-même ? Comment envisageons-nous notre chemin de vie ? Comment l’exprimons-nous ? Quel regard portons-nous sur notre parcours, sur ses défaillances comme sur ses points forts ? Percevons-nous notre vie en termes de moments dispersés et contradictoires ou bien comme orientée dans une même direction. Et, lorsque nous ressentons le besoin de faire le point, au moyen d’une narration, d’un récit, n’est-ce pas là que peut se manifester une conscience du mouvement de notre personnalité et de la vocation que nous y percevons ? Ce peut être ainsi une manière de prendre davantage conscience de nous-même, de ce qui nous nous tient à cœur, de ce à quoi nous nous sentons appelés. Nous pouvons ainsi exprimer une assurance dans le contexte du témoignage, une ‘attestation’ dans le langage du philosophe Paul Ricoeur pour qui l’idéal de vie consiste à ‘vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes’. Cette identité narrative est étudiée dans un livre de la philosophe Corine Pelluchon (1) : ‘Paul Ricoeur, philosophie de la reconstruction. Soin, attestation, justice’ (2). L’auteure y commente un livre majeur de Paul Ricoeur : ‘Soi-même comme un autre’.
A quelles questions ce livre veut-il répondre ? « Comment retrouver notre capacité d’agir quand nos repères s‘effondrent à la suite d’évènements traumatiques ? Quelle conception du sujet rend justice à la dimension narrative de l’identité ainsi qu’au tôle décisif joué par autrui et par les normes sociales dans la constitution de soi ? … » (page de couverture).
Par ailleurs, dépourvu de formation philosophique stricto sensu, nous ne rendrons pas compte de l’ensemble du livre, mais après avoir repris quelques considérations sur l’œuvre de Paul Ricoeur, nous présenterons l’approche narrative, en évoquant en fin de parcours ‘les prolongements de la théorie narrative en médecine et en politique’.
L’œuvre de Paul Ricoeur
Corine Pelluchon nous raconte d’abord comment ce livre est issu d’un séminaire consacré à l’étude de ‘Soi-même comme un autre’ et intitulé ‘Soin, attestation, justice’ dans le cadre d’un parcours en ‘Humanités médicales’. En 2021, l’auteure a approfondi sa réflexion sur Paul Ricoeur. « C’est ainsi qu’est né ce livre dans le but de faire comprendre une œuvre magistrale » (p 9).
Quel est l’esprit de cette œuvre ? « L’œuvre de Paul Ricoeur est une œuvre de reconstruction. Ce mot doit s’entendre de plusieurs manières qui s’entremêlent dans ‘Soi-même comme un autre’. La reconstruction est le fruit de la réflexion entendue comme réappropriation de notre effort pour exister. La réflexion en tant que telle est ressaisie de soi… Par l’interprétation, le sens, reconfiguré, permet au sujet de faire le lien entre le passé, le présent et l’avenir, c’est-à-dire d’affirmer son identité narrative et de pouvoir se poser comme un sujet capable de tenir ses promesses » (p 10). Ainsi, nous entendons la réflexion de Paul Ricoeur comme un aide « à mener une vie bonne dans un monde qui ne l’est pas » (p 11). C’est nous encourager à exister, à surmonter les crises, à poursuivre une action en personne responsable.
Paul Ricoeur adopte une ‘phénoménologie herméneutique’ qui se manifeste dans une approche constructive. Il s’oppose aux ‘herméneutes du soupçon’. « L’ambition de Paul Ricoeur est d’élaborer une philosophie rendant possible l’action d’un sujet soumis à la passivité… mais également capable d’initiatives… Si on ne rend pas justice à cette faculté qu’a l’être humain de se poser comme un sujet et de se reconnaitre dans ses actes, on ne peut plus parler de liberté et de responsabilité » (p 11). « Dans ‘Soi-même comme un autre’, les différents fils de son œuvre se rassemblent autour d’un motif central : bâtir une ontologie de l’agir qui donne du sens à l’action individuelle en dépit des épreuves et aide aussi à penser les conditions d’une revitalisation de l’espace politique sans laquelle les institutions démocratiques ne sont que des coquilles vides » (p 13).
La réflexion de Paul Ricoeur vient nous aider à être nous-même en traversant les crises et en éclairant notre travail de reconstruction. « Pour assumer sa parole et ses actes, être quelqu’un qui ne dit pas seulement « je », mais « me voici », il est indispensable de se penser comme moi, et non pas comme un moi quelconque. Continuer d’exister, se reconstituer après une dépression ayant provoqué l’effondrement du psychisme, rétablir de la cohérence dans une existence marquée par de nombreuses ruptures, penser sans illusion rétrospective que sa vie possède une unité malgré la discontinuité, redéfinir ses priorités, être disponible pour les autres et, de nouveau pouvoir s’engager parce que l’on croit à l’avenir : tel est le sens de l’herméneutique de soi que Paul Ricoeur parachève dans cet ouvrage dont la notion cardinale est celle d’attestation » (p 14).
Le sens d’une vie
Identité narrative et herméneutique de soi
A travers l’expression d’une histoire de vie, de ce récit, de cette narration, on découvre l’originalité, la singularité de sa personnalité, de son identité, ce qui se traduit en une interprétation, une herméneutique de soi.
« Parler d’identité narrative signifie d’abord que la connaissance de soi passe par le fait de se raconter, de tisser les différents évènements de sa vie pour leur conférer une unité et un sens qui n’est pas définitif et n’exclue pas la remise en question. L’identité n’est pas figée, ni à priori ; elle se transforme et se construit à travers les histoires que nous racontons sur nous-mêmes et sur les autres, et elle se nourrit des lectures et des interprétations qui enrichissent notre perception du monde et de nous. Plus précisément, l’identité narrative fait tenir ensemble les deux pôles dont la fiction littéraire présentant des cas-limites soulignent l’écart maximal. En effet, quand on parle de soi et qu’on veut se connaitre ou se faire connaitre à quelqu’un pour être compris de lui, on se raconte en mêlant des éléments reflétant à la fois son caractère (le ‘quoi’) et le maintien de soi, l’ipse (le ‘qui’). Or l’intérêt de la théorie narrative est de détailler les opérations mises en œuvre pour conjuguer l’unité et la diversité de sa vie » (p 120).
L’auteure met l’accent sur la tension entre unité et diversité au cours des vies. « Notre identité se construit par la manière dont nous agençons les évènements et les interprétons, en reconnaissant que certains s’inscrivent dans une certaine continuité avec ce que nous étions (idem), alors que d’autres nous ont poussé à remanier nos valeurs et à procéder à des changements importants de notre ipséité » (p 121) « Alors, la première opération que la théorie narrative met en avant est la configuration : le récit est un art de composition servant à faire le lien entre la concordance et la discordance. Se raconter, se connaitre, s’interpréter, c’est procéder à une synthèse de l’hétérogène… » (p 121).
Cette approche contribue non seulement à permettre à la personne de reconnaître la dynamique de sa vie, d’en bénéficier et, à la limite, de la partager, mais aussi de traverse des crises et d’en ressortir. « La notion d’unité narrative de la vie est essentielle si l’on veut saisir l’effort par lequel un individu tente de se reconstruire après une crise existentielle » (p 123). Dans une perspective qui débouche sur l’engagement de la personne, Paul Ricoeur en privilégie le ressort : une motivation enracinée dans l’histoire de vie : « Parce que l’identité narrative est une étape dans la construction de son concept d’attestation, Ricoeur privilégie la dimension de cohérence sur celle de discordance » (p 126). La crise peut déboucher sur un rebondissement. « Le sujet se rassemble après l’évènement ou les évènements l’ayant brisé. Bien plus, pour pouvoir répondre à l’appel des autres, il doit retrouver l’estime de soi ». (p 126). « Dans le projet d’ensemble de Paul Ricoeur, la notion d’unité narrative est un des éléments de son ontologie de l’agir, qui est une ontologie de l’homme capable, agissant et souffrant. Cette prise en compte de l’existant toujours situé dans un contexte social et géographique et qui a besoin, pour s’épanouir, de s’affirmer dans plusieurs domaines et d’être reconnu, le mène, pour introduire sa conception de l’unité narrative de la vie à distinguer des plans de vie, c’est-à-dire de vastes unités pratiques comme la vie professionnelle, familiale ou associative » (p 127)
La mise en œuvre d’une identité narrative n’est pas sans rencontrer des difficultés auxquelles l’auteure prête attention.
« Ne raconte-t-on pas uniquement ce qui a été métabolisé ou ce qui est métabolisable ? Jusqu’où et à quelles conditions faut-il accorder du crédit à la notion d’identité narrative, qui implique que le sujet appréhende l’unité de sa vie ? (p 123). Elle aborde aussi le cas des personnes atteintes de la maladie d’Alzeimer. En bref, « ces personnes ne se rappellent plus ce qu’elles ont fait et qui elles étaient… La capacité de rassembler sa vie en un tout est compromise par la maladie d’Alzeimer. L’enfermement dans le présent, caractéristique de cette pathologie, semble rendre la notion d’identité narrative totalement inopérante » (p 137) ; cependant, « il serait inexact de dire que la maladie d’Alzeimer prive la personne de son identité ». L’auteure aborde alors les modalités de son accompagnement.
Corine Pelluchon traite également des difficultés ressenties par les personnes ayant vécu une abomination. « Qu’il existe des narrations empêchées parce que le traumatisme n’est pas dicible, ou parce qu’en faire le récit serait s’infliger une peine supplémentaire puisqu’il ne serait pas reçu, souligne en creux l’importance de la narration. Celle-ci ne vise pas forcément à restaurer l’unité de vie, à rendre acceptable ce qui ne l’est pas ou à réparer l’irréparable. Toutefois, le témoignage peut donner un nouveau sens à la vie, comme on le voit dans l’œuvre de Semprun qui a beaucoup écrit, à partir des années 1960, sur la déportation » (p 135). Là, l’auteure souligne que la difficulté de s’exprimer dans une narration n’entame en rien ‘l’importance du récit dans l’existence’. Parfois, « la difficulté de vivre est aussi une difficulté de raconter et de se raconter… Pourtant, le récit existe. Même brisé, il ouvre le possible, puisqu’aucun récit ne clôt le sens, ne serait-ce que parce qu’il est lu par d’autres » (p 136).
Ainsi, Corine Pelluchon en arrive à affirmer le rôle essentiel du récit : « Le récit est un existential, une structure de l’existence. Notre identité est narrative, même si nous ne pouvons totalement nous rassembler et présenter une synthèse de l’hétérogène conférant une unité à notre existence et nous permettant de regarder l’avenir avec confiance. Dire que le récit est un existential signifie qu’il est nécessaire à la compréhension de soi et qu’il permet aussi de tenir bon, même quand il est différé et qu’il s’agit d’un récit qui parle de l’inénarrable ou met en scène la dissolution du soi… Le récit n’est pas seulement nécessaire sur le plan moral pour être un sujet responsable sachant quelles sont ses valeurs et ses priorités. Pour exister comme sujet, il faut pouvoir se raconter, même par bribes ou en confessant que l’on ne parvient pas à supprimer la déchirure » (p 136). L’auteure évoque également la psychanalyse : « Que la narration soit un existential apparait avec force quand on pense aux personnes qui reproduisent le refoulé sous la forme de symptômes et que la mise en récit de soi, comme la psychanalyse, peut aider (p 137).
L’approche narrative en médecine
Corine Pelluchon poursuit son étude de la mise en œuvre de la théorie narrative de Paul Ricoeur dans les champs de la médecine et de la politique.
L’apparition d’une médecine narrative s’inscrit dans un mouvement d’humanisation d’une profession tentée par une technicisation outrancière.
« Née aux Etats-Unis à la fin des années 1990 sous l’impulsion de Rita Sharon, professeur de médecine clinique à l’Université de Columbia, la médecine narrative, qui connait désormais un certain succès en France, répond à deux objectifs. Le premier est d’établir une relation entre médecins et patients qui soit fondée sur l’empathie et l’écoute attentive, afin que les traitements soient adaptés aux personnes et que le malade ne se sente pas objectivé. Le deuxième objectif de la médecine narrative est d’aider les soignants à réfléchir à leur métier, qui les confronte à la souffrance et à la mort, et à s’interroger sur le sens du soin en prenant en compte à la fois la souffrance des personnes et les contraintes économiques et relationnelles.
Bien que Rita Sharon ne se réfère pas à Ricoeur et que ceux qu’elle a inspiré connaissent souvent mal ce philosophe, la médecine narrative illustre ce qu’il écrit sur la narration et son herméneutique de soi éclaire même certains aspects de cette pratique » (p 141). L’auteure nous montre comment la médecine narrative rejoint l’approche de Paul Ricoeur. « La médecine narrative suppose en premier lieu de reconnaitre que les patients ont des histoires à raconter. Pour se connaitre et se faire connaitre à autrui, il faut se raconter, mettre en récit sa vie… Cet aspect est consonant avec la phénoménologie herméneutique de Ricoeur et avec son insistance sur le récit en première personne, qui découvre un sujet incarné et toujours situé… En termes ricoeuriens, on dira que la première compétence que la médecine narrative cherche à développer est la capacité de reconnaitre que le patient a besoin d’énoncer les symptômes motivant sa demande de soins, et de raconter une histoire lui permettant d’insérer l’épisode pathologique, qui est toujours vécu comme une rupture de l’unité – une discordance – dans une unité, une série d’évènements – une concordance. En mettant en intrigue les évènements de sa vie et en situant sa maladie à un certain moment de son existence, le récit aide le malade à reconfigurer le temps et à donner du sens à ce qui lui arrive » (p 142).
« La médecine narrative passe par un travail sur les textes des patients… Cette analyse doit aider le soignant à appréhender le désir du narrateur, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre de comprendre le sens que le patient donne à sa maladie. Cette manière de procéder évite de faire disparaitre le malade derrière sa maladie et de réduire celle-ci à sa dimension objective (disease) en négligeant sa dimension narrative (illness) » (p 143). Rita Sharon comme Paul Ricoeur critique le positivisme « Non seulement le vécu du malade ne doit pas être éclipsé par une ontologie de l’évènement, mais, de surcroit, la médecine elle-même est un art de l’interprétation… Le choix des traitements et l’accompagnement supposent de s’appuyer sur le vécu du malade et de chercher le sens global qu’il confère à sa maladie. Ainsi la médecine narrative rejoint-elle la phénoménologie herméneutique pour postuler un certain holisme de la compréhension » (p 144). La compétence narrative ne se borne pas à « reconnaitre les histoires des patients, mais aussi à les absorber, les interpréter et être émus par elles ». « Si les récits sont si éclairants, c’est parce que leurs auteurs ne relatent pas seulement des faits, mais décrivent leur vécu » (p 145). Si « le récit est lu au soignant qui va s’en servir comme d’un support pour élaborer avec le patient une démarche thérapeutique », il contribue également à ce que l’identité de la personne puisse se recomposer (p 146).
Cette approche se développe à l’encontre des dérives technicistes de la médecine. « Affirmer que la compétence première du soignant est une compétence narrative vise à répondre aux reproches adressés à la médecine contemporaine qui, en raison de sa haute technicité, tend à devenir impersonnelle et froide. Les contraintes économiques et l’organisation managériale de la santé aggravent ce phénomène. Le défaut d’écoute est compensé par l’inflation technologique et le soin est réduit à une protocolisation souvent déshumanisante (3). Pour briser ce cercle vicieux, la médecine narrative cherche à développer l’empathie, l’écoute attentive, et la capacité à comprendre les malades… Il s’agit de rééquilibrer le système de santé afin que la médecine, qui est une science et un art, et qui passe par la relation entre une équipe de soins et un sujet toujours singulier, soit plus juste et plus efficace » (p 142-143) (4).
Récit et politique
Corine Pelluchon aborde également le rôle du récit dans la constitution et l’entretien de l’identité d’une communauté politique. On se reportera à sa démonstration.
« En traitant des implications politiques du récit… Paul Ricoeur évoque Walter Benjamin qui, dans ‘Der erzähler’, publié en 1936, rappelle que l’art de raconter est ‘l’art d’échange des expériences’ et que celles-ci désignent, non l’observation scientifique, mais ‘l’exercice populaire de la sagesse pratique’. Ce texte, brièvement mentionné par Ricoeur est d’une grande pertinence quand on s’interroge sur le lien entre récit et politique » (p 153). Corine Pelluchon nous montre en quoi un manque de récit collectif pertinent engendre un désarroi politique : « Il y a un rapport étroit entre les crispations identitaires et l’impossibilité pour les individus de s’insérer dans un tissu d’expériences qui les précédent et les dépassent en les interprétant sans clore le sens. C’est pourquoi l’herméneutique est essentielle à la démocratie et contient la promesse d’une éthique interculturelle. Toutefois, avant de parler des conditions permettant à une communauté de construire un récit collectif qui ne s’apparente pas à une mystification et corresponde à une identité narrative, qui est par définition dynamique et ouverte aux influences étrangères, il importe d’insister sur une des affirmations principales de ‘Soi-même comme un autre’ : pour ‘rencontrer l’autre sans avoir peur de lui ni chercher à l’écraser, il faut savoir qui l’on est’. Pour ‘avoir en face de soi un autre que soi, il faut être un soi’ » (p 154).
N’en va-t-il pas de même collectivement ? Pour entrer pacifiquement en contact avec l’étranger, un peuple a besoin de se sentir lui-même.
« L’identité narrative implique l’ouverture à autrui comme aux autres cultures, mais cela exige que le noyau créateur d’un peuple qui renvoie aux images et symboles constituant un fonds culturel soit exploré et transmis » (p 154). C’est là aussi qu’une approche herméneutique, un travail d’interprétation et de réinterprétation est nécessaire. « Il ne s’agit pas de sacraliser un noyau éthico-mytique, mais de le soumettre à l’interprétation afin qu’une culture, prenant conscience d’elle-même, libère sa créativité. En l’absence d’un travail herméneutique visant à déchiffrer ces images et symboles qui forment ‘le rêve éveillé d’un groupe historique’, on ne peut rendre hommage à la diversité des cultures et s’y rapporter ‘autrement que par le choc de la conquête et de la domination’ » (p 153).
Cependant, nous dit Corine Pelluchon, l’âge moderne est marqué par le déclin du récit : manque de recul et manque de lien. On se reportera à son analyse inspirée par la réflexion de Walter Benjamin (p 156-159). Tout se tient. La reconnaissance des autres, la reconnaissance de l’étranger va de pair avec la connaissance de soi que ce livre présente en terme d’identité narrative.
« La connaissance de soi offre la capacité à aller vers l’autre, le travail sur les signes et les symboles de sa culture étant à la fois une condition de possibilité de l’accueil de l’autre et de l’hospitalité linguistique et leur conséquence » (p 161).
Voici une réflexion qui nous concerne. Comment nous percevons-nous ? Quel rapport entretenons-nous avec notre passé ? Et en quoi, le récit que nous pouvons en établir nous aide-t-il à déboucher sur un sens et sur un engagement ? Un autre philosophe, Charles Pépin envisage notre rapport avec le passé dans un livre : « Vivre avec son passé. Aller de l’avant » (5) Ainsi écrit-il :
« La question de l’identité personnelle est un des problèmes philosophiques les plus passionnants…. Qu’est-ce qui nous définit en tant qu’individu singulier, nous distingue de tout autre ? Qu’est-ce qui demeure en nous de manière permanente et constitue ainsi le socle de notre identité ? … Si nous nous interrogeons en ce sens, nous sentons bien combien nous pensons notre être, notre personnalité à travers notre histoire personnelle ». Charles Pépin interroge à ce sujet d’autres philosophes, des écrivains. Nous retrouvons là la pensée éclairante de Bergson (6). Ainsi Bergson écrit : « Dans une conférence donnée à Madrid, Henri Bergson synthétise cette idée de ressaisir notre passé pour nous projeter dans l’avenir sous le concept de récapitulation créatrice ». Et, pour notre part, nous aimons la manière dont il envisage un élan vital : « L’élan vital se particularise en chacun de nous… Notre personnalité est plus que la condensation de l’histoire que nous avons vécue depuis notre naissance… Elle est notre identité, mais propulsée vers l’avant, traversée par cette force de vie qui nous pousse à agir, à créer. »
Si nous revenons à la théorie narrative de Paul Ricoeur, à travers le livre de Corine Pelluchon, nous découvrons combien elle est féconde dans un champ très vaste de l’identité personnelle envisagée sous la forme d’identité narrative jusqu’à la médecine et la politique. Voici une approche à même d’éclairer les histoires de vie dont la rédaction s’est multipliée dans les dernières décennies. C’est aussi un apport pour considérer les reconfigurations qui apparaissent dans les témoignages qui abondent aujourd’hui dans le registre chrétien.
J H
- Les lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/des-lumieres-a-lage-du-vivant/
- Corinne Pelluchon. Paul Ricoeur, philosophe de la reconstruction. Soin, attestation, justice. PUF, 2022
- Pistes de résistance face à la montée d’une technocratie deshumanisante : https://vivreetesperer.com/pistes-de-resistance-face-a-la-montee-dune-technocratie-deshumanisante/
- Le soin est un humanisme : https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/
- Mieux vivre avec son passé : https://vivreetesperer.com/mieux-vivre-avec-son-passe/
- Bergson, notre contemporain : https://vivreetesperer.com/comment-en-son-temps-le-philosophe-henri-bergson-a-repondu-a-nos-questions-actuelles/
par jean | Sep 9, 2023 | Hstoires et projets de vie |
 Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants.
Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants.
« Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants » (1), c’est le livre de Christina de Stefano.
« C’est une biographie fascinante d’une pionnière du féminisme, des pédagogies nouvelles et des recherches sur le cerveau de l’enfant » (page de couverture).
Aujourd’hui, à un moment où l’humanité est confrontée à de graves menaces, il est bon de penser au mouvement de fond qui se poursuit depuis plus d’un siècle : une reconnaissance grandissante de la conscience des êtres humains et des êtres vivants jusque là méconnue par l’égocentrisme patriarcal, des femmes, des enfants et, à la limite, du règne animal. Mais, il n’y a pas de doute, la prise de conscience du potentiel du petit enfant, l’accompagnement respectueux de son développement, constitue une émergence de paradigme, une véritable révolution. A cet égard, Maria Montessori est la grande pionnière, tout en s’inscrivant dans le vaste mouvement de l’éducation nouvelle tel qu’il est apparu et se manifeste encore aujourd’hui comme un « printemps de l’éducation » (2).
Maria Montessori est celle qui, au début du XXe siècle, a dépassé les obstacles des conditions et des mentalités qui barraient la route à la reconnaissance d’une voie nouvelle, en proclamant et en démontrant que « l’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir ». Reconnaître le potentiel de l’enfant, c’est ne pas lui imposer, d’en haut, une instruction stéréotypée, des méthodes contraignantes, mais observer et accompagner son développement, son mouvement dans une approche personnalisée et la proposition d’un environnement matériel et social approprié. Reconnaître la dimension de l’enfant, c’est apprécier également sa dimension spirituelle. Le petit enfant est un « embryon spirituel ».
Si la pédagogie Montessori n’a pas occupé tout le champ de l’éducation et reste pionnière, sa présence s’est étendue : 200 écoles en France suite à une forte croissance dans les dernières décennies, et 20 000 dans le monde. Maria Montessori a écrit plusieurs livres. Son ouvrage : « l’enfant » fut pour nous une révélation (3), et, sur le web, il y a maintenant de nombreux sites qui présentent la pédagogie Montessori (4).
La pédagogie Montessori est toujours inspirante aujourd’hui. Dans le champ de l’éducation nouvelle, elle inspire des innovations comme celles de Céline Alvarez (5) retracées sur ce blog. Des recherches récentes, impliquant les neurosciences rejoignent les constats de Maria Montessori sur la dimension spirituelle de l’enfant. « L’enfant est un être spirituel » (6). Depuis la fin du XXe siècle, la pédagogie Montessori a même inspiré une nouvelle approche de la catéchèse chrétienne : « Godly Play » (7). On peut ajouter que l’éducation Montessori, à travers certaines de ses caractéristiques : l’attention à la dimension sensorielle, l’écoute, le respect commencent à inspirer aujourd’hui la communication entre adultes (8).
Ce livre de Christina de Stefano est un ouvrage de référence bien étayé, appuyé sur des notes et une bibliographie abondante. Et c’est aussi un livre très accessible réparti dans une centaine de courts chapitres et se déroulant en cinq parties : la construction de soi (1870-1900) ; la découverte d’une mission (1901-1907) ; les premiers disciples (1908-1913) ; la gestion du succès (1914-1934) ; l’éducation cosmique (1934-1952). En constant mouvement, dans des contextes différents d’un pays à un autre, de l’Italie aux Etats-Unis, de l’Espagne aux Pays-Bas et jusqu’à un long séjour en Inde, la personnalité de Maria Montessori apparaît dans sa complexité. Nous nous centrerons sur l’élaboration de « la méthode Montessori » fondée sur l’observation des enfants, ce que nous appellerons : l’invention montessorienne. Cette invention est la résultante de la formation d’une personnalité originale, une forte personnalité qui tranche avec la société dominante de l’époque. Il y a eu là toute une période de préparation. L’invention montessorienne a ensuite suscité des échos, si plus particulièrement dans certains pays, de fait dans le monde entier. Maria Montessori a communiqué sa vision et répandu son message en suscitant l’engagement et le dévouement d’un grand nombre de personnes. C’est une période de diffusion et d’expansion.
La préparation
Née en 1870, Maria Montessori a grandi comme fille unique dans une famille de la classe moyenne italienne, chérie par ses parents. « Son père travaille au ministère des Finances, sa mère se consacre à son éducation. Elle lui inculque les valeurs de la solidarité et lui fait tricoter des habits chauds destinés à des œuvres de bienfaisance. Elle l’encourage à s’occuper des pauvres et à tenir compagnie à une voisine handicapée par sa bosse. Peut-être, est-ce pour cela que la fillette caresse l’idée de devenir médecin » (13).
Maria supporte très mal l’école élémentaire. A cette époque, « immobile à son pupitre, on écoute la maitresse pendant des heures et on répète la leçon en chœur » (p 11). « Cette fillette extravertie est, malgré son jeune âge, dotée d’un grand charisme » (p 11). Elle poursuit ensuite ses études dans une école technique où elle réussit sa scolarité. Son père voudrait qu’elle s’inscrive à l’école normale pour devenir institutrice. Mais elle s’y refuse et déclare vouloir devenir ingénieur. « C’est un choix insolite, car les rares jeunes filles qui poursuivent leurs études le font pour enrichir leur culture avant de se marier ou, à la rigueur, pour entrer dans l’enseignement » (p 17).
Mais, encore plus surprenant à l’époque, elle voulut s’engager dans des études de médecine. Si l’esprit progressiste de sa mère la soutient, son père y est défavorable. « A l’époque, dans les milieux bourgeois, on protège jalousement les filles à marier, qui ne sortent jamais de chez elles sans être accompagnées. Il est donc proprement inouï d’imaginer une fille assise seule au milieu d’étudiants de sexe masculin » (p 19). Cependant Maria Montessori parvient à surmonter la barrière sociale et culturelle et à franchir les obstacles. Après avoir accompli des études préparatoires, en février 1992, elle intègre la faculté de médecine. A l’époque, certains professeurs ont des personnalités fortes et des idées avancées. Ils sont engagés dans une action médicale en milieu populaire. Maria les accompagne dans ce bénévolat. « Ayant grandi dans un environnement bourgeois et protégé, Maria n’était pas préparée à ce qu’elle découvre… C’est son « approche du peuple » (p 31). Très marquée par les cours d’un professeur sur la relation entre éducation et folie, elle décide de faire une thèse en psychiatrie sous sa direction. « Entre les cours, l’internat, dans les hôpitaux et l’étude des patients de la clinique psychiatrique en vue de sa thèse, la dernière année d’université de Maria est très intense. Elle obtient son diplôme en juillet 1896 » (p 34).
Maria Montessori va donc entrer dans un univers médical. Elle est assistante dans un hôpital. Et, tous les jours, en sortant de l’hôpital, « elle continue à faire du bénévolat auprès des déshérités de la ville. C’est au contact des enfants pauvres, qui sont les derniers de la société, que nait son attention à l’égard de l’enfance » (p 39).
Il lui arrive de fréquenter l’asile d’aliénés de Rome. C’est un endroit où règne la violence. Au cours de l’une de ses visites, elle découvre les enfants de l’asile. « Jugés incurables et donc enfermés à vie, ces enfants représentent peut-être ce que ce lieu épouvantable a de plus terrible » (p 44). « Maria comprend qu’elle a trouvé là une cause pour laquelle se battre ». Elle s’interroge à partir de la réaction d’une servante. « Si la réaction des enfants ne dépendait pas tant de leur désir de manger que celui d’interagir avec quelque chose » (p 44).
« Jusqu’alors, Maria a été une jeune femme médecin engagée dans les causes sociales et féministes. A partir de là, elle empruntera une voie qui la conduira très loin à parcourir le monde et à prêcher une nouvelle approche de l’enfant. Dans cette salle d’asile de Rome, son intuition lui dit que les petits déficients ont besoin d’un traitement spécifique qui les stimule et les élève » (p 45). Elle demande à en emmener quelques-uns hors de l’asile pour faire des expériences avec eux.
Elle s’intéresse à la pédagogie. « C’est ainsi quelle découvre le travail d’ Edouard Seguin, un français qui, au milieu du XIXe siècle, a mis au point une éducation particulière aux résultats surprenants… Seguin est le grand inspirateur de Maria Montessori et le créateur du matériel didactique à partir duquel elle a élaboré sa méthode » (p 45).
Edouard Seguin a été assistant du Docteur Itard devenu célèbre pour sa tentative d’éduquer « l’enfant sauvage de l’Aveyron ». Itard a pris en charge cet enfant en mettant en œuvre une méthode expérimentale, « faite de patience, d’observation et d’une grande créativité » (p 47). Dans ce sillage, Seguin se voit confier en 1840, ce qui est sans doute la première classe spécialisée de l’histoire, un groupe de jeunes déficients internés à l’asile de Paris. « Débordant d’enthousiasme, Seguin travaille, jour et nuit, pour essayer de communiquer avec eux. Il a décidé de bâtir une éducation complète, systématique, qui part de la sollicitation des sens pour ensuite s’étendre au développement des idées et des concepts abstraits… Pour ce faire, il invente tout un matériel éducatif… ». (p 48). En 1846, il publie un livre qui rapporte son travail. En raison de l’opposition manifestée par le milieu médical français, il émigre aux Etats-Unis.
A la fin des années 1890, un tournant majeur intervient dans la vie de Maria Montessori. Ce fut une rencontre amoureuse avec un collègue médecin Giuseppe Montesano. « Elle, socialiste, dans un sens, lui avec une éthique juive, son important sens moral, sa rigueur… elle trouva dans la douceur de Montesano l’élément complémentaire à son tempérament fort » (p 42). Ils travaillent ensemble. Mais Maria n’envisage pas un mariage. A cette époque, « la condition de la femme mariée est incompatible avec un travail hors du foyer » (p 52). Maria Montessori perçoit le mariage comme un assujettissement. Or elle tombe enceinte. La situation est critique. « A cette époque et dans son milieu, une grossesse hors mariage détruirait sa carrière et sa réputation » (p 51). Finalement à l’initiative de sa mère, les deux familles s’entendent pour masquer l’incident. L’accouchement a lieu à domicile le 31 mars 1898. L’acte de naissance indique que l’enfant est né de père et de mère inconnus. Il est confié à une nourrice éloignée. Maria Montessori accepte donc de se séparer de son nouveau-né. Elle demande au père, Giuseppe Montesano de « prendre soin de leur enfant à distance et de promettre de ne jamais se marier » (p 54 ). Ce dernier manifeste de la bonne volonté, mais il subit les pressions de sa famille et la situation se dégrade. « Tout a basculé en l’espace de quelques semaines. Le 29 septembre 1901, Giuseppe reconnaît légalement son fils. Le 6 octobre 1901, il épouse une autre femme » (p 74). Ce fut un grand chagrin pour Maria. « Ses proches évoquent un moment terrible : elle reste couchée par terre, en pleurs, pendant des jours (p 75)… Elle met fin à tout contact avec Montesano, notamment sur le plan professionnel. « Pour Maria Montessori, commence une longue traversée du désert, au terme de laquelle sa mission lui apparaitra clairement. Celle-ci la conduira à parcourir le monde en tant que théoricienne d’une nouvelle vision de l’enfant » (p 76).
En conséquence de ce grand choc, la vie de Maria Montessori s’est profondément transformée. Elle s’est abreuvée dans une foi intérieure. Cette intériorisation ne l’a pas détournée de ses engagements les plus avancés, sa grande activité au service du féminisme. Et elle a patiemment reconstruit sa situation professionnelle. Ainsi, quelques années plus tard, en 1907, elle a pu développer une grande expérience pédagogique qui va engendrer une nouvelle vision de l’éducation et de la pédagogie, « La Maison des enfants » à San Lorenzo, un quartier démuni de Rome.
En 1901, « plongée dans un silence profond, Maria Montessori traverse un grand moment de crise » (p 79) : un grand chagrin et la perte d’un premier enracinement professionnel. C’est dans ce contexte que Maria Montessori développe « une grande foi ». « La foi catholique, qui, jusque là, faisait simplement partie de sa culture, devient un refuge et une nouvelle manière de regarder la vie, une dimension qui explique et éclaire tout, y compris la souffrance » (p 79). Maria fait de longues retraites spirituelles et fréquente une congrégation religieuse. « Cette période de ferveur religieuse l’aide à contenir sa peine et à rassembler ses forces. Pendant un certain temps, elle mène « une vie de recueillement absolu ». « J’étais animée par une grande foi, et bien qu’ignorant si je pourrais un jour expérimenter la vérité de mon idée, j’abandonnais toute autre activité comme si je me préparais pour une mission inconnue » se souviendra-t-elle par la suite (p 80). Si sa foi s’exprime dans un contexte catholique, elle garde un caractère personnel. Elle inspire son engagement pédagogique et n’exclut pas une confrontation avec les idées conservatrices, tant sur le plan social que sur le plan religieux « En elle, coexistent un profond sentiment religieux, la conviction d’avoir une mission personnelle, le militantisme féministe, un esprit progressiste et indigné, ainsi que la curiosité à l’égard de toute idée nouvelle » (p 98).
Durant des années, l’engagement féministe de Maria Montessori ne s’est pas démenti. En 1906 déjà, elle est choisie comme déléguée italienne au Congrès international des femmes à Berlin. Très engagée dans l’action sociale, « Maria Montessori était devenue la secrétaire de l’association : « Per la donna »(Pour la femme) crée par un groupe de militantes pour promouvoir un programme très radical : éducation populaire, suffrage féminin, loi pour la recherche de paternité, égalité salariale entre les hommes et les femmes. Comme délégué, Maria a le profil idéal : elle est jeune ; elle est une des première femme médecin en Italie ; c’est une bonne oratrice » (p 35). En 1899, elle représente l’Italie au Congrès international de femmes à Londres. Cependant, après le grand choc qu’elle a subi dans sa vie personnelle, son activité en ce domaine ne se tarit pas. « Elle est en première ligne pour le droit de vote des femmes… Maria dit toujours ce qu’elle pense, y compris quand elle est en désaccord avec les positions de l’Eglise » (p 95).
Au cours de ces années, Maria Montessori reconstruit patiemment son insertion professionnelle. Ainsi, en septembre 1902, elle présente sa candidature pour enseigner l’anthropologie à l’université. « Elle imagine un cours où l’anthropologie serait appliquée à l’éducation, dans le but de fonder une pédagogie réellement scientifique. Au cœur de son projet se trouve un projet révolutionnaire : la classe comme laboratoire d’observation » (p 82).
Elle entreprend de nouvelles études à l’université. Et, à partir d’une nouvelle recherche, elle se qualifie pour enseigner l’anthropologie à la faculté des sciences (p 89). En 1906, elle est appelée à enseigner à la Scuola Pedagogica (École pédagogique) à Rome. « Dans le cours qui lui est confié, intitulé : « anthropologie pédagogique », Maria continue d’expliquer ses idées novatrices sur l’école : la classe laboratoire, l’enfant au centre, l’enseignant comme un scientifique qui observe ». Son inspiration spirituelle apparaît : « Ce qui fait véritablement un enseignant, c’est son amour pour l’enfant. Car c’est l’amour qui transforme le devoir social de l’éducation en conscience plus élevée d’une mission » (p 91).
L’invention montessorienne
Ainsi, à travers les expériences, les rencontres, les réflexions, la pensée de Maria Montessori a muri. Elle va pouvoir l ’exercer dans une expérience fondatrice, la création d’une école expérimentale dans un des quartiers les plus mal famés de Rome : San Lorenzo (p 101). En 1904, un organisme nouveau intervient dans ce quartier. Il fait assainir l’ensemble, achève la construction des immeubles, installe des fontaines. Il attribue les appartements et suit leur entretien. Cependant, dans la journée, en l’absence des parents, les immeubles restent aux mains des tout jeunes. « Abandonnés à eux-mêmes, ces derniers se déplacent en bandes et font des dégâts partout où ils passent » (p 102). Talamo, le directeur du plan de rénovation, « pense résoudre le problème en créant un réseau d’écoles maternelles où les jeunes enfants seront accueillis jusqu’au retour de leurs parents, du travail, et de leurs frères et sœurs plus âgés, de l’école ». Il demande à Maria Montessori de coordonner et de diriger ce projet. Elle accepte à condition de disposer d’une liberté totale. « Elle veut transformer le défi de San Lorenzo en une occasion d’expérimenter ses idées sur des enfants qui n’ont encore jamais été en contact avec l’école… En l’absence d’argent, l’école n’est pas organisée comme une école traditionnelle. Pas d’estrade, pas de pupitres, pas d’institutrices qui appliquent les principes appris à l’école normale. Cette école sera d’une nouveauté absolue, où Maria pourra tout structurer à sa manière. Elle décide d’appliquer la leçon de Seguin aux enfants normaux et d’observer ce qui se passe » (p 104).
En l’espace de quelques semaines, elle met le projet sur pied en s’appuyant sur différents courants de la société romaine. Le 6 janvier 1907, Maria Montessori inaugure la première école qui accueille une cinquantaine d’enfants de deux à six ans. C’est un grand jour. Inspirée, Maria évoque une parole biblique : « Lève-toi, sois éclairée ; car ta lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se lève sur toi » (Esaïe 60.1). L’école est au rez-de-chaussée de l’immeuble. Elle est formée d’une grande pièce, de sanitaires et d’une cour. Au début, elle est aménagée avec des meubles de récupération… Très vite, Maria fait fabriquer des meubles adaptés à la taille des enfants. « Chaque détail est pensé pour leur autonomie ». « Une amie de Maria, invitée à visiter l’établissement s’est écrié avec enthousiasme : « Mais c’est la maison des enfants ». Ainsi, nait le nom qui, en quelques années, fera le tour du monde et évoquera, à tous, la méthode Montessori » (p 106).
« Maria choisit la fille de la concierge comme institutrice. Elle lui dit de se contenter d’observer et de lui rapporter chaque événement. Elle veut que, dans ce laboratoire pédagogique, tout se révèle de manière naturelle… Les enfants doivent avoir une liberté de mouvement totale… ». « S’appuyant sur l’observation et sur son instinct, elle identifie chaque fois un nouvel élément » (p 107). Ainsi, un jour présentant aux enfants un nouveau né paisible et silencieux, elle les invite à un exercice de silence qui devient un des rituels de la maison des enfants. « Maria Montessori n’élève jamais la voix, elle n’impose pas son autorité. Elle s’assied et attend que les enfants viennent vers elle. Elle répète qu’il faut tout respecter chez eux, y compris le fait que leur corps leur appartient. (p 108). « Dans la Maison des enfants, le corps n’est pas seulement respecté, mais valorisé. Les enfants peuvent déplacer les chaises et les tables tout seuls et aller et venir dans la classe comme bon leur semble. A l’époque, cette approche est révolutionnaire. Maria a l’intuition, confirmée un siècle plus tard, que le mouvement fait partie du processus d’apprentissage » (p 109).
Pour reproduire le matériel de Seguin, Maria Montessori doit trouver les bons artisans. « C’est la première fois qu’elle utilise le matériel didactique avec ces enfants normaux. Les enfants normaux, eux, travaillent seuls. Cette différence représente une première innovation fondamentale vis-à-vis de Seguin » (p 110). « Elle adopte une position proche de celle d’une observatrice extérieure. Cela lui permet de revoir l’ensemble, de repenser la manière d’interagir avec les enfants. Cette étape cruciale la conduira très loin de Seguin, à une nouvelle approche de l’esprit enfantin. Elle montre le matériel et son fonctionnement aux enfants, elle les laisse travailler, tout en les observant ou mieux, comme elle aime le dire, en méditant… Peu à peu, les éléments de sa future méthode prennent forme… deux éléments centraux apparaissent : la nature différente du maître, qui dirige sans s’imposer et la nature différente de l’enfant qui travaille sans se fatiguer (‘Étudier n’use pas, ne fatigue pas, au contraire cette activité nourrit et soutient’) » (p 111). Elle découvre certains aspects de l’activité enfantine comme le rangement. La vie quotidienne entre dans la classe comme l’hygiène et le repas.
Sans cesse, Maria Montessori observe les enfants. Une réalité lui apparaît ; « Elle sent que les enfants recèlent une énorme capacité d’attention qui se manifeste dès qu’on lui place un cadre pensé pour eux et non pour les adultes. Grace à cet état particulier de son esprit, l’enfant apprend de manière plus profonde et définitive ». (p 115). Dès lors, « le pivot fondamental de l’éducation consiste à aider l’enfant à révéler sa véritable nature habituellement enfouie parce qu’elle est opprimée par une école pensée pour les adultes » (p 115). De fait, les enfants travaillent naturellement pour apprendre. Cet apprentissage est actif et intense. Ainsi, lorsque les enfants sont placés dans un environnement adapté, « ils cessent en peu de temps d’être agités et bruyants et se transforment en personnes paisibles, calmes, heureuses de travailler » (p 136). Un siècle plus tard, nous dit l’auteur, les neurosciences « confirment ces observations en identifiant « des fonctions exécutives » : contrôle inhibiteur, mémoire de travail, flexibilité cognitive (p136). Placé dans de bonnes conditions, plus personne n’a besoin de forcer l’enfant à se concentrer en classe. « Quand vous avez résolu le problème de la concentration de l’enfant, vous avez résolu le problème de l’éducation en entier » (p 136). C’est la voie d’une « auto-éducation ». L’auteure met en évidence la conjugaison d’une approche scientifique et d’une approche spirituelle chez Maria Montessori : « Sa conception métaphysique de la vie passe directement dans son approche de l’enfant, être spirituel par excellence, mais aussi dans son attitude en classe. Quand elle est avec les enfants, elle semble être en méditation, observatrice attentive à toutes les surprises… » (p 137).
La réussite de la Maison des enfants est saluée dans la presse. Maria Montessori poursuit le mouvement en créant une deuxième Maison des enfants. Elle choisit une jeune maitresse à laquelle elle donne le nom de directrice. Car elle demande à celle-ci « d’enseigner peu, d’observer beaucoup, et, par dessus tout, de diriger les activités psychiques des enfants et leur développement physiologique » (p 119). Par ailleurs, ce mouvement pédagogique est aussi un mouvement social. Ces écoles « participent à la libération des femmes qui travaillent ».
Dans les premières maisons des enfants, Maria Montessori ne s’est pas préoccupée de la lecture et de l’écriture parce que ces enseignements ont lieu à l’école élémentaire. « Ce sont les enfants de San Lorenzo qui, au bout de quelques mois passés à travailler avec le matériel sensoriel, en demandent plus. Ayant grandi dans un environnement analphabète, ils sentent que les mots écrits sont une clé pour leur avenir » (p 121). Maria développe une initiative. Elle fabrique des lettres mobiles en papier émeri. L’enfant peut suivre la lettre rugueuse du doigt, et ce faisant, il apprend le geste de l’écriture avant même de savoir ce qu’il signifie » (p 122). Les enfants de San Lorenzo accueillent les lettres rugueuses avec enthousiasme. Ils aiment crier le nom de chaque lettre. Ils passent des journées entières sur les lettres en carton. « Ils y travaillent pensifs, concentrés, suivant de leur doigt les lignes rugueuses, murmurant les sons à voix basses, mettant les lettres côte à côte » (p 122). A Noël 1907, deux mois après le début du travail avec les lettres rugueuses, il advient à San Lorenzo l’événement que Maria Montessori baptisera « l’explosion de l’écriture ». Un enfant invité à dessiner une cheminée avec une craie, poursuivit soudain en écrivant un mot. Un grand enthousiasme personnel, puis collectif, accompagna cette prise de conscience. La lecture vint donc en second. Selon Maria Montessori, l’apprentissage précoce de l’écriture représente seulement la partie émergée d’un processus bien plus large : la mise en lumière de la capacité naturelle d’auto-éducation des enfants quand ils se trouvent dans l’environnement adapté ». « L’explosion de l’écriture attire l’attention du monde et transforme en quelques années le système appliqué dans un quartier pauvre de Rome en un phénomène planétaire » (p 126).
Réception et diffusion
Aujourd’hui, la pédagogie Montessori est largement connue. Encore relativement peu pratiquée, elle gagne du terrain et, pour beaucoup, elle est source d’inspiration. La biographie de Maria Montessori, réalisée par Christina de Stefano nous permet de comprendre comment cette pédagogie a pu émerger dans une culture au départ peu propice, à travers l’œuvre pionnière d’une personne qui a initié à la fois une nouvelle pratique éducative et une nouvelle vision de l’enfant. Cette innovation, en rupture avec la culture dominante, constitue une « invention » sociale. C’est l’invention montessorienne. A partir de la création de la Maison des enfants de San Lorenzo, la diffusion de l’innovation va se poursuivre et s’étendre dans le monde entier à travers la diffusion de la vision et de la méthode par Maria Montessori. Ce livre se poursuit en relatant la campagne engagée par Maria Montessori pendant des décennies jusqu’à son décès en 1952.
Après un compte-rendu approfondi des chapitres montrant l’émergence de la pédagogie Montessori, nous nous bornerons à donner un bref aperçu de la campagne pour sa promotion à laquelle l’auteure consacre une bonne partie de ce livre.
Au cours des années, Maria Montessori a rencontré et attiré un grand nombre de personnes. Si bien que la troisième partie du livre est intitulé : « Le premiers disciples ». Et ce fut le cas en Italie et très vite à l’international. L’auteure nous décrit les éducatrices qui se sont engagées avec une passion militante. Maria anime un réseau. Elle y sera ensuite accompagnée par son fils Mario avec lequel elle a pu renouer une relation maternelle à partir de 1913 (le fils retrouvé : p 178-181). D’année en année, de pays en pays, les rencontres de Maria témoignent du potentiel d’attraction de l’idéal montessorien. Maria Montessori développe une œuvre de formation. Elle suscite la production d’un matériel éducatif. Cette dernière activité engendre parfois des conflits d’intérêt. Selon l’auteur, la forte personnalité de Maria Montessori peut lui attirer des reproches d’autoritarisme.
Le livre retrace un parcours international. L’action de Maria Montessori s’est exercée en Italie, et, pendant un temps, en Catalogne. Sa vision se répand dans le monde entier et elle est particulièrement bien accueillie dans certains pays. Ce fut le cas aux Etats-Unis durant un long séjour en 1914-1915, et à l’autre bout, en Inde, où elle réside pendant plusieurs années durant la seconde guerre mondiale.
Dans la poursuite de son action, Maria Montessori s’adapte aux différents terrains. Ainsi composa-t-elle avec le fascisme italien à ses débuts. Elle s’est impliquée dans la religion catholique pendant des années tout en gardant une distance vis-à-vis des conservatismes. Elle entretient des relations avec des personnalités très variées quant à leurs convictions philosophiques et religieuses. Dans certaines situations, elle recherche et conjugue les appuis de milieux différents, de congrégations catholiques à une franc-maçonnerie progressiste. Son grand voyage en Inde a été sollicité par le courant théosophique.
« Avec le temps, la vision de Maria Montessori s’élargit de plus en plus. Il ne s’agit plus seulement de changer l’école, mais aussi la société et donc le monde » (p 295). « Pendant les années 1930, Maria Montessori cesse d’être seulement une éducatrice, quoique géniale et très en avance sur son temps, pour devenir philosophe. » (p 297). « C’est à cette époque qu’elle commence à évoquer le concept d’éducation cosmique – éduquer à une vision d’ensemble grandiose, où chaque homme est lié aux autres et à la planète entière – qu’elle développe dans la dernière phase de sa vie » (p 295). « Son côté mystique n’a pas disparu, tant s’en faut, depuis qu’elle a renoncé à chercher le soutien des autorités catholiques. Il trouve d’autres voies d’expression, plus personnelles et plus libres et converge toujours vers une vision extrêmement respectueuse de l’enfant » (p 296). Sa foi chrétienne est toujours là : « Nous dépendons de l’enfant ; toute notre personnalité vient de lui. Plus que cela, il s’agit, pour ceux qui peuvent le comprendre, d’une réalisation chrétienne, car la supernature de l’enfant nous guide vers le Royaume de cieux. Premier citoyen de ce royaume, il le fut seulement dans les lignes de l’Evangile, sans que cela pénètre l’esprit, la conscience des chrétiens » (p 312).
Durant les dernières années, après un long séjour en Inde où elle fut accueillie comme « la Grande Âme », (p 302-304), elle s’établit aux Pays-Bas où elle continue à répondre aux sollicitations en provenance du monde entier.
Jusqu’à son départ, Maria Montessori est toujours en mouvement. Sur tous les plans, elle traverse et dépasse les frontières comme dans sa réponse à une question dans laquelle on lui demandait quelle était sa patrie : « Mon pays est une étoile qui tourne autour du soleil et qui s’appelle la terre » (p 315).
Au terme de cette lecture, on constate combien l’auteure de cette biographie, Christina de Stefano a su nous restituer le parcours de Maria Montessori dans sa dynamique et sa complexité. Elle a bien tiré parti « d’une correspondance inédite et de témoignages directs ». Elle nous rapporte une œuvre géniale tout en gardant son esprit critique. Ce livre est ainsi un ouvrage de référence sur Maria Montessori. Et dans une succession de chapitres courts, il se lit d’un trait.
Cependant, ici, nous avons centré notre analyse : mieux comprendre l’émergence de la pédagogie montessorienne. Nous pouvons suivre effectivement une maturation. L’éclosion de la « Maison des enfants est précédée par la redécouverte de Seguin par Maria Montessori et par ses expériences auprès d’enfants déficients. Elle est la résultante d’un engagement social précoce et constant. Elle témoigne d’un esprit d’observation qui s’inscrit dans un parcours scientifique.
Cependant la Maison des enfants est une innovation qui tranche avec la réalité éducative de l’époque. On y voit le surgissement d’une pratique éducative nouvelle. Cette pratique est la conséquence directe d’une nouvelle représentation de l’enfant, le fruit d’un état d’esprit propice à l’émerveillement et empreint de bienveillance et de respect. Ainsi, dans ces premières années, nous assistons à une véritable invention sociale.
On assiste là à un changement de regard. Ce changement permet de découvrir la vraie nature de l’enfant. C’est une vision psychologique et une vision spirituelle. Apprenons à observer, apprenons à regarder, apprenons à nous émerveiller.
J H
- Christina di Stefano. Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants. Les Arènes, 2022.
- Et si nous éduquions nos enfants à la joie ? Pour un Printemps de l’éducation. https://vivreetesperer.com/et-si-nous-eduquions-nos-enfants-a-la-joie-pour-un-printemps-de-leducation/
- Maria Montessori. L’enfant. Ce livre, fréquemment réédité est une belle introduction à la pensée de Maria Montessori. Il fut pour nous comme une révélation
- La pédagogie Montessori : https://www.montessori-france.asso.fr/page/155447-la-pedagogie-montessori-une-aide-a-la-vie
- Pour une éducation nouvelle, vague après vague : https://vivreetesperer.com/pour-une-education-nouvelle-vague-apres-vague/ Libérer le potentiel du jeune enfant dans un environnement relationnel : https://vivreetesperer.com/liberer-le-potentiel-du-jeune-enfant-dans-un-environnement-relationnel/
- L’enfant : un être spirituel : https://vivreetesperer.com/lenfant-un-etre-spirituel/
- Éducation et spiritualité : https://vivreetesperer.com/education-et-spiritualite/
- Godly play : Une nouvelle approche de la catéchèse : https://www.temoins.com/godly-play-une-nouvelle-approche-de-la-catechese/
- Welcome to DoBeDo. Re-enchanting life through stories, relationship, playfulness and openness to change : https://www.do-be-do.org/
par jean | Juin 4, 2023 | Hstoires et projets de vie |

Selon Michelle Obama
Dans ce monde difficile et incertain, nous avons besoin de points de repère. Ce sont des personnalités dont nous sentons qu’elles peuvent nous inspirer à travers leur honnêteté, leur bienveillance, leur générosité. Parfois de telles personnalités sont particulièrement visibles à travers un rôle éminent dans la vie sociale et politique. Nous pensons à Barack Obama dont nous avons rapporté ici l’autobiographie (1). Mais sa femme, Michelle, qui l’a accompagné lors de sa présidence des États-Unis, apparaît également comme une personnalité remarquable. Elle a déjà relaté son parcours dans un livre : « Devenir » (2), mais dans son nouvel ouvrage : « Cette lumière en nous. S’accomplir en des temps incertains » (3), elle nous invite à une réflexion à partir de son expérience pour nous aider à affronter les obstacles, à grandir et à poursuivre un chemin de vie.
Et elle peut s’adresser à nous à partir de son parcours. (4). Née en 1964 à Chicago, elle grandit avec ses parents et son grand frère dans un quartier afro-américain de la ville. Elle est portée par un climat familial chaleureux et respectueux. « Dès son plus jeune âge, ses parents lui apprennent à faire entendre sa voix ». A 24 ans, elle est diplômée de la prestigieuse faculté de droit d’Harvard. Elle entre dans un cabinet d’avocat où elle reçoit, comme stagiaire, Barack Obama. Cette rencontre débouche sur leur mariage en 1992. Ensemble, ils auront deux filles. Le 4 novembre 2008, Barack Obama est élu président des États-Unis et elle est la première afro-américaine « première dame » des États-Unis.
Comme jeune fille noire, elle a du faire face à de nombreuses humiliations. De plus, elle évoque sa grande taille qui ne la servait pas. A partir de cette expérience, elle est qualifiée pour nous apprendre à faire face aux rebuffades et à développer persévérance et confiance. « Au fil des ces pages », nous dit-elle, « il sera question de trouver son pouvoir personnel, un pouvoir collectif et le pouvoir de surmonter les sentiments de doute et d’impuissance. Je ne dis pas que tout ça est facile… J’ai passé des décennies à apprendre de mes erreurs, à faire des ajustements et à modifier mon cap en cours de route » (p 27). Elle nous apprend à nous accepter et à reconnaitre notre potentiel. « J’ai appris que l’estime de soi et la vulnérabilité n’étaient pas incompatibles, bien au contraire, et que les êtres humains avaient tous au moins une chose en commun : nous aspirons à mieux, en toute circonstances et à tout prix. On devient plus audacieux dans la lumière. Connaître sa lumière, c’est se connaître soi-même ; c’est porter un regard lucide sur sa propre histoire. La connaissance de soi engendre la confiance en soi, qui nous permet d’être plus sereins et de prendre du recul. C’est ainsi que nous pouvons nouer des relations authentiques avec les autres… La lumière se transmet. Une famille forte donne de la force à d’autres familles. Une communauté engagée éveille chez les autres le désir de s’impliquer. Tel est le pouvoir de la lumière qui est en nous » (p 28).
Ainsi, le partage de cette expérience peut être bienfaisant et inspirant pour beaucoup, d’autant qu’aujourd’hui, en ces temps de crise, l’inquiétude s’est répandue et le questionnement s’est généralisé. « A l’origine, j’avais conçu ce livre pour proposer un accompagnement aux lecteurs qui traversaient de grands bouleversements, un ouvrage que j’espérais utile et réconfortant pour quiconque entamait une nouvelle phase de sa vie, qu’il s’agisse de la fin des études, d’un divorce, d’un changement de carrière ou d’un diagnostic médical, de la naissance d’un enfant ou de la mort d’un proche… » (p 29). Cependant, aujourd’hui, nous sommes tous entrés dans une période de tempête en percevant les échos de l’épidémie, de la guerre, des troubles politiques. Alors, Michelle Obama nous invite à nous poser « des questions plus pragmatiques sur la façon de rester debout au milieu des défis et des changements : Comment s’adapter ? Comment se sentir plus à l’aise, moins paralysés face à l’incertitude ? Quels outils avons-nous pour nous aider ? Où trouver des soutiens ? Comment créer de la sécurité et de la stabilité ? Et, si nous unissions nos forces, que pourrions-nous réussir à surmonter ensemble ? » (p 31).
Comment donc ce livre est-il conçu ? « Il n’existe pas de formule. Ce que je peux vous proposer, c’est de vous offrir ma propre boite à outils… Certains de mes outils sont des habitudes et des pratiques, d’autres sont véritablement des objets physiques ; et le reste consiste en une panoplie d’attitudes et de convictions issues de mon parcours et de mes expériences personnelles, de mon propre « devenir » toujours en cours. Ce livre ne prétend pas être un mode d’emploi. Vous y trouverez plutôt une série de réflexions honnêtes sur ce que la vie m’a enseigné jusqu’ici, sur les béquilles qui m’aident à tenir. Je vous présenterai certaines des personnes qui me maintiennent debout et partagerai avec vous les leçons que j’ai apprises auprès de femmes exceptionnelles pour faire face à l’injustice et à l’incertitude. Je vous parlerai des choses qui continuent à me mettre par terre et de celles sur lesquelles je m’appuie pour me relever. Je vous confierai aussi certaines attitudes dont je me suis débarrassée avec le temps ayant fini par comprendre qu’il fallait faire le tri entre outils et défenses, les premiers étant bien plus utiles que les secondes » (p 26).
« Ce livre se déroule en trois parties : la première évoque le processus qui permet de puiser de la force et de la lumière en soi ; la seconde évoque notre relation aux autres et la notion de bien-être affectif ; la troisième a pour but d’ouvrir une discussion sur les manières de mieux nous approprier, protéger et renforcer notre lumière, notamment dans les périodes difficiles » (p 27).
Manifester sa présence
Ce livre foisonne en de multiples propos et se prête peu à une analyse méthodique. A titre d’exemple, nous choisissons donc ici un des chapitres : « Suis-je visible ? », pour témoigner de l’actualité et de la pertinence du sujet et de l’authenticité de l’expérience ainsi rapportée.
Si on est confronté à des attitudes de domination et à la pression du conformisme, on hésite bien sûr à apparaître. On se tient prudemment en retrait. On comprend ainsi la question : « Suis-je visible ? ». De par son parcours, Michelle Obama est bien placée pour en parler. « Partout où je vais, je rencontre des gens qui me confient avoir du mal à être acceptés en tant qu’individus à part entière, que ce soit à l’école, au travail, ou au sein d’un groupe plus large. C’est un sentiment que j’ai connu et avec lequel j’ai du composer pendant la majeure partie de ma vie » (p 105).
Les motifs du ressenti de non acceptation peuvent être très divers. Ainsi, dans son enfance et dans son adolescence, ce fut pour Michelle, l’impression que sa grande taille physique la mettait à part. « Dans mon quartier, être noir n’avait rien de remarquable. A l’école, je fréquentais des enfants de tous milieux et cette diversité créait un environnement où nous pouvions être pleinement nous-même. En revanche, j’étais grande. Et il a fallu que j’apprenne à m’en accommoder. On ne voyait que ça. On m’a collé cette étiquette très tôt et je n’ai jamais pu m’en débarrasser… » (p 106). Elles ressent par exemple les appels à l’école où on classe les enfants : « les petits derrière, les grands devant ». Cela lui donne « l’impression d’être publiquement reléguée à la marge ». « Cette apparente disgrâce a créé en moi une blessure infime, une petite graine de détestation de soi qui m’empêchait de voir mes atouts » (p 106). « Rétrospectivement, j’ai compris que je m’adressais deux messages simultanés particulièrement toxiques lorsqu’ils sont associés : « Je ne suis pas comme les autres » et « Je ne compte pas » (p 107). A l’époque, le sport féminin n’était pas aussi développé qu’aujourd’hui et ne lui offrait pas une voie d’affirmation.
Cependant, le ressenti de la différence comme source de rejet s’inscrit généralement dans une dimension sociale. Aux États-Unis, la discrimination vis-à-vis de la communauté afro-américaine prend des formes diverses. Michelle Obama évoque le cas « d’un certain nombre d’amies qui ont grandi dans des banlieues blanches aisées… La plupart racontent que leurs parents ont fait le choix de les élever dans des quartiers où les écoles publiques étaient bien dotées… ». Mais, il y avait alors une contrepartie. Ces enfants pouvaient se ressentir comme une exception. L’auteure nous raconte ici le cas d’Andrea. Comme fillette noire, « Elle a commencé à ressentir des flottements autour d’elle, dès son plus jeune âge… Cela n’a pas empêché Andrea de se faire des amis qui l’aimaient pour elle-même et d’avoir une enfance heureuse, simplement elle a été consciente de sa différence très tôt. Et elle a vite appris à décrypter les signaux lui rabâchant qu’elle n’était pas à sa place, à déceler les non-dits lui indiquant qu’elle était une intruse dans sa propre ville » (p 117). Ce sont là des blessures qui ont laissé des traces.
Michelle Obama a grandi dans un quartier où elle se sentait chez elle. « De ce fait, jusqu’à mes 17 ans, je n’ai jamais été « l’exception ». C’est à l’université que j’ai découvert cette forme d’invisibilité paradoxale ». Princeton est une prestigieuse université américaine dans un site magnifique. Mais Michelle s’y retrouvait dans un « environnement peuplé majoritairement de jeunes hommes blancs ». Elle a pu cependant trouver un lieu convivial dans un « centre multiculturel où se réunissaient les étudiants non blancs ». Dans ce milieu, il était possible d’exprimer des expériences de discrimination, de les comparer. « Nous n’étions pas fous. Ce n’était pas simplement dans notre tête. Le sentiment d’exclusion et d’isolement… n’était pas une vue de l’esprit. Et ce n’était pas non plus la conséquence d’une déficience ou d’un manque d’effort de notre part. Nous n’imaginions pas les préjugés qui nous rejetaient aux marges. C’était réel » (p 123). Ce sentiment étant présent et répandu, une question apparaît : « Qu’en faire ? ».
« Notre père dont les tremblements et la claudication attiraient parfois l’attention des passants dans la rue, nous disait toujours avec un haussement d’épaules : « Aucune critique ne peut vous atteindre si vous êtes en accord avec vous-même » (p 123). Michelle nous fait un portrait de son père. « Mon père ne se souciait pas du regard des autres. Il était bien dans sa peau. Il connaissait sa propre valeur et il était équilibré mentalement à défaut de l’être physiquement » (p 123). Le père de Michelle avait été lui aussi confronté à l’arbitraire. « Il n’avait jamais eu les moyens de faire des études supérieures. Il avait subi les politiques discriminatoires du logement et de l’éducation ». Mais il a refusé de s’engager dans l’amertume. « Il avait appris que, dans certaines circonstances, savoir ignorer les vexations et laisser couler était une force. Il était conscient de l’injustice, mais ne voulait pas céder au désespoir… Il a préféré nous inciter, mon frère et moi, à nous intéresser au fonctionnement du monde, et nous parler d’égalité et de justice » (p 124). Il savait mesurer sa valeur sur ce qu’il avait et non sur ce qu’il n’avait pas. « Le regard qu’on porte sur soi est déterminant. C’est la base, le point de départ pour changer le monde autour de soi. Voilà ce qu’il m’a appris. L’équilibre de mon père m’a aidée à trouvé le mien » (p 125).
« Aucune critique ne peut vous vous atteindre si vous êtes en accord avec vous-même ». Michelle nous raconte comment elle a évolué dans sa manière de penser et de se comporter. « On pourrait dire que tout a commencé par l’acceptation… Peu à peu, j’ai compris que si je voulais changer la dynamique des lieux que je fréquentais, pour moi-même et ceux qui me suivraient, si je voulais qu’ils accueillent plus largement la différence, que chacun s’y sente à sa place, je devais d’abord trouver en moi la fierté et l’aplomb nécessaires. Au lieu de cacher qui j’étais, j’ai appris à le revendiquer… Je devais m’entrainer à être à l’aise avec ma peur. C’était ça ou renoncer. La vie de mon père m’avait enseigné une chose : on fait avec ce qu’on a. On se forge des outils, on s’adapte et on avance. On persévère, en dépit de… » (p 106).
L’auteure nous rapporte des incidents révélateurs de mentalités imprégnées par une pensée d’exclusion. Ainsi Stacey Abrams, aujourd’hui femme politique, rapporte que major de sa promotion de lycée en 1991, elle fut invitée à une réception du gouverneur de Géorgie, et que s’y rendant avec ses parents, elle fut l’objet d’un rejet par un agent de sécurité. Elle parvint à passer parce que ses parents avaient parlementé, mais ce fut là un souvenir cuisant. « De tels messages ont un pouvoir annihilateur, surtout s’ils s’adressent à un sujet jeune dont l’identité se construit… » (p 132). L’auteure rapporte également « la légèreté avec laquelle une conseillère d’orientation, au lycée, a balayé ses ambitions au bout de dix minutes d’entretien, insinuant qu’il était inutile que je postule à Princeton, car, à ses yeux, je n’avais pas « le profil » adéquat » (p 132). « On ne perçoit pas toujours la portée de ce genre de message, c’est pourquoi il faut être attentif à la manière dont ils sont formulés et reçus. Les enfants et les adolescents désirent qu’on reconnaisse la lumière qui est en eux. Ils en ont besoin. C’est ce qui les aide à grandir. Et si on leur fait sentir qu’ils sont invisibles, alors ils trouveront d’autres moyens moins productifs de se faire remarquer » (p 133). Michelle Obama revient sur ceux qui ont fait barrage. Elle les perçoit comme « des figurants dans les récits plus vastes et plus intéressants qui témoignent de notre place dans ce monde. Leur seul pouvoir, au bout du compte, est de nous rappeler pourquoi nous persévérons » (p 135).
Pourquoi ce livre ? Les intentions de Michèle Obama
Quelles étaient les intentions de Michelle Obama en écrivant ce livre ? Elle nous répond dans une interview exclusive sur Brut où elle échange avec l’autrice Leïla Slimani (5).
Comme l’intervieweuse remarque que, dans son livre, elle n’hésite pas à exprimer combien elle a pu connaitre des angoisses et des doutes, et à montrer « la femme derrière l’icône », Michelle Obama répond que c’est là une manifestation « d’authenticité et de vulnérabilité ». « Parfois, il est facile de se dire que quand on est perçu comme un modèle, on doit avoir toutes les réponses, on ne doit montrer aucune faiblesse, mais je crois que c’est placer la barre trop haut à un niveau impossible à atteindre pour les personnes qui vous admirent et en fait ce n’est pas vrai. Nous souffrons tous de la peur. Nous traversons tous ces épisodes dépressifs. Nous nous demandons tous si nous sommes à la hauteur. Dans mon cas, le fait de l’admettre, c’est le « code source » de ma puissance. Comment mes différences et ma singularité ont fait de moi celle que je suis, plutôt que de chercher à les cacher, plutôt que de porter un masque de la perfection ».
Cependant que penser d’un rôle modèle ? Comment envisager cette notion de modèle ? Michelle Obama répond que les femmes qui sont présentes sur la scène publique ont une responsabilité. Comme femme noire, elle est singulière. Elle fait partie de femmes qui se sentent marginalisées comme si elles n’avaient pas de chemin bien défini à suivre parce qu’elles n’ont pas de modèles… Elle veut donc contribuer à « réécrire l’histoire qui est laissée de côté pour imposer notre image ». C’est permettre à des jeunes de se dire : moi aussi, je peux y arriver.
Des questions sur différents thèmes lui sont ensuite adressées. Et, comme elle a écrit un chapitre sur l’amitié, et que l’amitié tient une grande place dans sa vie, Leila Slimani lui demande d’en parler. Michelle Obama répond qu’elle a été surprise par le nombre de lecteurs qui ont réagi à ce chapitre «parce que beaucoup d’entre eux disaient qu’ils n’avaient pas d’amis ». Ainsi, en parlant à des femmes sur-occupées par leur activité professionnelle et leur responsabilité familiale, elle a constaté qu’elles n’avaient pas pu donner une priorité à l’amitié, et alors, « on se réveille un jour sans amis ». « Ma communauté de soutien a toujours été essentielle pour moi. Je la décris comme ma « table de cuisine ». J’ai choisi cette métaphore parce que, quand j’étais petite et que je vivais dans les quartiers sud de Chicago, la table de cuisine était l’endroit où tout le monde se réunissait dans notre petit appartement. C’est là qu’on réglait tous nos problèmes pendant que ma mère préparait le diner. C’est là que mes amies venaient pendant la pause déjeuner pour parler des soucis de la journée. C’est un endroit où on pouvait retirer son masque et être complètement soi-même… C’était un espace de confiance où on pouvait partager ses expériences, baisser le masque et être relevée, guérir des blessures du monde… C’est fondamental… Je pense qu’on ne peut pas tenir pour acquise cette communauté, qu’il faut la construire. On ne doit pas perdre cette habitude pas seulement de tisser des amitiés, mais de les entretenir dans la durée ».
L’intervieweuse pose une dernière question sur la devise proclamée par Michelle Obama à la convention démocrate de Philadelphie en 2016 : « Quand ils s’abaissent, nous nous élevons ». C’est un appel à la dignité et au courage, mais certains s’impatientent et se radicalisent. « Comment continuer à nous battre dans la dignité ? ». Michelle Obama répond qu’elle s’en est expliquée dans un chapitre. « Une devise n’est rien sans action. S’élever ne veut pas dire être complaisant… Pour moi, s’élever, c’est passer de la rage à l’action… Je cite John Lewis… « La liberté, ce n’est pas un état, mais un acte. Ce n’est pas un jardin enchanté… Il faut travailler intelligemment et prévoir stratégiquement. C’est comme cela que le mouvement des droits civiques a fonctionné. On parle toujours de la marche de Washington, mais la marche de Washington n’était que la cerise sur le gâteau. Il y avait des projets pour changer les lois. Il y avait des boycotts qui ont duré des années… ». Michelle Obama parle d’« une action à long terme où on cherche à savoir quel sera le résultat final de nos actions. Vont-elles ouvrir l’esprit des gens, les amener à mieux me comprendre ou vont-elles les amener à me craindre davantage ? J’explore cela d’une façon très détaillée ». Les générations actuelles peuvent s’interroger sur la vitesse du changement. « Mais, au final, je crois que l’intégrité, la dignité, la patience, la détermination, la préparation sont les clés et qu’elles ne passeront jamais de mode ».
Notre condition sociale comme les circonstances de la vie peuvent nous avoir courbé, étouffé, humilié. Une prise de conscience se généralise aujourd’hui. Cette situation n’est pas inéluctable. Il y en nous un potentiel qui peut se mobiliser. Michelle Obama nous appelle à découvrir cette force latente, en découvrant « la lumière en nous ».
Parce qu’elle-même a connu des situations dans lesquelles elle a été méconnue, et, en particulier, celle d’une jeune fille noire confrontée aux préjugés ambiants, elle peut écrire à partir de son expérience. Son expression authentique, sincère, contraste avec des approches plus convenues. Ainsi s’opère une rencontre avec lectrices et lecteurs. Un courant passe qui engendre la confiance. Ce livre suscite une prise de conscience libératrice. La parole de Michelle Obama porte d’autant plus qu’avec ses deux filles, elle a partagé la vie de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis.
Sur ce blog, nous avons suivi différents épisodes de cette présidence (1). Dans une histoire longue, la présidence de Barack Obama s’inscrit dans un mouvement d’émancipation et de solidarité qui a connu des étapes marquantes comme la lutte pour les droits civiques menées par Martin Luther King. On peut y voir une inspiration chrétienne telle qu’on peut la percevoir notamment dans le titre des mémoires de Barack Obama : « Terre promise » (1). En s’adressant à un grand public, la tonalité du livre de Michelle Obama nous paraît plus psychologique dans une forme où s’allie l’expérience et le bon sens et où s’exprime une dynamique de vie.
J H
- Barack Obama. Une Terre promise. Fayard, 2020. Compte-rendu avec un rappel des liens à différents articles sur ce blog portant sur différents épisodes et différentes facettes de cette présidence.
- Michelle Obama. Devenir. Fayard, 2018
- Michelle Obama. Cette lumière en nous. S’accomplir en des temps incertains. Flammarion, 2022
- Michelle Obama. Une vie. Brut You Tube : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=Michelle+Obama++Brut&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:deef07ed,vid:3ttPTHXihrQ
- Interview exclusive de Michelle Obama sur Brut : https://www.youtube.com/watch?v=cv7tEPpJk9o
par jean | Juin 1, 2022 | Hstoires et projets de vie |
 D’aide soignante à infirmière
D’aide soignante à infirmière
Une vie au service du care et de la santé
Mon père était médecin vétérinaire. Et, toute petite, je savais qu’il soignait les animaux. Moi, je me suis dit : Je ferai plutôt le métier d’infirmière. Et alors, je pourrai avoir des moments d’échange avec mon père sur le fait de soigner et sur l’évolution de la médecine. J’avais huit ans.
Plus tard, à 16 ans, pendant les trois mois de vacances, à la suggestion de ma tante, j’ai fait des stages bénévoles dans un dispensaire. Le matin, avant la tournée des religieuses soignantes, j’attirais l’attention des malades sur les précautions à prendre au niveau de l’hygiène. Déjà à cette époque, je participais à la prévention, par exemple en incitant les gens à avoir des moustiquaires pour faire face au paludisme.
Dans l’enseignement secondaire, j’ai fait des études en économie sociale et familiale (ESF). Dans ce cadre, je faisais également des stages. Je n’ai pas obtenu mon baccalauréat et je suis rentré directement dans la vie active. J’ai travaillé comme caissière dans une boulangerie. J’ai ensuite travaillé pendant dix huit mois dans le secteur santé de la garnison militaire de Yaoundé. Mes activités étaient très diverses : pansements ; participation à des consultations et même des accouchements ; un mois en réanimation…
Par la suite, je voulais entrer dans l’armée pour exercer dans le service de santé. Mes parents s’y sont opposés.
J’ai donc travaillé pendant cinq ans dans les cabines téléphoniques avec option conciergerie.
En 2002, je me suis mariée et j’ai rejoint mon mari en France en 2003. J’ai fait des petits boulots : garde d’enfant, femme de chambre.
D’aide soignante à infirmière
En arrivant en France en 2003, j’ai donc travaillé comme femme de chambre pendant cinq ans pour financer une formation d’aide soignante que j’ai suivi pendant dix mois. J’ai approfondi le coté relationnel qui était déjà ancré en moi, mais dont j’ai mieux compris l’application. Cela m’a conforté dans la vocation de soignante que j’avais depuis l’enfance. J’ai commencé à travailler dans les hôpitaux, en chirurgie viscérale en l’occurrence. Cela m’a permis d’asseoir mes connaissances pendant douze ans. Ensuite, j’ai voulu évoluer dans ma carrière professionnelle.
C’est alors que j’ai suivi une formation d’infirmière pendant trois ans. J’ai obtenu mon diplôme d’état d’infirmière en mars 2021.
Au départ, j’ai eu des difficultés, car je n’avais pas suivi d’études depuis longtemps. La formation d’infirmière est très variée et donc j’ai appris beaucoup de choses. Combiner la formation pratique et la formation théorique m’a beaucoup apporté. J’ai eu des difficultés dans le domaine de l’enseignement de la psychiatrie, parce que, au départ, j’associais ces troubles à la folie. J’avais du mal à prendre en charge ces personnes, mais au bout de la troisième semaine, j’ai réussi à surmonter cette difficulté avec l’aide du psychiatre.
Depuis le mois d’avril 2021, j’ai commencé à travailler dans un ephad et dans un hôpital.
Une vie au service du care et de la santé.
J’aime ma profession et je l’exerce de tout mon cœur. Quand je me lève le matin, j’ai le sentiment que je vais me rendre utile. Je demande à Dieu de m’utiliser comme un instrument entre ses mains, au service de ses créatures.
Pour moi, être infirmière, c’est être dans une écoute active, avoir de l’empathie, tout en étant authentique. Et, en retour, je reçois de la sympathie et de la bienveillance.
Dans les longues journées que je passe avec les patients, je trouve cette relation bénéfique. De par ma culture africaine, le respect, la proximité, l’intimité sont des éléments fondamentaux. Quand dans un ephad, un ainé me parle, je prends l’attitude de me taire et d’écouter. Cela me permet de donner une réponse. Je suis donc dans une attitude d’écoute active dans laquelle je mobilise mes connaissances et puis ainsi apporter une réponse adaptée. Je continue à apprendre constamment.
Les journées sont souvent longues et épuisantes, mais, en fin de parcours je me réjouis d’avoir été au service de personnes vulnérables et de leur avoir apporter, outre les soins, réconfort et soutien.
Cela donne un sens à ma vocation de soignante, ce que j’ai toujours voulu faire. C’est un accomplissement de ma vie selon tout ce que je crois : un ordre divin qui, par mon entremise, prend soin de ses créatures.
S T Y A