par jean | Avr 6, 2015 | ARTICLES, Hstoires et projets de vie, Société et culture en mouvement |
 Pour un nouveau vivre ensemble.
Pour un nouveau vivre ensemble.
La France traverse aujourd’hui un passage difficile. Affectées par un chômage massif, des populations sont affectées par le précarité et le mal être. Les frustrations engendrent l’agressivité et la défiance. Dans un univers mondialisé, le manque de point de repères, la perte de cadres de vie stables, une fragmentation du tissu social engendrent l’insécurité qui se mue en crainte de l’autre, en peur de l’étranger. Tout est donc aujourd’hui en question : une économie qui peine à se renouveler, mais aussi les séquelles d’un passé, celui d’un pays hiérarchisé, marqué par la longue opposition des deux France issues de la Révolution française. Des personnalités et des associations viennent d’appeler à une mobilisation pour une société plus fraternelle (1). C’est une juste intuition. Sans vision, un peuple meurt (2). Pour permettre le vivre ensemble, nous avons besoin de référents nouveaux en terme de valeurs et de récits, et de pratiques nouvelles en terme d’attitudes et de comportements.
Mais nous dira-t-on, dans les conditions actuelles, appeler à la fraternité, en promouvant une dynamique, n’est ce pas faire preuve d’un idéalisme éthéré ? On peut déjà répondre. La fraternité n’est pas un simple supplément d’âme, c’est une inspiration qui, en fin de compte, fonde la vie sociale. En effectuant pour cet article, une recherche documentaire sur internet, nous avons visionné une courte vidéo qui relate la fête de la fraternité organisée par Ségolène Royal, le 29 septembre 2008 (3). Le temps était dur puisque la crise économique venait d’éclater. Cette fête était mal perçue dans les arènes politiques. C’était une initiative à contre courant. C’était un pari d’espérance et aujourd’hui on peut en redécouvrir le caractère pionnier. Nous avons noté ainsi cette parole de Ségolène Royal : « On commence à comprendre qu’il faut changer radicalement de système autour de la fraternité. La fraternité pour moi, c’est encore mieux que la solidarité parce que c’est la fraternité qui la fonde et qui lui donne le sentiment d’humanité sans lequel la politique serait un simple métier sans âme, une simple transaction entre des intérêts bien compris. Parce que ce qui arrive de mauvais à l’autre où qu’il soit, finit par générer quelque chose de mauvais pour soi-même et aussi parce que ce qui arrive de bon à l’autre, finit par créer du bonheur chez soi ».
Si notre société traverse aujourd’hui un passage difficile, l’appel à la fraternité témoigne d’une prise de conscience qui s’appuie sur la vitalité du tissu associatif et humanitaire en France, mais qui s’inscrit aussi dans un mouvement en profondeur à l’échelle internationale.
Ces évolutions en cours sont parfois bien visibles. D’autres sont en germination comme des « signaux faibles » (4) qui demandent attention. Dans son livre : « Chemin de guérison » (5), Frédéric Lenoir traite des différentes étapes de l’individualisme dans les sociétés modernes. Après la montée de l’autonomie dans des sociétés encore structurées, on est entré pendant quelques décennies dans une période où s’est affirmé un individualisme égocentré. Aujourd’hui, une nouvelle phase apparaît : de plus en plus, l’exercice de l’autonomie s’inscrit dans un désir croissant de relation, d’interrelation. Des études sociologiques mettent en évidence le développement d’une culture nouvelle où la convivialité est désormais une pratique et une aspiration. Ainsi apparaît la notion de « Tiers lieu », un espace nouveau entre la vie institutionnelle et la vie privée. Des milieux conviviaux et informels apparaissent dans différents domaines (6), dans une dynamique internationale. Ce mouvement se répand et il y a aujourd’hui sur facebook, un groupe intitulé : « Tiers lieu. Open source » (7). Dans le contexte du web qui permet le partage à grande échelle, dans les années récentes en France, à partir de nombreuses initiatives, un mouvement en faveur de l’économie collaborative (8) grandit rapidement. On peut ainsi apprécier l’essor rapide d’une communauté comme « OuiShare » (9). Cependant, il semble bien que les esprits bougent à tous les niveaux. Ainsi les sciences humaines sont plus attentives aux sentiments altruistes (10). La notion d’empathie, bien mise en évidence dans un grand panorama historique et sociologique de Jérémie Rifkin (11) gagne du terrain dans les consciences. Ces différents signes témoignent d’une évolution dans l’esprit du temps. Voici un contexte favorable pour la réception d’un appel à la fraternité.
« Dimanche 11 janvier s’est exprimée dans un immense élan collectif la prise de conscience qu’une société désunie est une société désarmée. Mais ce mouvement, pour être durable, doit s’organiser et impliquer chacun d’entre nous, bien au delà de notre conception actuelle de la démocratie qui privilégie l’action politique en négligeant l’action citoyenne. C’est pourquoi si l’on ne veut pas décevoir, le moment est venu de changer de paradigme en faisant de l’action politique le levier de l’action citoyenne comme nous y invite le pacte républicain qui projette la liberté et l’égalité vers la fraternité… C’est pourquoi nous appelons les plus hautes autorités de l’Etat, mais aussi les responsables locaux à affirmer avec force leur intention d’inscrire le volet fraternité de la République dans leurs toutes premières priorités… L’objectif est notamment de favoriser toutes les dynamiques individuelles, associatives et institutionnelles aptes à construire de nouvelles relations d’écoute, d’entraide et de respect entre les cultures, les âges et les territoires… Pour illustrer au plus vite cette ambition, il pourrait par exemple, comme le propose également l’observatoire de la laïcité, être organisé dès cette année, une semaine nationale de la Fraternité… » (1). On lira avec un particulier intérêt la liste des premiers signataires qui témoigne d’une grande diversité des participants et d’un engagement important du mouvement associatif dans ses différentes composantes (12).
Dans le même esprit, le journal « Libération » à publié une tribune (13) de deux personnalités : Abdennour Bidar, philosophe, spécialiste de l’Islam et Patrick Viveret, philosophe et sociologue. Ce texte va plus loin dan une analyse philosophique et spirituelle de l’enjeu. « Le défi de notre société est de se donner à elle-même un grand cap, un horizon d’espérance et d’action collective, une direction porteuse d’un véritable projet de civilisation et d’une véritable vision de l’homme. Au beau milieu de tous ces gouffres qui s’élargissent, un abime plus immense encore s’est ouvert qui menace de nous engloutir tous : celui de la différence entre les conceptions du sacré… Nous devons tout faire pour apprendre d’urgence à cultiver ensemble le sens et la jouissance concrète d’un sacré partageable. D’un sacré constitué et enrichi par tous nos héritages, que l’on soit croyant ou non croyant. Notre chance est que ce sacré partageable a déjà un premier nom, un visage dessiné, celui de la fraternité… La fraternité est une valeur républicaine et une valeur religieuse et une valeur ancienne et une valeur moderne, et une valeur à réinventer, dont il faut avoir enfin collectivement l’audace ».
Comment vivre ensemble entre êtres humains ? A travers l’histoire, on peut observer la mise en oeuvre de l’inspiration de l’Evangile telle que Michel Clévenot nous la rapporte dans sa série historique : « Les hommes de la fraternité » (14). Si, en Occident, le thème de la liberté a été moteur, aujourd’hui il mérite d’être explicité. Sur ce blog (15), le théologien Jürgen Moltmann nous fait entrer dans une dimension plus vaste de cette valeur. « Dans une perspective historique, on constate que la liberté s’est affirmé fréquemment en terme de lutte pour le pouvoir. Il y a des vainqueurs et des vaincus. Cela a été le cas dans la société antique. La liberté apparaît comme une « maîtrise ». Celui qui comprend la liberté comme maîtrise ne peut être libre qu’au détriment des autres hommes… Au fond, il ne connaît que lui-même et ce qu’il possède. Il ne voit pas les autres comme des personnes… » . Mais la liberté peut être conçue différemment comme participation. « C’est le concept de la liberté communicative. C’est dans l’amour mutuel que la liberté humaine trouve sa réalité. Je suis libre et me sens libre lorsque je suis respecté et reconnu par les autres et lorsque, de mon côté, je respecte et reconnais les autres… Si je partage ma vie avec d’autres, l’autre n’est plus la limite, mais le complément de ma liberté… La vie est communion dans la communication. Nous nous communiquons mutuellement de la vie… ». C’est bien là que la liberté rejoint la fraternité. Il y a des moments de l’histoire française où la fraternité a été prise en compte. Ce fut le cas en 1848. Aujourd’hui, c’est la tempête en politique, mais nous sommes appelés à voir plus loin. L’appel à la fraternité est un point de repère qui se manifeste à partir de la société civile comme une aspiration à un autre genre de vie et comme une interpellation au monde politique pour une autre manière de faire société.
J H
(1) Appel : Maintenant, construisons la fraternité : http://odas.net/IMG/pdf/appel_fraternite_2015_-.pdf
(2) Proverbes 29.18
(3) Sur youtube : Fraternité avec Ségolène Royal : https://www.youtube.com/watch?v=sOx5i95wPGM
(4) Sur wikipedia : « En intelligence économique, les signaux faibles sont les éléments de perception de l’environnement, opportunités ou menaces qui doivent faire l’objet d’une attention anticipative, appelé veille.. » http://fr.wikipedia.org/wiki/Signaux_faibles
(5) Frédéric Lenoir. Chemin de guérison. Fayard, 2012
Sur ce blog : « Un chemin de guérison pour l’humanité » : https://vivreetesperer.com/?p=1048
(6) « Emergences d’espaces conviviaux et aspirations contemporaines. Troisième lieu (« Third place ») et nouveaux mode de vie » : http://www.temoins.com/evenements-et-actualites/recherche-et-innovation/etudes/emergence-despaces-conviviaux-et-aspirations-contemporaines-troisieme-lieu-l-third-place-r-et-nouveaux-modes-de-vie
(7) Tiers lieux. Open source francophone. Sur facebook : https://www.facebook.com/groups/tilios/
(8) A propos de l’économie collaborative : « Une révolution de l’être ensemble » (« Vive la co-révolution ! Pour une société collaborative : Anne-Sophie Novel et Stéphane Rioux ») : https://vivreetesperer.com/?p=1394
« Anne-Sophie Novel, militante écologiste et pionnière de l’économie collaborative » : https://vivreetesperer.com/?p=1975
(9) « Ouishare. communauté leader dans le champ de l’économie collaborative » : https://vivreetesperer.com/?p=1866
(10) « Quel regard sur la société et sur le monde » : https://vivreetesperer.com/?p=191
(11) « Vers une civilisation de l’empathie. A propos du livre de Jérémie Rifkin » : http://www.temoins.com/etudes/recherche-et-innovation/etudes/vers-une-civilisation-de-lempathie-a-propos-du-livre-de-jeremie-rifkinapports-questionnements-et-enjeux
(12) Sur le site de l’Observatoire national de l’action sociale délocalisée, liste des premiers signataires qui montre l’étendue du champ couvert : http://odas.net/L-Odas-soutien-l-appel-a-la-fraternite-lance-par
(13) Sur le site de Libération : « Le 11 mars, faites de la fraternité ! » (Abdennour Bidar, Patrick Viveret) : http://www.liberation.fr/societe/2015/03/10/le-11-mars-faites-de-la-fraternite_1218112 Patrick Viveret est l’auteur d’un recueil intitulé : « De la convivialité. Dialogue sur la société conviviale à venir ». Et un « Manifeste convivialiste » est paru en 2013 (Voir : note 15)
(14) Michel Clévenot : les hommes de la fraternité. Voir : « Un historien de la fraternité » : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/dha_0755-7256_1993_num_19_2_2101
(15) « Une vision de la liberté… La liberté comme maîtrise… La liberté comme participation… La liberté comme avenir… Egalité, liberté, fraternité… Vers une civilisation conviviale » : https://vivreetesperer.com/?p=1343
Voir aussi, sur le site de Témoins, la vision de Guy Aurenche : « La fraternité sauvera le monde » : http://www.temoins.com/societe/culture-et-societe/societe/la-fraternite-sauvera-le-monde.html
par jean | Mar 23, 2015 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
#
Apprécier et reconnaître ce qui est bon en chacun
En suivant notre fil facebook, nous avons rencontré une parole qui nous a rejoint profondément : « I believe that appreciation is a holy thing, that when we look what is best in a person we happen to be at the moment, we are doing what God does. So in appreciating our neighbor, we are participating in something truly sacred » : « Je crois qu’une appréciation positive appartient au registre de la sainteté, et que quand nous reconnaissons ce qui est le mieux dans une personne avec laquelle il nous arrive d’être à un certain moment, nous sommes en train de faire ce que Dieu fait. Ainsi, en appréciant notre prochain, nous participons à une réalité qui est vraiment sacrée ».
Fred Rogers, un homme qui, à la télévision, a su parler au cœur profond
Qui a exprimé aussi bien la grâce d’une appréciation positive de ce qui est bon et beau dans ceux que nous rencontrons ? C’est un homme mûr, pasteur américain qui, à un moment de sa vie, s’est engagé dans la participation à une émission de télévision à l’intention des enfants : « Mister Rogers Neiborhood » où il a apporté une présence authentique et chaleureuse. C’était un homme âgé qui aimait les enfants. Pour cette œuvre, Fred Rogers s’est vu décerné un prix en 1997. Après avoir été présenté « comme le meilleur des voisins que chacun de nous ait pu avoir », la parole fut donnée à cet homme humble et empathique qui en profita pour demander à l’assistance de prendre avec lui dix secondes pour « penser aux gens qui vous ont aidé à devenir ce que vous êtes, ceux qui ont pris soin de vous et ont voulu pour vous ce qui était le meilleur pour votre vie ». De fait, il en résulta un moment d’intense émotion.
L’article rappelle l’œuvre de Fred Rogers (1) et nous rapporte également dix paroles prononcées par lui. Ces paroles sont bien souvent émouvantes parce que nous ressentons personnellement leur profonde vérité. A partir de l’expression d’une vie en relation, elles font écho en nous. Nous en présentons ici quelques unes.
Des paroles qui touchent et éclairent
« Nous vivons dans un monde dont nous avons besoin de partager la responsabilité. Il est facile de dire : « Ce n’est pas mon enfant, ma communauté, mon univers. Ce n’est pas mon problème ». Et puis, il y a ceux qui voient le besoin et qui y répondent. Je considère ces gens comme mes héros ».
« Qu’est-ce qui pousse toujours plus des gens à vouloir davantage que ce qu’ils pourront utiliser ou avoir besoin ? Je pense tout bonnement que c’est l’insécurité. Comment faire connaître au monde que les signes extérieurs qui font fortune ne sont pas finalement ce qui est important pour être accepté ? »
« Comme être humain, notre rôle est d’aider les gens à réaliser combien chacun de nous est vraiment rare et précieux. A l’intérieur de nous, il y a quelque chose d’unique. C’est notre rôle de nous encourager les uns les autres à discerner cet apport original et à trouver les moyens d’en développer l’expression ».
« Je pense que chacun aspire à être aimé. Et, en conséquence, la plus grande chose que nous puissions faire est d’aider les gens à savoir qu’ils sont aimés et capables d’aimer ».
« Je crois qu’une appréciation positive appartient au registre de la sainteté et que, quand nous reconnaissons ce qui est le mieux dans une personne avec laquelle il nous arrive d’être à un certain moment, nous sommes en train de faire ce que Dieu fait. Ainsi, en appréciant notre prochain, nous participons à une réalité qui est vraiment sacrée ».
Chacune de ces réflexions éclaire le potentiel de notre manière d’être en relation . A certains moments, nous avons été encouragés et fortifiés par l’attention et l’affection qui nous ont été portées. Nous savons combien nos paroles peuvent elles aussi être porteuses d’encouragement et favoriser un processus de guérison et de libération. Fred Rogers nous permet d’aller à l’essentiel : un amour reçu et donné, une reconnaissance mutuelle, une appréciation de ce qui est bon et beau. C’est une harmonie à travers laquelle la présence de Dieu se manifeste.
J H
(1) « 10 Mr Rogers quotes you need to read » : http://www.relevantmagazine.com/culture/10-mr-rogers-quotes-you-need-read
Sur ce blog, autres textes sur ce thème :
« Amitié ouverte » (Jürgen Moltmann) : https://vivreetesperer.com/?p=14
« La beauté de l’écoute » (Frère Roger) : https://vivreetesperer.com/?p=1219
« Bienveillance humaine. Bienveillance divine. Une harmonie qui se répand » (Lytta Basset) : https://vivreetesperer.com/?p=1842
Dea petits riens de grande portée : la bienveillance au quotidien « (Odile Hassenforder) : https://vivreetesperer.com/?p=1849
« D’une religion enfermante à la vie » (Philippe Molla) : https://vivreetesperer.com/?p=1931
par jean | Mar 17, 2015 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |
 Un mouvement de libération qui se poursuit et s’universalise.
Un mouvement de libération qui se poursuit et s’universalise.
Il y a cinquante ans, à Selma, une petite ville de l’Alabama, animés par la vision de Martin Luther King, des afro-américains s’engageaient dans des luttes pour les droits civiques. Le 7 mars 1965, quelques six cent manifestants qui défilaient pacifiquement, étaient pris à partie par les forces de l’ordre dans une brutale répression policière. Pourtant ces marches non violentes se sont poursuivies. Deux semaines plus tard, plusieurs milliers de personnes emmenées par le pasteur Martin Luther King quittaient Selma pour rejoindre la capitale de l’Alabama, Montgomery, à prés de 90 kilomètres. L’opinion publique était touchée par ce mouvement pacifique. Et la victoire était remportée au plus haut niveau politique. Désormais les afro-américains pourraient voter sans entraves. La ségrégation allait également disparaître. Aujourd’hui, si les inégalités sociales et économiques demeurent très prégnantes et si le racisme n’a pas disparu, une nouvelle donne est intervenue. Les afro-américains ont une place dans la société, et, pour la première fois dans l’histoire, le président des Etats-Unis, Barack Obama, participe à cette culture. Aujourd’hui, cinquante ans après les évènements de Selma, c’est le temps de la commémoration et, pourrait-on dire plutôt, un moment de célébration. Une cinéaste vient de réaliser un film à ce sujet. Et, le 7 mars 2015, le président des Etats-Unis, Barack Obama, accompagnée de son épouse, Michèle, et de ses deux enfants, s’est rendu à Selma et y a prononcé un discours dont l’inspiration a été reconnue bien au delà de son milieu politique.
#
En entendant cette parole, en lisant le texte de ce discours (1), nous ressentons une émotion, nous percevons un grand souffle, nous recevons une vision. Barack Obama évoque le courage et la foi de tous ceux qui ont participé à cette première marche et ont été confrontés, de plein fouet, à la violence policière. Un cantique les accompagnait : « Quelques soit l’épreuve, Dieu prendra soin de vous » (What may be test, God will take care of you »). Et puis, à partir de là, il met en évidence la signification de ce combat en inscrivant cette lutte pour l’égalité et la justice dans l’histoire américaine, et, au delà, dans le monde d’aujourd’hui. « Combien ces hommes et ces femmes ont fait preuve d’une grande foi. Foi en Dieu, mais aussi foi en l’Amérique… Ils ont prouvé qu’un changement non violent est possible, que l’amour et l’espérance peuvent vaincre la haine… ». Ils ont lutté pour affirmer la vraie signification de l’Amérique : « L’idée d’une Amérique juste,d’une Amérique équitable, d’une Amérique inclusive, d’une Amérique généreuse a finalement triomphé… ». C’est la victoire de la solidarité. « Le mot le plus puissant dans notre démocratie, c’est le mot « nous » (« we »). « We shall overcome.. .Yes, we can … ». ( « Nous l’emporterons.. Oui, nous pouvons…). Il y a là un élan qui traverse les frontières. Dans sa vision d’une Amérique inclusive et généreuse, Barack Obama salue les diverses immigrations de tous ceux qui sont venus aux Etats-Unis parce qu’ils cherchaient la liberté politique ou la possibilité de sortir de la misère pour gagner une vie décente. Il égrène les mouvements qui ont permis aux minorités de conquérir le respect et de voir leurs droits reconnus. Et, au delà encore, Barack Obama proclame combien cet esprit inspire les luttes pour la démocratie qui se déroulent dans le monde entier. C’est un discours qui manifeste dynamisme et espérance. Ainsi reprend-il une parole du prophète Esaïe : « Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force… Ils marchent et ne fatiguent point » ( Esaïe 40.31).
La figure de Martin Luther King inspire ce grand mouvement pour la justice et les droits civique. une jeune réalisatrice américaine, Ava DuVernay vient de réaliser un film sur cette grande personnalité en situant son action et sa présence dans le contexte des évènements de Selma. Tel que nous le décrit Jean-Luc Gadreau sur son blog (2), ce film rend bien compte de la dimension épique et charismatique de cette présence et de cet événement et de la puissante émotion qui s’y manifeste.
#
Dans son discours, Barack Obama inscrit ce mouvement dans le courant démocratique jalonné par de grandes personnalités comme Abraham Lincoln et F D Roosevelt. Cette pensée généreuse, à laquelle nous avons personnellement goûté et qui été pour nous un point de repère, associe une spiritualité d’inspiration biblique à l’action politique. Hélas, il y a aussi dans l’histoire américaine d’autres moments ou conservatisme et impérialisme vont de pair avec l’influence exercée par de groupes religieux fondamentalistes. Dans son discours, Barack Obama exprime une dynamique de justice dans un processus de libération qui prend toute sa dimension dans une perspective universaliste. Dans un monde tourmenté, il y a là comme un rayon de lumière d’autant plus appréciable qu’il se manifeste dans une des plus grandes nations du monde. Ce discours peut s’appuyer sur la victoire remportée Martin Luther King dans sa lutte pour les droits civiques (3). Et, si son action peut être contestée sur certains points, nous percevons en Barack Obama (4) un homme de bonne volonté, un dirigeant intelligent et responsable qui contribue à rendre ce monde un peu moins dangereux. La vision positive qui s’exprime dans ce discours, vient à l’appui d’une théologie de l’espérance (5).
Dans un monde où les replis identitaires se manifestent, où des extrémismes religieux menacent la paix et débouchent sur la violence et le terrorisme, il est bon d’entendre qu’une spiritualité chrétienne peut inspirer une action politique qui se manifeste dans un processus de libération et la promotion de la justice et de la liberté. « Sans vision, le peuple meurt ». Cette parole biblique (Proverbes 29.18) rejoint notre expérience humaine. Nous avons besoin d’entrevoir un chemin. Nous avons besoin de motivation et de confiance. Puissent des chrétiens témoigner d’un Evangile libérateur ! Puissent-ils, en regard du désarroi et de ce qu’il engendre, témoigner d’une espérance, source de confiance et réponse à la recherche de sens !
J H
(1) Sur le site du Huffington post, vidéo du discours d’Obama et transcription en anglais de ce discours : http://www.huffingtonpost.com/2015/03/07/obama-selma-bloody-sunday-transcript_n_6823642.html Présentation de l’événement en français : « Le discours d’Obama sur les droits civiques à Selma salué comme le plus important de son mandat » : http://www.huffingtonpost.fr/2015/03/08/discours-barack-obama-selma-droits-civiques-mandat_n_6825764.html
(2) Sur le blog : ArtSpi’in : « Selma, pour se mettre en marche ». Commentaire sur le film et bande annonce en français : http://artspiin.eklablog.com/selma-pour-se-mettre-en-marche-a114847768
(3) Sur ce blog : « la vision mobilisatrice de Martin Muther King « I have a dream » : https://vivreetesperer.com/?p=1493
(4) Sur ce blog : « Obama : un homme de bonne volonté » : https://vivreetesperer.com/?p=1000 Et, sur le site de Témoins : « Le phénomène Obama : un signe des temps ? » : http://www.temoins.com/societe/culture-et-societe/societe/jean-hassenforder-le-phenomene-obama-un-signe-des-temps/all-pages.html
(5) Dans les années 60, le théologien Jürgen Moltmann publie son premier livre : la théologie de l’espérance. Dans sa version anglophone : Theology of hope, ce livre exerce une grande influence jusque à être présenté en première page du New York Times. Une présentation de la vie et de la pensée de Moltmann sur le blog : « l’Esprit qui donne la vie » : « une théologie pour notre temps » : http://www.lespritquidonnelavie.com/?p=695
par jean | Mar 17, 2015 | ARTICLES, Vision et sens |
Accueillir l’œuvre de Christ en nous
En relisant le cahier dans lequel Odile Hassenforder écrivait ses réflexions et ses méditations, on trouve un ensemble de trois textes au sujet de la ressemblance à Jésus, à Christ, écrits en début novembre 2006. Le premier d’entre eux a été publié dans un chapitre du livre : « Sa présence dans ma vie » (1) sous le titre : « Accueillir l’œuvre de Christ en nous » (p 121) : « Jésus n’est pas extérieur à nous comme un modèle à suivre, mais il demeure en nous. C’est l’œuvre de Dieu dans un mouvement de vie ». Nous poursuivons ici cette réflexion à travers des extraits des deux textes suivants, inédits.
1 Il s’agit de se laisser transformer.
Accueil de la bonté de Dieu : Parce que je la reçois, je me sens habitée. Alors, je peux et désire en vivre davantage.
Romains 12. 2 A cause de la bonté que Dieu vous a témoigné,
« Ne suivez pas les coutumes du monde où vous vivez
Mais,
laissez Dieu vous transformer
en vous donnant une intelligence nouvelle
Ainsi, vous pourrez savoir :
ce qu’il veut
ce qui est bon
ce qui lui plait
ce qui est parfait »
Offrir sa vie : consacrer son être tout entier : que notre corps, nos forces, nos facultés soient à sa disposition pour le renouvellement de notre mentalité.
Adopter une attitude intérieure différente. Donner à nos pensées une nouvelle orientation
Inspiration de nos pensées renouvelée. Coeur transformé. Attitude mentale et spirituelle changée.
Ephésiens 4.23 :
« Comprenez les choses
d’une façon nouvelle
selon l’Esprit de Dieu
Devenez une personne nouvelle
créée comme Dieu veut.
La vérité la rend juste et sainte ».
C’est à dire :
Ne mentez plus : dire la vérité à son prochain
Ne commettez plus de péché : votre colère cesse avant la nuit
Ne plus voler : travailler honnêtement
Pas de paroles mauvaises : paroles utiles qui aident les autres, qui font du bien
Ne pas garder de rancunes
Ne pas s’énerver ; pas de cris, d’insultes…
Cherchez les mots qui aident et encouragent
Que chaque parole contribue au progrès spirituel.
Dite à propos, cette parole sera le moyen par lequel
Dieu bénira celui qui vient, entend.
Faites disparaître toute mauvaise humeur : aigreurs, rancune, esprit de revendication, explosion de colère, raillerie, paroles blessantes.
Soyez aimables
Compréhensifs les uns pour les autres
Aidez vous les uns les autres
Toujours prêts à pardonner
Marcher dans l’amour de Christ.
2 Recevoir une force de vie
Jésus n’a pas apporté un enseignement extérieur.
Ses paroles sont force de vie.
pénètrent, transforment le cœur
Provoquent de l’enthousiasme parce qu’elles éveillent un désir profond
Alors, il s’agit de s’ouvrir à la force de vie, de résurrection-renouveau en Christ.
Touché au fond du cœur, c’est dans la joie et l’enthousiasme
que nous désirons changer
devenir++
en sachant que c’est possible
que l’Esprit agit en nous
Il ne s’agit plus d’observer une loi
mais de s’ouvrir à l’Esprit de Jésus
de se laisser conduire par Lui
en s’engageant dans la voie de l’amour.
Cela dépasse nos forces morales
Alors devenons lumière : bonté, justice, vérité.
Une telle expérience suscite en nous la louange (Ephésiens 5.18-20)
Odile Hassenforder
(1) Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Empreinte temps présent. 2011. Sur ce blog, des textes issus de ce livre ou inédits : https://vivreetesperer.com/?tag=odile-hassenforder
par jean | Mar 2, 2015 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement |
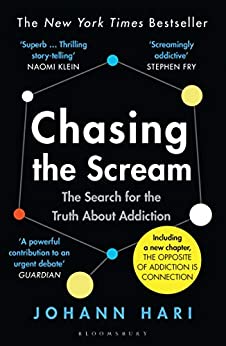 Comment la toxicomanie est liée à l’isolement social et peut trouver remède dans un environnement positif.
Comment la toxicomanie est liée à l’isolement social et peut trouver remède dans un environnement positif.
Des études sociologiques ont montré combien la dégradation du tissu social engendrait des maux de tous ordres dans les populations concernées. Et, à l’inverse, tout ce qui relie a des effets positifs. Ce regard est confirmé par une étude récente sur la manière d’affronter la toxicomanie. Auteur d’un livre tout récemment publié : « Chasing the Scream. The first and last days of the war of drugs » (1), Johann Hari (2) nous expose la recherche qui lui a permis de démonter les conceptions dominantes orientant la lutte contre ce fléau social et de proposer un éclairage nouveau : une approche environnementale (3).
Qu’est-ce qui pousse des gens à se polariser sur la drogue et à développer une dépendance jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus s’arrêter ? Comment pouvons aider ces gens à revenir avec nous ?
Aux Etats-Unis, dans les années 80, une explication de la toxicomanie s’est développée dans une perspective individualiste. Ainsi, s’appuyait-on sur une expérience en psychologie animale : « Mettez un rat seul dans une cage avec deux bouteilles d’eau. L’une est remplie seulement d’eau. L’autre contient de l’eau mélangée avec de l’héroïne ou de la cocaïne. Dans cette expérience, presque à chaque fois, le rat devient de plus en plus obsédé par l’eau mélangée avec de la drogue et en consomme de plus en plus jusqu’à ce qu’il en meure ».
Mais cette explication a complètement été remise en cause par une autre expérience mise en oeuvre par Bruce Alexander, professeur de psychologie à Vancouver. L’expérience précédente, a-t-il observé, se caractérise par la solitude du rat. Le rat est seul dans une cage et il n’a rien d’autre à faire qu’à s’adonner à la drogue. Qu’est ce qui arriverait si on procédait différemment ? Alors, le professeur Alexander a construit un parc pour des rats (« Rat park »). C’est une cage dans laquelle les rats ont à leur disposition des balles colorées, des tunnels, une bonne nourriture et plein d’amis. On y a placé les deux bouteilles : eau pure et eau droguée. Et bien, ces rats pouvant mener une bonne vie ne se sont pas précipité sur l’eau droguée. Pour la plupart, ils l’ont évitée. Aucun n’est mort comme ceux qui vivaient dans leur cage, seuls et malheureux.
« On peut en déduire que la dépendance est une adaptation. Ce n’est pas vous. C’est votre cage ». Le professeur Alexander avance que cette découverte « contredit à la fois la pensée de droite selon laquelle la toxicomanie est une faillite morale provoqué par un laxisme hédoniste et une pensée libérale selon laquelle cette dépendance à la drogue est une maladie se déroulant dans un cerveau chimiquement imprégné ». Et une autre expérience a confirmé sa thèse. Des rats drogués ayant séjourné seuls pendant des dizaines de jours dans la première cage, sont revenus progressivement à une vie normale dans le « parc des rats ».
Mais qu’en est-il dans la vie humaine ? Johann Hari a mené l’enquête. Il a mis en évidence que durant la guerre du Vietnam, un pourcentage important de soldats américains se droguait à l’héroïne. On se demandait ce qui allait arriver lorsqu’ils seraient de retour dans la vie civile. De fait, pour la plupart, ils ont repris une vie normale.
Autre exemple : les malades recevant à l’hôpital des médicaments comprenant de l’héroïne ne tombent pas dans une dépendance lorsqu’ils se retrouvent chez eux. Johann Harli évoque également l’exemple du Portugal qui, il y a quinze ans, a adopté une politique nouvelle en matière de lutte contre la drogue. Les dépenses ont été transférées de la répression à une action pour créer un environnement favorable en terme de logement et d’emploi. Cette politique a été évaluée positivement.
Ainsi, il y a des alternatives aux politiques traditionnelles. La réponse à la dépendance, c’est un milieu relationnel bienfaisant.
« Nous avons besoin d’aimer et d’être en relation » (« We need to connect and love »). Malheureusement, nous avons créé un environnement et une culture qui nous coupent de la connexion humaine ou qui offrent seulement une parodie de relation sur internet… La montée de la toxicomanie est un symptôme d’une maladie plus profonde qui réside dans la manière dont nous vivons ».
Johann Hari rapporte les propos de Bruce Alexander : « Pendant trop longtemps, nous avons parlé exclusivement en terme d’une sortie individuelle de la toxicomanie. Nous avons besoin d’envisager le processus en terme de guérison collective ». Cependant, « cette vérité ne nous remet pas seulement en question sur le plan politique. Elle ne nous oblige pas seulement à changer notre manière de penser. Elle nous appelle aussi à changer nos cœurs ».
Cette étude nous invite à envisager la lutte contre la toxicomanie d’une façon nouvelle depuis une action de terrain jusqu’aux politiques publiques. Cependant, beaucoup plus généralement et d’une façon presque emblématique, elle met en évidence l’influence de l’environnement humain sur les comportements. Cet environnement dépend lui-même de la qualité des relations qui l’induisent. Manifestement, il y a là une réalité qu’on peut observer à différents niveaux et sur différents registres. C’est dire notre responsabilité. C’est dire aussi combien nous avons besoin d’inspiration pour nous engager en ce sens (4).
Jean Hassenforder
(1) Hari (Johann). Chasing the scream. The first and last days of the war on drugs. Bloomsberry Publishing, 2015 Ce livre est présenté et mis en perspective sur : Wikipedia. The free encyclopedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Chasing_the_Scream
(2) Le parcours de Johann Hari a été aussi l’objet de critiques. On pourra consulter sa biographie dans : Wikipedia.The free encyclopedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Hari
(3) Ce texte prend pour source un article de Johann Hari paru sur un blog du Huffingtonpost : « The likely cause of addiction has been discovered and it is not what you think » : http://www.huffingtonpost.com/johann-hari/the-real-cause-of-addicti_b_6506936.html
(4) Bien entendu, les inégalités et la domination socioéconomique entravent le développement d’un environnement positif. Cependant, on observe aujourd’hui une montée des aspirations en quête d’un environnement relationnel et en demande de convivialité. Voir : « Emergences d’espaces conviviaux et aspirations contemporaines » : http://www.temoins.com/evenements-et-actualites/recherche-et-innovation/etudes/emergence-despaces-conviviaux-et-aspirations-contemporaines-troisieme-lieu-l-third-place-r-et-nouveaux-modes-de-vie On rejoint par là le message d’amour de l’Evangile et une vision de l’œuvre de l’Esprit. C’est la recherche d’une communauté telle que l’exprime très bien le théologien Jürgen Moltmann : « L’expérience de la communauté est expérience de la vie, car toute vie consiste en échanges mutuels de moyens de subsistances et d’énergie et en des relations de réciprocité. Il n’y a pas de vie sans relations de communauté qui lui soient propres. Une vie isolée et sans relations, c’est à dire individuelle au sens littéral du terme… est une réalité contradictoire en elle-même. Elle n’est pas viable et elle meurt. Une absence totale de relations représente la mort totale. C’est pourquoi la « communion de l’Esprit Saint » n’est qu’une autre expression pour désigner « l’Esprit qui donne la vie ». La vie naît de la communauté, et là où naissent des communautés qui rendent la vie possible et la promeuvent, là l’Esprit de Dieu est à l’œuvre… Instaurer la communauté et la communion est manifestement le but de l’Esprit de Dieu qui donne la vie dans le monde de la nature et dans celui des hommes. Tous les êtres créés existent non par eux-mêmes, mais en d’autres, et ont besoin, pour cette raison, les uns des autres, et ils trouvent leur consistance les uns dans les autres » (Moltmann (Jürgen). L’Esprit qui donne la vie. Seuil, 1999 (p 297-298) Ouverture à la pensée de Moltmann dans le blog : « L’Esprit qui donne la vie » : http://www.lespritquidonnelavie.com/ Sur ce blog : « Vivre en harmonie » : https://vivreetesperer.com/?p=43
 Pour un nouveau vivre ensemble.
Pour un nouveau vivre ensemble.

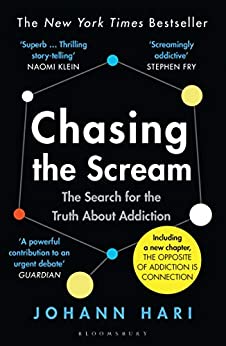 Comment la toxicomanie est liée à l’isolement social et peut trouver remède dans un environnement positif.
Comment la toxicomanie est liée à l’isolement social et peut trouver remède dans un environnement positif.