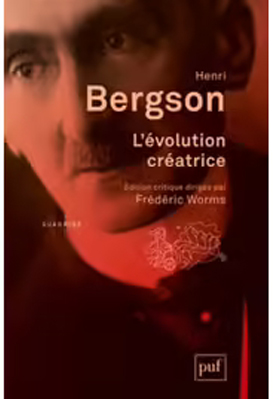par jean | Nov 4, 2022 | Vision et sens |
 Si nous sommes là, le sommes-nous par hasard, comme une pièce isolée, un peu de temps avant de disparaître ? Nous sentons bien qu’il n’en n’est pas ainsi, que nous nous inscrivons dans un courant de vie. Et plus encore, nous ne sommes pas des acteurs isolés. Nous participons à une communion de vie.
Si nous sommes là, le sommes-nous par hasard, comme une pièce isolée, un peu de temps avant de disparaître ? Nous sentons bien qu’il n’en n’est pas ainsi, que nous nous inscrivons dans un courant de vie. Et plus encore, nous ne sommes pas des acteurs isolés. Nous participons à une communion de vie.
« La vie comme participation » (1), c’est le titre d’une séquence de méditations publiées par Richard Rohr sur le site du « Center for action and contemplation ». A plusieurs reprises (2), nous avons rapporté ici la pensée de Richard Rohr, théologien franciscain, qui nous invite à reconnaître la bonté et l’amour de Dieu à travers ses méditations. Son livre : « The divine dance », « La danse divine » (3) nous introduit dans la communion divine d’un Dieu trinitaire.
La séquence de « la vie comme participation » a été publiée du 5 au 10 septembre 2021. Nous en rapportons ici quelques extraits.
Participer au déroulement de la création
Richard Rohr a beaucoup réfléchi sur la conversion de Paul à Damas. La vie de celui-ci a profondément changé et son enseignement témoigne de cette transformation. Richard Rohr s’en inspire ici
« Avant la conversion, nous pensons que Dieu est au dehors (out there). Après la transformation, Dieu n’est plus au dehors et nous ne regardons pas à la réalité. Nous regardons à partir de la réalité. Nous sommes maintenant au milieu de celle-ci. Nous faisons partie de celle-ci. Le tout est ce que j’appelle le mystère de la participation. Paul était obsédé par l’idée que nous sommes tous en train de participer à quelque chose. Je n’écris pas l’histoire par moi-même. Je suis un personnage dans l’histoire qui est en train d’être écrite en collaboration avec Dieu et le reste de l’humanité. Cela change tout dans la manière dont nous voyons nos vies ». Nous n’avons plus à nous obséder sur manière dont nous avons écrit ou écrivons notre histoire. Richard Rohr rapporte une « théologie participative » : « Je suis employée, je suis choisi activement, je suis conduit ». Cela ne porte pas sur le fait de rejoindre une nouvelle dénomination ou d’avoir un moment d’extase. Après une conversion authentique, vous savez que votre vie n’est pas à propos de vous. Vous êtes à propos de la vie ». C’est l’idée de participer à la bonté et au déroulement continuel de la création de Dieu…. ».
Participer dans la bonté originelle
« Chacun et chaque chose sont créés dans l’image de Dieu. C’est la connexion objective ou « l’ADN divine » que Dieu donne également à toutes les créatures au moment de leur conception. Le philosophe Owen Barfield appelle ce phénomène la « participation originelle ».
Richard Rohr apprécie le terme de « bénédiction originelle » apporté par Matthew Fox. La création est bonne comme Genèse 1 l’affirme clairement et avec insistance ». Alors, comment nous comporter en conséquence ? En s’appuyant sur la parole de Paul : « Il y a trois choses qui durent : la foi, l’espérance et l’amour » (1 Cor 13.13) ». Ces attitudes participent à la vie même de Dieu. « Elles nous sont données librement par Dieu, « infusées » en nous à notre conception ». « Nous sommes fait de la foi, de l’espérance et de l’amour de Dieu pour accroitre la foi, l’espérance et l’amour dans le monde ».
Richard Rohr entrevoit la foi, l’espérance et l’amour comme plantés profondément en notre nature, de fait « notre véritable nature » (Rom 5.5 ; 8.14-17). « La vie chrétienne consiste simplement à devenir ce que nous sommes déjà ». (1 Jean 3.1-2 ; Pierre 1.3-4). Mais nous sommes appelés à éveiller, permettre et développer cette identité profonde en lui disant consciemment oui et en nous appuyant sur elle comme une source fiable et essentielle. A nouveau, l’image doit devenir ressemblance. Nous devons participer au processus ».
Participer dans l’amour
Cette vie de participation, Paul la décrit en terme d’amour. Et Richard Rohr nous dit que, selon Paul, « l’amour n’est pas quelque chose que nous faisons, c’est quelque chose qui nous est fait et auquel nous participons » . Richard Rohr reprend l’expression : « tomber amoureux ». De même, l’amour est un comportement dans lequel nous tombons. Ce n’est pas par notre volonté que nous pouvons créer l’amour. Ce Grand amour dans lequel nous tombons, Paul l’appelle « agape ». « Nous traduisons par amour inconditionnel ou amour divin ». « C’est un amour que nous recevons en don. Nous ne pouvons pas le fabriquer . C’est un amour auquel nous pouvons seulement participer. C’est une vie plus grande que la notre ». Selon Richard Rohr, le passage à cet état d’amour advient d’autant plus que nous arrivons au bout de nos forces et perdons le contrôle. Nous commençons alors à nous appuyer sur une puissance plus grande que la notre. Nous entrons dans une nouvelle manière de voir. « Pour Paul, l’amour est l’état où nous voyons parfaitement. Quand nous sommes dans l’amour, dans l’agape, nous sommes capables de « voir » correctement. … Nous n’aurons pas de jugements négatifs…Nous verrons ce qui se passe réellement…..
Une responsabilité collective
« Paul enseigne que nous sommes à la fois des saints et des pécheurs à un niveau collectif (« corporate level »). Notre sainteté s’inscrit dans la plénitude du Corps de Christ ».
Une moralité participative
« La bonne nouvelle d’une religion de l’incarnation, d’une moralité fondée sur l’Esprit, c’est que nous ne sommes pas motivés par une récompense ou une punition extérieure, mais par notre participation au mystère lui-même ».
« Le moralisme – comme opposé à une saine moralité – dépend de codes de pureté largement arbitraires, de rituels requis, et d’exigences de devoir qui sont formulés en terme de prérequis pour un éveil spirituel ». C’est compréhensible, écrit Richard Rohr. C’est plus facile de penser en terme de faire ou de ne pas faire que « d’entreprendre une radicale transformation vers l’esprit et le cœur de Dieu ». « Il n’est pas étonnant que Jésus ait mis fortement en garde contre la publicité de la prière, des actes de générosité et du jeune dans son sermon sur la montagne (Matthieu 6. 1-18). Et pourtant, c’est ce que nous faisons encore ! »…..
Richard Rohr évoque une approche religieuse carotte-baton et une « gestion du péché » par un clergé. Et, à coté de cela, il y a de grands maux ravageurs comme le racisme, le sexisme, l’esclavage… les guerres..
« La bonne nouvelle d’une religion de l’incarnation, une moralité fondée sur l’Esprit, c’est que vous n’êtes plus motivé par une récompense extérieure ou une punition, mais par la participation au Mystère lui-même. On n’a plus besoin de carottes. « C’est Dieu, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son projet d’amour » (Philippiens 2. 13). Nous faisons les chose parce qu’elles sont vraies et aimantes et non parce que nous devons les faire ou parce que nous redoutons une punition ». La motivation vient du dedans et non pas du dehors.
La participation est le seul chemin
Richard Rohr évoque l’histoire de l’humanité et notamment la période autour de 500 ans avant Jésus Christ où, selon Karl Jaspers, un philosophe allemand, une conscience axiale a émergé partout dans le monde avec les sages de l’Orient, les prophètes juifs et les philosophes grecs. Parmi le peuple d’Israël, s’est remarquablement manifestée une union intime et une participation de groupe autour de Dieu. Ils ont reconnu des personnalités individuellement éclairées comme Moïse et Esaie. « La notion de participation s’est élargie à tout le peuple juif et au delà au moins pour beaucoup de prophètes juifs. Dieu sauvait le peuple comme un tout. La participation était historique et sociale et pas seulement individuelle…. Il est surprenant que nous l’ayons oublié et ignoré en réduisant le salut à des personnes allant au ciel ou en enfer, ce qui est surement une régression par rapport à la notion de salut historique, collectif et même cosmique enseignée dans la Bible. Rappelez-vous, Dieu a toujours sauvé Israël et pas seulement Abraham ».
Ce tournant s’est poursuivi dans la venue de Jésus. « Les écritures juives et l’expérience elle-même ont créé une matrice dans laquelle une réalisation nouvelle pouvait se manifester (4). Jésus a apporté une participation finale et étendue au monde entier dans son propre enseignement très holistique. Cela a permis à Jésus de parler dans une union véritable avec lui-même, avec les proches, avec les étrangers, avec les ennemis, avec la nature, et, à travers tous ceux-ci, avec le Divin. Le champ de la participation était total. Qu’est-ce qu’une vraie bonne nouvelle pourrait être d’autre ? » .
J H
- Center for action and contemplation Richard Rohr : Life as Participation : https://cac.org/life-as-participation-weekly-summary-2021-09-11/
- La grande connexion : https://vivreetesperer.com/la-grande-connexion/ Enlever le voile : https://vivreetesperer.com/enlever-le-voile/ Comment entendre les principes de la vie cosmique pour entrer en harmonie : https://vivreetesperer.com/comment-entendre-les-principes-de-la-vie-cosmique-pour-entrer-en-harmonie/ L’homme, la nature et Dieu : https://vivreetesperer.com/lhomme-la-nature-et-dieu/
- La danse divine (Divine dance) par Richard Rohr : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/ Reconnaître et vivre la présence d’un Dieu relationnel : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-et-vivre-la-presence-dun-dieu-relationnel/
- La vie et son œuvre, selon NT Wright : https://vivreetesperer.com/paul-sa-vie-et-son-oeuvre-selon-nt-wright/
par jean | Oct 3, 2022 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |
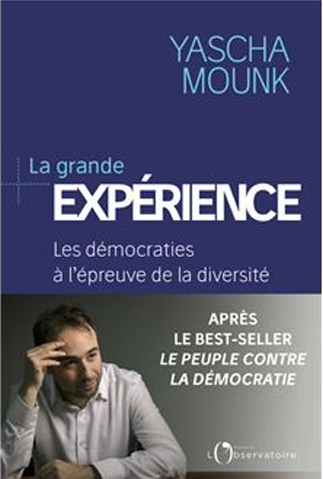 La grande expérience
La grande expérience
Selon Yascha Mounk
Nous vivons dans un régime démocratique, certes imparfait, mais qui nous assure des bénéfices inestimables, une participation à l’autorité politique, à la puissance publique à travers des élections libres, une garantie des droits fondamentaux tels qu’ils ont été proclamés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à travers un état de droit. Bref, si il y a des frustrations, il y aussi un espace où nous pouvons nous mouvoir pour susciter des changements et des améliorations. Nous vivons dans une république qui dépend de l’expression de chacun et est, en principe, l’affaire de tous. Mais avons-nous conscience de ce privilège ?
Cependant, la propagation d’une agitation à consonance autoritaire, se parant d’une référence au peuple, les divers populismes qui se sont répandus dans les dernières années sous des formes variées viennent nous interpeller et sonner l’alarme. En regard, il importe de comprendre le phénomène avec l’aide des sciences sociales. Ainsi, en 2018, un chercheur en sciences politiques Yascha Mounk a écrit un livre : « Le peuple contre la démocratie » (1).
Pourquoi des mouvements populistes en viennent-ils à mettre en cause le bon fonctionnement des institutions démocratiques ? On peut en distinguer quelques raisons comme la stagnation du niveau de vie depuis les années 1980, l’arrivée des migrants qui compromettent l’entre-soi national, ou bien l’emballement de la communication à travers les réseaux. Cependant, un des plus grands dangers est la montée d’un sentiment nationaliste et xénophobe dans une part de population qui se sent abandonnée, privée de son privilège national et sans espoir de promotion. Dans beaucoup de pays, en regard de la diversification de la population, on peut effectivement observer des phénomènes de rejet et une montée des tensions et des conflits. Le pouvoir politique devient alors un enjeu. Des forces contraires veulent se l’approprier pour neutraliser l’adversaire. Le débat politique, et tout ce qu’il implique et requiert : respect et compréhension, est alors compromis.
Or, effectivement, dans de nombreux pays occidentaux, de l’Angleterre à la Suède, de la France à l’Allemagne, une forte immigration est intervenue et la composition de la population a fortement changé. Aux Etats-Unis, si la diversité est constitutive, la diversification se poursuit autrement, avec une correction relative, mais positive des rapports de domination traditionnels. Comment les transformations démographiques en cours vont-elles modifier la vie politique ? L’enjeu est la réalisation d’une démocratie multiethnique. Chercheur en sciences politiques, d’origine allemande et aujourd’hui installé aux États-Unis, Yascha Mounk a intitulé son dernier livre : « la grande expérience » (2). Les démocraties occidentales vont-elles parvenir à un nouveau stade, celui d’une démocratie multiethnique ? Et comment ?
Yascha Mounk est bien qualifié pour aborder cette question. Car lui-même a grandi dans une famille polonaise, juive de confession, immigrée en Allemagne. Par expérience, il est sensible aux relations interculturelles. Yascha Mounk a fait ses études universitaires en Angleterre à Cambridge, puis il est devenu chercheur aux Etats-Unis. Il est maintenant professeur de politique internationale à l’Université John Hopkins. Il écrit dans de nombreuses revues et s’exprime dans de nombreuse conférences.
La transformation des sociétés et la question démocratique
Yascha Mounk part d’abord d’un constat. C’est la diversification considérable de la population des démocraties au cours des dernières décennies. « A la fin de la seconde guerre mondiale au Royaume-Uni, moins d’une personne sur vingt-cinq était née à l’étranger. Aujourd’hui, c’est une personne sur sept. Il y a quelques décennies de cela, la Suède était l’un des pays les plus homogènes du monde. Aujourd’hui, un habitant sur cinq a des origines étrangères » (p 16). La France et l’Allemagne vont dans le même sens. La différence des européens, le Canada et les Etats-Unis se sont pensés comme des nations d’immigrés dès leur conception. « Et pourtant, à leur manière, les deux grandes démocraties du Nouveau Monde ont été profondément excluantes durant la majeure partie de leur existence » (p 17). Aux Etats-Unis, la jeune république a composé avec l’esclavage et refusé aux noirs les droits les plus élémentaires. L’abolition de l’esclavage en 1865 a marqué un grand tournant, mais les discriminations affectant les afro-américains sont revenus ensuite. Elles s’effritent aujourd’hui.
Dans ces différents pays où s’opère la transformation démographique, des tensions sont apparues et affectent la vie démocratique.
Yascha Mounk s’interroge à partir de l’histoire. La démocratie multiethnique ne va pas de soi. Ainsi, dans le passé, « les citoyens des démocraties les plus respectées du monde ont porté leur pureté ethnique en étendard. D’Athènes à Rome, de Venise à Genève, les tentatives pré-modernes d’auto-gouvernance ont toutes été restreintes au groupe ethnique concerné » (p 14). A contrario, on a pu observer la réussite de sociétés multiethniques au sein d’empires où le pouvoir échappait à toute compétition entre des groupes. Ainsi, l’élargissement des démocraties rencontre des obstacles. Pour que la grande transformation s’effectue, « le récit qu’elles se font d’elles-mêmes, leur roman national, repose encore trop sur la fiction de leur homogénéité » (p 19). L’histoire d’une domination brutale exerce toujours son ombre dans telle société marquée par l’esclavage. Dans de nombreuses sociétés apparait un risque de fragmentation culturelle. « Certains groupes d’immigrés forment aujourd’hui une classe socio-économique défavorisée » (p 20). En regard des faits, Yascha Mounk observe une « ascension des pessimistes », mais son analyse porte réponse au « besoin d’optimisme » (p 22-34).
Avancer vers une démocratie multiethnique, c’est possible
Le terme de « démocratie multiethnique » peut donner lieu à des malentendus. En fait, l’ampleur est plus vaste. D’autres qualificatifs l’accompagnent : démocratie multiculturelle et multiconfessionnelle. (p 11). L’évolution vers cette nouvelle forme de démocratie est une traversée semée d’embuches, mais cette « grande expérience » n’est pas vouée à l’échec. Elle est possible et d’autant plus possible qu’on en perçoit les différents aspects et qu’on croit à sa réussite. « Si nous voulons que la ‘grande expérience’ réussisse, il nous faudra développer une vision optimiste » (p 27). Le livre aborde les différents aspects de la question en trois parties : Quand les sociétés multiethniques tournent mal ; de l’avenir souhaitable des démocraties multiethniques ; comment les démocraties multiethniques pourraient-elles s’épanouir ?
De fait, des recherches sur l’intégration en Europe montrent qu’à moyen terme, l’intégration en pays d’accueil se réalise. « L’intégration linguistique aussi bien que culturelle paraît plus lente en Europe qu’en Amérique du Nord, mais les tendances sont les mêmes. Il existe bien quelques exemples d’immigrés de deuxième ou même de troisième génération parlant mal la langue locale, mais, en général, les enfants nés en Italie, en France, en Suède ou en Grèce la parlent avec beaucoup plus de facilité que la langue de leurs ancêtres » (p 254).
Mais qu’en est-il du gouffre économique qui sépare encore la majorité historiquement dominante et les groupes minoritaires ? En fait, là aussi, il faut du temps selon les générations. « Ceux qui sont curieux de l’état actuel de nos démocraties multiethniques feraient bien de regarder les statistiques sur le parcours d’immigrés de très longue date afin de déterminer si leurs conditions de vie s’améliorent » (p 260). Et, dans l’ensemble, les conclusions sont positives. « Ainsi, aux Etats-Unis, les immigrés s’en sont très bien sortis, augmentant rapidement leurs revenus d’une génération à la suivante. Par ailleurs, la vitesse de cette progression dépend à peine de leur pays d’origine. Les enfants d’immigrés de presque tous les pays d’origine améliorent plus rapidement leurs conditions économiques que les enfants de parents nés aux États-Unis» (p 261).
Par ailleurs, à partir de différentes recherches, l’auteur tempère nos inquiétudes concernant une insécurité potentielle. « La plupart des immigrés partagent les valeurs de leur société d’accueil » (p 270). Si la menace terroriste est redoutable, elle n’a qu’une petite minorité pour origine.
« La démographie n’est pas un destin ». L’auteur prend en exemple les Etats-Unis. Une partie de la population blanche redoute de devenir une minorité brimée à l’avenir. Mais il y a de grandes différences dans l’évolution des groupes en croissance : les latinos, les asiatiques américains et les métis. L’auteur montre par exemple le caractère spécifique de la réussite intellectuelle des asiatiques américains. « Les asiatique américains ne représentent qu’un dixième de la population des Etats-Unis, mais un quart des élèves qui rentrent à l’Université Harvard. A l’Université Berkeley, presque la moitié des étudiants américains entrés en 2020 étaient des asiatiques américains ». La réussite économique va de pair (p 288). L’auteur montre également un développement rapide du groupe des métis. Il y a quelques décennies, le métissage rencontrait beaucoup d’hostilité. En 1980, seuls 3% des nouveau-nés étaient métis. A la fin des années 2010, un enfant sur sept était métis (p 284). Ainsi, les trajectoires de ces groupes sont différentes. Elles permettent une évolution des attitudes politiques. Elles vont à l’encontre d’une fatale confrontation entre « blancs » et « gens de couleur ».
Yascha Mounk estime que l’exemple américain est instructif et que les tendances qui y sont observées peuvent l’être également dans d’autres pays. « Des groupes qui nous semblent aujourd’hui soudés se fractureront sans prévenir. La démographie n’est pas un destin. Les habitants des démocraties multiethniques, dans leur grande diversité, sont embarqués sur le même bateau. Ceux d’entre nous qui pensons que la grande expérience peut réussir, devons remplir une tâche clé dans les décennies à venir : nous battre pour un avenir dans lequel le plus de personnes possibles se penseront non comme les membres de tribus mutuellement hostiles, mais comme citoyennes de démocraties multiethniques fières et optimistes » (p 304). Yascha Mounk , conscient des dangers du nationalisme, préconise en regard un patriotisme civique, inclusif et capable de rassembler les divers composantes de la population.
Dans quelle mesure les politiques publiques peuvent-elles aider à hâter cet avenir ?
Quelles politiques mettre en œuvre ?
Dans ce livre, Yascha Mounk ne se contente pas de proposer des analyses et des diagnostics ; en fin de parcours, il esquisse des orientations. « Quelles politiques publiques (aussi modestes soient-elles) pourraient contribuer à la réussite des démocraties multiethniques ? ».
Il importe d’abord d’identifier les obstacles majeurs.
« D’abord, de nombreuses personnes n’ont connu quasiment aucun progrès dans leurs conditions de vie ces dernières années. Elles s’inquiètent même d’une future dégradation. Comme l’a montré une étude sociologique, cela les rend beaucoup plus enclines à regarder avec peur ou dédain les membres des autres groupes démographiques.
Deuxièmement, certains groupes ethniques ou religieux subissent encore des conditions socio-économiques dégradées…
Troisièmement, les institutions des démocraties multiethniques peinent aujourd’hui à prendre des décisions efficaces. Elles sont insuffisamment réactives aux yeux de l’opinion ou elles excluent des minorités des processus de décision. En conséquence, les citoyens n’ont plus le sentiment d’être maitres de leur destin collectif, ce qui augmente le risque de tensions intergroupes.
Enfin, la polarisation croissant empêche les citoyens des démocraties multiethniques de considérer leurs opposants politiques avec bienveillance… » (p 307-308).
Dès lors, Yascha Mounk propose quelques orientations politiques majeures.
« Les démocraties doivent offrir à leurs citoyens une ‘prospérité garantie’ : encourager la croissance économique et s’assurer que ses gains finiront dans la poche des citoyens ordinaires. Elles doivent accentuer encore la ‘solidarité universelle’ : construire un État-providence généreux qui évitera la course à échalote entre groupes ethniques » (les avantages accordés à certains groupes peuvent susciter la jalousie et finalement s’avérer contre-productifs). Elles doivent bâtir des institutions efficaces et inclusives : donner à chaque citoyen le sentiment que ses préférences seront prises en compte. Enfin, elles doivent fonder une culture de respect mutuel… » (p 308).
Traduit de l’anglais, très fondé sociologiquement, comme en témoigne une annexe volumineuse de notes bibliographiques, ce livre se lit agréablement en couvrant une question majeure puisqu’il s’agit de l’avenir des démocraties multiethniques à l’échelle internationale. Et, en France, nous sommes directement concernés. Nous découvrons dans ce livre la pensée éclairante d’un chercheur engagé dans l’étude de problèmes politiques majeurs.
J H
- Yascha Mounk. Le peuple contre la démocratie. L’Observatoire, 2018
- Yascha Mounk. La grande expérience. La démocratie à l’épreuve de la diversité. L’Observatoire, 2022
Interview de l’auteur https://www.youtube.com/watch?v=3aLoeIWTTUk
https://www.youtube.com/watch?v=lqhxrUdUiPU
par jean | Oct 3, 2022 | Vision et sens |
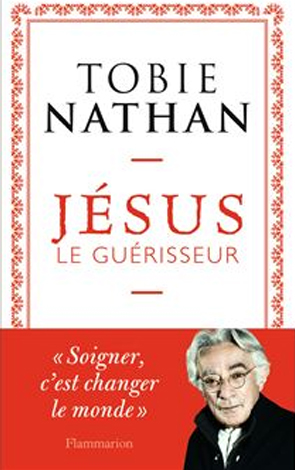 Selon Tobie Nathan, ethnopsychiatre
Selon Tobie Nathan, ethnopsychiatre
A travers une pratique pionnière, Tobie Nathan est devenue une figure majeure de l’ethnopsychiatrie en France. L’ethnopsychiatrie est psychologie transculturelle qui associe psychologie clinique et anthropologie culturelle. Tobie Nathan a notamment mis en évidence la part des croyances dans la prise en charge des maladies mentales. En relation avec des personnes venant de tous les continents, Tobie Nathan a été amené par l’une d’entre elles, à reconnaître la pratique de guérison exercée au nom de Jésus. En conséquence, il a donc entrepris une recherche sur Jésus qui a débouché sur l’écriture d’un petit livre : Jésus le guérisseur (1). « Jusqu’à la rencontre avec Gabriela, personne ne m’avait incité à examiner au plus près Jésus, l’homme donc et non la religion qui a découlé de son enseignement » (p 13). « Si l’on examine son parcours, Jésus a essentiellement parlé, réuni et guéri. C’est donc à l’analyse de ce personnage politique et thérapeute que j’ai voulu consacrer ces pages » (p 13).
L’auteur nous dit dans quel esprit, il a entrepris cette recherche.
« Je voudrais d’abord retracer le parcours personnel de Jésus, pour lequel je ressens une sympathie particulière – un personnage omniprésent dans notre monde alors qu’on sait assez peu sur lui…
Jésus imprègne notre vie quotidienne par des paroles, des expressions, des maximes, par une morale aussi, et une certaine vision politique. Il est partout dans les expressions de notre langue, dans nos proverbes, nos habitudes mentales, mais également dans l’art et la musique » (p 17). Jésus apparaît même dans des troubles psychiatriques. « Jésus est un interlocuteur : on l’appelle, on l’invoque, on le prie. Il est le compagnon des laissés-pour-compte, des démunis, des malades. Ici en France, en Europe, mais aussi très loin d’ici en Afrique, en Amérique du sud et de plus en plus en Chine… » (p 18).
Dans sa recherche historique, l’auteur estime que les sources historiques fiables sont peu nombreuses. « Pour élaborer cet exposé, je suis allé puiser dans les ressources historiques, celles qui reconstituent l’époque, l’atmosphère où Jésus a vécu : j’ai eu très peu recours aux exégèses théologiques. Il va de soi que Jésus, c’est aussi le Christ, le
sauveur, à la fois homme et dieu. Je n’aborderai ici que sa part d’histoire et dans une double perspective qui me questionne – et, je l’avoue, me fascine : Jésus le politique et Jésus le guérisseur. J’espère ne froisser personne en ne discutant que sa part d’histoire. Mais l’honnêteté exige que l’on n’outrepasse pas la frontière de ses compétences » (p 19).
Jésus, leader politique et guérisseur
Si ce livre, dans son sous-titre, met l’accent sur le rôle de Jésus comme guérisseur, l’ouvrage lui-même traite pour une bonne part d’un autre rôle, cher à l’auteur, celui de leader politique contre l’occupant romain. Tobie Nathan se montre ici connaisseur de la civilisation et de l’histoire juive. Et c’est dans cette connaissance que s’égrainent des chapitres comme : Son nom d’abord, parce que le nom, c’est la personne ; Le contexte, le lieu et les choses ; Les forces politiques ; Des mouvements contre l’occupant ; les actes politiques de Jésus ; le Royaume de Dieu…
« En Jésus, dominent deux dimensions à la source de mes réflexions » affirme l’auteur ». « Il y a d’abord la part politique de Jésus, un révolutionnaire juif, un militant en révolte radicale contre l’occupation romaine de la Judée, « le pays des juifs », poursuivant de sa vindicte les collabos du Temple et ceux du Palais, acclamé par une partie du peuple comme « Roi des juifs » avant d’être crucifié comme la plupart des agitateurs politiques de l’époque » (p23).
L’auteur met ensuite en exergue une autre dimension. « La seconde dimension tient dans son activité clinique… Son œuvre a principalement été de soigner les malades. Il rendait la vue aux aveugles, leurs jambes aux paralytiques ; il nettoyait les lépreux de leurs plaies et débarrassait les agités des démons » (p24). Cette activité suscite l’éloge de l’expert qu’est pour nous Tobie Nathan : « Un thérapeute, et de la plus pure espèce… Et comme tous les thérapeutes, il parlait des « paroles à l’envers », dirait mon collègue yoruba du Bénin, dont chacune a pénétré notre univers. Par là, je veux dire qu’il s’agit de paroles surprenantes exigeant un arrêt, une interprétation, des paroles paradoxales, des admonestations souvent qui fracturent des évidences… Un thérapeute, un vrai ! » (p 24).
Mais quel lien entre ces deux activités ?
« Si l’on examine le travail du thérapeute, on se demande ce qu’il a à voir avec la politique. » Dans la réponse, Tobie Nathan s’engage : « Mon hypothèse est précisément que les deux dimensions sont imbriquées ou plutôt que Jésus les a nouées ensemble, que c’est précisément là son originalité fondamentale, son « invention » (p 24-25).
En commentaire, pour notre part, la focalisation sur le rôle politique de Jésus témoigne de la diversité des points de vue selon les parcours et les sources, mais, tout en reconnaissant l’importance du contexte politique, elle ne correspond pas à notre interprétation personnelle. Citons, entre autres : « Mon Royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon Royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré… » (Jean 18.36). Notre propos ici est de recevoir l’éclairage que l’auteur apporte sur le rôle de Jésus comme thérapeute et guérisseur.
Tobie Nathan : histoire d’une vie
La démarche de Tobie Nathan s’inscrit dans une histoire de vie. Une interview oubliée sur le site du Monde nous en dit beaucoup à cet égard (2).
Né au Caire en 1948, il en est brutalement chassé en 1957 en même temps que 25 000 juifs d’Égypte. Ses parents immigrent en France. Leur vie est difficile. « Dans la cité de Gennevilliers où j’ai grandi au nord-ouest de Paris, la vie à la maison n’est pas très facile. Il y avait une douleur, un poids. D’abord parce qu’on était pauvre. Mais surtout en raison de la séparation avec le reste de la famille ». De plus, Tobie ne se sent pas à l’aise à l’école française. « Dès l’école communale, j’ai toujours exécré l’école française, à cause de l’uniformisation obligatoire que comporte cette institution ». Tobie Nathan a donc mal vécu sa condition d’immigré. Le souvenir de cette expérience va l’accompagner et l’aider à comprendre les problème des migrants.
En 1969, étudiant en psychologie et ethnologie, il rencontre pour la première fois le professeur Georges Devereux, le fondateur de l’ethnopsychiatrie en France. C’est avec lui qu’il réalisera sa thèse et, si, par la suite, ils se séparent, il donne son nom au centre qu’il crée en 1993. « Le centre Georges-Devereux s’est ouvert en 1993 dans le cadre de l’Université Paris VIII à Saint-Denis. Ce fut une période extraordinaire. Enfin on allait faire de la vraie psychologie en France. C’est à dire un endroit universitaire où on reçoit des patients, où l’on forme les étudiants en thèse et où l’on enseigne. Personnellement, c’est là que j’ai tout appris. De nos patients, bien sûr. Mais aussi de nos étudiants étrangers qui appartenaient souvent aux mêmes ethnies que les patients que nous recevions ».
Comment Tobie Nathan définit-il l’ethnopsychiatrie ? « Cela consiste à apprendre des autres peuples les connaissances qu’ils ont des troubles psychiques et de leur traitement, à tenir compte de leurs rites ancestraux pour les soigner ».
En 2003, Tobie Nathan abandonne le Centre Devereux pour partir à l’étranger. Il dirige le bureau de l’Agence française pour la francophonie pour l’Afrique des grands lacs au Burundi, puis le service culturel de l’ambassade française en Israël et en Guinée-Conakry. « Ce qui m’a changé, c’est de vivre en Afrique ».
De retour en France, il dirige le Centre d’aide psychologique qu’il a créé. Et il reçoit les jeune gens signalés par leur famille comme étant en danger de radicalisation islamique. « J’ai rencontré des gamins d’un bon niveau qui se posent des questions importantes me rappelant celles que je me posais à leur âge… Cela m’a incité à me questionner sur eux, mais aussi sur moi-même. En France, on ne sait pas penser l’étranger… On va être obligé d’admettre qu’il y a des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ont des dieux qui ne sont pas les nôtres et qu’il va falloir négocier avec eux une coexistence ».Tobie Nathan constate que de nombreux jeunes qui se radicalisent comblent un vide engendré par une perte de continuité culturelle. Dans son livre : « Les âmes errantes », il rapporte des histoires révélatrices.
Issu d’une famille rabbinique, Tobie Nathan se déclare juif comme « ayant des ancêtres, de gens auxquels on se réfère comme étant un début de lignée ». Il espère croire en Dieu un jour. « Chez les juifs, croire c’est l’aboutissement d’un travail, ce n’est pas le début. La croyance est un cadeau, et c’est un cadeau que je n’ai pas encore reçu ».
Une rencontre révélatrice : Gabriela
Dans sa pratique, Tobie Nathan se trouve constamment en rapport avec un vécu international. C’est une source de connaissance et d’ouverture. Et c’est ainsi que la rencontre avec Gabriela lui a ouvert une nouvelle piste : la guérison au nom de Jésus.
« Je l’appellerai Gabriela. Elle m’a montré des photos d’elle à vingt ans sur une plage brésilienne. A 22 ans, elle a épousé un Guyanais, chercheur d’or de passage au Brésil. Après des revers de fortune et plusieurs émigrations, elle s’était retrouvée dans une cité HLM d’une commune de Seine-Saint-Denis. Voici des années que son mari l’avait quittée, parti chercher de l’or en Angola, la laissant seule avec ses trois garçons… Il y a quelques années, lorsque son ainé a atteint 16 ans, Gabriel a appris par un ami revenu d’Afrique que son mari était mort… ». C’est alors que s’est déclenchée la délinquance des enfants.
Gabriela s’est effondrée.
Après une grave dépression et plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, elle a trouvé refuge et consolation au sein d’une Eglise évangélique. Peu à peu, elle s’est rapproché du berger, l’a secondé dans son travail auprès des fidèles » (p 11-12). Tobie Nathan commente alors : « Sa facilité à communiquer avec les esprits ou les anges qu’elle tenait peut-être de ses ancêtres, s’est bientôt manifestée dans l’église en de véritables transes. Régulièrement, il lui arrive de « parler en langues ». Quelquefois, lorsqu’elle est dans cet état, elle opère des « délivrances », c’est-à-dire des thérapies de personnes en détresse. Et c’est toujours au nom de « Jésus ». Gabriela dit qu’elle chasse les « mauvaises influences » qu’elle qualifie parfois de démons ou de diables. Elle m’assure que les fidèles s’en portent mieux. Je la crois ». (p 12-13).
Tobie Nathan nous rapporte comment la relation avec elle s’est établie et comment elle a porté du fruit. « Psychologue, je l’ai reçue durant des années. Nous parlions le plus souvent de ses problèmes de famille, puis, au fur à mesure que son état psychologique s’améliorait, de politique, de l’impasse sociale que constituaient les quartiers, mais aussi de Jésus, – de Jésus surtout ! Jésus, la matrice de son « don de guérison », son protecteur, son guide et son modèle » (p 25).
De fait, Tobie Nathan avait déjà entendu parler de la guérison divine. « Bien d’autres avaient attiré mon attention sur la fonction thérapeutique de Jésus, sur la puissance que conférait son être même. J’avais autrefois fait une enquête dans des Eglises évangéliques au Bénin. Par la suite, j’ai découvert celles du Burundi et du Ruanda. Je me suis insurgé contre les abus commis dans celles du Congo. Mais personne ne m’avait comme Gabriela, incité à examiner de plus près Jésus, sa personne… Selon ses adeptes, c’est en l’homme, Jésus, que réside la puissance de guérir » (p 15).
Jésus guérit
Le livre de Tobie Nathan débouche ainsi sur une description et une analyse de l’œuvre de Jésus comme thérapeute et guérisseur.
Jésus parlait. Il agit aussi. « La plupart de ses actions – peut-être même la totalité – furent des guérisons… Des guérisons, on en compte 37 dans ce qu’on appelle le Nouveau Testament et 14 dans le seul Evangile de Marc. C’est dire ! » (p 98 ). « Plus encore, et alors même que le débat était à son plus fort au sein de l’Église primitive sur la nature de Jésus – il n’y eut jamais aucune controverse, ni chez ses disciples, ni chez ses détracteurs, quant à ses dons de thaumaturge et d’exorciste. Quelle que fut sa nature, tout le monde lui reconnaissait ce don-là, le don de guérison. Dans les récits, tels qu’ils nous sont rapportés dans les Ecritures, Jésus ne refusait jamais la guérison à qui lui demandait » (p 99). « Et, à chaque fois, Jésus choisissait les démonstrations publiques, bien loin des intimités psychologiques de nos contemporains. Il se risquait aux guérisons les plus difficiles devant une foule rassemblée qu’il prenait à témoin, guérison à chaque fois plus inattendue, plus invraisemblable » (p 100).
Dans ce chapitre, Tobie Nathan va décrire, analyser et chercher la signification de quelques guérisons de Jésus. Et il commente ainsi la guérison du sourd-muet dans une ville de la Décapole. « Il lève le regard vers le ciel et gémit en araméen : ephatah ! – « Ouvre-toi » et voilà que la parole du bègue se délie… ». De fait, « cette parole est chargée… elle désigne le commencement de la prière. Le livre qui introduit à Dieu s’appelle en hébreu le Pata’h, « l’ouverture », que l’on retrouvera dans la première sourate de l’islam Al fati’ha qui signifie aussi : « ouverture ». Une fois encore, Jésus fait et dit. C’est l’un de ses secrets thérapeutiques : faire un acte et dire en même temps la parole qui le désigne. Il faut alors que cette parole colle à l’acte, mais également qu’elle s’envole vers une signification plus profonde, qui engage toute la communauté » (p 101).
La nouvelle des guérisons se répand. « Les malades ne guérissent pas parce qu’ils croient ; ils croient parce qu’ils on été guéris » (p 102). Ces guérisons participent à un mouvement de rassemblement autour de Jésus.
« On a inventorié trois types de malades guéris par Jésus : les aveugles, les sourds-muets et les paralytiques… Tous ont la perception et l’action entravée. C’est ainsi qu’il définit par ses gestes thérapeutiques la nature de la maladie : l’impossibilité de la connaissance de Dieu. Il faut donc voir dans ces malades des éveillés – les plus vaillants de la communauté – des êtres qui ont conscience dans leur corps des entraves au cheminement vers Dieu » (p 103 ).
Tobie Nathan inscrit l’œuvre de guérison de Jésus dans une dimension communautaire. « On doit se rendre à l’évidence : l’action de guérir, que Jésus maitrisait à la perfection, sans effort, en douceur, n’était pas le but ultime. Il voulait agir non sur la négativité qui affligeait un seul, mais sur l’inhibition qui paralysait sa communauté » (p 110). D’un bout à l’autre de son livre, Tobie Nathan met l’accent sur la vocation politique qu’il attribue à Jésus.
Une interpellation
« A cette époque, les thérapeutes, les devins, les magiciens, les sorciers étaient si nombreux… il y en avait tant et plus encore. Ils pullulaient en Judée et en Galilée. Il en existait parmi les grecs… » (p 115 ). Certains étaient renommés. Les techniques de Jésus ressemblaient à celles des guérisseurs de son temps, mais elles différaient par un détail d’importance : Jésus soignait gratuitement et exigeait de ses disciples qu’ils agissent de même » (Matthieu 10.7-10) (p 115-116). Tobie Nathan évoque ensuite une « longue lignée de rebelles politiques cherchant à délivrer Israël de l’oppression romaine » et le passé insurrectionnel à cette époque. Finalement « ce fut l’éradication du Temple et la domination de l’Empire romain ».Tobie Nathan conclut ainsi : « Révolutionnaire et thérapeute, c’est ainsi que j’ai compris Jésus à travers les évènements de la vie » (p 123). Il en apprécie les talents. « Cet homme aurait pu jouir d’une reconnaissance passagère ou disparaître dans les oubliettes de l’histoire comme d’autres dont nous ne savons rien ». Alors, il s’interroge sur la présence de Jésus dans la vie contemporaine et le mystère qu’on peut y voir :
« Mais son destin fut différent.
Qui en a décidé ainsi ?
Dieu, peut-être ? » (p 124).
Dans le brassage mondial des populations, Tobie Nathan apparaît comme une vigie. Ethnopsychiatre, il observe les phénomènes psychosociaux de notre époque. A ce titre, la réalité de la « guérison divine » ne lui paraît pas extravagante. Son regard croise celui des chrétiens évangéliques qui croient en la guérison au nom de Jésus. Tobie Nathan s’est engagé dans une recherche historique pour mieux connaître ce Jésus pour lequel il éprouve de la sympathie. Dans ce livre, selon sa culture, il nous fait part de son interprétation et de son questionnement. Jésus est bien source de guérison.
J H
(1) Tobie Nathan. Jésus le Guérisseur. Flammarion, 2017
(2) Tobie Nathan : la croyance est un cadeau que je n’ai pas encore reçu : https://www.lemonde.fr/la-matinale/article/2017/10/15/tobie-nathan-la-croyance-est-un-cadeau-que-je-n-ai-pas-encore-recu_5201182_4866763.html
(3) Tobie Nathan. Les âmes errantes. L’iconoclaste, 2017 (Livre de Poche) « Dans le secret de son cabinet, le psychologue Tobie Nathan accueille des jeunes en danger de radicalisation. Il écoute. Leurs histoires, leurs mères, leurs pères perdus. Et tout ce qu’ils ont à nous apprendre sur le monde tel qu’il est. Aucun penseur ne les a connu de si près. Aucun n’a osé dire qu’il leur ressemblait. Se raconter, se mettre à nu pour faire revenir « les âmes errantes » est un pari risqué. Le seul qui semble valoir la peine d’être tenté ».
Tobie Nathan, ethnopsychiatre
par jean | Sep 2, 2022 | Société et culture en mouvement |
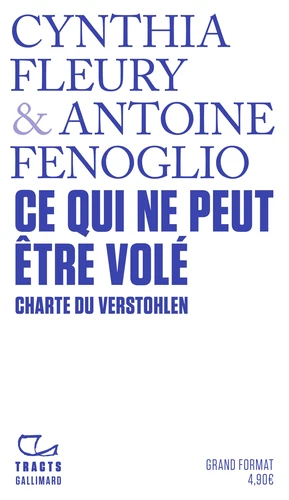 Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury
Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury
Sans que nous en ayons toujours conscience, il y a dans notre vie quotidienne, notre vie sociale, un essentiel, et, en quelque sorte, des conditions fondamentales pour que notre vie puisse être vécue humainement dans une «vie bonne ». Et, par exemple, avons-nous besoin de silence, et, le sachant, en voyons-nous toute l’importance, ou bien, si nous vivons dans un lieu bouché, ressentons-nous de même le manque d’horizon pour en revendiquer l’importance ? Dans les multiples contraintes de la vie d’aujourd’hui, parvenons nous à garder notre liberté, à préserver notre humanité et à faire mouvement dans ce sens ?
Ces questions, et bien d’autres, sont traitées dans le manifeste que Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio viennent de publier dans un livret ayant pour titre : « Ce qui ne peut être volé. Charte du Verstohlen » (1). Ce titre interroge. Y aurait-il des voleurs qui pourraient dérober ce qui est essentiel pour nous ? On imagine les enchainements qui risquent de nous asservir. Mais, en premier temps, il y a là une affirmation. Oui, il y a des conditions essentielles pour vivre une vie humaine, une vie bonne. Le vocable : « charte du verstohlen » est énigmatique pour les non initiés. En se référant à l’expression allemande correspondante, les auteur(e)s évoquent une affirmation et une reconnaissance d’un mouvement de « furtivité ». Cependant, il s’agit là d’un terme qui nous paraît peu usité jusqu’ici. On peut le comprendre comme le refus d’être emprisonné dans une assignation, dans une catégorisation, dan une localisation. Par là, la furtivité serait, en quelque sorte, le garant de la liberté.
Ce terme témoigne de l’inventivité conceptuelle qui se manifeste dans cette charte, Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio associant dans cette recherche des compétences et des champs complémentaires. La première, philosophe et psychanalyste, est pionnière dans le domaine du care et de l’éthique du soin. Le second œuvre dans le design et l’architecture. Ils sont associés à la Chaire de philosophie, à l’hôpital/CHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Notre attention pour ce texte a été attirée par notre appréciation de l’œuvre de Cynthia Fleury dont nous avons présenté deux livres sur ce blog : « Le soin est un humanisme » et « Ci-git l’amer : guérir du ressentiment » (2). Ce livre nous paraît plus difficile à rapporter ; car cette pensée subtile est, par nécessité très conceptuelle et elle s’exprime parfois avec des mots peu usités. Pour mieux en rendre compte au public de ce blog, nous ne résumerons pas un texte qui, de surcroit, vogue en liberté, mais nous essaierons simplement de présenter quelques pensées fortes de ce manifeste comme une ressource pour la compréhension et l’action, et participant ainsi à un travail de conscientisation.
Avant d’entrer dans cette présentation, nous rapportons ici une mise en perspective de France Culture.
Un manifeste en dix points
« Inappropriable, bien commun, bonheur national brut,… « Nommez-le comme vous voulez », nous dit le tract : « Ce qui ne peut être volé : Charte du Verstohlen », un manifeste en dix points coécrit par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste et le designer Antoine Fenoglio : « Dix points non négociables qui nous paraissent évidents, mais qui ne le sont plus » déclare Cynthia Fleury. « Cela va du silence à la santé en passant par le droit d’accéder à une vue… »
Les auteurs définissent tous les objets et les méthodes pour les défendre. Le « proof of care », le climat de soin, l’enquête, la furtivité, autant de moyens pour protéger ce qui peut nous être volé. Ainsi c’est l’écrivain, Alain Damasio, auteur notamment du roman « Les furtifs » (2019), qui a inspiré aux auteurs le concept de « furtivité », auquel le titre est dédié, « Verstohlen » renvoyant littéralement au terme « furtivement » en allemand. Le furtif, politisé, nous parle des manières de s’exfiltrer de la réalité telle qu’elle nous est proposée aujourd’hui, réduite, nous disent les auteurs, aux processus de réification quasi quotidienne ». « En défendant ce qui peut nous être volé, c’est aussi une certaine conception de la démocratie, mais aussi de la vulnérabilité qui est défendue. La vulnérabilité devient un vecteur de connaissance et non plus un objet de discrimination ou de stigmatisation » (3).
Des éclairages pour la compréhension et l’action
Voici donc quelques exemples des pensées fortes présentes dans ce livret et accessibles à chacun de nous pour une conscience des conditions essentielles d’une « vie bonne ».
La perspective. Accéder à une vue
Lorsque notre fenêtre débouche sur un horizon : un ciel, des arbres, une étendue, nous n’avons pas toujours conscience de l’effet engendré par un manque de perspective. Et pourtant, il y a bien là matière à avertissement : « Les mondes urbains et ruraux ne peuvent se transformer en prison où tout édifice arrête le regard : murs et bêtise ont ceci de commun qu’ils tuent la perspective » (p 5). « Une chambre avec « vue » désigne parfaitement ce qu’une ressource matérielle peut devenir, à savoir une ressource essentielle… Accéder à une vue, dans l’espace privé ou l’espace public, est une nécessité journalière. Voir l’horizon, voir la beauté , voir la lumière naturelle… nous inspire, nous soutient, et sollicite notre prendre soin en retour » (p 5). Il en ressort une réflexion sur l’architecture. « Premier critère de l’architecture. Elle est « biologique »… Et, ne jamais oublier que la destination d’un lieu, d’un objet, est d’être humain » (p 6).
La vertu du silence
Ne savons-nous pas que le bruit engendre le stress et le déséquilibre ? Le texte réaffirme la vertu du silence. « Véritable porte d’accès au monde, le sonore est un élément d’équilibre personnel fondamental dans notre relation aux autres et au monde ». « Le silence est un des facteurs-clés contribuant au bien-être, comme constitutif de la santé physique et mentale… » (p 7). Le texte dégage quatre grandes fonctions du silence. « La première peut être désignée comme spirituelle, dans la mesure où elle nous permet d’accéder au sacré, à l’espace du secret, à la solennité d’un moment, au ressourcement et au recueillement… la deuxième fonction du silence peut se définir comme intellective, cognitive, agente, dans la mesure où nous en avons besoin pour penser, réfléchir… La troisième fonction est clinique, thérapeutique… » (p 7). Enfin, les auteur(e)s mettent en évidence la contribution du silence dans « la vie publique, citoyenne ». En regard du bruit qui se manifeste souvent sur la place publique, ils rappelle que « le silence conditionne la civilité, l’urbanité, le fait de concilier vivre ensemble, extrême mobilité et circulation, libertés politiques et individuelles, dans le climat le moins hostile et agressif possible ; et l’exercice libre de la rationalité démocratique, soit la délibération ». « Nulle enceinte délibérative digne de ce nom qui n’organise les temps de parole et de silence de façon équitable, transparente et respectueuse des individualités de chacun » (p 8).
Ce silence, si important, ne doit pas être monopolisé par des milieux privilégiés. « Créer des espaces privés et publics, des architectures, des services, des paysages… qui permettent l’accès gratuit et durable au silence, c’est se soucier de préserver la qualité de notre attention au monde, à soi-même et aux autres, humains et non- humains, soit la condition d’un penser et d’un agir plus connectés… » (p 8).
Reconnaître la vulnérabilité
Cynthia Fleury accorde une grande place à la vulnérabilité dans son manifeste : « Le soin est un humanisme » (2). Et, ici, la vulnérabilité est reconnue et prise en charge. « Nos vulnérabilités ne sont ni des hontes, ni des fatalités » (p 9). Elles s’inscrivent dans la condition humaine.
Ce peut être un point de départ : « L’autonomie n’est pas un fait, mais un processus qui part du fait vulnérable et qui grâce aux ressources portées par les milieux environnants et par soi-même, se dégage de cette vulnérabilité, la rend réversible et capacitaire ». Ce mouvement comporte une dimension collective. « La politisation de la question sociale est précisément cette construction collective de l’autonomie, autrement dit la prise en considération par les ressources publiques de la vulnérabilité originelle et sociale, de la sortie de celle-ci du seul domaine privé et individuel, ou de la charité de certains » (p 9).
Une approche de care
Si la conscience du prendre soin, du care est apparue avec Carol Gilligan dans les années 1980 aux Etats-Unis (4), elle s’est répandue en France et à travers le monde. Dans ce manifeste, Cynthia Fleury a introduit une forte présence du care jusqu’à l’emploi d’une terminologie professionnelle. Ainsi évoque-t-elle les « proofs of care », les « preuves de soin », héritiers des « proofs of concept », qui sont des dispositifs de formats multiples dédiés à la vérification de l’efficacité, de la pertinence de la faisabilité, de la maturité de tels ou tels usage, technique, protocole, architecture, sachant que l’expérimentation doit être relativement frugale et rapide et absolument in situ » (p 9-10). « Le « proof of care » est au service du capacitaire humain ». « Il permettra de vérifier si le passage de l’a priori à l’a posteriori s’opère réellement et comment il est diffusable sur d’autres territoires avec d’autres parties prenantes qui à leur tour détermineront les « formes » que la « preuve » doit prendre dans leur réel… » (p10-11).
« Pas de soin du climat sans climat de soin ». « Le seul « proof of care » ne suffit pas. L’expérimentation doit s’étendre et former comme une culture, « un climat de soin » (« clouds of care »), certes par l’activation de différents « proofs of care », mais par une manière à chaque fois spécifique et pourtant reliée (donc universellement compatible, au sens où l’universel se tisse plus qu’il n’est en surplomb) » (p 12).
Le soin aux morts
Dans la société moderne, les morts, on le sait, sont repoussés à la périphérie. Le temps long est peu reconnu. Les trajectoires individuelles se dispersent. Ici, les auteur(e)s redressent la perspective. « Limiter le soin aux vivants est une hérésie » (p 15 ). « Nous formons communauté avec les vivants et les morts » p 16) (5). Cette affirmation s’inscrit dans le cadre de la prise de conscience d’une connexion généralisée : « Nous allons vers un monde plus conscient des interactions fondamentales entre humains » (p 16).
« Le soin des morts ne concerne pas exclusivement les humains. Nous formons communauté avec les non-humains et nos vies urbanisées et « modernes » ont hélas déconsidéré ce lien essentiel… Les activités hyper-capitalistiques humaines effacent les traces du vivant, font disparaitre des écosystèmes entiers. Nous avons désacralisé la reconnaissance due au non-humain. ». « Nos villes, nos espaces publics et privés, doivent pouvoir accueillir cette dimension anthropologique première qui n’est pas sans rappeler celle que nous cultivons avec le sacré et l’invisible. Si la religion est une option, le sacré ne l’est pas. L’homme se tient debout grâce à une verticalisation tout aussi physique que psychique et spirituelle » (p 16 ).
Le texte rapporte une conférence d’Heidegger « évoquant la nécessité de quadriparti de la terre, du ciel, des dieux et des mortels ». Et « l’homme est pour autant qu’il habite… Habiter est la manière dont les mortels sont sur terre ». « Habiter, c’est demeurer, prendre conscience du temps long qui nous traverse » (p 18). Si le « furtivement » préconisé par la charte va plutôt dans le sens du nomadisme, « il s’agit de comprendre ce qui nous lie émotionnellement, cognitivement, au mouvement et au fait de demeurer » (p 18).
Furtivité
Les auteurs développent plusieurs approches pour influer sur le cours des choses : une démarche furtive, l’enquête, le compagnonnage. Concernant la furtivité, nous appelons le lecteur à consulter l’exposé des chapitres correspondants. La société actuelle est perçue en terme de pression et d’immixtion. « Dans un premier temps, la vie furtive est un simple acte de résistance et de refondation de la liberté individuelle et publique, ensevelie sous la tyrannie de la traçabilité… Il fallait retrouver la possibilité d’être sous les radars. Il fallait être furtif… » (p18-19). Dans cette démarche, les auteurs se sont inspirés « des enseignements conjoints de l’écrivain Damasio et du neuroscientifique Damasio… Ils nous ont permis d’inventer une technique de furtivité, de maintien au monde, en consolidant nos pouvoirs d’agir et de liberté » (p 19). « Le Verstohlen, c’est d’abord cela : avoir le droit de demeurer pour prendre soin, avoir le droit d’agir et de transformer le monde sans subir la domination et la confiscation incessante de la décision politique, ne pas être en danger, posséder en partage, faire surgir le réel dans les interstices de l’invisible » (p 19).
Enquêter. Les humanités démocratiques
Lorsqu’on aménage un lieu, un paysage, lorsqu’on conçoit un service, un protocole… il faut s’occuper des habitants, de ses publics, de ses patients et médecins, de ses espèces végétales et animales. Anciens, actuels, futurs. Cela semble une évidence, c’est surtout une nécessité » (p 24). « L’enquête est par définition le grand outil méthodologique des sciences humaines et sociales, notamment de la sociologie et de l’anthropologie ». « Dans le moment de l’enquête, d’abord distanciée, puis familière, il se joue plusieurs étapes : la découverte des âmes du territoire, errantes et notabilisées, ou encore des espérances enfouies, des traumatismes passés, des parcours de vie et de soin des individus.
Ces « enquêtes » peuvent se réaliser à l’aide d’outils sociologiques classiques, statisticiens, mais plus ils sont affinés, capables d’intégrer la parole singulière des acteurs, de respecter leur demande de confidentialité, plus ils seront riches pour créer un projet pertinent. Autrement dit, il est possible d’avoir recours à ce que l’on nomme « les savoirs expérientiels » ou encore d’utiliser l’éthique narrative pour décrire la subtilité de ces vécus » (p 25).
On en vient donc ici à nous parler de « médecine narrative », comme ce dire des patients, réflexif, littéraire, (auto)biographique lorsqu’ils décrivent, avec toute leur sensibilité et leur expertise personnelle, la maladie dont ils sont atteints » (p 26). « En errance diagnostique, la médecine narrative demeure parfois le seul lien avec la raison et le sentiment de ne pas devenir fou ». « L’Université des patients de Sorbonne Université est notamment une instance où la parole des patients est accueillie, mais surtout valorisée, diplômée. Elle devient « enseignante » à l’attention de tous, patients, soignants, médecins. Elle permet d’analyser et de redessiner les parcours de soin, la démocratie sanitaire » (p 26).
En compagnonnage
L’idée et la réalité du compagnonnage ne sont pas nouvelles, mais elles sont mises en exergue dans ce texte. « L’objet essentiel du compagnonnage est la transmission des savoirs, être et faire, et la formation non discontinuée des individus se faisant en faisant » (p 28). Le compagnonnage s’exerce dans « la durée, le temps long, ce qui perdure au-delà ». « A la différence d’une institution peut-être davantage tournée vers l’activité d’un pouvoir décisionnaire et régulateur, le compagnonnage peut se contenter de « produire », de « créer », de persévérer dans son être par la seule pertinence du maintien de son ethos et des objets différents qu’il induit ». « Il demeure un idéal communautaire, fraternel… » (p 28). Les auteurs mettent l’accent sur l’actualité du compagnonnage, sa pertinence aujourd’hui. « Le compagnonnage n’est nullement qu’une affaire traditionnelle et rituélique mais une incarnation très existentielle, de concepts, d’outils méthodologiques et de valeurs » (p 29). Les auteurs ouvrent encore plus loin la conception du compagnonnage. « Aujourd’hui, les plus belles refondations de ce compagnonnage se situent du coté d’une activité des liens avec le monde vivant, dans sa variété multiple… Nous formons communauté, compagnonnage avec l’ensemble du vivant, dans sa pluralité, non pour rendre équivalents les rapports qui nous unissent, mais pour les expérimenter de façon plus subtile et plus dense » (p 29).
Les auteurs s’engagent dans la voie du compagnonnage « autour de trois axes : enquêter, expérimenter, déployer, pour édifier des formes institutionnelles furtives qui garantissent une sorte de propriété à ceux qui prennent soin, qui entretiennent le lieu naturel et patrimonial, mais aussi les communautés vivantes et mobiles qui l’inspirent » (p 31).
Si cette charte s’exprime dans un langage apte à manier les concepts et à communiquer dans un milieu expert, elle porte des idées originales et des valeurs humanistes et écologiques que nous avons voulu rapporter ici pour un public plus vaste.
J H
- Cynthia Fleury. Antoine Fenoglio. Ce qui ne peut être volé. Charte du Verstohlen. Gallimard, 2022 (Tracts). Interview vidéo de Cynthia Fleury sur cette charte : https://www.youtube.com/watch?v=EJpkyrsk9IU
- De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin. Le soin est un humanisme : https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/ Face au ressentiment, un mal individuel et collectif aujourd’hui répandu. Ci-git l’amer : https://vivreetesperer.com/face-au-ressentiment-un-mal-individuel-et-collectif-aujourdhui-repandu/
- Ce qui ne s’achète pas. La définition du bonheur selon Cynthia Fleury : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/ce-qui-ne-s-achete-pas-la-definition-du-bonheur-selon-cynthia-fleury-7074646
- Une voix différente. Pour une société du care : https://vivreetesperer.com/une-voix-differente/
- Selon Jürgen Moltmann : la communion avec les vivants et les morts : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/
par jean | Sep 2, 2022 | Vision et sens |
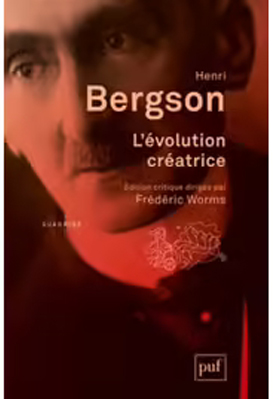 Bergson, notre contemporain. Selon Emmanuel Kessler
Bergson, notre contemporain. Selon Emmanuel Kessler
A une époque où les menaces abondent, mais où un mouvement profond, la conscience du vivant est en cours, de temps à autres, nous parviennent des échos de grands penseurs qui peuvent nous éclairer. Henri Bergson, un grand philosophe, célèbre à la « belle époque », puis dans l’entre deux guerres, nous a laissé une œuvre qui parle à notre temps. Dans ce premier XXe siècle, si marqué par de grands bouleversements dont la mémoire s’impose encore à nous, une pensée active a ouvert de nouvelles pistes. Déjà un dialogue s’esquissait au sein de la science et Albert Einstein et Henri Bergson se sont rencontrés. Nous avons rapporté la rencontre entre Henri Bergson et deux grands scientifiques visionnaires : Pierre Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadski (1). En 2007, Bergson est l’auteur d’un livre si innovant qu’il rencontre un accueil retentissant : « L’évolution créatrice ». Ce titre résonne encore pour nous aujourd’hui lorsque nous sommes à la recherche d’une philosophie de la vie. Et, plus tard, dans l’entre-deux guerres, dans un livre : « Les deux sources de la morale et de la religion », Bergson expose une vision de la société qui reste aujourd’hui instructive. Ainsi, a-t-il mis l’accent sur la tension entre sociétés fermées et sociétés ouvertes. Et il affirme la valeur de la démocratie. Si célébrée fut la carrière de Bergson que sa renommée connut une éclipse après la seconde guerre mondiale dans un contexte social et intellectuel différent. Mais aujourd’hui, alors que l’on prend conscience des logiques destructives qui ont engendré la crise climatique, la pensée de Bergson paraît de nouveau attractive. Son œuvre est à nouveau reconnue et commentée. Philosophe, directeur adjoint de l’Ecole Normale Supérieure, président de la société des amis de Bergson, Philippe Worms (2) a dirigé la première édition critique du philosophe aux PUF (2007-2012). Cet intérêt renouvelé pour Bergson se confirme dans la récente publication du livre : « Bergson, notre contemporain » (3). L’auteur, Emmanuel Kessler est « normalien en philosophie, journaliste politique et économique », acteur dans certains medias. Ce livre est le fruit d’un cheminement. Au cours de ses études, l’auteur se dit avoir été « fasciné » par Bergson. Dans la maturité, le voici nous offrant une belle présentation du grand philosophe : « Bergson, philosophe de la conscience écologique au style incomparable, ardent défenseur de la démocratie, acteur politique majeur, penseur optimiste surtout, qui a su croire à la liberté et à l’action. Dans une langue accessible et vivante, Emmanuel Kessler nous livre le récit, biographique et philosophique de cette vie hors du commun, de cette pensée en mouvement, de cette richesse de fond et de forme, de cette « préparation à bien vivre » qui rendent Bergson éternellement contemporain » (page de couverture).
Pourquoi relire Bergson ?
Emmanuel Kessler vient nous expliquer pourquoi relire Bergson aujourd’hui. A une époque où les idéologies se bousculent et font du bruit, « n’y aurait-il pas un immense profit à retrouver toute l’actualité d’un penseur qui refusera toujours d’enfermer le monde dans lequel nous vivons, dans des catégories toutes faites, dans des « ismes » qui figent une réalité multiple et mouvante… « Je n’ai pas de système », a-t-il déclaré dans une de ses rares interviews… Un penseur qui ne prétend pas avoir réponse à tout, voilà une première raison de redécouvrir Bergson !
Dans un univers de plus en plus complexe nourri de contradictions et de tensions de plus en plus vives, les philosophes de la nuance (4)… méritent de retrouver leur retentissement. Bergson est dans l’histoire de la philosophie, le tout premier d’entre eux ! Un philosophe de l’incertitude et de l’ouverture » (p 14).
Autre indice de son actualité. « Bergson est avant tout un philosophe de la nouveauté. Sans doute, à son époque, la révolution industrielle bat son plein. Mais, aujourd’hui encore, avec la révolution du numérique, nous ressentons ce mouvement qui nous attire et nous inquiète. Avec Bergson, nous allons prendre conscience que le changement, ce n’est pas maintenant, c’est tout le temps ! Nous allons pouvoir le sentir comme une source créative. Je vais donc vous emmener dans les pages qui suivent à la découverte du philosophe de la durée, c’est à dire de ce qui change à chaque instant » (p 14-15). Alors qu’à première vue, la philosophie, depuis Platon, cherche les permanences solides au delà des apparences trompeuses, bref ce qui demeure dans ce qui change, les idées éternelles, Bergson, lui renverse la table : le vrai, c’est justement ce qui change. Il a transformé la philosophie en préférant le nouveau à l’éternité. Ce qui mérite toute notre attention n’est pas ce qui est figé, mais ce qui nait, car c’est ce qui vit… Essayons d’appréhender, d’accompagner et d’enclencher à notre échelle humaine, et selon sa formule « la création continue d’imprévisibles nouveautés qui semblent se poursuivre dans l’univers » (p 15).
Emmanuel Kessler s’arrête sur le mot d’imprévisible (5). « C’est le mot qui nous parle le plus en ce moment ». Bergson est, comme personne avant lui, le philosophe de l’imprévisible » (p 16). Cette démarche correspond à la perception de l’auteur. « Que, pour le pire parfois, mais aussi pour le meilleur, jamais le monde ne se déroule selon « des lois mathématiques ». Un enchainement totalement nécessaire… Voici le cœur de la philosophie bergsonienne. Quoiqu’il arrive, rien ne se passe comme prévu. Le déterminisme n’existe pas. « L’avenir est réellement ouvert, imprévisible, indéterminé » (p 18).
La vie d’Henri Bergson
Bien qu’Henri Bergson se soit refusé à une exposition biographique, alléguant que sa pensée ne devait pas être confondue avec sa vie, Emmanuel Kessler nous présente ici les étapes et les facettes de la vie d’Henri Bergson. Ce fut une vie exceptionnelle : « l’itinéraire d’un enfant d’une modeste famille juive immigrée qui devient à moins de quarante ans le plus célèbre des philosophes de son temps, qui obtient au cours de sa carrière tous les honneurs et toutes les distinctions de la République » (p 20).
Bergson vient au monde le 18 octobre 1859 dans une famille juive immigrée dont il est le deuxième enfant. Dans ses études secondaires, il se révèle exceptionnellement doué. Il opte pour la préparation du concours d’entrée à Normale lettres alors qu’il est également doué en mathématiques et en sciences. Ce choix est décisif et révélateur. C’est le choix de la philosophie. Emmanuel Kessler commente ainsi : « Il pressent qu’il y a au-delà de la science mathématique qu’il voit régner en maitre, une connaissance plus complète encore » (p 27). En 1878, Bergson entre à l’Ecole Normale Supérieure dans la même promotion que Jaurès (6). Il entre ensuite dans une carrière d’enseignant dans le secondaire, d’abord en province. Un tournant majeur intervient en 1889. C’est la soutenance de deux thèses à la Sorbonne dont Emmanuel Kessler distingue le caractère révolutionnaire. EN 1892, Henri Bergson se marie. Il va mener à Paris une existence bourgeoise qui lui permet de se concentrer sur son activité philosophique.
En 1900, il est nommé à titre définitif au prestigieux Collège de France. Il y rencontre un grand succès et sa renommée s’étend. « Les années Collège de France qui se poursuivent jusqu’en 1914 sont marquées par un phénomène totalement inédit dans l’histoire de la philosophie. Le succès de son cours vaut à Bergson un engouement et une renommée considérable » (p 53), une renommée non seulement française, mais internationale. « La réputation de Bergson s’étend au delà de la France. Le phénomène est mondial. Jusqu’à la consécration du prix Nobel qu’il reçoit en 1928 et qui fait de lui un des français les plus connus du monde » (p 59). L’auteur met l’accent sur un atout de Bergson. « Il parle la langue de tout le monde ». « Une raison de fond a contribué à ce que sa philosophie se répande avec une telle ampleur… C’est son style » (p 61).
En 2007, paraît un livre fondateur de la pensée de Bergson : « L’évolution créatrice ». « L’objet de « L’évolution créatrice » – titre qui porte en lui-même une ouverture et une marche en avant – consiste précisément à appliquer à la vie en général, celle des espèces dont l’homme bien sûr, ce qu’il avait mis à jour en explorant la vie psychique : la durée qui « signifie à la fois continuité indivisée et création » (p 68). Tout n’est pas écrit et déployé à l’avance. « L’évolution répond à un mouvement dynamique et ouvert. Bergson va le nommer en utilisant un image : « l’élan vital » (p 69).
En 1914, un cataclysme intervient : la grande guerre. Henri Bergson prend parti pour son pays dan un élan patriotique que l’on peut juger excessif. Il ira en ambassade aux États-Unis susciter leur intervention militaire dans le conflit. Plus tard dans une perspective plus universaliste, il participera à la Société des Nations.
Dans l’entre-deux guerres, de nouvelles menaces apparaissent. C’est alors qu’Henri Bergson publie en 1932 une œuvre majeure : « les deux sources de la morale et de la religion ». « Bergson n’est plus ici le psychologue qui explore en notre moi intime les « données » de la conscience. Il se mue en sociologue, pour poser un diagnostic sombre sur l’état de notre civilisation et nous proposer un remède à ses maux » (p 149). « Il ne s’agit plus d’introspection, mais de politique ». Bergson dégage deux sources, deux directions, deux attitudes opposées capables d’orienter les comportements humains : la clôture et l’ouverture. On peut observer cette direction à la fois dans la société et dans la morale. Il y a des sociétés closes et des sociétés ouvertes. Et de même, il y a une religion statique et une religion dynamique. « Le texte des « Deux sources » nous met d’emblée face aux ambiguïtés les plus profondes du fait religieux » (p 155). Sur le plan politique, « il existe un régime qui répond à l’aspiration à l’ouverture. C’est la démocratie » (p 158).
A partir de 1925, Bergson est atteint de rhumatismes articulaires qui l’empêchent de se déplacer. Il continue à beaucoup travailler et séjourne à Paris. Tenté par le catholicisme à une époque où il sent monter l’antisémitisme, il reste dans le judaïsme, ayant vécu toute sa vie sans affinité avec celui-ci et hors de toute pratique. Il a pu ressentir la persécution du régime de Vichy juste avant de mourir en janvier 1941.
L’évolution créatrice
« L’Évolution créatrice », paru en 1907, a présenté une nouvelle vision. Il prend en compte les théories de l’évolution de Darwin et de Spencer. « Bergson intègre cette avancée scientifique, mais il ne s’en satisfait pas… Car on ne peut faire comme si tout était écrit et déployé d’avance » (p 68). « Pour être créatrice et traduire le fait que l’on retrouve dans la nature la durée qui a été mise à jour dans la conscience, l’évolution va répondre à un mouvement dynamique et ouvert… Bergson va le nommer en utilisant une image « l’élan vital… c’st une force, un courant qui porte la vie en général à travers le temps, la développe et l’enrichit… La réalité est « jaillissement ininterrompu de nouveautés dont chacune n’a pas plutôt surgi pour faire le présent qu’elle a déjà reculé dans le passé… Cet élan est l’« impulsion initiale » qui donne à la vie son évolution et permet de dire que « l’univers n’est pas fait, mais se fait sans cesse ». L’élan vital apparaît comme une « poussée intérieure » qui crée des formes nouvelles à chaque instant » (p 69). « Le monde devient ainsi « une création continuelle et continuée » (p 70). Mais comment envisage-t-il Dieu ? « Si la création est un événement qui s’est produit une fois pour toute à l’origine des temps, Bergson est bien anti-créationniste », explique un de ses meilleurs commentateurs, Vladimir Jankélévitch. Mais, poursuit-il, « il est créationniste et plus que créationniste, si il est vrai que la continuation elle-même est pour lui création, création continuelle et temporelle » (p 70). « Bergson nous propose une évolution créatrice qui commence en continuant » (p 70). C’est une vision dynamique. Mais Bergson a bien conscience des obstacles. « Dans cette période de changement, il nous invite à accorder aux transitions, c’est à dire aux mouvements, autant d’attention, sinon plus, qu’aux états figés » (p 73). Et il envisage les résistances : « L’évolution n’est pas seulement un mouvement en avant ; dans beaucoup de cas, on observe un piétinement sur place, et plus souvent encore une déviation ou un retour en arrière » (p 75).
Les deux sources de la morale et de la religion
Paru en 1932, le livre : « Les deux sources de la morale et de la religion » intervient dans une civilisation en crise. La guerre de 1914-1918 est passée par là. Et les menaces totalitaires sont désormais puissantes en Europe. Henri Bergson aborde la question en mettant en évidence deux attitudes opposées : clôture et ouverture. « Clôture et ouverture s’affrontent dans trois domaines : la société, la morale, la religion » (p 150). Emmanuel Kessler nous montre combien cette tension : « clôture- ouverture » est présente dans notre société aujourd’hui. Et cette même dualité se retrouve dans la morale.
« La morale close qui fédère les membres d’une société sert d’alibi à toutes les turpitudes… Face à cette morale close, se dresse une morale… ouverte. Comme une voix qui surgit de la conscience… La morale ouverte et qui vaut pour tous, dépasse le particulier pour atteindre l’universel » (p 154). « La lecture des « Deux sources » nous met d’emblée face aux ambiguïtés les plus profondes du fait religieux telles que nous les vivons encore aujourd’hui. Henri Bergson oppose cette fois la religion « statique » à la religion « dynamique » (p 155). Bergson souligne le rôle éminemment social de la religion. Il porte attention au christianisme « qui a porté plus haut, selon lui, l’aspiration morale à l’amour de l’humanité (p 157). Dans le même esprit, Bergson étudie également le fait politique. Et, selon lui, la forme de régime politique qui répond à l’aspiration à l’ouverture, c’est la démocratie. « De toutes les conceptions politiques, c’est en effet… la seule qui transcende, en intention au moins, les conditions de la « société close ». Elle attribue à l’homme des droits inviolables » (p 158). « A un ciment social générateur de violence et de haine dans la société close, Bergson oppose une ouverture démocratique définie par la « fraternité humaine » (p 159).
En quoi Bergson nous concerne-t-il ?
C’est une forte motivation qui a incité Emmanuel Kessler à écrire ce livre sur Bergson. Il s’en explique dans la conclusion : « Ce qui m’a conduit à retrouver le parcours d’un Bergson vivant et intensément présent de tous les temps plus encore que de son temps, c’est la conviction que les lignes de force de sa philosophie constituent non des réponses, mais des interpellations indispensables et fécondes ».
Bergson nous propose une prise en compte du réel, une philosophie de l’action. Le « bergsonisme » est un état d’esprit. Emmanuel Kessler en dégage quelques lignes de force.
« Restons ouvert ! La plus grande actualité du bergsonisme, c’est la distinction qu’il est le premier à opérer entre le clos et l’ouvert » (p 224). Effectivement aujourd’hui, cette distinction induit notre discernement. Face aux dérives actuelles, une société pacifique ne peut se constituer dans le paradigme de la clôture. L’ouverture s’impose.
« Le deuxième message concerne la science et la technologie. Bergson, et cela explique le choc qu’il a provoqué à son époque, est arrivé comme une protestation face à la croyance en la toute-puissance de la science et à la confiance absolue dans les vertus émancipatrices de la technique. La fin du XIXe siècle marque le triomphe d’un « positivisme » scientiste que Bergson conteste. La science est nécessaire, mais elle n’a pas, elle non plus, toutes les réponses… La science est faite d’incertitudes… La technique la plus sophistiquée remplacera jamais l’humain et sa capacité inventive » (p 225-226).
Emmanuel Kessler est également porté par l’attitude de Bergson vis-à-vis de la vie : « l’enthousiasme pour la vie, pour l’action vécue, pour l’obstacle surmonté » (p 226). C’est une « philosophie du oui » et même une « philosophie de la joie » (p 227). Bergson écrit ainsi : « Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l’homme n’ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie… La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu’elle a gagné du terrain, qu’elle a remporté une victoire… Partout là où il y a joie, il y a création : plus grande est la création, plus profonde est la joie » (p 227). L’auteur rebondit sur cet esprit de joie en évoquant la joie de la mère, de l’artiste, du savant, du commerçant, du chef d’entreprise. « Des différences de degré peut-être, mais une joie de nature commune et communicable, ouverte au partage, joie qui consiste à « avoir appelé quelque chose à la vie » (p 227).
Cette dynamique a retenti chez Emmanuel Kessler : « Hymne au nouveau, hymne à la joie, hymne à la vie : mon esprit m’avait guidé à l’issue de mes études de philosophie vers le journalisme par le goût du présent, de l’inédit, curiosité pour saisir ce mouvement qui sans cesse anime les sociétés humaines… » (p 228). Il rappelle le grand succès du livre de Bergson sur « le Rire » et il évoque en regard les films de Charlie Chaplin qui illustrent « la définition bergsonienne du comique » (p 229). Et par ailleurs, « avec le Chaplin des « Temps modernes », puis celui du « Dictateur », le rire devient l’arme du vivant pour résister à une mécanique implacable » (p 230). C’est sur cette note de liberté que l’auteur achève son éloge de Bergson.
Un état d’esprit partagé
La pensée d’Henri Bergson nous rejoint dans sa perspective de mouvement et d’ouverture.
Sa vision d’une évolution créatrice fut pionnière se heurtant aux rigidités religieuses ou matérialiste. Aujourd’hui, avec le théologien Jürgen Moltmann, dans son livre : « Dieu dans la création. Traité écologique de la création » (1988), nous pouvons envisager une « création continuée » (7). « La théorie de l’évolution appartient au lieu théologique de la création continuée « creatio continua »… Les formes de la conservation, du maintien, de la transformation et de l’accélération divines de la création doivent être présentées dans son histoire ouverte sur l’avenir, ce concept théologique de l’ouverture vers l’avenir reprenant et dépassant le concept d’ouverture de la théorie des systèmes… La théologie doit partir de l’idée que la création n’est pas encore achevée et n’a pas encore atteint son but ».
Le thème de l’ouverture est constamment présent dans l’œuvre de Bergson. Son livre : « Les deux sources de la morale et de la religion », nous offre une clé de compréhension de la vie sociale dans la dualité : clôture-ouverture. Cette tension est particulièrement marquée dans le monde d’aujourd’hui. Comme l’écrit Moltmann : « L’espérance eschatologique ouvre chaque présent au futur de Dieu. « Portes, ouvrez vos linteaux ; haussez-vous, portails éternels pour que le grand roi fasse son entrée. (Psaume 24.7) ». On imagine que cela puisse trouver sa résonance dans une société ouverte. Les sociétés fermées rompent la communication avec les autres sociétés. Les sociétés fermées s’enrichissent au détriment des sociétés à venir. Les sociétés ouvertes sont participatives et elles anticipent. Elles voient leur futur dans le futur de Dieu, le futur de la vie et le futur de la création éternelle » (8). Nous envisageons le processus de l’ouverture dans une dynamique spirituelle.
En nous présentant la vie et l’œuvre de Bergson, Emmanuel Kessler nous fait entrer dans un état d’esprit, ce qu’il exprime par ces mots : « Une philosophie du oui… Un hymne nouveau, un hymne à la joie, un hymne la vie ». C’est une vie en marche et nous la rejoignons dans une perspective d’espérance selon cette expression : « La vie dans l’espérance n’est pas une vie à moitié sous condition. C’est une vie pleine qui s’éveille aux couleurs de l’aube de la vie éternelle » (8).
C’est un éloge, lorsque nous disons de quelqu’un que c’est une personne ouverte. Après avoir lu ce livre, nous comprenons mieux pourquoi… Remercions Emmanuel Kessler pour sa lecture tonique d’Henri Bergson.
J H
- Un horizon pour l’humanité, la Noosphère : https://vivreetesperer.com/un-horizon-pour-lhumanite-la-noosphere/
- Frédéric Worms : https://philomonaco.com/intervenant/frederic-worms/
- Emmanuel Kessler. Bergson. Notre contemporain. Editions de l’observatoire, 2022. Interview vidéo d’Emmanuel Kessler sur son livre : https://www.youtube.com/watch?v=uZ1cahRaCak et : https://www.youtube.com/watch?v=r_9u_sr0-hc
- Le courage de la nuance : https://vivreetesperer.com/le-courage-de-la-nuance/
- Comprendre la mutation actuelle de notre société requiert une vision nouvelle du monde https://vivreetesperer.com/comprendre-la-mutation-actuelle-de-notre-societe-requiert-une-vision-nouvelle-du-monde/
- Jean Jaures : Mystique et politique d’un combattant républicain : https://vivreetesperer.com/jean-jaures-mystique-et-politique-dun-combattant-republicain-selon-eric-vinson-et-sophie-viguier-vinson-2/
- Jürgen Moltmann : Dieu dans la création. Traité écologique de la création. Chapitre VIII/II Evolution ou création ? http://www.unige.ch/theologie/distance/cours/ats3/lecon7/moltmann.htm
- Le Dieu vivant et la plénitude de vie. Eclairages apportés par la pensée de Jürgen Moltmann : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie/
 Si nous sommes là, le sommes-nous par hasard, comme une pièce isolée, un peu de temps avant de disparaître ? Nous sentons bien qu’il n’en n’est pas ainsi, que nous nous inscrivons dans un courant de vie. Et plus encore, nous ne sommes pas des acteurs isolés. Nous participons à une communion de vie.
Si nous sommes là, le sommes-nous par hasard, comme une pièce isolée, un peu de temps avant de disparaître ? Nous sentons bien qu’il n’en n’est pas ainsi, que nous nous inscrivons dans un courant de vie. Et plus encore, nous ne sommes pas des acteurs isolés. Nous participons à une communion de vie.
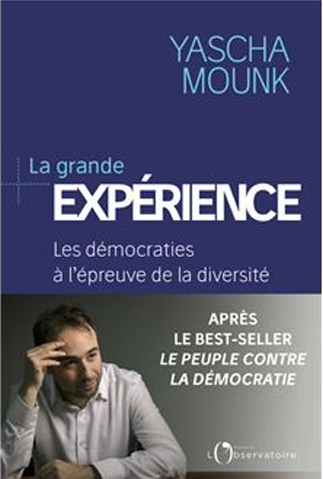
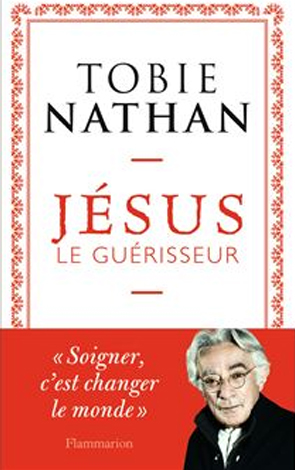
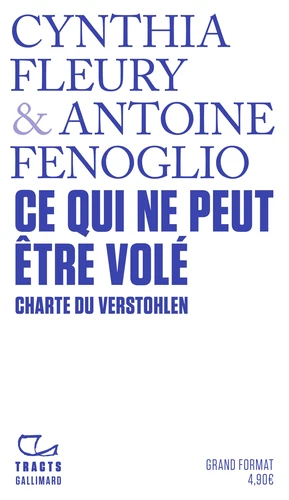 Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury
Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury