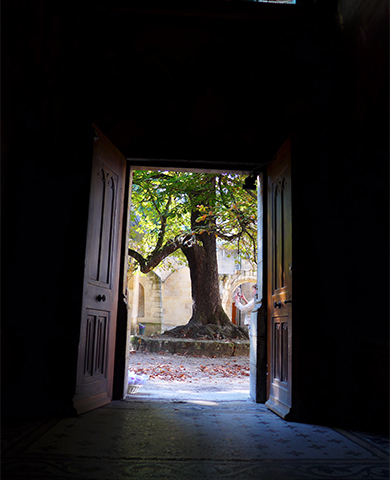par jean | Avr 12, 2023 | Vision et sens |
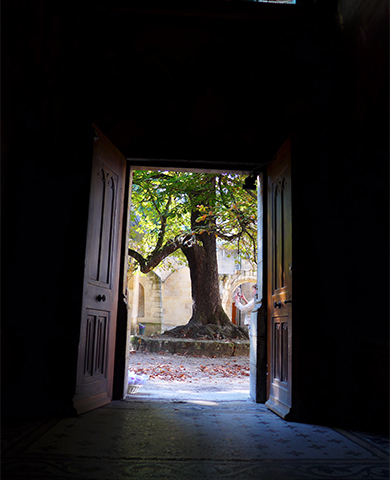 Selon Bertrand Vergely
Selon Bertrand Vergely
A plusieurs reprises, nous avons présenté sur ce blog des écrits de Bertrand Vergely (1). Bertrand Vergely, philosophe de culture et de conviction chrétienne orthodoxe, vient de publier un nouveau livre : « Voyage en haute connaissance. Philosophie de l’enseignement du Christ » (2). En page de couverture, ce livre est présenté dans les termes suivants : « Il existe aujourd’hui une crise morale et spirituelle très profonde en Occident, qui rend la vie fondamentalement absurde. L’absence de sens se traduit par une fuite dans les illusions et l’irresponsabilité. Bertrand Vergely propose une lecture stimulante et novatrice de l’enseignement christique qui nous montre comment naître à la vie spirituelle et grandir en conscience.
Quand la religion sort des visions politiques et dogmatiques léguées par l’histoire, spiritualité et philosophie se rencontrent. Le Christ n’est pas un adepte du dolorisme, ni uniquement un missionnaire social, il révèle surtout que nous avons en nous une destinée et des potentialités inouïes qu’il s’agit de découvrir ! ».
Ce livre est foisonnant. Les points de vue, les ouvertures se succèdent autour de l’enseignement du Christ, lui-même inépuisable. On ne peut résumer un tel ouvrage et nous ne nous sentons pas en mesure d’en rendre compte. C’est une approche originale. Bertrand Vergely ouvre et renouvelle les angles de vue. Nous ne le suivons pas toujours. Souvent, il nous déconcerte et nous nous interrogeons sur ses propos. Mais lorsque nous sommes perplexes, cela nous appelle à réfléchir plus avant.
A travers son interprétation des textes, son herméneutique, son exégèse, Bertrand Vergely nous ouvre de nouveaux horizons. Dans ce « voyage en haute connaissance », les visions se succèdent. Le parcours se déroulent en quelques grandes parties : « I Naître. S’ouvrir à la connaissance. II Grandir. Rompre avec l’agitation. III Libérer. Sortir du dolorisme. IV Resplendir. Rentrer dans la vie divine.
L’auteur nous aide à encourager chacun de ces mouvements : naître, grandir, libérer, resplendir dans une meilleure compréhension et un immense émerveillement. Parce que nous constatons fréquemment un écart entre cette élévation et un repli en terme de culpabilité, en terme de complaisance et d’enfermement dans la souffrance, nous évoquerons ici la séquence : « Libérer. Sortir du dolorisme ».
L’auteur décline cette partie en six chapitres : Sortir de la culpabilité, sortir de la malédiction, sortir du mérite, sortir de la punition, sortir de l’ignorance, sortir de l’obscurité.
Sortir de la culpabilité
Issu de Saint Augustin, le dogme du péché originel a assombri le christianisme occidental pendant des siècles. Dans son livre : « Oser la bienveillance » (3), la théologienne Lytta Basset a mis en évidence le mal-être engendré par cette représentation pervertie de la nature humaine. Elle-même en a souffert pendant de nombreuses années. Elle a vécu au départ une hantise de la question de la culpabilité, de la faute et du péché. « Autre préoccupation qui appartient à la préhistoire de ce livre : Dans les déclarations publiques comme dans les accompagnements spirituels, je suis frappée par l’image négative que les gens ont d’eux-mêmes et des humains en général ». « Ma réflexion a donc eu pour point de départ mon propre malaise par rapport à la question du péché et à l’image désastreuse qu’elle nous avait donné de nous-mêmes ». Il y a dans ce livre un parcours particulièrement utile pour engager un processus de libération par rapport à des représentations qui emprisonnent et détruisent. A partir de cette perspective, Lytta Basset propose une vision nouvelle fondée sur son expérience de la relation humaine et sur sa lecture de l’Evangile.
Dans un autre contexte, l’historienne et théologienne américaine, Diana Butler Bass, a vécu, dans sa jeunesse, une emprise religieuse mortifère dont elle a pu s’échapper (4). Ainsi a-t-elle, à l’époque, fréquenté un séminaire où elle s’est sentie formatée dans une vision de plus en plus sombre de l’humanité. Les humains étaient considérés comme de misérables pécheurs. « Il y avait désormais un fossé entre la dépravation de l’humanité et la sainteté divine ». Le culte devenait un exercice « de réaffirmer le péché et d’implorer le pardon ». « Je m’effondrais dans l’obscurité, intellectuellement convaincue que l’humanité était mauvaise, tombée si bas qu’il ne restait plus rien de bien, entièrement dépendant d’un Dieu qui pouvait dans sa sagesse, choisir de sauver quelques-uns parmi lesquels je priais avec ferveur de figurer ». Par la suite, Diana, à travers des études historique, a pu déconstruire cette impérieuse « certitude théologique ».
Dans d’autres contextes encore, on pourrait évoquer une incessante auto-surveillance dans une délibération sur la qualification des péchés, entre péché mortel et péché véniel, dans la perspective de la confession. A l’époque, un livre était paru ave un titre significatif : « L’univers morbide de la faute ».
Bertrand Vergely décrit avec justesse l’univers socio-religieux dans lequel la culpabilité s’impose. « A l’origine, est-il dit, on trouve le Bien et le Mal. Le Bien est l’ordre voulu par Dieu, le Mal, ce qui s’oppose à cet ordre. Agir consiste à obéir au Bien. Lorsqu’on choisit le Bien et qu’on lui obéit, on va au paradis. Lorsqu’on choisi le mal, on va en enfer. Le Christ est venu faire triompher le Bien contre le Mal. En acceptant de souffrir et de mourir sur la croix, il a été et il est le modèle absolu de l’obéissance qu’il convient de suivre. Il a été le mérite même en montrant comment il faut mériter. Cette vision-là a beaucoup existé de par le passé. Elle existe encore, bien plus qu’on ne le pense » (p 164). Bertrand Vergely impute cette conception à une volonté de puissance de l’organisation. « Pour tout un christianisme, si l’on veut demeurer une réalité collective qui dure à travers le temps, il n’y a pas d’autre solution que d’organiser cette réalité de façon militaire en créant un ordre et l’obéissance à cet ordre… Pour des raisons politiques, le christianisme a été organisé sur la base d’un modèle à la fois militaire et méritocratique. Il continue de l’être. Modèle ambigu. En apparence, il respecte la foi et Dieu. En profondeur, il les évacue subtilement » (p 165).
En remontant à l’origine, à la Genèse, « tout est créé par le Verbe. Il s’agit là d’une rupture radicale avec toute culpabilité…
Le Verbe est la divine intelligence qui rend toute chose lumineuse en la rendant parlante. Dieu créant tout par le Verbe, il y a là une nouvelle vertigineuse. Tout existe parce que tout est amené à l’existence par une divine information… Autre trait qui rompt ave la culpabilité : Dieu crée la terre et trouve cela bien. Dieu crée, mais le bien n’est pas donné au départ. Il résulte de la création qui apprend quelque chose à Dieu. Pour que le bien existe, il a fallu que la création ait lieu. Le bien étant ainsi création accomplie, on comprend le divin contentement… Un troisième élément vient confirmer cette vision très déculpabilisée. Dieu ne veut pas garder Dieu pour lui. Quand il crée l’homme, il le crée non seulement à son image, mais pour sa ressemblance avec lui. L’homme qui est créé par Dieu, est habité par le Verbe divin et l’information céleste qui lui permettent d’être ce qu’il est. Par cette information, il est appelé à informer le monde, l’humanité et l’existence… Cette vision dépourvue de toute honte est couronnée par l’état dans lequel sont l’homme et la femme. Nus, ils n’en ont pas honte. La nudité désigne l’état de connaissance absolue… » (p 167-168).
Bertrand Vergely ne voit également aucune culpabilité dans la chute de l’homme. « Quand il est raconté que l’homme, ayant le choix entre le bien et le mal, a choisi le mal en raison de sa volonté mauvaise, on invente, le récit de la chute montrant tout autre chose. Le récit, dit du péché originel, se trouve au chapitre 3 de la Genèse. Comme toute la Genèse, ce récit est un récit de libération. Il s’agit de comprendre la condition humaine. Tout vient de la connaissance. L’homme est invité à tout connaître, mais il importe de ne pas tout connaître avant l’heure. La connaissance est inséparable du temps de la connaissance qui renvoie à l’assimilation intérieure… » (p 171). Que nous enseigne le récit de la chute ? « Avant tout, à l’origine, il n’y a nullement une volonté mauvaise, mais bien plutôt une perte de volonté. Qui n’est plus lui-même, rompt sa relation avec la divine connaissance, non parce qu’il est méchant et révolté, mais parce qu’il n’est plus capable de vouloir. Quand on se laisse capturer par la séduction, ne connaissant plus rien d’autre, on cesse de connaître ce que l’on aimait…(p 171-172). C’est un drame, mais « tout n’est pas perdu pour autant. Après la mise au point sur le péché de l’homme, à savoir son éloignement de Dieu », une autre réalité apparaît : « Quand on a mal agi, il est beau d’en avoir honte, d’être conduit à le dire. Commence alors le début d’un retournement intérieur conduisant à retrouver la connaissance perdue. La Genèse le signifie par l’homme et la femme qui se cachent quand ils entendent la voix de Dieu. La divine connaissance ne peut pas être vécue sans un état intérieur divin. Quand cet état n’existe pas, c’est en séparant la connaissance divine de ce qui n’est pas divin, que l’on préserve la connaissance. Dans la Genèse, c’est exprimé à travers l’exclusion du jardin d’Eden. Cette exclusion prépare le renouveau de la connaissance » (p 172-173).
On s’interroge à propos de l’origine du mal. Le mal est supposé venir d’un principe méchant. Mais, l’interprétation de Bertrand Vergely est autre. « C’est l’éloignement de Dieu et avec lui, l’ignorance qui rend méchant et non une méchanceté foncière. On ne sait pas qui on est. Voilà pourquoi on ne sait pas ce que l’on fait, et ce que l’on fait de pire. Cette ignorance n’est pas un accident. Elle provient d’un état intérieur, en l’occurrence d’un manque total d’intériorité… » (p 173).
Dans ce mouvement de libération à l’égard de la culpabilisation, Bertrand Vergely nous appelle à lire le prologue de l’évangile de Jean après la Genèse. Dans ce prologue, on retrouve ce qui se trouve déjà dans le récit de la Genèse. « Dieu qui crée, crée le monde et l’Homme par la Parole. Il crée pour que la vie divine se diffuse partout, dans l’invisible comme dans le visible » (p 174). Le concept de transmission est très présent « Le Royaume, qui veut dire transmission, est diffusion » Dans le prologue de Jean, on lit : « La lumière a été envoyée dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas retenue ». « Cette parole a été mal traduite. Ne pas recevoir ne veut pas dire rejeter, mais ne pas pouvoir contenir. La Lumière divine est tellement lumineuse que rien ne peut la contenir ni l’arrêter. On a là le fondement de la connaissance divine… Dans la Genèse, l’échec concernant la connaissance de Dieu vient de la faiblesse et des limites humaines. Dans le prologue de Jean, l’échec concernant la connaissance de Dieu est la gloire même de Dieu. Dans la Genèse, l’homme retrouve la connaissance à travers la noble honte. Dans le prologue de Jean, il trouve la connaissance dans l’humilité » (p 175).
Sortir de la punition
Bertrand Vergely aborde la question du mal. C’est là, qu’entre autres, il évoque l’usage de punition dans un prétendu service du bien.
« Lorsqu’il fait passer le mal pour le bien, le mal se sert toujours de la justice. En punissant, il peut faire du mal en toute impunité. Il ne punit pas. Il œuvre pour le bien. Il purifie… Il est tentant de punir. Les bourreaux ne résistent jamais à se faire passer pour des justiciers venant punir afin de rétablir la justice. Cela éclaire l’autre face du mal. S’il ne va pas de soi de ne pas subir, il ne va pas de soi de ne pas faire subir. A chaque fois que l’on a affaire à une tentative de prise de pouvoir, cela ne manque jamais : l’aspirant au pouvoir ne dit pas qu’il veut le pouvoir, il veut la justice… » (p 206).
En regard, l’attitude du Christ est claire. « Le Christ n’est pas venu punir. Il n’est pas venu condamner la femme adultère. Il est venu au contraire mettre fin au mensonge de la punition permettant par exemple de lapider une femme en toute bonne conscience au nom de la justice. Il a ensuite été condamné à mort et exécuté. Ce n’est pas étonnant. Dénonçant le mensonge de la punition, il a été puni par ceux qui entendent pouvoir punir en toute impunité » (p 206).
« On ne remet pas facilement en cause la morale et la religion punitive… Dans le domaine religieux, on s’en rend compte. La difficulté voire l’impossibilité de se délivrer d’une religion punitive et sacrificielle en témoigne. L’impossibilité de se délivrer d’un Dieu punitif et sacrificiel aussi » (p 207).
« La tradition qui pense que le Christ est venu souffrir pour nous les hommes est inséparable de celle qui punit et qui magnifie le sacrifice. Souffrir, punir, se sacrifier, la logique est la même. Il faut mériter. Pour mériter, il faut souffrir. On souffre quand on se sacrifie. On se sacrifie quand on se sacrifie pour se sacrifier. Afin de parvenir à un tel résultat, un rituel sacrificiel s’impose. Il faut qu’il y ait le sacrifice suprême, à savoir la mort pour la mort, pour que, le sacrifice absolu étant fondé, le sacrifice le soit. Avec un coupable, il y a de la justice. Avec un innocent, la mort étant la mort pour la mort, il n’y en a pas. La mort est alors sure d’être sacrée. Sacrée, elle peut fonder le sacrifice, la souffrance, l’obéissance et le mérite » (p 207).
Dans les sociétés hiérarchisées, une pression s’exerce en faveur de l’obéissance. « Les sociétés humaines sont perdues quand les hommes n’obéissent pas. Présenté comme l’innocent qui accepte de mourir pour mourir, faisant vivre une mort sacrée à travers une mort absolue, le Christ devient celui qui fonde l’obéissance et le mérite, et sauve les sociétés humaines. Il conforte l’idée qu’il faut obéir à la société. Dieu veut qu’on lui obéisse et il offre son fils pour cela » (p 208).
On peut s’interroger sur la position du christianisme sur cette question dans l’histoire. Bertrand Vergely a démonté les mécanismes de la religion punitive et sacrificielle. Le christianisme ne doit pas être une religion de la souffrance et du sacrifice. « Le pouvoir, le mérite, l’obéissance, la souffrance ne sont pas les buts célestes. Dieu attend des hommes qu’ils fassent mieux que mériter, souffrir, obéir et se sacrifier. Les premiers chrétiens l’entendent. C’est la raison pour laquelle ils ne poursuivent pas de but politique… » (p 208). L’auteur s’interroge ensuite sur l’attitude de Paul et les conséquences du désir de celui-ci de rallier une communauté juive traditionnaliste.
Sortir de l’ignorance
Bertrand Vergely évoque un texte de Péguy qui reproche aux « honnêtes gens », caricaturant ainsi les bourgeois du XIXe siècle, de se draper dans une armure, de refuser toute vulnérabilité et de ne se prêter à aucune repentance. « Ils ne présentent pas cette entrée à la grâce qu’est essentiellement le péché. Parce qu’ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables… Parce qu’ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne panse point celui qui n’a pas de plaies… » (p 211). Bertrand Vergely commente ce texte en le situant dans son contexte. « Ce texte qui souhaite au bourgeois sûr de lui de souffrir est un texte de salut, sur le salut et pour le salut. Si le bourgeois souffre, comprenant qu’il ne peut pas se sauver tout seul, il va devenir humble. Il sera sauvé. Certes, il y a le salut, mais à quel prix ! Péguy s’inscrit dans la tradition d’un christianisme doloriste. Pour lui, cela ne fait pas de doute : la souffrance rend humble et Dieu sauve les humbles qui souffrent. Il oublie qu’il n’y a pas que la souffrance qui rend humble. La lumière divine rend humble. Le Verbe rend humble. L’aventure de la connaissance rend humble » (p 213) Un autre danger de ce genre de raisonnement, c’est d’induire que « Dieu fait exprès de faire chuter l’homme et de le faire souffrir pour mieux le sauver ». Ainsi Bertrand Vergely conclut que « pour aller vers le salut, occupons-nous de ce qui nous illumine et non de ce qui nous assombrit. Dieu se trouve dans ce qui sauve l’humanité et non dans ce qui fait exprès de la faire chuter pour mieux la sauver » (p 214). L’auteur pointe également un autre danger : l’exaltation de la souffrance. « Péguy a choisi les siens. Il est du côté des victimes, de ceux qui souffrent. Ce sont eux qui sauvent le monde. Tout un christianisme se fonde donc sur la figure du pauvre, de celui qui souffre, de la victime. Dieu, c’est eux. Le salut, c’est eux… Cet élan du cœur se comprend. Il n’en est pas moins désastreux. En faisant de la douleur ce qui sauve, on finit par faire d’elle non seulement un Dieu, mais ce qui le crée. C’est parce que l’homme est à terre que Dieu peut sauver et sauve, dit Péguy. Donc, c’est la douleur qui crée Dieu » (p 217). Selon Bertrand Vergely, il y aurait une complaisance dans la douleur. « Le moi, afin de s’imposer, crée un Dieu à sa mesure. Avec la douleur, il en va de même. Les victimes ayant besoin d’être réconfortées, elles créent une vision de la douleur qui invente Dieu et le salut… » (p 217). Bertrand Vergely situe cette attitude vis à vis de la souffrance au XIXe siècle et jusqu’à nos jours. Et en évoquant « la dérive qui enfonce le monde au lieu de le libérer », il en voit la traduction dans une représentation du Christ « crucifié, les yeux fermés, le visage ensanglanté par une couronne d’épines, les mains transpercées par des clous, seul, absolument seul » (p 218). A vrai dire, cette représentation remonte très loin dans le temps. L’auteur l’évoquait au début de son livre : « A Belem, non loin de Lisbonne, au Portugal, dans l’église du monastère des Hiéronymites, on peut voir un Christ grandeur nature crucifié, souffrant et ensanglanté. On est loin du Christ glorieux. Il faut souffrir, dit ce Christ, et il faut faire souffrir parce qu’il faut obéir et faire obéir. Message politique venu de loin, des légions romaines avec leur culte de l’ordre qui a inspiré tout un christianisme et l’inspire encore » (p 16-17).
Bertrand Vergely en vient à évoquer comment il envisage la confrontation avec la souffrance. « Face à la souffrance, la douleur est une attitude possible. Il y en a une autre. Elle repose sur l’être. La souffrance renvoie à l’expérience du retournement qui fait passer du refus de subir à la capacité de supporter. Entre les deux, il y a cet entre-deux qui forme l’attente consistant à être en souffrance » (p 218). On cherchera à comprendre cette manière de voir en se reportant aux explications de l’auteur. Il envisage cet entre-deux comme un hors temps. « Qui fait le vide, fait silence. Qui fait silence, fait taire le mental. Qui fait taire le mental fait taire la tentation d’être la victime… Quand ce silence se fait, l’être pouvant parler, il peut enseigner. Pouvant enseigner, il peut vraiment guérir et sauver » (p 219). Bertrand Vergely voit dans cette réflexion un éclairage pour envisager ce qu’il appelle : le sommeil céleste. Il nous introduit là dans un univers chrétien où la croix n’apparaît pas en termes morbides. C’est l’exemple du christianisme orthodoxe. « L’orthodoxie ne représente pas le Christ sous la forme d’un crucifié sur une croix. Quand il y a des représentations de la croix, celles-ci sont des icônes et non des tableaux. Une icône n’est pas un tableau et un tableau n’est pas une icône. Un tableau a pour but de représenter la réalité matérielle. Une icône a pour but de laisser passer la lumière divine… Avec une icône, la réalité matérielle et humaine est le reflet du ciel et du divin » (p 219). Bertrand Vergely engage une méditation sur la signification de la Croix auquel sera consacré son chapitre : « Sortir de l’obscurité ». Ici, il traite de la victoire sur la mort : « Par la mort, il a vaincu la mort », clame l’hymne pascal des églises orthodoxes pour célébrer la résurrection du Christ. Mourir, c’est aller au ciel et non dans la mort. La mort ne met pas le ciel en échec. C’est plutôt le ciel qui met la mort en échec. Le Christ dormant sur la croix est là pour le rappeler. Il est là pour que l’on fasse silence en stoppant le mental. Ne donnant pas à voir une victime dévorée par la douleur, mais un endormi céleste, l’icône de la croix rend impossible toute la mécanique mentale et politique qui se met en marche dès que le regard aperçoit une victime ».
(p 220).
Certes, aujourd’hui, le dolorisme a reculé en France. Mais, une telle mentalité religieuse associée à des justifications théologiques laisse des traces. Comme l’écrit Bertrand Vergely, « cette vision-là a beaucoup existé dans le passé. Elle existe encore bien plus qu’on ne le pense » (p 164). Récemment encore, une amie me faisait part d’un vif ressenti à cet égard. Dans les années 1970, au cours d’une séance de catéchisme le vendredi saint, ses garçons avaient été contraints de venir embrasser le Christ souffrant en croix. Et ils en étaient revenus très choqués. « Maman, je ne veux plus aller au catéchisme. Ce n’est pas nous qui avons tué Jésus-Christ ». On pourrait évoquer aussi des prédications où la résurrection compte peu par rapport à une crucifixion salvatrice. Refuser le dolorisme, c’est choisir une autre perspective théologique. C’est l’approche de Bertrand Vergely. Dans un autre contexte, nous évoquerons le livre de Jürgen Moltmann : « The living God and the fullness of life » (Le Dieu vivant et la plénitude de vie) (5). Il y écrit : « Pourquoi le christianisme est-il uniquement une religion de la joie, bien qu’en son centre, il y a la souffrance et la mort du Christ sur la croix ? C’est parce que, derrière Golgotha, il y a le soleil du monde de la résurrection, parce que le crucifié est apparu sur terre dans le rayonnement de la vie divine éternelle, parce qu’en lui, la nouvelle création éternelle du monde commence. L’apôtre Paul exprime cela avec sa logique du « combien plus ». « Là où le péché est puissant, combien plus la grâce est-elle puissante ! » (Romains 5.20). « Car le Christ est mort, mais combien plus, il est ressuscité » (Romains 8.34). Voilà pourquoi les peines seront transformées en joie et la vie mortelle sera absorbée dans une vie qui est éternelle » (p 100-101).
J H
- Avant toute chose, la vie est bonne : https://vivreetesperer.com/avant-toute-chose-la-vie-est-bonne/ Avoir de la gratitude : https://vivreetesperer.com/avoir-de-la-gratitude/ Dieu vivant : rencontrer une présence : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-rencontrer-une-presence/ Dieu veut des dieux : https://vivreetesperer.com/dieu-veut-des-dieux/ Le miracle de l’existence : https://vivreetesperer.com/le-miracle-de-lexistence/
- Bertrand Vergely. Voyage en haute connaissance. Philosophie de l’enseignement du Christ. Le Relié, 2023
- Bienveillance humaine. Bienveillance divine : une harmonie qui se répand : https://vivreetesperer.com/bienveillance-humaine-bienveillance-divine-une-harmonie-qui-se-repand/
- Libérée d’une emprise religieuse : https://vivreetesperer.com/liberee-dune-emprise-religieuse-2/
- Le Dieu vivant et la plénitude de vie : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie/

par jean | Juin 9, 2024 | ARTICLES, Vision et sens |
Comment la conscience de la divinité de Jésus est apparue, engendrant une nouvelle psyché humaine et le bouleversement du monothéisme traditionnel ?
« When did Jesus become God ?” par Ilia Delio
Dans notre monde en mutation, notre culture en pleine transformation, nous cherchons une nouvelle compréhension de notre état religieux et spirituel qui prenne en compte ce bouleversement. Dans cette recherche, il est bon de conjuguer une réflexion théologique et une compétence scientifique. Or, il y a bien des lieux où cette recherche est en cours, entre autres au ‘The Center for Christogenesis’ (1) animé, aux Etats-Unis par Ilia Delio (2), une sœur franciscaine hautement diplômée et qualifiée dans le domaine de la biologie et des neurosciences et théologienne notamment inspirée par Teilhard de Chardin. Délivrée des arcanes d’un catholicisme traditionnel, elle travaille dans un espace irrigué par une avancée scientifique et technologique spectaculaire et la conscience d’une transformation des mentalités. Nous présentons ici un des essais publié sur son site : « When did Jesus become God ? » (3). Dans d’autres textes, son approche des enseignements induits par la révolution scientifique et technologique en cours donne lieu à controverse. Mais ici, sa réflexion théologique, fondée sur une approche historique et psychologique à partir du Nouveau Testament, nous parait éclairante. Elle nous montre comment la prise de conscience de la divinité de Jésus dans les premiers temps va de pair avec la transformation de la psyché humaine qui s’est réalisée à l’époque. Cette analyse est une porte ouverte pour nous aider à reconnaitre aujourd’hui le transcendant divin à l’intérieur de nous : « recognize the transcendant divine ground within us ».
En avant-propos, Ilia Delio nous indique le sens de sa démarche : Dieu est un autre nom pour désigner la personne. La mutation chrétienne est le développement de la personnalité dans la liberté et l’amour ( « God is another name for personhood. The christian mutation is the development of personhood in freedom and love »).
L’émergence de la dévotion envers Jésus dans l’Église primitive.
Ilia Delio commence par nous inviter à mesurer combien la divinité de Jésus n’était pas évidente au départ dans le groupe de ses premiers disciples. A ce sujet, elle cite une théologienne australienne Anne Hunt : « Être chrétien avec la conviction de foi chrétienne que Jésus est divin et que Dieu est trinitaire, tend à voiler le caractère profondément révolutionnaire et radical qu’a représenté le développement de la conscience divine de Jésus pour ses disciples. Comme ceux-ci, Jésus était juif. Fidèles à leur tradition, ils tenaient une notion monothéiste exclusiviste de Dieu et de la dévotion à Dieu. Cependant leur expérience de Jésus suscitait chez eux un changement vraiment incroyable dans leur conscience de Dieu et une réinterprétation radicale de leur foi en un Dieu unique qui en viendrait éventuellement à s’exprimer dans la doctrine chrétienne de la Trinité ».
Ilia Delio trouve qu’il y a là « un mouvement vraiment fascinant ». « Comment est-ce qu’une compréhension de Dieu entièrement nouvelle a-t-elle émergé dans la vie d’un jeune homme juif, du nom de Jésus de Nazareth ? Les chercheurs s’accordent sur le fait que la mentalité religieuse des premiers chrétiens étaient façonnée par la tradition juive et que les disciples cherchaient à comprendre la signification de la vie de Jésus dans la relation à l’ancien Testament. La mort de Jésus et l’expérience de la résurrection de Jésus a conduit les disciples à proclamer que Jésus est Seigneur.
Quelle a été l’expérience psychologique transformante des premiers disciples ?
Ilia Delio fait appel à la recherche d’un chercheur bénédictin Sebastian Moore qui a cherché à déchiffrer l’expérience psychologique des premiers disciples.
« Ce qui comptait dans cette nouvelle expérience de la conscience de Dieu en la personne de Jésus, c’était une conscience nouvelle qui ne pouvait refléter plus longtemps un strict monothéisme (un Dieu), mais une nouvelle compréhension de la puissance de Dieu, une puissance partagée exprimée dans une perspective binitarienne (le Père et le Fils), qui éventuellement évoluerait vers la doctrine de la Trinité ». Ilia Delio se réfère ensuite à un chercheur spécialisé dans le Nouveau Testament tardif, Larry Hurtado : « Les premiers disciples ont vécu une mutation de conscience qui les a mené à chercher un fondement scripturaire pour la révolution chrétienne. Tandis que l’Ancien Testament utilise l‘imagerie d’un agencement divin tel qu’en Psaume 110.1 : « l’Éternel a déclaré à mon Seigneur : « Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’ai fait de tes ennemis ton marchepied » et le Livre de Daniel 7.14 : « On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et langues le serviront… » et ainsi aussi les écrits du Nouveau Testament tels que Romains 1.4 utilisent l’agencement divin pour décrire la divinité de Christ, « né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté par la résurrection d’entre les morts ». De même, en Actes 2.36, la résurrection de Jésus est conçue comme impliquant son exaltation à une position céleste d’importance majeure dans le plan de rédemption de Dieu. Essentiellement, comme Hurtado le souligne, Jésus de Nazareth a été associé à l’agencement divin que Paul a hérité du premier cercle de chrétiens juifs palestiniens et qu’il a lui-même élaboré partir de sa propre réflexion sur la signification de Christ ».
Le changement est apparu également dans les modes de dévotion. Selon Hurtado, « la dévotion chrétienne précoce a constitué une mutation significative dans le monothéisme juif. Il y a eu là une émergence d’une association étroite entre Dieu et Jésus-Christ et d’un mode monothéiste binitarien d’adoration et de prière ». « Les disciples ont fait l’expérience d’une présence énergétique nouvelle de Dieu en la personne de Jésus. Et une nouvelle conscience religieuse de la puissance d’amour de Dieu a jailli en eux. La transition du Jésus juif à Jésus- Christ, fils de Dieu, a fait irruption soudainement et rapidement et non graduellement et tardivement ». A partir de son origine, elle s’est rapidement étendue.
Une conscience nouvelle de la présence de Dieu
Ilia Delio nous parle ici en terme d’expérience spirituelle. « Si les disciples ont eu une conscience unique de Jésus comme Dieu, c’est parce que Jésus lui-même a manifesté une conscience nouvelle de la présence de Dieu. Comme Carl Jung l’a noté, Jésus est parvenu à un niveau supérieur, un niveau nouveau de la conscience de Dieu à l’intérieur de lui-même, réalisant un processus d’individuation et atteignant un niveau nouveau de liberté et ainsi un nouveau sens de mission. Selon Jung, les religions monothéistes ont évité la dimension psychique de le personnalité humaine, ce qui a conduit à une conception rétrécie de Dieu ». En ce sens, Ilia Delio pousuit : « Les chrétiens, en particulier, ont exclu la dimension psychique de la vie de Jésus de toute considération doctrinale, alors que c’est exactement ce qui distingue Jésus de Nazareth, une conscience nouvelle de la présence de Dieu qui l’a mené à ses actions radicales d’inclusivité, de guérison, de compassion et ultimement de sacrifice de soi.
L’expérience d’une nouvelle expérience immanente de Dieu est à l’origine de la dévotion à Jésus ». En suivant l’analyse de Sebastian Moore, Ilia Delio retrace trois étapes dans le développement de cette dévotion. La première étape fut « un éveil du désir lorsque les disciples firent l’expérience d’une joie et d’une extase dans leur interaction avec Jésus en Galilée, un sens nouveau et captivant de Dieu, un sens de Dieu délivré du fardeau du péché et de la culpabilité, le sens d’un Dieu ni éloigné, ni dominateur, mais une présence aimante et compatissante ». Cependant, au cours d’une deuxième étape marquée par la mort terrible de Jésus, les disciples ont fait « l’expérience de la désolation et du sentiment que tout était perdu. La mort de Jésus les a précipité dans une profonde crise spirituelle marquée par le désespoir, la honte et la confusion… Au sens jungien, les disciples subissait la mort de l’ego ».
Une troisième étape a suivi. « Moore suggère que la mort de Jésus a créé un sentiment de la mort de Dieu chez les disciples et que, avec l’apparition de Jésus ressuscité, ils ont fait l’expérience de Jésus ressuscité comme rien de moins que l’expérience renouvelée de Dieu en leur sein. Le Dieu de Jésus, le Père qui était mort avec Jésus et qui maintenant déclare son amour dans la résurrection de Jésus, Le Dieu qui est l’auteur de ce plan aimant et donneur de vie, réémergeait dans une puissance nouvelle ». Ils ressentaient que Jésus était Dieu. « Au début, ce fut un déplacement de la divinité vers Jésus qui devint le centre de leur nouvelle conscience de Dieu. Cependant, les disciples ne pouvaient appréhender cette extension de la divinité à Jésus sans que quelque chose prenne place à l’intérieur d’eux-mêmes. C’est au niveau de la conscience personnelle que cette nouvelle réalité a émergé. Selon Moore, c’est le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus qui a été la clef de la transformation radicale de la conscience de Dieu, une transformation qui a commencé avec leur expérience de Jésus dans son ministère terrestre et qui a été purifiée par la mort et la résurrection de Jésus ».
Une révolution théologique
Ilia Delio met en valeur le rôle majeur de la résurrection dans la transformation de la vision des disciples. « Pour eux, Dieu a émergé à nouveau vivant dans la personne même de Jésus, vivant comme jamais avant, avec une nouvelle compréhension d’eux-mêmes et de Jésus, radicalement transformée, libérée, énergisée ». C’est ainsi qu’une nouvelle vision théologique a émergé. « La mutation chrétienne a été une révolution théologique et une évolution de la personne humaine. La puissance du Dieu monothéiste a été éveillée dans la personne humaine comme la puissance d’une vie nouvelle révélée en Jésus et énergétisée par l’Esprit. Le langage de la Trinité a été une sténographie de la puissance partagée de l’amour, étendue dans la création par la Divinité… La transition du monothéisme au théisme binitarien, puis au théisme trinitarien, est une évolution de la conscience religieuse qui a des implications radicales pour une présence nouvelle de Dieu dans le monde et un nouveau genre de personne dans la montée d’un nouvel ordre mondial ».
Ultérieurement, une grande déviation théologique
La politisation de Dieu au Concile de Nicée en 325 et le mariage entre Athènes et Jérusalem ont mené à une héllénisation de la doctrine qui a provoqué une abstraction du langage philosophique dépouillé de sa dimension psychique. Le langage de la nature divine, essence, être et substance, devint une sémantique logique. La mutation chrétienne était avortée et la révolution de la puissance divine introduite par Jésus de Nazareth ne murit jamais. Au lieu d’une nouvelle puissance divine d’amour agissant dans le monde à l’intérieur de la personne humaine et à travers elle, ce qui a émergé, c’est l’internalisation du pouvoir divin exprimé dans un Dieu patriarcal… Comme la doctrine était institutionalisée, l’accent est passé de l’orthopraxie à l’orthodoxie. Le triomphe de l’institution patriarcale a supprimé la psyché humaine et a rendu impuissante la mutation chrétienne ».
Ilia Delio met en évidence l’ampleur du désastre. « Si la mutation chrétienne avait échappé à la politique de puissance et à la main-mise du patriarcat…, nous aurions probablement une église et un monde entièrement différents. Mais le nouveau mouvement était trop jeune et trop fragile pour y échapper : l’institutionnalisation du christianisme lui donna le pouvoir de modeler le premier millier d’années de la civilisation occidentale donnant naissance à une psyché sans Dieu et une humanité sans aucun vrai projet collectif ».
La primauté de l’expérience
Quelle est la portée de formulations doctrinales si elles ne s’appuient pas sur l’expérience ? Ilia Delio exprime la primauté de l’expérience : « Il me semble qu’à notre époque, le premier besoin théologique est que le psychologique assure la médiation du transcendant ». Elle précise : « Le seul vrai but du christianisme est d’éveiller le transcendant divin au niveau de la psyché. Tout le reste est mortel. La divinité de Jésus ressuscité et la nature trinitaire de l’être divin ne sont pas seulement des doctrines théologiques, mais des réalités profondément psychologiques. L’expérience des mystères à un niveau profondément psychologique est nécessaire avant leur expression dans la prière et la dévotion et avant l’articulation à une doctrine. La tâche de porter la foi et le sens religieux à la conscience contemporaine demande une médiation expressément psychologique, un éveil profondément personnel par lequel l’histoire de Jésus rencontre et transforme notre propre histoire personnelle »
Un enjeu majeur
Ilia Delio n’est pas seulement une théologienne, elle est également une scientifique qui suit de près l’avancée des sciences et des technologies. Elle est attentive à l’évolution du monde et à la mutation en cours de celui-ci. C’est dans cette perspective qu’elle situe la requête spirituelle et l’offre de la foi chrétienne. « Nous sommes aujourd’hui dans une étape de vie entièrement nouvelle au sein d’un univers en expansion. Nous en savons beaucoup plus sur la matière et l’esprit et nous avons une opportunité de changer le cours de l’histoire en portant la mutation chrétienne en alignement avec la science moderne et la cosmologie. Si nous ne le faisons pas, nous serons confrontés à des conséquences désastreuses. Aussi longtemps que la psyché humaine demeure évincée de son foyer naturel en la divinité, nous, humains, sommes des coquilles vides à la recherche de notre fondement de sens le plus profond. C’est le moment de reconnaitre en nous un terreau divin et transcendant et d’entrer dans une mutation qui peut mener à une réalité plus riche de la vie planétaire, pleinement vivante dans la gloire de Dieu ».
Cet texte d’Ilia Delio nous parait remarquable, car il éclaire notre expérience de foi, en la situant à l’image d’une première expérience, celle des disciples eux-mêmes inspirés par l’expérience de Jésus.
J H
- Center for Christogenesis : https://christogenesis.org/about/ilia-delio/
- Ilia Delio. Wikipedia. The free encyclopedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Ilia_Delio
- When did Jesus become God? : https://christogenesis.org/when-did-jesus-become-god/
par jean | Déc 2, 2019 | ARTICLES, Hstoires et projets de vie, Vision et sens |
 Un hymne à l’amour et une vision d’espérance
Un hymne à l’amour et une vision d’espérance
Jürgen Moltmann, un des plus grands théologiens de notre époque, a aujourd’hui une audience universelle. Ainsi, l’équipe chinoise qui a réalisé une délicate et émouvante vidéo à l’occasion de son anniversaire à 93 ans (1), vient de réaliser un film sur son parcours de vie et de recherche (2). Ce film nous présente à la fois la vie personnelle de Jürgen Moltmann dans son contexte familial et son parcours de recherche et d’enseignement, la vision nouvelle d’une théologie en phase avec les aspirations de nos contemporains. (3) Ainsi apparait le témoignage d’un homme qui porte amour et foi dans le même mouvement. Et ce témoignage s’allie à une vision théologique nouvelle qui change notre regard et nous ouvre un horizon.
L’amour unit. Il rassemble. Il libère. Nous voyons là un fil conducteur dans le déroulement et l’inspiration de ce film. Celui-ci ne s’ouvre-t-il pas sur le thème de l’amour entre Jürgen et son épouse Elisabeth, décédée il y a trois ans, mais toujours là dans une « seconde présence » (4), un amour qui s’exprime dans une famille unie et ouverte. Et il s’achève sur le thème de l’amitié, une amitié qui a inspiré Jürgen Moltmann dans ses relations, professionnelles entre autres (5).
La théologie de Molmann est étroitement liée à la vie de celui-ci, au départ vécue dans le bombardement de Hambourg, dans la guerre et dans un camp de prisonniers, puis ensuite dans sa participation à un mouvement social et intellectuel, qui se manifeste à l’échelle internationale pour plus de liberté et de dignité humaine (6). De la souffrance ressentie dans les épreuves de son adolescence et de sa jeunesse et de l’engagement dans la foi qui s’en est suivi, procède l’inspiration des ses trois premiers livres : Théologie de l’espérance ; Dieu crucifié ; L’Eglise dans la puissance de l’Esprit.
L’amour ne se résout pas à ce qui opprime les hommes. La pensée de Moltmann elle-même met en évidence ce qui unit et ce qui construit. Elle emprunte le vrai, là où il se trouve. Elle rejette la domination et se plait dans la conversation. C’est ce qui apparaît à travers de nombreuses interviews au sujet de la vie et de la théologie de Moltmann. Les paroles de celui-ci ponctuent le déroulement du film. Elles sont éclairées à leur tour par des interviews. Une vision commune émerge dans une pluralité d’expressions. Et cette vision est reçue universellement comme en témoignent les auteurs de ce film dans un moment consacré à la réception de la théologie de Moltmann en Chine.
Le film est intitulé : « The way of life ». Il y a bien dans ce film l’expression d’une manière de vivre. Mais il y aussi une réponse théologique aux questionnements sur nos raisons de vive, notre raison d’être. Les premiers chrétiens, rapporte-t-on, se présentaient comme « The people of the way » (7), le peuple de la voie, une voie d’amour et de paix à la suite de Jésus. « The way of life », c’est bien la voie de la Vie. Le livre le plus récent de Moltmann s’intitule « The living God and the fullness of life » (8).
https://www.youtube.com/watch?v=23vndWJavAY&fbclid=IwAR1M9j2vUtC9SMveWgNUpVJZyl9RV9KXIjMwF6Wo9zFB7Rn_Pmo0bCi6oQo
Ce film éveille l’émotion. Jürgen respire la bonté. Il parle vrai. Il s’exprime avec son cœur. On ressent son empathie. Et d’autre part, ce film a été réalisé avec une remarquable délicatesse. On y ressent une affection respectueuse pour l’homme et pour le théologien, une reconnaissance pour la vision qu’il communique, une vision de foi et d’espérance en un Dieu, communion d’amour et puissance de vie. Alors les paroles portent et suscitent l’émotion. Elles répondent à nos questions et éveillent notre intelligence. Un théologien, Miroslav Volf rapporte un fait significatif. Il y a quelques années, Jürgen Moltmann intervenait à Pékin devant un public de 3000 personnes, la plupart n’étant ni théologien, ni chrétien. Et, à la fin, tous se levèrent dans une « standing ovation ».
Ce film est beau dans son déroulé et dans ses images. Il va profond en associant le témoignage et l’enseignement. Nous y voyons comme un petit chef d’œuvre.
Le film se déroule autour de cinq séquences successives intitulée : amour, souffrance, théologie, Chine, amitié. Nous essaierons d’apporter ici un aperçu de chaque séquence à partir de quelques interventions marquantes.
Amour
Ce film sur Jürgen Moltmann commence par une évocation de sa vie personnelle aujourd’hui. Il a cette vertu de ne pas hésiter à entrer dans l’intimité de Jürgen avec une grande délicatesse.
D’entrée, Jürgen évoque Elisabeth, son épouse, décédée de maladie en 2016, il y a trois ans. C’est un amour profond qui s’exprime là. « Elle est toute ma vie ». Au sortir d’années difficiles, la rencontre avec Elisabeth a été fondatrice. « Quand j’ai rencontré mon épouse et que j’en suis tombé amoureux, la joie de vivre est venue à moi et ne m’a jamais quitté ». Dès le départ, ce fut un compagnonnage intellectuel et théologique. « Je suis reconnaissant à Elisabeth mon épouse pour le développement de sa théologie féministe ». Effectivement, Elisabeth Moltmann Wendel a joué un rôle pionnier dans ce domaine et leurs deux pensées se sont enrichies mutuellement (9). A travers l’interview de Jürgen, on perçoit la peine qui demeure à la suite de son départ. « La peine accompagne l’amour. La nuit, la peine me submerge, mais Elisabeth s’approche de moi ». Ainsi regarde-t-il vers l’avenir en terme de retrouvailles avec Elisabeth dans la vie éternelle, mais, dès maintenant, Elisabeth est encore là, autrement. « Mon épouse Elisabeth est décédée en 2016 et je ressens encore la joie de sa présence. Je suis convaincu qu’elle est ressuscitée dans la vie éternelle. Elle est présente dans une seconde manière de présence ». Et ses proches l’accompagnent dans cette conviction.
Jürgen Moltmann avait déjà exprimé sa conviction d’une seconde présence de ceux qui nous ont quitté lors d’un récit à propos de la mort de son père dans son autobiographie (4). Voici un message précieux pour ceux qui vivent une expérience analogue.
Dans cette séquence, la vie intime de Jürgen se déroule dans une ambiance familiale et amicale imprégnée par un amour mutuel. On le voit dans le climat chaleureux de la célébration de son anniversaire et, très généreusement, dans les témoignages de ses quatre filles et de ses amis. Michael Weker, professeur de théologie qui fut son assistant, nous rapporte dans cet esprit la motivation actuelle de Moltmann. « Je pense que j’ai découvert votre secret. Chaque jour, vous avez à écrire. Et chaque mois, vous voyagez dans un pays différent ». Et Jürgen a confirmé.
Ainsi, dans cette séquence, tout parle d’amour : l’amour de Jürgen et d’Elisabeth, mais aussi cette chaleureuse ambiance familiale et amicale. Ce n’est pas hors sujet par rapport à la théologie de Moltmann. Cette théologie est étroitement liée à l’expérience humaine et elle est inspirée par la bonté et par la bienveillance. Dieu est amour. Tout est relié en Lui.
Souffrance
Pourquoi suis-je en vie ?
La seconde séquence du film rappelle la souffrance endurée par Jürgen Moltmann lors de la seconde guerre mondiale, une souffrance qui a bouleversé sa vie et qui a trouvé une réponse dans la consolation de Jésus. Cette séquence est donc intitulée : « Souffrance. Pourquoi suis-je encore vivant ? » C’est une question existentielle qui va éveiller la recherche de Jürgen Moltmann. Cette séquence commence par la désolation et elle s’achève par le bonheur familial qui a précédé le malheur.
A travers le témoignage de sa sœur et de son frère, nous découvrons une vie de famille unie, retranchée sur elle-même face à l’emprise nazie. Autour d’une mère optimiste et d’un père rigoureux, une vie enfantine heureuse nous est rappelée. Né en 1926, Jürgen Moltmann manifeste déjà une orientation intellectuelle. « Mon idéal était la physique atomique. Einstein et Heisenberg étaient mes héros ». C’est dans ce contexte que le malheur de la guerre a fait irruption.
A 16 ans, la classe d’âge de Jürgen est mobilisée dans la défense anti-aérienne. « Nous étudions le jour. La nuit, nous montions la garde auprès des canons, attendant la venue de la Royal Air Force. Ils ne venaient pas. Et puis ils vinrent. Hambourg fut bombardé pendant une semaine. Ce fut une tempête de feu. J’étais dedans, mais j’ai survécu tandis que beaucoup de mes amis et de mes camarades sont morts. Depuis ce temps là, je me pose la question : Pourquoi ne suis-je pas mort comme eux ? Pourquoi suis-je vivant ? »
Mobilisé ensuite dans la Wehrmacht, il parvient à se rendre. Pendant trois ans et demi, il vit enfermé dans des camps de prisonniers, en Belgique, en Ecosse, en Angleterre. « Dans ces années de désespoir, j’ai trouvé la foi dans une communauté chrétienne et l’espérance qui dépasse tout. Je suis devenu chrétien, essayant de comprendre le mystère de ma survie, de ma vie et je suis devenu théologien ». « Lorsque je fus relâché du camp de prisonnier, ce fut une libération et j’étais dans la joie ». Ainsi, c’est à partir des questions posées par la souffrance et le mystère de la vie que Jürgen Moltmann a commencé sa recherche théologique.
Théologie
La troisième séquence porte sur l’oeuvre théologique de Jürgen Moltmann. Elle s’appuie sur de bons connaisseurs, entre autres : Miroslav Volf (Universty of Yale), Richard Bauckam (University of St Andrews) et Michael Welker (Heidelberg University). Elle est ponctuée par des paroles de Moltmann. Elle commence par une mise en perspective des œuvres fondatrices : Théologie de l’espérance, Dieu crucifié, L’Eglise dans la puissance de l’Esprit. C’est toute l’originalité de l’œuvre de Moltmann qui apparaît.
Les premières œuvres
Jûrgen Moltmann : « After Auschwitz, the word of God is different from before. Theology is related to the life and death expérience of people » : « Aprés Auschwitz, la parole de Dieu n’est plus comme auparavant. La théologie est reliée avec l’expérience de la vie et de la mort des gens ».
Miroslav Volf : « Il parle de son engagement personnel dans la foi et a été capable d’articuler la foi avec la vie, personnelle et structurelle, économique et politique ».
Richard Bauckam : « Ce qui a touché Moltmann chez les chrétiens écossais qu’il a rencontré lors de sa captivité, a été leur sens du pardon. Il a été profondément influencé par la manière dont ils se sont comportés envers lui. Et les deux thèmes qu’il identifie comme venant de cette expérience, le premier d’entre eux : la souffrance naturellement, et aussi l’espoir dans la souffrance, l’ont mené à son premier grand livre : « la théologie de l’espérance ».
Moltmann enchaine en nous disant le contexte dynamique dans lequel ce livre a été écrit : Martin Luther King, John Kennedy, le socialisme à visage humain, le Concile Vatican II (6).
Moltmann : « A cette époque, nous nous sommes tournés vers l’autre facette pour montrer comment le Royaume de Dieu, dans la nouvelle création, pouvait nous influencer ici-même ».
Miroslav Volf : « Je pense que la vision de la promesse a été fondamentale dans la théologie de l’espérance. La théologie de l’espérance est fondée sur une conviction fondamentale, celle que le futur vient vers nous, non pas parce que le passé et le présent engendrent le futur, mais plutôt parce qu’il y a une possibilité de quelque chose de nouveau qui ne peut pas être simplement extrapolé de la condition dans laquelle nous sommes maintenant. C’est une idée très importante qui provient de la résurrection de Christ.
Autant que je puisse le comprendre, la théologie de l’espérance a été initiée par une conversation avec Ernst Bloch.
Moltmann : « Ernst Bloch et Franz Rosenschweig, le penseur juif qui a écrit « l’Etoile de la rédemption », nous apportent un trésor de bonnes idées théologiques. Ernst Bloch m’a encouragé dans la théologie de l’espérance ».
Richard Bauckam : « Le livre de Moltmann nous entraine vers une orientation eschatologique de la théologie. La première théologie de Moltmann a exercé une influence majeure sur le monde théologique et au delà sur le monde chrétien. Cela a été son orientation vers une espérance tournée vers le futur.
L’autre côté de la pièce, l’autre versant de son expérience l’ont mené vers son deuxième livre majeur : « Dieu crucifié ». La manière dont il a ressenti le compagnonnage de Jésus dans sa souffrance durant sa captivité, l’a conduit vers le Dieu crucifié, voyant Jésus comme le Dieu crucifié en solidarité avec tous ceux qui souffrent. Tels ont été les deux thèmes majeurs de sa théologie originelle. On ne peut envisager sa théologie en dehors de ces deux thèmes ».
Miroslav Volf : « Ce que j’ai appris du Dieu crucifié, c’est sa considération pour les victimes. La théologie générale a toujours envisagé la croix en quelque sorte comme une consolation (« solace ») par rapport aux diverses afflictions dont nous faisons l’expérience, Moltmann a élevé cette tonalité à un plus haut niveau lorsqu’il parle d’un Dieu souffrant. Ainsi la souffrance de l’histoire est portée dans l’esprit même de Dieu. Je pense que c’est une conséquence de la conception trinitaire de Dieu et de l’amour radical de Dieu tel qu’il s’engage dans le monde ».
Moltmann : « J’ai envisagé la croix de Luther en parlant de Dieu comme une victime du pouvoir, de la violence et de l’injustice. Nous voyons dans la crucifixion du Christ le pouvoir du mal dans le monde. En Dieu crucifié, nous voyons l’amour, la patience et l’endurance de Dieu ».
Miroslav Volf : « Moltmann a suivi les évènements centraux de la dernière semaine de la vie du Christ et du commencement de l’Eglise. Ainsi la théologie de l’espérance est connectée avec la résurrection et a été suivie par ce qui a précédé la résurrection, c’est-à- dire : Dieu crucifié et ensuite par la Pentecôte : l’Eglise dans la puissance du Saint Esprit. Ainsi il y a une étroite cohérence entre les trois livres ».
Moltmann : « Le Saint Esprit dans la création et le Saint Esprit dans la vie et la voie de Jésus, le Saint Esprit est l’Esprit de vie. Le Saint Esprit pousse chaque chose à la perfection dans la nouvelle création ».
Une nouvelle approche théologique
Cet entretien sur les premières œuvres de Moltmann est suivi par diverses interventions qui mettent en évidence l’originalité de la nouvelle approche théologique de Moltmann.
Prof Ulrich Herrman : Les théologiens académiques sont souvent des savants de la religion. Jürgen Moltmann est un théologien qui parle de Dieu. C’est quelque chose de particulier, même dans la théologie protestante. C’est pourquoi il occupe une position spéciale.
Prof Hong Tsin Lin (Graduate school of theology Taïwan). Hong Tsin Lin remarque combien Moltmann ne s’en tient pas à la lecture de ses cours. Il improvise. Suivre son enseignement, ce n’est pas seulement apprendre à connaître Dieu, mais aussi à connaître tout ce que Dieu a créé, connaître les gens, connaître les origines du monde.
Miroslav Volf : La théologie est l’intelligence de la foi. La foi n’est pas un catalogue de croyances auxquelles nous adhérons contre toute évidence. En fait, la foi est un acte existentiel engageant l’existence entière à vivre dans la lumière de qui est Dieu et avec la présence de Dieu dans nos vies. La vie des théologiens accompagne ce que les théologiens expriment.
Prof Xu Zhang (University of China). Dans la seconde moitié du XXè siècle, la théologie de Moltmann a inspiré la théologie de la libération, la théologie Minjung, la théologie coréenne, la théologie du Sud Est et de Taïwan
Michael Welker : Il est l’un des plus grands théologiens du XXè siècle parmi les grands noms de Karl Barth, Bonhoeffer et Tillich. Il a développé une théologie tournée vers le fond et non pas seulement sur la méthode. Et il a une merveilleuse intuition pour voir quels sont les contenus théologiques les plus utiles pour nos contemporains.
Prof Xu Hong Song (Minzu University of China) : Parmi les idées des années 1982, il a manifesté une vitalité et une créativité extraordinaire. Il a porté attention à de nombreux problèmes du monde occidental et au delà de l’humanité : problèmes de l’économie, de l’écologie, de l’oppression de la femme. Il a abordé ces problèmes en théologien avec sa sagesse pour monter la pertinence de la réflexion théologique.
Miroslav Volf : Moltmann a compris l’importance des émotions et la prend en compte dans sa théologie.
Prof Bin Yu (Minzu University of China) : Dans sa vision, il embrasse le progrès de l’humanité.
Prof Xu Hong Xong : la beauté du langage et des formes de sa théologie… seulement ceux qui ont une grande passion peuvent écrire ainsi.
Moltmann : « Le royaume de Dieu est si fascinant lorsqu’on considère le futur de l’histoire humaine et de l’histoire naturelle. Autrement nous voyons une catastrophe apocalyptique. Le Royaume de Dieu est un oui à ce monde et à la vie de ce monde.
Miroslav Volf : Moltmann proclame une théologie de solidarité avec les victimes, mais aussi une bonne nouvelle de guérison pour ceux qui persécutent. C’est l’amour inconditionnel de Dieu.
En cette fin de séquence, le professeur Klaus Dietz évoque l’audience internationale de Moltmann. A travers le monde, il y a 450 thèses de doctorat portant sur son œuvre.
Moltmann : La vie doit être aimée et vécue en dépit du danger et des catastrophes. En regardant le futur, nous devons dire oui à la vie.
Chine
La théologie de Moltmann a eu et a un retentissement mondial. Son accueil en Chine témoigne de cette dimension universelle. Et ce sont des théologiens chinois qui nous font le cadeau de ce film sur la vie et l’œuvre de Moltmann. La quatrième séquence est consacrée à la réception de Moltmann en Chine.
Miroslav Volf rapporte un événement particulièrement significatif. Il a participé avec Jürgen Moltmann à un grand forum à Pékin en 2010. Moltmann était un des principaux orateurs et c’est lui qui était appelé à délivrer la conférence plénière. Il y avait près de 3000 personnes. La plupart d’entre elles n’était ni des théologiens, ni des chrétiens. Moltmann a fait un exposé où on pouvait reconnaître tous les aspects importants de sa théologie chrétienne. Quand il eut fini, tout le monde se leva et il y eut une « standing ovation ». « Les gens étaient excités et j’ai trouvé cela absolument stupéfiant ».
Dans cette séquence, plusieurs théologiens chinois marquent leur vif intérêt pour la théologie de Moltmann.
Ainsi le professeur Huilin Yang (University of China) nous montre en quoi et comment la théologie de Moltmann est importante en Chine. C’est une théologie décentrée, ouverte. Jürgen Moltmann développe une théologie écologique. Il y a une idée originale dans la théologie écologique de Moltmann. C’est aussi une théologie politique. Il s’agit de traiter justement les gens. Et cette attitude vaut dans la relation avec l’humain et la nature. Moltmann est un si grand penseur qu’il peut nous encourager à espérer dans l’avenir. Pour réfléchir ensemble, il est bon d’avoir un background en commun, une expérience commune. Ce peut être un événement traumatique. Pour Moltmann, c’est la guerre 1939-1945. Pour la génération de Huilin Yang, c’est la révolution culturelle. Ce traumatisme a engendré en retour le développement d’une pensée indépendante. Il y a des cadres imposés. Huilin Yang cite le philosophe français Alain Badiou. « Nous sommes obligés de penser ».
Dans ce paysage, il y a une longue relation de collaboration entre Moltmann et l’« Institute of sino-christian studies » . Avant même que l’Institut soit créé, cette collaboration était en route. Le premier livre traduit fut « Dieu crucifié » en 1994. La « théologie de l’espérance » fut célèbre à Hong Kong dans les années 1980. Un théologien, Milton Wan Wai-Yiu, nous rapporte comment ayant étudié la philosophie allemande en Grande-Bretagne, il a pu introduire la théologie de Moltmann à Hong Kong à travers des publications et des enseignements.
David Yeung Hee Nam, directeur de l’Institut des études sino-chrétiennes nous rapporte une longue et fructueuse collaboration avec Moltmann : il a étudié le Tao Te Ching (10), le livre de Lao Tseu, durant ces dernières années en essayant de prendre en compte les ressources du Tao Te Ching dans sa réflexion pédagogiques.
Jürgen Moltmann s’exprime à ce sujet en parlant du voisinage entre le Tao Te ching et la Bible : « J’ai donné une conférence à Taïwan. J’ai supervisé des recherches en ce domaine. Avec la compréhension du Tao Te Ching et la compréhension biblique de la création, je vois que les dirigeants doivent servir. Compassion et patience sont des vertus majeures ». La collaboration entre Moltmann et l’Institut des études sino-chrétiennes date de plus de vingt ans. « Il a beaucoup soutenu notre mouvement ». De nouveaux talents apparaissent.
Amitié
Ce film s’achève par une séquence sur l’amitié. Jürgen Moltmann a écrit de très belles pages sur l’amitié (5). Et on voit dans cette séquence combien l’amitié a été une trame de sa vie inspirant ses relations en tous domaines, et notamment dans sa vie professionnelle. Ce film commence par le thème de l’amour et s’achève par le thème de l’amitié.
Jürgen Moltmann : « Je crois à l’amitié entre les hommes et les femmes dans le mariage, entre les professeurs et les étudiants, entre les peuples du monde ».
Michael Welker rapporte sa relation d’amitié avec Jürgen Moltmann. Il a commencé ses études à Heidelberg, et puis admirant la « théologie de l’espérance » de Moltmann, il l’a rejoint comme jeune assistant. Il raconte comment Jürgen Moltmann a eu immédiatement avec lui une relation de dialogue et de partage, se fiant à lui, par exemple, pour la relecture de ses livres : « Nos relations ont été très libres sans aucune volonté de supériorité de la part de Moltmann. Cela a été une relation d’encouragement mutuel et d’amitié mutuelle ». Ainsi Michael Welker est bien placé pour nous parler de Jürgen Moltmann aujourd’hui : « Il est jeune de cœur, jeune d’esprit. C’est un brillant théologien, mais c’est aussi un être humain merveilleux ».
Très présent dans ce film, Miroslav Volf a aussi une relation profonde d’amitié avec Moltmann : « Jürgen Moltmann est le plus important partenaire en conversation que j’ai eu en développant ma propre théologie. Son œuvre sur la Trinité a été particulièrement importante pour moi, notamment dans son rapport avec le Dieu crucifié. Il m’a influencé, mais je pense que son influence a été très, très, significative au niveau de sa manière de faire de la théologie. Il est toujours concret, mais il recherche aussi les enjeux qui touchent les gens aujourd’hui et qui concernent des problèmes contemporains. Et il apporte la lumière de l’Evangile. Jürgen a été pour moi un père intellectuel… »
D’autres témoignages apparaissent comme celle de sa secrétaire encouragée dans son potentiel. Et on est ému par le témoignage de ses quatre filles.
Alors, on peut entendre, en conclusion, cette déclaration de Jürgen Moltmann comme l’expression d’une forte conviction : « Commencer une nouvelle vie, c’est selon Hannah Arendt, avoir la liberté de la commencer, de réaliser la possibilité de quelque chose de nouveau : Apporter la paix dans la guerre, la justice dans la violence, l’amour dans la haine.
Voilà ce qui est essentiel. Il y a un potentiel de créativité en chaque être humain et je désire éveiller cette créativité en toute personne ».
Une expression vivante en devenir
Ce film nous parle de la vie et de l’œuvre de Jürgen Moltmann. Nous y voyons la réception de cette oeuvre à travers les interviews de plusieurs théologiens. L’accent est mis sur les livres qui ont interpellé l’univers théologique dans les années 1960 et 1970 : « Théologie de l’espérance » et « Dieu crucifié ». Pour nous, nous sommes également particulièrement sensibles à ce que nous percevons comme un élargissement de la vision de Moltmann dans les années 1980 et 1990, et notamment les livres : « L’Esprit qui donne la vie » et « Dieu dans la création ». Nous y découvrons l’œuvre de Dieu dans le monde et dans l’humanité. Moltmann est un pionnier de la théologie écologique.
L’œuvre de Moltmann nous paraît immense, un véritable continent. Alors, elle peut être reçue différemment selon les parcours et les sensibilités de chacun. Elle ouvre des pistes nouvelles et diverses. Ainsi peut-on entendre la tonalité de l’écoute chinoise et la participation de Moltmann aux études sino-chrétiennes et son appréciation du Tao Te Ching. Ce film met en évidence l’audience mondiale de la théologie de Moltmann.
Les paroles de Jürgen Moltmann égrenées ici témoignent d’une pensée en marche ouverte à l’avenir. Ainsi, nous ne voyons pas seulement dans ce film une célébration. Nous voulons y voir aussi une expression vivante en devenir.
Ce film nous parle de la vie de Jürgen Moltmann. Sa théologie est étroitement liée à l’expérience, à son expérience et à celle des autres. Ainsi peut-elle faire écho auprès de tous.
Nous voyons dans ce film une expression de bonté, de bienveillance, de respect. C’est l’attitude de Jürgen Moltmann et c’est, d’un bout à l’autre, la manière dont on s’exprime à son sujet. Le film s’ouvre sur le thème de l’amour et s’achève sur le thème de l’amitié. Ainsi, osons nous dire que nous ressentons ce film comme un hymne à l’amour.
Ici, c’est le témoignage d’un théologien dont l’œuvre exprime l’amour de Dieu et la présence de l’Esprit.
Ici, c’est le témoignage d’une communauté vivante qui se reconnaît dans cette inspiration.
Ici, c’est le témoignage d’une équipe chinoise qui a réalisé un film d’une grande délicatesse et d’une grande beauté.
J H
- « Vivre la découverte théologique à l’échelle du monde. L’anniversaire de Jürgen Moltmann célébré en Chine » » : https://vivreetesperer.com/vivre-la-decouverte-theologique-a-lechelle-du-monde/
- « The way of Christ. A documentary of Jürgen Moltmann » https://www.youtube.com/watch?v=23vndWJavAY&fbclid=IwAR1M9j2vUtC9SMveWgNUpVJZyl9RV9KXIjMwF6Wo9zFB7Rn_Pmo0bCi6oQo
- Pour mieux connaître et comprendre la vie et l’œuvre de Jürgen Moltmann, on se reportera à son autobiographie : Jürgen Moltmann. A broad place. An autobiography. SCM Press, 2007 : « Une théologie pour notre temps. L’autobiographie de JürgenMoltmann » https://www.temoins.com/une-theologie-pour-notre-temps-lautobiographie-de-juergen-moltmann/ On pourra voir aussi le blog : « L’Esprit qui donne la vie. Réfléchir et méditer avec Jürgen Moltmann » : https://lire-moltmann.com
- « Par delà la séparation » https://vivreetesperer.com/par-dela-la-separation/
- Un très beau texte sur l’amitié, p 343-348, dans : Jürgen Moltmann. L’Esprit qui donne la vie. Cerf, 1999. Ici : https://vivreetesperer.com/amitie-ouverte/
- « Genèse de la pensée de Jürgen Moltmann » https://vivreetesperer.com/quelle-vision-de-dieu-du-monde-de-lhumanite-en-phase-avec-les-aspirations-et-les-questionnements-de-notre-epoque/
- « Le peuple de la voie », dans : Harvey Cox. The future of faith https://www.temoins.com/quel-horizon-pour-la-foi-chretienne-l-the-future-of-faith-r-par-harvey-cox/
- Jürgen Moltmann. The living God and the fullness of life. World Council of churches, 2016. « Le Dieu vivant et la plénitude de vie » https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/
- « Femmes et hommes en coresponsabilité dans l’Eglise. Dialogue théologique entre Elisabeth Moltmann-Wendel et Jürgen Moltmann » https://www.temoins.com/femmes-et-hommes-en-coresponsabilite-dans-leglise/
- Tao Te Ching sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dao_de_jing
par jean | Déc 6, 2012 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
L’éclairage apporté par la pensée théologique de Jürgen Moltmann.
L’expérience se définit, dans les termes du dictionnaire Petit Robert comme « le fait d’éprouver quelque chose ». Ainsi, à travers la perception et le ressenti que comporte l’expérience, nous nous ouvrons à une réalité qui se présente à nous. Au delà des perceptions sensibles de la vie courante qui n’attirent pas l’attention, l’expérience ressort dans la vie de la conscience et elle contribue à son élargissement. Notre vie est ponctuée et marquée par des expériences dont certaines ont un grand impact dans notre manière de voir et de sentir. Ce sont là des expériences fondamentales, des expériences spirituelles.
Si nous croyons « qu’en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Actes 7.27), alors nous pensons que ce Dieu là est proche de nous et se manifeste à travers notre expérience. Cependant, la reconnaissance de la présence de Dieu dépend, pour une part, de nos représentations. Si, au départ, en fonctions des idées reçues, nous ne croyons pas en la réalité de Dieu, alors nous aurons plus de mal à reconnaître sa présence. De même, cette reconnaissance requiert une ouverture, un désir de notre part, et ce désir lui-même est conditionné par notre état d’âme, mais aussi par la représentation que nous avons de Dieu. Si, dans un registre socio-culturel ou psychologique, nous avons peur de Dieu, évidemment nous ne chercherons pas à reconnaître sa présence, et même nous ferons barrage. C’est dire le mal causé par certaines formes religieuses qui communiquent l’image d’un Dieu plus ou moins redoutable. Quelle différence si nous croyons que Dieu est bonté et amour (1 Jean 16) !
Quelles représentations théologiques ?
Mais d’une façon moins criante, les obstacles peuvent venir également de certaines représentations théologiques. Aussi, suivons nous ici le fil conducteur que nous apporte Jürgen Moltmann dans son livre : « L’Esprit qui donne la vie » (1).
Certains théologiens, nous explique-t-il, ont affirmé « une discontinuité entre l’Esprit de Dieu et l’esprit de l’homme » (p 22). Dieu leur apparaît si grand, si puissant qu’il est hors de portée et se manifeste à distance. Par exemple, Karl Barth appelle l’Esprit Saint : « l’Esprit de la promesse, parce qu’il place l’homme dans l’attente du « Tout Autre », de Celui dont, pour cette raison, il n’est jamais possible de faire l’expérience » (p 29). Mais, comme écrit Moltmann, pourquoi opposer la révélation de Dieu à des hommes et l’expérience de Dieu faite par des hommes ? « Comment un homme pourrait-il parler de Dieu, si Dieu ne se révèle pas ? Comment pourrait-il parler d’un Dieu dont il n’existe aucune expérience humaine ? » (p 22). La réalité, c’est « l’immanence de Dieu dans l’expérience humaine et la transcendance de l’homme en Dieu ». « Parce que l’Esprit de Dieu est en l’homme, l’esprit de l’homme, dans son autotranscendance, est orienté vers Dieu » (p 24). La Bible ne rapporte-t-elle pas des expériences humaines qui manifestent l’œuvre de Dieu et à travers lesquelles Dieu nous parle ?
Et, par ailleurs, on observe dans l’histoire la prétention des « religieux » à restreindre l’œuvre de l’Esprit à ce qui relève de leur univers. « Dans la théologie et la piété protestante comme dans la théologie et la piété catholique, il existe une tendance à concevoir l’Esprit Saint uniquement comme l’Esprit de la rédemption dont le lieu est l’Eglise et qui donne aux hommes la certitude de la béatitude éternelle de leurs âmes. Cet Esprit sauveur est mis à l’écart de la vie corporelle comme de la vie naturelle » (p 25). Ainsi dans un ouvrage jadis consacré à l’Esprit Saint par le grand théologien, Yves Congar, la présentation de l’Esprit créateur et de l’Esprit de recréation de toutes choses est presque totalement absente » (p 26). C’est méconnaître que l’Esprit n’est pas seulement l’Esprit de la rédemption, mais aussi l’Esprit de la création, constamment à l’œuvre dans celle-ci.
Et, comme le souligne un autre théologien, William R. Davies (2), l’Esprit de Dieu est sans limite (« Spirit without measure »). Il est à l’œuvre dans tous les hommes et ne se laisse pas enfermer dans des catégories.
Comme l’écrit Moltmann, « Les hommes ne font pas l’expérience de l’Esprit, de façon extérieure seulement dans leur communauté ecclésiale, mais aussi de façon intérieure, dans l’expérience qu’ils font d’eux mêmes, à savoir dans le fait que « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint » (Romains 5.5). Cette expérience de l’Esprit, beaucoup de personnes l’expriment par ces simples mots : « Dieu m’aime ». Dans cette expérience de Dieu, elles font l’expérience de leur propre dignité, indestructible, inaliénable de sorte qu’elles peuvent se remettre debout… » (p 18). De nombreux témoignages rapportent ce vécu. (3)
Un éclairage théologique sur l’expérience spirituelle.
Moltmann nous propose une théologie de l’expérience qui échappe à l’emprise des spécialistes et se situe en résonance avec le vécu de tous. « En parlant d’expérience de l’Esprit, j’entends par là une perception de Dieu, dans, avec et sous l’expérience de la vie qui nous donne la certitude de la communion de l’amitié et de l’amour de Dieu » (p 37).
C’est une vision très ouverte. « L’expérience de l’Esprit de Dieu n’est pas limitée à l’expérience de soi du sujet humain », telle qu’on peut parfois l’envisager dans une polarisation sur la destinée de notre âme. (p 130-131). « Elle est aussi un élément constitutif dans l’expérience du Tu, dans l’expérience communautaire et dans l’expérience de la nature ». La conscience d’une présence transcendante se fonde sur « la possibilité de reconnaître Dieu en toutes choses et toutes choses en Dieu, à travers la compréhension de l’Esprit de Dieu comme puissance de la création et comme source de vie… « C’est le souffle de Dieu qui m’a fait, l’inspiration du Puissant qui me fait vivre » dit Job (Job 33.4) (p 60). Ainsi, toute expérience qui nous advient ou que nous faisons, peut avoir une face intérieure transcendante. Jürgen Moltmann met en évidence une unité de l’agir de Dieu dans la création, la rédemption et la sanctification de toutes choses » (p 21). C’est là une vision globale : « L’expérience de la puissance de la résurrection et la relation à cette puissance divine ne conduisent pas à une spiritualité qui exclut les sens, qui est tournée vers l’intérieur, hostile au corps et séparée du monde, mais à une vitalité nouvelle de l’amour de la vie » (p 17).
A une époque où on reconnaît l’importance majeure de l’expérience dans la vie spirituelle (4), la vision de Jürgen Moltmann est particulièrement éclairante. L’homme a besoin à la fois d’exprimer et de comprendre ces expériences. « Ces expériences sont tributaires des représentations et des concepts à l’aide desquelles nous cherchons à les saisir, car des expériences non comprises sont comme des expériences qu’on n’aurait pas faites ». Et de même, « sans expression adéquate, une expérience reste en quelque sorte bloquée en l’homme » (p 39). « Les expériences sans expression sont aveugles. Des expressions sans expérience sont vides. C’est dans l’expression que réside la puissance créatrice de la vie » (p 40).
Dans la communion de l’Esprit, nous pouvons percevoir la présence de Dieu sur des registres différents et dans une grande variété de situations. C’est bien dans cet esprit que l’expérience tient une grande place sur ce blog.
J H
(1) Moltmann (Jürgen). L’Esprit qui donne la vie. Cerf, 1999. La pensée de Moltmann est présentée sur le blog : « L’Esprit qui donne la vie » http://www.lespritquidonnelavie.com/ On y trouvera un article sur le thème de l’expérience : « Vivre l’expérience de la présence de Dieu » http://www.lespritquidonnelavie.com/?p=864
(2) Davies (William R). Spirit without measure. Charismatic faith and practice. Darton, Longman and Todd, 1996. Sur le site de Témoins : « Une ouverture pour le courant charismatique » http://www.temoins.com/reflexions/une-ouverture-theologique-pour-le-courant-charismatique/toutes-les-pages.html
(3) Parmi d’autres, le témoignage d’Odile Hassenforder dans son livre : « Sa présence dans ma vie » rapporte combien elle a été marquée par le ressenti de l’amour de Dieu accompagnant la réception de sa guérison. On pourra lire sur ce blog un récit de sa guérison. https://vivreetesperer.com/?p=746
(4) Cette importance de l’expérience dans la vie spirituelle est mise en valeur par David Hay dans son livre : « Something there » : Hay (David). Something there. Darton, Longman, Todd, 2006. Sur ce blog : « Expériences de plénitude » https://vivreetesperer.com/?p=231. Des livres récents : « The future of faith », par Harvey Cox, et « Christianity after religion », par Diana Butler Bass, mettent l’accent sur le développement d’une foi expérientielle. http://www.lespritquidonnelavie.com/?p=864
par jean | Fév 7, 2019
[custom-facebook-feed]