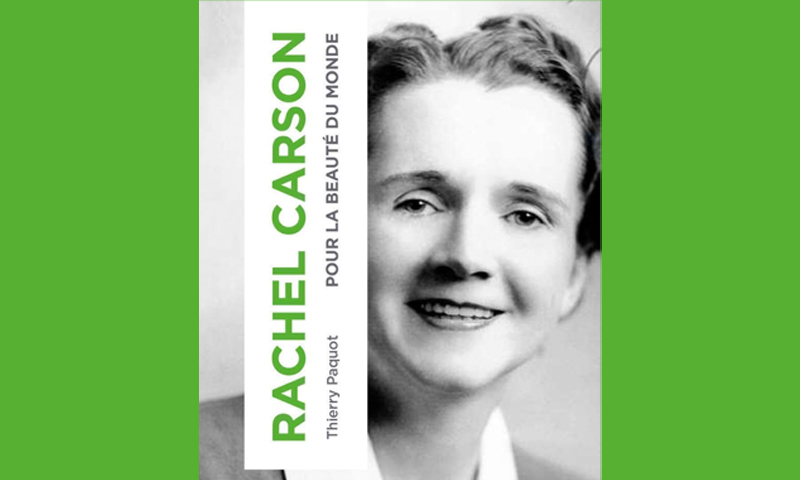par jean | Jan 21, 2026 | Société et culture en mouvement |
Selon Olivier Hamant
On peut discerner dans la culture occidentale un impératif du toujours plus et du toujours mieux. C’est aussi un désir du toujours plus vite si bien qu’un sociologue Harmut Rosa a pu voir dans l’accélération une caractéristique majeure de notre société (1). Il y a là un emballement dangereux. Dans la même veine, on constate une recherche effrénée de l’efficacité. C’est une polarisation qui entraine un déséquilibre. Comme biologiste, bien au fait des équilibres naturels, Olivier Hamant dénonce les méfaits d’une culture de la performance aujourd’hui en porte-à-faux par rapport aux limites des ressources naturelles et aux fluctuations des temps à venir et promeut en antidote, la robustesse qui se trouve dans le vivant. C’est ainsi qu’Olivier Hamant présente ses conclusions en faveur de la performance dans un opuscule de la collection : Tracts : « Antidote au culte de la performance : la robustesse du vivant » (2). Son texte commence ainsi :
« Le dérèglement socio-écologique n’est plus une prédiction, C’est désormais notre quotidien rythmé par des crises. En réaction, nous produisons du développement durable, une injonction de sobriété et surtout beaucoup d’éco-anxiété. Et si nous faisions fausse route ? Les rapports scientifiques convergent pour qualifier le XXIè siècle. : il sera fluctuant. Notre seule certitude, c’est le maintien et l’amplification de l’incertitude. Face à ces turbulences, le contrôle, l’optimisation ou la performance nous enferment dans une voie étroite très fragile. La robustesse – c’est-à-dire maintenir le système stable malgré les fluctuation – est la réponse opérationnelles aux turbulences. Contrairement à la performance, elle ouvre le champ des possibles et nous relie au vivant, robuste « par nature ». Mieux, les progrès récents de la biologie nous donnent aussi une clé importante : la robustesse se construit d’abord sur l’hétérogénéité, la redondance, les aléas, le gâchis, la lenteur, l’incohérence… bref, contre la performance. Le basculement vers la robustesse inverse tous les paradigmes de notre temps et nous aide à quitter le monde du burn-out. Sans regret. Tout un contre-programme » ( p 3). Dans une écriture dense, de petits chapitres vont successivement décrire les conséquences malheureuses de l’engouement pour la performance et, à contrario les bénéfices de la robustesse. Il y a un avenir dans le paradigme de la robustesse.
Dans une interview en vidéo, Olivier Hamant, répond à la question : « Comment sortir du culte de la performance? » (3). Il décrit la situation actuelle et le processus pour en changer en des termes accessibles et pédagogiques et nous allons donc présenter ses propositions.
Comment sortir du culte de la performance?
D’entrée de jeu, il nous montre la dimension de l’enjeu : « Ce qu’on vit, c’est une révolution culturelle. Ce n’est pas une crise sociale, une crise géopolitique, ce n’est pas une crise écologique au premier rang. C’est d’abord une crise culturelle. Il va falloir dérailler du culte de la performance ». Olivier Hamant est chercheur biologiste. Il anime l’Institut Michel Serres qui est un think tank qui a été fondé par Michel Serres en 2012. Michel Serres a écrit un livre qui s’appelle « Le Contrat naturel ». Le contrat naturel dit que la loi de l’offre et de la demande n’a aucun sens. La nature n’est pas un décor. La vraie loi est : besoins et ressources ». La nature est un partenaire. Olivier Hamant critique le culte de la performance. « Nous les êtres humains , on fait beaucoup de performance, tout le temps. Les êtres vivants font le contraire. Ils font d’abord de la robustesse ».
Qu’est-ce que la performance ?
« La performance, c’est la somme de l’efficacité et de l’efficience. L’efficacité atteint son objectif ; L’efficience, c’est l’usage du moins de moyens possibles. Quand on est performant, on se canalise. On va très très loin, très très vite, mais on oublie qu’il y a d’autres chemins. Dans notre monde actuel, c’est ça qu’on veut faire. Par exemple, l’intelligence artificielle, c’est d’arriver encore plus vite à produire des services etc sans se poser la question : est-ce qu’il y aurait d’autres chemins pour faire la même chose. Quand on est dans la culture de la performance, on est dans une culture de la compétition. Dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. La culture de la performance, c’est une culture de la violence. C’est pour cela qu’elle pose problème ; on a été tellement loin dans l’ultra performance qu’on est en train de générer un burn out des humains et des écosystèmes . On est exactement dans ce moment un peu difficile ».
Mais alors qu’est-ce que c’est le modèle opposé : la robustesse ?
« La robustesse, c’est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Un exemple, c’est le roseau dans le vent. Le roseau est stable malgré les fluctuations, et, à plus long terme, c’est maintenir le système viable malgré les fluctuations.. La robustesse répond à une pulsion profonde, celle de durer et de transmettre. Les êtres vivants sont robustes avant d’être performants ».
Où est-ce qu’on trouve de la robustesse ?
Dans le vivant, mais aussi dans les systèmes. Le vivant n’est qu’une incarnation de la robustesse. On la retrouve aussi dans des systèmes ; par exemple, un avion de ligne : il fonctionne à 50£% de sa capacité. Et dedans, il y a trois systèmes autopilote automatiques différents. Pourquoi tant de redondances : parce qu’il va lui falloir la capacité d’affronter des turbulences..Il faut qu’il soit un peu robuste. On peut décliner la robustesse dans les langages. Toutes les langues sont robustes avant d’être performantes. Une langue performante, c’est une langue robotique. Chaque mot a seulement un sens. Pas de polysémie Quand on a un langage robotique parfait, il n’y a pas de communication ». Ce sont les imperfections de la langue qui suscitent des questions, un dialogue en confiance.
Est-ce qu’il y a des secteurs qui basculent de la performance à la robustesse ?
« il y a des domaines qui sont plus ou moins en avance dans la bascule de la performance à la robustesse. Je pense à l’agriculture. En Amérique du sud, en 1980, un nouveau modèle a décollé. C’est l’agroécologie qui ensuite a décollé un peu partout. L’agroécologie, c’est l’exemple-type d’un système qui est robuste parce qu’il est moins performant. Quand on fait de l’agroécologie, on ne vise pas le résultat maximal, on vise le rendement stable. Par la diversité, on préserve les sols. Cela rend les parcelles agricoles robustes. Un autre exemple, c’est l’autoréparabilité. Aujourd’hui, il n’y a plus d’entreprises qui ne se pose la question de la réparabilité de ses produits. Cela, c’est plutôt de la robustesse. Quand on fait des objets réparables ; ils sont plus gros…. mais par contre, ils vont durer et on va pouvoir les transmettre ».
Existe-t-il un lien entre robustesse et justice sociale ?
« Il y a un lien entre la justice sociale et la robustesse. La santé des milieux naturels nourrit la santé sociale. La santé sociale nourrit la santé des humains. Et dans la santé sociale, la justice sociale est clé. Quand on fait de la justice sociale, on va se poser des questions d’équité. L’équité, cela veut dire qu’on accepte des inégalités. Cela veut dire par exemple que dans un collectif, on accepte qu’il y ait des personnes qui sont moins performantes, qui font d’autres choses, qui ont d’autre talents qui sont donc moins pertinente, mais qui peuvent être utiles. On a parfois de contre-performances individuelles au service de la robustesse du groupe. Ça, c’est la justice sociale ».
Quel rôle peuvent jouer les instances publiques ?
Aujourd’hui, on est dans un mouvement de bascule d’un monde qui état drogué à la performance pendant des décennies et même des siècles et là on va quitter ce monde-là parce que notre environnement va devenir très fluctuant. On rentre dans un monde de ruptures : des méga-feux, des méga-inondations, mais aussi des remous sociaux, des crises géopolitiques. Dans ce monde-là, on va faire de plus en plus de robustesse. Les fluctuations vont faire qu’on va passer du mode performant au mode robuste. Le problème, c’est que si on laisse faire, il y aura beaucoup de casse. Le rôle du politique, c’est d’accompagner ce basculement en devançant l’appel, en étant devant la loi ». Olivier Halant évoque ici « les premières régies municipales agricoles où on produit ses propres fruits et légumes et où on les donne aux écoles sans passer par des cadres sanitaires. Ça a très bien marché » et c’est devenu un modèle. Olivier Hamant évoque aussi un grand mouvement de masse partout dans le monde, en Amérique du sud, en Inde, en Chie, en Afrique, Tous ces mouvements, ce sont des mouvements qui mettent d’abord en avant le lien, des interractions humaines au service de la robustesse du groupe. La population est en train de développer de nouveaux modes d’interaction au service de la robustesse. On est dans un moment de basculement ».
Alors, quelles sont les initiatives qui peuvent être mises en place aujourdhui ?
« Ce qu’on vit, c’est une révolution culturelle, ce n’est pas une crise sociale, une crise géopolitique, une crise écologique en premier, c’est d’abord une crise culturelle. Il va falloir dérailler du culte de la performance. On est tous addicts à la performance. Et là, on peut s’inspirer des techniques de déprive sectaire. Donc, pour les gens qu’on veut faire sortir des sectes, il y a plusieurs méthodes, mais une méthode qui est hyper importante, ce sont des moments d’arrêt et créer des espaces d’arrêt où on fait face à toutes ces dissonances, à toutes ces contradictions internes. Les ultra performances n’ont que des projets de mort. Aller sur Mars, c’est mourir sur Mars. Faire des mines sur les astéroïdes, c’est délirant. Faire de bunkers… à Hawaï, c’est un tombeau. Un monde robuste, c’est un projet de vie. On vit avec les fluctuations sur la terre. On ne va pas sur Mars. On reste à la surface ».
On peut se demander : « Quels sont les freins au changement de paradigme », à l’abandon de la suprématie de la performance pour adopter une forme robuste ?
On les connait. Certains lobbys, le lobby pétrolier, le lobby financier, ceux qui sont encore dans le culte de la performance » ; Olivier Hamant voit là une forme de dérive sectaire … Ce sont des collectifs qui ne questionnent plus la performance. Toutes ces années, ils veulent augmenter la performance sans se poser la question qu’ils sont en train de détruire leurs écosystèmes, mais leurs vies aussi. Ce sont des gens qui en général finissent en burn out assez rapidement. Et aussi, il y a des freins éducatifs. C’est qu’en fait, si on a été formé pendant toute sa vie à la compétition, c’est très difficile de s’en détourner .Notamment, à propos du personnel politique souvent national ou supranational, Souvent ce sont des personnes qui ont été formées comme cela dans les années 80 , 90 et qui ont plus de mal à comprendre ce qui s’est passé. Les nouvelles générations ont bien compris que le monde était fluctuant. C’est bien ce que l’on voit chez les jeunes. Il y en a beaucoup plus de travail en équipe et de savoir faire sur le travail en équipe. Car en fait coopérer , ce n’est pas simple. Ça veut dire qu’on est capable de parler avec des gens de différentes traditions, de différentes cultures. On est aussi exposé à des conflits, mais par contre, on sait résoudre les conflits. Donc, en fait, cette coopération (4), ces écoles de la coopération, ça va certainement nous aider aussi à basculer ».
Aujourd’hui, nous vivons dans un univers mondialisé. « Ce modèle est-!l applicable à l’international ? ».
« On a tous été confiné la même année. Maintenant,
nous vivons effectivement à l’ère des synchronies. On est dans un mouvement planétaire. Toute la planète bouge ensemble. Il y a un très bon documentaire qui illustre bien cela. C’est « Bigger than us » de Flora Vasseur. Elle a suivi des jeunes entre dix et vingt ans, donc vraiment des jeunes qui dans leur territoire, que ce soit en Indonésie, au Liban, en Amérique du sud ont changé les lois de leurs pays. Ce ne sont que des bascules de la performance à la robustesse : contre ls violences faites aux femmes, pour les écosystèmes , contre le plastique, tout ça. Ce sont des jeunes qui ont bien compris ce qu’ils portaient, qui se sont mobilisés et qui ont fait changer le système. Mais en fait, c’est dans la même année, dans la même période et c’est la même génération Donc, ce qui est extraordinaire, et c’est pour la génération qui vient là, c’est un moment historique. Ce n’est jamais arrivé dans toute l’histoire de l’humanité : Qu’il y ait une génération qui ait la légitimité et le pouvoir de tout changer. »
Mais nous-mêmes, « à notre échelle, que peut-on faire ? ».
« La première chose que nous puissions faire individuellement, c’est de questionner les mots que l’on utilise. J’insiste beaucoup sur le fait que l’on vit une crise culturelle. Il y a beaucoup de mots que l’on utilise au quotidien et qui sont hérités du monde stable abondant en ressources, performant, extractiviste. Rentabilité, c’est un gros mot. Pendant longtemps, la rentabilité d’une entreprise était corrélée à sa performance. Ce n’est vrai que si le monde est stable. Dans un monde instable, la rentabilité d’une entreprise est corrélée à sa robustesse parce que les entreprises performantes seront les plus fragiles dans leur hyper canalisation. Si on évoque « le mode dégradé », en bricolant, le système D etc, cela devient le monde robuste. Le mode performant où on a accès à tout, où on a une supertechnologie, où ça tourne super bien, en fait, c’est un monde fragile parce qu’il ne faut pas qu’il y ait un grain de sable dans la machine. Alors, tout est cassé. L’autre chose en fait, c’est de se réancrer dans le territoire. On entend beaucoup l’idée qu’on manque d temps, qu’il y a urgence ; Que ce soit pour la crise climatique ou pour d’autres questions, on manque de temps. Si on manque de temps, il faut juste regarder dans les écosystèmes, chez les êtres vivants. Quand il y a une crise dans un écosystème, les êtres vivants n’accélèrent pas. Ils multiplient leurs interactions avec leur territoire. Ce sont des symbioses par exemple chez les plantes Pour nous, les êtres humains, c’est pareil. Si, en fait, on manque de temps, il faut se reconnecter à son territoire. Donc les interactions avec les associations locales, avec la ville locale, avec les entreprises locales, avec tout ce qu’on peut trouver autour. Quand on manque de temps, il faut se rendre compte qu’il nous reste l’espace ».
Alors y a-t-il un espoir ? Reste-t-il un espoir?
La question est posée à Olivier Hamant : « Quel est votre espoir si vous en avez un ? ». « J’ai beaucoup d’espoir pour ce qui vient parce que justement le monde va fluctuer. Il ne fuit pas être bisounours. Il va y avoir des fluctuations très fortes. Il y aura de turbulences ; il y aura des tempêtes. Il y en a déjà à vrai dire. Il y aura des remous sociaux. Il y aura des crises géopolitiques, etc… Donc, ça c’est la partie qui fait un peu peur. Mais, ces fluctuations condamnent le modèle socio-économique actuel qui est drogué à la performance et qui est très fragile dans les fluctuations. Ça va dégager un modèle économique qui n’a plus aucun sens et on va construire un modèle économique coopératif (5). Cela peut paraitre parfaitement utopique, mais ce qui est extraordinaire, c’est qu’en fait, on est déjà dans le monde d’après. Les modèles coopératifs s’accélèrent en ce moment. Il y en a de plus en plus. L’agroécologie, ça explose. C’est un peu l’image des nuées d’oiseux. Les nuages d‘oiseaux n’arrêtent pas de basculer de droite à gauche, et on peut se demander : comment font-ils pour basculer ? Mais en fait, c’est très simple. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupa qui guident le groupe parce que ce sont eux qui sont exposés les premiers aux fluctuations du monde : le prédateur qui arrive, la bourrasque du vent. Et après, ils se synchronisent et ils contaminent le cœur du système. On en est exactement là en ce moment. Les marges vivent des fluctuations très fortes. Elles ont déjà inventé des modèles robustes : le tout réparable, l’agroécologie… et c’est en train de contaminer le cœur. On est dans un moment porteur d’espoir.
La vision d’Olivier Hamant s’appuie sur sa recherche relative au monde vivant. Son regard s’est développé à partir de cette recherche et il a construit une interprétation éclairante de la situation actuelle. Il y a là une analyse en profondeur qu’Olivier Hamant décline en plusieurs livres et en de nombreuses vidéos. Ici, notre présentation de son œuvre est limitée, mais son interview en donne les grandes orientations
La crise que nous vivons aujourd’hui peut être abordée sous différents angles. Comme l’approche d’Harmut Rosa, celle d’Olivier Hamant est socio-culturelle. L’un met en cause l’accélération, l’autre, la performance. Dans les deux cas, la dérive peut être envisagée comme la résultante d’une volonté de puissance, une forme de démesure. Sur ce registre, il y a bien un antidote spirituel, c’est l’esprit des Béatitudes (6). La résistance à la culture qui mène l’humanité à sa perte, peut prendre différentes formes opérationnelles. En dénonçant une culture de la performance et en proposant une culture de la robustesse, il nous semble qu’Olivier Hamant ne se contente pas de nous proposer un diagnostic convaincant, il ouvre un horizon libérateur. Si le pessimisme accompagne la crise actuelle, l’espoir affiché par Olivier Hamant permet d’entrevoir une dynamique salutaire.
J H
- Face à une accélération et à une chosification de la société : https://vivreetesperer.com/face-a-une-acceleration-et-a-une-chosification-de-la-societe/
- Olivier Hamant. Antidote au culte de la performance ; La robustesse du vivant. Gallimard Tracts, 2023
- Comment sortir de la performance ? https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=olivier+Hamant++you+tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:7a767642,vid:TENa7UGWd1A,st:0
- Coopérer et se faire confiance : https://vivreetesperer.com/cooperer-et-se-faire-confiance/
- Face à la crise écologique, réaliser des transitions justes : https://vivreetesperer.com/face-a-la-crise-ecologique-realiser-des-transitions-justes/ Vers une économie symbiotique : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
- Les béatitudes au quotidien : https://www.temoins.com/les-beatitudes-au-quotidien-la-contre-culture-heureuse-des-evangiles-dans-lordinaire-de-nos-vies/

par jean | Jan 21, 2026 | Vision et sens |
Faire l’expérience de Dieu aujourd’hui
De plus en plus d’expériences du divin, sous des formes variées et des appellations diverses comme ce qui est décrit sous le terme de « awe » (1), sont rapportées aujourd’hui. Dans son livre : « God’s wider presence » (2, déjà présenté sur ce site (3), Robert K Johnston consacre un chapitre à un tournant actuel vers le spirituel : « Faire l’expérience de Dieu aujourd’hui »
« Nous le sentons tous, comme le nouveau millénaire a point, quelque chose a changé dans la culture occidentale ; quelque chose qui a aussi des conséquences en regard de la foi chrétienne…. Notre expérience de Dieu est en train de devenir à la fois moins centralisée ou institutionalisée, dans son expression variée, tandis qu’elle devient même plus importante que nos positions théologiques. Un nombre croissant de chrétiens ohoisissent de questionner l’autorité religieuse, décident pour eux-mêmes quelles positions théologiques adopter, et s’identifient d’une manière beaucoup plus libre aux institutions religieuses au moment même où ils sont de plus en plus ouverts à embrasser le mystère et à expérimenter la transcendance en dehors de la communauté d‘adoration » ( p 19). L’auteur remarque également que, si la raison demeure importante, les chrétiens actuels sont de plus en plus sensibles à l’imagination, au récit. Ils ne découvrent pas seulement la réalité de la révélation divine à l’intérieur de la communauté de foi, mais aussi en dehors des frontières du christianisme institutionnel.
Robert K Johnston consacre son livre à « une réflexion théologique à propos de cette tendance : en parler, apprendre de ses forces, contrer ses dégradations, et suggérer un chemin d’avenir, à la fois dans notre adoration et dans notre mission » ( p 19).
Une expérience de Dieu moins centralisée
Dans certains pays en Europe, on a constaté un recul important de la pratique dans de grandes églises au cours des cinquante dernières années. Le phénomène est moins marqué aux Etats-Unis, mais Robert K Johnston en évoque des symptômes. Ainsi, si 68 ¾ de la population se déclare chrétienne, observe-t-on un accroissement des personnes qui se disent sans religion, de 8 à 15% de 1990 à 2009. Cependant, les contres d’intérêt se déplacent. L’auteur cite une enquête selon laquelle 20% des américains se tournent vers « Les media, les arts et la culture » comme moyens premiers d’expérience spirituelle, en suggérant que si la tendance se poursuit, en 2025, les américains se tourneront autant vers les arts que ver les églises pour leur formation spirituelle ( p 20). On constate également aujourd’hui que seulement en dessous de 20% des américains fréquentent un office religieux le dimanche. Au total, il y a bien en Occident un recul du christianisme institutionnel.
Une expérience de Dieu plus importante
Parallèlement au déclin du christianisme institutionnel, on observe une montée de l’intérêt pour tout ce qui est spirituel. A la question : « Comme adulte, combien est-ce important pour vous de grandir dans votre vie spirituelle », en 1999, 26% des américains répondaient que c’était extrêmement important, 28 %, très important, et 23 %, assez important. « L’intérêt pour la spiritualité est répandu en Amérique ». Cette ouverture actuelle à la présence divine est également présente en Europe. A cet égard, l’auteur se réfère au livre de David Hay : « Something there » (4). Alors que la pratique du christianisme institutionnel a fortement décru en Grande-Bretagne au cours du dernier siècle, une recherche a montré que 76% des britanniques rapportaient avoir eu des expériences spirituelles ou religieuses, au-delà des 65% enregistrés en 1979 » ( p 21). David Hay tire les enseignements du recueil de récits d’expériences spirituelles collectés depuis 1969 par Alister Hardy au Religious Experience Research Center à l’université du Pays de Galles. Il a donc examiné les milliers de réponses personnelles à la question : « Vous est-il arrivé d’avoir conscience ou d’être influencé par une présence ou une puissance, que vous l’appeliez Dieu ou non, et qui soit différente de votre vécu quotidien ? ». A partir de là, on peut distinguer des catégories d’expériences. D’autres enquêtes ont également été réalisées en 1987 et en 2000. En 2000, 38% déclarent avoir eu une conscience de la présence de Dieu contre 28% en 1987… 25% ont eu conscience d’une présence sacrée dans la nature (16% en 1987). Ces chiffres sont en hausse. « Hay conclue : « L’augmentation remarquable des rapports d’expérience d’expérience spirituelles et religieuse en Grande-Bretagne durant la dernière décennie du XXè siècle est extraordinaire et demande quelque explication. J’imagine que cette réalité a toujours été là… ce qui change la perception, c’est le sentiment des gens qu’ils ont la permission sociale pour une telle expérience ». L’auteur ajoute ce commentaire : « Les gens en Occident non seulement ressentent la stérilité du rationalisme de la modernité, mais ils deviennent plus sensibles et ouverts aux évènements et aux puissances spirituels dans leurs propres vies et sentent qu’ils ont la permission de témoigner aux autres à ce sujet » ( p 21-22). David Hay a également interviewé un échantillon de gens fréquentant un centre commercial et rapportant qu’ils n’allaient jamais à l’église. « En dessous de la variété des interprétations allant des explications tirées du langage des église jusqu’à des interprétations personnelles bizarres, il se profilait un sens envahissant d’il y a quelque chose : « somethlng there ». C’est le titre du livre de David Hay (4) ( p 24).
Exemples de « correspondance surnaturelle en terre étrangère »
L’auteur commence son étude de la Révélation dont on fait l’expérience en dehors des formes institutionnelle de la communauté chrétienne de foi par des témoignages en provenance de l’oeuvre de David Hay (3), mais aussi d’étudiants suivant ses cours et d’une variété d’autres témoignages.
Répondant à la création
Dans son livre : « Something there (4) », David Hay nous rapporte de nombreux écrits d’expériences spirituelles dans le contexte de la nature. Ainsi, une des personnes qui n’allait jamais à l’
église a raconté cette expérience : « Une femme a raconté une expérience spontanée vécue dans son enfance. « Mon père avait l’habitude d’emmener toute la famllle en promenade durant les soirées de dimanche. Lors d’une de ces promenades, nous avancions dans un étroit sentier à travers un champ de blé haut et mur. Je trainais en arrière et me suis trouvé seule. Soudain, le ciel flamboya au-dessus de moi. Je fus enveloppée dans une lumière dorée. J’avais conscience d’une présence., si aimable, si aimante, si brillante, si consolante, si prévalente, existant n dehors de moi, mais si proche. Je n’entendais aucun son. Mais des mots me venaient à l’esprit tout à fait clairement : Tout va bien. Tout ira bien » ( p 25). L’auteur rappelle une description semblable de C S Lewis dans son autobiographie :
« C’était comme si la voix qui m’avait appelé de l’extrémité de la terre me parlait maintenant à mon côté. Elle était avec moi dans la pièce ou dans mon corps ou derrière moi » ( p 25).
L’auteur rapporte que dans ses classes de théologie, « il a demandé à ses étudiants de rapporter dans une courte description, une expérience de transcendance ou du divin qu’ils auraient eu en dehors des murs d’une église. Environ 40% de ces témoignages étaient fondés sur une expérience dans la nature dans des occasions aussi variées que la vie elle-même » Les circonstances sont très diverses : le spectacle de la « Yosemite Valley », un lever de soleil vu du chemin de fer transcanadien, la vue des nuages et de la pluie à partir de la fenêtre d’un avion…. « La seule constante est le sens de l’épiphanie, du numineux, de Dieu qui est médiatisé dans et à travers la création » ( p 27). Nous renvoyons également ici à un article présenté sur ce site : « Religious experience and ecology » (5). Jack Forster, chercheur au Centre de recherche sur l’expérience religieuse au Pays de Galles, après avoir présenté la personnalité pionnière en ce domaine : Alister Hardy, biologiste des environnements marins, puis chercheur sur les expériences religieuses et spirituelles, nous présente « de nombreux récits d’expériences transcendantes et extraordinaires apparemment induites par une immersion dans des systèmes écologiques vibrants ». « Dans son étude pionnière des compte-rendus recueillis : « The spiritual nature of man » (1979), Alister Hardy identifie « la beauté naturelle » comme un des déclencheurs les plus ordinaires des expériences religieuses,… suggérant ainsi une corrélation importante entre les environnements naturels et les expériences extraordinaires ». Alister Hardy a vécu lui-même dans son enfance des expériences dans la nature, des expériences puissantes et transformatrices. Ainsi a-t-il écrit : « Il n’y a pas de doute que, comme jeune garçon, j’étais en train de devenir ce qui pourrait être décrit comme un mystique de la nature. Quelque part, je sentais la présence de quelque chose qui était au-delà et cependant faisait partie de toutes les choses qui me ravissaient : les fleurs sauvages mais aussi les insectes. Je rapporterai quelque chose que je n’ai jamais dit auparavant… Juste quand j’étais sûr que personne ne pouvait me voir, je devins si impressionné par la scène naturelle que pendant un moment ou deux, je tombais à genoux dans la prière… ».
La vie de Jane Goodhall, pionnière dans la recherche sur les chimpanzés, rapportée sur ce site (6), est également riche en expérience spirituelle. « A Gombé dans la forêt tropicale, elle ressentais un grand émerveillement : « Plus je passais du temps dans la forêt, plus je devenais un avec ce monde magique qui était maintenant mon habitat ». Elle vivra un jour dans la forêt un temps d’extase. : « Perdue dans l’émerveillement face à la beauté autour de moi, j’ai du glisser dans un état de conscience élevé. C’est difficile – impossible en réalité – de mettre en mots le moment de vérité qui descendit sur moi… Les chimpanzés, la terre, les arbres, l’air et moi, nous semblions devenir un avec la puissance de l’esprit de vie lui-même… ».
Répondre à la création, la conscience et la culture travaillent ensemble
L’auteur ajoute des témoignages sur la manière dont la création peut œuvrer aux côtés de la culture et de la conscience pour communiquer la présence de Dieu se révélant.
Il rapporte ainsi le témoignage d’un doctorant, Patrick Oden. Celui-ci avait décidé de lire « le Paradis perdu » de Milton. Ayant trouvé un morceau de pelouse et un grand arbre pour s’asseoir en dessous, il commença sa lecture. Il ressentit alors une communion avec la nature. Comme, il répéta l’expérience pendqnt plusieurs jours, il écrit qu’à chaque fois, « il tomba en harmonie avec la vie et l’éternité. Une somptueuse nature autour de moi, des maitres mots et un récit se poursuivant en moi, mon âme se sentait chaleureuse, à peine capable d’être contenue à l’intérieur…. Ce fut une épiphanie prolongée » ( p 29-30).
Robert K Johnston sollicite également la littérature où il y trouve des récits comparables. Ainsi le romancier, John Updike, comme il a couvert la vie durant la seconde moitié du XXè siècle, offre un trésor de tels compte-rendus de tels évènements, de révélation qui arrivent en dehors de l’église ou de la synagogue.. Bien que romancés, les récits d’Updike semblent aussi fidèles à la vie. C’est leur force » ( p 30). On trouve également un témoignage de la présence de Dieu dans l’œuvre des poètes. L’auteur porte une attention particulière au poète Gérard Manley Hopkins. Si le veine poêtique de ce dernier a été contrariée par l’idée qu’il se faisait de sa vocation sacerdotale, il n’en a pas moins écrit des poèmes que l’auteur trouve remarquable et ainsi « un petit groupe de sonnets qui reflète sa sensibilité à la présence de Dieu dans et à travers la création ». Son biographe écrit : « Il ne voyait pas seulement les chose, il voyait en elles. Il envisageait avec confiance que la forme ou la nature témoignait de la présence de Dieu en toutes choses. C’est la présence de Dieu qui personnifiait les constellations du ciel, le mouvement des oiseaux ou le vent, la forme d’un nuage, d’une feuille ou d’un arbre. Ayant fait l’expérience d’un Dieu qui se révèle dans sa création, Hopkins ne pouvait qu’en montrer la réalité dans sa poésie, recréant la possibilité pour le lecteur d’en faire l’expérience » ( p 31-32).
Dans sa conférence de prix Nobel, Alexandre Soljenitsyne a bien résumé le rôle de l’artiste dans la passation de la présence d’un numineux qui se révèle : « L’art peut réchauffer une âme transie et sans lumière jusqu’à une expérience spirituelle exaltée. A travers l’art, nous recevons occasionnellement – indistinctement, brièvement – des révélations telles qu’elles ne peuvent advenir par la pensée rationnelle. C’est comme un petit miroir (dans les contes de fée). Vous regardez dedans, mais au lieu de vous voir, vous apercevez l’inaccessible pendant un moment., un royaume pour toujours hors de portée. Et votre âme commence à peiner » ( p 33).
Descriptions phénoménologiques et sociologiques
L’auteur poursuit son parcours par des descriptions phénoménologiques et sociologique en mettant en valeur les apports de deux chercheurs : le phénoménologue Rüdolf Otto, auteur d’un livre classique : « l’idée du sacré » (1917) et le sociologue Peter Berger, auteur du livre innovant : « La rumeur des anges » (1970).
Rüdolf Otto a décrit plusieurs expériences définies par lui comme sacrées ou saintes. Il voit dans le mystère de ces rencontres (mysterium) , une double aspect : tremendum (impressionnant ) et fascinans (désirable), suscitant de la crainte et de l’attrait. « Les thèses d’Otto continuent à être controversées, car il donne une validation phénoménologique aux expériences spirituelles ( p 34)
Ecrivant dans les années 1970, en pleine modernité, quand quelques uns entonnaient un récit de la chute supposée du surnaturel dans le monde, (« Dieu est mort »), dans son livre : « The rumors of angels », en sociologue, Peter Berger argumente pour montrer que ce n’est pas le cas. « Peter Berger croyait qu’il était possible d’avoir une approche inductive en théologie, un ancrage dans les expériences humaines fondamentales. Il y avait des expériences de l’esprit humain qui pointaient au delà de la réalité, qui rendait une « immédiateté à Dieu » (p 35).
Dans cette section, l’auteur nous offre également des exemples d’une reconnaissance de la présence de Dieu à grande échelle. C’est ainsi qu’il nous rapporte la perception du missionnaire anglais en Ouganda, John V Taylor dans son livre : « The primal vision ». « Dans ces parages, il reconnait : le sens profond d’une Présence prégnante ». On peut l’observer, nous dit-il, dans les anciens chants, les proverbes, le énigmes des peuples avec lesquels il a choisi de vivre ». il nous rapporte une parole de David Livingstone qui va dans le même sens.
De même, Robert K Johnston met en valeur une thèse de Deborah Buchanan qui décrit « la danse des esclaves qui était commune dans les plantations du sud des Etats-Unis et qui leur permettaient de déplorer leurs pertes, de célébrer leurs joies, et de faire l’expérience de la liberté religiuse au sein de la captivité . C’était une activité sacrée, fondée dans la liberté et la justice, et les connectant les uns aux autres, aux ancêtres décédés…Voilà une pratique culturelle, une dance qui était un véhicule pour la révélation de Dieu à l’humanité »
( p 34-35).
Approches théologiques
Robert K Johnston revient ici sur l’éclairage théologique concernant cette Présence de Dieu au delà du cadre ecclésial. Comme à son habitude, il présente soigneusement la thèse des auteurs évoqués avant de les commenter et éventuellement d’y faire objection.
La reconnaissance de la Présence divine opérant en toute liberté se heurte a une conception étroite du christianisme qui entraine une prudence extrême et la crainte de se tromper.
La crainte de l’autotromperie
L’auteur mentionne le livre de NT Wright : « Simply christian » (2006). Wright suggère qu’il y a quatre « voix » qui font écho dans le subconscient humain : l’aspiration à la justice, la quête de spiritualité, la soif de relation, et le ravissement de la beauté. Pour Wright, ces quatre voix issues de la création : justice, spiritualité, relation, beauté, pointent vers Dieu parce qu’elles ont leur source en lui…. Il se peut que Wight pense que l’on puisse interpréter ces voix comme des échos de l’Esprit. Cependant Wright se révèle très prudent. « La centration de Wright sur Jésus et le salut offert en lui, amène Wright à rester prudent sur la nature et la signification de ces expériences numineuses qui arrivent en dehors de l’Eglise. Comprenant l’activité de l’Esprit plus en terme de rédemption que de création, Wright limite le rôle d’une révélation fondée sur la création. Son langage d’« échos » et de « traces » suggére davantage le reste d’une activité de Dieu passée qu’une présence dynamique » ( p 36). L’auteur rappelle combien il est attaché à réfléchir à ces questions sur un fondement théologique solide. Si toutes les approches doivent être considérées, « on peut exclure par une sur-accentuation portée au péché et au salut, la réelle et révélante Présence de Dieu à travers son Esprit, ce qui est le clair témoignage d’une grande majorité d’occidentaux aujourd’hui » ( p 37). Ces expériences contribuent à être fondatrices et transformatrices…
Le danger de l’apathie spirituelle
Si l’autotromperie est un danger, il y en a un autre. « Ne pas se faire confiance pour reconnaitre le Divin dans le quotidien, peut mener à la conséquence non intentionnelle de l’indolence (sloth).. Kathleen Norris parle de ce danger pour les chrétiens – de « torpeur ou apathie spirituelle. Norris suggère que la plupart d’entre nous, la plupart du temps, tenons pour acquis ce qui est le plus proche de nous et le plus universel….. Norris nous appelle à reconnaitre et à savourer le saint dans les circonstances banales de la vie quotidienne. Elle nous invite à découvrir « Les mystères quotidiens ».
C’est aussi la vision que nous apporte Kevin Vanhoozer dans son livre : « Everyday theology. How to read cultural texts » (7) Prenant comme définition de la théologie du quotidien, « la foi cherchant à comprendre la vie quotidienne », Vanhoozer dit que » son texte de justification pour la théologie du quotidien est Mathieu 16. 1-3 ». Jésus interpelle les pharisiens capables de prévoir le temps à partir d’une observation préalable, mais ne parvenant pas à « interpréter les signes des temps ». « Nous recherchons un certain genre de connaissance, mais dans d’autres domaines, nous restons dans l’expectative et/ou non intéressé. En particulier, nous manquons de de prendre sérieusement en compte l’importance théologique des signes des temps culturels – l’environnement partagé, les pratiques et les ressources de la vie quotidienne. Nous manquons de découvrir Dieu au milieu de la vie » ( p 38).
Le déni du mystère
L’auteur évoque une autre précaution en mentionnant la thèse de Pete Rollins dans son livre : « How (Not) to speak of God » (2006) « Il croit qui si l’Eglise occidentale veut prospérer, elle a besoin de s’engager avec le langage ancien. C’est-à-dire, même si nous parlons de la plus grande révélation de Dieu, nous devons aussi reconnaitre son secret. Rollins aide à rappeler à ses lecteurs que la dissimulation n’est pas l’opposé de la révélation. Plutôt la révélation présente son mystère en son sein. Rollins utilise aussi le langage de l’hyper-puissance. Il écrit : « L’interaction de Dieu avec le monde est irréductible à la compréhension précisément parce que la présence de Dieu est un genre d’hyperpuissance ». L’auteur convient que toute révélation est partielle.. « Maintenant, je connais en partie », écrit Paul. « A présent, je connais d’une manière partielle, mais alors je connaitrai comme je suis connu » ( Corinthiens 13.12) . On notera également que pour Rollins, « il y a un silence qui fait partie de l’expérience de Dieu, comme Otto l’a noté » ( p 39-40).
La distraction de la clarté
« L’argumentation de Rollins est similaire à celle de Charles J Connitry Jr dans son livre : « Soaring in the Spirit » ( 2007), Connitry écrit : « Nous avons hérité du XVIIè siècle deux approches premières dans la spiritualité chrétienne : le chemin de la connaissance et sa contrepartie en réaction, le chemin de la piété » ; Voici une manifestation de plus des Lumières : le p!ège objectif/ subjectif.
Il y a une Eglise qui cherche à concevoir la spiritualité en terme d’accumulation de connaissances religieuses. C’est la tromperie de l’objectif. Le chemin de disciple revient trop souvent à pas beaucoup plus que transmettre de l’information. L’évangélisation est principalement un exercice d’apologétique. Dans ce contexte, le piétisme devint un contrepoids bien nécessaire face à l’intellectualisme stérile de l’Age de la Raison. Mais même là, le piétisme s’est dévoyé dans un subjectivisme mettant trop de stress sur une conduite pieuse… définie pour la plus grande part en termes négatifs… » ( p 40). L’auteur nous montre en quoi cet héritage nous éloigne du mystère. « Le problème du leg des Lumières – la voie de la connaissance et la voie de la piété – est que nous essayons de mesurer la qualité de notre spiritualité en termes noir et blanc, soit par ce que nous faisons ou ne faisons pas, il y a eu, depuis la Renaissance, « une fuite du mystère ». « Pendant 1500 ans, les mystiques étaient juste autant influents que les intellectuels dans la formation de la théologie et de la spiritualité de l’église ». L’auteur nous donne l’exemple de Thomas d’Aquin qui arrête son travail théologique de haute volée à la suite d’une expérience du mystère de Dieu.
« Comme nous sommes entrés dans ce nouveau millénaire, la distraction de la clarté comme la fuite du mystère sont devenus toujours plus prononcés, mais produisent aussi en retour une réaction compréhensible. Il n’est plus nécessaire de convaincre les gens qu‘il y davantage d’aspects de la réalité qui sont inaccessibles à la raison. La stérilité de la modernité a apporté cette leçon. Ainsi la piété a pris une nouvelle tournure, plus diffuse, et manquant souvent d’un contenu défini, peut-être même de substance. Mais, à travers l’élargissement, la oulture s‘est ouverte à une plus grande Présence de Dieu dans et à travers la vie, l’Eglise chrétienne étant à la traine en dans de nombreux domaines. Encore encombré par l’héritage de la pensée du XVIIè siècle – du piège de la dichotomie subjectif-objectif, nous nous sommes trouvé incapable d’entendre les témoignages et de cultiver l’appel pour une nouvelle pensée à propos de la pensée révélante de Dieu. Quelque part, la piété a besoin d’être à nouveau connectée à la théologie – pour recevoir un contenu personnel. C’est l’appel d’une troisième voie – celle qui reconnait la Présence d’un Dieu qui se révèle en plénitude dans et à travers la vie » ( p 41).
Si, tant le monopole du divin que le rejet entrainé par ce monopole ont fait obstacle à une manifestation sans frontières, Robert K Johnston nous apporte une aide précieuse pour reconnaitre la présence de Dieu à partir d’une observation des phénomènes et d’une perspective théologique. Certes, un regard complémentaire mettant l’accent sur la communion qui réside dans le Dieu Trinitaire peut nous permettre de mettre davantage en valeur la puissance de l’amour dans la présence divine. C’est la dimension que nous avons trouvé tant dans les textes de Jürgen Moltmann (7) que de Richard Rohr (8). L’un et l’autre font ressortir l’universalité de la présence de Dieu. « Dieu, le créateur du Ciel et de la Terre, est présent par son Esprit cosmique dans chacune de ses créatures et dans leur communauté créée… » (Jürgen Moltmann). « La Révolution Trinitaire, en cours, révèle Dieu comme toujours avec nous, dans toute notre vie et comme toujours impliquée. Elle redit la grâce comme inhérente à la Création et non comme quelque chose que quelques personnes méritent…. Dieu est Celui que nous avons nommé Trinité, le flux (flow) qui passe à travers toute chose sans exception et qui fait cela depuis le début…Ainsi toute chose est sainte pour ceux qui ont appris à le voir ainsi. Toute impulsion vitale, tout force orientée vers le futur, toute pulsion d’amour, tout élan vers la beauté, tout ce qui pousse vers la vérité, tout émerveillement pour une expression de bonté, tout bout d’ambition pour l’humanité et la terre, est éternellement un flux de Dieu Trinitaire….Comme la Trinité, nous vivons intrinsèquement dans la relation. Nous appelons cela l’amour. Nous sommes faits pour l’amour. En dehors de cela, nous mourrons très rapidement. Et notre lignage spirituel nous dit que Dieu est personnel. « Dieu est amour » (Richard Rohr).
J H
- Comment la reconnaissance et la manifestation de l’admiration et de l’émerveillement exprimées par le terme « awe » peut transformer nos vies ? : https://vivreetesperer.com/comment-la-reconnaissance-et-la-manifestation-de-ladmiration-et-de-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-peut-transformer-nos-vies/
- Robert K Johnston. God’s wider presence. Reconsidering general revelation. Baker academic, 2014
- Une plus grande présence de Dieu : https://vivreetesperer.com/une-plus-grande-presence-de-dieu/
- La vie spirituelle comme une conscience relationnelle. Une recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
- La participation des expériences écologiques à la conscience spirituelle : https://vivreetesperer.com/la-participation-des-experiences-spirituelles-a-la-conscience-ecologique/
- Jane Goodhall : une recherche pionnière sur les chimpanzés, un ouverture spirituelle, un engagement écologique : https://vivreetesperer.com/jane-goodall-une-recherche-pionniere-sur-les-chimpanzes-une-ouverture-spirituelle-un-engagement-ecologique/
- Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient » : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-dieu-present-dieu-avec-nous-dans-un-univers-interrelationnel-holistique-anime/
- La danse divine (Divine dance) : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/

par jean | Nov 27, 2025 | Expérience de vie et relation |
Une vie d’aide-soignante
Léo est aide-soignante de nuit dans un Ehpad
Dans sa veille de nuit, elle ne passe pas inaperçue, car, c’est dans une relation chaleureuse qu’elle prend soin des résidents. Aussi, nous lui avons demandé comment elle en était venue là
Une force m’a poussé à aider mon prochain avec amour
« J’ai choisi très tôt de devenir aide-soignante parce que je me sens naturellement proche des gens vulnérables. J’ai beaucoup de sensibilité et d’empathie pour mon prochain. Depuis toute petite, j’ai toujours été animée par une force qui me poussait à aider mon prochain avec amour. Alors, dans toute ma vie, que ce soit dans le travail, mes occupations, ou tout simplement, je fais tout avec le cœur. Je me souviens, qu’à l’âge de 16 ans, j’ai regardé un documentaire qui m’a complètement bouleversée. Ce documentaire portait sur l’aide aux personnes malades et cela a été pour moi une révélation. De là, j’ai voulu travailler dans le secteur socio-médical, l’aide à la personne. Je me trouve à ma place, proche des gens.
Une formation exigeante
J’ai choisi de m’orienter vers la profession d’aide-soignante. J’ai donc passé des concours d’entrée pour pouvoir intégrer un IFAS (institut de formation d’aide-soignante). C’était un écrit et un oral Je suis entré en formation le 5 janvier 2009 et j’ai terminé diplômée le 4 décembre 2009. Cette formation m’a donné les premiers acquis pour affronter le terrain, car l’expérience s’acquiert sur le long terme. A l’époque, la formation était très stricte. Nous avions huit compétences à valider sous forme de modules. La non réussite à certains modules pouvait être éliminatoire. Le stress était constamment présent, mais j’ai réussi à tout valider. Après l’obtention du diplôme, j’ai immédiatement travaillé en faisant le choix d’être intérimaire, ce qui m’a permis d’acquérir de l’expérience plus rapidement avec une grande polyvalence.
Apprendre la pratique
J’ai donc travaillé exclusivement en intérim dans le but de pouvoir accroitre mes connaissances dans plusieurs services. Le rôle propre de l’aide-soignante est toujours le même, mais les compétences exercées varient en changeant d’un service à l’autre. Il y a des services où on apprend plus que dans d’autres et où on a beaucoup plus de responsabilités. Dans certains services, l’aide-soignante peut être en binôme avec l’infirmière. Le rôle de l’aide-soignante, c’est d’apporter des soins, soins de confort, soins d’hygiène et beaucoup de soutien psychologique. Dans ce contexte, dans certaines situations, on fait face à beaucoup de misère et de souffrance. Nous sommes des oreilles qui écoutent. On doit faire face à des situations de conflit. Ne pas prendre pour soi l’agressivité. Gérer le conflit et faire preuve de bienveillance
Expériences
J’ai travaillé pendant près de deux ans dans un Ehpad médicalisé proche de mon domicile où je me suis senti très bien. Il y avait beaucoup d’amour dans cette maison, une atmosphère familiale. Chacun trouvait sa place. Chaque personne venait avec son lot de vécu. Les résidents étaient soignés correctement et respectés à leur juste valeur. Les soignants étaient écoutés et respectés. Ma venue était souvent attendue, car je liais une relation de confiance soignant-soigné. Les résidents se confiaient facilement à moi. J’ai quitté cette structure à contre-cœur et laissé derrière moi des personnes attristées par mon absence.
Autres souvenirs : Pendant trois ans, en aide à domicile, j’ai eu la charge d’une femme qui était sourde, muette et aveugle, élevée à l’assistance publique. De plus, cette femme avait été abandonnée à la naissance. Je communiquais avec elle par la main et ainsi, je l’orientais. Autre situation, dans un Ehpad, j’ai ressenti un conflit entre fils et mère. Il y avait là deux copines d’enfance qui vivaient face à face. L’une d’elle avait un enfant, mais lorsque celui-ci venait, il l’ignorait en parlant seulement à sa copine. Car il disait avoir souffert de sa mère et lui reprochait d’être cruelle. Cette femme rejetait sa haine sur nous. Lorsque la copine est décédée, le fils n’est plus revenu. La mère est décédée sans avoir jamais revu son fils. Pour les aides-soignantes, cette situation a été difficile à supporter. Pour ma part, j’ai respecté ces personnes.
Au total, j’ai travaillé dans des endroits différents, souvent comme intérimaire avec de bonnes comme de mauvaises expériences. La vie d’aide-soignante n’est pas toujours rose, car on est souvent sous-estimée et dévalorisée.
Dynamique de vie. Dynamique de travail
A partir du moment où l’on piétine en allant au boulot, il faut changer de métier. J’aime ce que je fais, mais j’aime surtout les gens. Et j’aime me rendre utile. Car, ne l’oublions pas, à un moment ou l’autre, nous arriverons à l’âge de la vieillesse. Une assistance ne sera pas négligeable. Nous sommes de petites mains, car sans aides-soignantes, on ne pourrait pas fonctionner.
Aujourd’hui, quand je réfléchis à mon passé, j’ai le sentiment qu’une force m’a poussé à aimer mon prochain, égayer la vie des gens par ma présence, mon naturel, mais surtout mon accessibilité. La communication fait partie intégrante de mon travail, la compréhension de l’autre. Je suis une personne qui apprécie les gens. Je ne suis pas dans le jugement. Je vois les défauts des gens, mais je ne m’arrête pas là. Je regarde le meilleur de ce qui peut ressortir de l’autre et je l’encourage toujours. J’analyse, j’observe, j’encourage. Je vois le potentiel de ce qu’elle peut réaliser. Je les pousse toujours à se surpasser. C’est ma devise. Ces traits de caractère font que les gens s’attachent à moi facilement. C’est dans la confiance et le contentement que je vis ces relations réciproques.
Léo
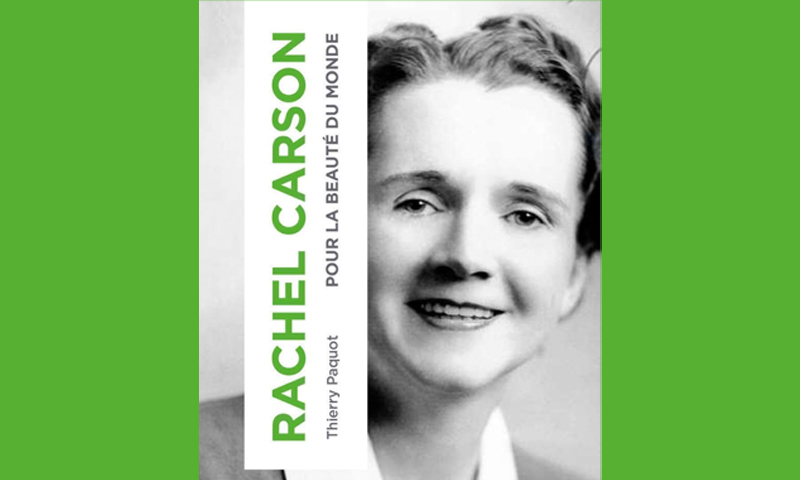
par jean | Oct 17, 2025 | Emergence écologique |
Au début des années 1960, un livre nous vint des Etats-Unis, en traduction sous le titre: « le printemps silencieux ». Dans cet après-guerre, le progrès technique battait son plein. La technique était en vogue et elle paraissait salutaire. Cependant, parce que l’auteure Rache Carson savait évoquer la beauté de la nature avec émerveillement, elle faisait s’autant mieux ressortir les conséquences ravageuses d’un polluant insecticide, le DDT. Biologiste marine, elle était compétente pour démontrer le péril et, malgrè la violente opposition des intérêts, elle fut entendue et le pesticide fut interdit.
Aujourd’hui, la campagne de Rachel Carson nous parait emblématique, car ce fut la première à mettre en cause, à grand bruit, les dangers de la pollution. Aussi, dans le péril actuel, tant le recul de la biodiversité que le dérèglement du climat, il n’est pas étonnant que son exemple inspirant soit retracé par plusieurs livres tel que : « Rachel Carson. Pour le beauté du monde » (1), par Thierry Paquot, lui-même philosophe social à partir d’une profession d’urbaniste. Cependant, notre intérêt a été particulièrement éveillé par l’attention portée à Rachel Carson dans un livre de Helen De Cruz que nous avons présenté sur ce blog : « Wonder Struck. How wonder and awe shape the way we think » (2). Cet ouvrage intervenait à la suite du livre qui, à la suite d’une démarche scientifique et d’une grande enquête, met en évidence le phénomène de la « awe », un émerveillement ébloui : « Awe. The New science of everyday wonder…. » (3). Dans « Wonder Struck », Helen de Cruz consacre une section à l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder) chez Rachel Carson ( p 159-164).
Le parcours de Rachel Carson
Dans son livre : « Rachel Carson. Pour la beauté du monde », Thierry Paquot retrace les étapes du parcours de Rachel Carson : Du plein air au laboratoire ; Exploratrice de l’univers marin ; Ce pesticide qui a rendu muet le printemps ; Un impact retentissant avant un long silence.
Observer et admirer
Née en 1907, Rachel Carson grandit dans une ferme en Pennsylvanie, auprès d’une mère cultivée qui l’initie à une littérature mettant en valeur la nature. « Ainsi donne-t-elle à lire à sa fille le « Handbook of nature study » d’Anna Bostford Comstock. Cette entomologiste et illustratrice, fille d’un quaker, est une grande admiratrice de Ralph Waldo Emerson et d’Henri David Thoreau » (p 15). C’est une indication sur le contexte culturel d l’éducation de Rachel. L’auteur, Thierry Paquot, la décrit ainsi : « C’est une petite fille qui s’intéresse à tout, et qui ne craint pas la solitude, qu’elle recherche pour mieux faire corps avec la nature. Elle se promène dans la campagne et s’initie aux sciences naturelles, apprenant le nom des arbres, des plantes et des fleurs et aussi celui des oiseaux, souvent en compagnie de sa mère. Elle sait s’occuper en lisant, écrivant, rêvant et observant tout autour d’elle. Ce qui la ravit surtout est d’inventer des histoires qu’elle écrit ensuite » ( p 17). Certaines sont même publiées dans un mensuel pour enfants : St Nicholas Magazine. Rachel entreprendra des études universitaires, d’abord en littérature anglaise, puis en s’orientant vers la biologie. Rachel Carson optera ensuite pour une carrière scientifique en dépit de préjugés défavorables à l’égard des femmes. En 1936, « elle devient la deuxième femme assistante-biologiste marin engagée par le Bureau des pêches. Elle va y mêler recherche et vulgarisation, tout en écrivant pour des journaux… ».
Rachel Carson s’est particulièrement distinguée par la publication de plusieurs livres sur l’univers de la mer envisagée tant dans son aspect scientifique que dans un ressenti poétique. Ce furent : « Under the sea wind » en 1941, « The sea around us” en 1951 et “the edge of the sea”en 1955. Le livre : “The sea around us” (Cette mer qui nous entoure ) a rencontré un grand succès, « numéro 1 de la liste des meilleures ventes du New York Times durant quatre-vingt-six semaines » et a été rapidement traduit en de nombreuses langues. Elle nous raconte l’apparition de la mer et son expansion comme une épopée, la montée du vivant. « Cet ouvrage est un récit choral de tous les êtres vivants qui font, défont et refont l’univers marin, sachant que « cette mer qui nous entoure » est aussi entourée par les activités humaines qui viennent en perturber les fragiles équilibres … Rachel Carson assemble les informations les plus précises et actuelles pour décrire un monde qu’elle pense comme une totalité, dans laquelle tous les éléments constitutifs sont interdépendants entre eux. N’est-ce point la définition de l’écologie, par Ernst Haeckel en 1866 ? » ( p 38). L’auteur nous rapporte également la vision spirituelle de Rachel Carson : « Croyant, comme moi à l’évolution, je crois simplement que c’est la méthode par laquelle Dieu a créé et continue de créer la vie sur terre. Et c’est une méthode si merveilleusement conçue que l’étudier en détail, revient à augmenter – et certainement jamais à diminuer – à la fois sa révérence et sa crainte à la fois envers le Créateur et à l’égard du processus » ( p 38). Thierry Paquot commente également le dernier livre de Rachel Carson : « The edge of the sea » (Là ou finit la mer : le rivage et ses merveilles), un ouvrage qui « clôt sa trilogie marine » : « C’est son texte le plus littéraire et le plus personnel, celui que je préfère en raison de son écriture émotionnelle, qui ne dédaigne pas pour autant les détours scientifiques sans la platitude scolaire fréquente des énoncés pédagogiques ».
Dénoncer les méfaits du DDT et des pesticides : un engagement pour le vivant
La connaissance et l’amour de la nature chez Rachel Carson l’ont portée à s’engager. Consciente de la grandeur et de la beauté de la toile du vivant, elle a ressenti les menaces à son égard et elle s’est engagée de toutes ses forces contre les méfaits des pesticides, en l’occurence du DDT en grande vogue à l’époque.
Thierry Paquot nous montre comment elle a recueilli des concours et rassemblé les preuves de la dégradation du vivant par le DDT. Ses arguments résonnent en anticipation aux recherches actuelles établissant les méfaits des pesticides. « Pour son étude, elle rencontre de nombreux médecins et biologistes, dont les spécialistes des « cancers professionnels et environnementaux » … Elle rassemble une très riche documentation, son livre comporte quarante pages de références bibliographiques… Une partie de ses informations a été collectées par une ornithologue amateure du Massachusetts…Elle recueille une abondante documentation de Marjorie Spock, poète et écologiste, pédagogue de l’anthroposophie, maraichère en agriculture biodynamique lorsque le DDT est aspergé sur ses terres… » ( p 51-52)
Rachel Carson a eu à faire à de fortes parties tant est grand à l’époque le prestige du DDT et puissants les intérêts qui le soutiennent. « Le DDT massivement prescrit contre les insectes porteurs du paludisme, du typhus, de la peste bubonique au cours des premières années de la guerre, devient après-guerre le traitement de choc de l’organisation mondiale de la santé (OMS) » (p 56). Puis, il commence à se répandre dans l’agriculture et c’est là qu’apparaissent les dangers de son utilisation, dangers que Rachel Carson va identifier : « l’une des caractéristiques les plus fâcheuses du DDT et des produits imilaires est de passer d’un organisme dans un autre en suivant la chaine alimentaire. En voici un exemple : un champ de luzerne est traité au DDT ; cette luzerne est donnée en pâté aux poules ; les œufs pondus par les poules contiennent du DDT » ( p. 56). « L’équilibre propre à la nature » est bouleversé. « Le tir de barrage chimique… s’abat sur la trame de la vie, sur ce tissu si fragile et délicat en un sens, mais aussi d’une élasticité et d’une résistance admirable… ». Rachel Carson propose « un autre chemin pour une terre habitable demain ». Ainsi, courageusement, car par ailleurs, elle fait face à la maladie, Rachel Carson écrit un livre qu’elle dédie à Albert Schweitzer, grand médecin et homme de paix. Ce livre, « Le printemps silencieux » commence par un constat érigé en des termes émouvants : « Ce fut un printemps sans voix. A l’aube qui résonnait naguère du chant des grives, des colombes, des geais, des roitelets et de cent autres chanteurs, plus un son désormais ne se faisait entendre. Le silence régnait sur les champs, les bois et les marais… Qu’est ce qui a déjà réduit au silence les voix du printemps ans d’innombrables villes américaines ? Ce livre essaie de l’expliquer » ( p 63). « Le printemps silencieux » va rencontrer « un succès planétaire ». « On peut distinguer deux phases dans la réception de Rachel Carson. : d’abord un accueil très favorable à son livre un soutien et une caution des milieux scientifiques… puis une phase d’oubli, due certainement à une contre-offensive des lobbies. Il faudra alors attendre l’émergence des écologistes pour qu’elle devienne une de leurs références et qu’elle en vienne même à toucher un plus large public » ( p 70).
Comment Rachel Carson témoigne du pouvoir de transformation de l’émerveillement et d l’admiration : « awe and wonder ».
« awe » and « wonder » : l’émerveillement et l’admiration
La présentation de la mer par Rachel Carson témoigne de son admiration et de son émerveillement vis-à vis des merveilles de la nature. Cette réalité peut être éclairée aujourd’hui par la découverte récente de l’existence du phénomène de la « awe », un émerveillement ébloui qui apparait dans certaines situations. Aux Etats-Unis en effet, à la fin du dernier millénaire, la psychologie a commencé à porter son attention aux émotions. Et puis, lorsque cette recherche a commencé à aborder le champ des émotions positives, en 1903, Dacher Keltner et un de ses collègues, Jonathan Haig, ont commencé à travailler pour mettre en évidence et définir l’émotion de la « awe ». Puis Dacher Keltner s’est engagé avec le professeur Yang Bei dans une grande enquête internationale à l’échelle mondiale en vue de rassembler de récits de personnes décrivant une expérience de « awe » selon la définition choisie : « Etre en présence de quelque chose de vaste et de mystérieux qui transcende votre compréhension habituelle du monde » (4). Par la suite, dans son livre : « Wonderstruck », une philosophe, Helen De Cruz a poursuivi cette recherche sur un autre plan. « Wonder » and « awe » sont au cœur des questions les plus profondes de la vie. Helen De Cruz démontre que « wonder » et « awe » sont des émotions motrices et que l’humanité a délibérément entretenu ces émotions dans des champs culturels tels que la religion, la science et la culture » (page de couverture). Comment Helen De Cruz envisage-telle « wonder » et « awe » ? « Dans ce livre, je considérerai « awe » et « wonder » comme distinctes, mais comme des émotions apparentées psychologiquement. La « awe » est une émotion où nous ressentons ou conceptualisons l’immensité, reliée à un besoin d’accommodement cognitif. L’immensité peut être physique (la dimension) ou conceptuelle (la complexité)… « Wonder » est l’émotion qui s’élève du terrain inconnu qui se tient juste au-delà des marges de notre compréhension courante. Comme la « awe », elle suscite un besoin d’accommodement cognitif, mais elle ne requiert pas une dimension d’immensité… Helen De Cruz associe « wonder » et « awe » parce qu’elles sont étroitement connectées dans la pensée occidentale. Des mots comme le grec ancien « thauma » ou le terme médiéval « admiratio » recouvrent à la fois « awe » et « wonder ». Les psychologues contemporains les traitent également ensemble ». Quelles sont leurs caractéristiques communes ? L’auteure en distingue deux. Ce sont des émotions épistémiques, c’est-à-dire des émotions qui nous motivent et nous incitent à explorer notre environnement et à apprendre davantage à son sujet . Ce sont également des émotions self-transcendantes . « Elles nous aident à nous mouvoir au-delà de la centration sur nous-mêmes et de nos propres préoccupations ».
« awe » et « wonder », émerveillement et admiration chez Rachel Carson
Dans son livre, Helen De Cruz cherche comment l’émerveillement et l’admiration forgent la manière dont nous pensons : la philosophie, la psychologie, la science, la religion. Cependant, elle considère également que ces deux grandes dispositions contribuent également à la transformation du monde.
L’auteure évoque des articles de psychologie qui mette en évidence les bienfaits psychiques engendrés par la « awe », par l’émerveillement. Cependant, nous dit-elle, les problèmes qui nous affectent comme l’anxiété et le stress, ne viennent pas seulement de nous-mêmes. « Ils sont provoqués par des problèmes sociaux plus généraux. Considérons, par exemple le phénomène répandu de l’anxiété climatique ou plus largement de l’éco-anxiété ». Nous voulons préserver un monde vivable pour les générations futures. L’auteure cite une militante écologiste, Jacquelyn Gill, qui écrit : « Quand les choses son dures, je me tourne souvent vers le monde naturel pour y trouver inspiration, force et même joie. Partager le sens de l’émerveillement avec d’autres, me donne le sentiment d’être plus connectée et plus fondée, m’apporte mon sens de la vie. Cela me rappelle aussi pourquoi je lutte » ( p 158). D’autres chercheurs partagent cette attitude. L’auteure pose une question : « Comment l’admiration et l’émerveillement (awe and wonder ) peuvent être des sources d’espérance ? » Elle s’inspire des vues de Rachel Carson sur l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder ), particulièrement comme elle les a exprimées dans son livre : « The sense of wonder » (1965). Elle veut montrer que Rachel Carson perçoit le sens de la merveille comme une vertu et une émotion transformante. « Je montrerai que l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder) peuvent nous apporter deux visions majeures : que nous sommes connectés avec le reste du monde et que les choses pour lesquelles nous éprouvons de l’émerveillement et de l’admiration sont intrinsèquement valables » ( p 158).
Les trois livres de Rachel Carson , « une trilogie de la mer » et d’autre œuvres précoces sont remarquées pour leur qualité lyrique et le sens de la merveille qu’ils évoquent. L’écriture de Rachel Carson est fortement associée avec l’émerveillement pour la nature » ( p 159).
L’auteure évoque aussi le livre « le printemps silencieux où la peur se manifeste. « le printemps silencieux » est moins lyrique que le reste de l’oeuvre de Rachel Carson . Mais il commence par une fable apocalyptique inoubliable : « Il y avait une fois une ville au cœur de l’Amérique où toute vie semblait en harmonie avec l’environnement » Tout paraissait bien jusqu’ à ce qu’un étrange fléau apparut dans le secteur et que tout commença à changer. Quelque charme maléfique s’était installé sur la communauté. Des maladies mystérieuses balayaient des troupeaux de poulets. Les vaches et les moutons tombaient malades et mouraient. Une ombre de mort régnait partout ». Et elle poursuit : « Il y avait un calme étrange. Les oiseaux, par exemple – où étaient-ils allés ? Beaucoup de gens en parlaient, intrigués et troublés… Les quelques oiseaux aperçus quelque part étaient moribonds. Ils tremblaient violemment et ne pouvaient plus voler. C’était un printemps sans voix… » ( p 160). Helen de Cruz commente ce texte en ces termes : « L’usage efficace de la rhétorique et du sublime scientifique est une caractéristique de l’œuvre de Rachel Carson. Dans ce cas, ce n’est pas une évocation, comme d’habitude de la majesté et de la force de la nature, mais de sa fragilité face aux interventions humaines inconsidérées…. Les premières œuvres de Carson sur la mer communiquaient un sens de la merveille, cherchant à aller au-delà d’un simple exposé de faits sur la nature et comment la contrôler, en vue plutôt de la réenchanter. De l’autre côté, le « Printemps silencieux » nous secoue hors de l’enchantement du techno-optimisme… » ( p 161). Rachel Carson pointe à un mauvais usage de la technologie. En contraste, elle propose une science éclairée, « une famille de disciplines sensibles aux intrications dans la toile de la vie, la relation qui tient tout dans une vie unique et en une communauté en évolution. Cette vision demande que nos actions soit animées par une éthique environnementale » ( p 161).
« L’entrelacement de l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder), du sublime et de la préoccupation morale de Rachel Carspn pour l’environnement sont les traits notables de sa philosophie. » Pendant qu’elle concevait le Printemps silencieux, elle préparait déjà un livre sur la « wonder », un livre sur la merveille. Cependant, le « Printemps silencieux prit le pas comme projet d’écriture, parce que Rachel Carson y vit une nécessité face à une menace urgente. Elle allait vers la fin de sa vie. Elle souffrait d’un cancer du sein qui finira par la tuer. Au lieu d’un gros livre ambitieux sur la merveille, sur la wonder, elle nous laisse un mince volume intitulé : « the sense of wonder ». C’est une édition illustrée posthume d’un essai que Carson écrivit pour le magazine : « Women’s home companion ». Elle y décrit la joie dont elle a fait l’expérience : « Une soirée d’automne orageuse, alors que mon neveu Roger était âgé de 20 mois, je l’enveloppais dans une couverture et l’emmenait en bas sur la plage dans un lieu sombre et pluvieux ». Ils entendaient le bruit tumultueux des vagues. « Ensemble, nous riions de pure joie, – lui, un bébé rencontrant pour la première fois le tumulte sauvage de l’océan ; moi avec le sel de l’amour d’une moitié de vie pour la mer »… Rachel Carson croyait que l’émerveillement et l’admiration étaient des émotions que les enfants possèdent naturellement bien qu’elles puissent diminuer avec le temps si elles ne sont pas nourries et cultivées (p 162). Elle croyait également que l’émerveillement et l’admiration non seulement nous font sentir bons, mais que ces émotions sont aussi une source de force en temps de difficultés (4). L’auteure commente ainsi : » Ceux qui demeurent, parmi les beautés et les mystères de la terre, ne sont jamais seuls et las de la vie. Quelque soient les vexations et les soucis de leurs vies personnelles, leurs pensées peuvent trouver des chemins qui les mènent vers un contentement intérieur et une ardeur de vivre renouvelée. Ceux qui contemplent la beauté de la terre trouvent des réserves de force qui dureront aussi longtemps que leurs vies ».
Dans la vision de Rachel Carson, l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder ) sont transformatrices. Ces émotions nous aident à voir le monde différemment et, en voyant le monde différemment, nous changeons aussi. S’émerveiller est un antidote à notre attitude destructrice de contrôler la nature pour notre propre intérêt. « Rachel Carson écrit : « Il semble raisonnable de croire – et je crois – que plus clairement nous pouvons centrer notre attention sur les merveilles de notre univers et moins de gout nous aurons pour la destruction de notre race. L’émerveillement et l’humilité sont des émotions saines et elles ne font pas bon ménage avec un appétit de destruction ». ( p 163).
Helen de Cruz voit en l’émerveillement le potentiel d’une vertu.
Pour une personne qui manifeste la vertu correspondante, un état de chose requiert des actions et des obligations. « La vertu vous harmonise avec l’environnement d’une manière particulière ». Dans ce chapitre consacré à la puissance de transformation intérieure de la « awe », de l’émerveillement, Helen de Cruz donne ainsi Rachel Carson en exemple.
Cette biographie, cette histoire de vie nous renvoie ainsi à la prise de conscience de la « awe » et de ses effets, une prise de conscience assez récente telle que nous l’avons découverte dans la recherche de Dacher Keltner, puis dans Helen De Cruz. Si, au moment de la parution du « Printemps silencieux », Rachel Carson nous apparait comme une militante héroïque de l’écologie, à travers sa vie et à travers son œuvre, elle manifeste la puissance de la awe, la puissance de l’émerveillement.
J H
- Thierry Pacot. Rachel Carson. Pour la beauté du monde. Calype éditions. 2023
- Wonderstruck : https://vivreetesperer.com/comment-ladmiration-et-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-induisent-la-culture-et-faconnent-la-maniere-dont-nous-pensons/
- The new science of everyday wonder: https://vivreetesperer.com/comment-la-reconnaissance-et-la-manifestation-de-ladmiration-et-de-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-peut-transformer-nos-vies/
- Voir aussi : L’enfant: un être spirituel : https://vivreetesperer.com/cooperer-et-se-faire-confiance/

par jean | Sep 19, 2025 | Vision et sens |
Une géographie de l’amour d’après la parabole de bon samaritain
La parabole du bon samaritain est sans doute une des plus marquantes de l’Évangile. Mais, en a-t-on saisi tout le sens ? Une philosophe Marie Grand veut élargir notre compréhension la plus habituelle à partir d’une peinture de Rembrandt et d’une réflexion prenant en compte la lecture de la Bible comme la philosophie de Paul Ricoeur. Dans son livre : « Géographie de l’amour. Une autre histoire du bon samaritain » (1), Marie Grand s’interroge sur l’étendue du déploiement de l’amour.
Le bon Samaritain et l’hôtelier
Son point de départ est l’examen d’un tableau de Rembrandt qui, au lieu de mettre l’accent sur la rencontre initiale entre le bon Samaritain et la victime des brigands, décrit « la fin de l’histoire en faisant entrer dans son cadre un personnage habituellement tapi dans l’hors-champ des tableaux et des commentaires bibliques : l’hôtelier » (p 14). Dans le dialogue entre le bon Samaritain et l’hôtelier à qui il confie le blessé, l’auteure perçoit un autre mode d’exercice de la charité. Et elle y trouve une occasion de distinguer les différentes formes selon lesquelles l’amour se déploie, « une géographie de l’amour ». « Vouloir aimer tout le monde, c’est en réalité vouloir deux choses très différentes que l’on peine d’ordinaire à bien distinguer. C’est en même temps ‘aimer tout un chacun indifféremment et tout le monde simultanément’… Généralement, seule la première question nous intéresse, car elle appelle les réponses les plus spectaculaires et les plus télégéniques… Les plateaux de télévision mettent régulièrement sous les projecteurs les Abbé Pierre, Cédric Villani, et autres bons samaritains. Chez ces aventuriers de l’amour, tout est à égale distance, car ils savent personnellement s’approcher de chacun. Mais ils ne sauraient avoir le monopole du cœur. On ne peut quadriller intégralement le monde par des rapports insulaires, des rapports de personne à personne. Il faut aussi se demander ce que devient l’amour quand les demandes et les sollicitations augmentent » (p 17-18).
Marie Grand en vient à souligner que l’action collective en vue d’aider les malheureux est une autre manifestation d’amour. « Devant le vertige des grands nombres, l’amour ne se contente pas d’improviser, il doit s’organiser. Ce visage-là est plus ingrat : c’est celui de l’Hôpital, de l’Éducation Nationale, de l’Ehpad, de la justice, de l’État, de la division du travail et du monde économique en général. C’est le visage de l’hôtelier ». L’auteure veut nous apprendre à voir dans des pratiques sociales une manifestation de l’amour au quotidien. « Signer, instruire, nourrir, loger, protéger et accueillir tout le monde : la tâche n’est plus de la même nature et pourtant c’est encore de l’amour. En effet, dans chacun de ces actes nous nous entretenons mutuellement dans la vie, ce qui est peut-être l’unique vocation de l’amour. Pour se faire, l’amour mobilise nos forces quotidiennes, s’inscrit dans l’épaisseur du tissu social, fait de nous les partenaires anonymes et interchangeables d’un système de services réciproques » (p 18). Certes, Marie Grand voit bien où réside l’écueil : « Nécessairement, en s’organisant, l’amour court le risque de profondément s’altérer, voire de disparaître dans les rouages de ce que nous appelons le « système » (p 19).
L’auteure met en lumière l’ampleur des besoins qui requièrent attention et soin en évoquant un autre passage de l’Évangile : « Les Évangiles nous racontent l’histoire d’une brebis perdue et retrouvée pour laquelle le berger délaisse son troupeau. On est en droit de s’interroger : qui veille sur les quatre-vingt-dix-neuf autres brebis quand il se porte au secours de la malheureuse ? Car, contrairement à ce que l’on croit, elles ne se trouvent pas en sécurité dans la bergerie, mais dans la montagne ou au désert » (p 19).
Marie Grand nous fait alors part du message qu’elle veut communiquer : « La conviction principale de ce livre est simple. On ne peut donner à l’amour son envergure et sa géographie maximale sans toujours tenir ensemble ces deux voies : celle du bon Samaritain et celle de l’hôtelier, celle de la rencontre interpersonnelle par laquelle nous tâchons de nous faire proches de quiconque et celle du service impersonnel par lequel nous allons à tous. Aimer tout homme, aller loin à la rencontre des territoires perdus de l’amour pour sauver la brebis égarée, tel est le défi du bon Samaritain. Aimer tous les hommes, les servir partout en même temps, veiller sur les quatre-vingt-dix-neuf autres brebis, tel est le défi de l’hôtelier. Il arrive que ces deux dimensions ne s’harmonisent pas ; pourtant elles se conditionnent et se corrigent réciproquement » (p 20).
Le livre se déroule ensuite en deux parties : ‘Aimer tout homme. Le bon Samaritain’ ; ‘Aimer tous les hommes. L’hôtelier’. Marie Grand soulève beaucoup de questions et y apporte de nombreuses analyses auxquelles on se reportera.
Aimer tout homme.
Le bon Samaritain
Marie Grant commente la demande : ‘Qui est mon prochain ?’. ‘Pourquoi as-tu besoin de savoir au préalable à qui s’adresse ton amour ?’… Aimer authentiquement, n’est-ce pas refuser de faire de la réponse à cette question un préalable de l’amour. Car c’est en aimant que l’on y répond… « (p 28). La réponse appelle à nous conduire en prochain. « Le prochain, c’est la conduite même de se rendre présent » commente Paul Ricoeur. « On n’a pas un prochain, on se fait le prochain » (p 30).
L’auteure introduit alors une analyse subtile de nos comportements oblatifs Notre amour peut s’adresser à différentes personnes et un conflit peut apparaitre entre ces différentes conduites. « Aimer tout le monde serait si simple si nous n’avions pas sans cesse à articuler des loyautés et des allégeances contradictoires, celles du lévite, du prêtre et du bon Samaritain. Il se peut que nous ayons de bonnes raisons de passer notre chemin : un enfant, un parent, un proche à secourir ou encore une responsabilité à exercer. Peut-on nier qu’il existe un ordre légitime et naturel de l’affection ? Il n’est pas honteux de commencer par s’aimer soi-même, c’est même un impératif vital. Ne dit-on pas d’ailleurs qu’il faut aimer le prochain comme soi-même ? » (p 35). Cependant, nos attachements ne sont-ils pas souvent trop exclusifs ? « Au sein de nos interactions, le sentiment aménage des zones d’extrême intensité, de hautes fréquences et de contrée froides et lointaines… Les différentes formes de l’affection devraient nous rapprocher les uns des autres mais elles produisent aussi des écarts et des différences… » (p 37-38). L’auteure explique le processus de nos attitudes différenciées.
« Paradoxalement, le défaut d’ouverture n’est pas le contraire de l’amour mais son ombre portée. Ce n’est pas faute d’aimer que nous sommes indifférents, voire inamicaux mais parce que nous aimons. Tel le soleil, nos sentiments investissent, éclairent et réchauffent certaines zones de l’espace social et en délaissent d’autres » (p 38). « L’amour doit se battre afin de parvenir à aimer tout le monde et faire triompher sa géographie rêvée (celle du bon Samaritain) sur sa géographie réelle (celle du lévite et du prêtre) » (p 40).
Marie Grand revisite l’épisode fratricide de Caïn et Abel. Caïn, l’enfant préféré de sa mère rejette son cadet et le tue. Elle remarque qu’il y a des familles enfermantes. « L’affection naturelle peut devenir une prison » (p 43). « En plaçant un fratricide à l’orée de sa grande saga, la Bible part d’un constat et indique une direction : c’est en s’étendant au dehors que nos liens se purifient. » (p 44). « Et sur un registre anthropologique, la prohibition de l’inceste est une première loi de civilisation qui nous prescrit de ne pas nous lier les uns aux autres, n‘importe comment. Elle nous invite à dépasser le cercle de la proximité… » (p 43). La société humaine se caractérise par son hypersociabilité. « En nouant de multiples contacts, les êtres humains tissent une solidarité d’un nouveau type qui préfigure progressivement le lien politique ». La devise : ‘Liberté, égalité, fraternité’ fait place à la fraternité qui évoque un sentiment familial. Marie Grand estime que « c’est parce que les liens de la famille ont vocation à s’universaliser. Le contrat social a besoin de puiser en eux une partie de sa force…. Pour vouloir l’égalité et la justice… le libre jeu des intérêts ne suffit pas… » (p 48). L’auteure estime que la parabole du bon Samaritain n’entraine pas un ‘universalisme abstrait’. C’est un récit qui renvoie à une réalité très concrète où des frontières existent et comptent.
Au total, Marie Grand met l’accent sur l’importance de l’attention. « L’exclusion est souvent le résultat d’un processus d’inattention passive, voire d’invisibilisation active » (p 54). Pendant que notre attention se porte sur certains sujets, elle se détache d’autres aspects de la réalité. « Un tri met en jeu des filtres qui reflètent nos à priori et nos intérêts » (p 58). Une juste attention est nécessaire. Elle n’est pas aisée el l’auteure rajoute une autre exigence. « Prêter attention ne suffit pas. Prêter attention, ce n’est pas encore être attentionné… L’attention doit se faire passive et patiente… » (p 61-62). Ainsi l’attention apparaît comme une priorité. « L’extension du domaine de l’amour est étroitement corrélée à l’extension de domaine de l’attention » (p 62).
Aimer tous les hommes. L’hôtelier
Marie Grand rappelle la formule de Michel Rocard : « On ne peut accueillir toute la misère du monde ». Si cette phrase peut paraitre abrupte, elle n’en exprime pas moins une part de la réalité. L’auteure commente en ce sens : « L’amour n’est pas seulement un sentiment, c’est une aptitude : ce qui suppose de s’enquérir des moyens par lesquels il s’incarne dans la réalité. C’est manifestement le cas du bon Samaritain qui a non seulement la compétence, mais aussi les ressources nécessaires pour dispenser les premiers secours » (p 66). Dans ce livre, Marie Grand apporte une vision originale en mettant l’accent sur un aspect le plus souvent négligé ou ignoré : la tractation du bon Samaritain avec l’hôtelier en le rémunérant pour lui confier le blessé. Elle trouve dans la peinture de Rembrandt le même regard. « La parabole ne suit pas une pente romantique. Le bon Samaritain ne fait pas l’impossible. Il fait ce qu’il sait faire avec ce dont il dispose. Il délègue la suite à celui qui a fait de l’hospitalité un métier. Rembrandt a choisi de nous montrer le moment précis où l’hôtelier prend le relai du bon Samaritain, où l’acte de charité se continue tout en se métamorphosant » (p 67).
L’auteure aborde la dimension collective de l’amour. « La fraternité universelle s’adresse à quiconque indifféremment, mais aussi à tous simultanément. Aimer ce ‘quiconque’, ce n’est pas encore aimer tous ces « quiconque ». (p 71). Telle exigence ne doit pas faire oublier l’autre. « Si l’on ne doit pas sacrifier l’individu à la communauté comme le font le lévite et le prêtre, on ne peut pas davantage sacrifier la communauté à l’individu comme certains bons Samaritains bien intentionnés pourraient être tentés de le faire » (p 73). L’auteure aborde la question du changement d’échelle. C’est un problème courant dans la vie économique. Ces changements appellent un changement de mentalité et d’organisation. Étendre l’œuvre de l’amour implique de même une approche nouvelle. « Plutôt que de réclamer une multitude de bons Samaritains, ne serait-il pas plus rationnel d’exiger que les routes de Palestine et du monde entier soient sûres ? Car on oublie souvent que l’histoire s’ouvre sur une scène de brigandage » (p 77). A partir de la parabole du bon Samaritain, l’auteure met l’accent sur une exigence sociale souvent méconnue. « Tant que nous ne remontons pas aux racines économiques et politiques de la difficulté, notre amour reste à la surface de la réalité. Pire, il procède en ordre dispersé de manière aléatoire et sélective » (p 80).
Le concept de justice apparait ici : « Pour prendre en charge de manière ordonnée l’augmentation exponentielle des besoins, l’amour se fait justice. Seule cette métamorphose lui permet de changer d’échelle et d’atteindre le niveau de généralité auquel il veut prétendre. La justice construit patiemment et rationnellement des équilibres. Elle répartit l’amour selon la règle de l’équivalence et de la réciprocité afin d’éviter toute forme de privilège… Exercice difficile… Inévitablement, en devenant justice, l’amour accepte des compromis imparfaits moins spectaculaires que ses élans spontanés » (p 83).
Aux côtés du bon Samaritain, l’hôtelier mérite sa place au cœur du récit de la fraternité universelle. « N’incarne-t-il pas une autre facette du lien social et un visage possible de l’amour ? ». Dans cette perspective, Marie Grand recourt à un article de Paul Ricoeur : ‘Le socius et le prochain’. « Le philosophe remarque que la société nous place toujours à l’entrecroisement de deux types de relations : des ‘relations courtes’ et des ‘relations longues’. Les premières sont immédiates et intimes. Elles rendent présentes une personne à une personne… Les secondes sont distantes et impersonnelles, car intermédiées par des circuits complexes et collectifs où l’argent jouent un rôle central » (p 85). Dans les ‘relations longues’, « nous jouons un rôle social… nous nous appréhendons en tant que nous sommes hôtelier, boulanger… Nous prenons place d’une manière plus ou moins anonyme dans une organisation sociale… le socius selon Paul Ricoeur, désigne la relation longue, celle par laquelle nous devenons réciproquement partenaires d’un vaste système de services » (p 86). On peut opposer ces deux relations, mais l’auteure met l’accent sur leur complémentarité. « C’est en réalité par la voie longue de nos rôles sociaux et même de nos interactions politiques et économiques que l’amour chemine le plus loin, et atteint justement ceux que nous ne choisissons pas… Par cette voie, l’amour rayonne au-delà du cercle de la proximité et de la connivence » (p 87). A partir de là, nous envisageons notre activité professionnelle sous un jour nouveau. « Prendre conscience qu’elle est à sa manière un lieu d’amour exige de questionner nos priorités… Quels hôteliers nous voulons être, quelle société nous souhaitons soutenir chaque jour par notre énergie et notre talent… » (p 91).
Marie Grand ajoute un autre registre de relation : ‘le tiers’ (p 91). C’est ‘aller à la rencontre de ceux qu’aucune interaction sociale ne placera jamais sur notre chemin’. « L’amour doit aussi s’engager dans cet extrême bord du lien social qui est l’au-delà de la présence, l’au-delà même du partenaire. Aimer, c’est se soucier de ceux que je ne vois pas mais pourrais voir si j’étais né ou si je vivais ailleurs » (p 94). Emmanuel Levinas évoque ‘le tiers’. ‘Il laisse entendre qu’il est potentiellement un tiers exclu’. Il y a là encore un sujet d’attention, mais nous dit Marie Grand, « garder à l’esprit ce tiers invisible ne suppose pas seulement un effort d’attention mais d’abstraction » (p 94). C’est donc « s’enquérir en chaque situation de ce que je dois à tous, à cette pluralité abstraite qui avoisine mes relations effectives… ». Cette attention va jusqu’à remettre en cause « des manières de vivre qui reposent structurellement sur l’asservissement d’un tiers que l’on ne voit pas » (p 95).
L’auteure élargit constamment le champ de sa réflexion. Ainsi, elle nous appelle à envisager l’institution comme une garante de la durabilité d’un lien d’amour. « Par l’institution, les êtres humains édifient un univers plus durable que leurs élans spontanés » (p 97). L’auteur dresse un bilan nuancé, mais globalement positif du rôle des institutions (p 97-105). C’est encore une invitation à réfléchir au-delà de nos impressions immédiates. « Nous avons tendance à ne plus faire confiance aux institutions… Nous les contournons en privilégiant tantôt les relations très courtes, le monde chaleureux de la communion où chacun se sent intimement lié à chacun ; tantôt les relations très longues, le monde flexible et fluide de la connexion où chacun peut s’engager et se désengager quand bon lui semble. L’institution a un tout autre style : ni communion, ni connexion mais communauté. Elle organise la coexistence humaine la plus large possible autour de pratiques communes et de significations partagées qui sont toujours les fruits d’une histoire » (p 104).
Cependant, l’auteure sait nous montrer comment les institutions peuvent dériver. En ce sens, elle procède à une interprétation originale du récit évangélique racontant l’accueil de Jésus par Marthe et Marie. « En s’affairant, en suivant à la lettre le protocole de l’hospitalité et les tâches qu’elle s’est fixée à l’avance, Marthe fait fonctionner la maison, tourner son organisation mais entre-t-elle en relation avec celui qu’elle sert ? … Marie a choisi la meilleure part selon le texte. Mais quelle est cette part ? C’est tout d’abord celle de l’attention. Elle écoute la parole de son hôte, nous rappelant qu’avant de servir, il faut connaitre celui qu’on sert. Il faut ajuster son service aux besoins qui sont les siens… La part de Marie est aussi celle de la relation. Marthe s’apprête à couvrir ses hôtes de présents, mais est-elle présente ? Les conditions matérielles de l’accueil prennent le pas sur l’accueil lui-même » (p 209-110).
A partir de là, l’auteure met l’accent sur ‘la dualité intime de l’accueil comme du soin’. « Le philosophe Frédéric Worms remarque que l’on soigne indissociablement quelque chose et quelqu’un » (p 110). Or, ces deux aspects peuvent être dissociés, la part essentielle de la relation étant méconnue. On en vient à comprendre les possibles dérives des institutions. « L’opposition des deux sœurs illustre une tension : la logique de l’institution est en partie contraire à celle de l’attention… Dans l’avalanche des procédures et des protocoles, il est difficile de prêter attention à la singularité des situations. La généralité des rôles ou le respect scrupuleux des règles peuvent nous conduire à ne plus être attentionnés, à nous absenter de ce que nous faisons en exécutant notre fonction de manière mécanique et désengagée » (p 111).
Presque tout le monde connait la parabole du bon Samaritain. Elle est répétée dans les églises, mais, bien au-delà, elle est devenue un texte emblématique pour tous ceux qui accordent priorité au souci de l’autre.
Ainsi, dans son livre : « Une philosophie de l’histoire. Darwin, Bonaparte et le Samaritain », le philosophe Michel Serres voit dans le bon Samaritain la figure d’un monde nouveau, un âge plus doux en voie d’advenir (2). En lui, Michel Serres célèbre la figure du médecin : « Celle qui se penche sur les blessés ; celle qui écoute les plaintes de l’agonie ; celle qui s’incline ; l’attentive qui cherche à comprendre et peut-être guérir… Non, il n’est pas seulement le héros de ce temps, mais sans doute celle et celui de toute l’histoire ».
Emblématique, ce texte s’ouvre à de nombreuses lectures. L’interprétation à laquelle il donne lieu dans le livre de Marie Grand, ‘La géographie de l’amour’, est particulièrement riche et originale. Elle tranche avec ce qu’on entend et lit couramment : une admiration, un appel à la ressemblance du seul samaritain et un regard critique pour ceux qui ont passé leur chemin sans prendre soin. Marie Grand a découvert un tableau de Rembrandt représentant cette scène d’une manière originale et elle peut s’appuyer sur cette peinture pour développer un commentaire particulièrement riche et avisé. C’est une réflexion sur les exigences de l’amour et la manière de les considérer et d’y répondre en évoquant les tensions et les ambiguïtés. Cependant, la grande originalité réside dans la mise en valeur du rôle de l’hôtelier dans son accord avec le bon Samaritain pour poursuivre son œuvre de sauvetage. Marie Grand met là en évidence que l’œuvre de l’amour ne peut se suffire de belles actions individuelles. Elle requiert également une action plus collective et plus continue. D’autant qu’il ne peut s’agir seulement de sauver tel ou tel, mais de venir à l’aide de tous les hommes sans exception. Marie Grand expose ainsi la conviction principale de son livre : « On ne peut donner à l’amour son envergure et sa géographie maximales sans toujours tenir ensemble ces deux voies : celle du bon Samaritain et celle de l’hôtelier, celle de la rencontre interpersonnelle par laquelle nous tâchons de nous faire proches de quiconque et celle du service impersonnel par lequel nous allons à tous » (p 20). Ce livre a ainsi le grand mérite de susciter une prise de conscience que des métiers ordinaires, en répondant aux besoins humains, participent à une œuvre d’amour en les valorisant ainsi à nos yeux.
Jean Hassenforder
- Marie Grand. Une autre histoire du bon samaritain. Cerf, 2024
Interview de Marie Grand sur son livre : « Voyage au pays de l’amour » sur Regards Protestants : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=Marie+Grand+bon+Samaritain+you+tube+&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:2ede7e11,vid:0bDdb8Ydk_8,st:0
- Une philosophie de l’histoire, par Michel Serres : https://vivreetesperer.com/une-philosophie-de-lhistoire-par-michel-serres/