par jean | Août 2, 2022 | Expérience de vie et relation |
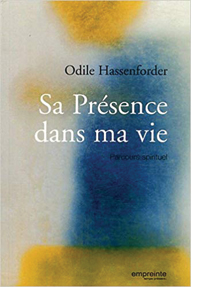 Ma vision de Dieu a changé.
Ma vision de Dieu a changé.
Un témoignage d’Odile Hassenforder
Depuis que Dieu est intervenu dans ma vie, tout a changé pour moi. Comme la samaritaine, j’ai déclaré autour de moi que Jésus était le Messie ; comme l’aveugle de Siloé, je me suis prosterné devant mon Dieu. Dire qui est Dieu pour moi aujourd’hui, ce qu’il était pour moi il y a dix, vingt ans, c’est dire quelle était ma relation à Lui. Je ne puis décrire Dieu. « Personne ne l’a jamais vu », dit l’apôtre Jean en commençant son évangile. « Qui me voit, voit le Père, dit Jésus à Philippe. Tous les contemporains de Jésus qui l’ont approché n’ont pas reconnu en lui le Fils de Dieu ; seuls ceux qui ont eu une véritable rencontre avec lui, ont reçu la lumière, ont saisi la vérité. J’imagine très bien l’émotion qu’ont du ressentir la samaritaine, l’aveugle et tant d’autres. Aujourd’hui un jeune dirait : « ça fait tilt », un amoureux dirait : « j’ai eu le coup de foudre ». Ces expressions sont bien pâles pour exprimer le choc d’une telle découverte.
Un chemin.
Que m’est-il arrivé ce mois d’octobre 1973 ?
L’impossibilité de vivre m’entraînait à la mort, au suicide.
Pourtant, je me rappelle qu’à l’époque où je suis rentrée dans la vie professionnelle, je croyais ne jamais connaître le désespoir, malgré toutes les difficultés de vivre que j’avais, parce que Dieu était avec moi. Je ressentais une assurance intérieure.
J’avais eu la chance de rencontrer, à cette époque, un aumônier d’action catholique qui me suivit durant quatre ans dans une forme de psycho-thérapie spirituelle, si je puis m’exprimer ainsi. En plus de la messe quotidienne, je profitais d’un entretien spirituel toutes les trois semaines avec cet aumônier. En fait, je pouvais exprimer mes aspirations et mes incapacités. Je ne me rappelle pas du contenu précis d’un de ces dialogues. Plein de bon sens et de finesse psychologique, mon interlocuteur me montrait que Jésus m’entraînait dans une dynamique positive. Par la confession qui suivait, je remettais au Seigneur tout le négatif de ma vie et attendais de lui la force de poursuivre mon chemin. Cela été pour moi l’occasion d’une évolution psychologique très appréciable. Je me rend compte aujourd’hui que la situation était ambiguë : surmonter mes difficultés psychologiques et réaliser une image idéale de moi, plutôt que de saisir l’invitation de l’Esprit à entrer dans l’univers de Dieu. J’ai reçu ce dont j’avais besoin à l’époque. J’en remercie le Seigneur aujourd’hui en revoyant tout ce qu’Il a mis sur ma route, d’étape en étape, respectant le cheminement de mon être, proposant la nourriture adaptée à ce que je vivais.
Mon mariage a évidemment été un tournant dans ma vie. Mon mari m’a apporté la vie culturelle et intellectuelle à laquelle j’aspirais tant, mais aussi une vie de foi complémentaire à la mienne. Nous avons essayé de prier ensemble le soir. Notre prière s’est vite tarie. Ensemble nous avons fait partie de groupes de foyers, de Vie Nouvelle dans les années soixante. Nous allions régulièrement le dimanche dans une paroisse voisine de trois kilomètres de notre domicile. Nous faisions allègrement le trajet à pied, car nous recevions là l’annonce d’une vie élargie en Jésus-Christ, un sens à notre vie en Dieu.
A la naissance de notre fils, né prématuré à six mois et menacé de ne pas survivre, nous avons beaucoup prié, remettant à Dieu notre sort autant que celui de cet enfant. Je savais intellectuellement que les miracles existaient, mais ma foi était bien faible pour croire que Dieu pouvait intervenir pour moi. Tout en disant « que ta volonté soit faite », je pensais au déroulement de l’enterrement imminent et je ne prêtais pas attention aux paroles d’espérance de mon entourage. Par la suite, j’ai attribué la survie de notre enfant uniquement aux médecins et à la science. Ce n’est que maintenant que mon cœur est rempli de reconnaissance envers celui qui a toujours été auprès de moi et que je ne voyais pas. Oui, je constate maintenant, en revoyant ma vie passée, que le Seigneur m’a préservée de catastrophes irréversibles. Pourtant à cette époque, il devenait pour moi de plus en plus absent. L’alimentation de la foi s’estompait peu à peu.
Cependant les handicaps de ma personnalité réapparaissaient dans mon nouveau mode de vie de mère au foyer. Je n’ai pu profiter alors des joies de la maternité. Je n’ai pas pu faire face non plus à mes conditions de vie. Mon action militante ne parvenait plus à compenser mes problèmes. J’entrepris une psychothérapie lorsque je constatais qu’à deux ans mon fils présentait des troubles de personnalité. La seule chose qui était en mon pouvoir je devais le faire. Avant d’entreprendre une telle démarche, j’allais voir un prêtre ami, espérant que, par son intermédiaire, Dieu me sortirait de là. En fait, il me dit que Dieu pouvait agir à travers les sciences humaines. Il insista d’autant plus qu’il avait constaté la tristesse la tristesse profonde que dévoilait mon visage lorsque je ne me croyais pas observée. Je compris sûrement assez mal ce qui m’a été dit ce jour-là car je mis mon seul espoir dans la psychologie. L’année suivante, je confiais mon fils à la garde d’une voisine et je repris le travail social. La psychothérapie m’a été d’un grand secours pour mettre à jour les causes de mon inhibition et aussi me dégager de bien des angoisses et des défenses que mon inconscient avait forgées. Lors de ma première consultation, je me présentais comme vivant dans une sphère de plexiglace au milieu de la vie, mais en dehors d’elle.
L’annonce d’une nouvelle naissance en 69 a été pour moi une catastrophe, car je n’avais pas encore suffisamment acquis mon autonomie. La catastrophe a été bien plus grande encore lors de la fausse couche qui a suivi. J’ai vécu la mort d’un enfant. Seul l’oubli a pu atténuer la douleur. Je ne me souviens pas m’être adressée à Dieu. Il n’était plus pour moi qu’une entité qui animait ce grand univers où je n’étais que poussière. Il existait bien sûr, mais à la façon de l’horloger et je faisais partie de la mécanique. Les amis, dans ces circonstances sont souvent de bien peu de secours. Et ils ne peuvent donner que ce qu’ils ont. Du reste, ceux ou celles-ci devenaient rares car, fatigués psychologiquement, mon mari et moi, nous allions de moins en moins aux réunions de toutes sortes et bien peu de monde se souciait de notre absence. Les soutiens religieux disparaissaient. Le curé de la paroisse que nous fréquentions partit en 1967 et nous n’avions pas trouvé ailleurs une alimentation spirituelle malgré nos nombreuses recherches. Les groupes de foyers s’étaient dissous.
Peu importe les raisons et les circonstances qui ont provoqué une dissociation de ma personnalité. Je suis persuadée aujourd’hui que, si j’étais restée en relation avec Dieu, je n’aurais pas vécu ce drame. Il était tout de même là présent, mais je ne le savais pas. J’ai utilisé tout ce qui était en mon pouvoir pour surmonter ces moments de dépression, trou noir où tout disparaissait. Je ne manquais pas de volonté et l’énergie déployée pour surnager était deux fois plus grande que celle que je dépense aujourd’hui. L’ergothérapie, pensais-je, pourrait peut-être me sortir de cet état second où l’imaginaire et la réalité s’entremêlaient. Alors, je me mis à tapisser la chambre de mon fils, avec beaucoup de mal du reste, car je me trompais constamment dans mes mesures. La relaxation permettait à mon corps de ne pas craquer trop vite, comme la chimiothérapie soutenait le psychisme. Il me semblait que la folie se profilait derrière mon angoisse ; et le phénomène ne faisait que s’amplifier. Je rencontrais cependant la compréhension attentive et patiente de médecins tandis que plusieurs amies m’exprimaient leur affection. Mais que pouvaient les uns et les autres ? Je leur suis cependant reconnaissants de leur attitude qui a atténué ma souffrance et m’a permis de tenir plus longtemps. Du moins jusqu’au jour où j’avalais trop de somnifères. L’escalade continuait. Des forces internes s’entraînaient à me détruire .
C’est dans cet état, huit jours après mon sommeil prolongé, que je participais à un week-end avec des amis sur le thème : « vivre sa foi ». Quelle gageure ! Ce dimanche, pendant la prière, je tirais le signal d’alarme, et, dans mon désespoir, je criais : « Jésus, si tu es la Vie, donne-moi le goût de vivre ». Un ami bien intentionné présenta une parabole à sa manière : deux grenouilles se débattaient dans une jatte de lait : l’une, dans son désespoir, se laisse couler. Mais l’autre continue à s’agiter et une motte de beurre se forme grâce à laquelle elle pu surnager. Cela ne fit qu’augmenter mon désarroi : pourquoi les prêtres ne parlaient-ils que psychologie ? Aucune force humaine ne pouvait me sortir de là. En fait, mon médecin avait mieux compris ma situation lorsqu’il me parla de crise existentielle. Sur son conseil, j’ai lu un livre sur le bouddhisme. Là encore, il me semblait que je devais tirer de moi-même la force de passer au stade de l’esprit. Je ne pouvais pas. J’étais anéantie. Il fallait que la vie vienne à moi car je ne pouvais la susciter malgré tout le désir que j’en avais . J’avais parfaitement conscience de ma responsabilité envers mon fils de huit ans, très angoissé de ce qu’il vivait malgré mes efforts pour cacher mes problèmes et compenser au maximum.
Délivrance.
Jésus a répondu à mon appel : je le sais maintenant car le hasard est devenu pour moi providence : « Pas un cheveu de votre tête ne tombe sans que je le veuille » . Ce n’est pas un hasard d’avoir trouvé un jour de vacances le pasteur d’une assemblée de Dieu, rencontré précédemment lors d’une réunion.
De cet entretien, je me rappelle :
° Jésus guérit, il peut vous guérir.
° Comment ?
° Quand je sème du blé, en fils de paysan, j’attends qu’il pousse. Je ne me demande pas comment il va pousser. C’est un fait d’expérience. De même, quand je prie Jésus, je sais qu’il répond. Je me place là sur un plan spirituel et non intellectuel.
En y réfléchissant maintenant, je réalise que je ne croyais plus alors à l’efficacité de la prière. Cet entretien fut le point de départ d’un renouveau pour moi.
Le retour de vacances fut difficile. Je me trouvais contrainte à m’absenter de plus en plus fréquemment de mon travail. Je m’y accrochais cependant pour ne pas sombrer. J’échappais de justesse à un accident de voiture que j’ai failli provoquer par ma faute. Alors, je réalisais que j’allais à la catastrophe. Face à moi-même, je me rendais compte avec une grande lucidité que j’avais un choix à faire. Deux possibilités se présentaient à moi. Je continuerai à lutter par mes propres forces tout en sachant que cela irait de mal en pis. Je pouvais aussi choisir le chemin de la vie. Je me détruis, pensais-je, parce que je ne peux vivre. J’ai envie de vivre . Alors je choisis la vie. C’est ainsi que je me déterminais pour Jésus, sans condition, prête à tout donner, mon indépendance entre autres, prête aussi à tout recevoir.
« Je n’en peux plus », c’est tout ce dont j’étais capable de dire. Je réalisais alors que la Parole de Dieu est efficace. Certaines citations de la Bible résonnaient en moi : « Dans la vallée de l’ombre de la mort » pour sûr, j’y étais. La suite du passage était moins évidente pour moi, bien que je l’ai mille fois entendue : « Tu es mon berger ». Ce jour-là, ce fut vrai. Je le sus dans tout mon être lorsque, à la suite de la prière, je ressentis une énergie vitale qui me donna force et consistance, puis un grand calme intérieur, puis la joie. C’était la première fois qu’on priait pour moi, avec conviction et non avec des formules, en résonance avec mes aspirations les plus profondes jamais exprimées. Ce qui était demandé se réalisait. C’était extraordinaire et merveilleux.
L’effet dura quarante-huit heures, puis les symptômes réapparurent. Je n’hésitais pas à retourner me désaltérer à la source. J’étais déterminée à continuer quoiqu’il arrive. En fait, j’ai osé réitérer ma démarche parce que la perche m’avait été tendue par le pasteur : « Dans votre état, il faudra prier plusieurs fois ». C’était l’expérience qui le disait. Tous les jours, les deux jours, j’ai ainsi demandé que l’on pria pour moi, cinq fois en une semaine. A chaque fois, la même énergie me donnait vie. Et ce dernier jeudi d’octobre, j’ai eu envie de m’associer à la prière d’un groupe charismatique catholique que je connaissais par ailleurs. Devant une assemblée nombreuse de cent ou cent cinquante personnes, j’exprimais tout haut l’assurance intérieure qui m’apparaissait : « Seigneur, je ne suis pas encore guérie mais je sais que tu vas me guérir et je t’en remercie ». Une prière murmurée en langues au centre de l’assemblée fut pour moi un soutien communautaire : ils savaient ce que je voulais dire et ils s’associaient à ma prière et la soutenaient. Ce soir-là, à peine couchée, je sentis ma personnalité se remettre en place, en une fraction de seconde. Comme un puzzle, chaque partie de mon être prenait sa place : l’unité s’est faite en moi. J’entrais dans la réalité, j’étais bien. Et dès le lendemain, je dis à qui voulait l’entendre que j’étais guérie. « ça se voit », me répondit-on souvent. Et le dimanche, au lieu d’aller demander à l’assemblée la prière des frères, j’y ai rendu grâce à Dieu.
J’étais transformée. Ma situation n’avait en rien changée, elle ne m’écrasait plus. J’étais à l’aise dans ma peau comme jamais je ne l’avais été. Qu’il pleuve, qu’il vente, tout me réjouissait. La fatigue, physique que je continuais à ressentir, n’entachait nullement ma joie profonde. Je me disais en convalescence, voilà, c’est tout. Rien ne pouvait assombrir cette joie, même la grande souffrance provoquée par une de mes amies, qui, au lieu de se réjouir avec moi, me rejeta en m’accusant de mysticisme, ce dont elle avait peur pour elle-même, du moins l’ai-je compris ainsi et je ne lui en voulus pas.
Une vie en abondance.
J’avais demandé la vie. Je l’ai reçu en abondance, bien au delà de ce que je pouvais imaginer : la vie éternelle. « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jean 17,3). Je suis née à la vie de l’Esprit, je suis entrée dans l’univers spirituel ; le royaume de Dieu, dit Jésus. Ce fut une révélation pour moi. Il m’est arrivé ce que Jésus disait à Nicodème : « L’Esprit souffle où il veut. Tu entends le bruit qu’il fait, mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour tout homme qui naît de l’Esprit ». La Trinité devenait une réalité aussi naturelle qu’avoir des parents. Jésus, par sa mort et sa résurrection, m’a tiré de la mort où m’entraînait le mal, pour me donner la vie éternelle en me réconciliant avec le Père. L’Esprit Saint qui les habite tout entier, ne faisant qu’un avec eux, m’anime de cette vie divine. « Celui qui doit vous aider, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit », a dit Jésus à ses disciples (Jean 17). Dieu se manifestait à moi aussi par l’amour qui m’envahissait. Je me suis sentie aimée au point où cet amour débordait de moi sur tous ceux que je rencontrais : j’aurais embrassé tout le monde si les convenances ne m’avaient retenue.
Simultanément, j’avais soif de connaître davantage. Je lisais ma Bible, surtout le Nouveau Testament. Et, assez curieusement, je comprenais beaucoup de choses qui m’étaient jusque là restées hermétiques.
Comme tout nouveau-né qui s’ouvre à la vie, je devais poursuivre mes découvertes. Avec deux autres ménages, nous avons formé un groupe de prière interconfessionnel qui, du reste, grandit très vite. Nous sommes allé voir ailleurs ce qui se passait, nous avons suivi des sessions et pris de nouveaux contacts. Par la suite, des difficultés et des déviations ont surgi dans ce groupe et nous avons du prendre du recul.
Vivre dans l’Esprit.
Aujourd’hui, la conviction de me savoir sauvée, c’est-à-dire vivre dans le règne de Jésus-Christ ressuscité, entraîne chez moi une attitude positive. Chaque matin, j’ouvre mon être à l’Esprit qui renouvelle toute chose. Je ne peux prévoir ce que je vais découvrir, je deviens disponible et disposée à voir sa présence lors d’une rencontre, au sein d’évènements. Je ressens le besoin d’exprimer cela à voix intelligible en une courte prière de quelques minutes dans une attitude active.
La lecture des Ecritures est une nourriture. De temps en temps, tel passage résonne en moi ; d’autres fois, me revient à la mémoire un verset à propos d’évènements que je vis, une question que je me pose, et j’y vois là une réponse. Je sais aussi que si je prends les promesses de Jésus pour moi, elles se réalisent pour moi. Cela a été le cas, par exemple, en ce qui concerne la confiance en Dieu. « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus » (Luc 12). Effectivement, je me suis rendu compte que mon être se transformait en considérant mes rêves ; ainsi dans un rêve représentant une scène de dévastation, je restais calme et sereine.
Jésus nous dit d’aimer notre prochain. Il nous aide à y parvenir. Il n’y a pas si longtemps, mon interlocuteur commençait à m’énerver. Intérieurement, je dis : « Donne-moi de l’aimer, Seigneur » et je me rappelle que le plus petit est le plus grand dans le royaume des cieux, que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et je réalisais ainsi que je devais être au service de celui qui était là à côté de moi. Mon ressentiment disparut. Je m’intéressai à ce qui le préoccupait.
Je souhaite voir davantage comment Dieu se manifeste sous des formes bien diverses : à travers les autres, dans la nature, dans l’histoire. Après ces trois années de découverte, je m’aperçois que je marche à peine. Je suis heureuse de voir la vie éternelle devant moi comme en moi : c’est une louange constante que j’adresse au Seigneur, qui est en même temps adoration et contemplation. Je lui rends grâce pour tout ce qu’il a fait pour moi.
Odile Hassenforder
Texte polycopié retrouvé dans ses archives
« Ma vision de Dieu a changé », p 27-36 dans : Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Empreinte temps présent, 2011
Voir aussi : Odile Hassenforder : « Sa présence dans ma vie » : un témoignage vivant : https://vivreetesperer.com/odile-hassenforder-sa-presence-dans-ma-vie-un-temoignage-vivant/
par jean | Août 2, 2022 | Vision et sens |
 Pour un engagement chrétien authentique
Pour un engagement chrétien authentique
Dans une méditation sur le site du « Center for action and contemplation », Richard Rohr nous enseigne que nous pouvons nous engager dans de nouvelles manières de vivre si nous parvenons à un certain degré de détachement vis-à-vis des systèmes en place.
Non-idolâtrie
« Le fondement du programme social de Jésus est ce que j’appellerai une non-idolâtrie, c’est à dire un retrait des passions pour tous les royaumes excepté le Royaume de Dieu. C’est bien meilleur que de ressentir le besoin d’attaquer les choses directement. Le non-attachement (la liberté par rapport à des dépendances à des systèmes humains de domination) est le meilleur moyen que je connaisse de protéger les gens du fanatisme religieux et de toute forme de pensée et de conduite marquée par un antagonisme. Il n’y a pas à se mobiliser contre. Juste à se concentrer sur la Grande Chose vis à vis de laquelle nous sommes pour »
Les églises comme inspiration d’un genre de vie alternatif
C’est en ce sens que Richard Rohr envisage les églises. « Paul essaie de créer des genres d’aides audiovisuelles pour ce Grand Message qu’il a appelé des « églises » (un terme que Jésus a utilisé seulement deux fois et seulement dans un évangile (Matthieu 16.18 et 18.17). Paul a besoin de modèles visibles et vivants du nouveau genre de vie qui rend évident que les gens de Christ suivent un chemin différent de la conscience de masse. Ce sont des gens qui sont dépourvus de méchanceté (innocent) et authentiques… et qui brillent comme des étoiles dans un milieu trompeur et sournois » ( Philippiens 2.15). Aux gens qui demandaient : pourquoi devrions nous croire qu’il y a une nouvelle vie meilleure possible ? Paul pouvait dire : regardez à ces gens. Ils sont différents. Il y a un nouvel ordre social : « En Christ, il n’y a plus de distinction entre les juifs et les grecs, les esclaves et les hommes libres, les homme et les femmes, mais vous êtes tous un en Christ Jésus (Galates 3.28).
Une société alternative
Richard Rohr met ainsi en évidence une nouvelle vision. « Dans la pensée de Paul, nous sommes supposés vivre à l’intérieur d’une société alternative, presque une utopie, et, à partir d’une telle plénitude, d’aller vers le monde. Au lieu de cela, nous avons créé un modèle où les gens vivent presque entièrement dans le monde, entièrement investis dans les attitudes du monde vis-à-vis de l’argent, de la guerre, du pouvoir et du sexe, et quelquefois, « aller à l’église ». Cela ne semble pas marcher. Des groupes comme les amish, les communautés anabaptistes du Bruderhof, les Eglises noires, et des membres de quelques ordres religieux catholiques, ont probablement une meilleure chance d’entretenir réellement une conscience alternative. La plupart d’entre nous semble bien finir par penser et par agir comme notre culture environnante ».
Nouvelles pistes
Et c’est là que Richard Rohr, dans cette analyse et dans cette perspective, met en évidence de nouvelles pistes aujourd’hui en voie d’émergence.
« Beaucoup de gens aujourd’hui mettent leur confiance dans des think tanks, des groupes d’entraide, des groupes de prière, des groupes d’étude, des projets de construction de logements, des cercles de guérison ou des associations à but communautaire. Peut-être, sans toujours le reconnaître, nous nous dirigeons souvent dans la bonne direction. Quelques études récentes indiquent que les chrétiens ne sont pas tant quittant le christianisme que se réalignant dans des groupes qui vivent les valeurs chrétiennes dans le monde – au lieu de se rassembler à nouveau pour entendre des lectures, réciter une confession de foi et chanter des chants le dimanche. Jésus n’a pas besoin de nos chants. A la place, nous avons besoin d’agir comme une communauté. Aujourd’hui, un comportement chrétien pourrait grandir plus que nous le réalisons. Le comportement, c’est quelque chose de très différent de l’appartenance ».
« Rappelez-vous… Ce n’est pas la marque publicitaire qui compte ».
J H
par jean | Juil 4, 2022 | Vision et sens |
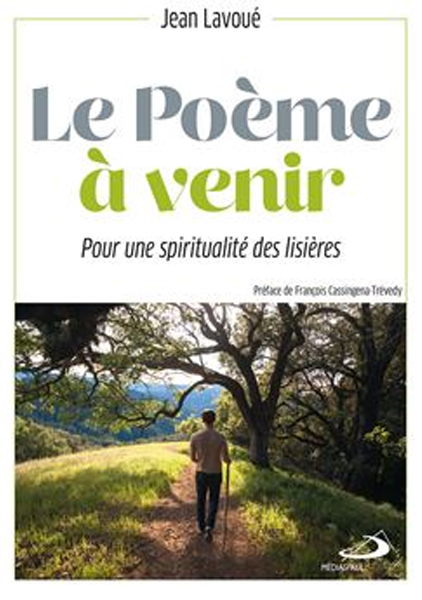 Jean Lavoué : une œuvre spirituelle
Jean Lavoué : une œuvre spirituelle
En réponse à notre quête spirituelle, un livre vient de paraitre : « Un poème à venir. Pour une spiritualité des lisières » (1). Si, au premier abord, le titre peut paraître insolite, il convient au départ d’entendre la voix qui s’y exprime, le parcours de l’auteur. Celui-ci, Jean Lavoué, est un écrivain, éditeur et poète breton. On peut en lire ici et là la biographie. Mais la meilleure entrée nous paraît une interview de Magali Michel parue dans La Vie : « De l’absence jaillit la présence » (2).
Très tôt porté à l’écriture, Jean Lavoué s’engage dans une expression poétique. C’est un atout pour faire face aux embuches de la vie et approfondir un chemin de libération spirituelle où il sera aidé par un prêtre atypique, Jean Sulivan. Son parcours professionnel s’exerce dans l’éducation surveillée et dans la sauvegarde de l’enfance.
Cependant, à partir des années 2000, Jean Lavoué, constamment en activité poétique, commence à écrire des livres portant sur des auteurs avec lesquels il se trouve en affinité. Cette œuvre littéraire va aller en croissant. En 2007, Jean Lavoué crée un blog, baptisé : « l’enfance des arbres » ( http://www.enfancedesarbres.com ).
En 2017, il ouvre une petite maison d’édition. C’est dire combien, à tous égards, l’écriture tient une place centrale dans la vie de Jean Lavoué. « L’écriture finalement se déploie dans le temps, pourvu qu’on persiste, même s’il n’y a pas beaucoup d’écho au départ ».
Dans cette interview, Jean Lavoué nous fait part aussi de sa vie spirituelle. « J’aime lire la Bible avec d’autres. L’Ecriture est d’une grande poésie. Dans la vie professionnelle, comme dans la vie intérieure, j’apprécie la fécondité des petits groupes de parole. Avec Anne, ma femme, nous participons à plusieurs d’entre eux. Mon enracinement ecclésial s’inscrit dans cette modalité peu visible, mais bien plus répandue que l’on ne le croit ».
Les deux livres les plus récents de Jean Lavoué témoignent de son parcours spirituel : « les clairières en attente » où il évoque notamment l’apport des petits groupes de partage : https://www.youtube.com/watch?v=9Jm5hkO3TAM
et « Le Poème à venir ? Pour une spiritualité des lisières » où « il explore la dimension christique du Poème en élargissant la conception et la montrant également à l’œuvre dans l’ensemble des autres spiritualités humaines » : https://www.youtube.com/watch?v=5K01-5KffYk
Sur le chemin de l’expression d’une vision
En introduction du livre : Le Poème à venir
Dans l’introduction de son livre : « Le Poème à venir », Jean Lavouè nous fait part de son cheminement et de la manière dont celui-ci débouche sur une nouvelle approche.
Ne ressentons nous pas plus ou moins des raideurs et des pertes dans l’annonce ecclésiale de l’Evangile ? « Les mots ont trop servi. Ils semblent usés » (p 10). « Il faut désempierrer la source pour tenter de la retrouver. J’ai choisi pour ma part le mot : Poème pout tenter de dire ce qu’avec d’autres, je cherche à tâtons… ».
Mais pourquoi ce mot nouveau ? Quelle en est la signification ? Jean Lavoué nous en explique l’origine. « Poiêsis » pour les grecs, signifie création… Pour Platon, l’art poétique est rattaché à l’ « enthousiasme ». Dans la Bible, le poète est le prophète. Pour les philosophes de l’Orient, la poésie rejoint la contemplation du sage ». Dans quelle acception, Jean Lavoué a-t-il adopté le mot ? « Il peut recouvrir ces différentes définitions, même si la source de mon questionnement concerne, de manière plus spécifique, ce qui touche à une réception encore inédite de l’annonce christique des évangiles, ce désir du Royaume, cet engendrement qui se sont entièrement saisi de la personne que l’on nomme Jésus. De ce Verbe, de cette Parole, de ce Logos qui, diront les écrivains de la Bonne Nouvelle, se sont emparés de lui » (p 12).
Mais l’auteur envisage un mouvement dans un horizon plus vaste : « Le Poème tel que je l’envisage, ne se réduit pas à lui. Il recouvre une réalité encore plus vaste. Certes, cet homme Jésus ne mit aucun obstacle à l’avènement en lui de cette réalité qui le dépassait. Toutefois, il ne cessa d’affirmer selon les évangiles synoptiques, qu’il n’était pas lui-même cette réalité. Mais, selon l’évangile de Jean, il va jusqu’à dire que le Père lui ne font qu’un… Pour tous ces témoins, il est indéniable qu’il se laissa entièrement envahir par le Souffle saint lui inspirant chacune de ses paroles et chacun de ses gestes » (p 12).
Jean Lavoué ouvre l’horizon : « C’est en fait le dynamisme créateur de cette Vie partout à l’œuvre dans l’univers que nous avons voulu traduire dans ce récit méditatif par le mot : Poème. La Vie, nul ne l’a jamais vue, mais elle se fait connaître par cette puissance créatrice qui ne cesse de tirer l’univers tout entier vers un accomplissement toujours plus complexe, toujours plus harmonieux. Et cela, malgré les pesanteurs et les ombres, voire les impasses qui semblent s’accumuler aujourd’hui sur le devenir de l’humanité (p 12).
L’auteur rappelle la conception grecque du Logos. Mais, à l’époque, ils avaient « une vision stable du cosmos, cohérente, hiérarchique et aux contours bien délimités ». Ce n’est plus cette vision qui est la notre aujourd’hui. « Les théories de l’origine de l’univers, de l’évolution, de la connaissance de la matière nous ont conduits à une nouvelle conception totalement interactive, systémique, de ce qui est, depuis les choses inanimées jusqu’aux êtres vivants. Tout et relié à tout. Tout est mouvement permanent, croissance, devenir. C’est cette immensité transformatrice et créatrice à l’œuvre partout dans le monde que nous appelons Poème. Son origine, nous la nommons Source ou Vie… » (p 13).
Jean Lavoué envisage la vie et l’œuvre de Jésus dans ce grand mouvement. « L’homme Jésus fut habité comme nul autre par le Poème. On pourrait dire aussi par le Souffle créateur qui agit en tout et en tous, mais qui s’empara de manière singulière de son être » (p 13). Dans l’immédiat, ce fut exprimé dans la culture de l’époque : « Les mots qui étaient à leur disposition étaient ceux de Logos pour ceux qui étaient de culture grecque, ou de Messie, c’est à dire de Christ, pour ceux qui s’inspiraient de la grande tradition hébraïque et biblique. Tout l’effort des théologiens des premiers siècles fut de tenter de définir en quoi et à quel point, cette dimension christique de Jésus, cette incarnation en lui du Logos, se confondait avec l’Etre créateur, avec Yahvé, avec Dieu » (p 13).
Le Poème, envisagé par Jean Lavoué correspond à la dimension « Christ » de Jésus telle que nous la reconnaissons dans la culture judéo-chrétienne. Mais, le dynamisme créateur de la Vie, dont ce mot est le signe, ne saurait se réduire à cette culture. Nous sommes à l’âge planétaire où nous prenons la mesure de la pluralité des formes d’expression spirituelle. Nous découvrons que notre destin est lié à celui de tous les êtres vivants et à l’ensemble de l’écosystème dont nous sommes les hôtes » (p 13).
Jean Lavoué plaide pour une réception plus universelle de ce dynamisme créateur. « Puisque chrétien et enraciné dans la tradition biblique, nous éclairerons cette compréhension pour nous du Poème… essentiellement à partir des éléments tirés de ce lieu exceptionnel de réalisation que constitue le témoignage évangélique. Mais nous essaierons aussi de faire en sorte que ce que nous exprimerons du poème, à partir de cet ancrage dont la vie de Jésus fut la terre d’accueil, puisse aussi éclairer bien d’autres espaces culturels et spirituels traduisant à leurs manières plurielles et différentes leur coopération avec le dynamisme du Souffle créateur » (p 14)
« Si l’homme Jésus devint souffle lui-même au yeux de ses disciples, n’est-ce pas le fait de cette confiance et de cette foi vitales qu’il éveillait en chaque être, en chaque chose, en chaque événement. C’est d’abord de cela qu’ils furent témoins. C’est pour les avoir eux-mêmes relevés, les avoir fait participer de manière très personnelle et intime, au dynamisme créateur du Poème de la Vie qu’ils le reconnurent. C’est ainsi qu’ils le définirent avec les termes qui se trouvaient à leur disposition comme ‘Christ’ : Oint en cette Source vitale par la grâce du Poème. C’est en cela qu’il accepta d’être, saisi qu’il fut par le Souffle saint, l’homme par excellence de la Parole : celui qui fait lever autour de lui les germes du Royaume… » (p 14-15).
« Pour relier tous ceux qu’il rencontrait, disciples ou inconnus, à cette même origine de la Vie, il aimait donner à cette dernière, le nom de Père, Abba : et avec ces deux premières lettres de l’alphabet hébraïque : alpha, bêta, il révélait déjà tout ce qui reliait le visible à l’invisible… Tous se trouvaient issus de la même source, plongés dans les mêmes eaux transformatrices du Poème… Dans d’autres traditions et dans d’autres cultures, cette vision de la Source originaire fut traduit par d’autres mots : Allah pour les uns, Atman pour les autres, Terre-Mère ou Gaia encore pour d’autres. Ces visions différentes ne sont pas exclusives les unes des autres » (p 16).
Jean Lavoué nous explique le but de son livre et la motivation qui l’a porté. « C’est cette puissance de nouveauté universelle que je cherche à honorer par ce livre – poème. Aujourd’hui encore, elle vient à toute femme, à tout homme, à l’humain en général, quelque soit le Dieu, la Source, la Vie, l’Energie auxquels il se réfère ou pas. C’est cela que nous voudrions avant tout suggérer » (p 16).
L’auteur nous dit alors comment il a réalisé son livre. « Il est le fruit d’intuitions, nourries par des lectures et vendangées dans les celliers du cœur. Des auteurs m’auront mis en chemin » (p 16). Jean Lavoué mentionne alors des théologiens et des auteurs spirituels dans une vaste gamme de Christoph Theobald, Raphaël Picon à Teilhard de Chardin et Richard Rohr. L’auteur précise également son usage du mot Poème. Ainsi, en faisant référence à l’homme Jésus, il nous dit « préférer au terme de Christ, qualifiant la manière spécifique dont il s’abandonna à la puissance agissante de son Père, celui de Poème, le faisant participer à une place singulière et unique, au dynamisme transformateur et créateur initié par le Souffle de la Vie dans la totalité de l’univers » (p 18).
Ce livre porte en sous-titre : « Pour une spiritualité des lisières ». Mais qu’entend-il par lisière ? La lisière c’est le lieu où « l’humain s’ouvre à l’infini qui le dépasse, un lieu mystérieux d’interaction et de transformation réciproque où l’un et l’autre communiquent et s’apprivoisent. De cet échange intime où se nouent la rencontre entre souffles divin et humain, toute spiritualité est l’expression singulière ; même si chacune d’elle attribue au mystère autour duquel elle gravite des noms différents voire si elle ne le nomme pas du tout comme c’est le cas pour une grande part de la quête contemporaine » (p 18). « C’est de la lisière dont l’Evangile est le signe dont il sera principalement question ici. Mais cela de manière non exclusive de telle sorte que la « spiritualité des lisières » pourrait aussi correspondre à une volonté de chercher à faire tomber tous les murs autant entre notre propre vérité et celle des autres qu’entre le divin et nous-mêmes » (p 18).
Paysages
Le Poème à venir nous appelle à une promenade où nous découvrons sans cesse des paysages nouveaux. Tandis que les chapitres se déroulent, tant de paragraphes nous appellent à une lecture méditative Voici donc quelques extraits de ce livre pour entrer dans cette lecture.
Un Père qui venait de l’avenir…
« Un homme, un poète, voici ce qu’il était. Il était venu, il y deux mille ans dans un bout de Palestine. Dans sa courte existence, il n’avait cherché qu’à incarner dans chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, le souffle du Poème. Il affirmait que celui-ci venait de son Père. Et quand il parlait ainsi, on sentait bien que ce n’était pas pour lui un père biologique, un père du passé. Non, plutôt un Père qui venait de l’avenir. Une force qui le tirait en avant, qui l’entrainait dans les voies les plus risquées, le plus improbables pour annoncer, disait-il, un Royaume qui viendrait. Et il était d’ailleurs déjà là : son être tout entier rayonnait de cet amour qui refluait sur lui telle l’annonce d’un printemps » (p 22).
Le Souffle saint qui ne cherche qu’une chose : Leur permettre à tous de choisir la Vie.
« Quand le « poète » mourut, tous crurent que c’en était fini de son histoire. Or, celle-ci ne faisait au contraire que commencer. Ou plutôt , elle ne pourrait désormais que se prolonger. Car s’il incarna plus que tout le poème, il avait la vive conscience de ne pas en être l’origine. A cette Source, il donna le nom de Père. Et, n’est-ce pas celle-ci, aujourd’hui encore, qui œuvre en toute femme et tout homme de bonne volonté cherchant l’harmonie entre les peuples de la terre : quelque soient leurs croyances, leurs dieux, leurs fois, leurs cultures, leurs raisons. Sans tous ces particularismes, le Poème ne serait pas. Mais il les transcende tous. Comme ceux-ci n’existeraient pas sans lui.
Pourtant chacun croit pouvoir lui donner un nom, une forme, une assignation bien à eux, opposés à ceux revendiqués par les autres hommes. Mais, ce faisant, ils oublient le Souffle saint qui ne cherche qu’une chose, à travers toutes leurs langues, leurs cultes, leurs dialectes : les arracher au chaos et à la destruction ; leur permettre à tous de choisir la Vie » (p 23).
Porter secours à la planète, c’est porter secours à l’humain, à Dieu lui-même…
« Porter secours à la planète en feu, c’est porter secours à l’humain, à Dieu lui-même. Voilà ce qu’il leur faut entreprendre. Notre maison commune est aussi celle du Poème en nous. Notre seule résidence sur la terre. Notre seule chance de nous laisser habiter par lui. De l’inviter chez nous. De le laisser y faire sa demeure. Rien qu’il n’ait désiré d’un plus grand désir : laisser sa parole créatrice se déployer en tout être, en toute chose. Tandis que l’homme au contraire s’est dressé face à elle. Ce qu’ils avaient imaginé de puissance menaçante et de défi chez cet hôte qui n’était pourtant que bienveillance à leur égard, ils se l’approprièrent pour eux-mêmes. Ainsi devinrent-ils une menace le uns pour les autres ainsi que pour la planète dont ils se croyaient être à jamais les maîtres ». (p 28).
Ce Poème en avant de nous
« C’est l’un de ses amis qui écrivit un jour le prologue de notre propre vie. Et depuis, nous n’avons cessé de voir ce Poème en avant de nous. Souvent, entendant une nouvelle fois ce récit, nous croyions le connaître par cœur. Alors qu’il surgissait toujours neuf de l’horizon. Ceux qui restaient tournés vers le passé finissaient par l’oublier. Leur vie cessait soudain de chanter au rythme de son pas. Tandis que tout un peuple, par ailleurs, grandissait, se mettait en marche, s’élançait par les brèches ouvertes de sa promesse » (p 35).
Fondés dans la confiance et l’espérance
« Et c’est alors qu’ils s’éprouveraient « jubilescents ». Fondés dans la confiance et l’espérance que toute mort est vaincue. Qu’ils participent, de l’avènement d’une Vie qui n’a jamais cessé de venir vers eux pour être-avec-eux ressource d’espérance, soutien dans leurs avancées obscures. Pour être au plus fragile de leur humanité et dans toute l’épaisseur de leur finitude et de leur précarité, le signe d’une tendresse qui ne leur ferait jamais défaut. Et cela par la grâce d’un avenir ouvert qui ne leur a jamais manqué » (p 38).
Voici donc un livre qui nous propose une vision plus vaste de la dynamique évangélique, une vision plus fraiche à travers de nouveaux mots et de nouvelles images. Cette proposition peut éveiller quelques questionnements théologiques. Cependant, ce chant nouveau nous éveille et nous porte. C’est le murmure de l’eau vive. Le mouvement de Dieu en Jésus s’exprime dans un Souffle créateur. C’est « une puissance de vie universelle » que Jean Lavoué « cherche à honorer à travers son livre Poème » (p 16).
J H
- Jean Lavoué. Le Poème à venir. Pour une spiritualité des lisières. Préface de François Cassingena- Tréverdy. Mediaspaul, 2022 . Une superbe présentation du livre : « Pentecôte : le souffle des lisières » : https://www.golias-editions.fr/2022/06/02/pentecote-le-souffle-des-lisieres/
- Jean Lavoué. De l’absence jaillit la présence. Interview de Magali Michel dans La Vie : https://www.lavie.fr/christianisme/temoignage/jean-lavoue-de-labsence-jaillit-la-presence-3127.php
par jean | Juil 4, 2022 | Société et culture en mouvement |
 Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.
Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.
C’est le mouvement que décrit Amos Yong (2) dans une séquence sur le Saint Esprit réalisée par Richard Rohr sur le site du Center for action and contemplation. Théologien pentecôtiste américain, d’origine malaisienne, Amos Yong est l’auteur d’une œuvre originale et abondante qui se décline dans de nombreux livres (3). Amos Yong propose ainsi une théologie pionnière où les ressources du pentecôtisme s’inscrivent dans une pensée chrétienne ouverte à une dimension œcuménique et interreligieuse, comme à la culture d’aujourd’hui, notamment scientifique. Amos Yong est professeur à la Faculté Évangélique californienne Fuller où il dirige l’École des études interculturelles, un centre de recherche missiologique. Son œuvre mérite d’être mieux connue au delà de l’univers anglophone.
La dynamique de la Pentecôte
« La vie palestinienne du premier siècle, de beaucoup de manières, semblable à notre village global d’aujourd’hui, était marquée par des suspicions vis à vis de ceux qui parlaient d’autres langues où qui incarnaient d’étranges genres de vie. Ce fut l’œuvre de l’Esprit de rassembler ceux qui étaient étrangers les uns aux autres et de réconcilier ceux qui auraient pu autrement demeurer à l’écart de ceux qui leur étaient dissemblables ».
La Pentecôte ouvre un horizon nouveau. « Elle inaugure un Israël restauré et le royaume de Dieu en établissant de nouvelles structures et de nouvelles relations sociales. A noter que le don de l’Esprit n’est pas réservé aux 120 hommes et femmes qui sont rassemblés dans la chambre haute (Actes 1. 14-15) : Les langues de feu qui se sont divisées, se sont posées sur chacun et ont permis à chacun, soit de parler, soit d’entendre dans des langues étrangères (Actes 2.3-4).
Pour expliquer ce phénomène, Pierre cite le prophète Joël :
« Vos fils et vos filles prophétiseront
Vos jeunes hommes auront des visions
Vos anciens auront des songes
Et sur mes esclaves, hommes et femmes
Je déverserais mon Esprit
En ces jours, ils prophétiseront » (Actes 2. 17-18)
Un changement de société
Amos Yong élargit la réception habituelle. « Les dons de l’Esprit ne sont pas destinés seulement aux individus. Ils ont des effets sociaux en mettant en cause les pouvoirs en place, « the powers that be ».
Pierre comprenait bien que, tandis que l’ancienne ère juive avait un caractère patriarcal, la restauration d’Israël manifesterait l’égalité de l’homme et de la femme. Les deux prophétiseraient dans la puissance de l’Esprit. Tandis que l’ancienne alliance manifestait la direction des anciens, le royaume restauré impliquera la responsabilisation (empowerment) d’hommes et de femmes de tous les âges. En tout ceci, l’œuvre de l’Esprit était annoncée en des langues étranges, et pas dans les langues conventionnelles du statu quo.
En effet, la restauration du royaume de Dieu par la puissance de l’Esprit renversait effectivement le statut quo. Comme il avait été prédit à Marie et Zacharie, ceux qui étaient au bas de l’échelle sociale, les femmes, les jeunes et les esclaves, étaient les récepteurs de l’Esprit et les véhicules d’un revêtement de puissance (empowerment) de l’Esprit (Luc 1.46-55, 1.67-79). Les gens, autrefois divisés par la langue, l’ethnie, la culture, la nationalité, le genre et la classe seraient réconciliés par cette nouvelle version du royaume.
Potentiellement, « toute chair » serait incluse .
Une interpellation
Dans cette vision inspirante, Amos Yong interpelle.
Est-ce que ces caractéristiques continuent à marquer l’église comme une fraternité inspirée par l’Esprit ? Est-ce que l’église parle encore les langues de l’Esprit ? Ou bien restons-nous prisonniers d’une division portée par les langages, les structures et les conventions des empires de ce monde ? (4). Notre prière devrait être : « Viens Saint Esprit » de telle manière à ce que la proclamation de l’épanchement de l’Esprit sur toute chair puisse vraiment encore trouver son accomplissement à notre époque.
Amos Yong
Rapporté en français par J H
- « Paul : Sa vie et son oeuvre selon NT Wright » : https://vivreetesperer.com/paul-sa-vie-et-son-oeuvre-selon-nt-wright/
- A reconciling power : https://cac.org/daily-meditations/a-reconciling-power-2022-06-09/
- Amos Yong . Fuller Seminary : https://www.fuller.edu/faculty/amos-yong/
- L’Esprit Saint à l’œuvre dans les sociétés et pas seulement à l’échelle individuelle : « Pour une vision holistique de l’Esprit. Avec Jürgen Moltmann et Kisteen Kim » : https://vivreetesperer.com/pour-une-vision-holistique-de-lesprit/
par jean | Juin 1, 2022 | Hstoires et projets de vie |
 D’aide soignante à infirmière
D’aide soignante à infirmière
Une vie au service du care et de la santé
Mon père était médecin vétérinaire. Et, toute petite, je savais qu’il soignait les animaux. Moi, je me suis dit : Je ferai plutôt le métier d’infirmière. Et alors, je pourrai avoir des moments d’échange avec mon père sur le fait de soigner et sur l’évolution de la médecine. J’avais huit ans.
Plus tard, à 16 ans, pendant les trois mois de vacances, à la suggestion de ma tante, j’ai fait des stages bénévoles dans un dispensaire. Le matin, avant la tournée des religieuses soignantes, j’attirais l’attention des malades sur les précautions à prendre au niveau de l’hygiène. Déjà à cette époque, je participais à la prévention, par exemple en incitant les gens à avoir des moustiquaires pour faire face au paludisme.
Dans l’enseignement secondaire, j’ai fait des études en économie sociale et familiale (ESF). Dans ce cadre, je faisais également des stages. Je n’ai pas obtenu mon baccalauréat et je suis rentré directement dans la vie active. J’ai travaillé comme caissière dans une boulangerie. J’ai ensuite travaillé pendant dix huit mois dans le secteur santé de la garnison militaire de Yaoundé. Mes activités étaient très diverses : pansements ; participation à des consultations et même des accouchements ; un mois en réanimation…
Par la suite, je voulais entrer dans l’armée pour exercer dans le service de santé. Mes parents s’y sont opposés.
J’ai donc travaillé pendant cinq ans dans les cabines téléphoniques avec option conciergerie.
En 2002, je me suis mariée et j’ai rejoint mon mari en France en 2003. J’ai fait des petits boulots : garde d’enfant, femme de chambre.
D’aide soignante à infirmière
En arrivant en France en 2003, j’ai donc travaillé comme femme de chambre pendant cinq ans pour financer une formation d’aide soignante que j’ai suivi pendant dix mois. J’ai approfondi le coté relationnel qui était déjà ancré en moi, mais dont j’ai mieux compris l’application. Cela m’a conforté dans la vocation de soignante que j’avais depuis l’enfance. J’ai commencé à travailler dans les hôpitaux, en chirurgie viscérale en l’occurrence. Cela m’a permis d’asseoir mes connaissances pendant douze ans. Ensuite, j’ai voulu évoluer dans ma carrière professionnelle.
C’est alors que j’ai suivi une formation d’infirmière pendant trois ans. J’ai obtenu mon diplôme d’état d’infirmière en mars 2021.
Au départ, j’ai eu des difficultés, car je n’avais pas suivi d’études depuis longtemps. La formation d’infirmière est très variée et donc j’ai appris beaucoup de choses. Combiner la formation pratique et la formation théorique m’a beaucoup apporté. J’ai eu des difficultés dans le domaine de l’enseignement de la psychiatrie, parce que, au départ, j’associais ces troubles à la folie. J’avais du mal à prendre en charge ces personnes, mais au bout de la troisième semaine, j’ai réussi à surmonter cette difficulté avec l’aide du psychiatre.
Depuis le mois d’avril 2021, j’ai commencé à travailler dans un ephad et dans un hôpital.
Une vie au service du care et de la santé.
J’aime ma profession et je l’exerce de tout mon cœur. Quand je me lève le matin, j’ai le sentiment que je vais me rendre utile. Je demande à Dieu de m’utiliser comme un instrument entre ses mains, au service de ses créatures.
Pour moi, être infirmière, c’est être dans une écoute active, avoir de l’empathie, tout en étant authentique. Et, en retour, je reçois de la sympathie et de la bienveillance.
Dans les longues journées que je passe avec les patients, je trouve cette relation bénéfique. De par ma culture africaine, le respect, la proximité, l’intimité sont des éléments fondamentaux. Quand dans un ephad, un ainé me parle, je prends l’attitude de me taire et d’écouter. Cela me permet de donner une réponse. Je suis donc dans une attitude d’écoute active dans laquelle je mobilise mes connaissances et puis ainsi apporter une réponse adaptée. Je continue à apprendre constamment.
Les journées sont souvent longues et épuisantes, mais, en fin de parcours je me réjouis d’avoir été au service de personnes vulnérables et de leur avoir apporter, outre les soins, réconfort et soutien.
Cela donne un sens à ma vocation de soignante, ce que j’ai toujours voulu faire. C’est un accomplissement de ma vie selon tout ce que je crois : un ordre divin qui, par mon entremise, prend soin de ses créatures.
S T Y A

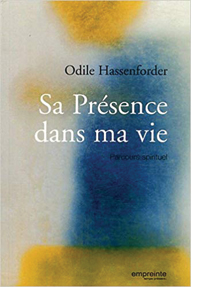

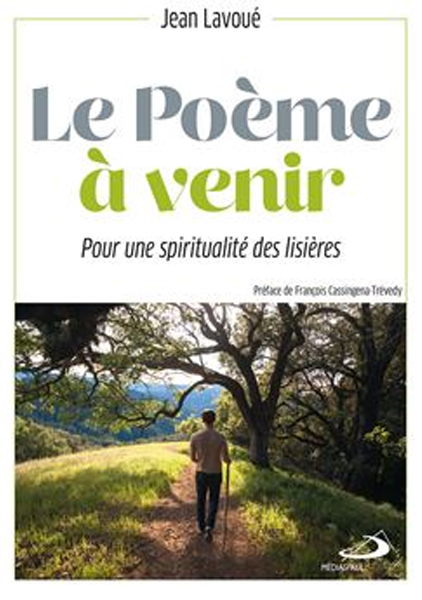
 Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.
Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.