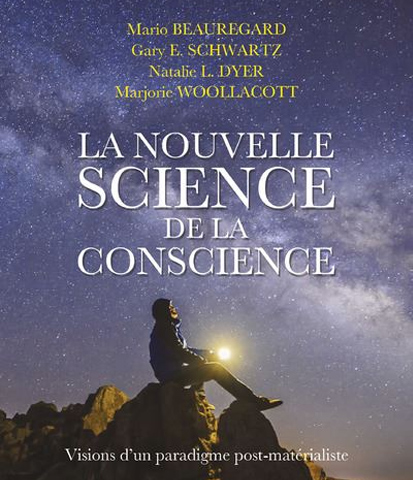par jean | Mar 5, 2024 | ARTICLES, Vision et sens |
La vision spirituelle du médecin psychiatre, Jacques Besson dans la découverte de nouveaux horizons : les neurosciences, les synchronicités, la lutte contre les addictions, l’usage des psychédéliques, le chamanisme…
Auteur d’un livre sur : Addiction et spiritualité (1), Jacques Besson, médecin psychiatre, addictologue, ancien chef du département de psychiatrie communautaire du département de psychiatrie du centre hospitalier universitaire vaudois, professeur honoraire de l’Université de Lausanne, a été fréquemment interviewé dans des vidéos sur You tube (2). Il y met en évidence des relations sensibles entre spiritualité, présence d’une conscience, lutte contre les addictions, usage des psychédéliques, expérience de mort imminente, expérience du chamanisme. En même temps, Jacques Besson se présente comme un croyant enraciné dans une foi chrétienne d’inspiration protestante. En écoutant Jacques Besson, nous découvrons des réalités qui se manifestent aujourd’hui et sur la signification desquelles nous nous interrogeons. A partir de son expérience et des connaissances, il nous apporte un éclairage précieux. Voici donc quelques aperçus à partir d’une interview de jacques Besson par Didier Reinach : « Spiritualité et créativité de soi – l’esprit du bonheur » (3).
Cheminement professionnel et spirituel de Jacques Besson
Au départ, l’intervieweur rappelle les intérêts de Jacques Besson : « la psychiatrie communautaire, la santé mentale, les rapports entre la psychiatrie, la religion, la spiritualité et les neurosciences ». Il pose donc une première question : « Pourquoi la spiritualité est-elle un chemin de guérison ? » Et il l’interroge sur ses motivations : « Qu’est-ce qui te pousse, qu’est-ce qui te porte à introduire la dimension spirituelle ? ». La réponse porte d’abord sur les racines : « Je viens d’une longue tradition protestante. Comme enfant, j’ai eu des visions, des intuitions, des aspirations sur l’invisible, sur la lumière du monde. Cela m’a toujours intrigué et passionné. Depuis l’âge de cinq ans environ, je m’intéresse à l’individu, à la question de l’esprit ». Jacques Besson s’est donc dirigé vers la médecine ; puis, il s’est intéressé à la neurologie. Il est passé ensuite à la psychiatrie, puis à la psychanalyse. Et de la psychanalyse, il s’est dévoué pour des populations vulnérables, pour la médecine des pauvres au Centre Saint-Martin qui a accueilli des milliers toxicomanes. C’était une médecine communautaire, généreuse. De là, Jacques Besson est devenu un expert en addictologie, une science interdisciplinaire qui rassemble un ensemble de savoirs pour faire face à la complexité du problème de l’addiction. Il s’est engagé dans des psychothérapies et c’est là qu’il s’est rendu compte petit à petit que « la question du sens était centrale ». Jacques Besson a également été médecin dans l’Armée du Salut. Il a vu là un témoignage magnifique et il y a beaucoup appris. C’est là qu’il a rencontré « les alcooliques anonymes », un mouvement spirituel et non religieux qui a commencé dans les années 1930, où les participants se remettent à une puissance supérieure, à plus grand qu’eux-mêmes, pour leur rétablissement. Les « alcooliques anonymes » ont actuellement plusieurs dizaines de millions d’adeptes en traitement qui vont bien. Jacques Besson, bien au fait de la biologie moléculaire, a considéré les bienfaits engendrés par l’approche des alcooliques anonymes : les différentes étapes, le lâcher-prise et la conscience dans l’univers. Il s’est alors demandé : est-ce qu’il y aurait une neuroscience des alcooliques anonymes ? La réponse est oui. Il y a eu beaucoup de recherches en imagerie sur l’impact de la prière, de la méditation. Dans les années 1990, au cours d’une année sabbatique à Harvard, il a pu suivre les débuts de l’imagerie fonctionnelle cérébrale et il a découvert la puissance de l’instrument. « Entre addiction et spiritualité, il y a un rapport très étroit. D’un côté, l’addiction est une impasse de sens. De l’autre côté, la spiritualité est une ouverture à plus grand que soi. Donc la spiritualité est un instrument puissant pour la prévention et le rétablissement des addictions ». Après avoir fait une thèse sur la correspondance échangée entre Freud et le pasteur Pfister où les fondements du dialogue entre psychanalyse et religion étaient posés, Jacques Besson s’est engagé dans une étude de la pensée de Carl Jung et, pendant une dizaine d’années, il s’est formé à la psychanalyse jungienne en autodidacte, puisque celle-ci n’est pas agréée dans l’enseignement officiel. Il y a trouvé les ingrédients dont il avait besoin pour établir un lien entre science et spiritualité. « Il peut y avoir une science de l’esprit qui est plus grande que celle du cerveau ou de la psychologie, et la question de l’inconscient collectif, la question du Dieu inconscient, la question de ce qui nous transcende et de ce qui nous traverse sont des questions qui ont habité les humains depuis toujours et Jung a été un investigateur de génie sur ces questions ». Par la suite, Jacques Besson s’est tourné vers l’œuvre du sociologue médical, rescapé d’Auschwitz, Aaron Antoniovsy. Il a observé la vie dans les camps et « il en a tiré la conclusion que les humains avaient besoin de sens et de cohérence, de cohérence permettant d’aligner le somatique, le psychique et le spirituel, et d’être droit dans ses bottes, d’avoir un sens dans la vie. Voilà ce qui est générateur de ce qu’il a appelé lui-même la salutogenèse. La salutogenèse, à travers ses origines latines entend le salut à la fois comme santé et comme salut. La salutogenèse est le concept génial qui créé la promotion de la santé. Les médecins obsédés par les causes des maladies s’intéressent beaucoup moins aux attracteurs de santé et je me suis passionné pour le ‘solutionnisme’, c’est à dire conjuguer toutes les approches disponibles dans un champ comme les addictions où la médecine était très pauvre et pouvoir venir ainsi à l’aide de populations vulnérables ».
Mais, si l’on peut distinguer des groupes vulnérables, « nous sommes tous aujourd’hui vulnérables d’une certaine manière… Nous avons tous des carences, nous avons tous des maltraitances… la condition humaine fait que la vie est imparfaite et que nous sommes sur un chemin entre l’inaccompli et l’accompli. C’est une voie mystique qui ne me fait pas peur parce qu’elle est compatible avec la vision scientifique d’un monde évolutionnaire ».
Aujourd’hui, « l’humanité est traumatisée et elle n’accède pas, pas encore, aux instruments de guérison, cet alignement entre le physique, le psychique et le spirituel, entre la science de la nature, la science humaine et, peut-être la science de l’esprit. Donc, j’ai toujours cherché cette cohérence, cet alignement… Je n’ai jamais quitté cette ligne et je suis ‘le capitaine de mon âme’ » (cette expression en écho à celle du poème récité en priant, par Nelson Mandela dans sa prison).
L’être humain et la spiritualité
L’entretien se poursuit au sujet de la nature humaine. Nous ressentons aujourd’hui les effets nocifs du matérialisme. « Ce matérialisme, dans lequel nous sommes désespérément plongés, nous coupe de ce que les peuples premiers savaient très bien… C’est que le monde est un. Nous sommes dans une totalité ». En demandant à ses étudiants en médecine : où est l’esprit, Jacques Besson les amenait à penser qu’il n’était pas seulement dans le cerveau, dans le corps, mais que, pour vivre, l’être humain avait besoin d’un langage, de relations, d’une culture ; « il faut une humanité, il faut une planète, il faut un univers. Pour un seul être humain, il faut la totalité de l’univers et le grand mystère, c’est que chaque être humain représente une singularité ». Mais cette singularité se vit en complémentarité, dans un ensemble. « Plus on va vers soi-même, disent les sages du premier millénaire chrétien, plus on s’approche de Dieu, mais il s’agit de soi-même, au sens de Jung, c’est à dire d’une individuation. Il s’agit de bien comprendre le rapport entre le soi et la totalité ».
C’est un apport de la psychanalyse jungienne qui, elle-même, peut être envisagée comme une étape pour aller plus haut. A partir d’un épisode vécu et rapporté par Jung, du ‘rêve d’un scarabée par un patient et l’apparition de cet insecte à la fenêtre’, la conversation s’engage sur le phénomène des synchronicités. Jacques Besson a vécu de nombreuses synchronicités dans sa carrière et « il est convaincu que ce phénomène introduit une fenêtre sur un rapport différent au temps, au temps qui nous dépasse, au temps vertical, le grand temps, celui qui s’est déployé avec le big bang… ». L’accueil des synchronicité requiert « une grande ouverture au monde, à l’univers, à la conscience, qui est bien plus grande que ce qu’on peut imaginer, et pour les scientifiques, beaucoup d’humilité », vertu trop peu répandue… « Il faut être bien conscient des limites de la science pour accéder à un monde plus grand… La foi et la science ne s’oppose pas. On peut être scientifique et mystique. La science s’occupe des ‘comments’. Elle propose des modèles. La métaphysique propose des intuitions, des visions ».
La conversation se poursuit sur les ressources du cerveau humain. « Le cerveau a de nombreuses fonctions… Le cerveau est un univers à lui tout seul. C’est un microcosme. L’univers du cerveau est un univers infiniment complexe ». Ainsi, s’il y a un infiniment petit et un infiniment grand, « comme l’a intuitivement prédit, le génial Blaise Pascal, l’homme est le milieu de toutes choses et l’être humain est entre les deux infinis, le petit et le grand, et je suis arrivé à la conclusion qu’il détient le troisième infini qui est l’infiniment complexe… La science se préoccupe d’objectiver. La ligne de la science, c’est bien l’objectivité, mais nous autres, êtres humains, nous vivons aussi d’une subjectivité et la science du sujet est extrêmement importante. C’est la science de la conscience précisément… La totalité implique d’avoir recours à la science et à la conscience, à la science et à la spiritualité ».
Spiritualité, soin, médecine
Une question de l’interviewer : Est-ce que la spiritualité peut soigner des égos blessés, des égos malades ? Jacques Besson répond en évoquant « une nouvelle science qui a fait d’énormes progrès depuis une quinzaine d’années : la psycho-traumatologie. La psycho-traumatologie est l’étude interdisciplinaire des traumatismes psychiques. Nous avons tous un certain capital de santé mentale et nous pouvons supporter ainsi un certain nombre de souffrances. Mais s’il y a effraction, un abus trop fort, une agression trop violente, la blessure psychique qui en résulte est un traumatisme. La question du traumatisme est très importante parce qu’elle participe au diagnostic d’une vulnérabilité particulière chez certaines personnes qui peut être investiguée et surtout peut être traitée.
Puis, une grande question se pose : pourquoi moi ? Pourquoi à moi, m’est-il arrivé tel accident, tel malheur ? Et le ‘pourquoi moi’, est un grand mystère. C’est une blessure parce que c’est incompréhensible. Le monde est imparfait. L’arrivée d’un accident nous dépasse et la spiritualité nous aide à redonner du sens, à recouvrir notre âme… C’est la technique chamanique. C’est l’extraction d’esprit et le recouvrement d’âme. Les chamans sont spécialistes du trauma à leur manière. L’extraction d’esprit, c’est se détourner de ce qui nous a blessé, peut-être l’extraire ou tout au moins s’en détacher. Le recouvrement d’âme, c’est aller vers plus grand que soi. Et voilà un mouvement salutogénique. Et voilà, les peuples premiers ont cette intuition qu’il y un rétablissement possible. La santé mentale est le fruit d’une plasticité. Et cela, c’est tout l’espoir que peut avoir un psychiatre, un psychiatre psychothérapeute en l’occurrence. Le cerveau est plastique. C’est à dire que les connexions s’adaptent à l’environnement, à la culture. Les neurones dialoguent entre eux et se connectent. Et cela laisse de la trace.
Donc, du coup, l’expérience spirituelle, cela laisse de la trace. Pour en donner un exemple, la méditation en pleine conscience, qui s’est occidentalisé récemment, se révèle modifier la connectivité cérébrale, ainsi que montre les nouvelles techniques d’imagerie. On devient plus autonome affectivement et cognitivement, plus souple. Ce sont des encouragements très forts pour relier la médecine psychiatrique, la médecine somatique et la psychothérapie. Depuis plusieurs années, j’ai eu la chance d’introduire la santé spirituelle à la faculté de médecine, notamment à la suite de la rencontre publique avec le Dalaï Lama en 2013.
Je lui ai posé la question des trois ordres de la médecine et il m’a répondu avec beaucoup de chaleur que c’était une question qu’il fallait absolument explorer en Occident, car, pour la médecine tibétaine, il est évident que le premier rang de la santé est la santé spirituelle. En découle la santé psychique dont découle la santé physique. Or, en Occident, nous faisons très exactement le contraire. Nous avons jeté les bases d’une santé somatique, nous avons élaboré correctement une psychiatrie qui tient la route, mais nous somme encore très loin de la singularité du sujet, de la question du lien, de la question du sens qui sont les vraies questions qui mobilisent la salutogenèse et le rétablissement ».
Une création de sens ? suggère l’interviewer. C’est inné ou cela se travaille ? demande-t-il. « Les deux à la fois » répond Jacques Besson. « Je crois qu’il y a du divin dans l’homme, pour citer les Pères de l’Église ». En reprenant une expression latine, « l’homme est capable de Dieu. C’est-à-dire, il a une intuition du beau, du bien, du vrai, du juste, et il peut suivre ce chemin. C’est un possible. Alors cela nécessite évidemment un travail. Le Bouddha a dit : « Le bonheur est sur le chemin ». Alors, cheminons.
Psychédéliques, chamanisme, médecine ouverte
Jacques Besson envisage son approche de la guérison sous différents angles. Ainsi, dans un cadre psychiatrique, il participe à « la réhabilitation des psychédéliques (champignons hallucinogènes, Lsd, certaines formes d’ecstasy) », à des fins thérapeutiques. Historiquement, ces substances ont été stigmatisées après le premier développement de leur usage aux Etats-Unis, mais on observe aujourd’hui un retour parce qu’on a compris que ce n’est pas le même groupe de drogues que les opiacés, la cocaïne ; un groupe différent qui a la capacité de perturber l’ordre psychique, mais à petites dose, bien contrôlées et dans un cadre thérapeutique, cela peut permettre de modifier un ordre établi dans le sens d’ouvrir certaines mémoires qui étaient dans des tiroirs. Lorsqu’un traumatisme désorganisateur infecte une existence, il vaut mieux le sortir, l’aérer. Et cela, c’est l’extraction d’esprit et le recouvrement d’âme opérés par les chamans, c’est ce que la psychanalyse essaie de faire laborieusement avec de longs processus, c’est ce que l’hypnose essaie de faire par des conditionnements, mais les psychédéliques sont aujourd’hui le moyen le plus prometteur pour accéder aux souvenirs traumatiques dans un contexte sécurisé et élargir la conscience… On pense que les psychédéliques ont le pouvoir d’accroitre la plasticité neuronale, et notamment les champignons, ce que les peuples premiers savaient très bien. Aujourd’hui les médicaments les plus prometteurs en psychiatrie sont ceux qui ont été les plus ostracisés et maudits quand j’étais jeune. Le cannabis ouvre des perspectives intéressantes en médecine curative et les psychédéliques ouvrent des pistes intéressantes pour la santé mentale ».
Jacques Besson critique les préjugés engendrés par un matérialisme réductionniste vis-à-vis des pratiques des peuples premiers. « J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui se sont intéressées scientifiquement au chamanisme. Ainsi le docteur Olivier Chambon en France qui a écrit un texte de référence : « Psychothérapie et chamanisme ». Il évoque la psychologie transpersonnelle, notamment Stéphane Gros. Ce sont des psychologues qui acceptent qu’on puisse communiquer d’inconscient à inconscient et communiquer avec plus grand que soi. Le chamanisme, c’est aussi une communication avec un monde plus grand. Le chamane et à la fois prêtre et médecin. Aujourd’hui, nous avons rejeté le prêtre et garder le médecin.
Il est grand temps de réconcilier le prêtre et le médecin, le spirituel et le scientifique ». il y a un fossé à combler. Cependant, en médecine scientifique, on enseigne la psychologie médicale, les fondements de la relation médecin-malade, l’alliance thérapeutique et il y a maintenant une science établie de l’effet placebo. Le médecin revient au prêtre par des voies détournées. Et il utilise très largement, souvent inconsciemment, le chemin de la suggestion (suggestion que Freud n’aimait pas trop). Pour ma part, je pense que le médecin de famille est un homme de confiance. Il a le manteau du druide. Il fait de la suggestion. Et c’est une bonne chose ! Les médicaments parfois peuvent avoir un effet placebo sans le savoir ». Jacques Besson évoque une recherche sur les antidépresseurs qui montre qu’il n’y a que 5% de variance entre le placebo et le médicament. « Cela rend modeste quand on pense qu’on a dépensé des milliards pour des antidépresseurs.
« Je crois qu’il faut être juste et humble. Il y a un ordre somatique de la médecine. Il y a des gènes. Il y a des molécules. Il y a un déterminisme biologique. Il y a une génétique. Mais il y a aussi une épigénétique. Les gènes dialoguent avec l’environnement. Le sujet a une histoire dans sa nature, dans son contexte. Et c’est toute la force de l’ordre psychique. Nous avons une éducation, un environnement, une culture, des valeurs et cela produit de la plasticité ». Il y a des intuitions. L’intuition est une dimension de l’appareil psychique qui n’est pas étudiée en psychothérapie. Elle est souvent destinée aux « bonnes femmes » alors que la femme a beaucoup plus d’intuition que l’homme.
C’est probablement avec les femmes que l’on a eu les plus grandes découvertes de la sacralité. Certes, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, mais ces différences ne sont pas absolues. « Il y a l’ordre psychique, les apprentissages, les valeurs qui ont été transmises. Mais je pense que la réponse la plus appropriée est dans la psyché, les archétypes, l’animus et l’anima… La santé psychique, c’est le dialogue, le mariage entre l’animus et l’anima. C’est la rencontre des opposés. Pour atteindre la totalité, l’individuation, il faut avoir marié l’anima et l’animus… ». Cette analyse se poursuit au niveau de l’univers. « La rencontre du ciel et de la terre se fait pour que l’homme puisse accéder à plus grand que lui. Henri Bergson disait : « la terre est un incubateur de Dieu ». Tout se passe comme si la matière voulait être spiritualisée… ». C’est une vision de réconciliation.
Puis, Jacques Besson évoque l’amour des autres comme l’amour de soi. » Pour les bouddhistes, pas de sagesse sans compassion. Pour les chrétiens, pas de vérité sans charité. La conscience ne suffit pas… il faut passer par le don de soi ; par la créativité, par le nouveau. Si nous sommes dans un univers évolutionnaire, alors nous faisons partie de l’évolution. Nous avons une responsabilité. Nous sommes des co-créateurs ».
« La méditation, la prière, la sagesse des peuples premiers et la religion peuvent nous apporter quelque chose. La spiritualité n’a pas besoin d’être religieuse ; mais je pense qu’il y a des religions qui peuvent être spirituelles. Personnellement, j’ai beaucoup d’admiration pour le soufisme… Soyons humble. Gandhi a dit : « celui qui va au fond de sa religion, va au fond de toutes les religions ». Le noyau dur des religions, c’est la spiritualité, c’est la sacralité, c’est le rapport entre la vérité et la charité. C’est cela le noyau dur ».
Quelles lectures éclairantes ? Une inspiration biblique
L’intervieweur demande à Jacques Besson de nous conseiller. Et, entre autres, quelles lectures comptent pour lui ? La réponse va à l’encontre de la mode. C’est « lire la Bible ». « Parce que c’est, quand même, un livre incroyable. Ce sont des centaines d’auteurs qui écrivent ensemble dans des moments différents, dans des contextes différents, pour exprimer une forme de vérité profonde dont ils ont eu l’inspiration, la révélation pour le bien de la communauté. Il y a, bien sûr, des chapitres plus difficiles, mais lire la Bible avec la psychologie des profondeurs, avec de l’éveil, avec un regard chamanique, c’est très riche de sens, de lien, d’expérience d’autres humains, d’autres situations. Quand Moïse va chercher les tables de la loi et qu’il trouve les « couillons » avec le veau d’or, c’est une modernité effrayante. Et le Christ sur sa croix qui est plus fort que la mort – après, on peut l’interpréter de plusieurs manières – c’est actuel, je pense. Si on ne s’occupe pas trop de la mort, on devient tellement plus vivant. Il faut vivre l’instant ». Et donc, si la Bible n’est plus toujours appréciée, Jacques Besson s’écrie : « moi, je la lis ». Certains passages le touchent davantage ; « Ma petite préférence va à l’Évangile de Jean. Dans l’Ancien Testament, j’aime beaucoup le Livre de Job, le malheur de l’innocent… Il y a les psaumes qui sont merveilleux aussi et bien sûr les Évangiles. Septante trois guérisons du Christ. Le Christ est un exorciste. C’est un immense chaman. Le Saint-Esprit, vu par la spiritualité et les neurosciences, c’est le Grand Esprit, c’est l’âme du monde ». Paracelse est cité en évoquant ‘la lumière, l’âme du monde’. « Lisez Paracelse, lisez Jung, lisez la Bible, regardez la biographie de Gandhi ».
Interrogé sur l’esprit qui l’anime, Jacque Besson revient à son enfance : « Quand j’avais quatre ans, mon grand-père est mort dans des conditions assez tristes et ma mère a fait une assez grave dépression ; je me suis mis à avoir peur du noir. C’était assez angoissant. Un jour que ma nourrice s’occupait de moi, elle a remarqué que j’avais peur du noir et elle s’est adressée à moi avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d’humanité, elle m’a dit : Jacques, il ne faut pas avoir peur du noir. Non, il ne faut pas avoir peur du noir parce que, dans le monde, il y a une lumière invisible. Oui, c’est une lumière qui éclaire et qui réchauffe le cœur des enfants. C’est un enfant aussi qui la donne. Il s’appelle Jésus. Cela m’a intéressé : il y aurait une lumière invisible et un autre enfant qui la donne. Et il est d’un autre ordre… Donc, à partir de quatre-cinq ans, je me suis intéressé à cette figure. On m’a envoyé à l’école du dimanche. Je me suis passionné pour les personnages de la Bible : Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et les pharaons, Moïse, David, Goliath et puis, après, le Christ. J’ai toujours eu cette intuition qu’il y a du visible dans l’invisible. Et plus tard, j’ai découvert, avec les Pères du premier millénaire chrétien ce qu’ils appellent l’intelligible, non pas au sens de l’intelligence, mais au sens que dans l’invisible, il y a des choses qu’on peut comprendre, auxquelles on peut accéder, c’est une grâce divine. Alors, toute ma vie a été éclairée, d’un côté par mon intérêt sincère et rigoureux pour la science et mon intérêt sincère et rigoureux pour la spiritualité. Et, un jour j’ai découvert, je crois que c’est Jean Calvin qui l’a dit, « la science permet l’émerveillement ». J’avais une passerelle….
Cette contribution de Jacques Besson nous parait particulièrement éclairante et innovante. Elle reconnait et prend en compte des réalités émergentes comme par exemple les résultats de l’imagerie cérébrale, les synchronicités et le chamanisme. Des courants de pensée et de recherche, encore minoritaires sont pris en compte. Un nouveau paysage apparait.
Cette contribution nous parait doublement précieuse. A l’encontre d’un matérialisme encore puissant, elle instaure une nouvelle compréhension de la nature humaine et de l’ordre du monde d’autant qu’en plus des phénomènes mentionnés dans cet interview, on peut en ajouter d’autres comme les expériences de mort imminente présentées par l’auteur dans une autre vidéo. En même temps, elle installe la spiritualité dans la préservation et le recouvrement de la santé.
On peut ajouter un autre apport qui nous parait précieux dans la configuration religieuse actuelle où certains courants fondamentalistes manifestent une étroitesse d’esprit en considérant négativement des phénomènes émergeants jusqu’à les condamner et à les rejeter avec violence au nom d’une interprétation littérale de la Bible. Or, ici, Jacques Besson conjugue la reconnaissance de ces phénomènes avec un témoignage de foi chrétienne et une lecture de la Bible à la fois instruite et enthousiaste.
Ainsi, à tous égards, cette contribution nous parait appeler une particulière attention.
Rapporté par J H
1.Jacques Besson. Addiction et spiritualité. Spiritus contre spiritum. Erès, 2017. « L’auteur propose un voyage depuis l’aube de l’humanité en compagnie des substances psycho-actives jusqu’à l’épidémie addictive contemporaine. Il montre comment l’addiction représente une pathologie du lien et du sens. Les relations entre addiction et spiritualité sont explorées par les dernières recherches neuroscientifiques sur la méditation et la prière, dans ce qui est devenu une nouvelle science, la neurothéologie »
2. La CONSCIENCE , moteur de la prochaine REVOLUTION : https://www.youtube.com/watch?v=-bA52VG7wZg
Expériences de mort imminente : la science face à une énigme : https://www.youtube.com/watch?v=REoY0EwwnMM
3.Spiritualité et créativité de soi. L’esprit du bonheur : https://www.youtube.com/watch?v=M7C1FXvMzSA
Voir aussi :
The Awakened brain ( Cerveau et spiritualité) : https://vivreetesperer.com/the-awakened-brain/
La nouvelle science de la conscience : https://vivreetesperer.com/la-nouvelle-science-de-la-conscience/
Comment nos pensées influencent notre réalité : https://vivreetesperer.com/comment-nos-pensees-influencent-la-realite/
Les expériences spirituelles : https://vivreetesperer.com/les-experiences-spirituelles/
Une révolution spirituelle. Une approche nouvelle de l’au-delà (Lytta Basset) : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/
Jésus le guérisseur (Tobie Nathan) : https://vivreetesperer.com/jesus-le-guerisseur/

par jean | Fév 6, 2024 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |
La réussite d’enfants apprenant librement en petit groupe auprès d’un ordinateur en puisant dans le savoir d’internet.
Comment l’expérimentation de Sugata Mitra s’est propagée en Inde et à travers le monde : des environnements d’apprentissage auto-organisés, une école dans le nuage (school in the cloud).
Il y a une dizaine d’années, le nouveau processus pédagogique initié et propagé par un ingénieur indien, Sugata Mitra, à partir d’une expérience initiale en 1999 : la réussite d‘un groupe d’enfants d’un bidonville indien à utiliser un ordinateur mis à leur portée ‘The hole in the wall’, était reconnue par le dispositif Ted qui diffuse les idées nouvelles dans l’univers anglophone à travers des ‘talks’, courtes interventions en vidéo ; en 2013, Ted lui décerne un prix accompagné d’un crédit qui va lui permettre d’engager une expérimentation à grande échelle en créant sept espaces propices à cette pédagogie : 2 en Grande-Bretagne et 5 en Inde. Nous avons rendu compte de la première étape du parcours de Sugata Mitra, celle des grandes innovations qui, durant la première décennie du XXIe siècle, ont engendré un nouveau processus pédagogique (1). Or en 2019, Sugata Mitra publie un livre qui dresse le bilan de l’ensemble de l’innovation et trace des perspectives d’avenir : « The school in the cloud. The emerging future of learning » (2). « L’Éducation a essayé d’exploiter la “promesse” de la technologie de l’éducation pendant des décennies pour aucun profit, mais nous avons appris que des enfants en groupe – quand l’accès à internet leur est donné – peuvent apprendre par eux-mêmes n’importe quoi (learn anything by themselves)… » En 1999, Suga Mitra a mené la fameuse expérience du ‘trou dans le mur’ qui a donné matière à trois causeries TED et lui a permis de gagner le premier prix TED d’un million de dollars pour la recherche. Depuis lors, il a mené une nouvelle recherche à propos des environnements d’apprentissage auto-organisés (self-organized learning environments, SOLE), construisant des ‘Écoles dans le Nuage’ (Schools in the Cloud) à travers le monde. Ce nouveau livre partage les résultats de cette recherche… Dans ce livre révolutionnaire, vous apercevrez le futur émergent de l’apprentissage avec la technologie. Il en ressort que la promesse n’est pas dans la technologie elle-même. Elle est dans « un apprentissage dirigé par les enfants eux-mêmes utilisant la technologie » (page de couverture).
Cet ouvrage se déroule en trois grandes parties : Qu’est ce qui arrive quand les enfants rencontrent internet ? – Les écoles dans le nuage – Aperçus sur le futur de l’apprentissage.
Internet peut être un fabuleux moyen d’apprentissage pour les enfants
Avec son esprit curieux, en mettant un ordinateur en accès à des enfants d’un bidonville indien, l’ingénieur Sugata Mitra a fait apparaitre un phénomène insoupçonné : la capacité d’enfants défavorisés et sans instruction, mais s’entraidant les uns les autres de découvrir le fonctionnement d’un ordinateur et d’apprendre à partir d‘internet. A l’entrée de son premier chapitre intitulé : ‘Self–organizing systems in learning’ (les systèmes d’apprentissage s’organisant eux-mêmes), Sugata Mitra résume en ces termes le nouvel horizon : « Quand on leur donne l’accès à internet en groupe, les enfants peuvent apprendre n’importe quoi tout seuls » (p 3). Il décline ensuite ce constat à travers les résultats d’expérimentation auprès d’enfants d’âge divers en des lieux différents et dans des conditions variées. En Inde, dans les régions rurales ou les faubourgs misérables, puis dans d’autres pays, au Bhutan, au Cambodge et en Afrique du sud, « les résultats ont toujours été les mêmes : la capacité digitale a jailli de ce qui paraissait de nulle part » (Digital literacy sprang out of seemingly nowhere) (p 4). Sugata Mitra en précise les conditions : « Au cours des années, nos expériences ont montré que des groupes d’enfants, se voyant donner accès à internet dans des espaces publics et sûrs apprendrons à utiliser les ordinateurs et internet sans instruction venant des adultes. Nos expériences montrent que les enfants en groupe apprennent à des vitesses beaucoup plus grandes que des enfants travaillant individuellement par eux-mêmes. La mentalité de la ruche collective se montre un enseignant efficace. Il m’a fallu des années pour réaliser que cette situation collective d’apprentissage était un exemple d’un système s’auto-organisant… » (p 7).
Des environnements d’apprentissage auto-organisés
Nommé professeur de technologie de l’éducation à l’université de Newcastle en novembre 2006, Sugata Mitra arrive en Angleterre. En 2009, un film indien célébrant un effet de promotion sociale de l’expérience, ‘The hole in the wall’, le rend célèbre et il est contacté par une institutrice anglaise d’une petite école élémentaire Saint-Alban à Gateshead. Il engage la conversation avec des élèves de huit ans et leur propose d’essayer une expérience d’apprentissage avec des ordinateurs. Le 6 juillet 2009, les 24 élèves enthousiastes, âgés de huit ans, se voient proposés cinq questions concernant les avantages de l’adaptation pour la survie, questions correspondant à un niveau supérieur de quatre années. « Les enfants ont accès à un ordinateur par groupe de quatre en toute liberté. Au bout de trente minutes, les enfants reviennent avec leurs réponses sur un bout de papier. Puis, on demanda à chaque groupe de poser sa propre question. Il fut demandé à l’institutrice de retenir les réponse et de reposer individuellement et sans recours à l’ordinateur, les mêmes questions deux mois après (p11). Les résultats furent remarquables : « Les groupes peuvent répondre aux questions de l’examen classique, avec des années d’avance. Et, après avoir appris en groupe, beaucoup d’entre eux peuvent assimiler leur réponse dans une compréhension personnelle. Et deux mois après, ils ont retenu les résultats » (p 12). Ce fut là une nouvelle ouverture pour la recherche. L’expérience a ensuite été de nombreuses fois répétées montrant que les enfants pouvaient répondre à des questions encore plus difficiles correspondant à un niveau d’âge plus élevé. Sugata Mitra a trouvé un nouveau nom pour désigner cette méthode. Dans ces classes, l’ordre avait été remplacé par un doux chaos dans l’espoir d’un ordre émergeant spontanément. J’ai trouvé un nouveau nom pour ce que nous avions réalisé : nous avions découvert le « Self-organized learning environment » (SOLE) (Environnement d’apprentissage auto-organisé )» (p 14).
A partir de là, Sugata Mitra a développé quelques environnements expérimentaux en Inde.
En récapitulant les résultats obtenus par les enfants durant plusieurs années, Sugata Mitra peut mettre en évidence des gains remarquables :
- Devenir un bon usager autonome d’internet
- Apprendre assez d’anglais pour utiliser les moteurs de recherche ou un chat en mail
- Apprendre à chercher sur internet pour répondre aux questions
- Améliorer sa prononciation anglaise
- Améliorer ses scores en mathématiques et en sciences à l’école
- Évaluer les opinions et détecter l’endoctrinement et la propagande (p 15)
Les enfants à qui on donne accès à internet en groupe peuvent apprendre n’importe quoi tout seuls
Dès lors, Sugata Mitra s’est posé la question : « Y a-t-il une limite à ce que les enfants peuvent comprendre en utilisant internet ? ».
Pour répondre à cette nouvelle question, une nouvelle expérience a été entreprise à kalikuppam, un village de l’Inde du sud. « Nous avons posé une question dont nous pensions que les enfants ne parviendraient pas à y répondre : quel est le processus de réplication de l’ADN ? Est-ce que des enfants Tamil âgés de 12 ans à Kalikuppan peuvent apprendre et comprendre le processus de réplication de l’ADN en anglais à partir d‘un ordinateur, trou-dans-le-mur, sans guidance d’un adulte ? A ma stupéfaction la réponse a été : oui » (p 15) ». Un matériel universitaire de biotechnologie avait été déchargé sur l’ordinateur. Au bout de deux mois, ces enfants qui comprenaient à peine ce langage sur un sujet bien en avance de ce qui leur était enseigné à leur âge, sont parvenus tout seuls à un score de 30%. Puisqu’on ne pouvait trouver un professeur de biochimie pour cette école, Sugata Mitra a eu l’idée de chercher une ‘médiatrice’. « Cette personne était juste une figure adulte amicale qui encouragerait les enfants à aller plus loin, simplement à travers des expressions chaleureuses comme : ‘Formidable. Comment tu as pu comprendre cela ?’ ou ‘Je n’aurais jamais pu comprendre cela tout seul’… pareil à la manière dont une grand-mère admire ses petits-enfants. La médiatrice n’avait aucune connaissance du sujet. Elle avait de l’affection pour les enfants et elle les admirait. J’ai appelé cela la ‘méthode de la grand-mère’. En quelques semaines, la ‘méthode de la grand-mère’ a mené les enfants de Kalikuppan au même niveau que des enfants plus âgées qui recevaient l’enseignement d’un professeur formé de biochimie dans un école urbaine de Delhi ».
Cette expérience de Kakikuppan a appris deux grandes leçons à partir desquelles Sugata Mitra a pu déclarer : « Les enfants à qui on donne accès à internet en groupes peuvent apprendre n’importe quoi tout seuls ». Dès lors, les déclarations de Sugata Mitra ne sont plus apparues comme naïves, mais comme dangereuses. Cette expérience a également montré que l’admiration est un puissant outil d’apprentissage. L’apprentissage auto-organisé est tout au long aidé par l’admiration. J’ai appelé cette méthode : ‘Une éducation envahissante au minimum’ (minimally invasive education) » (p 16).
Comment des grands-mères viennent encourager les enfants sur skype
A partir de là, Sugata Mitra s’est dit que la ‘méthode des grands-méres’ était efficace et il a décidé d’essayer à nouveau. Est-ce que cette pratique pourrait se réaliser avec skype ? En 2009, comme Sugata Mitra est interviewé par le ‘Guardian’, il fait savoir que son dispositif est associé à un service de téléphone skype à Hyderabad comme près de Newcastle. Et il raconte : « Quand je suis allé en Inde récemment, j’ai demandé aux enfants comment ils aimeraient utiliser skype au mieux et ils m’ont répondu qu’ils souhaiteraient que des grands-mères anglaises leur lisent des contes de fée ». L’intervieweur en a fait part dans le Guardian et du coup des mails sont arrivés. Sugata Mitra s’est adressé aux volontaires pour leur donner les principes de la ‘méthode des grands-mères’ : ne pas enseigner, entrer en conversation, poser des questions et demander aux enfants d’éventuelles réponses. En d’autres mots, elles peuvent conduire une session SOLE sur skype. Nous décidâmes d’appeler ce groupe de volontaires ‘The Granny Cloud’ (le nuage de la grand-mère). Parmi ces volontaires, certaines personnalités se sont révélées particulièrement ajustées. Aujourd’hui, des ‘grannies’ opèrent à l’échelle mondiale (p 17-18). Cette intervention a eu notamment un effet bénéfique sur le langage des enfants (p 32).
Les Écoles dans le Nuage
Dans ce livre, Sugatra Mitra nous rapporte comment l’expérimentation s’est poursuivie à travers l’implantation d’ ‘environnements d’apprentissage auto-organisés’ (SOLE) à travers le monde ; effectivement, des expériences sont apparues dans de nombreux pays : Australie, Argentine, Uruguay, Chili, Etats-Unis. Et bien sûr, elle a continué à s’étendre en Angleterre et surtout en Inde. L’Inde a été le grand champ d’expérimentation des ‘Schools in the Cloud’. Ce livre nous rapporte, par le menu, l’histoire de chaque innovation dans son environnement spécifique : les atouts, les oppositions, les difficultés, les gains qui, à chaque fois, viennent confirmer la réussite de cette nouvelle approche.
Au total, Sugata Mitra peut dresser un bilan : « Qu’est-ce que nous avons appris des écoles dans le nuage ? » (p 125-140). « Nous savons maintenant que les enfants peuvent apprendre à se servir des appareils tout seuls. Ils peuvent même apprendre plus vite dans des groupes non supervisés… Ils peuvent aussi enseigner aux adultes les usages de la nouvelle technologie. Nous voyons là une génération qui peut utiliser n’importe quelle technologie digitale pour résoudre des problèmes… Ils peuvent calculer (compute) des solutions aux problèmes. Calculer est la nouvelle arithmétique (Computing is the new arithmetic). On constate également une amélioration de la ‘compréhension de lecture’ lorsque les enfants utilisent l’Ecole dans le Nuage. « Il est important de noter que la ‘compréhension de lecture’ est seulement un des aspects de la compréhension des contenus. En plus des textes imprimés, les enfants ont affaire à beaucoup d’autres genres de médias incluant des représentations visuelles, audio et vidéo ». « Ainsi il vaudrait mieux parler de ‘compréhension de multimédias’. Dans les ‘Écoles dans le Nuage’, cette compréhension s’améliore à des niveaux au-dessus de celle qui prévaut dans l’éducation standard ». Au total, les enfants apprennent à lire mieux et plus vite dans l’École du Cloud. Il est peut-être possible de commencer avec des enfants aussi jeunes que cinq ans. Voici une génération qui peut comprendre le monde à partir du nuage massif de données qui les entoure ».
« Nous savons que des groupes d’enfants cherchant sur internet réussissent mieux dans leur recherche et habituellement détectent les erreurs dans l’information ou dans leur perception. A la différence des écoles traditionnelles, dans les Ecoles dans le Nuage, les enfants apprennent à chercher en groupe, se corrigent les uns les autres, et discutent entre eux quelle découverte est la plus authentique. En se comportant ainsi, les enfants apprennent à communiquer avec le réseau, à répondre aux bonnes questions de la bonne manière, et expliquer et discuter leurs découvertes les uns avec les autres. Communiquer est la nouvelle écriture.
Quand les enfants recherchent sur internet et sont complimentés sur leurs découvertes, il est naturel de s’attendre à ce que la confiance en eux-mêmes s’accroisse… Voilà une génération qui a confiance dans ses capacités digitales.
Les enfants n’ont pas peur de la technologie moderne. Ils ont seulement besoin d’y avoir accès. C’est une vision d’espoir.
Finalement, ‘le Trou dans le Mur’ et ‘l’École dans le Nuage’ nous montrent qu’il y a un changement fondamental dans les capacités dont les enfants ont besoin pour la nouvelle époque dans laquelle ils sont en train de grandir. Une transition se produit : un mouvement de la lecture, l’écriture, l’arithmétique à la compréhension, la communication et le calcul ».
Une réflexion prospective
Dans un dernier chapitre, Sugata Mitra s’engage dans une réflexion prospective ‘Looking for the future’. Sugata Mitra est impressionné par la rapidité du changement technologique. « Nous sommes dans une trajectoire technologique pour le développement humain qui est maintenant dans une phase exponentielle » (p 166). Son attention se porte sur l’organisation des réseaux et de leur évolution. Comme physicien, il envisage les ‘systèmes dynamiques complexes’ et il rapporte des changements où on passe spontanément d’une situation chaotique à un ordre supérieur. « Quand des systèmes complexes passent du chaos à l’ordre, nous les appelons des systèmes s’auto-organisant » (p XXXVIII). Sugata Mitra entrevoit cette réalité dans la nature et il la perçoit dans son expérimentation pédagogique dans un processus où on passe du brouhaha à une construction collective. Il aperçoit un phénomène analogue dans l’émergence d’internet aujourd’hui. « Cette époque est caractérisée par un ordre spontané dans un réseau global de gens » (p 173). Nous ne le suivons pas dans des extrapolations qui apparaissent aujourd’hui dans le courant transhumaniste. Nous ne nous arrêtons donc pas à ce court épilogue, car il ne rapporte en rien l’apport majeur de ce livre : l’invention d’une pédagogie nouvelle fondée sur la créativité des enfants dans des petits groupes en phase avec internet. La recherche et l’innovation menées par Sugata Mitra nous paraissent à la fois spectaculaires et révolutionnaires.
Dans cette innovation épique, le nouveau processus pédagogique initié par Sugata Mitra s’appuie sur l’élan créatif des enfants et, à cet égard, on peut y voir une parenté avec d’autres formes d’éducation nouvelle, comme l’invention montessorienne (3). Cependant, comme les innovations précédentes, celle-ci s’est heurtée et se heurte encore à un système scolaire marqué par la hiérarchie, la compétition, l’individualisme. Certes, ce système est de plus en plus contesté dans l’aire anglophone comme dans l’aire francophone. En l’occurrence, Sir Ken Robinson, qui remit le prix TED à Sugata Mitra, auteur et conférencier anglais, expert dans le domaine de l’éducation artistique, a fréquemment dénoncé les effets pervers des systèmes scolaires forgés à l’image de la production industrielle (4). Il déclarait ainsi : « L’école nous introduit dans une voie standardisée et annihile la créativité que chaque enfant porte en lui à la naissance ». Ken Robinson montrait comment le système scolaire actuel est le produit d’une autre époque où un intellectualisme individualiste issu du XVIIIe siècle s’est combiné à une organisation industrielle associant uniformisation, standardisation et division du travail. Aujourd’hui, nous avons besoin de passer d’un « processus mécanique » à un « processus organique ». Les nouveaux modes de communication changent la donne et permettent le changement. Sans doute, percevons-nous aujourd’hui davantage non seulement les bienfaits d’internet, mais également les risques potentiels. Cependant, cette analyse nous permet de comprendre en quoi l’innovation de Sugata Mitra s’est heurtée au conservatisme de l’institution scolaire. Cette opposition apparait bien dans le commentaire d’un chercheur anglais, James Nottingham : « Ce livre met en question une représentation conventionnelle et vous pousse à entrer dans une nouvelle manière de penser au sujet du comment apprendre. Par exemple, pensez aux millions dépensés pour fournir un ordinateur à chaque étudiant alors que Sugar Mitra montre que les enfants apprennent mieux lorsqu‘ils se rassemblent auprès d’un grand écran… » Et de même, cet auteur fait ressortir la vanité du bachotage des tests au regard des résultats durables obtenus dans les ‘environnements d’apprentissage auto-organisés’. Une caractéristique majeure de cette innovation éducative est l’apprentissage en petits groupes. C’est aussi un élément majeur de sa réussite. Ainsi la rupture avec le système traditionnel n’est pas seulement technique, elle est aussi sociale.
J H
- Sugata Mitra , un avenir pédagogique prometteur https://vivreetesperer.com/sugata-mitra-un-avenir-pedagogique-prometteur-a-partir-dune-experience-dauto-apprentissage-denfants-indiens-en-contact-avec-un-ordinateur/
- Sugata Mitra. The School in the Cloud. The emerging future of learning. Corwin, 2020. On pourra voir parallèlement un film documentaire réalisé par Jerry Rothwell : https://www.platform-mag.com/film/the-school-in-the-cloud.html
- L’invention montessorienne : https://vivreetesperer.com/linvention-montessorienne-2/
- Une révolution en éducation : https://vivreetesperer.com/une-revolution-en-education/

par jean | Fév 6, 2024 | ARTICLES, Vision et sens |
In the fellowship of the Holy Spirit
« In the fellowship of the Holy Spirit », c’est le titre d’un chapitre du livre de Jürgen Moltmann : « The source of life. The Holy Spirit and the theology of life » (1). A la suite d’un premier ouvrage de Moltmann : « The Spirit of life » (1992) traduit en français et publié en 1999 sous le titre : « L’Esprit qui donne la vie », ce livre, inédit en français, se propose d’apporter une théologie du Saint Esprit à l’intention d’un vaste public. Dans ce chapitre, Jürgen Moltmann nous introduit dans la personnalité du Saint Esprit à travers une caractéristique majeure : la « fellowship », ce terme évoquant par ailleurs le potentiel chaleureux de la vie associative, et pouvant dans ce cas, se traduire en français par toute une gamme de termes : amitié, fraternité, communion… « Dans la communion d’un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint Esprit, le Saint Esprit vient à notre rencontre et il communique avec nous, comme nous avec lui. De fait, il nous permet d’entrer en communion avec Dieu (« fellowship with God »). Avec lui, la vie divine nous est communiquée et Dieu participe à notre vie humaine. Ce qui advient ainsi dans la manifestation de l’Esprit, n’est rien moins qu’une communion avec Dieu (« fellowship with God ») (p 190). Cette lecture nous est précieuse parce qu’elle nous permet d’apprendre à vivre aves le Dieu vivant (« The living God ») en nous, pour nous, avec nous (2).
La communion : une caractéristique de l’Esprit
« Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ et l’amour de Dieu et la communion (« fellowship ») de l’Esprit soient avec vous tous ». Ainsi s’énonce une ancienne bénédiction chrétienne (II Corinthiens 13.13). Jürgen Moltmann s’interroge. « Pourquoi le don particulier de l’Esprit est-il perçu comme la communion (fellowship), alors que la grâce est attribuée à Christ et l’amour à Dieu le Père ? ». Cette caractéristique a des conséquences considérables. « Dans cette communion, l’Esprit est davantage qu’une force vitale neutre. L’Esprit est Dieu lui-même en personne. Il entre en communion avec les croyants et les attire en communion avec lui. Il est capable de communion et désire la communion » (p 89).
Les vertus de la communion fraternelle
Le terme « fellowship » est difficile à traduire ici, car, dans la vie courante, il s’applique aussi à l’esprit associatif et on peut l’évoquer en terme de fraternité ; nous utiliserons ici le terme : communion fraternelle. « La communion fraternelle ne s’impose pas par la force et par la possession. Elle libère. Nous offrons une part de nous-même et nous partageons la vie d’une autre personne. La communion fraternelle se vit dans une participation réciproque et une acceptation mutuelle. La communion fraternelle surgit quand des gens qui sont différents, trouvent quelque chose en commun, et, que ce quelque chose en commun est partagé par différentes personnes… Il y a communion fraternelle dans une relation mutuelle : des fraternités engendrées par une vie partagée. Dans la plupart des fraternités humaines, les objectifs et les relations personnelles sont liés » (p 89). Et la communion fraternelle peut s’établir entre gens semblables, mais aussi entre gens différents.
La communion de Saint Esprit : un phénomène original
Si on considère ainsi la communion fraternelle, la fraternité dans le genre humain, qu’en est-il dans la communion fraternelle, telle qu’elle se manifeste à travers le Saint Esprit ? « Si nous nous rappelons les différentes connotations et les différents significations de la fraternité humaines, alors la communion du Saint Esprit avec nous tous, devient un phénomène tout à fait étonnant. Dans l’Esprit, Dieu rentre en communion avec les hommes et les femmes : La vie divine nous est communiquée et Dieu participe à notre vie humaine. Dieu agit sur nous à travers sa proximité éveillante et vivifiante et nous agissons sur Dieu à travers nos vies, nos joies et nos souffrances. Ce qui advient en étant dans l’Esprit de vie n’est rien moins que la « fellowship », la communion fraternelle avec Dieu. Dieu est impliqué en nous, nous répond et nous lui répondons. C’est pourquoi l’Esprit peut porter de bons fruits en nous et c’est pourquoi nous pouvons aussi peiner et éteindre l’Esprit. En l’Esprit, Dieu est comme un mari, une épouse, un partenaire. Il nous accompagne et partage nos souffrances. Le Saint Esprit ne se comporte pas avec nous d’une manière dominatrice, mais avec tendresse et prévenance. De fait dans un esprit de communion fraternelle » (p 90).
Avec le Saint Esprit, entrer dans la communion de Dieu trinitaire.
Cependant, nous devons envisager la communion fraternelle de l’Esprit avec nous dans un paysage bien plus vaste. « Le Saint Esprit n’entre pas seulement en communion avec nous et ne nous attire pas simplement en communion avec lui. L’Esprit lui-même – elle-même – existe en communion avec le Père et le Fils, « d’éternité en éternité », et est adoré et glorifié ensemble avec le Père et le Fils comme le dit le credo de Nicée. Ainsi, la communion de l’Esprit avec nous se cache dans la communion éternelle avec Christ et le Père de Jésus – Christ. La communion du Saint Esprit avec nous correspond à sa communion divine éternelle. Elle ne correspond pas seulement à cette communion, elle est elle-même cette communion. Ainsi dans la communion de l’Esprit, nous sommes liés au Dieu trinitaire, pas seulement extérieurement, mais intérieurement. A travers l’Esprit, nous sommes attirés dans la symbiose éternelle ou la communion vivante du Père, du Fils et de l’Esprit, et nos vies humaines limitées participent au mouvement circulaire éternel de la vie divine. Ainsi, dans la communion du Saint Esprit avec nous tous, nous faisons l’expérience de la proximité de la vie divine et aussi l’expérience de notre vie mortelle comme une vie qui est éternelle. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous… Dans la communion du Saint Esprit, la Trinité divine est si grande ouverte que la création entière peut y demeurer. C’est une communion qui invite : « Qu’ils puissent tous être en nous », telle est la prière de Jésus dans l’Evangile de Jean ( Jean 17.21) » (p 90-91).
Une unité respectueuse de la diversité
Cette description de la place et du rôle du Saint Esprit dans la communion trinitaire peut-elle nous apprendre quelque chose sur le genre d’unité que les croyants vont développer dans la communion de l’Esprit ? Est-ce que l’Esprit se manifeste essentiellement dans l’animation de la communauté ou bien particulièrement dans la vie individuelle des croyants ? Jürgen Moltmann récuse cette alternative tranchée. « La communion du Saint Esprit ne renforce ni l’individualisme protestant dans la foi, ni le collectivisme ecclésial catholique. L’expérience de la riche variété des dons de l’Esprit est aussi primordiale que l’expérience de la communion dans l’Esprit. « Il y a une variété de dons, mais c’est le même Esprit » (I Cor 12.4)… L’expérience de la liberté qui donne à chacun ce qui lui est propre (I Cor 12.11) est inséparable de l’expérience de l’amour qui unit les gens ensemble dans l’Esprit. La vraie unité des croyants dans la communion de l’Esprit est une image et un reflet de la Trinité de Dieu et de la communion de Dieu dans des relations personnelles différentes. Ni une conscience collective qui réprime l’individualité des personnes, ni une conscience individuelle qui néglige ce qui est commun, ne peuvent exprimer cela. Dans l’Esprit, personnalité et socialité viennent ensemble et sont complémentaires » (p 92).
Le chapitre : « In the fellowship of th Spirit » se poursuit en deux autres séquences : « L’Église dans la communion de l’Esprit », et « La communion fraternelle entre les générations et les sexes ».
La pensée théologique de Moltmann est entrée dans une nouvelle étape créative au début des années 1990 à travers sa théologie de la création, sa nouvelle théologie trinitaire et sa théologie de l’Esprit (2). Ce livre : « La source de vie » s’inscrit dans ce mouvement. Nous avons été inspiré par ce passage qui évoque pour nous la présence divine en terme de communion, dans un rapport à l’expérience de la communion fraternelle.
Rapporté par J H
- Jürgen Moltmann. The source of life. The Holy Spirit and the theology of life. Fortress Press, 1997
- Pour une vision holistique de l’Esprit : https://vivreetesperer.com/pour-une-vision-holistique-de-lesprit/
par jean | Août 7, 2023 | ARTICLES, Emergence écologique |
Ecothéologie et pentecôtisme
 Dans la prise de conscience écologique, une nouvelle vision théologique est apparue au point de porter un nom : écothéologie. Michel Maxime Egger nous en a montré les différents visages (1). Nous savons aussi comment le théologien Jürgen Moltmann a sous-titré son livre : « Dieu dans la création » paru dès 1988 : « Traité écologique de la création » et poursuivi ensuite constamment son œuvre en ce domaine (2). En 2015, le pape François publie dans ce domaine une encyclique retentissante : « Laudato si’ » (3). Dans la dernière décennie, ce mouvement est également apparu dans le champs pentecôtiste, du moins chez certains théologiens anglophones. Sachant l’expansion actuelle du pentecôtisme dans le monde, ce fait est important d’autant que certaines manifestations politiques du pentecôtisme dans certains pays ont pu être contestées. A J Swoboda est pasteur et professeur de théologie, notamment à la faculté Fuller (4). Il se déclare un environnementaliste pentecôtiste : « Le soin porté à la création est un aspect intégral de l’œuvre relationnelle du Saint Esprit dans le monde » (5). A J Swoboda a écrit sur cette questions plusieurs livres qui font référence : « Tongues and trees. Towards a Pentcostal Ecological Theology » (6) ; « Introducing Evangelical Ecotheology. Foundations in Scripture, Theology, History and Praxis ». Aussi a-t-il édité un recueil d’écrits théologiques : « Blood cries out. Pentecostals, Ecology and the Groans of Creation » (Pentecostals, Peacemaking and Social Justice) (7).
Dans la prise de conscience écologique, une nouvelle vision théologique est apparue au point de porter un nom : écothéologie. Michel Maxime Egger nous en a montré les différents visages (1). Nous savons aussi comment le théologien Jürgen Moltmann a sous-titré son livre : « Dieu dans la création » paru dès 1988 : « Traité écologique de la création » et poursuivi ensuite constamment son œuvre en ce domaine (2). En 2015, le pape François publie dans ce domaine une encyclique retentissante : « Laudato si’ » (3). Dans la dernière décennie, ce mouvement est également apparu dans le champs pentecôtiste, du moins chez certains théologiens anglophones. Sachant l’expansion actuelle du pentecôtisme dans le monde, ce fait est important d’autant que certaines manifestations politiques du pentecôtisme dans certains pays ont pu être contestées. A J Swoboda est pasteur et professeur de théologie, notamment à la faculté Fuller (4). Il se déclare un environnementaliste pentecôtiste : « Le soin porté à la création est un aspect intégral de l’œuvre relationnelle du Saint Esprit dans le monde » (5). A J Swoboda a écrit sur cette questions plusieurs livres qui font référence : « Tongues and trees. Towards a Pentcostal Ecological Theology » (6) ; « Introducing Evangelical Ecotheology. Foundations in Scripture, Theology, History and Praxis ». Aussi a-t-il édité un recueil d’écrits théologiques : « Blood cries out. Pentecostals, Ecology and the Groans of Creation » (Pentecostals, Peacemaking and Social Justice) (7).
Le ‘Jour de la Terre’
L’instauration d’un ‘Jour de la Terre’ aux Etats-Unis en 1970, initiative suivie internationalement, témoigne d’une éclosion de la prise de conscience écologique. C’était un jour de méditation et d’action pour restaurer la relation humaine avec la terre. Le fondateur et le visionnaire du ‘jour de la Terre’ fut John McConnell Jr. Dans son livre : « Blood cries out », (7) A J Swoboda nous décrit cette personnalité dans son parcours spirituel, nous signifiant par là que la préoccupation écologique a pu être présente en quelqu’un fortement marquée par une inscription familiale pentecôtiste. Les parents de McConnell ont été membres fondateurs de la charte des assemblées de Dieu en 1914. Son propre grand-père fut même un participant au grand réveil de la Rue Azuza à Los Angeles en 1906. Ainsi le ‘Jour de la Terre’ a commencé avec de fortes convictions religieuses. McConnell ,voyant la crise écologique à travers sa culture religieuse, « envisageait un jour où les chrétiens pourraient montrer la puissance de la prière, la valeur de leur charité et leur préoccupation pratique pour la vie et les gens de la terre ». Ce rappel historique est une entrée en matière qui légitime une approche théologique pentecôtiste de l’écologie.
Univers écologique et univers pentecôtiste : tout est relation
Brandon Rhodes était étudiant à l’université d’Oregon (Etats-Unis) et il y fréquentait deux univers : l’écologie et le pentecôtisme (6). Dans la communauté pentecôtiste, il se voit proclamer l’importance de la relation : « Le Royaume de Dieu porte entièrement sur les relations ». A travers leur vie ensemble, les étudiants pentecôtistes « apprenaient à voir et à nommer l’œuvre de l’Esprit dans leur vie et dans leurs relations quotidiennes ». Cependant, dans ses études en écologie, Brandon Rhodes s’éveillait à « l’interconnexion de toutes choses, comme les champignons qui s’emploient à constituer un réseau relai entre les arbres de la forêt. Quand un feu, une sécheresse ou une tronçonneuse frappe un arbre, la forêt entière en frisonne de conscience. En écologie, la relation, c’est tout. Cette prise de conscience a profondément influencé la manière dont je voyais la terre ». « La Création brille de vie, de relation et déborde d’un saint mystère ». « Avec le temps, cette résonance entre l’écologie et le pentecôtisme me devint tout-à-fait évidente. Le Royaume de Dieu porte entièrement sur la relation et il en va de même pour l’écologie. Le royaume de Dieu dans l’Esprit est écologique et vice versa. Je le ressentais d’une manière palpable dans cet environnement verdoyant des montagnes de l’Oregon ».
A la recherche d’une rencontre entre la réflexion théologique et l’expérience
Brandon Rhodes constata pourtant que le pastorat pentecôtiste percevait rarement la connexion entre les deux approches, et plus généralement la valeur de l’écologie. Ce fut donc avec joie qu’il accueillit la parution du livre de A J Swoboda, un ouvrage qui établissait un pont par dessus la division entre écologie et pentecôtisme. Et, encore mieux, il rencontra l’auteur habitant dans le même voisinage. Le livre de Swoboda : « Tongues and trees : toward a pentecostal ecological theology » formule sa thèse de doctorat pour un public plus large. Cependant, Brandon Rhodes s’interroge sur le format académique qui peut donner l’impression que le message descend d’en haut vers des réalités sociales qui montent d’en bas. « Le défi majeur pour Swoboda est de transmettre des idées académiques de haut en bas vers une tribu à la base, celle de l’église pentecôtiste. A J Swoboda trace bien quelques pistes comme « imposer les mains à la terre pour sa guérison, ou bien prêcher des eschatologies créationnelles ». Mais Brandon Rhodes reste en partie sur sa faim.
« Un épilogue plus développé en terme de pratiques pentecôtistes, expériences écologiques, incursions liturgiques, comportements mystiques à l’intention de l’église locale aurait idéalement arrondi ce travail ».
Un témoignage et un parcours de recherche
Brandon Rhodes partage avec nous sa vision de foi. « Le pentecôtisme, ce n’est pas seulement une manière de prêcher, chanter, se rassembler et prier. C’est fondamentalement développer des cœurs ouverts à l’activité de l’Esprit. C’est une imagination active se demandant où Jésus peut être à l’œuvre à travers l’Esprit ».
« Cependant ce comportement pentecôtiste tourné vers l’Esprit refuse d’être commodément institutionnalisé, planifié, préemballé pour une consommation ecclésiale ».
« Swoboda semble appeler l’écothéologie à nourrir notre capacité de voir la création comme une arène où se montre la vie de Dieu. Si je le lis fidèlement en pentecôtiste, il désire nous amener à devenir des magiciens verts plutôt que des écothéologiens – des guides mystiques à même de nous faire voir la magie dont ce monde est abreuvé par le Saint Esprit. L’Esprit holistique, baptisant la création, vers où « Tongues and Trees » dirige le pentecôtisme, est vivant et actif dans le monde ». Brandon Rhodes nous appelle « à avoir des yeux pour le voir et à répondre dans la repentance ».
Aperçus
Suite à son analyse, Brandon Rhodes présente un résumé détaillé du livre : « Tongues and Trees ». En voici quelques extraits.
Swoboda présente les apports des différentes dénominations à l’écothéologie. En ce qui concerne le pentecôtisme, il perçoit certaines dispositions favorables. « D’abord, le pentecôtisme met l’accent sur ce que Miroslav Wolf appelle : « la matérialité du salut » ce qui historiquement s’est prêté à une attention pour des questions de justice sociale – une disposition qui s’ouvre tout naturellement à honorer le monde matériel et, dans de nombreux cas, là où la dégradation écologique accroit les injustices existantes. Deuxièmement, l’accent pentecôtiste sur l’Esprit se prête au témoignage biblique de l’Esprit de Dieu vivifiant et même baptisant toute la création. Ainsi nous devons attendre les charismes non seulement de l’église charismatique, mais du reste du royaume de la création.
Swoboda résume son bilan des écothéologies charismatiques en deux points majeurs : « D’abord si l’Esprit de Dieu crée et vit dans la création et le peuple de Dieu, les deux sont en voie de restauration à la relationalité. La relationalité est la force même de la théologie et de la pratique pentecôtiste. Ultimement, c’est la force des théologies Esprit/création. L’accent pentecôtiste sur une église interconnectée – par – l’Esprit, nous enjoint de joindre la ‘conversation’. J’ai trouvé dans mon enseignement de l’écologie l’interconnexion de la terre elle-même. Deuxièmement, Swoboda conclut de cette recherche que notre tâche future est de nourrir une imagination pneumatologique concernant le « care » écologique.
Le développement de l’approche écologique transforme notre vision du monde. Elle nous incite à considérer qu’il y plus grand que nous et que nous nous inscrivons dans un tissu de relations. Cette vision nous invite à entrer dans une vision spirituelle où la Pentecôte apparaît comme une figure privilégiée. On comprend qu’un théologien pentecôtiste assume l’approche écologique en espérant que cette attitude se répande dans sa dénomination comme elle s’étend dans d’autres églises.
Rapporté par J H
- Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
- Dieu dans la création : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
- Convergences écologiques :Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François et Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
- A J Swoboda Ph D : https://www.bushnell.edu/faculty/a-j-swoboda/
- A J Swoboda : I am a pentecostal environmentalist : https://faithandleadership.com/aj-swoboda-im-pentecostal-environmentalist
- Book Review, Tongues and trees. Toward a pentecostal ecological theology : https://christandcascadia.com/2014/08/01/book-review-tongues-and-trees-toward-a-pentecostal-ecological-theology/
- A J Swoboda. Blood cries out : https://www.amazon.com/Blood-Cries-Out-Pentecostals-Peacemaking/dp/1625644620
par jean | Juil 5, 2023 | ARTICLES, Vision et sens |
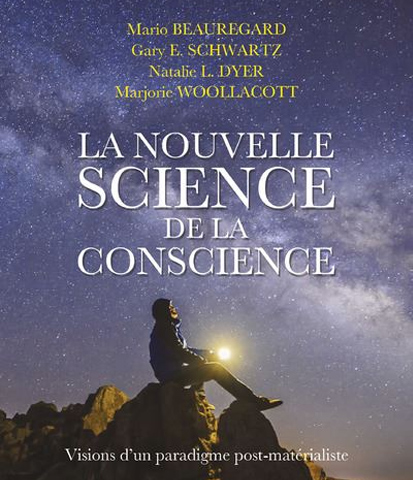 Pour une science post-matérialiste
Pour une science post-matérialiste
Le terme matérialisme évoque des sens différents selon le contexte auquel on l’applique. Ainsi, dans la vie quotidienne, on peut désigner comme « matérialiste », « une personne qui cherche des jouissance et des biens matériels » (définition google). Ainsi, beaucoup de gens dans notre société ont pu être perçus à la fois comme individualistes et matérialistes. Aujourd’hui, on peut constater, au plan social, le développement d’attitudes et de comportements en réaction contre ce matérialisme pratique. En ce sens, le sociologue américain Ronald Inglehart désigne, en terme de post-matérialiste, une évolution culturelle dans les pays économiquement avancés dans laquelle les gens cherchent moins à satisfaire des besoins physiques élémentaires et davantage des besoins immatériels tels que l’estime, l’épanouissement de la personne ou les satisfactions esthétiques.
Cependant, sur un autre registre, le matérialisme désigne une philosophie d’après laquelle « il n’existe d’autre substance que la matière », « une doctrine qui rejetant l’existence d’un principe spirituel ramène toute la réalité à la matière et à ses modifications » (Google). L’origine de cette philosophie remonte à l’antiquité où elle figurait en regard d’autres écoles philosophiques. Cependant, dans la foulée du progrès scientifique, une métaphysique matérialiste a influé sur l’activité scientifique si bien qu’on peut évoquer un « matérialisme scientifique ». Dans le chapitre d’un livre qui œuvre en faveur du développement d’un paradigme post-matérialiste, ‘La nouvelle science de la conscience’ (1), Mario Beauregard répond à une question préalable : Qu’est-ce que le matérialisme scientifique aujourd’hui ? : « Peu de scientifiques sont conscients que ce que l’on appelle « la vision scientifique du monde » repose sur un certain nombre de postulats métaphysiques – c’est-à-dire des hypothèses sur la nature de la réalité – qui ont été proposées pour la première fois par certains philosophes présocratiques. Ces postulats comprennent le matérialisme – l’idée selon laquelle tout ce qui existe est constitué exclusivement de particules et de champs matériels / physiques (les termes « matérialisme » et « physicalisme » peuvent être utilisés de manière interchangeable dans ce chapitre) – et le réductionnisme, le concept selon lequel les choses complexes ne peuvent être appréhendées qu’en les réduisant aux interactions des parties qui les constituent, ou à des choses plus simples et plus fondamentales telles que de minuscules particules matérielles. Le « mécanisme », l’idée que le monde fonctionne comme une machine, représente un autre de ces postulats. Au cours du XXe siècle, ces postulats se sont durcis, puis transformés en dogmes et en un système de croyances connus sous le nom de « matérialisme scientifique » (p 18). Cette idéologie exerce une influence dans le domaine des neurosciences. « Selon ce système de croyances, l’esprit et la conscience – et tout ce que nous vivons subjectivement (par exemple, nos souvenirs, nos émotions, nos objectifs et nos épiphanies spirituelles)… ne sont rien de plus que des processus électriques et chimiques dans le cerveau : ces processus cérébraux étant en définitive réductibles à l’interaction entre des éléments physiques fondamentaux. Une autre implication de ce système de croyances est que nos pensées et nos intentions ne peuvent avoir aucun effet sur nos cerveaux et nos corps, sur nos actions et le monde physique, puisque l’esprit ne peut impacter directement les systèmes physiques et biologiques. En d’autres termes, nous les êtres humains, ne sommes rien d’autres que des machines biophysiques complexes. En conséquence, notre conscience et notre spiritualité disparaissent automatiquement lorsque nous mourrons » (p 18).
Cependant, aujourd’hui, de plus en plus de découvertes viennent contredire les théories matérialistes. On peut envisager « une vague d’éveil pour une science et une société post-matérialiste » (p 63). « La science connaît actuellement un changement fondamental. Le matérialisme sur lequel elle s’est appuyée pendant plusieurs siècles fait aujourd’hui place à un nouveau paradigme dans lequel la conscience est considérée comme étant causale et fondamentale » (page de couverture).
Un mouvement pour une science post-matérialiste
De nombreux scientifiques se conjuguent aujourd’hui pour promouvoir un paradigme post-matérialiste. « L’Académie pour l’avancement des sciences post-matérialistes » a organisé en février 2014 en Arizona, un « Sommet international sur la science, la spiritualité et la société post-matérialiste ». Des scientifiques couvrant des domaines d’expertise allant de la biologie et des neurosciences à la psychologie, la médecine et la recherche psi ont participé à cet événement déterminant. Il en est résulté « un manifeste pour une science post-matérialiste » (2) auquel plus de 300 scientifiques et philosophes du monde entier ont apporté leur soutien » (p 14). Pendant le sommet, plusieurs participants ont décidé de réaliser « une anthologie des perspectives et des preuves relative à la science post-matérialiste », ouvrage publié en français sous le titre : « La nouvelle science de la conscience » (1). « Coordonné par Mario Beauregard et Guy E Schwartz, cet ouvrage appréhende les concepts post-matérialistes relatifs à l’esprit, au corps et à la santé. En s’appuyant sur de nombreuses preuves, il aborde l’organisation et les fonctions spécifiques des phénomènes non physiques, ouvrant la voie à la possibilité de considérer leur nature et leur influence dans le cadre d’une future science globale » (page de couverture).
Une recherche pionnière : Mario Beauregard
Dans un premier chapitre, Mario Beauregard nous introduit à une « prochaine grande révolution scientifique ». Ce chercheur travaille depuis longtemps en ce sens et nous avions rapporté une de ses conférences dans un article : « Comment nos pensées influencent la réalité » (3) et présenté un de ses livres : « Brain wars » (4).
En s’inscrivant dans la perspective du changement des paradigmes énoncée par Thomas S Kuhn, Mario Beauregard écrit : « Les scientifiques qui travaillent actuellement dans le domaine de la recherche sur la conscience et qui s’intéressent au problème : « esprit-cerveau », se trouvent dans une situation similaire à celle des physiciens au début du XXe siècle. Ils sont indéniablement confrontés à une quantité croissante de preuves d’anomalies qui ne peuvent être élucidées par les théories de la pensée matérialiste » (p 21). Mario Beauregard nous présente ensuite quelques unes de ces preuves.
« Les différentes preuves examinées ici sont regroupées en deux catégories. La catégorie I comprend les preuves comme quoi une explication matérialiste, bien que couramment présentée, est moins appropriée qu’une explication post-matérialiste. Cette catégorie comprend les phénomènes suggérant que l’esprit ne soit limité ni par l’espace, ni par le temps. La catégorie II comprend des preuves qui sont rejetées d’emblée par les théories de la pensée matérialiste, mais qui viennent soutenir une perspective post-matérialiste, celle-ci étant incompatible avec la perspective matérialiste selon laquelle l’esprit et la conscience sont produits uniquement par le cerveau » (p 22). Ces différents éléments de preuve apparaissent dans la complexité de leur nature et de leur mise en œuvre, aussi notre compte-rendu sera sommaire en renvoyant le lecteur à la description formulée dans ce chapitre.
L’esprit au delà de l’espace et du temps
« L’un des éléments de preuve concerne les phénomènes dit « psi » qui comprennent la perception extra-sensorielle (PES), et la psychokinésie (PK). La perception extra-sensorielle désigne l’acquisition d’informations sur des événements ou des objets extérieurs par des moyens autres que la médiation d’un vecteur de communication sensorielle connu. Cela comprend la télépathie – l’accès aux pensées d’une autre personne sans l’utilisation d’aucun de nos vecteurs sensoriels connus, la clairvoyance – la perception d’évènements ou d’objets qui ne peuvent être perçus par les sens connus, et la précognition – la connaissance d’un événement futur qui ne peut être déduit à partir d’informations connues dans le présent. La psychokinésie (PK) se réfère à l’influence de l’esprit sur un système physique qui ne peut être totalement expliqué par la médiation d’un moyen physique connu » (p 22). Depuis plusieurs décennies, des expériences répétées à travers des dispositifs sophistiqués ont prouvé la réalité de ces phénomènes.
L’esprit au delà du cerveau
D’autres phénomènes concernent « l’esprit au delà du cerveau » : les expériences de la mort imminente pendant un arrêt cardiaque et la mort clinique ; recherches sur la réincarnation et les vies antérieures ; recherches sur la médiumnité ; communications sur le lit de mort ». « Les expériences de mort imminente (EMI) sont des expériences intenses et réalistes qui transforment généralement profondément la vie des personnes qui ont été proches de la mort psychologiquement et physiologiquement. Les principales caractéristiques des EMI sont un souvenir clair de l’expérience, une activité mentale décuplée, et la conviction que l’expérience vécue est plus réelle que celle de la conscience ordinaire à l’état de veille. L’expérience hors du corps (EHC) est une autre caractéristique typique des EMI ; la personne a l’impression réelle d’être sortie de son corps et d’observer les évènements qui se déroulent autour d’elle, ou parfois dans un lieu éloigné. Les EMI sont fréquemment évoquées lors d’un arrêt cardiaque… Étant donné que les structures cérébrales qui soutiennent l’expérience consciente et les fonctions mentales supérieures ( par exemple la perception, la mémoire et la conscience) sont gravement endommagées, on ne s’attend pas à ce que les survivants d’un arrêt cardiaque aient des expériences mentales claires et lucides dont ils se souviendront… Il convient de noter que les personnes ayant vécu une EMI déclarent avoir perçu des choses qui coïncident avec la réalité alors qu’elles étaient cliniquement mortes » (p 25). Un autre chapitre du livre, sous la plume de Pim Van Lommel, médecin cardiologue réputé, est consacré aux expériences de mort imminente, « une forte indication en faveur de la conscience non locale » (p 191-209).
L’auteur évoque également le cas de « jeunes enfants ayant rapporté des vies antérieures ». « Au cours des cinquante dernières années, plus de 2500 cas de ce genre ont été étudiés ». « La plupart de ces enfants ont des souvenirs de vie antérieure entre deux et cinq ans… Environ 80% des supposés souvenirs de vie antérieure des enfants évoquent des morts violentes… Beaucoup d’enfants ont des marques de naissance qui coïncident avec des blessures qui seraient associées à leur vie antérieure… il arrive souvent que l’on parvienne à identifier la personne à laquelle l’enfant fait référence… » (p 26-27). L’auteur propose des interprétations : « Il est possible que ces enfants se souviennent de vies antérieures qu’ils ont vécues comme ils le suggèrent ou qu’ils accèdent aux informations d’un individu décédé par des moyens inconnus (c’est-à-dire la théorie du super-psi appelée également « super ESP », la récupération d’informations par le canal psychique » (p 28).
Une autre approche de recherche est engagée auprès de médiums, « personnes déclarant pouvoir communiquer avec les personnes décédées », en présumant la bonne de foi de certains d’entre eux. Des protocoles sophistiqués ont été utilisés par certains chercheurs comme le Dr Gary E Schwartz, auteur d’un chapitre technique sur ce thème dans ce même livre. « Les résultats montrent qu’avec des essais réalisés en triple aveugle dans des conditions rigoureuse, certains médiums peuvent recevoir des informations justes et précises sur des personnes décédées. » (p 29).
Mario Beauregard mentionne également « les communications sur le lit de mort ou DBC (Deathbed communication) », une autre source de preuve suggérant que la conscience et la personnalité peuvent perdurer après la mort physique. Il s’agit de toute communication entre le patient et des amis ou des parents décédés… Ce type d’expériences a été rapporté dans diverses cultures à travers l’histoire. Les DBC incluent des aspects auditifs, visuels et kinesthésiques et se manifestent souvent pat des processus communicatifs non verbaux… Un type fréquent de DBC inclue des rencontre avec des présumés esprits de personnes décédées qui semblent accueillir l’expérienceur dans l’au-delà et converser avec lui/elle d’une façon interactive… Des recherches menées auprès d’infirmières et de médecins en soins palliatifs suggèrent que ces expériences sont relativement courantes… Il existe des cas de DBC qui ne peuvent être expliqués comme de simples hallucinations… : dans de tels cas, la personne mourante semble voir une personne qu’elle croyait vivante, mais qui est en fait décédée récemment, et exprime de la surprise » (p 30).
Une nouvelle vision postmatérialiste
« Prises ensemble, les différentes preuves empiriques montrent clairement que l’idée que l’esprit et la conscience sont produits par le cerveau est erronée et obsolète… Vers la fin du XIXe siècle, le psychologue américain, William James a suggéré que le cerveau pouvait jouer un rôle permissif et transmissif concernant les fonctions mentales et la conscience. Il a en outre émis l’hypothèse que le cerveau pouvait agir comme un filtre qui limite / contraint / restreint l’accès à des formes de conscience élargie. Cette hypothèse a également été défendue par les philosophes Ferdinand Schiller et Henri Bergson… » (p 31). « Cette hypothèse de la transmission apporte un cadre théorique utile… ».
« Le moment est venu de nous libérer des chaines et des œillères de l’ancien paradigme matérialiste et d’élargir notre vision de l’Univers et du vivant. Même si nous n’avons pas encore toutes les réponses, il est toutefois possible d’esquisser les grandes lignes d’un paradigme post-matérialiste » (p 31). Mario Beauregard nous présente, de son point de vue, quelques éléments clés de ce nouveau paradigme.
1° « L’esprit est irréductible et son statut ontologique est aussi primordial que celui de la matière, de l’énergie et de l’espace-temps. De plus, l’esprit ne peut être issu de la matière et réduit à quelque chose de plus élémentaire. A ce propos, le philosophe David Chalmers et le cosmologiste, Andrei Linde ont tous deux soutenu que la conscience est un constituant fondamental de l’univers. Il semble plausible que les processus / phénomènes mentaux, y compris l’intériorité subjective, existent à des degrés divers et à tous les niveaux d’organisation de l’univers… A ce sujet, le physicien Freeman Dyson suggère que puisque les atomes se comportent en laboratoire comme des agents actifs et non comme de la matière inanimée… ils doivent posséder la capacité réflexive de faire des choix… au niveau moléculaire, il est prouvé que les molécules composées de quelques protéines simples ont la capacité d’interagir de manière complexe, comme si elles possédaient leur propre intelligence… Dans cette perspective, chaque niveau d’organisation comprend un aspect physique (extérieur) et un aspect mental/ expérientiel (intérieur) (p 32-33).
2° « Comme le révèlent les phénomènes psi, il existe une profonde interaction entre le monde mental (psyché) et le monde physique (physis) qui ne sont pas vraiment séparés – ils ne le sont qu’en apparence. En fait, la psyché et la physis sont profondément interconnectées, car elles sont des aspects (ou des manifestations) complémentaires issus d’une base commune. On peut concevoir que cette base représente un niveau transcendant de l’esprit / conscience qui constitue le principe fondamental qui sous-tend l’ensemble de la réalité… » (p 33).
3° « L’esprit / volonté agit comme une force, c’est-à-dire qu’il peut impacter l’état du monde physique et agir de manière non locale. Cela implique qu’il n’est pas limité à des points spécifiques dans l’espace tels que les cerveaux et les corps, ni à des points spécifiques dans le temps comme le moment présent. Les preuves présentées dans ce chapitre de façon succincte indiquent également que les phénomènes mentaux exercent une influence sur le fonctionnement du cerveau et du corps ainsi que sur le comportement… » (p 34).
4° « Le cerveau agit comme un émetteur récepteur de l’activité mentale, c’est-à-dire que l’esprit fonctionne grâce au cerveau mais n’est pas produit par lui. Le fait que les fonctions mentales soient perturbées lorsque le cerveau est endommagé ne prouvent pas que l’esprit et la conscience soient produits par le cerveau… Dans l’idée que le cerveau puisse être une interface pour l’esprit, cet organe peut être comparé à un poste de télévision qui reçoit des signaux de diffusion et les convertit en images et en sons ». Si il est endommagé, il y a des perturbations dans la réception. « De même, une lésion dans une région spécifique du cerveau peut perturber les processus mentaux médiés par cette structure cérébrale, cependant cette perturbation n’implique pas que ces processus soient réductibles à l’activité neuronale dans cette région du cerveau » (p 34-35).
Pour une science post-matérialiste
Mario Beauregard a participé à la rédaction du manifeste pour une science post-matérialiste (2). Une bonne partie de son argumentation se retrouve dans ce manifeste. La perspective est vaste Elle s’inspire également de la révolution intervenue en physique dans le surgissement de la mécanique quantique : « A la fin du XIXe siècle, les physiciens découvrirent des phénomènes empiriques qui ne pouvaient être expliqués par la physique classique. Durant les années 1920 et au début des années 1930, cela a conduit au développement d’une nouvelle branche révolutionnaire de la physique, appelée : mécanique quantique. La mécanique quantique a mis en question les fondations matérielles de l’univers en montrant que les atomes et les particules subatomiques n’étaient pas des objets réellement solides – ils n’existent pas avec certitude à des emplacements spatiaux définis et à des moments définis. Plus important, la mécanique quantique a introduit notre esprit dans sa structure conceptuelle de base puisqu’il a été trouvé que les particules étant observées et l’observateur –le physicien et la méthode utilisée pour l’observation – sont liés. Suivant une interprétation de la mécanique quantique, ce phénomène implique que la conscience de l’observateur est décisive pour l’existence des évènements physiques observés et que les évènements mentaux peuvent affecter le monde physique. Les résultats d’expériences récentes soutiennent cette interprétation. Ces résultats suggèrent que le monde physique n’est plus la première ou la seule composante de la réalité et que celle-ci ne peut être pleinement comprise sans faire référence à l’esprit ». Le manifeste se poursuit en mettant l’accent sur l’influence que la pensée peut exercer sur le comportement et la santé. Et il poursuit l’argumentation apportée ici par Mario Beauregard. Au total, le manifeste proclame que l’adoption du paradigme post-matérialiste aura des effets bénéfiques pour l’ensemble de la civilisation humaine. C’est dans la même perspective que s’achève le chapitre de Mario Beauregard.
« Individuellement et collectivement, le paradigme post-matérialiste a des implications d’une portée considérable. Ce paradigme réenchante le monde et modifie profondément notre vision de nous-mêmes en nous rendant notre dignité et notre pouvoir en tant qu’êtres humains. Le paradigme post-matérialiste favorise également des valeurs positives telles que la compassion, le respect, la bienveillance, l’amour et la paix, car il nous fait prendre conscience que les frontières entre nous-mêmes et les autres sont perméables. Ce faisant, ce paradigme favorise une prise de conscience de la profonde interconnexion entre la nature et nous au sens large, y compris tous les niveaux d’organisation de l’univers. Ces niveaux peuvent englober des domaines non physiques et spirituels. A ce sujet, il convient de rappeler que le paradigme post-matérialiste reconnaît les expériences spirituelles qui se réfèrent à une dimension fondamentale de l’expérience humaine et qui sont fréquemment rapportées dans toutes les cultures… Et enfin, ce paradigme favorise également une prise de conscience concernant les questions environnementales et la nécessité de préserver notre biosphère, en mettant l’accent sur le lien profond qui nous unit à la nature » (p 35).
Une ouverture
Ce livre nous présente différentes approches du nouveau paradigme scientifique post-matérialiste. Dans sa présentation des phénomènes qui permettent d’envisager l’esprit au delà du cerveau, on constate l’universalité de ces phénomènes répandus dans toutes les cultures. Il en découle une universalité de la réalité spirituelle dont ils témoignent. Cette universalité peut embarrasser certains groupes religieux voulant s’approprier un monopole de « la vie après la vie ». En regard, un récent livre de la théologienne chrétienne Lytta Basset nous offre une approche inclusive dans son livre : « Cet Au-delà qui nous fait signe ». (5). Cette approche de l’Au-delà apparaît comme une révolution spirituelle. Le paradigme post-matérialiste nous présente une réalité interconnectée. Ainsi, « il existe une profonde interaction entre le monde mental et le monde physique qui ne sont pas vraiment séparés ». « La conscience apparaît comme un constituant fondamental de l’univers ». « Le nouveau paradigme favorise une prise de conscience de la profonde interconnexion entre la nature et nous, au sens large, y compris tous le niveaux d’organisation de l’univers » « C’est dans une perspective analogue que, selon le théologien Jürgen Moltmann, nous envisageons l’œuvre de Dieu dans la création (6). Ici, la création apparaît comme une « communauté dans laquelle toutes les créatures communiquent chacune à sa manière entre elles et avec Dieu ». Mario Beauregard envisage les incidences considérables de l’approche scientifique post-matérialiste sur notre culture. Sur le plan conceptuel, le matérialisme scientifique s’opposait à l’approche religieuse et à la perspective du salut. Ici cet obstacle est levé. « Le paradigme post-matérialiste reconnait les expériences spirituelles qui se réfèrent à un dimension fondamentale de l’expérience humaine ». Le nouveau paradigme « réenchante le monde ». C’est une perspective dans laquelle peut s’inscrire Michel Maxime Egger dans son livre : « Réenchanter notre relation au vivant » (7). Ce livre nous apporte une grande ouverture
J H
- Mario Beauregard, Gary R Schwartz, Natalie L Dyer, Marjorie Woollacott. La nouvelle science de la conscience. Visions d’un paradigme, post-matérialiste. Guy Trédaniel, 2021
- Manifesto for a post-materialist science : https://opensciences.org/files/pdfs/Manifesto-for-a-Post-Materialist-Science.pdf
- Mario Beauregard . Comment nos pensées influencent la réalité : https://vivreetesperer.com/comment-nos-pensees-influencent-la-realite/
- Potentiel de l’esprit humain et dynamique de la conscience : https://vivreetesperer.com/potentiel-de-lesprit-humain-et-dynamique-de-la-conscience/
- Une révolution spirituelle. Une nouvelle approche de l’Au-delà : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/
- Dieu dans la création : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
- Réenchanter notre relation au vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/
par jean | Juil 5, 2023 | ARTICLES, Vision et sens |
 Le mouvement de l’utopie
Le mouvement de l’utopie
Selon Jürgen Moltmann
Apparue dans les années 1960, la théologie de l’espérance de Jürgen Moltmann a répondu à une grande aspiration et suscité une dynamique qui s’est poursuivie à travers le temps (1). Cette dynamique se poursuit et garde toute son actualité comme en témoigne un petit livre publié chez Labor et Fides et intitulé : « Utopie » (2). Cet ouvrage reprend quelques textes fondateurs de Moltmann en les introduisant par un avant-propos de Marion Muller-Colard et en les accompagnant des éclairages de quelques théologiens. Nous présentons ici le premier des trois chapitres de Moltmann : « Utopie et pensée utopique ». La tonalité du chapitre nous apparaît dans cette profonde pensée : « La pensée espérante est la pensée des possibles » (p 17).
Du passé, du présent et du futur
Jürgen Moltmann nous appelle à réfléchir sur notre rapport avec le passé et avec le futur en passant par notre vécu du temps présent.
« La vie humaine est le temps de l’histoire. Elle est en tension entre le futur et le passé. Le futur est le domaine du possible, le passé, celui du réel ; quant au présent, c’est la ligne de front sur laquelle des possibilités peuvent être réalisées ».
Mais comment entrons-nous en rapport avec notre passé ? Comment notre mémoire s’exerce-t-elle et quel est son rôle ?
« Par le souvenir, nous rendons présentes les expériences passées, et par la mémoire, nous relions la réalité présente à la réalité passée » (p 13) ; Ainsi s’établit une « continuité rétrospective ». C’est la mémoire qui engendre également l’identité. « Aussi bien individuellement que collectivement, nous trouvons et confirmons notre identité grâce à une identification remémorant notre passé » (p 13). Notre ressenti de ces souvenirs peut être bien différent. Cependant, « ce passé peut influencer notre présent et notre futur, de telle façon que nous revenons toujours à ces évènements dont nous reconnaissons qu’ils font partie de notre histoire ».
Notre regard sur le futur est moins contraint. « Au regard de l’avenir, nous rendons présentes des expériences futures possibles par l’attente » (p 14). Là aussi, notre regard peut être différent. Ainsi la peur nous rend inquiet, mais peut-être aussi pré-voyant. « Nous devenons « pré-voyant » ». Autrement, « dans nos espoirs, nous anticipons également le futur et nous imaginons ce que serait le devenir des choses si nos désirs et nos attentes étaient exaucés. Par l’espérance, nous nous figurons un avenir désirable et concevons plans et projets pour le réaliser. Sans espoirs, ni plans, ni projets, nous passerions, aussi bien individuellement que collectivement, à coté de nos meilleures possibilités, pour la simple raison que nous ne les percevrions même pas » (p 15).
En mouvement
« Selon la forme que prend l’anticipation d’une expérience future possible, nous la nommons rêve, vision, utopie, projet ou planification ». C’est une ouverture. « Aux modes temporels du passé et du futur, correspondent les modes d’être du réel et du possible ». Certes, il n’est facile de prendre du large par rapport à des situations bien installées et à leurs effets, mais il y a des marges : « A la différence du passé, ces possibilités ne sont pas fixées ; en tant que possibilités futures, elles comportent toujours un facteur de hasard, de contingence, de surprise ou de déception.
« Pour l’expérience du présent comme tel, il est tout aussi important de se représenter un futur que de se souvenir du passé. Les attentes futures marquent l’expérience du présent autant que l’agir actuel… Qui envisage le futur avec sérénité y investira… Pour la vie dans l’histoire, l’orientation vers le futur est d’importance vitale. C’est la raison pour laquelle nous connaissons une grande variété de modalités selon lesquelles nous regardons vers le futur : de la peur à l’espoir, de l’attente à la planification » (p 16-17). Nous dépendons de cet horizon. « Si il ne se passe « rien de neuf sous le soleil, nous n’avons plus qu’à nous résigner ». Alors dans quelles conditions et comment pouvons nous embrasser l’espérance ? « Tant que les systèmes politiques et économiques dans lesquels nous vivons sont « des systèmes ouverts », l’espérance nous fait vivre. Dans des « systèmes clos », il ne reste que la mort. Notre espérance subjective dépend de l’ouverture du monde objectif pour lequel elle s’engage en prenant soin. La pensée espérante est une pensée des possibles » (p 17).
L’approche planificatrice
« Nous pratiquons la pensée des possibles par la planification et par l’utopie ». Jürgen Moltmann décrit et analyse l’activité planificatrice courante et parfois centrale dans nos sociétés. « Sous le terme de « planification », nous comprenons une disposition anticipante pour l’avenir. La croissance de la masse des possibilités dans la société scientifique et technique ainsi que le nombre croissant des changements sociaux en jeu rendent plus signifiante une planification à moyen et long terme, destinée à éviter « les mauvaises surprises » (p 17). On entend procéder à partir des causes et de leurs effets.
« Mais si des prévisions causales sont effectivement possibles pour des phénomènes isolés, elles ne peuvent être appliquées à des « systèmes ouverts » dont le futur est encore partiellement indéterminé. Pour intervenir dans les systèmes ouverts, on doit faire appel aux calculs des probabilités. Par ailleurs, « référées à des réalités plus complexes et à des possibilités multiples, les planifications se trouvent toujours dans un rapport dialectique avec l’histoire faite et vécue » (p 19). Elles interfèrent avec le cours des évènements.
La planification implique et engage un choix de valeurs. « D’année en année, nous sommes mieux équipés pour atteindre ce que nous voulons, mais que voulons-nous au juste ? Il n’existe pas de planification indépendante de choix de valeurs » (p 20).
La planification est mise en œuvre par ceux qui disposent du pouvoir de l’entreprendre. « Dans notre société, les planifications d’envergure présupposent le pouvoir économique et politique, et servent à élargir et consolider le pouvoir. Le futur doit être réalisé comme progrès du présent… Ces planifications sont au service d’une image du futur dégagée à partir des tendances et des faits, du statu quo. La mentalité planificatrice est de part en part articulée à la conservation du pouvoir. Elle ne perçoit pas le futur comme l’arrivée de nouvelles possibilités, mais comme la continuation du présent. Il ne s’agit pas de rendre réel le futur, mais d’étendre le présent » (p 20).
La pensée utopique
« Par le terme « utopie », nous désignons des images d’un avenir souhaitable qui n’a pas encore trouvé d’autres lieux de réalisation que les rêves ou les désirs des hommes ». Jürgen Moltmann évoque des œuvres écrites dans le passé et décrivant des sociétés imaginées idéales comme « La Cité de Dieu » de Saint Augustin, « l’Utopie » de Thomas More ; « L’Abbaye de Thélème » de François Rabelais, « La Cité du soleil » de Tommaso Campanelle. « On peut enfin dire que la « Réforme Radicale » vit foncièrement d’une pensée ou d’une quête utopique ». « Depuis la Révolution française et par delà les Lumières européennes, l’Utopie… apparaît dans le futur de l’histoire dans un avenir à accomplir » (p 21-22). Dans les criss actuelles, « la pensée utopique est devenue pertinente pour l’avenir, prenant la forme d’un rapport révolutionnaire au statu quo… On projette ses espoirs sur une vie dans l’avenir et on les confronte à un présent porteur de mort ou lourd d’aliénations. Les utopies du bonheur et de la liberté deviennent l’espoir d’avenir de ceux qui souffrent et sont prisonniers ; elles les mobilisent dans la réalisation de leurs buts » (p 22).
« On peut distinguer les buts réellement possibles et les facteurs d’espérance qui nécessairement les dépassent ». Jürgen Moltmann rappelle de grandes luttes où l’espérance a joué un grand rôle. « Sans le « rêve » de liberté et d’égalité, les noirs opprimés des Etats-Unis ne seraient pas descendus dans la rue avec le Mouvement pour les droits civiques de Martin Luther King. Sans le rêve d’une dignité propre, bien des peuples ne se seraient pas soulevés contre la dictature qui les opprimait, ni Nelson Mandela contre le régime d’apartheid de l’Afrique du Sud ».
Dans les Temps modernes européens, les utopies se sont mobilisées, soit pour l’égalité, soit pour la liberté, utopies socialistes ou utopies démocratiques. Mais l’un ne va pas sans l’autre. « Pas de liberté sans justice, pas de justice sans égalité » (p 24). Ainsi, l’utopie socialiste de l’Union soviétique s’est effondrée. Aujourd’hui, « l’utopie capitaliste de la marchandisation globale de toutes choses et de la démocratie libérale a pris sa place. Selon Francis Fukuyama, la société du marché global doit être « la fin de l’histoire ». Mais tant que le libre marché récompensera les forts et pénalisera les faibles, il y aura des utopies opposées qui maintiendrons vivante l’espérance du peuple. Car cette « utopie universelle du statu quo » n’est souhaitable que pour le premier monde. A long terme, elle détruit l’humanité et la planète » (p 25).
Le Royaume de Dieu : nouvel avenir de l’humanité
Jusqu’ici, ce sont des utopies partielles qui ont été présentées. « La forme ultime du désir humain a toujours été appelée le « Bien Suprême » et identifiée à une réalité totalement nouvelle qui supprimerait cette réalité temporelle infirme et endommagée. Ce furent les religions, et, parmi elles, avant tout les religions d’espérance abrahamiques – judaïsme, christianisme, islam – qui attendent de l’avenir de l’histoire cette alternative totale ». Là où il y a espérance, elle tient lieu de religion, et la vérité de la religion est la lumière de cette utopie alternative et totale, « espérance en finalité et totalité » (p 25).
Au chapitre suivant, Jürgen Molmann abordera la pensée eschatologique. En christianisme, le Royaume de Dieu est une réalité primordiale. « L’utopie totale du « Royaume de Dieu » n’apporte pas un nouvel avenir historiquement situé, mais un nouvel avenir de l’histoire toute entière. Avec lui prend fin le temps historique et s’ouvre l’éternité. C’est pourquoi, dans ce « Royaume de Dieu », non seulement prennent fin famine et esclavage, mais avec eux disparaît tout le « schème » de ce monde à l’envers : péché, mort et diable ». (p 26). Cette nouvelle réalité est appelée à s’étendre au monde entier. « Cet accomplissement n’est pas seulement attendu par le monde humain n’ayant pas encore été racheté, mais également par « la création gémissant dans les douleurs de l’enfantement » (Rom 8.19). Il figure le dépassement de toute détresse et l’exaucement de tous les désirs. Puisque tout agir humain produit de nouvelles détresses, cette utopie totale a été liée à l’expérience religieuse et rapportée à la présence de la transcendance, c’est-à-dire à Dieu » (p 26-27).
Dans un avant-propos, l’écrivaine et théologienne protestante Marion Muller-Colard nous dit « l’actualité » du texte de Jürgen Moltmann qui date pourtant des années 1990 (p 7). Avec elle, nous pouvons considérer l’utopie en terme de « dynamique » et « c’est dans cette perspective que Jürgen Moltmann nous offre une perspective inspirante ». Nous retrouvons ici quelques paroles décisives de Moltmann comme : « Pour la vie dans l’histoire, l’orientation vers le futur est d’importance capitale ». Et, dans cette démarche, elle aussi reprend l’affirmation : « La pensée espérante est la pensée des possibles » (p 8).
J H
- Quelle vision de Dieu, du monde et de l’humanité en phase avec les aspirations et les questionnements de notre époque ? : https://vivreetesperer.com/quelle-vision-de-dieu-du-monde-de-lhumanite-en-phase-avec-les-aspirations-et-les-questionnements-de-notre-epoque/
- Jürgen Moltmann. L’Utopie. Avant-propos de Marion Muller-Colard. Labor et Fides, 2023 (Dossier de l’encyclopédie du protestantisme N° 10)