par jean | Oct 21, 2012 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |
Choisir l’espérance, c’est choisir la vie.
Jean-Claude Guillebaud : Une autre vie est possible.
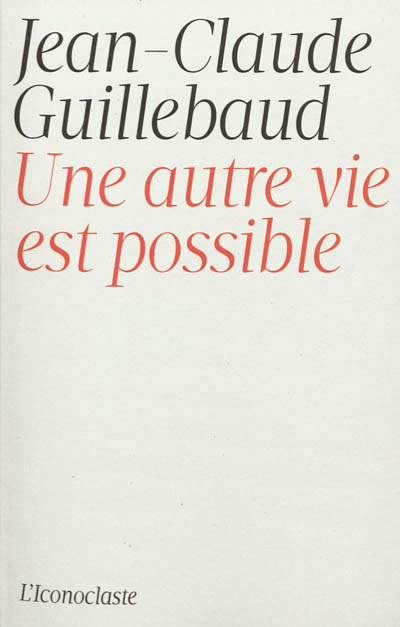 L’histoire du XXè siècle a été marquée par de grandes hécatombes qui assombrissent notre mémoire. La croyance au progrès s’est dissoute. Si, malgré les aléas, le développement économique a été sensible et a changé les conditions de vie, aujourd’hui la crise de l’économie associée à la montée des inégalités engendre inquiétude et pessimisme. Cette insécurité est accrue par une perte des points de repère, parce que les croyances religieuses d’autrefois ont besoin d’être reformulées dans les termes d’une culture nouvelle. Alors, on assiste aujourd’hui à des phénomènes de repli tant sur le plan individuel que collectif. Puisque l’avenir collectif paraît bouché, on recherche des accommodements individuels ou on se réfugie dans des satisfactions immédiates. Ces notations correspondent à ce que nous pouvons observer dans certains comportements et dans certaines expressions. Certes, il y a en regard d’autres représentations et d’autres comportements. Il n’empêche, face à l’inquiétude dominante, face à la morosité ambiante, on a besoin d’une vision. Car, comme le dit si bien un verset biblique : « Là où il n’y a pas de vision, le peuple périt » (Proverbes 29. 18). Alors on peut saluer la publication récente d’un livre de Jean-Claude Guillebaud : « Une autre vie est possible » (1). Et le sous-titre en précise le sens : « Comment retrouver l’espérance ? ».
L’histoire du XXè siècle a été marquée par de grandes hécatombes qui assombrissent notre mémoire. La croyance au progrès s’est dissoute. Si, malgré les aléas, le développement économique a été sensible et a changé les conditions de vie, aujourd’hui la crise de l’économie associée à la montée des inégalités engendre inquiétude et pessimisme. Cette insécurité est accrue par une perte des points de repère, parce que les croyances religieuses d’autrefois ont besoin d’être reformulées dans les termes d’une culture nouvelle. Alors, on assiste aujourd’hui à des phénomènes de repli tant sur le plan individuel que collectif. Puisque l’avenir collectif paraît bouché, on recherche des accommodements individuels ou on se réfugie dans des satisfactions immédiates. Ces notations correspondent à ce que nous pouvons observer dans certains comportements et dans certaines expressions. Certes, il y a en regard d’autres représentations et d’autres comportements. Il n’empêche, face à l’inquiétude dominante, face à la morosité ambiante, on a besoin d’une vision. Car, comme le dit si bien un verset biblique : « Là où il n’y a pas de vision, le peuple périt » (Proverbes 29. 18). Alors on peut saluer la publication récente d’un livre de Jean-Claude Guillebaud : « Une autre vie est possible » (1). Et le sous-titre en précise le sens : « Comment retrouver l’espérance ? ».
Cet auteur-là a une histoire de vie qui légitime ses propos. En effet, grand reporter au « Monde », il y a couvert de grands conflits. Dans ce métier, il a été confronté à la réalité de la misère humaine dans des catastrophes collectives. « Du Biafra (1969) à la Bosnie (1994), j’ai vu mourir et s’entretuer des hommes » (p 22). Son discours n’est pas abstrait. A partir de cette expérience, il sait ce dont il parle en terme de vécu humain. Jean-Claude Guillebaud est ensuite devenu éditeur au Seuil dans le domaine des sciences humaines. Et, là, il a découvert des clefs pour comprendre le changement social et culturel qui caractérise le monde d’aujourd’hui. Ainsi a-t-il pu fréquenter de grands penseurs engagés dans une réflexion transdisciplinaire et convaincus de l’imminence d’une mutation anthropologique : Edgar Morin, Henri Atlan, Michel Serres…(2). Jean-Claude Guillebaud a lui-même écrit de nombreux livres où il explore les grands enjeux sociaux et culturels de notre temps (3). Dans ses ouvrages, l’auteur fonde sa réflexion à la fois sur des savoirs recueillis en recourant à des sources variées et une recherche de sens qui s’est développée tout au long de cet itinéraire et a abouti à une redécouverte de la foi chrétienne (4).
Mais si Jean-Claude Guillebaud écrit beaucoup, c’est aussi un homme qui, dans la foulée de sa carrière de journaliste, continue à aller à la rencontre des gens à travers de multiples réunions et conférences. Et, de par cette capacité de dialogue, il est particulièrement attentif à ce qu’il entend, à ce qu’il perçoit de l’opinion ambiante. Et aujourd’hui, il écrit ce livre : « Une autre vie est possible » pour affirmer une espérance face à un pessimisme qui lui paraît omniprésent. « J’aimerais trouver des mots, le ton, la force afin de dire pourquoi m’afflige décidément la désespérance contemporaine. Elle est un gaz toxique que nous respirons chaque jour. Et, depuis longtemps, l’Europe en général et la France en particulier semblent devenues ses patries d’adoption. Elle est amplifiée, mécaniquement colportée par le barnum médiatique… L’optimisme n’est plus tendance depuis longtemps. On lui préfère le catastrophisme déclamatoire ou la dérision revenue de tout, ce qui est la même chose. Se réfugier dans la raillerie revient à capituler en essayant de sauver la face. Après moi, le déluge… » (p 13-14).
Quelles sont les origines de ce pessimisme ? Quelles sont nos raisons d’espérer ? Jean-Claude Guillebaud explore pour nous et avec nous les voies de l’espérance.
Jean Hassenforder
A suivre :
Quel avenir pour le monde et pour la France ? / 2 : La montée du pessimisme et de la négativité.
Quel avenir pour le monde et pour la France ? / 3 : Des raisons d’espérer.
(1) Guillebaud (Jean-Claude). Une autre vie est possible. Comment retrouver l’espérance. L’iconoclaste, 2012.
(2) Présentation de Jean-Claude Guillebaud et de son itinéraire : Karih Tager (Djénane) ; Jean-Claude Guillebaud. Le messager. Le Monde des religions, N° 13, sept-oct 2005, p 68-69.
(3) Bien documentés, bien argumentés, porteurs de conviction, les livres de Jean-Claude Guillebaud abordent de grandes questions et de grands enjeux. Notons, entre autres : « La refondation du monde » (1999), « Le principe d’humanité » (2001), « le goût de l’avenir » (2004)… Nous avons présenté, sur le site de Témoins : « la force de conviction. A quoi pouvons nous croire ? » (2005) http://www.temoins.com/publications/la-force-de-conviction.html et: « Le commencement d’un monde. Vers une modernité métisse » (2008) http://www.temoins.com/societe/vers-une-modernite-metisse-le-commencement-d-un-monde-selon-jean-claude-guillebaud./toutes-les-pages.html
(4) Guillebaud (Jean-Claude). Comment je suis redevenu chrétien ? Albin Michel, 2009. Sur le site de Témoins : Les valeurs fondamentales. Une inspiration chrétienne. Contributions de Frédéric Lenoir, Joseph Moingt, Jean-Claude Guillebaud. http://www.temoins.com/etudes/les-valeurs-fondamentales-selon-frederic-lenoir.html
par jean | Déc 27, 2011 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
Participer aux forces qui circulent et construisent dans le mouvement de la vie, c’est aussi refuser l’isolement et le repli sur soi. En terme spirituel, c’est participer à l’œuvre de l’Esprit qui donne vie (1). De plus en plus, cette conscience se répand, et, pourtant, nous savons par expérience les obstacles que nous ressentons. Il y a en nous de mauvais plis hérités du passé qui limitent et encombrent nos psychismes. Cependant, Dieu, en Christ et dans l’Esprit, vient à nous comme Celui qui aime, donne et libère, en nous a ppelant à participer à la vie divine. Cette inspiration se répand à travers des relations humaines. Mais, là aussi, des représentations héritées du passé peuvent faire obstacle : dogmatisme, légalisme, volontarisme. C’est comme si un cadre plus ou moins contraignant nous était imposé d’en haut. Cette attitude est bien illustrée par une formule présente dans des catéchismes anciens : « Les vérités à croire. Les commandements à pratiquer ». Mais, sous d’autres formes et dans différents milieux, on peut rencontrer aujourd’hui cet état d’esprit.
Odile Hassenforder, dans le livre : « Sa présence dans ma vie » (2), rapporte son expérience. Parce qu’un jour, elle a reçu le don de Dieu dans sa plénitude, elle a poursuivi son existence dans l’accueil de l’Esprit. Aussi, en regard des rigidités qu’elle a pu rencontrer, elle sait nous communiquer son élan intérieur et nos aider à accueillir et recevoir la vie divine. Ce message transparaît dans plusieurs chapitres de son livre. Voici quelques extraits significatifs.
Ce désir au fond de moi
« Ce désir au fond de moi d’être imprégné de la vie divine est suscité par l’Esprit. Donc, j’ai à accueillir son œuvre en moi et ensuite, à donner mon accord pour qu’il me rende capable du vouloir, puis du faire, vis-à-vis des actes qui lui plaisent. C’est très différent que de me forcer, de rassembler ma volonté pour agir… (p 119)
Accueillir l’œuvre de Christ en moi.
« J’entend souvent : « Il faut », Je dois », c’est à dire par mes propres forces. Dans la conversion, il y a certes une décision de notre part, c’est vrai pour toute chose, mais nous ne pouvons décider d’agir comme Jésus si nous n’en avons pas la grâce. Notre attitude juste est celle de l’accueil de l’œuvre de Jésus en nous, décision qu’elle se fasse en nous par l’Esprit, dans l’espérance, dans notre marche vers… La mort de Jésus a été la conséquence du refus humain à la vie divine. Le mal perd son pouvoir dans la résurrection qui donne la vie. A nous d’accueillir l’œuvre de Christ en nous en prenant conscience qu’il demeure en nous et en décidant de demeurer en Lui. Jésus n’est pas extérieur à nous comme un modèle à suivre, mais il demeure en nous » (p 121).
Nous sommes le plaisir de Dieu
Je me rend compte que nous sommes le plaisir de Dieu… La création est un acte d’amour qui éclate de Dieu : Père, Fils et Esprit pour partager, donner, dialoguer… Dieu prend plaisir à créer, à recréer ce qui est endommagé… Dieu aime toute sa création d’un amour identique pour chacun… Alors ! Dieu est d’autant plus content lorsque nous recevons (p 90).
Libres paroles sur la venue du Dalaï Lama à Paris.
« Ce succès montre la soif de spiritualité de nos contemporains : soif de paix, de tolérance, d’amour….
Et nous chrétiens, qu’avons-nous à apporter ? Nous parlons aussi d’amour. Je ne me crois pas meilleure que les autres. Depuis le jour où Dieu s’est révélé à moi à travers une prière exaucée et où j’ai découvert que je recevais de lui, paix et plénitude, je suis entré dans un univers spirituel, une nouvelle dimension. Dans la relation avec Dieu, en Jésus-Christ, je suis assuré de sa sollicitude jusque dans l’éternité… Je vois la présence de Dieu à l’œuvre aujourd’hui. Au milieu de l’ivraie, tout le négatif que nous rabâche les médias, je vois aussi le blé qui porte du fruit… » (p199).
« Dieu fait pour nous des projets de bonheur et non de malheur » (Jérémie 29.11). C’est bien dans cet esprit que nous sommes appelés à vivre. Entraidons-nous pour accueillir la Vie dans nos vies .
JH
(1) Voir le site : www.lespritquidonnelavie.com
Hassenforder (Odile). Sa présence dans ma vie. Empreinte, 2011. Site : www.editions-empreinte.com Présentation sur le site de Témoins accompagnée de commentaires et de témoignages : « Sa présence dans ma vie » http://www.temoins.com/evenements-et-actualites/sa-presence-dans-ma-vie.html
par jean | Jan 17, 2016 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |
La création de la « Chan Zuckerberg Initiative »
Dans un monde où les menaces abondent, ne perdons pas confiance. Sachons reconnaître les évolutions positives et les promesses d’avenir dans une multitude de signes encore peu visibles. C’est regarder au bien plutôt qu’au mal. C’est accepter des nouveautés, des surprises. C’est aller au delà de nos conventions et de nos habitudes de pensée, et parfois à l’encontre d’une pensée dominante dans certains cercles. Ce préalable est-il nécessaire pour saluer la toute récente création de la « Chan Zuckerberg Initiative » par Mark Zuckerberg, inventeur et directeur de Facebook et son épouse, Priscilla Chan à l’occasion de la naissance de leur fille Max ?
Peut-être parce que des esprits chagrins peuvent voir là une manifestation spectaculaire de la richesse… Il est vrai qu’actuellement les inégalités se creusent en fonction d’un capitalisme non régulé. Mais, les choses étant ce qu’elles sont, il y a toute la différence entre un riche patron qui thésaurise et celui qui met une fortune au service des gens.
Ainsi, le 1er décembre 2015, Mark Zuckerberg annonçait la création, avec son épouse Priscilla Chan, de la « Chan Zuckerberg Initiative » (CZI) (1). Cette organisation caritative sera à terme dotée de 99% des actions de Facebook détenues par le couple, soit une somme estimée aujourd’hui à 45 milliard de dollars (42 milliards d’euros). Elle a pour ambition de « faire avancer le potentiel humain et de promouvoir l’égalité » avec un intérêt majeur pour l’enfance et l’éducation.
Pourquoi évoquer ici une initiative, qui, dans le contexte français, peut paraître lointaine, décalée, voire suspecte ? Parce que justement elle s’inscrit dans les signes positifs qui apparaissent dans un monde en pleine transformation. Dans une recherche commune, sachons reconnaître les avant-garde où qu’elles soient.
Et, dans ce cas, le berceau des nouvelles technologies de la communication, la « Silicone valley » est en train d’engendrer une nouvelle philanthropie, qui, ici, tient ses ressources du talent et du travail de ses promoteurs. Et, à l’exemple de la fondation Bill Gates, on peut voir là un outil puissant, parce que souple et efficace, pour promouvoir des pratiques au service de la vie.
Et puis, dans cette initiative, il y aussi une dimension émotionnelle qui nous touche profondément. Un jeune couple et la naissance de sa petite fille. Ce n’est pas rien qu’à l’occasion de cette naissance, les parents choisissent d’engager leur vie au service de l’humanité. Dans ces circonstances, ce geste donateur de parents fortunés nous rappelle certains contes d’autrefois. Mais, dans ce cas, la vision d’avenir n’est pas la poursuite d’une dynastie régnant sur un peuple, mais un engagement au service du progrès de l’humanité.
Cet événement advient dans un pays qui est devenu un creuset de toutes les populations du monde. Priscilla Chan est fille de parents sino-vietnamiens arrivés aux Etats-Unis après la chute de Saigon en 1978 (2). Et elle a fait de brillantes études médicales. Aujourd’hui, à 30 ans, elle est créatrice et directrice d’une école privée à but non lucratif qui se propose d’offrir à des élèves de condition modeste, un enseignement ainsi qu’un suivi de santé, jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Facebook, l’œuvre de Mark Zuckerberg s’inscrit dans le processus actuel de globalisation. Nous sommes là au cœur d’une dynamique internationale.
Ainsi, la création de cette nouvelle organisation humanitaire nous apparaît à la fois comme un événement symbolique et une promesse d’avenir.
Pour annoncer leur engagement, Mark Zuckenberg et Priscilla Cham publient une lettre dans laquelle ils s’adressent à la petite fille qui vient de naitre : « Lettre à notre fille » (3).
« Ta mère et moi, nous n’avons pas encore les mots pour décrire l’espoir que tu nous donnes pour l’avenir. Ta vie nouvelle est pleine de promesses et nous espérons que tu seras heureuse et en bonne santé pour pouvoir explorer cet avenir. Tu nous donnes déjà une raison pour réfléchir au monde dans lequel nous espérons que tu vas vivre. Alors que les grands titres de la presse se concentrent sur ce qui mal, de bien des manières, ce monde est en train d’aller mieux. La santé s’améliore. La pauvreté recule. Le savoir grandit. Les gens se connectent. Dans chaque domaine, le progrès des technologies implique que ta vie devrait être bien meilleure que la notre aujourd’hui ».
Cette lettre se caractérise par un parti pris d’optimisme. Les auteurs attendent de nouvelles découvertes scientifiques et techniques à même de changer les conditions de vie. On peut s’interroger, mais ils sont certainement bien placés pour apprécier le potentiel qui se développe actuellement. Ainsi, il nous est dit que l’ouverture d’un accès à internet a des conséquences remarquables en terme de condition de vie et d’emploi. Or, plus de la moitié de la population mondiale n’a pas encore accès à internet. La progression de cet outil devrait permettre à des centaines de millions de personnes de sortir de leur enfermement. « Notre espoir pour cette génération se concentre sur deux idées : faire progresser le potentiel humain et promouvoir l’égalité »

Dans une perspective optimiste, Mark et Priscilla manifestent une grande confiance dans les progrès de la médecine. Et ils préconisent des investissements massifs dans ce domaine. Cependant, Mark et Priscilla décrivent la mise en œuvre d’une dynamique de progrès dans tous les domaines qui régissent les conditions de vie. C’est le cas en particulier dans le domaine de l’enseignement.
« Notre génération a grandi dans des classes où nous apprenions tous la même chose à la même vitesse sans tenir compte des intérêts et des dons de chacun. Votre génération traduira en objectifs ce que vous désirerez devenir : ingénieur, professionnels de santé, écrivain, leader de communauté…Vous aurez la technologie qui comprendra comment vous pouvez le mieux apprendre et sur quoi vous avez besoin de vous concentrer…Dans le monde entier, les étudiants auront accès à travers internet à des aides d’apprentissage personnalisé… ». C’est une vision mobilisatrice. « Nous ferons tout pour que cela arrive non seulement parce que nous t’aimons, mais parce que nous avons une responsabilité morale envers tous les enfants de la prochaine génération ».
En considérant le monde d’aujourd’hui,, nous y voyons bien des malheurs, guerres, maladies, famines. Des politiques essaient d’y faire face. Des organisations humanitaires se confrontent à ces souffrances pour essayer d’en limiter l’impact. Cependant, nous devons prendre en compte les différents aspects de la réalité non seulement dans le court terme, mais aussi dans le long terme. Dans la durée, sur certains points, on peut observer des améliorations sensibles. Dans le paysage actuel, il y a bien des orages, bien des nuages, mais aussi des ciels plus lumineux. Sachons apprécier les lumières qui apparaissent et rendent le monde meilleur. Bienvenue à la « Chan Zuckerberg Initiative ».
J H
(1) « Mark Zuckerberg, symbole d’une nouvelle génération de philanthropes ». Sur le site du « Monde », propos recueillis par Morgane Tual auprès d’Antoine Vaccario, président du Centre d’étude et de recherche sur la philanthropie. Un éclairage bien informé et inscrivant le phénomène dans sa dimension historique et culturelle. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/12/03/mark-zuckerberg-symbole-d-une-nouvelle-generation-de-philanthropes_4823502_4408996.html
(2) « Qui est Priscilla Chan, l’épouse de Mark Zuckerberg ? » : http://www.lexpress.fr/styles/vip/qui-est-priscilla-chan-l-epouse-de-mark-zuckerberg_1741830.html
(3) « A letter to our daughter » : https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-letter-to-our-daughter/10153375081581634
(4) Sur ce blog : « Une révolution en éducation. L’impact d’internet pour un nouveau paradigme en éducation » : https://vivreetesperer.com/?p=1565 « Sugata Mitra : un avenir pédagogique prometteur à partir d’une expérience d’autoapprentissage d’enfants indiens en contact avec un ordinateur » : https://vivreetesperer.com/?p=2165
par jean | Juil 25, 2012 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
Le bonheur, est-ce bien pour nous ? Et si nous étions happés dans la spirale de nos maux intérieurs, nos agressivités retournées contre nous-mêmes qui donnent de la voix ? Et si les grands massacres qui hantent l’histoire étaient le dernier mot, une mémoire interminable, irrémédiable ? (1) Mais alors, nous livrons à la mort la clé de nos vies. En regard, il existe bien un autre horizon. Dans une perspective chrétienne, Dieu intervient pour nous proposer une dynamique de vie. Cela implique un choix : « J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité » (Deutéronome 30.19). Et Dieu nous invite à entrer dans des projets de bonheur et non de malheur (Jérémie 29.11).
Alors, dans quel état d’esprit sommes-nous lorsque nous considérons la vie dans laquelle nous sommes engagés ? Les découvertes de la psychologie nous ont appris que nos représentations influaient sur nos comportements et toute notre personnalité (2). De même, nous sommes influencés par l’environnement dans lequel nous évoluons et avec lequel nous vivons en interaction. Quel va être notre regard ?
Une approche pionnière.
Il y déjà plusieurs décennies, la journaliste Marcelle Auclair a ouvert pour nous la voie nouvelle d’un savoir-être et d’un savoir-faire qui reste aujourd’hui étonnamment actuelle et pertinente. Elle a su allier une inspiration spirituelle chrétienne et une attitude innovante dans un contexte où commençait à émerger un nouveau genre de vie qu’elle était bien placée pour apprécier puisqu’à « Marie Claire », elle a été une pionnière du journalisme féminin. C’est une place de choix pour observer et pour parler. Ainsi va-t-elle écrire deux livres : « Le bonheur est en vous » et « La pratique du bonheur » qui sont aujourd’hui rassemblés dans un ouvrage publié au Seuil : « Le livre du bonheur ».
Ce sont des écrits qui anticipent la dimension holistique avec laquelle nous sommes aujourd’hui plus familiers. Ce sont des textes qui prennent appui sur des exemples concrets pour énoncer des principes de vie et proposer leur mise en oeuvre à travers des attitudes pratiques. Et, déjà, nous sommes en présence d’une approche spirituelle qui n’impose pas une doctrine religieuse et respecte les cheminements de chacun.
Bien penser pour bien vivre.
Voici donc quelques aperçus empruntés aux premiers chapitres. On pourra ensuite poursuivre la réflexion à travers la lecture de l’ouvrage.
En premier, Marcelle Auclair met l’accent sur « une loi essentielle : la pensée crée. La parole crée »… « La pensée, la parole, la lumière de même que le son forment des vibrations toutes puissantes » (p. 11). Nos habitudes de pensées ou de paroles positives ou négatives ont donc des conséquences. « Branchez-vous sur les ondes du bonheur », nous dit Marcelle Auclair.
Et si la pensée crée, elle a aussi un pouvoir d’attraction : « Qu’est-ce que la loi d’attraction ? C’est la loi d’amour… Les vibrations identiques s’attirent, s’unissent et se renforcent mutuellement ». Ce n’est pas un vain mot de dire d’un idéal, d’un sentiment qu’ils sont « élevés » ou qu’ils sont « bas ». Le langage traduit exactement la vérité : une pensée d’espoir, d’amour dégagée de tout égoïsme… crée en nous des vibrations hautes qui se joignent à toutes les vibrations analogues et forment avec elles une émission puissante… Eprouvons-nous une « dépression ». Nos vibrations s’abaissent et rien d’heureux, d’harmonieux ne se trouve plus dans notre champ d’attraction. »
« Les croyants ont une façon souveraine de hausser les vibrations défaillantes : la prière, l’appel à un Dieu de bonté, l’abandon à sa volonté qui est joie et abondance… » (p.15)
Non seulement, la parole a des conséquences et en quelque sorte « crée », mais il existe également une « force créatrice à notre usage ». Ne nous épuisons donc pas dans une œuvre purement volontaire. Apprenons à recevoir (p.39). L’auteure nous parle du « guide intérieur » évoqué par Marc Aurèle, un empereur romain philosophe, mais non croyant. C’est une belle expression, qui, pour les chrétiens, évoque le Saint Esprit. « Prier, ce n’est pas émouvoir une divinité plus ou moins hautaine ou sévère… C’est nous disposer, nous, à recevoir ce qui nous revient du flot inépuisable de l’abondance suprême. Il n’y a rien de surnaturel, c’est la loi. » (p.30) (3)
Avec Marcelle Auclair, nous entrons dans un état d’esprit. Partageons ensemble nos questions et nos expériences à ce sujet.
JH
(1) Sur cette question, Jürgen Moltmann nous apporte un éclairage libérateur ; Voir : « Délivre-nous du mal » sur le site : www.lespritquidonnelavie.com
(2) L’influence de l’esprit humain sur le corps est remarquablement mise en évidence par Thierry Janssen dans un livre particulièrement innovant puisqu’à partir d’un bilan de la recherche, incluant l’apport des grandes civilisations de l’Asie, il présente les bases d’une nouvelle médecine du corps et de l’esprit. Nous reviendrons sur cette nouvelle approche, celle notamment de la médecine de terrain trop méconnue en France. Le livre (Janssen (Thierry) La solution intérieure. Fayard, 2006) est présenté dans un article paru sur le site de Témoins : « Vers une nouvelle médecine du corps et de l’esprit » http://www.temoins.com/developpement-personnel/vers-une-nouvelle-medecine-du-corps-et-de-l-esprit.guerir-autrement.html
« Méditer avec Marcelle Auclair ». Site de Témoins (Ressourcement) http://www.temoins.com/ressourcement/mediter-avec-marcelle-auclair-le-bonheur-cest-possible.html
par jean | Jan 25, 2013 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
Admirer, m’émerveiller, adorer c’est gratuit !
Propos d’Odile Hassenforder
dans son livre : Sa présence dans ma vie.
Dans son livre : « Sa présence dans ma vie ? », (1) Odile Hassenforder nous rapporte une dynamique de vie qu’elle puise en Dieu et qui la porte jusque dans l’épreuve de la maladie. Dans ce mouvement, elle reçoit la vie comme un don, un cadeau. Et elle entre naturellement dans une attitude d’émerveillement et d’adoration. C’est une attitude profondément ancrée dans les différents moments de la vie quotidienne, comme celui-ci marqué par une grande fragilité.
« Je me sentais si bien hier. Pourquoi ce vague à l’âme au réveil ce matin ? Un retour de bâton ? Je me sens vide, pas d’envie, pas d’énergie, inutile… Je sens, par expérience, qu’il n’est pas bon de ruminer ainsi.
Du fond de mon lit, je regarde par la fenêtre le ciel, l’arbre qui gigote, et ma pensée s’envole vers des souvenirs. Des paysages défilent à toute allure avec des sensations de plaisir. Que c’est beau ! Que c’est bon ! Le créateur me donne cela gratuitement. C’est gratuit, oui, gratuit. C’est pour moi. Je n’ai qu’à prendre. Et ce don, ce cadeau vient humecter mon cœur comme une douce pluie bienfaisante dans mon désert.
Une sensation de contentement m’envahit. Je respire doucement, profondément avec délice… Le balancier de mon cœur se débloque et trouve peu à peu le mouvement calme et régulier du rythme de mon cœur. J’accueille cette paix imprégnée de sécurité, une joie d’exister reliée au créateur m’est donnée.
Que c’est bon d’exister pour admirer, m’émerveiller, adorer ! C’est gratuit. Je n’ai qu’à recevoir, en profiter sans culpabilité sans besoin de me justifier. (Justifier quoi ? de vivre ?)
D’un sentiment de reconnaissance, jaillit une louange joyeuse, une adoration au créateur de l’univers dont je fais partie, au Dieu qui veut le bonheur de ses créatures. Alors mon « ego » n’est plus au centre de ma vie. Il tient tout simplement sa place relié à un « tout », sans prétention ( Psaume 131). Je respire le courant de la vie qui me traverse et poursuit son chemin.
Comme il est écrit dans un psaume : « Cette journée est pour moi un sujet de joie… Une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel auprès de toi, mon Dieu… Louez l’Eternel car il est bon. Son amour est infini. » (Psaume 16.118..)
La vie est vraiment trop belle pour être triste. Alleluia ! »
Odile Hassenforder
(1) Hassenforder (Odile). Sa présence dans ma vie . Parcours spirituel. Empreinte, 2011. Le texte ci-dessus est paru dans ce livre : p. 179-180. Rédigé par Odile dans les derniers mois précédant son départ de la vie terrestre, il a également été mis en ligne très tôt, en mars 2009, sur le site : relation-aide.com http://www.relation-aide.com/forum/viewtopic.php?t=4285&view=previous&sid=86e477ecc0372fe31b050dbbb5864aae . Une présentation de « Sa présence dans ma vie » sur le site de Témoins : http://www.temoins.com/evenements-et-actualites/sa-presence-dans-ma-vie.html. On trouvera sur ce blog plusieurs textes présentant la pensée d’Odile : https://vivreetesperer.com/?tag=odile-hassenforder
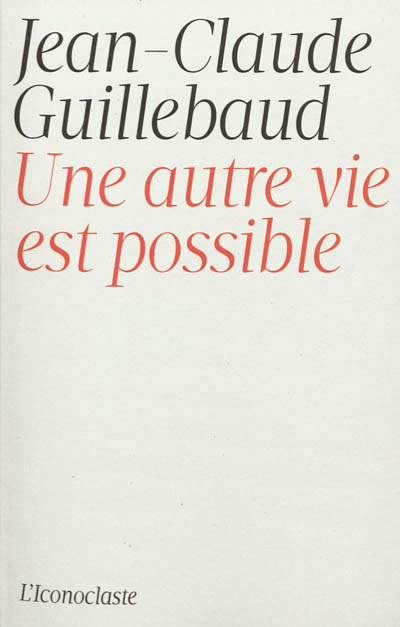 L’histoire du XXè siècle a été marquée par de grandes hécatombes qui assombrissent notre mémoire. La croyance au progrès s’est dissoute. Si, malgré les aléas, le développement économique a été sensible et a changé les conditions de vie, aujourd’hui la crise de l’économie associée à la montée des inégalités engendre inquiétude et pessimisme. Cette insécurité est accrue par une perte des points de repère, parce que les croyances religieuses d’autrefois ont besoin d’être reformulées dans les termes d’une culture nouvelle. Alors, on assiste aujourd’hui à des phénomènes de repli tant sur le plan individuel que collectif. Puisque l’avenir collectif paraît bouché, on recherche des accommodements individuels ou on se réfugie dans des satisfactions immédiates. Ces notations correspondent à ce que nous pouvons observer dans certains comportements et dans certaines expressions. Certes, il y a en regard d’autres représentations et d’autres comportements. Il n’empêche, face à l’inquiétude dominante, face à la morosité ambiante, on a besoin d’une vision. Car, comme le dit si bien un verset biblique : « Là où il n’y a pas de vision, le peuple périt » (Proverbes 29. 18). Alors on peut saluer la publication récente d’un livre de Jean-Claude Guillebaud : « Une autre vie est possible » (1). Et le sous-titre en précise le sens : « Comment retrouver l’espérance ? ».
L’histoire du XXè siècle a été marquée par de grandes hécatombes qui assombrissent notre mémoire. La croyance au progrès s’est dissoute. Si, malgré les aléas, le développement économique a été sensible et a changé les conditions de vie, aujourd’hui la crise de l’économie associée à la montée des inégalités engendre inquiétude et pessimisme. Cette insécurité est accrue par une perte des points de repère, parce que les croyances religieuses d’autrefois ont besoin d’être reformulées dans les termes d’une culture nouvelle. Alors, on assiste aujourd’hui à des phénomènes de repli tant sur le plan individuel que collectif. Puisque l’avenir collectif paraît bouché, on recherche des accommodements individuels ou on se réfugie dans des satisfactions immédiates. Ces notations correspondent à ce que nous pouvons observer dans certains comportements et dans certaines expressions. Certes, il y a en regard d’autres représentations et d’autres comportements. Il n’empêche, face à l’inquiétude dominante, face à la morosité ambiante, on a besoin d’une vision. Car, comme le dit si bien un verset biblique : « Là où il n’y a pas de vision, le peuple périt » (Proverbes 29. 18). Alors on peut saluer la publication récente d’un livre de Jean-Claude Guillebaud : « Une autre vie est possible » (1). Et le sous-titre en précise le sens : « Comment retrouver l’espérance ? ».
