par jean | Jan 1, 2023 | Emergence écologique |
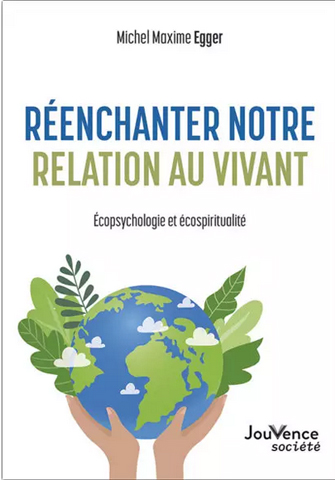 Avec Michel Maxime Egger
Avec Michel Maxime Egger
Sociologue et écothéologien, Michel Maxime Egger œuvre activement pour la transition écologique. Ainsi, a t-il fondé un Laboratoire de transition intérieure porté par deux ONG suisses. Ses livres jalonnent une prise de conscience psychologique et spirituelle. Nous avons déjà présenté un de ses livres, très dense, sur l’écospiritualité (1). Il a préfacé un livre de Joanna Macy, une grande écologiste américaine : « L’espérance en mouvement » (2). Dans ses interventions, il nous appelle à une vision spirituelle de l’écologie (3). Michel Maxime Egger vient de publier un nouveau livre : « Réenchanter notre relation au vivant. Ecopsychologie et écospiritualité » (4). Nous apprécions dans cet ouvrage les mêmes qualités que précédemment : accessibilité, richesse encyclopédique de l’information, vision théologique dynamique.
« Dans quel monde aspirons-nous à vivre ? Les dérèglements écologiques et climatiques nous préoccupent-ils ? Cet ouvrage nous propose de nouvelles approches pour réharmoniser les relations avec la toile du vivant : l’écopsychologie et l’écospiritualité. Deux champs de recherche transdisciplinaires qui permettent d’opérer la transition vers un monde véritablement écologique, juste et résilient » (page de couverture). Dans ce livre, Michel Maxime Egger nous entraine dans un parcours : découvrir les nouveaux champs de connaissance qui viennent éclairer l’écologie : écopsychologie et écospiritualité ; analyser les causes de la menace actuelle («Aux racines de l’écocide et de l’écoanxiété ») ; adopter un nouveau regard sur la nature ; « redonner sa juste place à l’être humain » et transformer l’éducation ; abolir les séparations et les frontières en « se reliant à la Terre et au Ciel »; nous engager en devenant une personne méditante-militante ».
Par rapport aux écrits précédents de l’auteur, ce livre comporte un nouveauté : une galerie de portraits de personnalités très diverses contribuant à l’écologie, par exemple : Carl Gustav Jung, Théodore Roszak, John Muir, Thomas Berry, Jacques Ellul, Philippe Descola, Teilhard de Chardin (5), Joanna Macy, David Thoreau…
Comme ce livre nous paraît incroyablement riche, nous nous limiterons à la présentation d’un chapitre : « Réenchanter notre regard sur la nature » (p 91-131). En Occident, notre attitude vis à vis de la nature était devenue de plus en plus omnipotente. Changer notre regard et donc notre attitude est devenu une priorité. « La nature ne prend de sens et de valeur qu’à travers le regard que nous portons sur elle. La vision – héritée culturellement – que nous en avons, influence, voire détermine la façon dont nous la traitons et notre manière d’y habiter et d’y vivre. Ce ne sont pas seulement les révolutions scientifiques et technologiques qui ont changé l’idée de la nature, c’est aussi la transformation de cette dernière qui les a rendu possibles. Nous ne sortirons pas du saccage de la planète tant que nous n’aurons pas converti notre regard sur la Terre et la place de l’être humain en son sein » (p 91).
Vision plurielle de la nature
Quelles sont les représentations actuelles de la nature ? Une prise de conscience intervient. Ces représentations évoluent. « On assiste depuis une quinzaine d’années à un reprise et une intensification d’un large questionnement sur ce qu’est la nature (p 92). « On peut discerner aujourd’hui plusieurs approches :
° La Terre comme objet. Nourri par le réductionnisme et le fantasme démiurgique de maîtrise totale issue de la modernité, l’être humain veut (re)façonner, réparer le climat, et produire la vie à coups d’exploits technologiques, de biologie de synthèse et de géo-ingénierie… La nature est manipulée et chosifiée à l’extrême.
° La Terre comme hybride. A l’ère de l’anthropocène, la Terre serait tellement marquée par l’empreinte humaine qu’elle perdrait toute réalité en elle-même… Nature et culture seraient si imbriquées que Bruno Latour propose de remplacer le mot nature par un nouveau concept : « Nat/Cul ».
° La Terre comme toile du vivant. C’est l’hypothèse Gaïa développée dans les années 1970 par le biochimiste James Lavelock et la microbiologiste Lynn Margulis. Pour reprendre l’expression du philosophe Baptiste Morizot, notre planète est un tissu d’êtres vivants – humains et autres qu’humains – en interactions créatrices et relations d’interdépendance.
° La Terre comme Domaine « inconstructible » ou « contre- altérité ». La nature est une réalité en soi, autonome que nous n’avons pas créée et qui nous échappe. La préserver, c’est la respecter dans son altérité radicale, sa part sauvage et sa finitude.
° La Terre comme mystère sacré. Cette vision va se décliner de multiples manières selon les traditions de sagesse à travers des notions comme la Grande Déesse, la Terre Mère, l’âme du monde ou encore la Création. » (p 92-93).
Toutes ces différentes conceptions font l’objet de débats. Et, en particulier, certains s’opposent à l’emploi du mot nature comme un terme distinguant l’humanité de la nature, un terme « trop anthropocentrique, occidental et dualiste en ce qu’il induit une coupure entre l’humain et le non-humain ». La controverse est possible. L’auteur avance l’approche de Baptiste Morizot : « Nous sommes des vivants parmi les vivants, façonnés et irrigués de vie chaque jour par les dynamiques du vivant… Nous ne sommes plus face à face, mais côte à côte avec le reste du vivant, face au dérobement de notre monde commun » (p 94).
Redonner une âme à la Terre
° Une toile d’interdépendance
Par rapport aux approches précédentes, « c’est clairement à la Terre comme toile du vivant que la majorité des écopsychologues se rattachent ». « Ils intègrent les nouveaux paradigmes scientifiques dans leur approche holistique complexe et non dualiste »… « L’être humain est partie intégrante et partenaire coévolutionnaire de la toile du vivant. La coopération et l’entraide l’emportent sur la compétition et la loi du plus fort, chères à Darwin. Les êtres, autres qu’humains, ne sont pas des ressources, mais des entités vivantes… ». Nous voici dans l’approche de l’hypothèse Gaïa qui s’ouvre à plusieurs interprétations. « Les milieux issus ou proches de l’écopsychologie ont adopté une compréhension qui voit la terre comme un super-organisme vivant, créatif, symbiotique et autorégulateur ». D’autres ajoutent parfois une tendance à personnaliser, voire anthropomorphiser Gaïa. Cette lecture est contestée… « Pour Bruno Latour, l’hypothèse Gaïa présente simplement la Terre comme « un ensemble d’êtres vivants et de matière qui se sont fabriqués ensemble, qui ne peuvent pas vivre séparément et dont l’homme ne saurait s’extraire ».
° Le Tao, transformation et harmonie
L’auteur nous introduit à la contribution du taoïsme dans la compréhension de la nature. « La vision de la nature comme processus, système organique et ordonné en transformation constante, entre en résonance forte avec des spiritualités de l’immanence comme le taoïsme. Du fait de sa perspective holistique, dynamique et relationnelle qui vise à « suivre la nature », ce dernier est particulièrement prisé par les penseurs de l’écologie » (p 99).
° L’âme du monde
La Terre, comme organisme vivant, est-elle animée par un principe psychique ? L’auteur envisage « le mythe transculturel de l’âme du monde ». « Le philosophe Mohammed Taleb le définit ainsi : « Émanant de l’Un, l’âme du monde est le liant universel qui donne au cosmos sa cohérence qui fait que l’univers est justement cosmos et non chaos, organisme et non assemblage » (p 102). Ainsi, « la psyché, ou l’âme, n’est pas limitée à l’être humain. Elle traverse les frontières entre les espèces et les règnes de la nature, l’intérieur et l’extérieur, et s’étend au cosmos tout entier ». Et, dans cette perspective, « les animaux et les plantes, les montagnes et les cours d’eau ne sont pas que des agrégats matériels ou des ressources psychologiques. Ils ont aussi une voix, une dimension psychique reliée à l’âme du monde, comme lieu originel et matriciel, principe fondateur suprapersonnel et cosmique » (p 102). Il arrive que cette conception débouche sur une perspective animiste. « Pour Ralph Metzner et Theodore Roszak, par exemple, l’être humain serait « naturellement », animiste, c’est-à-dire ouvert à une perception des entités non humaines comme vivantes et douées d’une âme… Ainsi que nous l’apprennent les peuples premiers… l’animisme est une manière empathique de nous relier au monde naturel, en renouant avec nos racines terrestres et animales ainsi qu’avec « la pensée sauvage » (Claude Levi-Strauss) » (p 103).
Vertu écologique : l’émerveillement
« Une première vertu qui participe du réenchantement de notre relation à la nature est l’émerveillement ». Il y a bien des motifs d’émerveillement. « Être émerveillé, « c’est être saisi par le don permanent du vivant, le mystère de la Présence qui conduit à l’amour de la beauté au-delà des apparences ». « L’émerveillement fait partie de ce que Chellis Glendinning appelle « la matière primitive » de notre être qui se traduit par « une expérience corporelle, une perception du monde, une manière d’être vivant caractérisée par l’ouverture, l’écoute, la volonté de dire oui à la vie ici et maintenant ».
L’émerveillement suppose en particulier de développer l’intelligence contemplative et d’éveiller les sens pour se mettre à l’écoute de notre propre âme et de celle de la Terre » (p 106-107).
Redécouvrir la sacralité de la Terre
La Terre aurait-elle été désacralisée par la modernité ? Peut-on remédier « au divorce entre le sacré et la Terre, non pour diviniser la nature, mais pour lui redonner son mystère, source de respect » ? (p 207). Encore doit-on définir ce qu’on entend par sacré, car, étant donné l’héritage historique, il y a là une source de malentendu. « Forgé par l’anthropologie culturelle, le sacré est une notion complexe lourde d’héritage divers. Étymologiquement, il désigne « ce qui est (mis) à part », séparé l’impur et du profane. C’est le domaine du « Tout Autre », tissé de règles et d’interdits. Aujourd’hui, le sacré change de visage dans une nouvelle conscience. Il ne sépare plus, mais relie. Il vient moins de l’extérieur et par le haut (le Ciel) que de l’intérieur et par le bas (la Terre). Il n’existe plus en soi, mais à travers une relation… Il n’est pas réductible au religieux institué qui n’en est qu’une des expressions » (p 109). Selon Thomas Berry, le sacré évoque les profondeurs du merveilleux. « Dans une perspective écospirituelle, le sacré est ce qui émerge quand, en communion profonde ave la nature, il y a ouverture à une réalité invisible – l’Esprit, la Présence, le Souffle – qui s’offre et se révèle, relie les êtres et les choses entre eux et à la Source du vivant, les habite d’une dimension de mystère. Cette expérience est liée à un état intérieur d’unification corps-âme-esprit ainsi qu’à un alignement éprouvé entre cette Réalité ultime ineffable, la nature et soi-même» ( p 118-119).
° La Terre comme mère.
Comme expression de la sacralité du vivant, une expression prégnante dans les traditions spirituelles est la Terre Mère. Elle symbolise toute la nature comme mystère de la fertilité. Figure universelle très ancienne, elle est portée avec force par les peuples premiers… Chez les amérindiens, la plupart des textes n’attribuent pas une essence divine à la Terre Mère, mais en font la messagère du Grand Esprit » ( p 110-111). Cette distinction peut être moins patente ailleurs. Cependant, la Terre Mère est célébrée aujourd’hui dans beaucoup de traditions. Elle apparaît dans l’écobouddhisme contemporain. « Cette vision n’est pas absente de la tradition chrétienne. On en trouve des échos dans les textes bibliques de la Sagesse. Elle existe dans la théologie latino-américaine, mais aussi chez nombre d’auteurs. Dans la même veine, Laudato si’ parle de la Terre comme une « mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts »
° La création comme don.
« Plus de la moitié de la population mondiale désigne la nature par le terme de Création qui englobe l’ensemble du monde créé : minéral, végétal, animal, humain et même angélique. C’est le cas notamment des trois grandes religions monothéistes – le judaïsme, le christianisme et l’islam – qui proclament la foi en un Dieu créateur » (p 119). « La notion de Dieu créateur et de Création existent également dans d’autres traditions sous des formes différentes. Certains peuples premiers – les Amérindiens, par exemple, – y recourent avec la figure du Grand Esprit qui n’est autre que la source créatrice et le principe vital de tout ce qui est ». En Afrique, des peuples croient en un Dieu suprême qui a créé le monde. On peut entrevoir un Dieu créateur dans l’hindouisme ( p 115-116).
Michel Maxime Egger recourt aux textes des religions monothéistes pour montrer en quoi elles peuvent contribuer à réenchanter notre relation avec la nature.
° « La Création trouve la source de son être et de sa vie en Dieu. On accède à cette source en pénétrant à l’intérieur de soi-même et de la Création, en s’élevant à un autre plan de conscience ».
° « La Création est un mystère… Elle n’a rien à voir avec la fabrication. Elle est toujours au-delà de ce que nous pouvons en dire et en saisir par nos sens et notre intelligence rationnelle ».
° « La Création est un don libre et gratuit : une manifestation de la bonté de Dieu, de sa générosité, de son désir de se faire connaître et surtout de son amour qui embrasse jusqu’à chaque grain de sable. Le don, par essence, relie. Il se reçoit et se partage ».
° « La Création est bonne et belle. La Genèse clôt chaque jour par ce refrain : « Dieu vit que cela était bon »… La Création, dans son ensemble, toutes les espèces et chaque créature en particulier ont une valeur propre et intrinsèque comme partie de la toile du vivant » (p 114).
La notion de création et les écologistes
« La notion de Création n’a pas toujours bonne presse chez les écologistes. Elle recèle pourtant un grand potentiel pour réenchanter notre relation à la Terre… mais à trois conditions : D’abord considérer la Création comme un concept non doctrinaire mais comme un concept « transversal » et « nomade ». « qui invente et découvre la réalité au lieu de vouloir maitriser et subordonner ». Ensuite éviter le dualisme qui peut naître quand on accentue la transcendance de Dieu (incréé) au détriment de son immanence dans la nature (créée). Enfin s’affranchir de certaines théologies closes et statiques » (p 116).
Une vertu écologique : la gratitude
« Face à la Terre, comme organisme vivant, comme mère et comme don, la plus grande vertu écospirituelle est la gratitude ». L’auteur cite de nombreuses recommandations allant dans ce sens en provenance de toutes les traditions de sagesse.
« Rendre grâce, c’est dire merci pour tout ce qui nous est offert à chaque instant, sans quoi nous ne vivrions pas, mais dont nous n’avons pas toujours conscience… C’est accueillir avec joie la nature et tout ce qui l’habite comme un présent gratuit et sacré… ». L’auteur cite Joanna Macy dans le « Travail qui relie ». « Il est capital de nous « enraciner » dans la gratitude ou, mieux encore, de la laisser s’enraciner en nous. Cette disposition intérieure nous aide à devenir plus réceptif à ce qui est déjà là et « à devenir encore plus émerveillés de nous sentir vivant dans ce monde admirable plein de vie »… Antidote au consumérisme, la gratitude accroit la satisfaction pour ce que nous avons par rapport à l’insatisfaction pour tout ce qui nous manquerait… ». L’auteur évoque l’approche spirituelle. « Bénir c’est relier notre être et ce qui nous est offert à l’Être qui en est la source, qui s’offre lui-même à travers ce qu’il nous offre » (p 119).
Trouver Dieu dans la nature
Évoquer la sacralité de la nature suscite souvent des crispations dans les Églises qui voient poindre le retour d’un culte de la nature (paganisme) contre lequel le christianisme a lutté pendant des siècles. Les choses sont toutefois en voie de changer. En témoigne l’encyclique Laudato si’(7) invitant à accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes et à leurs traditions culturelles qui nous rappellent que la Terre est un espace sacré » (p 120).
Michel Maxime Egger nous invite ici à participer à une approche théologique, celle du panenthéisme. « Ce dernier permet d’aller au-delà de deux pôles entre lesquels la question écologique est souvent enfermée : le matérialisme et le panthéisme ». « Comme son étymologie l’indique, le panenthéisme est la doctrine du « Tout en Dieu et Dieu en nous ». Il existe sous différentes formes dans plusieurs traditions philosophiques et mystiques ainsi que dans la science contemporaine, en particulier dans certains courants de la mécanique quantique. Dans le monde chrétien, il est au cœur de la théologie orthodoxe, mais aussi présent chez des auteurs comme Teilhard de Chardin (5), Thomas Berry, Matthew Fox, Jürgen Moltmann (6), et Leonardo Boff » (p 121). C’est une voie grande ouverte. « Tout est en Dieu, mais tout n’est pas Dieu. Dieu est immanent dans sa transcendance et transcendant dans son immanence. Le panenthéisme permet donc de dépasser le dualisme entre Dieu, l’être humain et la nature. Il redonne à la nature une dimension sacrée. D’une manière non pas absolue – par essence – mais « relative », du fait de sa relation au divin. Le panenthéisme unit le divin et la nature sans les confondre… Dans sa version faible, la nature est le miroir du divin… Les humains, les animaux, les oiseaux, les arbres, les fleurs sont des manifestations de Dieu, des signes de son amour, de sa sagesse et de sa bonté. Dans sa version forte, la nature n’est pas que la manifestation du divin, mais le lieu de sa présence. « En toute créature habite un Esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui », écrit le pape François » ( p 121-122).
Michel Maxime Egger nous présente ici « trois modalités de panenthéisme fort qui résonnent à travers différentes traditions religieuses : les empreintes du divin, les énergies divines et les esprits invisibles ».
Empreintes du divin
« Le premier mode de présence de Dieu dans la nature est l’empreinte divine que chaque être – humain et autre qu’humain – porte dans son être profond. Cette empreinte est comme son ADN spirituel… Dans la tradition chrétienne, cette conception a été développée en particulier par le théologien byzantin Maxime le confesseur (VIIe siècle). Selon la Nouveau Testament, le Logos ou Verbe divin est le « Principe » en qui, par qui et pour qui tout existe et toutes choses ont été créées. Il a implanté dans chaque être créé un logos, une « parole », une « idée – volonté » qui exprime son dessein envers elle. Chaque créature porte ainsi en elle comme une information divine ». « C’est un ensemble de potentialités à réaliser en synergie avec la grâce de l’Esprit » (p 122-123). Michel Maxime Egger évoque la vision du Christ cosmique. « L’écospiritualité invite à retrouver la dimension cosmique du Christ, qui – à quelques expressions près comme François d’Assise – a eu tendance à s’effacer en Occident à partir du VIe siècle au profit de la dimension humaine. Présente dans le christianisme primitif, cette vision est promue aujourd’hui par des figures comme Leonardo Boff et Matthew Fox. L’un de ses précurseurs est Pierre Teilhard de Chardin… « (p 123). L’auteur mentionne « des analogies de cette théologie des logoi (pluriel de logos) dans d’autres traditions religieuses », ainsi dans le taoïsme et dans le bouddhisme.
Énergies divines
« Un deuxième mode de la présence de Dieu dans la nature se communique à travers ses énergies qui rayonnent sur toute la Terre… Elles pénètrent l’univers comme l’eau une éponge et font de chaque réalité naturelle un sacrement de la présence de Dieu ». L’auteur nous renvoie ici à la tradition orthodoxe. « Grégoire Palamas, un théologien byzantin, à partir de la transfiguration du Mont Thabor, voit dans la création un « buisson ardent des énergies de Dieu ». Ces énergies sont ce par quoi Dieu se manifeste… ». L’auteur cite également Hildegarde de Bingen (7), une mystique occidentale du XIIe siècle. « Ces énergies sont la puissance créatrice et le souffle de feu par lesquels Dieu a créé le monde et continue d’y agir ici et maintenant » (p 124-125). On trouve des analogies des énergies divines dans d’autres traditions mystiques comme dans la kabbale juive ou dans l’hindouisme.
Esprits invisibles
Dans certaines cultures, « le divin se manifeste à travers les esprits qui peuplent le monde invisible d’en bas (proches de la terre, des mondes animal et végétal) et d’en haut (le ciel) en interaction constante dans le grand cercle de la vie ». « Ces entités spirituelles sont au cœur des religions animistes et chamaniques ». « Ces puissances spirituelles sont associées à des êtres humains…, des animaux, des arbres, des plantes, mais aussi des lieux et des phénomènes naturels. Elles les habitent et les animent. Chaque entité de la nature a ainsi sa vibration propre, sa raison d’être et une intériorité qui lui donne une dimension sacrée… Souvent, ces esprits multiples émanent d’une puissance supérieure à l’origine de toutes choses, qui représente le principe d’unité du cosmos dont elle est le gardien suprême : un être éternel, à la fois transcendant et immanent, que l’on peut invoquer, qui entend les humains et leur répond » (p 127). L’auteur envisage également la chamanisme, « une manière de vivre en harmonie avec tous les êtres vivants qui nous entourent, sa spécificité étant que cette visée se réalise à travers la cohabitation avec les esprits » (p 128).
Vertu écologique : le respect
« La Terre est notre maison commune (Laudato si’) (8) ». Cette affirmation implique le respect. « Être un hôte digne, c’est respecter le lieu qui nous accueille…». « Cette exigence de respect est d’autant plus grande que la Terre a une âme, qu’elle n’est pas seulement la demeure de l’être humain, mais aussi celle de l’Esprit. C’est pourquoi le pape François parle de respect sacré et que le chef indien, Elan noir affirme que chaque pas sur la Terre-Mère devrait « être comme une prière ». L’auteur évoque le respect de la nature comme « étant au cœur des traditions religieuses ». (p 130)
Un lieu de débats
Michel Maxime Egger prend en compte et mentionne ici des visions de la nature qui sont l’objet de critiques (p 131-132) et invitent donc au débat : ambiguïté de la figure de la mère projetée sur la Terre, anthropomorphisme, culte romantique de la nature, absolutisation de celle-ci au détriment de l’être humain, retour à la pensée magique… le risque de formes explicites ou larvées de divinisation de la nature… une conception « idéaliste » ou « passéiste » de la nature… A la fin de ce tour d’horizon, c’est en pleine conscience que nous pouvons réenchanter notre regard sur la nature.
La prise écologique requiert et entraine un nouveau regard sur la nature. Michel Maxime Egger aborde cette question sous l’angle du réenchantement. Son approche est globale et particulièrement bien informée. On imagine la richesse de la pensée de Michel Maxime Egger quand on pense que ce livre vient à la suite de précédents tout aussi denses et que nous n’en avons présenté ici qu’un seul chapitre. Réenchanter notre regard à la nature : un émerveillement constant, l’avènement d’une autre dimension…
J H
- Ecospiritualité. Une nouvelle approche spirituelle : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
- L’espérance en mouvement : https://vivreetesperer.com/lesperance-en-mouvement/
- Un chemin spirituel vers un nouveau monde : https://vivreetesperer.com/un-chemin-spirituel-vers-un-nouveau-monde/
- Michel Maxime Egger. Réenchanter notre relation au vivant. Ecopsychologie et écospiritualité. Jouvence, 2022
- Un horizon pour l’humanité. la Noosphère : https://vivreetesperer.com/un-horizon-pour-lhumanite-la-noosphere/
- Dieu dans la création :https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
- Hildegarde de Bingen. L’homme, la nature et Dieu : https://vivreetesperer.com/lhomme-la-nature-et-dieu/
- Laudato si’. Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François, Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
par jean | Juil 7, 2018 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
Lorsque la vie est difficile et la santé menacée, il n’est pas toujours facile de se réveiller et de commencer la journée. Dans son livre: « Sa Présence dans ma vie » (1), Odile nous fait part de son expérience quotidienne. Ici, au réveil, prendre vie dans la participation au Vivant, à la Présence divine…
« Ce matin au réveil, fatigue immense.
Il me faut faire un trop grand effort pour rassembler mes forces. Je n’en ai pas envie. Me laisser dormir encore un peu.
L’expérience m’a montré que cette sensation provenait non pas d’une surcharge extérieure de trop d’activité, mais bien plus d’une mauvaise orientation de l’énergie. Alors, peu à peu, je me suis mise à respirer progressivement de plus en plus profondément, calmement, accueillant une sensation de détente.
La pensée me vient que cet air que je respire est porteur de vie, énergie. Dieu créateur y est présent, car cet air existe animé par Lui. Jésus a dit : Je suis la Vie. Il est tout en tous.
Alors, comme pour la prière du Pèlerin russe, à chaque longue respiration, je dis Jésus en pensant que je reçois sa Vie, sa puissance de Vie reliée au Père. Je bloque ma respiration et compte 1.2.3.4 en réalisant que sa vie imprègne mon être tout entier : mon être physique (l’air dans les poumons. L’oxygène dans le sang circule dans les cellules) ; mon être psychique, émotionnel (sensation de calme, contentement) ; mon être intellectuel (une certaine compréhension que je m’approprie) ; mon être spirituel (reconnaissance pour cette paix intérieure, une certaine joie de vivre).
L’énergie revenant peu à peu, tangible, la pensée me vient que je peux reprendre ma vie en main, faire des projets pour la journée. Et je réalise que ces deux derniers jours, je flottais, ne sachant même plus quel jour de la semaine je vivais : vendredi, samedi. .. Heureusement que mon mari me demande pour organiser sa journée quel était mon programme . Cela m’a permis d’avoir des repères durant cette période de temps. Drôle de sensation désagréable que celle de ne pas pouvoir saisir le temps. Hors du temps, je me sentais hors de la réalité tout en m’activant. Cela provoquait une sorte de déprime avec une perte d’énergie.
Ce matin, en faisant cet exercice, je récupère la notion de temps, l’énergie, la volonté de reprendre ma journée en main . Je regarde le ciel à travers la fenêtre ouverte, rideau que je ne tire pas le soir, car j’aime me réveiller avec le jour. Ce regard vers le ciel fait de mon énergie qui circule en cercle fermé en moi, une ouverture, une spirale vers le cosmos. Je me sens à ma juste place en moi, et moi dans l’univers imprégné du Créateur.
Je te loue, je t’adore, o Eternel
Toi qui me donne Vie en toi.
Merveille, magnificence, joie de vivre.
« Tout en moi bénit l’Eternel », maître du temps et de l’espace
« N’oublie aucun de ses bienfaits », aucun, c’est beaucoup dire, en tout cas, reçois ma reconnaissance.
« C’est toi qui pardonne toutes mes fautes ». Tu as remis en place ce qui était faussé en moi. Merci !
« C’est toi qui guérit toutes mes maladies ».
C’est la conséquence de la remise en place selon les lois de vie. (Psaume 103) ».
Odile Hassenforder
02.07.2006
Extrait d’écrits personnels
Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. ( p 155)
(1) Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Parcours spirituel . Empreinte Temps présent, 2011. Sur ce site : https://vivreetesperer.com/?p=2345
(2) De nombreux écrits d’Odile Hassenforder sont publiés sur ce blog, ainsi, parmi les plus récents : « la joie jusque dans l’épreuve » : https://vivreetesperer.com/?p=2662 « Ce matin » : https://vivreetesperer.com/?p=2612 « La prière » : https://vivreetesperer.com/?p=2612 « Mon regard en Dieu » : https://vivreetesperer.com/?p=2125 « Ressembler à Jésus ? » : https://vivreetesperer.com/?p=2060 « Une vie qui a du sens » : https://vivreetesperer.com/?p=2028 ………
par jean | Juil 9, 2018 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |
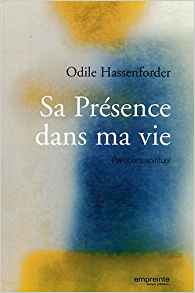 Lorsque la vie est difficile et la santé menacée, il n’est pas toujours facile de se réveiller et de commencer la journée.
Lorsque la vie est difficile et la santé menacée, il n’est pas toujours facile de se réveiller et de commencer la journée.
Dans son livre : « Sa présence dans ma vie » (1), Odile nous fait part de son expérience quotidienne. Ici, au réveil, prendre vie dans la participation au Vivant, à la Présence divine…
« Ce matin au réveil, fatigue immense.
Il me faut faire un trop grand effort pour rassembler mes forces. Je n’en ai pas envie. Me laisser dormir encore un peu.
L’expérience m’a montré que cette sensation provenait non pas d’une surcharge extérieure de trop d’activité, mais bien plus d’une mauvaise orientation de l’énergie. Alors, peu à peu, je me suis mise à respirer progressivement de plus en plus profondément, calmement, accueillant une sensation de détente.
La pensée me vient que cet air que je respire est porteur de vie, énergie. Dieu créateur y est présent, car cet air existe animé par Lui. Jésus a dit : Je suis la Vie. Il est tout en tous.
Alors, comme pour la prière du Pèlerin russe, à chaque longue respiration, je dis Jésus en pensant que je reçois sa Vie, sa puissance de Vie reliée au Père. Je bloque ma respiration et compte 1.2.3.4 en réalisant que sa vie imprègne mon être tout entier : mon être physique (l’air dans les poumons. L’oxygène dans le sang circule dans les cellules) ; mon être psychique, émotionnel (sensation de calme, contentement) ; mon être intellectuel (une certaine compréhension que je m’approprie) ; mon être spirituel (reconnaissance pour cette paix intérieure, une certaine joie de vivre).
L’énergie revenant peu à peu, tangible, la pensée me vient que je peux reprendre ma vie en main, faire des projets pour la journée. Et je réalise que ces deux derniers jours, je flottais, ne sachant même plus quel jour de la semaine je vivais : vendredi, samedi. .. Heureusement que mon mari me demande pour organiser sa journée quel était mon programme . Cela m’a permis d’avoir des repères durant cette période de temps. Drôle de sensation désagréable que celle de ne pas pouvoir saisir le temps. Hors du temps, je me sentais hors de la réalité tout en m’activant. Cela provoquait une sorte de déprime avec une perte d’énergie.
Ce matin, en faisant cet exercice, je récupère la notion de temps, l’énergie, la volonté de reprendre ma journée en main . Je regarde le ciel à travers la fenêtre ouverte, rideau que je ne tire pas le soir, car j’aime me réveiller avec le jour. Ce regard vers le ciel fait de mon énergie qui circule en cercle fermé en moi, une ouverture, une spirale vers le cosmos. Je me sens à ma juste place en moi, et moi dans l’univers imprégné du Créateur.
Je te loue, je t’adore, o Eternel
Toi qui me donne Vie en toi.
Merveille, magnificence, joie de vivre.
« Tout en moi bénit l’Eternel », maître du temps et de l’espace
« N’oublie aucun de ses bienfaits », aucun, c’est beaucoup dire, en tout cas, reçois ma reconnaissance.
« C’est toi qui pardonne toutes mes fautes ». Tu as remis en place ce qui était faussé en moi. Merci !
« C’est toi qui guérit toutes mes maladies ».
C’est la conséquence de la remise en place selon les lois de vie. (Psaume 103) ».
Odile Hassenforder
02.07.2006
Extrait d’écrits personnels
Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. ( p 155)
(1) Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Parcours spirituel . Empreinte Temps présent, 2011. Sur ce site : https://vivreetesperer.com/?p=2345
(2) De nombreux écrits d’Odile Hassenforder sont publiés sur ce blog, ainsi, parmi les plus récents : « la joie jusque dans l’épreuve » : https://vivreetesperer.com/?p=2662 « Ce matin » : https://vivreetesperer.com/?p=2612 « La prière » : https://vivreetesperer.com/?p=2612 « Mon regard en Dieu » : https://vivreetesperer.com/?p=2125 « Ressembler à Jésus ? » : https://vivreetesperer.com/?p=2060 « Une vie qui a du sens » : https://vivreetesperer.com/?p=2028 ………
par jean | Juil 4, 2022 | Société et culture en mouvement |
 Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.
Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.
C’est le mouvement que décrit Amos Yong (2) dans une séquence sur le Saint Esprit réalisée par Richard Rohr sur le site du Center for action and contemplation. Théologien pentecôtiste américain, d’origine malaisienne, Amos Yong est l’auteur d’une œuvre originale et abondante qui se décline dans de nombreux livres (3). Amos Yong propose ainsi une théologie pionnière où les ressources du pentecôtisme s’inscrivent dans une pensée chrétienne ouverte à une dimension œcuménique et interreligieuse, comme à la culture d’aujourd’hui, notamment scientifique. Amos Yong est professeur à la Faculté Évangélique californienne Fuller où il dirige l’École des études interculturelles, un centre de recherche missiologique. Son œuvre mérite d’être mieux connue au delà de l’univers anglophone.
La dynamique de la Pentecôte
« La vie palestinienne du premier siècle, de beaucoup de manières, semblable à notre village global d’aujourd’hui, était marquée par des suspicions vis à vis de ceux qui parlaient d’autres langues où qui incarnaient d’étranges genres de vie. Ce fut l’œuvre de l’Esprit de rassembler ceux qui étaient étrangers les uns aux autres et de réconcilier ceux qui auraient pu autrement demeurer à l’écart de ceux qui leur étaient dissemblables ».
La Pentecôte ouvre un horizon nouveau. « Elle inaugure un Israël restauré et le royaume de Dieu en établissant de nouvelles structures et de nouvelles relations sociales. A noter que le don de l’Esprit n’est pas réservé aux 120 hommes et femmes qui sont rassemblés dans la chambre haute (Actes 1. 14-15) : Les langues de feu qui se sont divisées, se sont posées sur chacun et ont permis à chacun, soit de parler, soit d’entendre dans des langues étrangères (Actes 2.3-4).
Pour expliquer ce phénomène, Pierre cite le prophète Joël :
« Vos fils et vos filles prophétiseront
Vos jeunes hommes auront des visions
Vos anciens auront des songes
Et sur mes esclaves, hommes et femmes
Je déverserais mon Esprit
En ces jours, ils prophétiseront » (Actes 2. 17-18)
Un changement de société
Amos Yong élargit la réception habituelle. « Les dons de l’Esprit ne sont pas destinés seulement aux individus. Ils ont des effets sociaux en mettant en cause les pouvoirs en place, « the powers that be ».
Pierre comprenait bien que, tandis que l’ancienne ère juive avait un caractère patriarcal, la restauration d’Israël manifesterait l’égalité de l’homme et de la femme. Les deux prophétiseraient dans la puissance de l’Esprit. Tandis que l’ancienne alliance manifestait la direction des anciens, le royaume restauré impliquera la responsabilisation (empowerment) d’hommes et de femmes de tous les âges. En tout ceci, l’œuvre de l’Esprit était annoncée en des langues étranges, et pas dans les langues conventionnelles du statu quo.
En effet, la restauration du royaume de Dieu par la puissance de l’Esprit renversait effectivement le statut quo. Comme il avait été prédit à Marie et Zacharie, ceux qui étaient au bas de l’échelle sociale, les femmes, les jeunes et les esclaves, étaient les récepteurs de l’Esprit et les véhicules d’un revêtement de puissance (empowerment) de l’Esprit (Luc 1.46-55, 1.67-79). Les gens, autrefois divisés par la langue, l’ethnie, la culture, la nationalité, le genre et la classe seraient réconciliés par cette nouvelle version du royaume.
Potentiellement, « toute chair » serait incluse .
Une interpellation
Dans cette vision inspirante, Amos Yong interpelle.
Est-ce que ces caractéristiques continuent à marquer l’église comme une fraternité inspirée par l’Esprit ? Est-ce que l’église parle encore les langues de l’Esprit ? Ou bien restons-nous prisonniers d’une division portée par les langages, les structures et les conventions des empires de ce monde ? (4). Notre prière devrait être : « Viens Saint Esprit » de telle manière à ce que la proclamation de l’épanchement de l’Esprit sur toute chair puisse vraiment encore trouver son accomplissement à notre époque.
Amos Yong
Rapporté en français par J H
- « Paul : Sa vie et son oeuvre selon NT Wright » : https://vivreetesperer.com/paul-sa-vie-et-son-oeuvre-selon-nt-wright/
- A reconciling power : https://cac.org/daily-meditations/a-reconciling-power-2022-06-09/
- Amos Yong . Fuller Seminary : https://www.fuller.edu/faculty/amos-yong/
- L’Esprit Saint à l’œuvre dans les sociétés et pas seulement à l’échelle individuelle : « Pour une vision holistique de l’Esprit. Avec Jürgen Moltmann et Kisteen Kim » : https://vivreetesperer.com/pour-une-vision-holistique-de-lesprit/

par jean | Avr 5, 2025 | ARTICLES, Vision et sens |
Selon Ilia Delio
La réflexion sur la vie et la mort est au cœur de notre existence. Dans notre société, elle est ravivée au temps de Pâques. Dans un contexte chrétien, la résurrection de Jésus est proclamée, mais, dans certains milieux, des doctrines et des rites accordent beaucoup d’importance à l’empreinte de la mort. Cependant, c’est bien sur la victoire de la Vie que repose notre espérance. Dans son site : « Center for Christogenesis », Ilia Delio aborde cette question existentielle dans un essai intitulé : « Death anxiety and the cross » (1) (l’angoisse de la mort et la croix). Ilia Delio est une sœur franciscaine américaine, à la fois neuroscientifique et théologienne (2). Inspirée par la pensée de Teilhard de Chardin, en phase avec une culture émergente, elle exprime ici une dynamique spirituelle.
Angoisse de la mort
Selon Ilia Delio, l’angoisse de mort est propre à l’homme.
« La nature vit dans la radicalité de l’amour en étant simplement elle-même. Les arbres et les fleurs, le poisson et la volaille, et toutes les créatures vivantes de la terre existent dans leur unique statut de créature ». « Un arbre ne fait rien de plus que d’être un arbre, mais en étant un arbre, il rend gloire à Dieu », écrit Thomas Merton. La nature ne souffre pas d’angoisse de mort ou de peur de la mort comme les humains en souffrent. Plutôt, toute la nature cède à la mort dans un flux de vie. La vie jaillit à travers les restes carbonisés des arbres morts et dans les cendres de violentes explosions volcaniques. La vie trouve un chemin en poussant à nouveau miraculeusement, en émergeant triomphalement dans une vie nouvelle. Le dernier mot de la vie est la Vie elle-même – et c’est Dieu ».
Au contraire, l’angoisse de mort affecte l’humanité.
L’homme est confronté à la peur de la mort. « La violence délibérée de la nature commence avec l’évolution humaine et la montée d’une conscience auto-réflexive. Et ce que nous savons, c’est que nous mourrons ». On trouve des traces de cette conscience jusque dans l’art préhistorique puisque, entre autres, on trouve des symboles de mort dans la grotte de Lascaux. La mort est présente dans l’histoire d’Adam et Eve dans le livre de la Genèse. « L’angoisse de mort est un état psychologique qui a tourmenté les humains à travers les siècles ».
« Aujourd’hui, le monde moderne est tombé dans une nouvelle angoisse de mort à la pensée de la guerre nucléaire et de l’extinction de masse. Notre vie peut disparaitre en un instant. La pensée d’être personnellement effacé de l’univers par la mort a poussé la personne moderne à faire tout ce qui était en son pouvoir pour préserver son empreinte cosmique, depuis des actions héroïques de dévouement à l’accumulation de richesses pour bâtir des monuments, Nous désirons qu’on se rappelle de nous pour quelque chose de petit ou grand ».
Angoisse de mort et pensée religieuse. Péché originel et expiation
Ilia Delio se demande si l’angoisse de mort ne s’est pas incarnée dans une pensée religieuse mortifère. « Je me demande si l’angoisse de mort ne se tient pas derrière la construction de la doctrine du péché originel… Car il y a un écart logique entre le Nouveau Testament et la formulation tardive de la doctrine chrétienne. Le théologien Paul Tillich faisait remarquer que la doctrine du XIe siècle de Saint Anselme, connue comme la ‘théorie de la satisfaction’ (définition : ‘Christ ayant souffert en tant que substitut de l’humanité, satisfaisant par son infini mérite, les exigences requises par l’honneur de Dieu’) retenait l’attention parce qu’elle apaisait le fardeau de la culpabilité… D’autres théories de l’expiation, incluant la substitution pénale ont également été proposées pendant des siècles pour apaiser le fardeau de la culpabilité dans une humanité difforme qui craint le jugement final et la punition éternelle ».
Ilia Delio montre combien cette doctrine est contraire au message de Jésus. « La doctrine de l’expiation et les théories ultérieures de la substitution pénale sont des développements plutôt tardifs dans le christianisme. En d’autres mots, elles ne sont pas immédiatement associées à Jésus de Nazareth. Dans les quelques premiers siècles de l’Église, l’accent a été mis sur la Résurrection et la vie nouvelle en Dieu plutôt qu’une ‘satisfaction’ due au péché ». Ilia Delio explique comment la théorie de l’expiation a émergé après Augustin. « Comme Dieu s’éloignait de la puissance de la vie, vivante en Jésus-Christ, pour aller vers un Être parfait, immuable, intérieur, essentiel, de même ainsi, le péché originel formulé par Augustin, a commencé à forger une humanité déchue (3). L’omnipotence divine et la dépravation humaine devint corrélée. Le christianisme a été construit sur l’angoisse de mort et la menace existentielle du néant de telle façon que nous n’avons jamais pu parvenir à boire à la source de la vie ressuscitée, la vie spontanée, féconde de l’Esprit qui est créativement nouvelle, porteuse d’espérance et orientée vers le futur ».
En Jésus, la conscience divine
« Depuis le début de sa vie, il y a eu quelque chose de différent en Jésus. Elevé dans une famille juive et fidèle aux rituels et aux fêtes juives, Jésus a fait l’expérience du Dieu d’Abraham et de Moïse au cœur de sa propre vie. L’Esprit du Seigneur était sur lui de telle façon qu’il ressentait l’expérience de Dieu en lui. Il était un homme simple et probablement sans instruction, et il a travaillé comme charpentier jusqu’à il se soit senti poussé à parler au nom du royaume de Dieu, comme si quelque chose de nouveau faisait irruption à travers lui – ce que Larry Hurtado et d’autres ont appelé une mutation de conscience (4). La puissance de Dieu s’enflamma en lui, et de cette puissance, un nouveau genre de personne, une personne divine (Godly-person) émergea. La puissance de Dieu brûlait en lui, et de cette puissance, un nouveau genre de personne, une personne divine (Godly-person), a émergé. Jésus a changé les frontières humaines, se montrant être humain et divin à la fois. La puissance du Dieu d’Abraham s’exprimait maintenant dans une personne humaine.
L’ ‘incarnation’ était si contraire au sens commun qu’elle a déstabilisé des catégories chosifiées. Se montrant délibérément comme un humain avec une conscience divine, Jésus a révélé l’arbitraire et le caractère construit de ce que d’autres considéraient être la norme. Sa vie et son ministère ont déstabilisé des valeurs établies. La présence de Dieu ressentie profondément en lui, a poussé Jésus au-delà de la norme. Il devint un perturbateur, un dérangeur, celui qui choquait les autres en ne répondant pas à leurs attentes. ‘N’est-ce pas le fils du charpentier ?’ demandaient-ils ». Ilia Delio nous montre Jésus brouillant les frontières et les habitudes de pensée. « Jésus était incontrôlable parce qu’il était complétement libre. Il y avait en lui une puissance à l’œuvre, non pas une puissance de domination, mais une puissance d’amour, de pardon, de compassion, un pur désir de relever les déchus, d’aider les blessés et de soigner les malades. Jésus se sentait concerné par la personne humaine et par son inclusion dans la communauté. Il a déplacé la focalisation sur le Dieu d’en haut à celle sur le Dieu de l’intérieur… Il a vécu de l’énergie spontanée de l’amour qui vous propulse vers une relation créative ».
« Jésus est un formidable modèle quant à la manière d’être une personne humaine ouverte à et en relation avec la puissance de la vie elle-même, la puissance de Dieu. Jésus est Dieu vivant et aimant dans la chair. Nous ne pouvons pas nous détourner du fait que Dieu est le nom de la Vie elle-même, non un Être, mais le dynamisme d’un Être vivant, relationnel, actif, orienté vers davantage de vie. Prier Dieu, ce n’est pas simplement réaliser un acte d’adoration, mais plutôt prier est être conscient de la vitalité de Dieu en nous et autour de nous. Adorer requiert une vitalité nouvelle en célébration et en communauté, anticipant un nouveau futur ensemble et célébrant la vie nouvelle émergeant parmi nous ».
La croix et une vie invincible
« Il est important de porter attention aux derniers jours de la vie de Jésus telle qu’elle est racontée dans les Évangiles. Un homme innocent, trahi, humilié, injustement accusé de subversion politique, et puis jeté dans une foule en colère qui demande sa mort en échange de la libération d’un criminel. ‘Il a été conduit comme un agneau à l’abattage’ acceptant le destin de la mort sans résistance. Quel genre de personne accepterait volontairement la mort à un âge jeune à moins qu’il ne soit conduit par une croyance ou un engagement plus fort que la mort ? »
Ilia Delio apporte à cette occasion sa réflexion sur la mort : « La mort de Jésus était déjà inscrite le jour où il est né. De la même façon que notre mort est déjà une donnée quand nous ouvrons nos yeux dans l’univers. Nous vivons dans la perspective de mourir, parce que la mort est la forme finale de notre personnalité, l’empreinte que nous laissons dans le cosmos pour toute l’éternité. La mort n’est pas la fin, mais le premier acte plénier de notre personnalité. Comment nous vivons jusqu’à ce premier acte plénier de notre personnalité est le chemin de la vie elle-même. Le plus limité nous vivons, le plus égoïste nous sommes, moins nous contribuons à l’éternelle créativité cosmique de la vie ».
« Jésus a agi comme celui qui était subversif, mais cependant comme celui qui était sans ego séparé. Sa liberté radicale était la liberté de l’amour, compassion, pardon, miséricorde, guérison et espérance. Agir dans un amour subversif, c’est savoir que l’amour fait partie de la vie. Jésus commença son ministère sans avoir peur de mourir parce que la puissance de Dieu était si forte en lui que la vie elle-même ne pouvait être éteinte. L’amour radical vous demande de vivre dans la victoire ultime de la vie, qui est Dieu ».
Ilia Delio envisage la mort de Jésus dans la plénitude de l’amour. « Jésus est mort dans la plénitude de l’amour. ‘Tout est accompli’ a-t-il dit. L’amour est complet quand nous avons fait tout ce que nous pouvons pour réaliser l’amour dans les personnes que nous sommes. Jésus est mort dans une mort terrible parce qu’il croyait que Dieu ne pouvait être anéanti par la terreur d’un pouvoir humain. Et il avait raison ». Notre véritable ennemi, « c’est la distorsion du pouvoir, un pouvoir qui s’érige à partir d’un niveau de pensée enfermé dans nos propres peurs égoïstes ».
Ilia Delio fait le procès de l’intellectualisme : « Nous nous enorgueillissons du pouvoir des idées, nous pensons qu’elles peuvent nous sauver, mais nous oublions comment être nous-mêmes ».
Au moment des célébrations de Paques, Ilia Delio ne se reconnaît pas dans ‘des liturgies interminables ou des prières en termes de formules’. « Cela devait être une célébration tous azimuts de la vie ». Elle appelle des « cris exprimant que la vie ne peut être anéantie par la mort, un engagement dans tout ce nous avons et tout ce que nous sommes, envers la plénitude de vie, la conviction que Dieu est actif et vivant dans la personne humaine, dans les arbres, les plantes, les petits animaux, les créatures vivantes de la terre… ». « Si nous nous sentions nous-mêmes remplis par ce Dieu de vie, alors nous nous précipiterions dans les chemins où la vie est bloquée par l’injustice, la guerre, l’insouciance, l’avidité, la pauvreté ». Ilia Delio évoque le remue-ménage fécond qu’on peut observer dans la vie de Jésus. C’est le fruit d’ ‘une vie remplie de l’Esprit’.
Les compétences conjuguées d’Ilia Delia, sa référence à la pensée de Teilhard de Chardin, sa perception de l’évolution des mentalités lui permettent de fonder sa théologie dans un champ de vision très large. Certes, certains de ses points de vue peuvent être contestés comme comportant trop de distance avec une interprétation biblique classique, mais, comme dans ce texte, elle apporte des éclairages qui font sens. Ici, en effet, elle aborde une question existentielle : la manière dont la condition mortelle de l’homme engendre une angoisse profonde qui se manifeste tout au long l’histoire de l’humanité et qui nous concerne chacun. Il arrive que la religion amplifie cette angoisse, comme ce fut le cas avec la théorie de l’expiation. Ici, Ilia Delio nous apporte une réponse libératrice. En effet, elle sait nous présenter comment, à un tournant de l’histoire juive, Jésus a fait l’expérience du Dieu d’Abraham et de Moïse au cœur de sa propre vie. La puissance de Dieu se manifesta en lui et, de cette puissance, un nouveau genre de personne, une personne divine émergea. Dans une puissance d’amour, de pardon, de compassion, il bouscula les habitudes et les frontières. Ce mouvement se heurta à une violente opposition qui provoqua sa mort terrible sur la croix. Mais, au total, c’est la dynamique de la vie divine qui l’a emporté. Jésus avait commencé son ministère sans avoir peur de mourir parce que la puissance de Dieu était si forte en lui que la vie elle-même ne pouvait être éteinte. Il est mort dans une mort terrible parce qu’il croyait que Dieu ne pouvait être anéanti par la terreur d’un pouvoir humain. Jésus est mort dans la plénitude de l’amour. L’amour radical nous demande de vivre dans la victoire ultime de la vie, qui est Dieu. Le texte d’Ilia Delio se termine sur une affirmation de la victoire finale de la Vie.
J H
- Death anxiety and the cross (les extraits sont traduits à partir de la version anglaise (traduction personnelle non professionnelle). Il existe une traduction française automatique) https://christogenesis.org/death-anxiety-and-the-cross
- Une spiritualité de l’humanité en devenir : https://vivreetesperer.com/une-spiritualite-de-lhumanite-en-devenir/
- Lytta Basset. Oser la bienveillance : https://vivreetesperer.com/bienveillance-humaine-bienveillance-divine-une-harmonie-qui-se-repand/
- Comment la conscience de la divinité de Jésus est apparue : https://vivreetesperer.com/comment-la-conscience-de-la-divinite-de-jesus-est-apparue/

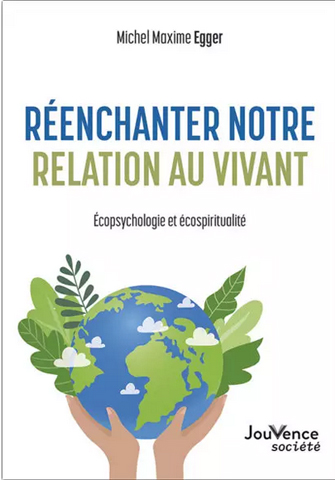
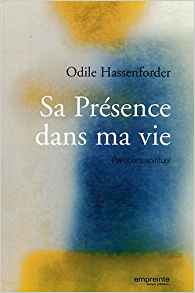
 Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.
Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.