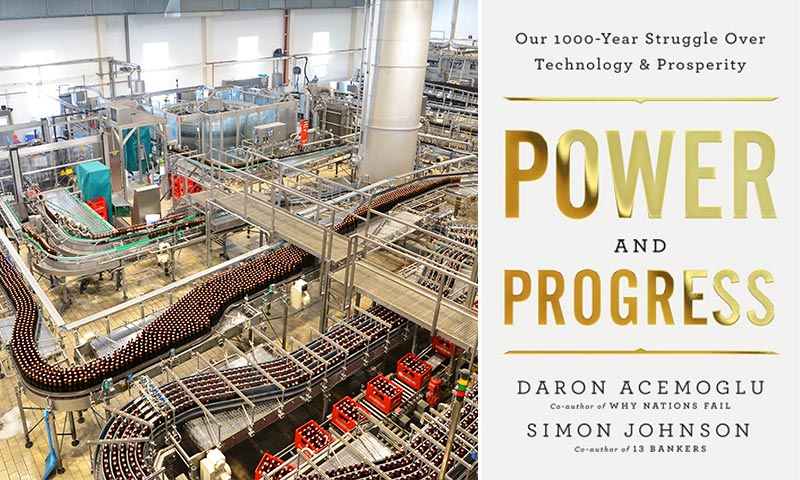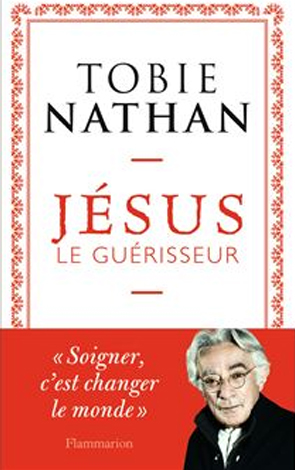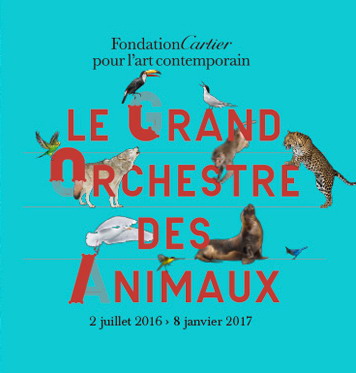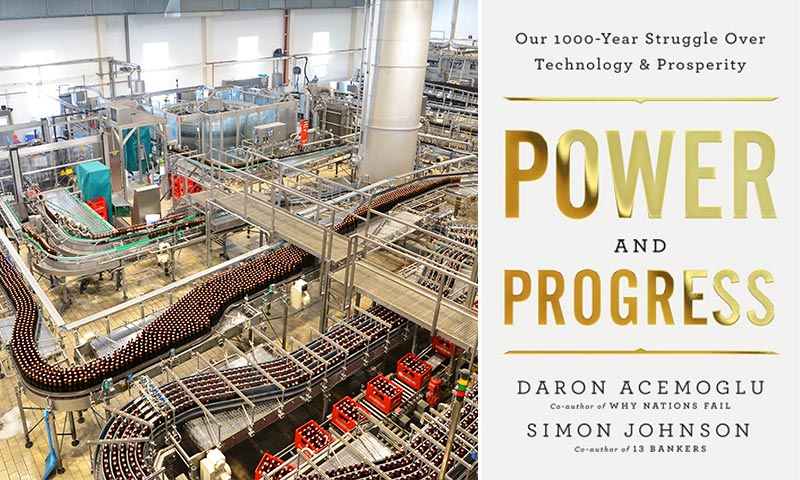
par jean | Déc 25, 2023 | Société et culture en mouvement |
Des exemples de l’histoire aux menaces actuelles.
Power and progress
Par Daron Acemoglu et Simon Johnson
Il n’y a pas très longtemps, tout ce qui paraissait un progrès technologique excitait l’enthousiasme comme la promesse d’une abondance dans une société prospère d’où disparaitrait la pauvreté et la misère. Aujourd’hui, on se rend compte qu’au cours des quatre dernières décennies, les sociétés occidentales et particulièrement la société américaine, ont pris le chemin inverse, en devenant beaucoup plus inégalitaires. Et on prend également conscience que la course au développement économique bouleverse notre écosystème planétaire et dérégule le climat par un usage forcené des énergies fossiles. Aujourd’hui, la conscience écologique suscite une réaction à l’échelle planétaire. Face à des ambitions démesurées, la prudence s’impose et on en appelle même aux mérites de la sobriété.
Deux chercheurs américains au MIT, Daron Acemoglu et Simon Johnson, directement confrontés à la course effrénée à l’automatisation qui bouleverse les équilibres de l’économie américaine, viennent d’écrire un livre qui situe nos problèmes actuels dans une histoire longue où l’on constate qu’en maintes périodes, les acquis du progrès technologique ont été confisqués par un groupe dominant aux dépens des travailleurs ayant porté cette innovation. Les auteurs nous apportent cependant une bonne nouvelle : à d’autres périodes, des forces sociales se sont élevées dans la société et ont permis un développement équilibré au bénéfice de tous. Ce livre : « Power and Progress. Our Thousand-year struggle over technology and prosperity” (1) nous montre comment garder notre autonomie par rapport aux dévoiements de processus économiques contrôlés à leur profit par des élites égoïstes ». « Le progrès n’est pas automatique, mais il dépend des choix que nous faisons en matière de technologie. De nouvelles manières d’organiser la production et la communication peuvent, soit servir les intérêts étroits d’une élite, soit devenir le fondement d’une prospérité étendue ». Ce problème est d’actualité « à un époque où les technologies digitales et l’intelligence artificielle accroissent l’inégalité et minent la démocratie à travers une automatisation excessive, une collecte massive des données et une surveillance intrusive ». « Il n’est pas obligé qu’il en soit ainsi. ‘Power and Progress’ démontre que la voie de la technologie peut être mise sous contrôle. Les formidables avancées informatique du dernier demi-siècle peuvent devenir des outils d’autonomisation et de démocratisation, mais pas si les décisions majeures demeurent dans les mains de quelques leaders technologiques animés par une hubris » (page de couverture). Ce livre, jusqu’à présent non traduit en français, est présenté en cette langue par un expert. On pourra se reporter à son article : « La chaire» a lu pour vous : https://www.chaireeconomieduclimat.org/points-de-vue/la-chaire-a-lu-pour-vous-power-and-progress-our-thousand-year-struggle-over-technology-and-prosperity-de-daron-acemoglu-et-simon-johnson/
Aussi, nous nous bornerons ici à présenter quelques aperçus significatifs de ce livre.
Comment des bénéfices de progrès technologiques substantiels ont été captés par une élite politique ou religieuse
Les auteurs remontent loin dans le passé pour mettre en évidence, la manière dont des progrès technologiques majeurs ont été captés par des élites politiques ou religieuses. Il y a environ douze mille ans, est apparu un processus menant à une agriculture installée, permanente, fondée sur des plantes et des espèces domestiquées. Des genres différents de société apparurent. Mais il y a 7000 ans, un régime particulier se développa dans le Croissant fertile. Le fondement était une agriculture avec une seule récolte. Les inégalités économiques s’intensifièrent et une haute hiérarchie sociale apparut, consommant beaucoup. En Égypte, pyramides et tombes se développèrent dans le cadre d’une élite comparable. C’est là que les auteurs mettent en évidence l’introduction des grains de céréales comme « un exemple d’innovation technologique ». Or, sous les auspices d’états centralisés, la condition des paysans semble avoir été pire que celle de leurs ancêtres. De fait, « les choix technologiques dans les premières civilisations ont favorisé les élites et appauvri la plupart des gens ». Les auteurs décriront une situation comparable au Moyen âge anglais. « Dans les deux cas, le système politique plaçait un pouvoir disproportionné dans les mains d’une élite. La coercition jouait un rôle bien sûr, mais le pouvoir de persuasion de la religion et les leaders politiques étaient souvent un facteur décisif » (p 115-120).
« Cependant, ni la monoculture du grain, ni l’organisation hautement hiérarchisée qui extorquait le surplus aux fermiers, n’a été ordonnée ou dictée par la nature des récoltes correspondantes. Même la culture de céréales n’a pas toujours produit l’inégalité et la hiérarchie comme l’illustrent les plus égalitaires vallées de l’Indus et la civilisation mésoaméricaine. La culture du riz dans l’Asie du Sud-est a pris place dans le contexte de sociétés moins hiérarchiques… (p 122).
« Contrairement à une opinion répandue, il y a eu un changement et une amélioration technologique significative dans la productivité économique de l’Europe au Moyen Age… Cependant, il y a quelque chose de tout à fait sombre à cette époque. La vie des gens travaillant la terre resta dure et le niveau de vie des paysans peut même avoir décliné dans certaines parties de l’Europe. La technologie et l’économie ont progressé d’une manière qui s‘est révélée nuisible pour la plus grande part de la population » (p 100-101). En Angleterre, le développement des moulins a été une innovation décisive. A la fin du XIe siècle, il y a environ 6000 moulins à eau en Angleterre et ce nombre a doublé durant les deux siècles suivants et leur productivité s’est accrue. La productivité agricole s’est également accrue. Malheureusement, il n’y a pas eu une élévation correspondante des revenus chez les paysans. Le surplus a été, de fait, majoritairement consommé par « la hiérarchie religieuse qui a construit des cathédrales, des monastères et des églises » (p 103). Cette construction a été couteuse. Le contrôle féodal a exercé une coercition : « Comme les nouvelles machines se déployaient et que la productivité augmentait, les seigneurs féodaux ont exploité plus intensément la paysannerie ».
Les auteurs nous rapportent ensuite comment s’est déroulée, au XVIIIe siècle en Angleterre, la pression en faveur de la clôture des terres, les « enclosures ». « Cette histoire a montré clairement que cette réorganisation technologique de la production, même lorsqu’elle était proclamée dans l’intérêt du progrès et du bien commun, avait pour conséquence de mettre davantage à bas ceux qui étaient déjà dépourvus de pouvoir ».
Les auteurs envisagent ensuite deux moments de l’histoire très différents où le progrès technologique n’a pas profité aux travailleurs, mais a participé à leur asservissement : l’introduction de l’égraineuse de grains de coton dans les plantations américaines à la fin du XVIIIe siècle ; le développement du machinisme agricole dans les années 1920 en Union soviétique. « Le secteur cotonnier a fleuri Etats-Unis grâce aux nouvelles connaissances comme l’égraineuse de coton et d’autres innovations aux dépens des esclaves noirs travaillant dans les grandes plantations. L’économie soviétique a grandi rapidement dans les années 1920 en utilisant le machinisme, tel que les tracteurs et les moissonneuses batteuses, appliqué aux champs de céréales. Cependant, la croissance s’est produite au détriment de millions de petits paysans » (p 133).
Lorsque la prospérité accompagne le progrès technologique
Les auteurs nous présentent dans ce livre une histoire du progrès technologique. Ils consacrent ainsi le chapitre 5 à la grande révolution industrielle qui a métamorphosé le visage économique de la Grande-Bretagne au XVIIIe et XIXe siècle. Ce fut l’invention bouleversante de la machine à vapeur. Ce livre nous rapporte cette épopée industrielle, le développement des mines de charbon, la fulgurante expansion des chemins de fer et une dynamique d’invention et de réalisation de nouvelles machines.
Un changement technologique et économique aussi conséquent et radical apparait dans l’histoire comme un phénomène original. Les auteurs s’interrogent donc sur les facteurs originaux de cette irruption. Ils mettent l’accent sur un facteur « souvent sous-estimé » : « l’émergence d’une classe moyenne nouvellement enhardis : entrepreneurs et hommes d’affaires. Leurs vies et leurs aspirations étaient enracinés dans les changements institutionnels qui avaient commencé à donner du pouvoir à ce milieu social depuis le XVIe et le XVIIe siècle. La Révolution industrielle peut avoir été propulsée par les ambitions de gens nouveaux essayant d’améliorer leur richesse et leur standing social, ce qui était loin d’une vision inclusive » (p 45-46).
En effet, au début de la Révolution industrielle, si des hommes ont participé à un enthousiasme innovant, « la première phase de cette Révolution a été appauvrissante et affaiblissante pour la plupart des gens. C’était la conséquence d’un fort parti pris d’automatisation et dans le manque de voix ouvrière en regard de la fixation des salaires. Ce ne sont pas seulement les moyens de subsistance qui ont été affectés négativement par l’industrialisation mais aussi la santé et l’autonomie d’une bonne part de la population.
Cette affreuse image a commencé à changer dans la seconde partie du XIXe siècle quand des gens ordinaires se sont organisés et ont provoqué des réformes politiques et économiques. Les changements sociaux ont modifié l’orientation de la technologie et fait monter les salaires. Ce fut seulement une petite victoire pour une prospérité partagée et les pays occidentaux auront à cheminer plus longuement sur un chemin contesté, technologique et institutionnel, pour réaliser une prospérité partagée » (p 56).
Selon les auteurs, l’emploi dépend des modes d‘industrialisation. Au début de la révolution industrielle, l’automatisation de la filature et du tissage a nui à l’emploi. Au contraire, dans la période ultérieure, le développement des chemins de fer a suscité toute une gamme d’emploi.
« Les avancées dans les chemins de fer suscitèrent beaucoup de nouvelles tâches dans l’industrie des transports et les emplois requéraient toute une gamme de capacités de la construction à la vente de tickets, maintenance, ingénierie, et management » (p 196). Des contrepoids sont apparus permettant le partage des bénéfices du progrès technologique. « Un machinisme et des méthodes de production se sont développés et ont accru la productivité de l’industrie britannique, en même qu’elle étendait aussi la gamme de tâches et d’opportunités pour les travailleurs. Mais le progrès technologique n’est jamais suffisant en lui-même pour élever les salaires. Les travailleurs ont besoin de développer un plus grand pouvoir de négociation vis-à-vis des employeurs ». C’est en 1871 que les syndicats devinrent pleinement légaux en Grande-Bretagne (p 202).
Il y a d’autres périodes où le progrès technologique a contribué à une diversification et à une multiplication des emplois. Les auteurs étudient en ce sens le développement de l’électrification et celui de la production d’automobiles aux Etats–Unis. Ils envisagent la grande période de progrès technologique, de croissance économique et de bien-être social qu’ont été les trois décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale. « Les Etats-Unis et les nations industrielles ont fait l’expérience d’une croissance économique rapide qui a été largement partagée par la plupart des groupes démographiques. Ces tendances économiques ont été de pair avec d’autres améliorations sociales, incluant l’expansion de l’éducation, les soins de santé et l’augmentation de l’espérance de vie. Ce changement technologique n’a pas seulement automatisé le travail mais il a aussi créé de nouvelles opportunités pour les travailleurs et ceci s’est inscrit dans un cadre institutionnel qui a renforcé les contre-pouvoirs » (p 36).
« Quelle a été la sauce secrète de la prospérité partagée dans les décennies ayant suivi la seconde guerre mondiale ? La réponse réside en deux éléments : une direction de la technologie qui a créé de nouvelles tâches et emplois pour des travailleurs de tous les niveaux de qualification et un cadre institutionnel permettant aux travailleurs de partager les gains de productivité entre employés et employeurs » (p 240). Les auteurs traitent de cette histoire aux Etats-Unis en montrant comment elle a notamment bénéficié des réformes du New Deal et il aborde cette histoire équivalente de progrès en Europe dans le contexte de la reconstruction après la guerre et un esprit social tel qu’il a été exprimé en Angleterre dans le Rapport Beveridge qui proclame « l’abolition du besoin » (p 249).
Faire face aujourd’hui à la nouvelle crise économique qui est venue s’inscrire dans la révolution digitale à travers un accroissement des inégalités et la menace d’une automatisation dévastatrice.
Née aux Etats-Unis et portant d’extraordinaires promesses, la révolution digitale y a été détournée à la fin du XXe siècle. « Les technologies digitales sont devenues le cimetière de la prospérité collective. L’augmentation des salaires a baissé, la part du travail dans le revenu national a diminué fortement et l’inégalité des salaires a surgi autour de 1980. Bien que de nombreux facteurs, incluant la globalisation et l’affaiblissement du mouvement syndical, aient contribué à cette transformation, le changement opéré dans la technologie est le plus important. Les technologies digitales ont automatisé le travail et désavantagé le travail par rapport au capital et les travailleurs peu qualifiés par rapport aux diplômés universitaires » (p 257). Dans la plupart des économies industrialisées, la part du travail a diminué. Aux Etats-Unis, la régression a pris un tour particulièrement défavorable. Un fossé s’est à nouveau accru entre les salaires des blancs et des noirs. L’inégalité s’est considérablement accrue.
Les auteurs en imputent la cause principale à un automatisation massive. Dans les décennies précédant la seconde guerre mondiale, l’automatisation est également rapide, « mais elle était contrebalancée par d’autres changements technologiques qui augmentaient la demande de travail.
La recherche récente montre que depuis 1980, l’automatisation s’est accélérée significativement et qu’il y a moins de tâches et de technologies nouvelles qui créent des opportunités pour les gens. Ces changements entrent pour beaucoup dans la détérioration de la position des travailleurs dans l’économie…
L’automatisation a été aussi un accélérateur majeur de l’inégalité en affectant des tâches remplies particulièrement par des travailleurs peu ou moyennement qualifiés » (p 261).
Les auteurs soulignent qu’il n’y a pas là une fatalité. « La technologie a accru les inégalités à cause des choix que des entreprises ou de puissants acteurs ont effectué. La globalisation n’est pas séparée de cette question… De fait, il y a eu une synergie entre automatisation et globalisation avec le même souci de réduire les coûts du travail et le nombre de travailleurs moins qualifiés. Ce processus a été facilité à la fois par le manque de contre-pouvoirs dans le milieu du travail et par l’évolution politique depuis 1980 (p 263). Les auteurs dressent un tableau des pressions exercées par les grandes entreprises et les milieux d’affaire et ils mettent en évidence les idéologies correspondantes telles que la « doctrine Friedman ». Dans d’autres pays, les dérives ont été moins marquées. Les auteurs mentionnent les cas de l’Allemagne et du Japon où on a combiné l’automatisation et la création de tâches nouvelles (p 286).
Les auteurs critiquent une nouvelle ‘utopie digitale’ : « la transformation de l’éthique des hackers en une utopie digitale corporative est largement liée à une poursuite de l’argent et du pouvoir social » (p 289). C’est une idéologie de la ‘disruption’, une forme sauvage d’innovation qui détruit les anciens équilibres. « Ce biais technologique est très largement un choix, et un choix construit socialement. Alors les choses ont commencé à devenir bien pires économiquement, politiquement et socialement, alors que les nouveaux visionnaires trouvent un nouvel outil pour refaire la société : l’intelligence artificielle » (p 296).
Pourquoi considérer l’intelligence artificielle avec réserve et avec prudence
Dans la perspective de l’histoire récente de l’usage d’internet, l’emballement de certains vis-à-vis de la promotion de l’intelligence artificielle parait suspect.
Les auteurs consacrent un chapitre à l’intelligence artificielle en en montrant les usages potentiels, les apports, les risques et aussi les limites. Nous renvoyons à ce chapitre écrit avec maitrise et expertise ; ‘Artificial struggle’ (p 297-338). Nous en rendrons compte ici par une courte présentation des auteurs. « Ce chapitre explique que la vision d’internet post-1980 qui nous a égarés, en est venue aussi à définir comment concevoir la nouvelle phase des technologies digitales, ‘l’intelligence artificielle’ et comment l’intelligence artificielle exacerbe les tendances vers l’inégalité économique.
En contraste des proclamations effectuées par beaucoup de leaders de la tech, nous verrons aussi que dans la plupart des tâches humaines, les technologies actuelles de l’intelligence artificielle apportent seulement des bénéfices limités. De plus, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la surveillance au lieu de travail ne propulse pas seulement l’inégalité, mais elle prive également les travailleurs de leur pouvoir d’action (disempower). Pire, un usage courant de l’intelligence artificielle risque de renverser des décennies de gain économique dans les pays en développement en exportant globalement l’automatisation. De tout cela, rien n’est inévitable. Ce chapitre développe une argumentation selon laquelle l’intelligence artificielle, et même l’accent sur l’intelligence de la machine, reflète une approche très spécifique du développement des technologies digitales, une approche qui a de profonds effets dans la répartition des richesses, en bénéficiant à quelques personnes et en laissant le reste derrière.
Plutôt que de se focaliser sur l’intelligence des machines, il serait plus profitable de lutter pour une utilité des machines (‘machine usefulness’) en envisageant combien les machines peuvent être très utiles aux humains, par exemple en complétant les capacités des travailleurs. Comme elle s’est mise en œuvre dans le passé, l’utilité des machines conduit à quelques-unes des applications les plus importantes et les plus productives des technologies digitales, mais qui ont été de plus en plus mises de côté par l’intelligence de la machine et l’automatisation » (p 37).
Cependant l’intelligence artificielle se déploie à un autre niveau, au niveau de la société elle-même. Et elle y pose problème, car « la collecte et la moisson massive de données utilisant l’intelligence artificielle sont en voie d’intensifier la surveillance des citoyens par les gouvernements et les entreprises. En même temps, les modèles d’affaire fondés sur la publicité s’appuyant sur la puissance de l’intelligence artificielle propagent la désinformation et amplifient l’extrémisme ». Les auteurs nous mettent ainsi en garde vis-à-vis de l’intelligence artificielle. « Son utilisation courante n’est bonne ni pour l’économie, ni pour la démocratie et ces deux problèmes malheureusement se renforcent l’un l’autre ». (p 37)
Dans la situation critique dans laquelle nous nous trouvons, comment réorienter la technologie ?
Les auteurs ne se bornent pas à un diagnostic critique de la situation. Déjà, à travers l’examen de l’histoire longue auquel ils ont procédé, nous avons compris que le progrès technologique n’est pas une panacée, que ses effets dépendent d’un contexte plus général, des orientations qui sont prises, d’un choix de société. Bref, le progrès technologique n’est pas la réponse à tous nos problèmes. Et on peut, on doit ne pas considérer son orientation présente comme une fatalité.
Dans le dernier chapitre du livre, les auteurs nous apprennent et nous invitent à rediriger le changement technologique (‘redirecting technology’).
Aujourd’hui rediriger le changement technologique, c’est en premier, faire face à la menace existentielle du changement climatique. Or, à cet égard, il y a eu « de remarquables avancées dans les technologies de l’énergie renouvelable ».
Finalement, « Aujourd’hui, les énergies du soleil et du vent sont produites à meilleur marché que les énergies fossiles » (p 389). La différence est devenue significative. Comment ce changement a-t-il pu intervenir ? Les auteurs mettent l’accent sur le rôle du ‘changement de narratif’ ; du développement du mouvement écologique qui s’en est suivi et l’a accompagné, et des mesures qui en sont résultées.
« Du point de vue du défi posé par les technologies digitales, on peut apprendre beaucoup de la manière dont la technologie est redirigée dans le secteur de l’énergie. La même combinaison – changer le narratif, développer des pouvoirs faisant contrepoids et développer et mettre en œuvre des politiques spécifiques – voilà ce qui peut également marcher pour rediriger la technologie digitale» (p 392). Les auteurs posent les problèmes de la technologie digitale en ces termes : « La puissance concentrée des entreprises digitales nuit à la prospérité parce qu’elle limite le partage des gains réalisés grâce au changement technologique. Mais son effet le plus pernicieux se manifeste dans l’orientation de la technologie qui se dirige excessivement vers l’automatisation, la surveillance, la collecte des données et la publicité. Pour regagner une prospérité partagée, nous devons rediriger la technologie et cela signifie une version de la même approche que celle qui a fonctionné pour les progressistes, il y a plus d’un siècle » (p 393). « Cela doit commencer par changer le narratif et les normes ». On retrouve dans ce chapitre les mises en garde et les orientations qui parcourent cet ouvrage avec comme grandes recommandations : changer le narratif, bâtir des pouvoirs faisant contre-poids et développer des techniques, des régulations et des politiques pour traiter des aspects spécifiques du biais social de la technologie » (p 38). Voilà un ouvrage auquel nous pouvons nous référer pour mieux comprendre les enjeux actuels de la technologie digitale et faire face aux menaces présentes.
J H
- Daron Acemoglu, Simon Johnson. Power and Progress. One thousand-year struggle over technology and prosperity. London, Basic Books, 2023.
par | Jan 23, 2013 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |
La traversée en voiture de la grande banlieue parisienne nous a préparées peu à peu au changement de paysage culturel dont nous faisons l’expérience en approchant du collège où nous devons intervenir. Arrivées en avance, nous avons le temps de faire une halte dans un petit café tout proche. Pas une femme à l’intérieur. Nous amadouons le patron en lui disant que nous venons prendre un réconfort avant d’attaquer notre tâche délicate dans le collège voisin : il nous fait apporter deux tasses de café, déposées sur le comptoir à côté d’un tronc marqué « Pour l’entretien de la mosquée ». « Vous êtes enseignantes ? », nous demande-t-il – Non, nous animons des séances d’éducation à la paix – Ah mesdames, il faut venir nombreuses, » répond-il, une expression soudainement triste sur le visage, « ici on est dépassé par nos jeunes ! »
Quelques instants plus tard Marie Lou et moi traversons la cour du collège, surplombée par des barres d’immeubles où logent la plupart des élèves avec leur famille. Trois jeunes garçons, d’une douzaine d’années, nous sont amenés par l’éducatrice spécialisée. Nous sommes bientôt rejoints par Myriam, qui fait aussi partie du groupe, mais qui finissait juste de tresser les cheveux d’une amie !
Nous sommes conduits dans une salle accueillante, de taille réduite, réservée au travail de l’éducatrice qui, dans le cadre d’un Dispositif Nouvelle Chance agréé par l’Education nationale, accompagne des petits groupes d’élèves ayant décroché, pour motifs divers, de la scolarité courante.
Depuis quelques mois deux d’entre nous, engagées avec le programme Education à la paix, viennent une fois par semaine pour contribuer à ce processus, avec nos propres activités.
Nous consacrons trois heures d’affilée à quatre de ces jeunes, différents d’une fois sur l’autre.
En début de séance, nous nous présentons puis nous invitons les enfants à visionner une courte vidéo, intitulée Caméra café, qui se veut drôle mais induit des situations de tensions entre les protagonistes de l’histoire. Nous remettons ensuite à chacun le texte imprimé du scénario pour le relire ensemble, ayant distribué les rôles. Nous constatons chez les jeunes de réels talents d’interprétation. Ils seront prompts, ensuite, à identifier les situations qui génèrent sentiments de violence ou d’injustice.
On en vient à parler de la vie au collège. Les jeunes nous font vite sentir qu’il y a un grand décalage entre les idées de notre programme et ce qu’ils vivent ici. Myriam prend respectueusement la parole ; elle s’exprime dans un français qui m’impressionne pour une fillette de onze ans « en difficulté scolaire » : « Vous savez, la plupart des jeunes ici n’ont pas ce langage que vous tenez. D’ailleurs c’est pas bien d’être ici, nous dit-elle, il y a beaucoup de grossièreté. Et puis, il n’y a pas de solidarité. » « Oui, ajoute un garçon, sur le mur d’entrée on voit liberté égalité fraternité, mais ici on vit pas ça. Et pour se défendre il faut savoir se battre. » Marie Lou acquiesce à l’idée qu’il faut se défendre, que c’est important, mais se défendre veut-il dire nécessairement frapper ? « On se voit pas faisant autrement, Madame, sinon on se ferait traiter de tapettes. Et puis il y a les grands frères qui s’en mêlent quelques fois. » Marie Lou demande : « Est-ce que vous êtes contents que ça marche comme ça ici, qu’on ne crée des relations que par la peur, et que ça devienne une habitude ? » Silence. « Vous voudriez d’un monde où c’est partout comme ça ? – Ben non bien sûr … – Et bien, reprend Marie Lou, je vous assure que pour régler des conflits, il faut être hyper créatifs, hyper intelligents. – Oui mais justement nous on n’est pas vraiment … intelligents. – Qu’est ce que c’est être intelligent ? – C’est … être des intellos. » Et Myriam de nous expliquer que, par exemple, elle n’a pas de bons résultats scolaires. Marie Lou rétorque qu’il y a bien d’autres signes d’intelligence que les résultats scolaires.
Et nos quatre jeunes en seront bien la preuve. Lors d’une séquence de l’animation, une trentaine de photos, représentant des situations ou des objets les plus divers, seront étalées sous leurs yeux. Il leur sera demandé d’en choisir en silence deux chacun : une représentant un objet ou une situation qu’ils aiment, la seconde au contraire quelque chose qui leur déplait.
Les deux choix de Myriam et Kevin seront les mêmes, mais pour des raisons opposées ! Une photo représente quatre vieilles femmes parlant ensemble sur un banc au soleil : Myriam aime cette photo qui lui fait penser à ses conversations avec sa grand-mère, au Maroc. Cette grand-mère qui dit à sa petite fille que même si elle n’aime pas l’école, elle a de la chance d’apprendre à lire et écrire. « J’aime parler avec les vieilles personnes, on apprend toujours des choses intéressantes », insiste Myriam malgré les moqueries de ses camarades que cette scène de vieillards révulse franchement. Ce n’est pas pour rien que Kevin l’a choisie comme le dernier endroit où il voudrait être. « C’est vrai que quelquefois les vieux disent des choses pas intéressantes, dit Myriam, mais ça m’est égal, et dans ce cas là je m’endors à côté d’eux, je me sens en sécurité. » Quant à la scène des amoureux, c’est celle-là qui la révulse : « C’est dégoûtant, c’est violent, j’aurais honte qu’un membre de ma famille me voit dans cette position ! – Ouais, tu dis ça, mais dans quelques années tu changeras d’avis », s’esclaffent les garçons. Et d’ailleurs Kevin ne cache pas du tout que lui rêverait de vivre déjà une histoire amoureuse, c’est pour cela qu’il a choisi cette photo comme sa préférée ! Les choix des autres jeunes seront aussi des occasions d’échanges animés, les images interpellant vivement leurs imaginaires et leur univers émotionnel.
La fin de la séance approche. On distribue à chacun une feuille de papier qui préfigure une lettre qu’il va s’écrire à lui-même. Celle-ci sera ensuite glissée dans une enveloppe sur laquelle sera inscrite l’adresse de l’auteur. Dans un mois nous expédierons les lettres. Marie Lou va d’un garçon à l’autre pour les aider à entrer dans le jeu. La démarche est prise au sérieux. Chacun se concentre dans son coin. Quant à Myriam, elle me confie qu’elle n’est « pas bonne à l’écrit » et me demande si je peux écrire ce qu’elle va me dire. « Mais c’est personnel, c’est secret », lui dis-je. « Je n’ai rien à cacher », rétorque la fillette. Puis elle regarde droit devant elle et après un petit silence me dicte les réponses qu’elle veut donner aux trois questions pré imprimées sur sa feuille : Chère Myriam, … Voilà ce que tu as retenu de l’animation à laquelle tu as participé le … juin au collège : (Réponse de Myriam) ce que je pense de moi-même est plus important que ce que les autres pensent de moi. Je peux régler mes problèmes autrement que par la bagarre.
Voici ce que tu aimerais voir changer dans le collège : (Réponse de Myriam) qu’il y ait moins de grossièreté, plus de respect et que les gens arrêtent d’avoir des préjugés les uns sur les autres d’après les vêtements qu’on porte ou comme on parle.
Voici ce que tu es prête à faire pour aider les choses à changer : (Réponse de Myriam) plutôt que de taper, je parlerai avec les autres pour comprendre la cause du problème. Je serai plus coopérante pour les aider Je ferai comme je sens qui est bien au fond de moi et qui m’apporte la paix. Je devrais être plus concentrée en classe. »
Pardon Myriam de divulguer ainsi tes pensées : j’ai changé ton nom pour préserver l’anonymat. J’ai une grande excuse : faire savoir que dans des milieux difficiles grandissent des enfants comme toi qui ont plein de pépites au fond du cœur et dont l’intelligence vibre déjà très fort à l’interpellation de valeurs qui ne sont pas celles du milieu ambiant. Ton répondant à notre animation justifie tous les efforts entrepris pour mettre au point des programmes d’éducation à la paix dans tous les milieux. Et il constitue un grand message d’espoir!
Nathalie CHAVANNE
Le Programme Education à la Paix, est un des programmes portés par l’Association Initiatives et Changement.
Il met au point des espaces structurés de réflexion et d’expression, où, dans des contextes divers, les jeunes peuvent développer leurs compétences sociales en faveur d’un meilleur vivre ensemble et d’une ouverture à l’initiative citoyenne.
Programme : Education à la paix
Dialoguer, apprendre à vivre ensemble, agir en citoyen.
7 bis, rue des Acacias
92130 Issy-les-Moulineaux
http://www.fr.iofc.org/
par jean | Oct 3, 2022 | Vision et sens |
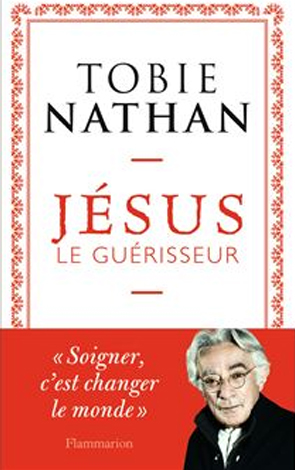 Selon Tobie Nathan, ethnopsychiatre
Selon Tobie Nathan, ethnopsychiatre
A travers une pratique pionnière, Tobie Nathan est devenue une figure majeure de l’ethnopsychiatrie en France. L’ethnopsychiatrie est psychologie transculturelle qui associe psychologie clinique et anthropologie culturelle. Tobie Nathan a notamment mis en évidence la part des croyances dans la prise en charge des maladies mentales. En relation avec des personnes venant de tous les continents, Tobie Nathan a été amené par l’une d’entre elles, à reconnaître la pratique de guérison exercée au nom de Jésus. En conséquence, il a donc entrepris une recherche sur Jésus qui a débouché sur l’écriture d’un petit livre : Jésus le guérisseur (1). « Jusqu’à la rencontre avec Gabriela, personne ne m’avait incité à examiner au plus près Jésus, l’homme donc et non la religion qui a découlé de son enseignement » (p 13). « Si l’on examine son parcours, Jésus a essentiellement parlé, réuni et guéri. C’est donc à l’analyse de ce personnage politique et thérapeute que j’ai voulu consacrer ces pages » (p 13).
L’auteur nous dit dans quel esprit, il a entrepris cette recherche.
« Je voudrais d’abord retracer le parcours personnel de Jésus, pour lequel je ressens une sympathie particulière – un personnage omniprésent dans notre monde alors qu’on sait assez peu sur lui…
Jésus imprègne notre vie quotidienne par des paroles, des expressions, des maximes, par une morale aussi, et une certaine vision politique. Il est partout dans les expressions de notre langue, dans nos proverbes, nos habitudes mentales, mais également dans l’art et la musique » (p 17). Jésus apparaît même dans des troubles psychiatriques. « Jésus est un interlocuteur : on l’appelle, on l’invoque, on le prie. Il est le compagnon des laissés-pour-compte, des démunis, des malades. Ici en France, en Europe, mais aussi très loin d’ici en Afrique, en Amérique du sud et de plus en plus en Chine… » (p 18).
Dans sa recherche historique, l’auteur estime que les sources historiques fiables sont peu nombreuses. « Pour élaborer cet exposé, je suis allé puiser dans les ressources historiques, celles qui reconstituent l’époque, l’atmosphère où Jésus a vécu : j’ai eu très peu recours aux exégèses théologiques. Il va de soi que Jésus, c’est aussi le Christ, le
sauveur, à la fois homme et dieu. Je n’aborderai ici que sa part d’histoire et dans une double perspective qui me questionne – et, je l’avoue, me fascine : Jésus le politique et Jésus le guérisseur. J’espère ne froisser personne en ne discutant que sa part d’histoire. Mais l’honnêteté exige que l’on n’outrepasse pas la frontière de ses compétences » (p 19).
Jésus, leader politique et guérisseur
Si ce livre, dans son sous-titre, met l’accent sur le rôle de Jésus comme guérisseur, l’ouvrage lui-même traite pour une bonne part d’un autre rôle, cher à l’auteur, celui de leader politique contre l’occupant romain. Tobie Nathan se montre ici connaisseur de la civilisation et de l’histoire juive. Et c’est dans cette connaissance que s’égrainent des chapitres comme : Son nom d’abord, parce que le nom, c’est la personne ; Le contexte, le lieu et les choses ; Les forces politiques ; Des mouvements contre l’occupant ; les actes politiques de Jésus ; le Royaume de Dieu…
« En Jésus, dominent deux dimensions à la source de mes réflexions » affirme l’auteur ». « Il y a d’abord la part politique de Jésus, un révolutionnaire juif, un militant en révolte radicale contre l’occupation romaine de la Judée, « le pays des juifs », poursuivant de sa vindicte les collabos du Temple et ceux du Palais, acclamé par une partie du peuple comme « Roi des juifs » avant d’être crucifié comme la plupart des agitateurs politiques de l’époque » (p23).
L’auteur met ensuite en exergue une autre dimension. « La seconde dimension tient dans son activité clinique… Son œuvre a principalement été de soigner les malades. Il rendait la vue aux aveugles, leurs jambes aux paralytiques ; il nettoyait les lépreux de leurs plaies et débarrassait les agités des démons » (p24). Cette activité suscite l’éloge de l’expert qu’est pour nous Tobie Nathan : « Un thérapeute, et de la plus pure espèce… Et comme tous les thérapeutes, il parlait des « paroles à l’envers », dirait mon collègue yoruba du Bénin, dont chacune a pénétré notre univers. Par là, je veux dire qu’il s’agit de paroles surprenantes exigeant un arrêt, une interprétation, des paroles paradoxales, des admonestations souvent qui fracturent des évidences… Un thérapeute, un vrai ! » (p 24).
Mais quel lien entre ces deux activités ?
« Si l’on examine le travail du thérapeute, on se demande ce qu’il a à voir avec la politique. » Dans la réponse, Tobie Nathan s’engage : « Mon hypothèse est précisément que les deux dimensions sont imbriquées ou plutôt que Jésus les a nouées ensemble, que c’est précisément là son originalité fondamentale, son « invention » (p 24-25).
En commentaire, pour notre part, la focalisation sur le rôle politique de Jésus témoigne de la diversité des points de vue selon les parcours et les sources, mais, tout en reconnaissant l’importance du contexte politique, elle ne correspond pas à notre interprétation personnelle. Citons, entre autres : « Mon Royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon Royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré… » (Jean 18.36). Notre propos ici est de recevoir l’éclairage que l’auteur apporte sur le rôle de Jésus comme thérapeute et guérisseur.
Tobie Nathan : histoire d’une vie
La démarche de Tobie Nathan s’inscrit dans une histoire de vie. Une interview oubliée sur le site du Monde nous en dit beaucoup à cet égard (2).
Né au Caire en 1948, il en est brutalement chassé en 1957 en même temps que 25 000 juifs d’Égypte. Ses parents immigrent en France. Leur vie est difficile. « Dans la cité de Gennevilliers où j’ai grandi au nord-ouest de Paris, la vie à la maison n’est pas très facile. Il y avait une douleur, un poids. D’abord parce qu’on était pauvre. Mais surtout en raison de la séparation avec le reste de la famille ». De plus, Tobie ne se sent pas à l’aise à l’école française. « Dès l’école communale, j’ai toujours exécré l’école française, à cause de l’uniformisation obligatoire que comporte cette institution ». Tobie Nathan a donc mal vécu sa condition d’immigré. Le souvenir de cette expérience va l’accompagner et l’aider à comprendre les problème des migrants.
En 1969, étudiant en psychologie et ethnologie, il rencontre pour la première fois le professeur Georges Devereux, le fondateur de l’ethnopsychiatrie en France. C’est avec lui qu’il réalisera sa thèse et, si, par la suite, ils se séparent, il donne son nom au centre qu’il crée en 1993. « Le centre Georges-Devereux s’est ouvert en 1993 dans le cadre de l’Université Paris VIII à Saint-Denis. Ce fut une période extraordinaire. Enfin on allait faire de la vraie psychologie en France. C’est à dire un endroit universitaire où on reçoit des patients, où l’on forme les étudiants en thèse et où l’on enseigne. Personnellement, c’est là que j’ai tout appris. De nos patients, bien sûr. Mais aussi de nos étudiants étrangers qui appartenaient souvent aux mêmes ethnies que les patients que nous recevions ».
Comment Tobie Nathan définit-il l’ethnopsychiatrie ? « Cela consiste à apprendre des autres peuples les connaissances qu’ils ont des troubles psychiques et de leur traitement, à tenir compte de leurs rites ancestraux pour les soigner ».
En 2003, Tobie Nathan abandonne le Centre Devereux pour partir à l’étranger. Il dirige le bureau de l’Agence française pour la francophonie pour l’Afrique des grands lacs au Burundi, puis le service culturel de l’ambassade française en Israël et en Guinée-Conakry. « Ce qui m’a changé, c’est de vivre en Afrique ».
De retour en France, il dirige le Centre d’aide psychologique qu’il a créé. Et il reçoit les jeune gens signalés par leur famille comme étant en danger de radicalisation islamique. « J’ai rencontré des gamins d’un bon niveau qui se posent des questions importantes me rappelant celles que je me posais à leur âge… Cela m’a incité à me questionner sur eux, mais aussi sur moi-même. En France, on ne sait pas penser l’étranger… On va être obligé d’admettre qu’il y a des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ont des dieux qui ne sont pas les nôtres et qu’il va falloir négocier avec eux une coexistence ».Tobie Nathan constate que de nombreux jeunes qui se radicalisent comblent un vide engendré par une perte de continuité culturelle. Dans son livre : « Les âmes errantes », il rapporte des histoires révélatrices.
Issu d’une famille rabbinique, Tobie Nathan se déclare juif comme « ayant des ancêtres, de gens auxquels on se réfère comme étant un début de lignée ». Il espère croire en Dieu un jour. « Chez les juifs, croire c’est l’aboutissement d’un travail, ce n’est pas le début. La croyance est un cadeau, et c’est un cadeau que je n’ai pas encore reçu ».
Une rencontre révélatrice : Gabriela
Dans sa pratique, Tobie Nathan se trouve constamment en rapport avec un vécu international. C’est une source de connaissance et d’ouverture. Et c’est ainsi que la rencontre avec Gabriela lui a ouvert une nouvelle piste : la guérison au nom de Jésus.
« Je l’appellerai Gabriela. Elle m’a montré des photos d’elle à vingt ans sur une plage brésilienne. A 22 ans, elle a épousé un Guyanais, chercheur d’or de passage au Brésil. Après des revers de fortune et plusieurs émigrations, elle s’était retrouvée dans une cité HLM d’une commune de Seine-Saint-Denis. Voici des années que son mari l’avait quittée, parti chercher de l’or en Angola, la laissant seule avec ses trois garçons… Il y a quelques années, lorsque son ainé a atteint 16 ans, Gabriel a appris par un ami revenu d’Afrique que son mari était mort… ». C’est alors que s’est déclenchée la délinquance des enfants.
Gabriela s’est effondrée.
Après une grave dépression et plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, elle a trouvé refuge et consolation au sein d’une Eglise évangélique. Peu à peu, elle s’est rapproché du berger, l’a secondé dans son travail auprès des fidèles » (p 11-12). Tobie Nathan commente alors : « Sa facilité à communiquer avec les esprits ou les anges qu’elle tenait peut-être de ses ancêtres, s’est bientôt manifestée dans l’église en de véritables transes. Régulièrement, il lui arrive de « parler en langues ». Quelquefois, lorsqu’elle est dans cet état, elle opère des « délivrances », c’est-à-dire des thérapies de personnes en détresse. Et c’est toujours au nom de « Jésus ». Gabriela dit qu’elle chasse les « mauvaises influences » qu’elle qualifie parfois de démons ou de diables. Elle m’assure que les fidèles s’en portent mieux. Je la crois ». (p 12-13).
Tobie Nathan nous rapporte comment la relation avec elle s’est établie et comment elle a porté du fruit. « Psychologue, je l’ai reçue durant des années. Nous parlions le plus souvent de ses problèmes de famille, puis, au fur à mesure que son état psychologique s’améliorait, de politique, de l’impasse sociale que constituaient les quartiers, mais aussi de Jésus, – de Jésus surtout ! Jésus, la matrice de son « don de guérison », son protecteur, son guide et son modèle » (p 25).
De fait, Tobie Nathan avait déjà entendu parler de la guérison divine. « Bien d’autres avaient attiré mon attention sur la fonction thérapeutique de Jésus, sur la puissance que conférait son être même. J’avais autrefois fait une enquête dans des Eglises évangéliques au Bénin. Par la suite, j’ai découvert celles du Burundi et du Ruanda. Je me suis insurgé contre les abus commis dans celles du Congo. Mais personne ne m’avait comme Gabriela, incité à examiner de plus près Jésus, sa personne… Selon ses adeptes, c’est en l’homme, Jésus, que réside la puissance de guérir » (p 15).
Jésus guérit
Le livre de Tobie Nathan débouche ainsi sur une description et une analyse de l’œuvre de Jésus comme thérapeute et guérisseur.
Jésus parlait. Il agit aussi. « La plupart de ses actions – peut-être même la totalité – furent des guérisons… Des guérisons, on en compte 37 dans ce qu’on appelle le Nouveau Testament et 14 dans le seul Evangile de Marc. C’est dire ! » (p 98 ). « Plus encore, et alors même que le débat était à son plus fort au sein de l’Église primitive sur la nature de Jésus – il n’y eut jamais aucune controverse, ni chez ses disciples, ni chez ses détracteurs, quant à ses dons de thaumaturge et d’exorciste. Quelle que fut sa nature, tout le monde lui reconnaissait ce don-là, le don de guérison. Dans les récits, tels qu’ils nous sont rapportés dans les Ecritures, Jésus ne refusait jamais la guérison à qui lui demandait » (p 99). « Et, à chaque fois, Jésus choisissait les démonstrations publiques, bien loin des intimités psychologiques de nos contemporains. Il se risquait aux guérisons les plus difficiles devant une foule rassemblée qu’il prenait à témoin, guérison à chaque fois plus inattendue, plus invraisemblable » (p 100).
Dans ce chapitre, Tobie Nathan va décrire, analyser et chercher la signification de quelques guérisons de Jésus. Et il commente ainsi la guérison du sourd-muet dans une ville de la Décapole. « Il lève le regard vers le ciel et gémit en araméen : ephatah ! – « Ouvre-toi » et voilà que la parole du bègue se délie… ». De fait, « cette parole est chargée… elle désigne le commencement de la prière. Le livre qui introduit à Dieu s’appelle en hébreu le Pata’h, « l’ouverture », que l’on retrouvera dans la première sourate de l’islam Al fati’ha qui signifie aussi : « ouverture ». Une fois encore, Jésus fait et dit. C’est l’un de ses secrets thérapeutiques : faire un acte et dire en même temps la parole qui le désigne. Il faut alors que cette parole colle à l’acte, mais également qu’elle s’envole vers une signification plus profonde, qui engage toute la communauté » (p 101).
La nouvelle des guérisons se répand. « Les malades ne guérissent pas parce qu’ils croient ; ils croient parce qu’ils on été guéris » (p 102). Ces guérisons participent à un mouvement de rassemblement autour de Jésus.
« On a inventorié trois types de malades guéris par Jésus : les aveugles, les sourds-muets et les paralytiques… Tous ont la perception et l’action entravée. C’est ainsi qu’il définit par ses gestes thérapeutiques la nature de la maladie : l’impossibilité de la connaissance de Dieu. Il faut donc voir dans ces malades des éveillés – les plus vaillants de la communauté – des êtres qui ont conscience dans leur corps des entraves au cheminement vers Dieu » (p 103 ).
Tobie Nathan inscrit l’œuvre de guérison de Jésus dans une dimension communautaire. « On doit se rendre à l’évidence : l’action de guérir, que Jésus maitrisait à la perfection, sans effort, en douceur, n’était pas le but ultime. Il voulait agir non sur la négativité qui affligeait un seul, mais sur l’inhibition qui paralysait sa communauté » (p 110). D’un bout à l’autre de son livre, Tobie Nathan met l’accent sur la vocation politique qu’il attribue à Jésus.
Une interpellation
« A cette époque, les thérapeutes, les devins, les magiciens, les sorciers étaient si nombreux… il y en avait tant et plus encore. Ils pullulaient en Judée et en Galilée. Il en existait parmi les grecs… » (p 115 ). Certains étaient renommés. Les techniques de Jésus ressemblaient à celles des guérisseurs de son temps, mais elles différaient par un détail d’importance : Jésus soignait gratuitement et exigeait de ses disciples qu’ils agissent de même » (Matthieu 10.7-10) (p 115-116). Tobie Nathan évoque ensuite une « longue lignée de rebelles politiques cherchant à délivrer Israël de l’oppression romaine » et le passé insurrectionnel à cette époque. Finalement « ce fut l’éradication du Temple et la domination de l’Empire romain ».Tobie Nathan conclut ainsi : « Révolutionnaire et thérapeute, c’est ainsi que j’ai compris Jésus à travers les évènements de la vie » (p 123). Il en apprécie les talents. « Cet homme aurait pu jouir d’une reconnaissance passagère ou disparaître dans les oubliettes de l’histoire comme d’autres dont nous ne savons rien ». Alors, il s’interroge sur la présence de Jésus dans la vie contemporaine et le mystère qu’on peut y voir :
« Mais son destin fut différent.
Qui en a décidé ainsi ?
Dieu, peut-être ? » (p 124).
Dans le brassage mondial des populations, Tobie Nathan apparaît comme une vigie. Ethnopsychiatre, il observe les phénomènes psychosociaux de notre époque. A ce titre, la réalité de la « guérison divine » ne lui paraît pas extravagante. Son regard croise celui des chrétiens évangéliques qui croient en la guérison au nom de Jésus. Tobie Nathan s’est engagé dans une recherche historique pour mieux connaître ce Jésus pour lequel il éprouve de la sympathie. Dans ce livre, selon sa culture, il nous fait part de son interprétation et de son questionnement. Jésus est bien source de guérison.
J H
(1) Tobie Nathan. Jésus le Guérisseur. Flammarion, 2017
(2) Tobie Nathan : la croyance est un cadeau que je n’ai pas encore reçu : https://www.lemonde.fr/la-matinale/article/2017/10/15/tobie-nathan-la-croyance-est-un-cadeau-que-je-n-ai-pas-encore-recu_5201182_4866763.html
(3) Tobie Nathan. Les âmes errantes. L’iconoclaste, 2017 (Livre de Poche) « Dans le secret de son cabinet, le psychologue Tobie Nathan accueille des jeunes en danger de radicalisation. Il écoute. Leurs histoires, leurs mères, leurs pères perdus. Et tout ce qu’ils ont à nous apprendre sur le monde tel qu’il est. Aucun penseur ne les a connu de si près. Aucun n’a osé dire qu’il leur ressemblait. Se raconter, se mettre à nu pour faire revenir « les âmes errantes » est un pari risqué. Le seul qui semble valoir la peine d’être tenté ».
Tobie Nathan, ethnopsychiatre
par | Sep 18, 2012 | ARTICLES, Vision et sens |
Dans un temps où l’on a souvent du mal à trouver des raisons d’espérer, ceux qui mettent leur confiance dans le Dieu de la Bible ont plus que jamais le devoir de « justifier leur espérance devant ceux qui (leur) en demande compte » (1 Pierre 3,15). A eux de saisir ce que l’espérance de la foi contient de spécifique, pour pouvoir en vivre.
Or, même si, par définition, l’espérance vise l’avenir, pour la Bible elle s’enracine dans l’aujourd’hui de Dieu. Dans la Lettre 2003, frère Roger le rappelle : « (La source de l’espérance) est en Dieu qui ne peut qu’aimer et qui nous cherche inlassablement » (1)
Dans les Ecritures hébraïques, cette Source mystérieuse de la vie que nous appelons Dieu se fait connaître parce qu’il appelle les humains à entrer dans une relation avec lui : il établit une alliance avec eux. La Bible définit les caractéristiques du Dieu de l’alliance par deux mots hébreux : hased et emet (par ex : Exode 34,6 ; Psaume 25,10 ; 40, 11-12 ; 85, 11). En général, on les traduit par « amour » et « fidélité ». Ils nous disent, d’abord, que Dieu est bonté et bienveillance débordantes pour prendre soin des siens et, en deuxième lieu, que Dieu n’abandonnera jamais ceux qu’il a appelés à entrer dans sa communion.
Voilà la source de l’espérance biblique. Si Dieu est bon et s’il ne change jamais son attitude ni ne nous délaisse jamais, alors, quelles que soient les difficultés –si le monde tel que nous le voyons est tellement loin de la justice, de la paix, de la solidarité et de la compassion- pour les croyants, ce n’est pas une situation définitive ; dans leur foi en Dieu, les croyants puisent l’attente d’un monde selon la volonté de Dieu ou, autrement dit, selon son amour.
Dans la Bible, cette espérance est souvent exprimée par la notion de promesse. Quand Dieu entre en rapport avec les humains, cela va de pair en général avec la promesse d’une vie plus grande. Cela commence déjà avec l’histoire d’Abraham : « Je te bénirai, dit Dieu à Abraham. Et par toi se béniront toutes les familles de la terre » (Genèse 12, 2-3).
Une promesse est une réalité dynamique qui ouvre des possibilités nouvelles dans la vie humaine. Cette promesse regarde vers l’avenir, mais elle s’enracine dans une relation avec Dieu qui me parle ici et maintenant, qui m’appelle à faire des choix concrets dans ma vie. Les semences de l’avenir se trouvent dans une relation présente avec Dieu.
Cet enracinement dans le présent devient encore plus fort avec la venue de Jésus le Christ. En lui, dit Saint Paul, toutes les promesses de Dieu sont déjà une réalité (2 Corinthiens 1,20). Bien sûr, cela ne se réfère pas uniquement à un homme qui a vécu en Palestine il y a deux mille ans. Pour les chrétiens, Jésus est le Ressuscité qui est avec nous dans notre aujourd’hui . « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin de l’âge » (Matthieu 28.20.
Un autre texte de saint Paul est encore plus clair.
« L’espérance ne déçoit point, parce que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné » (Romains 5, 5). Loin d’être un simple souhait pour l’avenir sans garantie de réalisation, l’espérance chrétienne est la présence de l’amour divin en personne, l’Esprit Saint courant de vie qui nous porte vers l’océan d’une communion en plénitude.
Texte publié sur le site de Taizé
(1) Cette réflexion sur l’espérance chrétienne est la première partie d’un texte sur l’espérance publié sur le site de Taizé : http://www.taize.fr/fr_article1080.html . Nous avons pensé la comuniquer sur ce blog, car elle est formulé en termes très accessibles, et nous y trouvons une consonance avec certains accents de la théologie de l’espérance qui est proposée par Jürgen Moltmann et appréciée dans ce blog . Les accentuations en gras ont été ajoutées par l’animateur de ce blog.
par jean | Août 28, 2016 | ARTICLES, Emergence écologique |
Le Grand Orchestre des Animaux
Courez admirer et écouter le Grand Orchestre des Animaux. Il joue à Paris, à la Fondation Cartier jusqu’au 8 janvier 2017. On y vient en famille pour le plus grand bonheur des enfants. Ils prennent le temps de s’asseoir pour regarder de bout en bout, chaque vidéo, chaque spectacle. Ils ne veulent pas en perdre une miette.
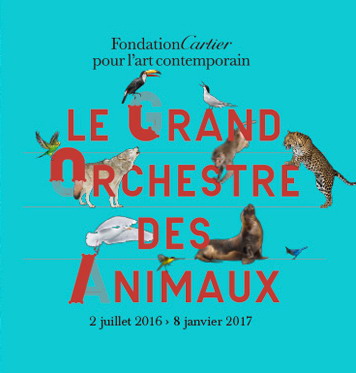
Il y a là un hymne à la création, la création du monde, sa beauté inouïe, le respect que nous lui devons, mais aussi à la créativité géniale des scientifiques et des poètes, auteurs de cette exposition. Que penser de ces pièges à photo qu’ils ont disséminés çà et là pour capter des images insolites ?
Dès l’entrée, nous sommes accueillis par une grande fresque murale, un paysage d’animaux qui fait penser irrésistiblement aux peintures rupestres de Lascaux ou de la grotte Chauvet. Ensuite, c’est l’immersion totale dans un monde esthétique, sonore et visuel, dans un monde animal aujourd’hui menacé.
J’ai beaucoup aimé tout ce qui concerne la beauté des oiseaux, leurs vols, les parades nuptiales. J’ai aimé écouter les voix du monde vivant non humain, des voix d’animaux enregistrés. J’ai aimé leur beauté et leur diversité.
Ici, il nous est donné de contempler le monde naturel, le monde à nos yeux caché, ici dévoilé, et alors s’élève en nous un chant d’action de grâce et nous revient la mémoire des psaumes sur la magnificence de la création.
Geneviève Patte
Présentation du grand orchestre des animaux :
http://www.ushuaiatv.fr/actualités/le-grand-orchestre-des-animaux