par jean | Juin 1, 2022 | Vision et sens |
 Selon Patrice Van Eersel
Selon Patrice Van Eersel
Les crises se succèdent. Les menaces grandissent. L’horizon parait bouché. Nous voyons le climat se dégrader, la diversité des espèces se réduire. Nos repères se fragilisent. Il semble que l’ordre naturel est ébranlé. Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ?
L’humanité elle-même nous paraît de plus en plus instable. Le rythme de la vie sociale s’accélère, s’emballe. Dans cette ambiance préoccupante, la solidarité vacille. Des forces s’entrechoquent. Des monstres, bien réels ou imaginaires apparaissent. Dans ce tohu-bohu, certains se désespèrent et envisagent la fin du monde, un grand effondrement. Ce catastrophisme est dévastateur. Il sape les élans de vie.
C’est dans ce contexte que Patrice Van Eersel, journaliste et écrivain (1), connu pour ses études pionnières dans la découverte de réalités hors du commun, d’expériences transcendentales, a décidé de répondre au pessimisme ambiant en écrivant un livre intitulé : « Noosphère » (2). Il trace une piste décrivant le processus intellectuel qui a commencé au début du XXè siècle et a mis en évidence la perspective de l’émergence d’une conscience collective.
Ce livre est présenté ainsi dan la page de couverture.
« Comment croire en l’avenir quand on a trente ans et la conviction de vivre l’effondrement de la planète – réchauffement global, dégradation de la biodiversité, pollution généralisée, le tout aggravé par une crise sanitaire mondiale ?
En remontant le temps, répond l’auteur de ce récit à son jeune interlocuteur, Sacha, en s’inspirant du concept de Noosphère, forgé dans les années 1920 par deux hommes, le français Teilhard de Chardin et le russe Vladimir Vernadski qui désignaient ainsi la conscience collective planétaire. Ayant compris le rôle crucial de l’action humaine sur la biosphère – ce que l’on appelle aujourd’hui l’anthropocène – ces visionnaires, convaincus du caractère « cosmique » de la vie biologique, considéraient le triomphe de la « Noosphère » comme la prochaine et irrésistible étape de l’Évolution, condition sine qua non de notre survie sur la terre ».
L’auteur a agencé son récit en fonction d’interlocuteurs imaginés : le fils d’un ami décédé, Sacha, un jeune homme en pleine dépression parce qu’il s’attend à un effondrement de la société et, en conséquence, s’est réfugié dans un refus du travail, et, autour de lui, une constellation familiale, sa mère, sa compagne, mère d’une petite fille, séparée de lui et elle aussi, portée à des idées extrêmes. Et donc, le récit se développe en phase avec des questionnements et des ressentis. Dans cette disposition de l’ouvrage, l’auteur engage un dialogue avec toute une jeunesse en recherche. Et, en même temps, l’auteur nous présente une réflexion complexe au carrefour de considérations scientifiques, philosophiques et même théologiques. Dans un déroulé historique, attentif à la vie des personnalités évoquées, le récit suscite une attention soutenue. Patrice Van Eersel a écrit là un livre fondé sur de nombreuses enquêtes et lectures. C’est un ouvrage important, en 400 pages. Il ne peut donc être question ici d’en résumer le contenu. Nous chercherons simplement à en présenter quelques étapes, quelques parties saillantes.
Une approche de l’effondrement : la collapsologie
Puisque son jeune ami, Sacha, est obsédé par la menace de l’effondrement, Patrice Van Eersel va lui ménager un contact avec ceux qui, eux aussi, se focalisent sur cette question de l’effondrement. Ainsi, il entre en contact avec des scientifiques innovants qui, en fin de compte, se sont engagés dans l’exploration de cette hypothèse. Depuis quelques années, Patrice connaissait un chercheur belge, Gauthier Chapelle, spécialiste de biomimétisme : comment reconnaître les inventions de la nature et en tirer parti ? Avec un autre chercheur, Pablo Servigne, Cauthier Chapelle avait participé à la rédaction d’un livre particulièrement innovant : « L’entraide. L’autre loi de la jungle » (3). Cependant, les années passant, Gauthier Chapelle avait rejoint son collège et ami, Pablo Servigne dans son regard pessimiste sur l’avenir de l’humanité. Ce dernier avait écrit un livre : « Pourquoi tout peut s’effondrer ». Pablo Servigne et un petit groupe de chercheurs avec lui s’étaient engagés dans un recherche sur l’effondrement en adoptant le terme de : collapsologie. « Ce que ces jeunes chercheurs s’escrimaient à étudier en détail, c’était le « processus systémique » par lequel une société s’emballe dans une série de spirales devenant folles et qui, tendant vers l’infini à partir de certains seuils, résonnent si bien les unes avec les autres qu’elles font exploser l’ensemble » (p 18). Gauthier Chapelle ayant donc facilité une rencontre entre Patrice van Eersel et Pablo Servigne, celle-ci déboucha sur une discussion concernant la perspective de l’effondrement. Pablo Servigne suggéra à Patrice de faire bénéficier son groupe de son expérience sur l’approche de la mort apprise d’« Elisabeth Kubler Ross, psychiatre américano-suisse, initiée au feu de l’ouverture des camps de concentration en Pologne, puis projetée dans l’univers des grands hôpitaux américains » (p 23). Dans son pessimisme, Pablo Servigne a choisi néanmoins de « rester humain quoiqu’il arrive » et il s’est installé avec ses enfants dans la campagne de la Drome (p 24-25). En emmenant Sacha avec lui, Patrice Van Eersel lui rend visite dans son nouveau lieu de vie. La conversation s’oriente vers la puissance de l’entraide qui « concerne tous les êtres vivants depuis quatre milliards d’années ». « Les groupes qui s’entraident survivent beaucoup plus longtemps ». Cette puissance de l’entraide a été mise en valeur par la pensée pionnière de Kropotkine, géographe et anarchiste, et le courant russe de l’anarchisme mystique. « On débouche sur un engagement social d’essence éthique et, même, finalement sur une voie philosophique étroitement spirituelle » (p 135-136). Tout en envisageant le pire, Pablo Servigne poursuit sa recherche sur les manières de l’affronter. « Les humains ont besoin de grands récits. Or ceux qui ont nourri le monde moderne depuis la Renaissance, en particulier le récit de la liberté individuelle ou de la technoscience, sont maintenant épuisés. Et Pablo énonce des pistes d’action : « Schématiquement, je vois trois possibilités : bâtir des réseaux d’entraide, motivés par le bien commun ; s’entrainer à recevoir l’imprévisible, le pire et le meilleur… et puis ouvrir des horizons, rêver ensemble, tisser de grands récits ! » (p 140).
Chercheurs artistes américains
Éclaireurs pour une nouvelle vision du monde
L’auteur a réalisé de nombreuses enquêtes aux Etats-Unis. « L’Amérique est un pays si contradictoire qu’il peut vous dégouter autant que vous inspirer. Du nord au sud et de la côte ouest à la côte est, j’y avais rencontré des dizaines de chercheurs artistes et de scientifiques ouvreurs de voies » (p 32). Dans ces rencontres, il a mesuré la dimension historique de l’anthropocène. « Tout d’abord, ces gens, bien qu’en général d’idéologie libertaire, m’ont lavé d’une première grande illusion. Ce n’est pas la finance digitalisée, ni le capitalisme, ni la révolution industrielle qui ont commencé à foutre en l’air la biosphère terrestre. Le mal a débuté bien plus tôt, au minimum au Néolithique c’est à dire à l’âge où les humains se sont peu à peu sédentarisés, élevant des animaux domestiques et cultivant des plantes » (p 32-33). Et, dès cette époque, ces scientifiques « prétendaient inventer des façons concrètes de pacifier ce qu’on s’entend à appeler ‘anthropocène’ aujourd’hui ». Ainsi Patrice Van Eersel a rencontré la microbiologiste Lynn Margulis. « Cette grande spécialiste des bactéries, qui était aussi une artiste visionnaire, fut à l’origine, avec le climatologue James Lovelock, de « l’hypothèse Gaïa » selon laquelle la biosphère qui enveloppe notre planète se comporterait comme un seul gigantesque être vivant » (p 34).
Lynn Margulis a écrit un essai magistral : « L’univers bactériel ». Les bactéries ont joué un rôle majeur dans le développement de la vie. « Elles ont fait de cette planète non seulement leur nid, mais leur chose, leur production, leur création collective » (p 34). Les bactéries ont traversé ainsi plusieurs épisodes très difficiles de la vie terrestre. Aujourd’hui, à nouveau, une crise a éclaté. « L’humanité et ses langages ont secrété une technosphère constituée de toutes nos techniques… Quand est survenue la révolution industrielle, le processus mortifère s’est accentuée dans des proportions démentes… » (p 36-37). Ici Lynn Marjulis a ouvert un nouvel horizon à Patrice Van Eersel : « le défi est colossal , mais clair. Si nous voulons que la technosphère humaine cesse d’agresser la biosphère qui l’a engendrée et constitue sa matrice, il faut que s’impose une sphère nouvelle. Il faut d’urgence renforcer la Noosphère » (p 37). La Noosphère, « c’est la sphère de la conscience. En grec, « noos » signifie « esprit, conscience ». L’intelligence collective des humains est impressionnante, mais elle n’est encore que très partiellement consciente… Seul un colossal saut collectif dans la conscience, donc dans la responsabilité, peut rendre les techniques humaines biophiles et non plus antibiotiques ». (p 38). Lynn Margulis va orienter Patrice Van Eersel vers les pionniers de cette vision. Ce sont « deux grands chercheurs du début du XXè siècle… deux savants prophétiques sans exagération : le plus vieux était russe et s’appelait Vladimir Ivanovitch Vernadski. L’autre était français et s’appelait Pierre Teilhard de Chardin. Venant de philosophies très différentes – immanentiste pour le russe et transcendantaliste pour le français – ils tombèrent d’accord pour dire deux choses. D’une part que la Noosphère émergeait de la nature même du monde matériel, d’autre part que l’on pouvait voir en elle l’avenir même de l’univers ». Lynn Margulis encouragea Patrice à enquêter sur ces deux hommes.
Pierre Teilhard de Chardin
Une vision émergente
Patrice Van Eersel est donc parti à la découverte de Teilhard de Chardin. Celui-ci est aujourd’hui une personnalité célèbre, qui a donné lieu à des biographies et dont l’abondante production est maintenant éditée (4). Il existe même une association des Amis de Teilhard de Chardin (5). Dans plusieurs chapitres successifs et en fonction de son auditoire imaginaire, Patrice Van Eersel poursuit un récit du parcours de Teilhard de Chardin. Il retrace les grands moments de sa vie, c’est à dire le contexte dans lequel sa vision a grandi depuis les affres de la grande guerre jusqu’à son intense recherche paléontologique. Prêtre jésuite, sa vision s’est heurtée au pouvoir de la hiérarchie catholique et s’est diffusée sous le manteau à travers un réseau d’amis et grâce à des amitiés féminines. Cette vision a fait irruption après sa mort avec la publication d’un livre clé : « le Phénomène Humain ».
L’auteur nous relate la vie de Pierre Teilhard de Chardin tout au long de la grande guerre comme brancardier et « dans la fureur et le sang » (p 41-54). Très particulièrement exposé en fonction du courage qu’il manifeste au secours des blessés et en fonction de sa haute taille, il échappe à la mort quasi miraculeusement. A travers les massacres qui l’environnent, il garde le cap et dans les moments de répit, il écrit passionnément. « Profitant de la moindre accalmie, hanté par une recherche de sens d’autant plus déraisonnable que le contexte est fou, le prêtre paléontologue écrit des centaines de pages » (p 86) qu’il envoie ensuite à sa cousine Marguerite.
La vision de Teilhard se développe en tension avec le malheur ambiant. « Sous la pression de sa mission assumée de caporal brancardier œuvrant dans les tranchées, le docteur en paléontologie voit un ordre supérieur jaillir du chaos… » (p 95). Il écrit : « L’effet du séjour dans le danger est de purifier le goût de spéculations… L’âme est sensibilisée par l’effort moral, bandée aussi dans toutes ses énergies spéculatives, longtemps comprimées. Sitôt qu’une éclaircie se fait dans l’existence des tranchées, l’homme se retrouve lui-même et au dessus de lui-même, parce que désintéressé dans ses vues et agrandi dans ses facultés (aiguisées et affamées) » (p 101). La dynamique du chercheur se poursuit et s’intensifie ; L’évolution lui apparaît de plus en plus comme « une réalité omniprésente et universelle ».
Après la guerre, Teilhard va pouvoir s’engager dans la recherche. « A partir du printemps 1923, la Chine va devenir la destination favorite de Teilhard, sa « seconde patrie » où il va creuser la piste du Sinanthrope ou homme de Pékin, l’ancêtre chinois d’Homo Sapiens ». En Chine, son regard s’élargit. Sa vision est « de plus en plus globale ».Dans une lettre, il écrit : « Je rêve d’une espèce de Livre de la Terre où je me laisserais parler non comme Français, ni comme élément d’un compartiment quelconque, mais simplement comme homme ou comme ‘Terrestre’ » (p 167).
Dans ses allées et venues qui vont se poursuivre toute sa vie, Teilhard rentre de Chine à la fin de l’été 1924 avec plusieurs tonnes de fossiles et d’échantillons de toutes sortes destinés au Muséum. Et là, il va rencontrer un autre paléontologue l’abbé Breuil et un philosophe Edouard Le Roy qui vient d’être choisi par Henri Bergson pour lui succéder à la chaire de philosophie grecque et latine du Collège de France. (p 177). « Catholique convaincu , mais très attaché à la laïcité, Edouard Le Roy, ce mathématicien philosophe n’a pas hésité à résister au Vatican. Les conversations entre Teilhard et Le Roy vont être très constructives. Le Roy est un élève et un ami de Bergson, auteur de « l’Evolution créatrice » et de « L’Energie spirituelle ». Et les intuitions de Teilhard et de Bergson vont pouvoir se rejoindre sur un point essentiel : «Toutes deux saisissent dans un même mouvement l’Être et le Devenir – et l’idée d’évolution irréversible constitue une clé majeure pour l’un comme pour l’autre. L’Être se révèle dans le devenir parce que l’évolution est création » (p 181).
Ultérieurement, Teilhard de Chardin va passer une bonne partie de sa vie en Chine. L’auteur nous fait part du développement de sa réflexion sur la Noosphère qui va de pair avec un idéal de vie exigeant. « Seule vaut l’action fidèle, pour le Monde, en Dieu. Pour arriver à voir cela et à en vivre, il y a une sorte de pas à franchir ou de retournement à faire subir à ce qui paraît l’habitude générale des hommes. Mais, ce geste un fois exécuté, quelle liberté pour travailler et pour aimer » (p 321).
Dans son livre emblématique : « Le Phénomène Humain », Teilhard envisage le processus qui débouche sur l’éclosion de la Noosphère.
« Besoin d’une religion à la mesure de la terre nouvelle », de fait le christianisme renouvelé. Et il envisage « un processus de recherche, de tentatives et de tâtonnements multiples ». Et il écrit : « Ce n’est que par le libre choix, la découverte et le développement, par chaque segment national et culturel de l’humanité de sa forme singulière de liberté, que pourront être assurées la convergence et la structuration de cette multitude dans un système planétaire uni » (p 223). Et il appelle à une « poussée du tous ensemble ».
L’auteur déroule la pensée de Teilhard de Chardin telle qu’elle s’exprime dans le Phénomène Humain. C’est « la vision spatiotemporelle d’un monde fibreux (chaque nouvelle émergence constituant un fibre à l’intérieur d’une nappe évolutive) et toute la techtonique psycho-matérielle de l’univers s’enroulant sur lui-même suivant la loi de la complexité-conscience. Une complexité-conscience croissante qui ayant abouti à l’avènement de l’humain… a engendré ipso facto une Noosphère : une conscience réfléchie de plus en plus socialisée, prise dans un tissage de plus en plus collectif » (p 348).
Le parcours d’un géologue russe : le professeur Vernadski
La chercheuse américaine Lynn Margulis avait également orienté l’auteur vers un géologue russe : le professeur Vernadski. Le parcours de celui-ci s’est développé dans un tout autre contexte : un milieu scientifique russe qui va être entrainé au XXè siècle dans une grande tourmente politique. Vernadski est l’élève de grands savants russes ; En 1884, il est appelé à décrypter l’histoire du sol ukrainien, le tchernozium, au fil de l’évolution géologique. « En observant la terre mère d’Ukraine, coupe de sol après coupe de sol, il avait observé un mélange unique d’humus et d’argile… Et il n’avait pu faire autrement que d’admirer l’inextricable tissage de vie recelé par ce sol. Un réseau d’une densité et d’une variété inouïes où se mêlait dans un enchevêtrement et un grouillement éblouissants tout ce que la vie biologique avait pu inventer depuis les champignons jusqu’aux mammifères… sans parler des bactéries… Camouflée sous le silence apparent de la terre, s’offrait à ses yeux une véritable frénésie… admirablement organisée, telle une étoffe relationnelle ultracomplexe. (p 61-62). « De là, l’énorme hypothèse qui avait peu à peu émergé dans son esprit : la vie biologique ne mettrait-elle pas en branle, par son intelligence propre des flux de matière et d’énergie infiniment supérieurs à ceux engendrés par la seule géologie minérale ? Dit plus abrupt, la biologie n’accélérait-elle pas tous les processus terrestres dans des proportions extravagantes constituant de la sorte la force biologique numéro un de la surface de notre planète ? » p 62). « En quelques années, sa propre intuition l’amena à se poser une question encore plus folle pour un scientifique rigoureux comme lui : ne fallait-il pas considérer la vie biologique comme une entité en soi impossible à réduire à ses éléments chimiques inertes ? Ne fallait-il pas, peut-être, parler d’elle comme d’une force cosmique spécifique, dont la physique ne tenait pour l’instant aucun compte ? » (p 63). Vernaski en vint à se demander si la richesse minérale faramineuse de la terre n’était à mettre en relation avec l’existence de la biosphère… c’est à dire avec la matière vivante, prémonition que les recherches scientifiques n’allaient cesser de valider jusqu’au XXIè siècle » (p 65).
A partir des années 1990, Vernaski grimpa rapidement dans la hiérarchie universitaire et académique russe et multiplia les voyages auprès de chercheurs de premier plan en Europe. Il introduisit dans le corpus de son enseignement, l’idée totalement nouvelle et transdisciplinaire d’une « biogéochimie ». « Tous les êtres vivants, avançait-il, forment une sorte d’entité géante qui, nourrie des corps chimique inertes, sculpte, malaxe, cristallise et fait transmuter la surface de la terre à sa guise » (p 65).
Patrice Van Eersel déroule la biographie de Vladimir Ivanovitch Vernadski dans plusieurs chapitres de son livre. Vernadski ne fut pas seulement un grand savant visionnaire, mais aussi un homme engagé socialement et politiquement. Ainsi, dans les années prérévolutionnaires, il a participé à « une organisation apte à accueillir les idéaux humanistes et démocratiques et à en permettre la mise en œuvre ». « Avec plusieurs camarades, ils avaient donc créé une fraternité comme c’était alors la coutume » (p 69). Foncièrement démocrate, il se heurte à la dictature issue de la Révolution d’Octobre, mais sa réputation scientifique l’aide à traverser cette tourmente. Et elle va l’aider à composer avec le régime soviétique.
Sa réflexion philosophique assise sur sa recherche scientifique va donc se poursuivre. Réfugié en Ukraine, puis en Crimée juste après la Révolution d’octobre, déjà atteint par la tuberculose, fin 1919, il tombe gravement malade du typhus. Or, dans cet état, il va connaître un genre d’expérience mystique. « Hospitalisé et mis sous perfusion, le savant se retrouve pendant plusieurs semaines dans « un état de conscience modifiée », une forme de délire qui, peu à peu, va se transformer en visualisation claire et limpide… Vision de la suite à donner à ses recherches jusque dans ses détails théoriques les plus abstraits et les conditions expérimentales correspondantes (p 121). « J’ai clairement vu de quelle façon il faudrait m’y prendre pour faire progresser et aboutir en particulier mon idée de « matière vivante ». Il est profondément impressionné par « l’esthétique des choses et des êtres. La faramineuse beauté de la nature, son harmonie, sa prodigalité, mais aussi la beauté des êtres humains et de leurs trouvailles, m’ont fait atteindre une extase que j’aurais du mal à décrire avec des mots » (p 123). Il projette la création d’un « Institut de la matière vivante ». PatriceVan Eersel nous relate dans le détail la maturation de la pensée de Vernadski, son hommage aux naturalistes anglais et australiens du XIXè siècle (p 125) et un approfondissement de sa conception de l’émergence du vivant. « Depuis son avènement il y a des centaines de millions d’années, la vie biologique a constitué la force biologique et atmosphérique numéro 1 de la surface de notre planète. Cependant, depuis beaucoup moins longtemps, c’est l’humanité qui, de tous les êtres vivants, constitue la force de transformation matérielle la plus puissante… Après la biosphère, nous nous trouvons donc en présence d’une « humanosphère » (p 128).
La Noosphère : Le concept émergeant d’une grande rencontre : Olivier Le Roy, Pierre Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadski
En 1922 le professeur Vernadski arrive en France et y poursuit son activité scientifique. En automne 1924, un dialogue s’engage entre lui, Olivier Le Roy, disciple de Bergson et Pierre Teilhard de Chardin. A partir de textes existants, Patrice Van Eersel reconstitue et restitue leur conversation où se manifeste une reconnaissance commune de la Noosphère. Olivier le Roy déclare ainsi : « Je vous propose l’hypothèse de travail suivante qui découle directement de vos travaux respectifs. Ne pourrait-on pas dire que la biosphère, ayant atteint l’ère anthropozoïque dont nous parle de façon très immanentiste le professeur Vernadski (le concept de céphalisation, p 215), et « se retournant sur elle-même », comme le propose dans une perspective transcendentale, le père Teilhard, qui me parlait récemment « d’une incarnation planétaire de l’esprit », doit à présent accoucher d’une Noosphère pleine et entière, c’est à dire d’une conscience collective intégrale ». Ainsi l’évolution cosmique pourrait passer au stade suivant » (p 222). PatriceVan Eersel précise que Teilhard et Vernadski ont été aussi portés, aussi bien l’un que, à utiliser le terme de noosphère et que Vernadski en attribue l’expression à Olivier Le Roy. (p 224).
Vernadski aussi bien que Teilhard ont été confrontés aux massacres guerriers. Ils ont conscience des dangers encourus par l’humanité. Il y a cent ans déjà, l’humanité se sentait menacée.
Face aux régimes totalitaires, Teilhard voit dans la noosphère un espace de personnalisation. « Si, sous la pression considérable du processus de complexification cosmique appelée « évolution », les consciences individuelles se rapprochent les une des autres, les individualités ne disparaissent pas. Elles transcendent leurs limites et resplendissent » (p 217). Et de même, dans cette conversation, différents obstacles sont évoqués : l’individualisme exacerbé, la tentation de faire machine arrière, la peur de la mort… A chaque fois, des réponses apparaissent. Selon Teilhard, nous devons être spirituellement amoureux de la matière. « L’idéal noosphérique contredit en tous points aussi bien l’isolationnisme du spiritualiste coupé du monde dans l’attente d’un au delà que l’idéal du petit-bourgeois claquemuré derrière son confort » (p 228). Vernadski évoque le refus d’aller de l’avant. « Cela ne nous est pas possible ou alors seulement en disparaissant. Si l’humanité veut continuer d’exister, elle est contrainte de chercher à transformer le monde et à se métamorphoser elle-même. Sinon elle disparaît purement et simplement » (p 229). Face à la mort, Teilhard pense qu’à travers nous, se manifeste une présence que rien ne peut éteindre. La biologie seule, même si elle résiste, finirait dispersée par l’entropie. Seule l’émergence de l’humain change définitivement la donne : pour moi, ce qui sera définitivement conservé, c’est l’énergie humaine, c’est-à-dire la Personne » (p 234). Il y a des forces qui interviennent face au totalitarisme oppresseur. Vernadski évoque la puissante forte de l’entraide à l’œuvre dans le monde vivant et mise en évidence par le savant russe, de conviction anarchiste, Kropotkine (p 236) et Teilhard, dans une inspiration chrétienne, évoque « une conspiration d’amour » animée par les forces de la sympathie » (p 235).
La Noosphère : quelle actualité ?
La vision de la noosphère a émergé il y a un centaine d’années dans un contexte où l’humanité était déjà confrontée à de grands maux. Aujourd’hui, cette vision est toujours éclairante et des réalités nouvelles comme l’expansion du web viennent l’illustrer.
Comme d’autres chercheurs, Patrice Van Eersel évoque le besoin d’un grand récit fédérateur répondant aux questionnements de beaucoup de nos contemporains. Ainsi évoque-t-il « l’utilité vitale, reconnue par tous, d’inventer de nouveaux grands récits pour tirer en avant l’humanité menacée de désespérance » (p 291).
Dans plusieurs chapitres, l’auteur dialogue avec la jeune génération telle qu’il la représente dans quelques personnages. Il évoque ainsi des réalités bien documentées, mais aujourd’hui largement méconnues. Ainsi, il apparaît qu’à long terme, dans la vie quotidienne, la violence recule. Et il fait appel à de nombreuses recherches qui montrent l’influence potentielle de la pensée et de la méditation sur des réalités sociales. Des interrelations nouvelles apparaissent. On découvre ainsi que « nos volontés et nos actions influent sur nos corps… Nos cerveaux sont beaucoup plus malléables que l’on ne croyait. Nos réseaux neuronaux se reconstruisent en permanence. Et même, mis en relation avec quelqu’un, nous fonctionnons littéralement en wifi. Et cela nous transforme. Nous nous transformons physiquement les uns les autres en fonction de nos interactions… » (p 267). Sur un autre registre, le concept d’imaginal est avancé. « Ce sont des mondes et des niveaux de conscience différents, mais bien réels » ; certains disent même plus réels que le réel… Pour les mystiques de toutes les traditions, on pourrait dire que l’imaginal représente le monde intermédiaire entre le réel physique et l’Être ineffable et absolu » (p 271).
Un des interlocuteurs présents dans ce livre s’exprime ainsi : « Je suis persuadé que Vernadski et Teilhard visualisaient la Noosphère comme une dimension bien réelle, mais habitée par des humains ayant suffisamment cultivé leurs mondes intérieurs – et résolu leurs névroses – pour pouvoir s’échapper à volonté dans l’imaginal » (p 272). Patrice Van Eersel se rend compte que pendant longtemps il a réfléchi à la Noosphère « en terme d’extériorité, beaucoup plus rarement en terme de vie intérieure – qui est bien autre chose que le flux psychologique des images et des pensées qui nous traversent à chaque instant… Pourtant, chacun à sa façon, les personnages de mon récit, Teilhard de Chardin comme Vernadski ou Le Roy, n’avaient jamais cessé d’insister sur le va-et-vient indissoluble entre le dehors et le dedans » (p 273)…
« Pourrait-on donc imaginer que l’évolution d’Homo Sapiens ait atteint un stade limite où s’ouvrirait soudain en nous l’urgence vitale d’ouvrir une porte inédite vers un « ailleurs » ? Ou plutôt une porte aussi ancienne que l’être humain des origines, mais oubliée depuis des siècles par quasiment toute l’humanité à l’exception de minuscules minorités d’initiés, une porte qui signalerait une transition vers un être humain non pas « augmenté », mais « métamorphosé » ? (p 274).
Cet ouvrage volumineux de Patrice Van Eersel se lit de bout en bout, car il y a un dynamisme dans ce récit et un appel constant à la découverte. C’est un univers tant il est vaste dans le thème abordé et l’approche empruntée. Ce livre est également constamment orienté vers une recherche de sens. La vision suggérée et proposée de la Noosphère est envisagée non seulement dans son émergence, mais dans sa réception. Une piste est tracée et elle est accueillie dans un dialogue incessant entre l’auteur et des interlocuteurs imaginés exprimant les angoisses, les interpellations et les attentes d’une nouvelle génération. Ce livre est un univers. Il ne rapporte pas seulement la vie et l’apport de grands chercheurs, mais il aborde également des recherches et des innovations plus récentes. Une abondante bibliographie en témoigne. Nous avons essayé de proposer quelques aperçus de ce livre, sachant que nous ne pouvions rendre compte de toute sa diversité. Il y a, dans ce livre, une dynamique à la fois intellectuelle et humaine. C’est aussi un ouvrage qui met, à la portée de tous, une ouverture de sens pour nos contemporains. Une incitation à la lecture.
J H
- Biographie de Patrice Van Eersel : https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_Van_Eersel
- Patrice Van Eersel. Noosphère. Eléments d’un grand récit pour le XXIè siècle. Albin Michel, 2021
Interview de Patrice Van Eersel sur son livre : Noosphère : https://www.youtube.com/watch?v=WCV7TOnoScA
- Face à la violence, l’entraide dans la nature et dans l’humanité : https://vivreetesperer.com/face-a-la-violence-lentraide-puissance-de-vie-dans-la-nature-et-dans-lhumanite/
- Il existe de nombreuses études sur la vie et l’œuvre de Pierre Teilhard de Chardin. Ici : Patrice Boudignon. Teilhard de Chardin. Sa biographie par sa correspondance : https://www.canalacademies.com/emissions/au-fil-des-pages/teilhard-de-chardin-sa-biographie-par-sa-correspondance Plus précisément, en rapport avec le sujet de cet article : Noosphère podcast : de la conscience individuelle à la conscience collective, par François Euvé : https://www.youtube.com/watch?v=09WRgOQAc24
- Association des amis de Teilhard de Chardin : https://teilhard.fr/
par jean | Mar 5, 2021 | ARTICLES, Vision et sens |
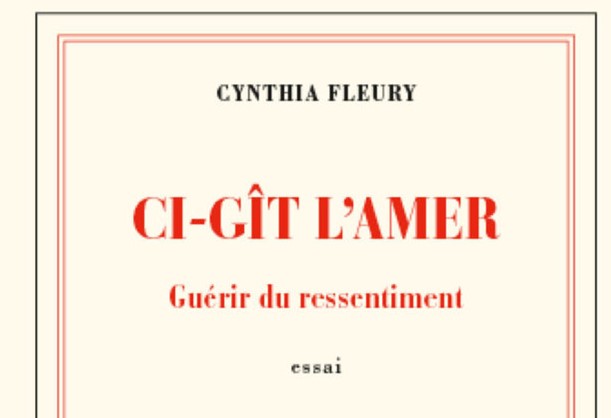 « Ci-git l’amer. Guérir du ressentiment » de Cynthia Fleury
« Ci-git l’amer. Guérir du ressentiment » de Cynthia Fleury
Il nous arrive, il nous est arrivé de rencontrer des gens qui manifestent un profond ressentiment. Nous avons pu nous-même éprouver du ressentiment envers quelqu’un ou à notre égard. Nous savons combien il est précieux de pouvoir sortir de cette situation. Et, plus généralement dans la vie sociale, et tout particulièrement si nous fréquentons certains réseaux sociaux et parcourons certains commentaires sur internet, nous y percevons parfois des bouffées de haine, des violences verbales dont nous percevons le rapport avec un profond ressentiment. Le ressentiment est donc une réalité assez répandue qui ne nous est pas inconnue et que nous avons besoin de comprendre pour y faire face, car c’est une réalité pernicieuse.
Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, vient d’écrire à ce sujet un livre intitulé : « Ci-git l’amer » avec pour sous-titre : « Guérir du ressentiment ». C’est un ouvrage conséquent de plus de 300 pages qui, en 54 chapitres, étudie le problème du ressentiment dans ses dimensions personnelles et collectives, à partir d’une culture psychanalytique, philosophique et littéraire qui mobilise de nombreuses références, ainsi, parmi d’autres : Scheler, Nietzche, Winnicott, Mallarmé, Montaigne, Fanon… La culture de Cynthia Fleury est très vaste et se manifeste sur de nombreux registres. Lorsqu’on ne dispose pas des mêmes outils de compréhension, on peut donc hésiter à entrer dans cette lecture et encore plus à s’engager dans la présentation du livre. Il nous paraît que ce serait fort dommage de se passer d’un tel apport, car l’écriture de Cynthia Fleury est claire, compréhensible et elle sait mettre les mots appropriés sur les différents aspects du ressentiment. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». Cette qualité d’écriture nous paraît remarquable. Elle nous aide dans la compréhension du phénomène.
La pensée de Cynthia Fleury se déploie dans une grille d’analyse d’inspiration psychanalytique. « D’où vient l’amertume ? De la souffrance et de l’enfance disparue, dira-t-on d’emblée. Dès l’enfance, il se passe quelque chose avec l’amer et ce Réel qui explose dans un monde serein. Ci-git la mère. Ci-git la mer. Chacun fera son chemin, mais tous connaissent le lien entre la sublimation possible (la mer), la séparation parentale (la mère) et la douleur (l’amer), cette mélancolie qui ne relève pas d’elle-même… L’amer, la mère, la mer, tout se noue » (p 13). Et comment traiter avec l’amer ? Cynthia Fleury évoque son travail de psychanalyste et les ressources de la « rêverie océanique ». La mer n’est pas une affaire de navigation, mais de grand large existentiel, de la sublimation de la finitude et de la lassitude » (p 14). « Universelle amertume », tel est le titre du premier chapitre. Le livre s’intitule : « Ci-git l’amer ». Notre propos n’est pas de commenter la vision de la vie qui est celle de l’auteur, mais de nous instruire de son analyse du ressentiment. Nous voici donc à la découverte du ressentiment d’abord dans sa version individuelle, puis dans sa vision collective.
Le ressentiment
Cynthia Fleury nous fait part de la définition du ressentiment telle que nous la communique Max Scheler dans un essai publié à ce sujet en 2012 : « L’expérience et la rumination d’une certaine réaction affective dirigée contre un autre qui donnent à ce sentiment de gagner en profondeur et de pénétrer, peu à peu, au cœur de la personne, tout en abandonnant le terrain de l’expression et de l’activité ». Cynthia Fleury commente en ces termes : « Le terme clé pour comprendre la dynamique du ressentiment est la rumination… Il s’agit de revivre une ré-action émotionnelle qui, au départ, pouvait être adressée à quelqu’un de particulier. Mais le ressentiment allant, l’indétermination de l’adresse va prendre de l’ampleur. La détestation se fera moins personnelle, plus globale… » (p 19). Il y a là un processus destructeur.
« Cela gronde, comme l’écrit Max Scheler à travers le mot allemand : groll. « Groll, c’est la rancœur, le fait d’ « en vouloir à » ; et l’on voit comment ce « en vouloir à » prend la place de la volonté, comment une énergie mauvaise se substitue à l’énergie vitale joyeuse… Le ressentiment allant, l’indétermination se fait plus grande… Tout est contaminé. Tout fait boomerang pour raviver le ressentiment ». L’effet est dévastateur. « Scheler évoque l’auto-empoisonnement pour décrire les « malfaits » du ressentiment »… « Le sens du jugement est vicié de l’intérieur. La pourriture est là » (p 22). Ainsi, le sens du jugement, « instrument possible de libération » est détourné vers « le maintien dans la servitude devant une pulsion mortifère ».
Si le ressentiment a un visage personnel, il débouche également sur une pulsion collective. Aujourd’hui, celle-ci s’exprime particulièrement sur les réseaux sociaux.
https://youtu.be/ElNNOOXQEv4
Guérir du ressentiment
Confronté au ressentiment, Cynthia Fleury perçoit la difficulté d’en sortir pour ceux qui s’y emprisonnent. « Seule aptitude du ressentiment à laquelle il excelle : aigrir, aigrir la personnalité, aigrir la situation, aigrir le regard sur. Le ressentiment empêche l’ouverture. Il ferme, il forclôt, pas de sortie possible ; le sujet est peut-être hors de soi, mais en soi, rongeant le soi, et, dès lors, rongeant la seule médiation possible vers le monde » (p 24). D’autant que le ressentiment peut se radicaliser : « Je puis tout te pardonner sauf d’être ce que tu es, sauf que je ne suis pas toi. Cette envie porte sur l’existence même de l’autre » (p 25). Dès lors, dans la relation clinique, « l’extraction hors de cette emprise sera extrêmement compliquée. Il faut poser comme idée régulatrice que la guérison est possible, mais que la clinique est sans doute insuffisante dans son soin. Il est impossible de dépasser le ressentiment sans que la volonté du sujet entre en action. C’est précisément cette volonté qui est manquante, enterrée chaque jour par le sujet lui-même » (p 25).
Cependant, quel est le chemin de guérison proposée par Cynthia Fleury ? « L’homme qui échappe au ressentiment n’y échappe pas d’emblée . C’est toujours le fruit d’un travail… la sublimation des instincts… Celle-ci est « un talent » de faire avec les pulsions autre chose que du pulsionnel régressif, de les tourner vers un au delà d’elles-mêmes, d’utiliser à bon escient l’énergie créatrice qui les parcourt » (p 65). C’est apprendre à bien utiliser son énergie. « La grande santé, c’est choisir l’avenir, choisir le numineux » (p 71). Cynthia Fleury prône l’accès à la création. « Choisir l’œuvre, c’est toujours choisir l’ouvert ». « L’œuvre crée l’air, l’ouverture, la fenêtre. Elle crée l’échappée » (p 73).
Le ressentiment collectif
Les ressentiments individuels peuvent s’exprimer collectivement, par exemple en empruntant la voie d’internet. En quelque sorte, ils s’agglutinent dans un déchainement de violence verbale. Cependant, le phénomène n’est pas nouveau parce que, dans l’histoire, on a pu observer des comportements analogues, par exemple dans un lien entre la passion de l’égalité et le ressentiment collectif. « La structure du ressentiment est égalitaire. Celui-ci surgit au moment où le sujet se ressent certes inégal, mais surtout lésé parce qu’égal… La frustration se développe sur un terreau de droit à… Je me crois lésé parce que je crois à mon dû ou à mon droit » (p 28). Il y a là un processus dangereux. « Dénigrer les autres ne suffit pas au ressentiment. Il faut un pas de plus : la mise en accusation. Celle-ci étant toutefois sans objet réel, elle vire à la délation, à la désinformation… Dorénavant, l’autre sera coupable. Une forme de dépréciation universelle s’enclenche » (p 29). Cette fureur engendre évidemment la fin du discernement : « Ne plus faire le point des choses, viser la « tabula rasa » sans autre projet »… « Il se produit un « éthos renversé », une « disposition générale » à produire de l’hostilité comme d’autres produisent de l’accueil au monde » (p 30). C’est bien ce que l’on observe dans une violence répétitive qui marque certains commentaires politiques apparaissant sur internet.
Cynthia Fleury nous décrit « l’homme ressentimiste » qui se manifeste ainsi. « L’une des manifestations les plus explicites et audibles du ressentiment demeure l’utilisation ordurière du langage. L’homme du ressentiment… se lâche et vomit, par son langage, sa rancœur (p274-275). L’homme ressentimiste choisit délibérément de n’user du langage que pour dégrader l’autre, le monde, les rapports qu’il entretient avec lui ». C’est une manifestation de haine. « Cette haine dresse un cadre de vie et de pensée assez nauséeux, car du ressentiment au délire conspirationniste, il n’y a qu’un pas. Telle est la version collective du désir de persécution. (p 284). On assiste à une logique implacable où les valeurs s’inversent. « Si vous êtes riche et bien portant dans cet univers inique, c’est que vous êtes complice de cet univers inique. Le ressentiment est une idéologie, un rapport de force qui cherche à s’établir et à promouvoir les intérêts d’un nouveau groupe qui se trouve spolié » (p 286). Il y a donc un renversement de la mentalité. « La notion de « mundus inversus » est très importante pour comprendre le lien manifeste entre ressentiment et pensée conspirationniste. Elle correspond à une sorte de solution magique ayant réponse à tout, pouvant expliquer toutes les vexations narcissiques de l’individu ressentimiste et permet par ailleurs une merveilleuse dissolution de ses responsabilités… Le raisonnement conspirationniste est bien connu dans la psychiatrie, car il est l’apanage des structures paranoïaques » (p 288).
Réduire le ressentiment collectif
Cependant, si ces processus de pensée sont malheureusement répandus, on peut s’interroger sur les conditions qui peuvent en favoriser le développement. Ainsi combien il est important de respecter les singularités, l’originalité de chacun. La question a été posée au niveau des institutions de soin, des asiles. « Il est intéressant de voir que cette analyse peut être élargie de nos jours au fonctionnement plus global de la société. Que faire de l’attention au petit, à l’infime, aux détails du singulier ? y a-t-il une place pour cela dans la politique ? » (p 262). C’est prendre garde à la « réification », à la chosification, à la normalisation qui s’opèrent dans les institutions publiques comme « si elles prenaient plaisir à détruire les positions de l’individu pour le mettre sous tutelle et enlever tout goût d’individuation » (p 261). Cynthia Fleury met en évidence des facteurs favorisant des dysfonctionnements individuels et des dysfonctionnements collectifs. « Il s’agit de comprendre que la santé psychique des individus produit un impact tout à fait indéniable sur le fonctionnement de la société… Dans « Les irremplaçables », j’avais cherché à démontrer ce lien à l’égard d’un individu réifié, se sentant remplaçable, interchangeable, non respecté par un environnement notamment institutionnel et professionnel, donc public au sens large. Comment cet individu, petit à petit, se clivait pour résister à cette maltraitance psychique » (p 271). « Nos institutions doivent produire assez de soin pour ne pas renforcer les vulnérabilités inhérentes à la condition humaine, à savoir ses conflits pulsionnels… et prendre garde à ne pas produire de la réification qui après s’être retournée contre les individus, les avoir rendu malades, se retourne contre la démocratie elle-même en développant la traduction politique de ces troubles et notamment dudit ressentiment » (p 273).
Plus généralement, le ressentiment collectif se nourrit d’une angoisse sociale en lien avec un manque de relations humanisantes. Cynthia Fleury cite Michel Angenot dans une analyse qui s’inspire de Max Weber. « Les idéologies du ressentiment sont intimement liées aux vagues d’angoisse face à la modernité, à la rationalisation, à la déterritorialisation. La mentalité de la « gemeinshaft », homogène, chaude et stagnante a tendance à tourner à l’aigre dans les sociétés ouverts et froides, rationnelles et techniques. Le ressentiment qui recrée une solidarité entre pairs rancuniers et victimisés… apparaît comme un moyen de réactiver, à peu de frais, de la chaleur, de la communauté dans l’irrationnel chaleureux » (p 290). Ainsi, pour Cynthia Fleury, prévenir le ressentiment collectif autant que faire se peut, c’est veiller à ne pas renforcer les processus extrêmes de rationalisation et de déterritorialisation qui provoquent immanquablement un sentiment de réification et donc, par réaction, une résistance qui, très vite, préfère se soumettre à une passion victimaire » (p 291).
Cette présentation du livre de Cynthia Fleury nous fait comprendre l’importance du ressentiment et en éclaire les ressorts. Mais il est très loin de rendre compte de la richesse de cet ouvrage. Ainsi, l’auteure traite également des incidences de la colonisation et des processus du fascisme. Et aussi, on découvre des réflexions sur des sujets de grande importance comme le discernement (p 30-31) ou la pratique d’écriture en thérapie (p 257-258). Dans ce livre, Cynthia Fleury entre en dialogue avec ses pairs, analystes et psychologues. Si notre culture est différente, il reste que Cynthia Fleury ouvre au lecteur non expert des fenêtres de compréhension. Dans cette tâche, elle est servie par une écriture riche et précise autant que par sa vaste culture. A une époque où nous sommes confrontés au ressentiment, au moins dans sa forme collective, il serait dommage d’ignorer l’apport de ce livre.
Cynthia Fleury aborde la question à partir de sa culture et de sa pratique d’analyste. D’autres points de vue sont envisageables. Ainsi peut-on envisager la prévention du ressentiment à partir d’une culture spirituelle qui met en avant l’amour, la miséricorde, le pardon, d’une culture relationnelle de la fraternité et de la communauté. C’est l’enseignement de Jésus qui, dans la dynamique de l’Esprit, nous appelle à un amour universel et à un pardon inépuisable. Nous voici, aujourd’hui interpellé par les manifestations de ressentiment. Cynthia Fleury nous permet d’envisager les dimensions de ce phénomène, d’en comprendre les ressorts et de participer ainsi à la « guérison du ressentiment ». Voila un précieux éclairage.
J H
- Cynthia Fleury. Ci-git l’amer. Guérir du ressentiment. Gallimard, 2020. Cynthia Fleury est interviewée sur son livre dans plusieurs vidéos : France culture. Dépasser le ressentiment pour sauver la démocratie : https://www.youtube.com/watch?v=ElNNOOXQEv4
Voir aussi :
De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin
https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/
par jean | Sep 24, 2013 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement, Vision et sens |
 Un avenir pour l’humanité dans l’inspiration de l’Esprit.
Un avenir pour l’humanité dans l’inspiration de l’Esprit.
#Pippa Soundy est une amie anglaise qui, au long des années, a effectué un parcours spirituel qu’elle poursuit actuellement comme pasteure-prêtre dans l’Eglise anglicane, constamment en recherche des émergences positives. Pippa a pris connaissance du livre de Anne-Sophie Novel et Stéphane Riot : « Vive la Co-révolution. Pour une société collaborative », en lisant, sur ce blog, la présentation de cet ouvrage (1). Dans une dimension internationale, elle en perçoit toute l’originalité. Pour elle, cette perspective prend tout son sens dans la vision d’un Dieu lui-même communion. Elle répond ici à quelques questions.
#Pippa, peux-tu nous décrire brièvement ton parcours ?
#J’ai été une enfant studieuse et c’est au cours de mes années d’études à l’université d’Oxford que j’ai connu le Christ comme personne vivante. Depuis lors, j’ai été membre de plusieurs églises et cela fait six ans que j’exerce un ministère. Au départ, je considérais l’Église comme la « société alternative » inaugurée par Jésus, un peu à part de la société en général. Mais ces dernières années, je suis devenue plus consciente que l’Esprit de Dieu agit à travers toutes sortes de personnes et d’institutions et, aujourd’hui, je me considère moins comme ‘leader d’église’ que comme facilitateur de communauté et je pense que le partenariat est la clé d’une transformation de la société.
#Pourquoi t’intéresses-tu particulièrement aujourd’hui aux changements culturels et aux innovations sociales ?
#Le monde change plus vite aujourd’hui qu’à tout autre moment de l’histoire de l’humanité et la culture change aussi, à la fois au niveau mondial et local. Il est urgent que nous trouvions des solutions innovantes et créatives aux problèmes rencontrés sur toute la planète et cela m’intéresse de réfléchir à la façon dont nous, chrétiens, permettons à notre relation avec Dieu de donner forme à notre engagement dans ce processus de changement. Je pense que c’est un « impératif évangélique » et je suis donc partie prenante pour tenter « d’éveiller » l’Église aux mouvements de changement culturel et d’innovation sociale. En termes de mission, nous vivons un moment extrêmement favorable.
#Tu connais bien aujourd’hui la littérature internationale. Ce livre : « Pour une société collaborative » te paraît apporter une contribution originale. En quoi ?
#Je pense que ce qui met ce livre à part, c’est la reconnaissance d’une science intuitive et communautaire – « soyons davantage en prise avec notre cœur ». Cela va au-delà de l’utilitarisme et suggère l’émergence d’un « sens du bien commun » qui transcende l’individualisme et la compétition. La plupart des ouvrages séculiers que j’ai lus présument que nous ne pourrons jamais sortir de nos tendances individualistes et donc que toutes les solutions devront en fin de compte faire appel à notre désir de gain personnel, laissant beaucoup moins d’espoir pour une vraie collaboration.
#Quelle avancée vois-tu dans le mouvement vers une société collaborative ?
#Je le vois d’abord dans l’attitude de la génération montante. J’observe que les jeunes qui grandissent dans ce monde émergent attachent de l’importance à l’amitié au-delà des frontières nationales, raciales, religieuses et économiques, et cette amitié est facilitée par les média sociaux. Il en ressort que tandis que ma génération d’Occidentaux cherchait « comment puis-je améliorer ma vie », la génération montante semble comprendre que la façon d’améliorer notre propre vie est de chercher à améliorer celle des autres. Peut-être cette prise de conscience augmente-t-elle du fait que nous acceptons que notre être-même a besoin des autres. Un article récent du Huffington Post était intitulé « Comment améliorer votre vie (Petit tuyau : Cela commence par améliorer la vie des autres » (http://huff.to/1fSfsn5).
La révolution de l’information nous met davantage au courant des problèmes du monde qu’auparavant (spécialement les problèmes de justice). La popularité des campagnes internationales lancées sur la toile par des mouvements comme Avaaz (http://avaaz.org) montrent que les gens ne sont pas indifférents à la souffrance des autres, mais ont une approche instinctive de la façon dont le monde pourrait et devrait marcher, dans une optique de collaboration. On pense de plus en plus qu’il est important de faire preuve « d’intelligence du cœur » autant que « d’intelligence de la raison », même si je ne suis pas sûre que notre système éducatif ait encore pris ce tournant.
De la même façon, les mouvements concernant l’environnement, qui ont été tant marginalisés au XXe siècle, prennent de l’importance sur le terrain, même si nos leaders politiques continuent à se battre sur les accords internationaux. Certains de ces mouvements proposent avec succès une collaboration directe – ainsi l’Alliance Pachamama (http://www.pachamama.org) qui a commencé avec comme objectif les forêts primaires d’Amazonie et tente d’aider les gens à comprendre l’interconnexion de la vie sur notre planète et à prendre des mesures concrètes pour le changement.
Nous observons aussi l’effondrement des hiérarchies intellectuelles. Les gens n’ont plus peur des « experts » et l’expertise concerne de plus en plus l’expérience plus que le savoir. Cela fournit une excellente base pour la collaboration, avec des échanges qui s’opèrent sur un fond de connaissances communes et porteurs d’idées créatives plus que d’information pure. Au niveau universitaire, l’école Martin à Oxford (http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk) met en oeuvre une approche interdisciplinaire pour essayer de s’attaquer aux problèmes les plus importants de ce XXIe siècle, dans l’espoir d’une fertilisation croisée des idées, d’une collaboration concernant des scientifiques de haut niveau, mais aussi le grand public. On y fait l’hypothèse que chacun peut apporter une contribution valable au débat, quel que soit son niveau de formation.
Si l’on considère la société du Royaume uni aujourd’hui, la crise économique (avec la réduction significative des budgets publics) entraîne une meilleure collaboration entre les secteurs salariés et bénévoles et des partenariats sans précédents, par exemple entre les pouvoirs locaux (les institutions locales) et les églises. Nous le voyons dans la création de toutes sortes de services communautaires, y compris l’éducation, les bibliothèques, les refuges pour les sans abris et les banques alimentaires et, à l’occasion de toutes ces opportunités nouvelles, les églises et différents groupes de fidèles commencent à collaborer comme jamais ils ne l’avaient fait.
#Pour toi, comment cette perspective fait-elle écho à ta manière de te représenter Dieu et son œuvre ?
#h bien, à partir de mes 33 ans d’expérience comme chrétienne et spécialement de mon étude de la Trinité ces dernières années, j’ai compris que Dieu était une relation d’amour mutuel et que les êtres humains avaient le privilège de participer à cet amour. Nous ne vivons à l’image de Dieu que si nous sommes en relation avec Dieu et les autres et nous sommes tellement faits pour la relation, la vie ensemble, que nous sommes incapables de refléter Dieu en étant des individus séparés. En d’autres termes, une société collaborative commence à refléter un Dieu qui est Collaboration dès avant le Commencement. J’ai montré le Dieu Trinité comme Celui qui prend soin, l’Incarné et l’Esprit co-créateur et notre collaboration à l’image de ce Dieu comprend le renouveau de notre pensée, de notre corps et de notre esprit dans l’aide que nous nous apportons mutuellement de tant de façons.
De même que la Trinité a exprimé son amour dans la Création, nous sommes aussi invités à participer ensemble au renouveau de notre environnement et, bien que nous puissions chacun faire quelque chose, la taille même de notre monde implique que nous travaillions ensemble de plus en plus. L’importance croissante des mouvements environnementaux témoigne du fait que nous et notre monde sommes sauvés ensemble. Le salut est un exercice de collaboration ! Depuis que l’Esprit du Christ a été répandu sur tous, une invitation a été lancée à tous de se joindre à l’œuvre divine de re-Création et je considère que ce mouvement de collaboration est une preuve de l’Esprit dans le monde d’aujourd’hui.
#Comme chrétienne, quelle inspiration reçois-tu en ce sens ?
#D’abord je reçois l’espérance. Au cœur de la bonne nouvelle du Christ il y a la restauration des relations et la fin du besoin de nous détruire mutuellement (ou notre monde) psychologiquement, économiquement ou corporellement. Lorsque je vois des gens qui vivent à l’image de Dieu dans une société collaborative, je me souviens que le Royaume de Dieu est là et que je n’ai pas à attendre la mort pour commencer à jouir de la Terre nouvelle que Jésus est venu inaugurer.
#Interview de Pippa Soundy
Traduction par Edith Bernard
#(1) Sur ce blog : « Une révolution de « l’être ensemble ». La société collaborative : un nouveau mode de vie »
https://vivreetesperer.com/?p=1394
Voir aussi le livre publié sous la direction de Carine Dartiguepeyrou : « La nouvelle avant-garde. Vers un changement de culture » où se manifeste un nouveau courant de pensée qui allie : sciences, arts et spiritualité. Sur le site de Témoins (sept. 2013) : « Emergence d’une vision du monde « évolutionnaire ». Un changement de culture au Club de Budapest » http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1029&catid=4
Sur ce blog, on pourra lire aussi : « Une vision de la liberté » : https://vivreetesperer.com/?p=1343
par jean | Fév 3, 2016 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Hstoires et projets de vie |
Une ressource spirituelle
Grâce à des recherches comme celles de Rebecca Nye (1), nous apprenons aujourd’hui à découvrir la spiritualité de l’enfant comme un univers original, original et merveilleux… Pour nous qui sommes devenus adultes, cette découverte nous invite à revisiter notre enfance comme une ressource qui peut nous éclairer et nous inspirer. C’est ce à quoi Rebecca Nye nous encourage lorsqu’elle écrit : « Nous avons vu que la spiritualité de l’enfant et celle de l’adulte ne sont pas complètement distinctes. Elles ont beaucoup en commun. Les enfants deviennent des adultes pour lesquels les expériences avec Dieu pendant l’enfance sont souvent très formatrices. Il serait précieux de vous interroger sur votre propre vie avec Dieu, celle que vous vivez aujourd’hui et celle que vous viviez étant enfant… Une des façons d’être à l’écoute de votre être et, en particulier de votre âme d’enfant est de faire l’inventaire de quelques moments marquants de votre enfance » (p 41).
Un moment d’enfance
Nous voici donc en train de nous remémorer un moment d’enfance. Dans cette enfance environnée par la guerre et finalement protégée, il y a eu bien des moments heureux. Cependant, dans la réévocation d’une histoire spirituelle, il y a un événement qui est toujours revenu à ma mémoire. C’est un moment où, dans le mouvement de ce qui était alors la « communion solennelle », sans doute au moment où on me prenait en photo, j’ai remis en pensée ma vie à Jésus. Mais quand je me remémore ce printemps 1942, il y a eu finalement une « période sensible » que je découvre comme une oasis à l’orée d’une adolescence inquiète. Mon père était médecin militaire. Fin 1941, on lui confie la direction de l’hôpital Bégin qui accueille des prisonniers de guerre rapatriés pour raison de santé. A Noël 1941, j’arrive donc avec ma mère habiter le grand appartement de fonction qui nous était destiné. Mon père était très bon. Ce fut une grande joie de le retrouver après la séparation de la guerre, puis de son poste à Chateauroux en « zone libre ». Enfant unique, j’étais aussi objet d’affection et d’attention pour mon père, et je me rappelle combien, dans ces mois là, j’ai cherché à l’initier à ma jeune culture, à mes lectures, à mes apprentissages scolaires. Je lui faisais partager mes découvertes avec mon intuition enfantine, source de bonheur pour l’un et pour l’autre. On avait finalement trouvé pour moi à Vincennes une petite école privée destinée à un public de filles, mais où on acceptait un petit groupe de garçons. Le climat était familial et j’en perçois rétrospectivement la douceur. L’hôpital se situait dans un grand parc où je me promenais librement. Dans les beaux jours lorsque des familles s’installaient sur la pelouse, j’aimais jouer avec les plus petits et participer à ce bonheur. Cependant, il me revient aussi la forte mémoire des rencontres que j’ai eu à cette période avec des prisonniers de guerre africains rapatriés pour raison de santé. Je les rencontrais au tournant d’une allée. J’allais vers eux, je leur manifestais ma sympathie, parfois en leur offrant des fleurs cueillis au bord du chemin. Spontanéité et empathie de l’enfance…
Au printemps 1942, il y eut donc cette communion solennelle dans une grande église bondée. Avec papa, j’avais été acheter à Saint Sulpice des images de Jésus, de Marie, de saints et j’en avais tapissé le mur de ma chambre. Et sur la cheminée de ma chambre, initiative quelque peu singulière, j’avais disposé un Ancien et un Nouveau Testament illustrés par des grands dessins peut-être de Gustave Doré. Tous les soirs, j’invitais mon père à venir prier. Je ne me rappelle pas ce qui se disait, mais c’était un vrai élan de foi. Cependant, le point d’orgue de tout ceci, c’est la paix qui m’a imprégné pendant ces quelques semaines alors que j’étais un enfant très peureux, vivant dans la crainte des bombardements. C’est un souvenir très prégnant d’autant que j’ai vécu ensuite à nouveau dans la peur de cette menace. Ce fut donc une oasis par rapport aux craintes et aux tourments qui allaient monter par la suite. Je me souvenais de ce mouvement de mon cœur où j’avais confié ma vie à Jésus… En revisitant cette période, je me rends compte qu’il y a eu là une « période sensible » où amour, confiance et foi se sont conjugués dans mon vécu, un moment de grâce. Et puis les nuages sont arrivés. Le paysage intérieur s’est brouillé. Des années difficiles ont suivi.
Enfance : nos racines
A la suite de l’invitation de Rebecca Nye dans son livre sur « la spiritualité de l’enfant », nous nous sommes donc engagés dans cette exploration de la mémoire en faisant le choix de ce moment d’enfance. Certes, nous avons chacun une relation différente avec les différentes étapes de notre vie. Et de telle ou telle période, on peut garder des souvenirs qui, pour les uns, ont besoin d’être guéris (2), et qui, pour les autres, nous porteront. Pour moi, si l’adolescence a été souffrante, je puis entrer dans la vision d’Antoine de Saint-Exupéry lorsqu’il écrit dans « Pilote de guerre » (1942) : « D’où suis-je ? Je suis de mon enfance comme d’un pays ». Cette dynamique nous paraît correspondre à l’émerveillement que suscite le livre de Rebecca Nye.
A travers les expériences positives qui transparaissent dans nos vies, sachons apprécier l’œuvre de l’Esprit, et, par delà, sa puissance de guérison et de transformation dans l’immédiat et dans la durée (4).
J H
(1) Nye (Rebecca). La spiritualité de l’enfant. Comprendre et accompagner. Empreinte Temps présent, 2015. Présentation sur le site de Témoins : http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1106:l’enfant-est-un-être-spirituel&catid=14:developpement-personnel&Itemid=84
Voir aussi sur ce blog : « L’enfant : un être spirituel » :
https://vivreetesperer.com/?p=340
(2) Lecomte (Jacques). Guérir de mon enfance. Odile Jacob, 2004
(3) Nous renvoyons ici à nouveau à la pensée théologique de Jûrgen Moltmann : Moltmann (Jürgen). De commencements en recommencements. Une dynamique d’espérance. Empreinte Temps présent, 2012. Sur ce blog : « Une dynamique de vie et d’espérance » : https://vivreetesperer.com/?p=572
Mise en perspective de la pensée théologique de Jürgen Moltmann sur le blog : « L’Esprit qui donne la vie » : http://www.lespritquidonnelavie.com
par jean | Sep 2, 2022 | Société et culture en mouvement |
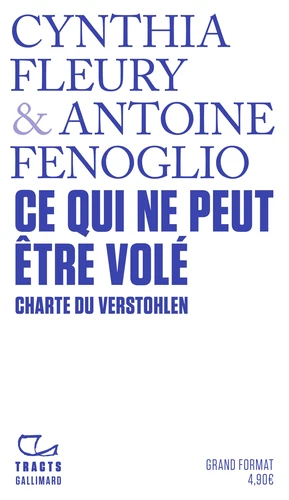 Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury
Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury
Sans que nous en ayons toujours conscience, il y a dans notre vie quotidienne, notre vie sociale, un essentiel, et, en quelque sorte, des conditions fondamentales pour que notre vie puisse être vécue humainement dans une «vie bonne ». Et, par exemple, avons-nous besoin de silence, et, le sachant, en voyons-nous toute l’importance, ou bien, si nous vivons dans un lieu bouché, ressentons-nous de même le manque d’horizon pour en revendiquer l’importance ? Dans les multiples contraintes de la vie d’aujourd’hui, parvenons nous à garder notre liberté, à préserver notre humanité et à faire mouvement dans ce sens ?
Ces questions, et bien d’autres, sont traitées dans le manifeste que Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio viennent de publier dans un livret ayant pour titre : « Ce qui ne peut être volé. Charte du Verstohlen » (1). Ce titre interroge. Y aurait-il des voleurs qui pourraient dérober ce qui est essentiel pour nous ? On imagine les enchainements qui risquent de nous asservir. Mais, en premier temps, il y a là une affirmation. Oui, il y a des conditions essentielles pour vivre une vie humaine, une vie bonne. Le vocable : « charte du verstohlen » est énigmatique pour les non initiés. En se référant à l’expression allemande correspondante, les auteur(e)s évoquent une affirmation et une reconnaissance d’un mouvement de « furtivité ». Cependant, il s’agit là d’un terme qui nous paraît peu usité jusqu’ici. On peut le comprendre comme le refus d’être emprisonné dans une assignation, dans une catégorisation, dan une localisation. Par là, la furtivité serait, en quelque sorte, le garant de la liberté.
Ce terme témoigne de l’inventivité conceptuelle qui se manifeste dans cette charte, Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio associant dans cette recherche des compétences et des champs complémentaires. La première, philosophe et psychanalyste, est pionnière dans le domaine du care et de l’éthique du soin. Le second œuvre dans le design et l’architecture. Ils sont associés à la Chaire de philosophie, à l’hôpital/CHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Notre attention pour ce texte a été attirée par notre appréciation de l’œuvre de Cynthia Fleury dont nous avons présenté deux livres sur ce blog : « Le soin est un humanisme » et « Ci-git l’amer : guérir du ressentiment » (2). Ce livre nous paraît plus difficile à rapporter ; car cette pensée subtile est, par nécessité très conceptuelle et elle s’exprime parfois avec des mots peu usités. Pour mieux en rendre compte au public de ce blog, nous ne résumerons pas un texte qui, de surcroit, vogue en liberté, mais nous essaierons simplement de présenter quelques pensées fortes de ce manifeste comme une ressource pour la compréhension et l’action, et participant ainsi à un travail de conscientisation.
Avant d’entrer dans cette présentation, nous rapportons ici une mise en perspective de France Culture.
Un manifeste en dix points
« Inappropriable, bien commun, bonheur national brut,… « Nommez-le comme vous voulez », nous dit le tract : « Ce qui ne peut être volé : Charte du Verstohlen », un manifeste en dix points coécrit par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste et le designer Antoine Fenoglio : « Dix points non négociables qui nous paraissent évidents, mais qui ne le sont plus » déclare Cynthia Fleury. « Cela va du silence à la santé en passant par le droit d’accéder à une vue… »
Les auteurs définissent tous les objets et les méthodes pour les défendre. Le « proof of care », le climat de soin, l’enquête, la furtivité, autant de moyens pour protéger ce qui peut nous être volé. Ainsi c’est l’écrivain, Alain Damasio, auteur notamment du roman « Les furtifs » (2019), qui a inspiré aux auteurs le concept de « furtivité », auquel le titre est dédié, « Verstohlen » renvoyant littéralement au terme « furtivement » en allemand. Le furtif, politisé, nous parle des manières de s’exfiltrer de la réalité telle qu’elle nous est proposée aujourd’hui, réduite, nous disent les auteurs, aux processus de réification quasi quotidienne ». « En défendant ce qui peut nous être volé, c’est aussi une certaine conception de la démocratie, mais aussi de la vulnérabilité qui est défendue. La vulnérabilité devient un vecteur de connaissance et non plus un objet de discrimination ou de stigmatisation » (3).
Des éclairages pour la compréhension et l’action
Voici donc quelques exemples des pensées fortes présentes dans ce livret et accessibles à chacun de nous pour une conscience des conditions essentielles d’une « vie bonne ».
La perspective. Accéder à une vue
Lorsque notre fenêtre débouche sur un horizon : un ciel, des arbres, une étendue, nous n’avons pas toujours conscience de l’effet engendré par un manque de perspective. Et pourtant, il y a bien là matière à avertissement : « Les mondes urbains et ruraux ne peuvent se transformer en prison où tout édifice arrête le regard : murs et bêtise ont ceci de commun qu’ils tuent la perspective » (p 5). « Une chambre avec « vue » désigne parfaitement ce qu’une ressource matérielle peut devenir, à savoir une ressource essentielle… Accéder à une vue, dans l’espace privé ou l’espace public, est une nécessité journalière. Voir l’horizon, voir la beauté , voir la lumière naturelle… nous inspire, nous soutient, et sollicite notre prendre soin en retour » (p 5). Il en ressort une réflexion sur l’architecture. « Premier critère de l’architecture. Elle est « biologique »… Et, ne jamais oublier que la destination d’un lieu, d’un objet, est d’être humain » (p 6).
La vertu du silence
Ne savons-nous pas que le bruit engendre le stress et le déséquilibre ? Le texte réaffirme la vertu du silence. « Véritable porte d’accès au monde, le sonore est un élément d’équilibre personnel fondamental dans notre relation aux autres et au monde ». « Le silence est un des facteurs-clés contribuant au bien-être, comme constitutif de la santé physique et mentale… » (p 7). Le texte dégage quatre grandes fonctions du silence. « La première peut être désignée comme spirituelle, dans la mesure où elle nous permet d’accéder au sacré, à l’espace du secret, à la solennité d’un moment, au ressourcement et au recueillement… la deuxième fonction du silence peut se définir comme intellective, cognitive, agente, dans la mesure où nous en avons besoin pour penser, réfléchir… La troisième fonction est clinique, thérapeutique… » (p 7). Enfin, les auteur(e)s mettent en évidence la contribution du silence dans « la vie publique, citoyenne ». En regard du bruit qui se manifeste souvent sur la place publique, ils rappelle que « le silence conditionne la civilité, l’urbanité, le fait de concilier vivre ensemble, extrême mobilité et circulation, libertés politiques et individuelles, dans le climat le moins hostile et agressif possible ; et l’exercice libre de la rationalité démocratique, soit la délibération ». « Nulle enceinte délibérative digne de ce nom qui n’organise les temps de parole et de silence de façon équitable, transparente et respectueuse des individualités de chacun » (p 8).
Ce silence, si important, ne doit pas être monopolisé par des milieux privilégiés. « Créer des espaces privés et publics, des architectures, des services, des paysages… qui permettent l’accès gratuit et durable au silence, c’est se soucier de préserver la qualité de notre attention au monde, à soi-même et aux autres, humains et non- humains, soit la condition d’un penser et d’un agir plus connectés… » (p 8).
Reconnaître la vulnérabilité
Cynthia Fleury accorde une grande place à la vulnérabilité dans son manifeste : « Le soin est un humanisme » (2). Et, ici, la vulnérabilité est reconnue et prise en charge. « Nos vulnérabilités ne sont ni des hontes, ni des fatalités » (p 9). Elles s’inscrivent dans la condition humaine.
Ce peut être un point de départ : « L’autonomie n’est pas un fait, mais un processus qui part du fait vulnérable et qui grâce aux ressources portées par les milieux environnants et par soi-même, se dégage de cette vulnérabilité, la rend réversible et capacitaire ». Ce mouvement comporte une dimension collective. « La politisation de la question sociale est précisément cette construction collective de l’autonomie, autrement dit la prise en considération par les ressources publiques de la vulnérabilité originelle et sociale, de la sortie de celle-ci du seul domaine privé et individuel, ou de la charité de certains » (p 9).
Une approche de care
Si la conscience du prendre soin, du care est apparue avec Carol Gilligan dans les années 1980 aux Etats-Unis (4), elle s’est répandue en France et à travers le monde. Dans ce manifeste, Cynthia Fleury a introduit une forte présence du care jusqu’à l’emploi d’une terminologie professionnelle. Ainsi évoque-t-elle les « proofs of care », les « preuves de soin », héritiers des « proofs of concept », qui sont des dispositifs de formats multiples dédiés à la vérification de l’efficacité, de la pertinence de la faisabilité, de la maturité de tels ou tels usage, technique, protocole, architecture, sachant que l’expérimentation doit être relativement frugale et rapide et absolument in situ » (p 9-10). « Le « proof of care » est au service du capacitaire humain ». « Il permettra de vérifier si le passage de l’a priori à l’a posteriori s’opère réellement et comment il est diffusable sur d’autres territoires avec d’autres parties prenantes qui à leur tour détermineront les « formes » que la « preuve » doit prendre dans leur réel… » (p10-11).
« Pas de soin du climat sans climat de soin ». « Le seul « proof of care » ne suffit pas. L’expérimentation doit s’étendre et former comme une culture, « un climat de soin » (« clouds of care »), certes par l’activation de différents « proofs of care », mais par une manière à chaque fois spécifique et pourtant reliée (donc universellement compatible, au sens où l’universel se tisse plus qu’il n’est en surplomb) » (p 12).
Le soin aux morts
Dans la société moderne, les morts, on le sait, sont repoussés à la périphérie. Le temps long est peu reconnu. Les trajectoires individuelles se dispersent. Ici, les auteur(e)s redressent la perspective. « Limiter le soin aux vivants est une hérésie » (p 15 ). « Nous formons communauté avec les vivants et les morts » p 16) (5). Cette affirmation s’inscrit dans le cadre de la prise de conscience d’une connexion généralisée : « Nous allons vers un monde plus conscient des interactions fondamentales entre humains » (p 16).
« Le soin des morts ne concerne pas exclusivement les humains. Nous formons communauté avec les non-humains et nos vies urbanisées et « modernes » ont hélas déconsidéré ce lien essentiel… Les activités hyper-capitalistiques humaines effacent les traces du vivant, font disparaitre des écosystèmes entiers. Nous avons désacralisé la reconnaissance due au non-humain. ». « Nos villes, nos espaces publics et privés, doivent pouvoir accueillir cette dimension anthropologique première qui n’est pas sans rappeler celle que nous cultivons avec le sacré et l’invisible. Si la religion est une option, le sacré ne l’est pas. L’homme se tient debout grâce à une verticalisation tout aussi physique que psychique et spirituelle » (p 16 ).
Le texte rapporte une conférence d’Heidegger « évoquant la nécessité de quadriparti de la terre, du ciel, des dieux et des mortels ». Et « l’homme est pour autant qu’il habite… Habiter est la manière dont les mortels sont sur terre ». « Habiter, c’est demeurer, prendre conscience du temps long qui nous traverse » (p 18). Si le « furtivement » préconisé par la charte va plutôt dans le sens du nomadisme, « il s’agit de comprendre ce qui nous lie émotionnellement, cognitivement, au mouvement et au fait de demeurer » (p 18).
Furtivité
Les auteurs développent plusieurs approches pour influer sur le cours des choses : une démarche furtive, l’enquête, le compagnonnage. Concernant la furtivité, nous appelons le lecteur à consulter l’exposé des chapitres correspondants. La société actuelle est perçue en terme de pression et d’immixtion. « Dans un premier temps, la vie furtive est un simple acte de résistance et de refondation de la liberté individuelle et publique, ensevelie sous la tyrannie de la traçabilité… Il fallait retrouver la possibilité d’être sous les radars. Il fallait être furtif… » (p18-19). Dans cette démarche, les auteurs se sont inspirés « des enseignements conjoints de l’écrivain Damasio et du neuroscientifique Damasio… Ils nous ont permis d’inventer une technique de furtivité, de maintien au monde, en consolidant nos pouvoirs d’agir et de liberté » (p 19). « Le Verstohlen, c’est d’abord cela : avoir le droit de demeurer pour prendre soin, avoir le droit d’agir et de transformer le monde sans subir la domination et la confiscation incessante de la décision politique, ne pas être en danger, posséder en partage, faire surgir le réel dans les interstices de l’invisible » (p 19).
Enquêter. Les humanités démocratiques
Lorsqu’on aménage un lieu, un paysage, lorsqu’on conçoit un service, un protocole… il faut s’occuper des habitants, de ses publics, de ses patients et médecins, de ses espèces végétales et animales. Anciens, actuels, futurs. Cela semble une évidence, c’est surtout une nécessité » (p 24). « L’enquête est par définition le grand outil méthodologique des sciences humaines et sociales, notamment de la sociologie et de l’anthropologie ». « Dans le moment de l’enquête, d’abord distanciée, puis familière, il se joue plusieurs étapes : la découverte des âmes du territoire, errantes et notabilisées, ou encore des espérances enfouies, des traumatismes passés, des parcours de vie et de soin des individus.
Ces « enquêtes » peuvent se réaliser à l’aide d’outils sociologiques classiques, statisticiens, mais plus ils sont affinés, capables d’intégrer la parole singulière des acteurs, de respecter leur demande de confidentialité, plus ils seront riches pour créer un projet pertinent. Autrement dit, il est possible d’avoir recours à ce que l’on nomme « les savoirs expérientiels » ou encore d’utiliser l’éthique narrative pour décrire la subtilité de ces vécus » (p 25).
On en vient donc ici à nous parler de « médecine narrative », comme ce dire des patients, réflexif, littéraire, (auto)biographique lorsqu’ils décrivent, avec toute leur sensibilité et leur expertise personnelle, la maladie dont ils sont atteints » (p 26). « En errance diagnostique, la médecine narrative demeure parfois le seul lien avec la raison et le sentiment de ne pas devenir fou ». « L’Université des patients de Sorbonne Université est notamment une instance où la parole des patients est accueillie, mais surtout valorisée, diplômée. Elle devient « enseignante » à l’attention de tous, patients, soignants, médecins. Elle permet d’analyser et de redessiner les parcours de soin, la démocratie sanitaire » (p 26).
En compagnonnage
L’idée et la réalité du compagnonnage ne sont pas nouvelles, mais elles sont mises en exergue dans ce texte. « L’objet essentiel du compagnonnage est la transmission des savoirs, être et faire, et la formation non discontinuée des individus se faisant en faisant » (p 28). Le compagnonnage s’exerce dans « la durée, le temps long, ce qui perdure au-delà ». « A la différence d’une institution peut-être davantage tournée vers l’activité d’un pouvoir décisionnaire et régulateur, le compagnonnage peut se contenter de « produire », de « créer », de persévérer dans son être par la seule pertinence du maintien de son ethos et des objets différents qu’il induit ». « Il demeure un idéal communautaire, fraternel… » (p 28). Les auteurs mettent l’accent sur l’actualité du compagnonnage, sa pertinence aujourd’hui. « Le compagnonnage n’est nullement qu’une affaire traditionnelle et rituélique mais une incarnation très existentielle, de concepts, d’outils méthodologiques et de valeurs » (p 29). Les auteurs ouvrent encore plus loin la conception du compagnonnage. « Aujourd’hui, les plus belles refondations de ce compagnonnage se situent du coté d’une activité des liens avec le monde vivant, dans sa variété multiple… Nous formons communauté, compagnonnage avec l’ensemble du vivant, dans sa pluralité, non pour rendre équivalents les rapports qui nous unissent, mais pour les expérimenter de façon plus subtile et plus dense » (p 29).
Les auteurs s’engagent dans la voie du compagnonnage « autour de trois axes : enquêter, expérimenter, déployer, pour édifier des formes institutionnelles furtives qui garantissent une sorte de propriété à ceux qui prennent soin, qui entretiennent le lieu naturel et patrimonial, mais aussi les communautés vivantes et mobiles qui l’inspirent » (p 31).
Si cette charte s’exprime dans un langage apte à manier les concepts et à communiquer dans un milieu expert, elle porte des idées originales et des valeurs humanistes et écologiques que nous avons voulu rapporter ici pour un public plus vaste.
J H
- Cynthia Fleury. Antoine Fenoglio. Ce qui ne peut être volé. Charte du Verstohlen. Gallimard, 2022 (Tracts). Interview vidéo de Cynthia Fleury sur cette charte : https://www.youtube.com/watch?v=EJpkyrsk9IU
- De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin. Le soin est un humanisme : https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/ Face au ressentiment, un mal individuel et collectif aujourd’hui répandu. Ci-git l’amer : https://vivreetesperer.com/face-au-ressentiment-un-mal-individuel-et-collectif-aujourdhui-repandu/
- Ce qui ne s’achète pas. La définition du bonheur selon Cynthia Fleury : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/ce-qui-ne-s-achete-pas-la-definition-du-bonheur-selon-cynthia-fleury-7074646
- Une voix différente. Pour une société du care : https://vivreetesperer.com/une-voix-differente/
- Selon Jürgen Moltmann : la communion avec les vivants et les morts : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/
 Selon Patrice Van Eersel
Selon Patrice Van Eersel
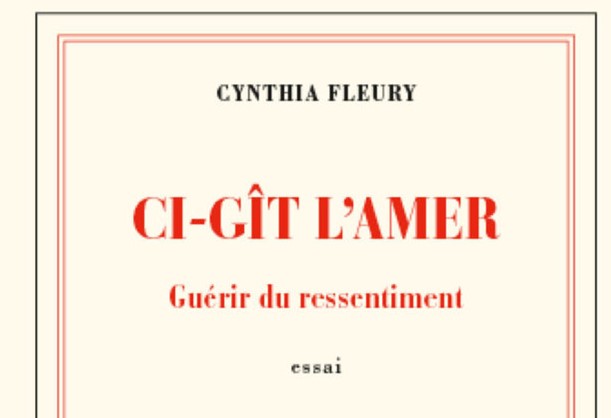

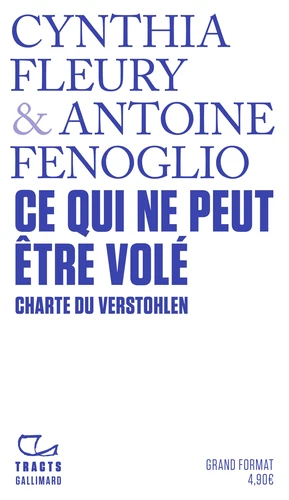 Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury
Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury