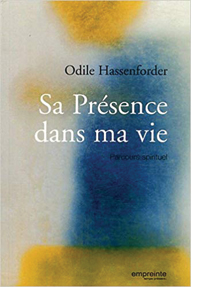par jean | Mar 18, 2018 | ARTICLES, Emergence écologique, Vision et sens |
Tous interconnectés dans une communauté de la création
La menace qui pèse sur la nature nous réveille d’une longue indifférence. Nous prenons conscience non seulement qu’elle est condition de notre vie, mais aussi de ce que nous y participons dans une vie commune, dans un monde de vivants. Nous retrouvons l’émerveillement que l’homme a toujours éprouvé par rapport à la nature et qui risquait de s’éloigner. Aujourd’hui, une nouvelle approche se répand. C’est celle d’une écologie qui ne s’affirme pas seulement pour préserver les équilibres naturels, mais aussi comme un genre de vie, un nouveau rapport entre l’humanité et la nature.
On connaît les dédales par lesquels une part du christianisme avait endossé la domination de l’homme sur la nature (1). Aujourd’hui, on perçoit à nouveau combien cette nature est création de Dieu, un espace où les êtres vivants communiquent, un don où l’humain participe à un mouvement de vie. C’est donc un nouveau regard qui s’ouvre ainsi et qui trouve inspiration dans la vision de théologiens comme Jürgen Moltmann (2) et le Pape François (3).
Aux Etats-Unis, un frère franciscain, Richard Rohr, a créé un « Centre d’Action et de Contemplation » où, entre autres, il intervient en faveur d’une spiritualité de la création. Nous présentions ici deux de ses méditations journalières mises en ligne sur internet (4).
La nature est habitée
Avec Richard Rohr, nous découvrons une merveilleuse création.
« Par la parole du Seigneur, les cieux ont été créés » (Psaume 35.6). Ceci nous dit que le monde n’est pas advenu comme un produit du chaos ou de la chance, mais comme le résultat d’une décision. Le monde créé vient d’un libre choix… L’amour de Dieu est la force motrice fondamentale dans toutes les choses créées. « Car tu aimes toutes les choses qui existent et tu ne détestent aucune des choses que tu as faites, car tu n’aurais rien fait si tu les avais détestées » (Sagesse 11.24) (Pape François Laudate Si’ 77).
En Occident, nous nous sommes éloigné de la nature. « Pour la plupart des chrétiens occidentaux, reconnaître la beauté et la valeur intrinsèque de la création : éléments, plantes et animaux, est un déplacement majeur du paradigme. Dans le passé, beaucoup ont rejeté cette vision comme une expression d’animisme ou de paganisme. Nous avons limité l’amour de Dieu et le salut à notre propre espèce humaine, et, alors, dans cette théologie de la rareté, nous n’avons pas eu assez d’amour de reste pour couvrir toute l’humanité !… ».
Notre spiritualité s’est rétrécie. « Le mot « profane » vient du mot latin « pro » voulant dire « au devant » et « fanum » signifiant « temple ». Nous pensions vivre « en dehors du temple ». En l’absence d’une spiritualité fondée sur la nature, nous nous trouvions dans un univers profane, privé de l’Esprit. Ainsi, nous n’avons cessé de construire des sanctuaires et des églises pour enfermer et y contenir un Dieu domestiqué… En posant de telles limites, nous n’avons plus su regarder au divin… Notez que je ne suis pas en train de dire que Dieu est en toutes chose (panthéisme), mais que chaque chose révèle un aspect de Dieu. Dieu est à la fois plus grand que l’ensemble de l’univers, et, comme Créateur, il interpénètre toutes les choses créées (panenthéisme) ».
Toute notre représentation du monde en est changée. Nous vivons en communion. « Comme l’as dit justement Thomas Berry : « Le monde devient une communion de sujets plus qu’une collection d’objets ». « Quand vous aimez quelque chose, vous lui prêtez une âme, vous voyez son âme et vous êtes touché par son âme. Nous devons aimer quelque chose en profondeur pour connaître son âme. Avant d’entrer dans une résonance d’amour, vous êtes largement aveugle à la signification, à la valeur et au pouvoir des choses ordinaires pour vous « sauver », pour vous aider à vivre en union avec la source de toute chose. En fait, jusqu’à ce que vous puissiez apprécier et même vous réjouir de l’âme des autres choses, même des arbres et des animaux, je doute que vous ayez découvert votre âme elle-même. L’âme connaît l’âme ».
La nature comme miroir de Dieu.
Hildegarde de Bingen (1098-1179), proclamée, en catholicisme, docteur de l’Eglise, en 2012, « a communiqué spirituellement l’esprit de la création à travers la musique, l’art, la poésie, la médecine, le jardinage et une réflexion sur la nature. « Vous comprenez bien peu de ce qui est autour de vous parce que vous ne faites pas usage de ce qui est à l’intérieur de vous », écrit-elle dans son livre célèbre : « Schivias ».
Richard Rohr nous entraine dans la découverte du rapport entre le monde intérieur et le monde extérieur. La manière dont Hildegarde envisage l’âme est très proche de celle de Thérèse d’Avila. « Hildegarde perçoit la personne humaine comme un microcosme avec une affinité naturelle pour une résonance avec un macrocosme que beaucoup appellent Dieu. Notre petit monde reflète le grand monde ». Ici la contemplation prend tout son sens. « Le mot-clé est résonance. La prière contemplative permet à votre esprit de résonner avec ce qui est visible et juste en face de vous. La contemplation élimine la séparation entre ce qui est vu et celui qui voit ».
Hildegarde utilise le mot « viriditas ». Ce terme s’allie à des mots comme : vitalité, fécondité, verdure ou croissance. Il symbolise la santé physique et spirituelle comme un reflet du divin (5). Richard Rohr évoque « le verdissement des choses de l’intérieur analogue à ce que nous appelons « photosynthèse ». Hildegarde reconnaît l’aptitude des plantes à recevoir le soleil et à le transformer en énergie et en vie. Elle voit aussi une connexion inhérente entre le monde physique et la présence divine. Cette conjonction se transfère en une énergie qui est le terrain et la semence de toute chose, une voix intérieure qui appelle à « devenir ce que nous sommes », « tout ce que nous sommes »… C’est notre souhait de vie (« life wish ») ».
Nous pouvons suivre l’exemple de Hildegarde. « Hildegarde est un merveilleux exemple de quelqu’un qui se trouve en sureté dans un univers où l’individu reflète le cosmos et où le cosmos reflète l’individu ». En regard, Richard Rohr rapporte la magnifique prière d’Hildegarde à l’Esprit Saint : « O Saint Esprit, tu es la voie puissante dans laquelle toute chose qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, est ouverte à la connexion et à la relation (« penetrated with connectness, relatedness). C’est un vrai univers trinitaire où toutes les choses tournent les unes avec les autres ». Ici, Richard Rohr rejoint la vision de Jürgen Moltmann dans « L’Esprit qui donne la vie » (6).
Hildegarde a entendu Dieu parler : « J’ai créé des miroirs dans lesquels je considère toutes les merveilles de ma création, des merveilles qui ne cesseront jamais ». « Pour Hildegarde, la nature était un miroir pour l’âme et pour Dieu. Ce miroir change la manière dont nous voyons et expérimentons la réalité ». Ainsi, « la nature n’est pas une simple toile de fond permettant aux humains de régner sur la scène. De fait, la création participe à la transformation humaine puisque le monde extérieur a absolument besoin de se mirer dans le vrai monde intérieur. « Le monde entier est un sacrement et c’est un univers trinitaire », conclut Richard Rohr.
Une oeuvre divine
Et, dans cette même série de méditations, Richard Rohr évoque la vision d’Irénée (130-202). « Irénée a enseigné passionnément que la substance de la terre et de ses créatures portait en elle la vie divine. Dieu, dit-il, est à la fois au dessus de tout et au dedans de tout. Dieu est la fois transcendant et immanent. Et l’œuvre de Jésus, enseigne-t-il, n’est pas là pour nous sauver de notre nature, mais pour nous restaurer dans notre nature et nous remettre en relation avec la tonalité la plus profonde au sein de la création. Dans son commentaire de l’Evangile de Jean dans lequel toutes choses sont décrites comme engendrées par la parole de Dieu, Irénée nous montre Jésus, non pas comme exprimant une parole nouvelle, mais comme exprimant à nouveau, la parole première, le son du commencement et le cœur de la vie. Il voit en Jésus, celui qui récapitule l’œuvre originale du Créateur en articulant ce que nous avons oublié et ce dont nous avons besoin de nous entendre répéter, le son duquel tout est venu. L’histoire du Christ est l’histoire de l’univers. La naissance de cet enfant divin-humain est une révélation, le voile soulevé pour nous montrer que toute vie a été conçue par l’Esprit au sein de l’univers, que nous sommes tous des créatures divines-humaines, que tout ce qui existe dans l’univers porte en soi le sacré de l’Esprit ».
En lisant ces méditations, on ressent combien nous nous inscrivons dans une réalité plus grande que nous. Nous faisons partie de la nature et nous y participons. Dieu est présent dans cette réalité et nous pouvons le reconnaître en nous et en dehors de nous. Cette reconnaissance et cette adhésion sont source d’unification et de paix. Ces méditations nous ouvrent à un nouveau regard.
J H
(1) « Vivre en harmonie avec la nature. Ecologie, théologie et spiritualité » : https://vivreetesperer.com/?p=757
(2) Jürgen Moltmann est un théologien qui a réalisé une oeuvre pionnière dans de nombreux domaines. Paru en français dès 1988, son livre : « Dieu dans la création » (Cerf) porte en sous titre : « Traité écologique de la création ». La pensée de Jürgen Moltmann, très présente sur ce blog, est pour nous une référence théologique. Voir aussi le blog : « L’Esprit qui donne la vie » : http://www.lespritquidonnelavie.com
(3) « Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltman, Pape François et Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/?p=2151
(4) Center for action and contemplation
« Nature is ensouled » : https://cac.org/nature-is-ensouled-2018-03-11/ « Nature as a mirror of God » : https://cac.org/nature-as-a-mirror-of-god-2018-03-12/ Et enfin : « The substance of God » : https://cac.org/the-substance-of-god-2018-03-13/
(5) Un blog de Claudine Géreg : « Viriditas » inspiré par Hildegarde de Bingen : https://viriditas.fr
(6) Sur ce blog, voir notre précédent article : « Un Esprit sans frontières. Reconnaître la présence et l’œuvre de l’Esprit » (d’après le livre de Jürgen Moltmann : L’Esprit qui donne la vie. Cerf, 1999).

par jean | Fév 6, 2024 | ARTICLES, Vision et sens |
In the fellowship of the Holy Spirit
« In the fellowship of the Holy Spirit », c’est le titre d’un chapitre du livre de Jürgen Moltmann : « The source of life. The Holy Spirit and the theology of life » (1). A la suite d’un premier ouvrage de Moltmann : « The Spirit of life » (1992) traduit en français et publié en 1999 sous le titre : « L’Esprit qui donne la vie », ce livre, inédit en français, se propose d’apporter une théologie du Saint Esprit à l’intention d’un vaste public. Dans ce chapitre, Jürgen Moltmann nous introduit dans la personnalité du Saint Esprit à travers une caractéristique majeure : la « fellowship », ce terme évoquant par ailleurs le potentiel chaleureux de la vie associative, et pouvant dans ce cas, se traduire en français par toute une gamme de termes : amitié, fraternité, communion… « Dans la communion d’un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint Esprit, le Saint Esprit vient à notre rencontre et il communique avec nous, comme nous avec lui. De fait, il nous permet d’entrer en communion avec Dieu (« fellowship with God »). Avec lui, la vie divine nous est communiquée et Dieu participe à notre vie humaine. Ce qui advient ainsi dans la manifestation de l’Esprit, n’est rien moins qu’une communion avec Dieu (« fellowship with God ») (p 190). Cette lecture nous est précieuse parce qu’elle nous permet d’apprendre à vivre aves le Dieu vivant (« The living God ») en nous, pour nous, avec nous (2).
La communion : une caractéristique de l’Esprit
« Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ et l’amour de Dieu et la communion (« fellowship ») de l’Esprit soient avec vous tous ». Ainsi s’énonce une ancienne bénédiction chrétienne (II Corinthiens 13.13). Jürgen Moltmann s’interroge. « Pourquoi le don particulier de l’Esprit est-il perçu comme la communion (fellowship), alors que la grâce est attribuée à Christ et l’amour à Dieu le Père ? ». Cette caractéristique a des conséquences considérables. « Dans cette communion, l’Esprit est davantage qu’une force vitale neutre. L’Esprit est Dieu lui-même en personne. Il entre en communion avec les croyants et les attire en communion avec lui. Il est capable de communion et désire la communion » (p 89).
Les vertus de la communion fraternelle
Le terme « fellowship » est difficile à traduire ici, car, dans la vie courante, il s’applique aussi à l’esprit associatif et on peut l’évoquer en terme de fraternité ; nous utiliserons ici le terme : communion fraternelle. « La communion fraternelle ne s’impose pas par la force et par la possession. Elle libère. Nous offrons une part de nous-même et nous partageons la vie d’une autre personne. La communion fraternelle se vit dans une participation réciproque et une acceptation mutuelle. La communion fraternelle surgit quand des gens qui sont différents, trouvent quelque chose en commun, et, que ce quelque chose en commun est partagé par différentes personnes… Il y a communion fraternelle dans une relation mutuelle : des fraternités engendrées par une vie partagée. Dans la plupart des fraternités humaines, les objectifs et les relations personnelles sont liés » (p 89). Et la communion fraternelle peut s’établir entre gens semblables, mais aussi entre gens différents.
La communion de Saint Esprit : un phénomène original
Si on considère ainsi la communion fraternelle, la fraternité dans le genre humain, qu’en est-il dans la communion fraternelle, telle qu’elle se manifeste à travers le Saint Esprit ? « Si nous nous rappelons les différentes connotations et les différents significations de la fraternité humaines, alors la communion du Saint Esprit avec nous tous, devient un phénomène tout à fait étonnant. Dans l’Esprit, Dieu rentre en communion avec les hommes et les femmes : La vie divine nous est communiquée et Dieu participe à notre vie humaine. Dieu agit sur nous à travers sa proximité éveillante et vivifiante et nous agissons sur Dieu à travers nos vies, nos joies et nos souffrances. Ce qui advient en étant dans l’Esprit de vie n’est rien moins que la « fellowship », la communion fraternelle avec Dieu. Dieu est impliqué en nous, nous répond et nous lui répondons. C’est pourquoi l’Esprit peut porter de bons fruits en nous et c’est pourquoi nous pouvons aussi peiner et éteindre l’Esprit. En l’Esprit, Dieu est comme un mari, une épouse, un partenaire. Il nous accompagne et partage nos souffrances. Le Saint Esprit ne se comporte pas avec nous d’une manière dominatrice, mais avec tendresse et prévenance. De fait dans un esprit de communion fraternelle » (p 90).
Avec le Saint Esprit, entrer dans la communion de Dieu trinitaire.
Cependant, nous devons envisager la communion fraternelle de l’Esprit avec nous dans un paysage bien plus vaste. « Le Saint Esprit n’entre pas seulement en communion avec nous et ne nous attire pas simplement en communion avec lui. L’Esprit lui-même – elle-même – existe en communion avec le Père et le Fils, « d’éternité en éternité », et est adoré et glorifié ensemble avec le Père et le Fils comme le dit le credo de Nicée. Ainsi, la communion de l’Esprit avec nous se cache dans la communion éternelle avec Christ et le Père de Jésus – Christ. La communion du Saint Esprit avec nous correspond à sa communion divine éternelle. Elle ne correspond pas seulement à cette communion, elle est elle-même cette communion. Ainsi dans la communion de l’Esprit, nous sommes liés au Dieu trinitaire, pas seulement extérieurement, mais intérieurement. A travers l’Esprit, nous sommes attirés dans la symbiose éternelle ou la communion vivante du Père, du Fils et de l’Esprit, et nos vies humaines limitées participent au mouvement circulaire éternel de la vie divine. Ainsi, dans la communion du Saint Esprit avec nous tous, nous faisons l’expérience de la proximité de la vie divine et aussi l’expérience de notre vie mortelle comme une vie qui est éternelle. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous… Dans la communion du Saint Esprit, la Trinité divine est si grande ouverte que la création entière peut y demeurer. C’est une communion qui invite : « Qu’ils puissent tous être en nous », telle est la prière de Jésus dans l’Evangile de Jean ( Jean 17.21) » (p 90-91).
Une unité respectueuse de la diversité
Cette description de la place et du rôle du Saint Esprit dans la communion trinitaire peut-elle nous apprendre quelque chose sur le genre d’unité que les croyants vont développer dans la communion de l’Esprit ? Est-ce que l’Esprit se manifeste essentiellement dans l’animation de la communauté ou bien particulièrement dans la vie individuelle des croyants ? Jürgen Moltmann récuse cette alternative tranchée. « La communion du Saint Esprit ne renforce ni l’individualisme protestant dans la foi, ni le collectivisme ecclésial catholique. L’expérience de la riche variété des dons de l’Esprit est aussi primordiale que l’expérience de la communion dans l’Esprit. « Il y a une variété de dons, mais c’est le même Esprit » (I Cor 12.4)… L’expérience de la liberté qui donne à chacun ce qui lui est propre (I Cor 12.11) est inséparable de l’expérience de l’amour qui unit les gens ensemble dans l’Esprit. La vraie unité des croyants dans la communion de l’Esprit est une image et un reflet de la Trinité de Dieu et de la communion de Dieu dans des relations personnelles différentes. Ni une conscience collective qui réprime l’individualité des personnes, ni une conscience individuelle qui néglige ce qui est commun, ne peuvent exprimer cela. Dans l’Esprit, personnalité et socialité viennent ensemble et sont complémentaires » (p 92).
Le chapitre : « In the fellowship of th Spirit » se poursuit en deux autres séquences : « L’Église dans la communion de l’Esprit », et « La communion fraternelle entre les générations et les sexes ».
La pensée théologique de Moltmann est entrée dans une nouvelle étape créative au début des années 1990 à travers sa théologie de la création, sa nouvelle théologie trinitaire et sa théologie de l’Esprit (2). Ce livre : « La source de vie » s’inscrit dans ce mouvement. Nous avons été inspiré par ce passage qui évoque pour nous la présence divine en terme de communion, dans un rapport à l’expérience de la communion fraternelle.
Rapporté par J H
- Jürgen Moltmann. The source of life. The Holy Spirit and the theology of life. Fortress Press, 1997
- Pour une vision holistique de l’Esprit : https://vivreetesperer.com/pour-une-vision-holistique-de-lesprit/
par jean | Juil 20, 2019 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
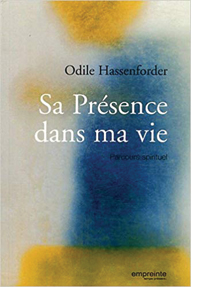 De plus en plus, quelque soient les tempêtes, nous percevons un mouvement d’unification dans le monde d’aujourd’hui (1) et, en abaissant les barrières entre les disciplines académique, ce mouvement affecte également notre usage du savoir (2). De plus en plus, l’être humain est envisagé dans une perspective globale, holistique. Le corps et l’esprit communique et interfère réciproquement comme le montre Denis Janssen dans son livre : « la guérison intérieure » (3). Dans le même mouvement, la médecine est appelée à reconnaître les interrelations entre les différents composants, les différents niveaux du corps et à s’engager dans une perspective intégrative (4). La spiritualité est, elle aussi, concernée au premier chef. On a pu la définir récemment comme une « conscience relationnelle », comme une relation avec soi-même, avec les autres, avec la nature et avec Dieu (5). La focalisation sur l’âme se détournant du corps, la méconnaissance de celui-ci, sont en train de s’éloigner. Tout est perçu en terme de relation. Comme le souligne Jürgen Moltmann dans sa théologie trinitaire, Dieu lui-même est communion d’amour, un amour qui se répand (6). La présence de Dieu se manifeste (7).
De plus en plus, quelque soient les tempêtes, nous percevons un mouvement d’unification dans le monde d’aujourd’hui (1) et, en abaissant les barrières entre les disciplines académique, ce mouvement affecte également notre usage du savoir (2). De plus en plus, l’être humain est envisagé dans une perspective globale, holistique. Le corps et l’esprit communique et interfère réciproquement comme le montre Denis Janssen dans son livre : « la guérison intérieure » (3). Dans le même mouvement, la médecine est appelée à reconnaître les interrelations entre les différents composants, les différents niveaux du corps et à s’engager dans une perspective intégrative (4). La spiritualité est, elle aussi, concernée au premier chef. On a pu la définir récemment comme une « conscience relationnelle », comme une relation avec soi-même, avec les autres, avec la nature et avec Dieu (5). La focalisation sur l’âme se détournant du corps, la méconnaissance de celui-ci, sont en train de s’éloigner. Tout est perçu en terme de relation. Comme le souligne Jürgen Moltmann dans sa théologie trinitaire, Dieu lui-même est communion d’amour, un amour qui se répand (6). La présence de Dieu se manifeste (7).
Cependant, dans ce monde en mutation, nous vivons en tension. Les représentations du passé sont encore là et font souvent barrage. Des attractions nouvelles nous bousculent parfois et nous dispersent. Les vicissitudes de la vie, les menaces concernant la santé sont toujours là avec les inquiétudes qu’elles génèrent. Nous avons toujours, et même de plus en plus, besoin de vivre en relation avec une présence, la Présence divine, source de confiance et de vie. Ainsi, ce texte d’Odile Hassenforder : « Vers une personnalité unifiée », écrit, il y a une dizaine d’années, nous paraît toujours innovant. Il vient nous éclairer dans nos cheminements de vie. C’est un texte de réflexion qui a demandé à Odile un effort de synthèse. Et c’est aussi un témoignage, car Odile a écrit ce texte tout en étant confrontée à une dure maladie. Aussi bien, nous savons qu’à l’époque, elle en avait parlé à son médecin, pour elle, un ami.
Ce texte est paru en 2006 sur le site de l’association à laquelle Odile participait activement : Témoins (8). Il a été ensuite publié dans le livre : « Sa présence dans ma vie » (9). Ici, Odile exprime une vision globale d’un être humain en marche vers une personnalité unifiée, dans une perspective de plénitude (en anglais : wholeness) (11) , en Christ ressuscité, promise et offerte par Dieu.
J H
- Une prise de conscience de la globalisation qui remonte à la conception de la « Noosphère » selon Teilhard de Chardin : https://fr.wikipedia.org/wiki/Noosphère
- Michel Serres. Petite Poucette. Une nouvelle manière d’être et de connaître. Vers un nouvel usage et un nouveau visage du savoir : https://vivreetesperer.com/une-nouvelle-maniere-detre-et-de-connaitre-3-vers-un-nouvel-usage-et-un-nouveau-visage-du-savoir/
- Vers une nouvelle médecine du corps et de l’esprit : https://www.temoins.com/vers-une-nouvelle-medecine-du-corps-et-de-lesprit/
- Médecine d’avenir. Médecine d’espoir : https://vivreetesperer.com/medecine-d’avenir-medecine-d’espoir/
- La vie spirituelle comme une « conscience relationnelle ». la recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
- Dieu, communion d’amour : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
- Jürgen Moltmann. Reconnaître la présence de Dieu à travers l’expérience : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-la-presence-de-dieu-a-travers-lexperience/ Richard Rohr. La danse divine (The divine dance) : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/ Une nouvelle manière de croire (Diana Butler Bass) : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/
- Sur le site de Témoins : Vers une personnalité unifiée : https://www.temoins.com/vers-une-personnalite-unifiee/
- Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Parcours spirituel. Empreinte, 2011 (p 207-211) Voir sur ce blog : Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Un témoignage vivant : https://vivreetesperer.com/odile-hassenforder-sa-presence-dans-ma-vie-un-temoignage-vivant/
Vers une personnalité unifiée
Les besoins, à différents niveaux, sont si nombreux que les multiples facettes de la relation d’aide sont toutes utiles. Pour ma part, depuis une trentaine d’années, j’ai fait bien du chemin. Dans les milieux charismatiques ou évangéliques, j’ai vu les merveilles de l’amour de Dieu, des miracles. J’ai aussi constaté qu’après amélioration, certaines personnes retombaient dans les mêmes ornières, malgré leur confiance en Dieu. Assistante sociale de profession, j’étais habituée à l’écoute et à la recherche de solutions, sociales bien sûr, mais aussi psychologiques.
Découvertes psychologiques.
Peu à peu, tout en m’imprégnant de la Parole de Dieu, j’ai cherché à approfondir mes connaissances psychologiques en suivant diverses formations, en lisant des livres spécialisés ou en consultant des personnes compétentes. J’en ai tiré une importante leçon de vie. Quelle grande espérance de savoir que la découverte des racines de ses dysfonctionnements permet de reconstruire sa personnalité selon ses désirs profonds. De même, quelle libération de pouvoir mettre à jour ses projections ou les déviations d’une mentalité parfois marquées par un héritage ancestral… qui déforment la réalité, court-circuitent la communication et faussent la relation. Et, parallèlement, l’introduction de nouvelles représentations suscite un meilleur équilibre. C’est toujours une joie profonde de voir une personne prendre peu à peu sa vie en main.
Une approche du corps.
Observant l’influence du psychisme sur le corps, je me suis attachée, ces derniers temps, à creuser davantage mes connaissances physiologiques. Ainsi j’ai découvert que la maladie pouvait être une interpellation positive lorsqu’elle nous permettait d’aller plus loin dans la compréhension des racines de notre mal-être. Découvrir les causes permet de mieux remédier au mal. Le corps est heureusement doté de capacités de régénération et de mécanismes d’auto-défense. Cependant, ces phénomènes peuvent céder face à de trop fortes agressions. La médecine globale, telle qu’elle se développe actuellement, cherche à remettre en ordre l’équilibre général: les circuits qui relient les différents organes à l’image de vases communicants. Tout se tient. Il y a un lien entre les glandes endocrines , les hormones, les réseaux nerveux, le flux sanguin et même les ondes énergétiques… La guérison devient alors la remise en ordre de l’harmonie corporelle. Le traitement médical intervient comme un soutien positif pour remédier aux dysfonctionnements. Il ne s’agit plus de supprimer simplement les symptômes, mais de les considérer comme des panneaux de signalisation. Je loue le Créateur pour cette merveille qu’est notre corps dans sa complexité et dans ses potentialités (Ps .139).
La Vie circule.
Aujourd’hui, en essayant de faire une synthèse de mes découvertes, je réalise combien il y a interrelation entre les différents registres de notre être , du physique au spirituel en passant par les divers aspects de la vie psychique, de l’émotionnel au cognitif.
En lisant la Bible, j’y découvre une vision dynamique qui éclaire cette compréhension. Dans les Proverbes, par exemple, n’est-il pas indiqué que « D’aimables paroles sont bienfaisantes pour le corps (Pr. 16.24). Le cœur joyeux est un excellent remède (Pr. 17.22). La langue du sage apporte la guérison (Pr.12.18) ».
Ma pensée s’est peu à peu imprégnée d’une vision herméneutique et systémique : interprétation personnelle de chaque phénomène en le situant dans un ensemble au sein d’un système en mouvement et en évolution. Tout se tient. Avec émerveillement, je me rends compte que les textes bibliques font écho à ma manière de voir toute chose. Dieu Trinitaire nous a créés à son image pour devenir à sa ressemblance: une personne en relation. Par ailleurs, comme le montre les comparaisons employées par Jésus : l’eau vive, la sève, la lumière…la vie divine circule à tous les niveaux. Lorsque nous n’y mettons pas d’obstacles, nous pouvons en percevoir les effets bénéfiques. Le pardon des péchés fait tomber les barrières. Dieu agit. Dieu régénère. Dieu guérit. Comme le dit l’Evangile en parlant de Jésus : « Une force sortait de Lui et les guérissait tous » (Luc 6.19, 8.46).
Notre participation à la création.
J’ai été secouée au plus profond de mon être, le jour ou j’ai réalisé que Dieu m’appelait à participer à la gérance de sa création, à commencer par ma personnalité. Qui suis-je pour être ainsi « collaboratrice » du Créateur (Ps.8) ? Dieu continue à créer avec chacun de nous et avec moi. Le Père Céleste agit sans cesse, dit Jésus, et Il m’invite à participer à la nouvelle création mise en route dans sa résurrection. En peu de mots ici, je voudrais dire comment je comprends le dernier verset des Psaumes comme une apothéose : « Que tout ce qui respire loue l’Eternel ! ». Toutes les expressions qui se traduisent par des mouvements, des énergies, des ondes… ne participent-elles pas à cette respiration ?
Une motivation forte.
Cette expression d’une vie qui nous dépasse et à laquelle nous participons, m’aide à accompagner positivement les personnes en difficulté. En effet, pouvoir imaginer que notre cheminement à chacun peut nous conduire vers une vie plus pleine et plus libre, est une forte motivation qui fait avancer. Ainsi une épreuve devient un tremplin pour rebondir dans l’espérance (Rom. 5.54), une invitation à faire le point pour réajuster sa vie, l’occasion d’accueillir la force divine (I Cor. 10.13) pour traverser cette crise et en sortir. En Christ ressuscité, la vie est plus forte que le mal qui a perdu son pouvoir de destruction absolue (I Cor. 15). Le but poursuivi est de guider le cheminement de guérison vers l’harmonie de l’être tout entier en utilisant des approches différentes selon la personne intéressée, à sa mesure, en fonction de sa situation et de sa culture. Ce travail intérieur peut parfois se traduire par une transformation profonde du mode de vie (Rom. 12.1). Ainsi la vie porte davantage de fruits (Jean 15).
Une nouvelle dynamique.
Ainsi concrètement, il me paraît important d’apprendre à voir au quotidien ce qui est beau et bon autour de soi et en soi en développant ce que Paul appelle les fruits de l’Esprit (Gal. 5.23, Eph. 5.9, Col. 3.12…). Exprimer ses observations positives en les partageant avec d’autres, bénir en toutes circonstances (Mat. 5.45), voilà des attitudes qui développent en nous paix et joie, sentiment de plénitude dans la présence de Dieu (Rom. 14.17). Bien sûr, il serait mal venu d’imposer mes représentations, y compris par l’intermédiaire de versets bibliques. Chacun doit pouvoir exprimer ses souffrances comme son mal de vivre, mais à partir de là, il est possible de découvrir tout ce qui est positif dans sa vie et favoriser ainsi une dynamique nouvelle qui va avoir une influence bénéfique sur le psychisme et sur le corps. Ainsi j’encourage mon interlocuteur à manifester ses désirs profonds, et, ainsi à découvrir et à développer ses potentialités. C’est de cette façon qu’il pourra reconstruire librement sa vraie personnalité : « corps, âme, esprit » (I Th. 5.23). J’adhère à ce commentaire trouvé dans l’édition du Semeur de la Bible: Il s’agit de l’être humain, non en trois dimensions superposées, mais dans une globalité de la personne dans ses trois dimensions, pour vivre en contact, en relation: le corps dans sa présence au monde, l’âme, l’être intérieur dans sa relation au monde, l’esprit, l’être intérieur dans sa relation avec Dieu.
En marche.
Dans les limites de ce texte, il n’est pas possible d’illustrer, par des exemples concrets, ce panorama ou bien des nuances doivent être apportées. J’aime partager cette vision qui m’habite et suscite en moi un élan de vie. C’est le fruit d’une mise en place progressive de ma vie dans le projet d’un Dieu qui veut mon bonheur. Même dans les temps ou il me faut traverser la vallée de l’ombre, Il se tient à mes cotés et me reçoit à sa table en « invitée d’honneur » (Ps. 23). Sans ambition, ni prétention, simplement à ma mesure, je cherche à tenir ma place dans cette marche humaine que nous sommes appelés à effectuer ensemble en Eglise selon le projet divin (Eph. ch 1) . Cette vision, qui inspire ma vie, me permet d’affirmer à toute personne rencontrée que la vie vaut la peine d’être vécue.
Odile Hassenforder.
Voir aussi :
Médecine d’avenir. Médecine d’espoir : https://vivreetesperer.com/medecine-d’avenir-medecine-d’espoir/
Les progrès de la psychologie. Un grand potentiel de guérison : https://vivreetesperer.com/les-progres-de-la-psychologie-un-grand-potentiel-de-guerison/
La prière, selon Agnès Sanford, une pionnière de la prière de guérison : https://vivreetesperer.com/la-priere-selon-agnes-sanford-une-pionniere-de-la-priere-de-guerison/

par jean | Juil 1, 2025 | ARTICLES, Vision et sens |
Selon la définition du dictionnaire Le Robert, la conscience est ‘la connaissance immédiate de sa propre activité psychique’. Selon une recherche google, ‘la conscience est la présence constante et immédiate de soi à soi’. Cette définition se poursuit ainsi : ‘C’est la faculté réflexive de l’esprit humain, c’est-à-dire la capacité de faire retour sur soi-même. C’est la conscience qui permet à l’homme de se prendre lui-même comme objet de se penser, au même titre que les objets extérieurs’. La conscience est ainsi au cœur de l’existence humaine. Mais n’est-ce pas la réduire que de la limiter à cette existence ? Depuis quelques décennies, un mouvement s’opère pour en élargir le champ. Nous le ressentons à travers de nombreuses découvertes. Le titre du nouveau livre de Patrice Van Eersel est à cet égard très significatif en se portant à l’extrême : ‘Le soleil est-il conscient ? Et les dauphins ? Et les baobabs ? Et l’IA ? Et vous-même ?’ (1) Le bas de couverture explicite l’intention de l’auteur : « Elucider le mystère de la conscience ». On comprend que cet ouvrage est la résultante ultime d’une quête engagée depuis des décennies.
« Ecrivain à Libération et à Actuel, rédacteur-en-chef de Nouvelles Clés Patrick van Eersel a longuement enquêté sur différents sujets alternatifs qui ont débouché sur des livres : ‘La Source noire’ (1986) sur les Expériences de Mort Imminente ; ‘Le Cinquième Rêve’ (1993) pour les contacts avec les animaux et les dauphins.; ‘La Source blanche’ (1996) sur l’histoire des dialogues avec l’Ange ; ‘J’ai mal à mes ancêtres’ (2002) sur la psychogénéalogie ; ‘Mettre au monde’ (2008) sur de nouvelles façons d’envisager la naissance » (page de couverture). Plus récemment, en 2021, Patrice van Eersel a publié un livre intitulé ‘Noosphère’ qui présente le cheminement de la pensée de Teilhard de Chardin (2). Tous ces livres sont réalisés à partir d’interviews d’acteurs et d’experts. Au long de plusieurs décennies, Patrice van Eersel a fréquenté un grand nombre de découvreurs et c’est sur eux qu’il s’appuie pour écrire ce nouveau livre sur la conscience. Dans un entretien avec Anne Guesquière sur le site Métamorphoses, il raconte sa quête, de rencontre en rencontre, avec des personnalités remarquables (3). C’est un chemin de découverte relaté en page de couverture : « Cela parait fou, mais les faits sont là. La conscience parait habiter l’univers entier. Dans toutes les cultures anciennes, la conscience habite l’intégralité des êtres de l’univers. Les monothéismes puis les modernes l’ont progressivement réduite à une exclusivité humaine. D’universelle, elle est devenue le propre de nos cerveaux hyper-complexes. – et nous sommes supposés être ‘seuls dans l’immensité indifférente de l’univers d’où nous avons émergé par hasard’, comme dit le credo matérialiste. Or ce monopole glacé craque de tous les côtés » (page de couverture). A partir d’une immense culture qui s’est forgée dans la rencontre avec tous ceux qui mettaient en évidence des réalités et des compréhensions nouvelles, ‘une cinquantaine de scientifiques, thérapeutes, philosophes et témoins de l’extraordinaire’, Patrice van Eersel fait apparaitre des convergences, l’émergence d’un paysage nouveau. « C’est une révolution à double sens. D’une part descendant des sommets de la théorie, les découvertes de la physique quantique démontrent que la réalité intime de la matière présente des similarités troublantes avec ce que nous appelons ‘conscience’. D’autre part, remontant de la base, d’innombrables observations et expériences empiriques nous mettent en relation de résonance intelligente et sensible avec les animaux, mais aussi avec les végétaux, voire les minéraux, et peu à peu avec l’univers entier visible et invisible » (page de couverture). L’auteur entre alors dans une nouvelle vision : « Tout se passe avec une constante troublante comme si, à chaque niveau, la conscience ressemblait à une musique. Une musique issue d’un silence infiniment subtil » (page de couverture).
Nous trouvons dans ce livre la description de phénomènes déjà plus ou moins abordés au cours de notre parcours et exposés sur ce site https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/. Il y a dans ce livre de 450 pages une abondance d’informations et une piste de réflexion qui se poursuit dans un va-et-vient d’un interlocuteur à l’autre. C’est dire que nous ne pouvons pas le présenter selon notre manière habituelle. Nous nous bornerons à en présenter quelques extraits.
Aux origines de la quête
En 1981, l’auteur part enquêter en Californie au sujet des expériences de mort imminente appelé à cette époque ‘Near death experiences’ (NDE). Il reconnait l’impasse des chercheurs voulant expliquer le phénomène par la neurochimie. Il rencontre les pionniers qui mettent en évidence le caractère extraordinaire du phénomène, le psychiatre Raymond Moody et le psychosociologue Kenneth Ring. Pour l’auteur, c’est un point de départ de cette recherche sur la conscience. « Quelque fut leur fascination, ce n’était pas la mort que ces chercheurs s’acharnaient à élucider. Comment était-il possible qu’au moment où leur cœur avait cessé de battre, certaines personnes aient pu connaitre une lucidité extraordinaire, unique dans leur vie, doublée le plus souvent du souvenir d’un bonheur si ineffable que leur existence s’en était trouvée changée à jamais, la peur de mourir les ayant définitivement quittés » ? (p 21).
« Cette impression se trouvait renforcée par toutes sortes de témoignages. Ces témoins-là rapportaient des expériences en tous points semblables aux EMI (Expérience de mort imminente)… sauf qu’ils n’avaient jamais couru le risque de mourir… Pour certains, le décollage hors corps vers la grande lumière d’amour et de connaissance s’était effectuée depuis le quotidien le plus banal, à la terrasse d’un café ou lors d’une balade en forêt » (p 21) (4).
Une autre convergence se dessinait. « De grands professionnels de la méditation, venus notamment du yoga, du zazen ou du tantrisme apportaient une contribution inattendue. Selon eux, la description de l’EMI correspondait à s’y méprendre à ce que leurs disciplines respectives nommaient ‘pur éveil’ ou ‘conscience cosmique’ » (p 21).
A la même époque, Patrice rencontre le mouvement naissant des soins palliatifs. La confrontation avec la mort l’interroge. Il sort bouleversé de sa participation à un séminaire animé par cette personnalité pionnière que fut Elisabeth Kübler-Ross. Il s’était trouvé avec une centaine de personnes en extrême souffrance. La compassion transformait toute l’assemblée en chœur de pleurs… « Ce que j’allais découvrir, c’est qu’accompagnés par une praticienne aussi chevronnée qu’Elisabeth Kübler-Ross, qui avait tenu la main de milliers de mourants, mes compagnes et compagnons de grande infortune réussissaient à traverser cette vallée de larmes pour atteindre l’autre rive » (p 23). C’était un nouvel état d’esprit. « J’étais donc revenu de ce séminaire avec la conviction que, sans les femmes fondatrices des soins palliatifs, sans leur incroyable capacité à réveiller l’humain moderne de sa transe technicienne, la recherche des hommes qui ont mis en évidence le phénomène des expériences de mort imminente aurait paru si fantasque, si déracinée du réel… qu’à mon avis, elle n’aurait pu être intégrée au corpus commun » (p 24).
L’apparition d’une convergence
En remontant dans son passé, Patrice van Eersel y voit la manière dont sa quête et apparue et s’est affirmée, nourrie par des rencontres qui ont révélé une multitude de convergences.
« Presque un demi-siècle s’est écoulé depuis mes premières explorations américaines. Et, tout à coup, prenant du recul, cela s’est imposé à moi comme le nez au milieu de la figure : si tous mes reportages pour Actuel, et plus tard Nouvelles Clés, puis Clés n’ont pas exclusivement tourné autour de l’énigme de la conscience, je peux dire que ce fut bien le cas de ceux qui ont vraiment compté pour moi. Depuis le musicien Jim Nollman qui joue de la guitare dans un canoé en concert avec les orques du Pacifique, jusqu’à l’astronaute américain Edgar Mitchell revenant de la lune amoureux de la terre, en passant par la nageuse et dessinatrice Gitta Mallasz, dernier témoin de l’aventure prophétique des Dialogues avec l’ange, ou du pianiste Ray Lema, découvrant comment les villages de la forêt congolaise sont régulés par des ‘roues rythmiques’, j’ai eu la chance immense de pouvoir rencontrer des dizaines d’hommes et de femmes passionnants et géniaux dont l’essentiel de la quête tournait finalement autour de l’énigme de la conscience » (p 15).
Un nouveau regard scientifique sur le monde : la mécanique quantique
Plusieurs mouvements convergent pour entrainer un changement de notre vision du monde et donc de notre représentation de la conscience
« Je suggère que pour la plupart de nos contemporains, la façon de se figurer la conscience a fortement évoluée au cours du dernier siècle avec la double poussée d’un mouvement ‘top down’ et d’un mouvement ‘bottom up’. Peut-on dire ce qui s’est passé quand ces deux mouvements se ont rencontrés ? Se pourrait-il que cela ait profondément changé l’ADN de nos sociétés ? » (p 186). L’auteur envisage le mouvement ‘bottom up’ comme celui qui se manifeste dans de nouvelles expériences humaines comme les visions suscitées par les psychadéliques, la découverte des ‘gymnosophies d’orient’, un nouveau regard sur la mort engendré par les expériences de mort imminente. Et d’autre part, il envisage ce qu’il intitule le mouvement ‘top down’ comme la nouvelle représentation du monde qui nous est communiquée par des scientifiques : la mécanique quantique.
« Aujourd’hui, malgré sa grande complexité mathématique originelle, le concept de ‘quantique’ s’est répandu du sommet vers le bas dans un mouvement ‘top down’, une vulgarisation décomplexée que l’on retrouve propagée dans toutes sortes de réseaux… » (p 75). Selon l’auteur, ‘la mécanique quantique reconstruit notre vision du monde de A à Z’. L’auteur a, très tôt, rencontré un chercheur en ce domaine, le physicien David Bohm. Il rapporte son propos : « Au bout de la logique quantique, toute solitude s’avère désormais partielle, voire illusoire : il n’existe plus d’entité ni d’individu isolé, l’univers entier est relié et se comporte comme un seule gigantesque interconnexion, cachée derrière une mosaïque infiniment morcelée des apparences ». L’auteur va encore plus loin dans cette représentation révolutionnaire « Pris dans un ‘tissu supral’, comme l’a baptisé Emmanuel Ransford, toile d’araignée invisible qui relie les milliards de billiards de trilliards de particules cosmiques, chacun de nous peut, s’il sait donner à sa vigilance une densité et une sérénité suffisantes, non seulement communiquer avec les organes qui composent son propre corps – pour les connaitre, les harmoniser et les soigner en leur envoyant ‘des intentions bienveillantes’ – mais entrer en contact avec les autres éléments de l’univers, sans limite dans l’espace-temps » (p 77). Certes, ce bouleversement des représentations rencontre des résistances. En effet, les enjeux sont immenses. « Deux millénaires et demi après Aristote, les axiomes de base de la science occidentale ne demeurent désormais valides que dans un périmètre restreint. L’essentiel devient flou. La matière n’existe plus en tant que ‘chose’, mais laisse la place à un ‘tissu relationnel’ obéissant à de probabilités aléatoires, qui s’étendent à l’univers entier » (p 78). « Même au bout d’un siècle, comment notre système des pensée cartésien-newtonien, matérialiste, mécaniste, réductionniste et individualiste jusqu’au bout des ongles, pourrait avaler pareille métamorphose » (p 78). Une question se pose également, ‘comment peut-on passer du micro au macro ?’. Cette interrogation s’exerce dans le champ de la biologie. Selon l’auteur, la logique quantique se manifeste très largement. « Ce qui est vrai pour nos technologies de pointe l’est a fortiori pour les processus autrement sophistiqués qui meuvent les organismes vivants… De plus en plus de biologistes, de généticiens, de thérapeutes abondent en ce sens… Depuis vingt ans, les publications se multiplient. Sur l’essentiel, les arguments convergent : aucun phénomène biologique – en première ligne, citons l’olfaction, la photosynthèse, la machinerie génétique et toute l’activité neuronale – ne serait explicable sans faire appel aux lois quantiques, ne serait-ce que pour des raisons de temps et de vitesse » (p 81). « Selon Morvan Salez, ‘nos molécules communiquent les unes avec les autres. Elles chantent ensemble’. N’est-ce pas dans cet esprit qu’un biophysicien a eu (l’idée de faire pousser des légumes dans le désert en stimulant leur métabolisme, non avec de l’eau, mais avec des musiques, c’est-à-dire des résonances, processus éminemment quantique » (p 80).
Le post-matérialisme nait du croisement de deux révolutions
Patrice van Eersel nous décrit un puissant mouvement de transformation culturelle. « Il y a un siècle des calculs sophistiqués de la haute physique théorique, ce que je propose d’appeler le mouvement ‘top-down’, est peu à peu descendu jusque dans la société civile, où il suscite une multitude de pratiques de tous acabits, généralement qualifiées de ‘quantiques’. En sens inverse, le mouvement ‘bottom-up’, fonde une foule d’expériences subjectives, psychédéliques dans les cas extrêmes, mais aussi de vécus spirituels ou mystiques, parfois dits paranormaux (l’EMI étant la plus connue), et a progressivement informé la société entière de bas en haut, jusqu’à son sommet, obligeant les élites intellectuelles à le prendre en considération, avec beaucoup de réticence d’abord, mais de façon irréversible » (p 109). L’auteur nous rapporte un exemple de cette diffusion des nouvelles manières de voir. Ainsi, début 2019, est-il invité au colloque ‘Etats de conscience aux frontières de la mort’ à la Faculté de médecine de Paris. C’est donc une entrée de l’examen du phénomène des EMI dans l’espace même de l’Université française. L’organisatrice du colloque, Laurence Lucas Skalli, psychiatre et psychanalyste, veut « inciter la médecine française à s’ouvrir au champ immense de l’étude de la conscience et de son impact sur la guérison » (p 109). « Laurence Lucas Skalli ne visait rien de moins que la fondation d’une association internationale qui sera bientôt baptisée ‘Conscience sans frontières’. Pour lancer ce projet, elle a réussi à convaincre… d’éminents universitaires et chercheurs qui vont intervenir dans ce colloque. Ces personnalités reconnues dans leur domaine de compétence ont donc accepté ‘de réfléchir ensemble au fait que, aux frontières de la vie, la conscience s’avère décidément plus insaisissable que tout ce que la science avait supposé jusque là’ ». Patrice découvre en même temps d’innombrables initiatives du même acabit à travers le pays. Dès lors, à lui qui travaillait sur ces questions depuis longtemps, il apparait « que notre société s’ouvre à nouveau comme quand dans les années 1980, sous l’égide de François Mitterand et de son amie Marie de Hennezelle, s’ouvrirent en France les premières unités de soins palliatifs » (p 118).
« La conclusion de cette semaine passionnante porte le nom philosophique ‘phénoménologie’. La phénoménologie ouvre la voie à une foule d’actions pratiques, puisqu’elle signifie qu’on ne cherche plus les causes premières ni l’essence des choses, mais que l’on se concentre sur le ressenti, le subjectif, l’intériorité » (p 112). Cette séquence se poursuit par des interviews de Patrice avec des thérapeutes engagés autour de la compréhension et la mise en valeur des EMI. Elle débouche sur une rencontre avec le chercheur québécois Mario Beauregard (5). Et avec lui, nous allons pouvoir envisager le postmatérialisme en mouvement.
Patrice van Eersel fut invité à un atelier sur les synchronicités auquel Mario Beauregard participait. Il nous raconte la vie de celui-ci. « Né dans une ferme, Mario Beauregard a grandi très proche de la nature… Il est encore gamin quand il vit une expérience mystique de fusion avec la forêt (5) qu’il n’oubliera jamais et fait naitre en lui le rêve d’exercer un métier qui lui permettrait de comprendre ce qui lui est arrivé. Il vivra plusieurs autres expériences spirituelles très fortes dont ‘une sortie du corps’ d’autant plus marquante qu’il est alors atteint d’une maladie très inquiétante que personne ne sait soigner. Un ‘être de lumière’ lui apparait alors, qui le rassure en lui annonçant qu’il survivra à ce qu’il doit considérer comme une forme d’initiation. Son rêve d’enfance se trouve galvanisé – il veut absolument comprendre ce que tout cela signifie et donc étudier la nature de la conscience ». (p 120). Il devient docteur en neurologie et docteur en neurobiologie. Il parvient à utiliser les grosses machines à imagerie de sa faculté pour observer des états modifiés de conscience. En 2006, son étude sur les cerveaux d’une communauté de carmélites en prière le rend célèbre. « Il établit que les pratiques spirituelles peuvent à ce point influencer le cerveau que de vieilles religieuses censées être atteintes de maladies neurologiques graves – car leurs réseaux corticaux s’avèrent passablement délabrés – tiennent en fait vaillamment le coup. Comme si leur esprit pouvait avoir sur leur corps des effets plus qu’insoupçonnés » (p 121). Ses recherches dérangent les autorités de la faculté de Montréal. En 2013, il rejoint l’Université d’Arizona où il travaille sous la houlette de Gary Schwartz, directeur du Laboratoire de recherche sur la conscience et la santé à Tucson. Ils décident d’organiser une rencontre internationale entre des scientifiques non conformistes. « L’accord principal n’a pas été long à émerger : l’approche matérialiste réductionniste a apporté à l’humanité des découvertes prodigieuses, mais elle en a profité pour faire passer sa méthodologie au niveau ontologique, c’est-à-dire qu’elle prétend avoir le dernier mot sur la nature du réel, qu’elle réduit à la matière. Comme si, en dehors de celle-ci, rien n’existait » (p122) (6). Le paradigme dominant actuel ne parvient pas à prendre compte en grand nombre de phénomènes nouvellement identifiés. « C’est le cas avec des phénomènes comme la perception extrasensorielle, la psychokinésie, la télépathie, la clairvoyance, les VSCD (Vécus Subjectifs de Contact avec un Défunt), les EMI, les sorties du corps ou la lucidité terminale. Mais la liste ne s’arrête pas là. Comment expliquer plus généralement l’intuition, le processus de création, l’hypermnésie ou le génie des autistes Asperger… » (p 124). En regard, différentes hypothèses sont envisageables. « Pour tenter d’expliquer que la conscience n’émerge pas, mais qu’elle est comme une donnée primordiale qui transcende ce que nous croyons savoir de la matière-énergie et de l’espace-temps, Robert Sheldrake, par exemple, plaide pour une approche ‘panpsychique’ – un terme repris à Francesco Patrizi, philosophe italien du XVIe, qui suppose que dans l’univers, toute entité fondamentale ou organisée a une forme de conscience. D’autres chercheurs se réfèrent plutôt au ‘monime neutre’ qui, de Spinoza à Bertrand Russell, avance l’idée que la conscience et la matière sont deux aspects complémentaires et irréductibles l’un à l’autre, de la même mystérieuse réalité fondamentale… » (p 125).
Communiquer avec les animaux
Le changement de vision relaté dans ce livre s’étend aux animaux et aux plantes. Comme nous avons pu déjà nous en rendre compte, ce livre échappe à un résumé tant par son étendue que par son bouillonnement. Les différents chapitres ne peuvent être rapportés de la même manière. Certains s’écrivent à partir de vécus rapportés par des personnalités originales. Ainsi les récits de rencontres avec les grands animaux marins comme les dauphins et les orques nous surprennent en nous entrainant dans un univers féérique où la communication parfois intime avec des hommes et des femmes se réalise à travers des rêves ou à travers la télépathie. L’auteur aborde également la communication animale telle qu’elle s’exerce au plan terrestre. Il cite les livres sur la subjectivité animale écrits par Viviane Despret, psychologue éthologue (7), comme ‘Habiter en oiseau’ ou ‘Penser comme un rat’.
« Nous vivons une époque étrange où, d’une part, se multiplient les initiatives de communication animale inter espèces, et où, de l’autre, nous exterminons, sans même y penser des millions d’animaux » (p 180). C’est à travers des interviews que l’auteur nous décrit des initiatives de communication animale.
Ainsi nous entretient-il de Karine lou Matignon, auteur du livre ‘Sans les animaux, le monde ne serait pas humain’, et de beaucoup d’autres. « Grande amie des chevaux, Karine en a sauvé un certain nombre de l’abattoir. Cette femme ultrasensible a consacré sa vie à tenter de faire comprendre les animaux à ses congénères… ». Elle constate des progrès dans cette compréhension : « Depuis que j’ai commencé à creuser ma piste, même en France, le pays le plus conservateur et le plus matérialiste que je connaisse, les mentalités ont énormément évolué. Quand, avec des dizaines d’experts, nous avons rédigé ‘Révolutions animales’, qui est une sorte d’encyclopédie, je me suis rendu compte qu’en soixante-dix ans, notre regard sur les animaux avait franchi plusieurs paliers.
L’un des premiers acteurs du changement a été Konrad Lorenz quand, dans les années 1950, il a exigé de pouvoir étudier les animaux hors des labos dans leur milieu de vie. C’est lui qui a inspiré Jane Goodhall (7) et les autres grandes primatologues. Si aujourd’hui, on peut aller jusqu’à parler sérieusement de ‘l’individualité de la fourmi’, du ‘blues de l’araignée’ ou de la ‘conscience du poisson’, j’ai envie de dire que c’est grâce à lui » (p 183).
Karine Lou Matignon est également une soignante. L’auteur rapporte un de ses récits. « Elle avait recueilli un pauvre vieux chat de gouttière tout mité. Mais ce chat était farouche. Il ne fallut pas moins de huit mois pour que sa protectrice puisse enfin poser la main sur lui… ‘Je l’ai caressé et il a léché ma main pour la première fois. J’étais toute contente… Un mois plus tard, une nuit, j’ai fait un rêve où il me disait ‘Je meurs’… Le lendemain, une voisine l’a découvert gisant devant son portail. Il avait tenu à me dire au revoir comme pour me remercier’ » (p 184). « En soi, le fait de communiquer par rêve ou par télépathie avec autrui, humain ou animal, n’a pas étonné Karine. Elle a ce don depuis l’enfance ».
Dans cette riche séquence sur les animaux, l’auteur a également rassemblé « huit toutes petites histoires de chien, de chat, de chouette et de perroquet » (p 287). Nous y avons noté l’histoire de ce chien qui allait s’assoir devant la porte d’entrée pour attendre sa maitresse rentrant du travail. En observant, on s’aperçut que ce manège n’était pas lié à une ouïe très fine. De fait, il commençait « à l’instant précis où sa maitresse décidait de rentrer chez elle » (p 189).
Cette séquence se termine par une enquête émouvante : l’expérience terrifiante que l’écrivaine Isabelle Sorente a vécu dans un élevage industriel de porcs, un processus horrible décrit en ces quelques mots ‘calcul ultrarationnel qui métamorphose en coulée de matière organique des êtres vivants – des mammifères proches de nous à plus d’un titre’. Cependant, un jour, il se produisit un évènement remarquable. « Un après-midi quand l’écrivaine, dans sa combinaison, s’apprête à sortir de cet espace de mort, des centaines de truies, enserrées dans l’acier, le sentent aussitôt et braquent leurs regards sur cette visiteuse étrangère bien repérée depuis plusieurs jours. Alors, elle se mettent à crier toutes ensembles. Un hurlement insensé. Comme si elles appelaient au secours ». L’auteur va plus loin dans son commentaire ; « comme si elles suppliaient Isabelle de ne pas oublier la ‘magie de sympathie’ qui met les vivants en résonance les uns avec le autres ».
« La plongée d’Isabelle Sorente pourrait bien nous rappeler une vérité que les temps civilisés nous ont fait oublier : les animaux connaissent la ‘magie de sympathie’ de façon innée. Mieux que nous parce que c’est ainsi qu’ils communiquent » (p 193).
L’expression des végétaux
La nature n’est pas passive. Elle n’est pas indifférente. Elle n’est pas muette Tout communique. Pout le monde végétal, c’est une grande découverte et elle est récente. Patrice van Eersel consacre une séquence à cette prise de conscience.
On peut désormais reconnaitre, capter et diffuser la musique émise par les végétaux. L’auteur nous raconte sa rencontre avec deux pépiniéristes installés dans les Landes, Jean et Frédérique Thoby. « Leurs jardins et leurs terres sont des merveilles où s’entremêlent toutes sortes de végétaux aux couleurs, aux parfums et aux goûts les plus variés, des plus petits légumes aux plus grandes fleurs ». C’est dans ce lieu qu’au cours d’une conférence, l’auteur a pu entendre la musique jouée par ces plantes. Ce fut un enchantement. « Une musique des plus étonnante. A la fois, impressionniste dans sa douceur – on la dirait composée par des elfes ou des fées – et expressionniste dans son phrasé très accidenté. Quand ce sont plusieurs plantes qui jouent en même temps, vous vous dites que le jardin d’Eden ne pouvait pas déployer des jeux d’harmonie plus surprenants » Mais comment cela fonctionne-t-il techniquement ? « Spontanément, cette musique n’est pas audible pour nos oreilles. Pour que sa subtilité apparaisse dans la portion du spectre sonore que capte notre ouïe, il faut qu’on ait branché sur les feuilles et dans les racines de la plante, les électrodes d’un biodynamiseur, une machine inventée par des ingénieurs ayant suivi les directives du physicien Joël Sternheimer… » (p 197).
L’auteur commente ainsi cette réalisation. « Les plantes ne jouent pas de la musique au sens strict… Ce qui est certain, c’est que, comme tous les êtres vivants, leur vitalité s’exprime à chaque instant par des activités électriques. Captées par des sondes, ces impulsions peuvent être traduites de toutes sortes de manières ; cependant, cette traduction musicale correspond, bel et bien et subtilement, aux plantes elles-mêmes. Elles y réagissent en effet illico, en modifiant leurs mélodies et harmonies dans un mouvement de feed-back – si la traduction ne leur plait pas, elles se taisent ». Des chercheurs ont établi que les activités électriques des végétaux émettaient en fait des ultrasons (dont la gamme des fréquences correspondait à celles qu’émettent aussi les chauve-souris). Mais le plus fou est que ces sons influencent le métabolisme des autres espèces, végétales mais aussi animales. Cette influence inter-espèce et même inter-règne, constitue en soi une énigme colossale (p 198).
Cependant, nous découvrons ensuite que des exploitations agricoles utilisent avec succès des ‘protéodies’, c’est-à-dire, à la suite des recherches de Joël Sternheimer, une mélodie de protéine. Le conférencier écouté par l’auteur, Jean Thoby, raconte qu’un de ses voisins viticulteurs ne parvenant pas à se débarrasser de l’oïdium malgré un usage massif de produits phytosanitaires a réussi à s’en débarrasser grâce à l’utilisation de leur biodynamiseur pendant un an. Il assure que « nous disposons aujourd’hui de centaines d’expériences prouvant, à grande échelle, que notre mode de culture est efficace et même très efficace, puisque que dans certaines exploitations, les rendements ont augmenté de 30 ou 40%, et cela alors que les agriculteurs n’utilisent plus le moindre gramme d’intrants chimiques ! » (p 200).
L’auteur poursuit en racontant une expérience spectaculaire, ‘L’homme qui fait pousser des tomates dans le désert’. Un jeune ingénieur, Pedro Ferrandez, voulant contribuer à prouver l’efficacité de l’approche de Joël Sternheimer expérimente la technique correspondante dans une culture de tomates de ses parents. Plusieurs protéodies de tomate sont utilisées, notamment celle d’une protéine active dans la floraison et une autre dans la résistance à la sécheresse. Résultats renversants : en pleine chaleur estivale de 2004, les feuilles des plantes qui ont reçu de la musique… restent vertes alors que les autres sont sèches. D’abord menée en Suisse, l’expérience fut ensuite invitée à faire ses preuves, dans une exploitation horticole sénégalaise où Joël démontre que les protéidies permettent de résister aux insectes et que l’on peut obtenir de très belles tomates avec dix fois moins d’eau » (p 297).
Patrice en vient à s’interroger également aux ressentis des plantes. Ainsi, il nous raconte comment deux chevaux très différents ont été guéris par l’expression musicale de fougères, bien vivantes. Or on constata que les expressions furent différentes en s’adaptant à la condition de chaque cheval. « Tout s’était donc passé comme si chacune s’adaptait à son patient. Donc qu’une communication s’était établie entre l’animal malade et la plante thérapeute. Comme si une communication s‘était manifestée entre l’individu végétal et l’individu animal. Par quel mystérieux jeu de résonance ? (p 213).
En s’interrogeant sur ‘la compassion des végétaux’, un univers revint à la mémoire de l’auteur, celui des Kogis, « une ethnie précolombienne restée intacte, protégée par les montagnes, où elle s’est réfugiée de plus en plus haut pour échapper aux envahisseurs » (p 51). On pouvait retrouver dans cette ethnie une mentalité humaine en osmose avec la nature telle qu’elle avait émergée au début de l’humanité. Pour les Kogis, « les choses étaient claires : soit tu comprends que la nature constitue un vaste corps, vivant et conscient, que tu dois respecter avec le maximum d’humilité, et alors tu peux poursuivre ta route, soit tu ne comprends pas et tu es malheureusement fichu » (p 52).
En s’interrogeant sur ‘la compassion des végétaux’, Patrice van Eersel se rappelle que pour les habitants de la Serra Nevada de Santa Marta, tout notre malheur écologique et climatique actuel vient de ce que nous sommes devenus sourds aux innombrables communications (notamment musicales) que tous les êtres vivants tissent entre eux à chaque instant et que les cultures anciennes semblaient entendre, au moins en partie, les imitant par exemple dans leurs chants de guérison, comme en témoignent encore certaines communautés en Australie, en Amérique latine et en Afrique » (p214).
Une nouvelle vision du monde
Pour rapporter ce livre et contribuer à en faire connaitre l’apport décisif, nous avons présenté quelques-unes des fenêtres ouvertes par cet ouvrage. A la simple lecture de ces échappées, on comprend la richesse phénoménale de cette enquête tant par l’ampleur de son champ, la richesse de la documentation, les rencontres avec un grand nombre de découvreurs, la persévérance de la réflexion. Le sujet est immense. Si on relit le titre ‘Le soleil est-il conscient ? Et les dauphins ? et les baobabs ? Et le cristal ? Et l’IA ? Et vous-même ?’, on se rend compte combien nos aperçus sont très loins d’avoir couvert ce grand continent. Ils encouragent seulement à lire cet ouvrage de bout en bout.
De même, la fin de l’ouvrage appelle une lecture réfléchie, pas à pas. L’auteur nous y propose des chemins d’interprétation et de discernement. Il y évoque, bien sûr, le péril actuel, « la mortelle mise en danger de notre biosphère » (p 318) et les moyens d’y faire face. Les dernières séquences ouvrent une voie.
« Pourquoi chanter relie la Terre au Ciel » (p 389). Ainsi Jill Purce, enseignante de méditation par le chant en Angleterre sait expliquer de quelle façon chanter pour ouvrir notre conscience sur les plus hautes sphères et nous faire accéder au cœur d’une guérison à la fois physique, émotionnelle et spirituelle » (p 398). Elle a exploré également de nombreuses voies spirituelles notamment auprès des Tibétains et des Amérindiens (p 381). « Le pouvoir absolu de la musique, c’est qu’elle est le dernier phénomène qui vient nous rassembler (religere en latin), ravivant le sentiment d’appartenance à un tout, que Spinoza nommait joie (p 401), conclut l’auteur.
La dernière séquence explore la dimension spirituelle et évoque la méditation et le silence : « Et si la conscience jaillissait d’un silence très subtil » (p 403). Ici, Patrice van Eersel interview, entre autres, son ami, Jean-Yves Leloup, ‘prêtre orthodoxe, théologien très suivi’. L’auteur retient l’idée que, dans différents contextes, « on puisse remonter à la même source d’inspiration, mais avec des niveaux de conscience étalés sur un immense éventail ». Et, « Quel que soit ‘le niveau de conscience’ d’une personne visitée ou non par une inspiration supérieure, la question est surtout de savoir quelle est l’origine, la source de sa conscience. Si je prends le prologue de Saint Jean, je lis que le commencement est un Logos qui nous échappe. C’est une pure lumière, une vacuité, un Silence. Et notre conscience nait de ce silence… Saint Jean précise aussi que ce Logos est créateur, habité d’Eros, de désir. C’est par lui que toute existence prend forme. La conscience est donc première » (p 429-420). Jean-Yves Leloup distingue la conscience des états de conscience qui s’étalent dans l’horizontalité alors que le retour à la conscience nous dresse dans une verticalité qui passe du Silence pour y retourner » (p 422). Il précise aussi que « la conscience n’est pas de l’ordre de la substance, mais de l’ordre de la relation… Le fond de l’Être, c’est une relation. Dans la tradition chrétienne, c’est ce que nous appelons la Trinité » (p 424).
La pensée de Jean-Yves Leloup prend en compte l’état du monde dans lequel nous vivons. « Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que peut-être, la seule chose que nous puissions faire pour être utiles à l’humanité – et au cosmos, puisque tout est inter-relié – c’est de nous asseoir et de méditer plutôt que de nous activer. L’Internationale des consciences créée par Catherine Arno et Jean-Yves Leloup avec l’aide d’ Ines Weber et Abdennour Bidar, de l’association Sésame, se veut liée à la Terre, aux cinq continents, parce que partout il y a des femmes et des hommes, de chair et d’os, qui prennent le temps de s’asseoir, de se tenir en silence, de tenter de se relier à ce qui est la Source à la fois de la vie, de la conscience, de l’intuition, de l’amour. Ces gens qui méditent sont de plus en plus nombreux dans le monde et ont envie d’être reliés les uns aux autres ». Et de rappeler que « des recherches scientifiques ont permis de constater que là où plusieurs personnes méditaient, la violence baissait » (p 425-426).
Ce livre nos parait quasiment incomparable, car, de tous côtés, il y converge de connaissances nouvelles à partir d’interviews avec un grand nombre de découvreurs et de penseurs. Et de plus, l’auteur nous présente ces découvertes avec pédagogie. Ici, Patrice van Eersel nous fait partager sa quête sur la manière d’envisager la conscience aujourd’hui et il débouche sur une vision : « Oui, décidément oui cette dimension mystérieuse que nous appelons ‘conscience’ habite l’univers entier et pas seulement le cerveau et le cœur d’ ‘Homo sapiens’ (p 435).
Une vision chrétienne en réception de la perspective du livre de Patrice van Eersel
Patrick van Eersel nous apporte une nouvelle vision du monde : l’affirmation de la conscience à partir de convergence d’un grand nombre de faits et de ressentis qui vienne s’ajuster comme dans un puzzle. C’est une vision qui rompt avec une conception matérialiste et individualiste longtemps dominante telle qu’elle s’est exprimée dans ‘Le hasard et la nécessité’ de Jacques Monod. Cependant, peut-on dire qu’elle vient également corriger une pensée théologique qui s’était enfermée dans l’humain et était sortie de la création. La vision nouvelle de la conscience généralisée vient rebattre les cartes. Elle peut être bien accueillie par les théologiens que nous consultons sur ce blog : Jürgen Moltmann, auteur du livre ‘Dieu dans la création’ paru dans les années 1980, Richard Rohr, animateur du Centre pour l’action et la contemplation et auteur du livre ‘La Danse divine’ qui met en évidence la présence dans le monde d’un Dieu trinitaire et donc communion, Michel Maxime Egger, dont la pensée théologique s’inscrit dans la révolution écologique. Quelques extraits de auteurs viendront résonner avec la perspective émergente de Patrice Van Eersel.
En 2019, dans son livre : ‘The Spirit of hope’ (9), Jürgen Moltmann reprend le fil d’une pensée qui s’est développée pendant plusieurs décennies :
« Une approche historique montre qu’à partir du XVIe siècle, une volonté de puissance s’est imposée à partir d’une approche scientifique et d’une interprétation biblique. L’humanité est devenue « le centre du monde ». Seul l’être humain a été reconnu comme ayant été créé à l’image de Dieu et supposé soumettre la terre et toutes les autres créatures. Il devint ‘le Seigneur de la Terre’ et dans ce mouvement, il se réalise comme le maitre de lui-même… La vision de la nature a été la conséquence d’une représentation de Dieu… ‘Dieu a été pensé comme sans le monde, de la façon à ce que le monde étant sans Dieu puisse être dominé et que le monde puisse vivre sans Dieu’. Et le monde étant compris comme une machine, l’humain est menacé d’être considéré également comme une machine.
Mais, aujourd’hui, une compréhension écologique de la création est à l’œuvre. « Le Créateur est lié à la création non seulement intérieurement, mais extérieurement. La création est en Dieu et Dieu dans la création. Selon la doctrine chrétienne originelle, l’acte de création est trinitaire. Le monde est une réalité non divine, mais il est interpénétré par Dieu… » Ce qui ressort d’une vision trinitaire, c’est l’importance et le rôle de l’Esprit. « Dans la puissance de l’Esprit, Dieu est en toute chose et toute chose est en Dieu… » Au total, « l’Esprit divin est la puissance créatrice de la vie. Le Christ ressuscité est le Christ cosmique et le Christ cosmique est ‘le secret du monde’… » Aujourd’hui, « l’essentiel est de percevoir en toutes choses et dans la complexité et les interactions de la vie, les forces motrices de l’Esprit de Dieu et de ressentir dans nos cœurs l’aspiration de l’Esprit vers la vie éternelle du monde futur ».
Dans son livre : ‘la danse divine’, Richard Rohr en revenant aux sources du christianisme affirme une vision relationnelle de Dieu. « Dieu est celui que nous avons nommé Trinité, le flux (flow) qui passe à travers toute chose sans exception et qui fait cela depuis le début. Toute impulsion vitale, toute force orientée vers le futur, tout élan vers la beauté, tout ce qui tend vers la vérité… est éternellement un flux du Dieu trinitaire… Maintenant, nous voyons bien que Dieu n’est pas, n’a pas besoin d’être ‘une substance’ dans le sens d’Aristote et de quelque chose d’indépendant de tout le reste. En fait, Dieu est lui-même relation. Comme la Trinité, nous vivons intrinsèquement dans la relation. Nous appelons cela l’amour. Nous sommes faits pour l’amour. En dehors de cela, nous mourrons très rapidement… » Le mystère trinitaire peut être également entrevu dans le code de la création. « Ce qu’à la fois les physiciens et les contemplatifs affirment, c’est que le fondement de la réalité est relationnel. Chaque chose est en relation avec une autre ».
Dans un de ses livres ‘Ecospiritualité’, Michel Maxime Egger nous appelle à ‘réenchanter notre relation à la nature’. L’envergure de cette réflexion se marque à travers six grandes parties : Relier écologie, science et religion ; réenchanter la nature ; redécouvrir la sacralité de la terre ; être un pont entre la terre et le ciel ; transforme son cosmos intérieur ; devenir un méditant militant. « La prise de conscience écologique appelle une nouvelle conscience spirituelle, mais aussi un renouvellement des héritages religieux… » « Le préfixe ‘trans’ est un mot latin qui signifie par-delà. Il sied bien à l’écospiritualité. Celle-ci est transcendante, transreligieuse, transdisciplinaire, transmoderne… ».
L’auteur note également le rapport avec une évolution scientifique et nous retrouvons là la recherche de Patrice van Eersel. « L’écospiritualité se nourrit également des apports de la science postmoderne vulgarisés par des figures comme Frank Capra et Rupert Sheldrake. Ce vaste chantier a été ouvert par de nouvelles approches qui se sont développées au XXe siècle entre l’infiniment grand et l’infiniment petit » Michel Maxime Egger évoque lui aussi les voies du ‘panenthéisme’. « Le panenthéisme est une voie du tout en Dieu et de Dieu en tout. C’est l’approche de Jürgen Moltmann. C’est aussi la voie des théologiens orthodoxes, mais aussi de nombreux théologiens très divers de Teilhard de Chardin à Léonardo Boff… Le panenthéisme unit le divin et la nature sans les confondre… Au total, quel que soit la forme du panenthéisme, la nature est plus qu’une réalité matérielle obéissant à des lois physiques et chimiques. Elle est un mystère habité d’une conscience et d’une présence ».
Voici donc quelques pistes théologiques en regard de la réflexion de Patrice van Eersel sur la vision nouvelle du monde qu’il nous propose. Manifestement, la lecture de son livre est un point de départ indispensable pour une réflexion commune en vue de compréhension de la réalité telle qu’elle nous apparait aujourd’hui.
J H
- Patrice van Eersel. Le soleil est-il conscient ? Et les dauphins ? Et les baobabs ? Et le cristal ? Et l’IA ? Et vous même ? Elucider le mystère de la conscience. Guy Trédaniel, 2025
- Un horizon pour l’humanité : la noosphère. Selon Patrice van Eersel : https://vivreetesperer.com/un-horizon-pour-lhumanite-la-noosphere/
- Interview de Patrice van Eersel sur son livre au site : Métamorphoses : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=métamorphose+patrice+van+Eersel+you+tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:382bdaf7,vid:dbqjd70KuRI,st:0
- La participation des expériences spirituelles à la conscience écologique : https://vivreetesperer.com/la-participation-des-experiences-spirituelles-a-la-conscience-ecologique/
- Comment nos pensées influencent la réalité ? : https://vivreetesperer.com/comment-nos-pensees-influencent-la-realite/
- Une nouvelle science de la conscience : https://vivreetesperer.com/la-nouvelle-science-de-la-conscience/
- Une vision nouvelle des animaux : https://vivreetesperer.com/une-vision-nouvelle-des-animaux/
- Jane Goodhall. Une recherche pionnière sur les chimpanzés : https://vivreetesperer.com/jane-goodall-une-recherche-pionniere-sur-les-chimpanzes-une-ouverture-spirituelle-un-engagement-ecologique/
- Un avenir écologique pour la théologie moderne : https://vivreetesperer.com/un-avenir-ecologique-pour-la-theologie-moderne/
- La danse divine : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/
- Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
Voir aussi
Spiritualité et psychiatrie :
https://vivreetesperer.com/spiritualite-et-psychiatrie/
Lytta Basset. Une approche nouvelle de l’au-delà : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/
par jean | Avr 8, 2012 | ARTICLES, Vision et sens |
Dans son livre : « Sa présence dans ma vie », Odile Hassenforder aime se rappeler et nous rappeler que la vie n’est pas dépourvue de sens. Ainsi, le dernier chapitre du livre est intitulé : « Tout se tient. Unité et harmonie en Dieu ». Elle écrit : « Qui suis-je pour être « collaboratrice » du créateur ? (Psaume 8). Dieu continue à créer avec chacun de nous et avec moi. « Le Père céleste agit sans cesse », dit Jésus, et il m’invite à participer à la nouvelle création mise en route dans sa résurrection » (p. 209). Extrait de ses écrits personnels et jusqu’ici non publié, dans une forme suggestive, ce texte est court, mais accompagné par des versets bibliques auxquels elle nous renvoie, il nous invite à aller au delà de nos impressions immédiates. JH
Comprendre la sagesse de Dieu.
Dieu a construit sa création
selon des règles de vie.
A nous de les observer
Admirer … adorer le Créateur.
A nous de rentrer dans ses places
Et de collaborer
Car il nous donne la force : toutes qualités : don, vie…intelligence.
Tout le long de la Vie.
Les refus, les obstacles opposés par les hommes sont utilisés par Dieu. Car les hommes enfermés dans leurs erreurs sont l’occasion d’une ouverture pour d’autres.
Chercher le positif que Dieu tire des déviations, épreuves.
Car Il poursuit son œuvre.
Et donne sa grâce, son pardon à tous les hommes
toutes les nations
qui reconnaîtront
Le Dieu de l’Univers
Manifesté à chacun.
Odile Hassenforder
15.10.2006
Textes bibliques en regard
Esaïe 28.23-29
Ecoutez ma parole attentivement.
Quel laboureur laboure la terre en tout temps pour y semer ?..
C’est son Dieu qui l’instruit des règles à suivre
l’enseigne
Car on ne foule pas l’aneth à l’aide d’un rouleau…
Tout cela vient de l’Eternel le Seigneur (de l’Univers).
Son plan est merveilleux
Sa sagesse est immense.
Proverbe 22.19
Pour que tu mettes ta confiance en l’Eternel,
Je vais t’instruire.
Psaume 92
versets 5-7
Ce que tu fais, Seigneur, me remplit de joie
L’ouvrage de tes mains, j’acclamerai
Tes pensées sont grandioses
Tes pensées sont profondes.
L’insensé n’y connaît rien
Le sot ne peut les comprendre.
verset 9
Eternel, tu es souverain pour l’éternité…
Voici. Tes ennemis périssent.
Romains 11
verset 33
Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science
verset 28-32
Si on considère comment les juifs ont refusé l’Evangile,
Devenus ennemis de Dieu, c’est pour votre bien.
Si on considère le choix de Dieu, ils sont ceux que Dieu aime à cause de leurs ancêtres, car Dieu ne change pas d’idées.
Vous connaissez Dieu parce que les juifs ont désobéi.
Eux aussi connaissent son pardon.
Car Dieu a emprisonné les hommes dans leur désobéissance afin de faire grâce à tous…
Les écrits d’Odile Hassenforder sont une ressource à laquelle nous faisons appel dans ce blog : Voir : « La grâce d’exister » (septembre 2011), « Lorsque Dieu nous parle de bonheur » (octobre 2011), « Accueillir la vie » (décembre 2011), « Horizon de vie » (février 2012).