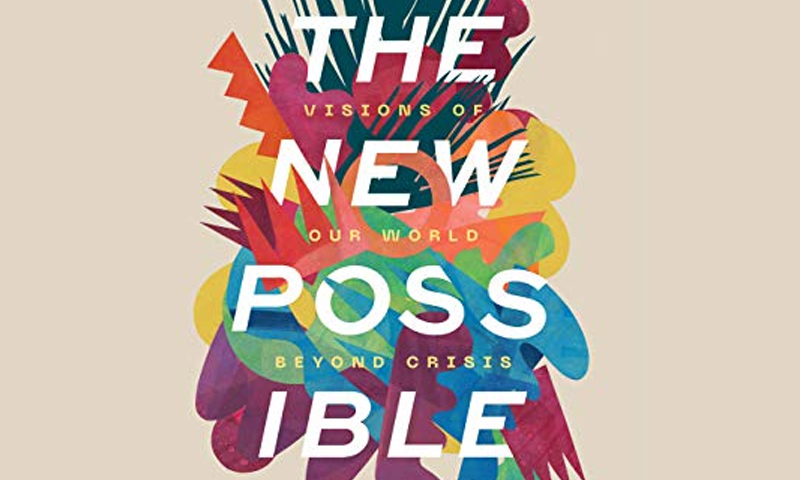Actu
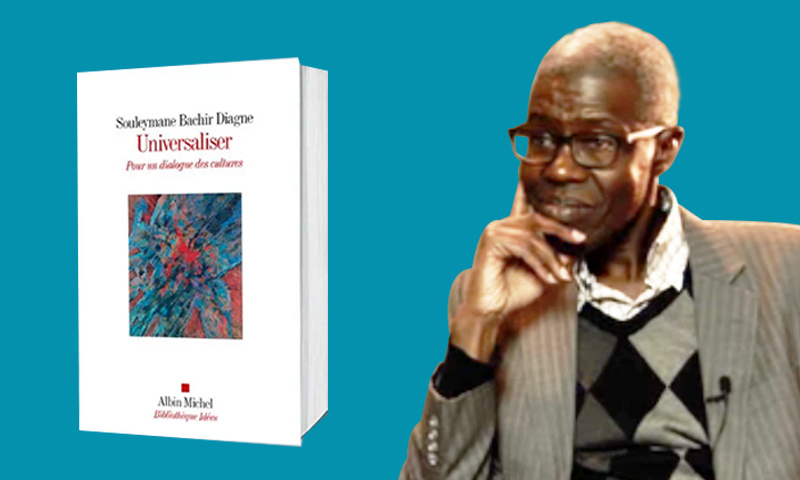
Universaliser
Pour une civilisation de l’universel Reconnaissons-nous l’humain dans son égale dignité quelque soient ses conditions d’existence ? Face aux dominations et aux enfermements, n’y a-t-il pas un mouvement qui œuvre pour la reconnaissance de ce commun qu’est notre...

Une plus grande présence de Dieu
Reconnaitre les expériences de révélation en dehors de l’Eglise Selon Robert K Johnston En ce début du XXIè siècle, la recherche a commencé à mettre en évidence des expériences puissantes d’émerveillement en reprenant, pour les qualifier le terme de « awe », jadis...
L’invention montessorienne
 Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants.
Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants.
« Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants » (1), c’est le livre de Christina de Stefano.
« C’est une biographie fascinante d’une pionnière du féminisme, des pédagogies nouvelles et des recherches sur le cerveau de l’enfant » (page de couverture).
Terre promise
 L’aventure et la mission de Barack Obama
L’aventure et la mission de Barack Obama
Barack Obama vient de publier le premier volume de ses mémoires : « Une Terre Promise » (1). La présentation qui en est donnée en page de couverture, mérite d’être rappelée ici : « Dans le premier volume de ses mémoires présidentielles, Barack Obama raconte l’histoire passionnante de son incroyable odyssée, celle d’un jeune homme en quête d’identité devenu dirigeant du monde libre, retraçant de manière personnelle son éducation politique et les moments emblématiques du premier mandat de sa présidence. Obama nous invite à le suivre dans son incroyable voyage et ses premiers pas sur la scène politique à sa victoire décisive aux primaires de l’Iowa qui démontre le pouvoir de l’engagement citoyen, et jusqu’à la soirée historique du 4 novembre 2008 lorsqu’il fut élu quarante quatrième président des Etats-Unis devenant ainsi le premier afro-américain à accéder à la fonction suprême. En revenant sur les grandes heures de sa présidence, Barack Obama nous offre un point de vue unique sur l’exercice du pouvoir présidentiel, son amplitude phénoménale, mais aussi ses limites, ainsi qu’un témoignage singulier sur les ressorts de la politique intérieure et de la diplomatie internationale ».
La première campagne présidentielle de Barack Obama a suscité des échos dans le monde entier. Il y avait là une promesse de transformation en profondeur de la société politique américaine dans un mouvement de justice sociale et de respect des groupes jusque là discriminés.
De l’esclavage à la lumière
Du Bénin à la région parisienne, une histoire de vie
 Philo a vécu enfant au Bénin jusqu’à l’âge de onze ans. Elle vivait avec ses parents, avec ses frères et sœurs. « Nous étions une famille très chrétienne, une famille très unie. Un papa maçon. Une maman très commerçante. Nous habitions à Porto Nove au Bénin. Je suis allée à l’école là bas. J’étais une élève très assidue. J’aimais l’école. J’aimais être avec mes ami(e)s à l’école. Après l’école, je jouais avec mes frères et sœurs. J’ai appris tôt à cuisiner et on lavait le linge à la main (Il n’y avait pas de machine à laver !). Pour les devoirs de l’école, je les faisais ensemble avec mes frères et sœurs. Je lisais aussi des livres, par exemple « Finagnon ».
Philo a vécu enfant au Bénin jusqu’à l’âge de onze ans. Elle vivait avec ses parents, avec ses frères et sœurs. « Nous étions une famille très chrétienne, une famille très unie. Un papa maçon. Une maman très commerçante. Nous habitions à Porto Nove au Bénin. Je suis allée à l’école là bas. J’étais une élève très assidue. J’aimais l’école. J’aimais être avec mes ami(e)s à l’école. Après l’école, je jouais avec mes frères et sœurs. J’ai appris tôt à cuisiner et on lavait le linge à la main (Il n’y avait pas de machine à laver !). Pour les devoirs de l’école, je les faisais ensemble avec mes frères et sœurs. Je lisais aussi des livres, par exemple « Finagnon ».
Emmenée en France comme domestique
Vivre de la présence divine
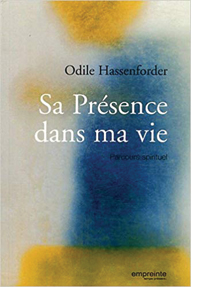
« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu » (Romains. 8/39).
La guérison est beaucoup plus que le rétablissement de la santé.
En moi, je ressens en profondeur cette certitude : que quoiqu’il m’arrive,
Dieu, en Jésus Christ, attesté par l’Esprit
Demeure en moi.
Sa présence est intégrée à ma personne. Je sais, je le vis.
Tout en moi est imprégné de divinité.
Tout ce qui est terrestre est une couche superficielle de mon être comme l’aspect visible de l’arbre, de la vigne.
La sève, invisible, circule dans toutes les ramifications, apporte la vie.
L’arbre qui est coupé, paraît mort. Mais, du tronc, racines, la sève fait resurgir des pousses. Un deuxième arbre apparaît.
D’où me viendra le secours ? Une expérience de libération
Un témoignage d’Odile Hassenforder
Depuis que Dieu est intervenu dans ma vie, tout a changé pour moi. Comme la samaritaine, j’ai déclaré autour de moi que Jésus était le Messie ; comme l’aveugle de Siloé, je me suis prosterné devant mon Dieu. Dire qui est Dieu pour moi aujourd’hui, ce qu’il était pour moi il y a dix, vingt ans, c’est dire quelle était ma relation à Lui. Je ne puis décrire Dieu. « Personne ne l’a jamais vu », dit l’apôtre Jean en commençant son évangile. « Qui me voit, voit le Père, dit Jésus à Philippe. Tous les contemporains de Jésus qui l’ont approché n’ont pas reconnu en lui le Fils de Dieu ; seuls ceux qui ont eu une véritable rencontre avec lui, ont reçu la lumière, ont saisi la vérité. J’imagine très bien l’émotion qu’ont du ressentir la samaritaine, l’aveugle et tant d’autres. Aujourd’hui un jeune dirait : « ça fait tilt », un amoureux dirait : « j’ai eu le coup de foudre ». Ces expressions sont bien pâles pour exprimer le choc d’une telle découverte.
L’amour des autres commence par l’amour de soi
Cette méditation publiée sur le site : Center for action and meditation (1), s’appuie sur la réflexion de la pasteure et docteure Jacqui Lewis (2) : « Peu importe ce que nous sommes et d’où nous venons, peu importe qui nous aimons et comment nous gagnons notre vie, l’appel à aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même, lorsqu’il est vécu, exprime l’interdépendance dont les humains ont besoin pour survivre et prospérer. Et le premier pas, le point de départ est l’amour de soi. Dans la langue grecque, les expressions : aimer son prochain et s’aimer soi-même sont reliées par le mot ‘os’ qui est comme un signe égal. Ce qui suggère que s’aimer et aimer son prochain, c’est exactement le même mouvement.
Le souci de l’autre et le soin au fondement de la vie humaine
Une approche anthropologique des questions sociales et politiques
En 1982, dans un livre pionnier : « In a different voice », Carol Gilligan a porté un nouveau regard sur la manière de formuler des jugements moraux, en écoutant autrui et en prenant en compte cette expérience. Cette attention à l’autre ouvre la voie à une sollicitude à son endroit. A partir de ce changement de regard, un mouvement nouveau va apparaître et se développer rapidement : le mouvement du « care », du « prendre soin ».

La traversée
Un contre récit positif pour traverser le chaos Nous avons conscience de la grave menace du dérèglement climatique. Mais s’y ajoute une crise économique et sociale : la montée des inégalités. Et l’angoisse ambiante contribue à une augmentation de l’agressivité. Dans...
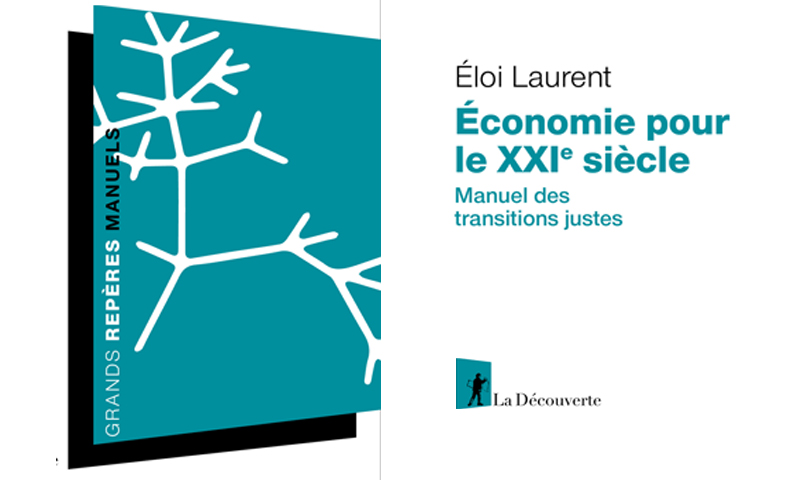
Face à la crise écologique, réaliser des transitions justes
Une nouvelle pensée économique selon Eloi Laurent Pour réaliser les transformations économiques requises urgemment par la crise écologique, nous avons besoin de considérer l’économie sous un jour nouveau. C’est pourquoi Eloi Laurent nous propose un livre...
Des Lumières à l’âge du vivant
 Réparons le monde. Humains, animaux, nature
Réparons le monde. Humains, animaux, nature
Selon Corine Pelluchon
A une époque où nous sommes confrontés à la mémoire des abimes récents de notre civilisation et aux menaces dévastatrices qui se multiplient, nous nous posons des questions fondamentales : comment en sommes-nous arrivés là ? Comment sortir de cette dangereuse situation ? Ainsi, de toute part, des chercheurs œuvrant dans des champs très divers de la philosophie à la théologie, de l’histoire, de la sociologie à l’économie et aux sciences politiques tentent de répondre à ces questions. Nous avons rapporté quelques unes de ces approches (1).
Parmi les voix qui méritent d’être tout particulièrement entendues, il y a celle de la philosophe Corine Pelluchon. Son dernier livre, tout récent, « L’espérance où la traversée de l’impossible » (janvier 2023), nous fait entrer dans une perspective d’espérance. C’est une occasion pour découvrir ou redécouvrir une œuvre qui s’est développée par étapes successives, dans une intention persévérante et qui débouche sur une synthèse cohérente et une vision dynamique.
Face à une accélération et à une chosification de la société
 Y remédier à travers une résonance : Le projet d’Hartmut Rosa
Y remédier à travers une résonance : Le projet d’Hartmut Rosa
Notre inquiétude vis-à-vis de l’évolution actuelle de la société ne tient pas uniquement à une analyse. Elle se fonde sur un ressenti à partir d’indices précis. Et parmi ces indices, il y a l’impression que tout va de plus en plus vite, en consommant le temps disponible. Nous vivons sous la pression d’une accélération. Comme l’écrit le sociologue Hartmut Rosa : « Nous vivons à une époque qui exige de notre part que nous nous adaptions rapidement à de nouvelles techniques et à de nouvelles pratiques sociales. Nous faisons l’expérience qu’avoir du temps est devenu une chose rare. C’est la raison pour laquelle nous inventons des technologies de plus en plus rapides pour nous permettre de gagner du temps. Mais ce que nous avons à apprendre aujourd’hui, c’est que ce projet ne fonctionne pas » (p 20).
Reconnaître aujourd’hui un mouvement émergent pour la justice dans une inspiration de long cours
 Et si nous envisagions les paroles qui nous sont confiées par le message biblique comme des semences en train de grandir…
Et si nous envisagions les paroles qui nous sont confiées par le message biblique comme des semences en train de grandir…
Nous trouvons sur le site du « Center for action and contemplation » animé par Richard Rohr, une séquence hebdomadaire intitulée : « Movements of justice and the Spirit » (13-19 novembre 2022) (1).
Un mouvement à la rencontre des rejetés
Au départ, une première méditation rappelle que « Jésus a vécu parmi les rejetés. Il a exercé son ministère parmi les rejetés. Il est mort et a été crucifié comme rejeté, comme quelqu’un qui était en dehors de la structure du pouvoir politique. Mais, en sortant de la tombe à l’aube d’un dimanche, il entrepris un mouvement de résurrection – un réveil d’amour, un réveil de justice, un réveil de miséricorde, un réveil de grâce » (2).
Contempler la création
Louez l’Eternel du bas de la terre, Monstres marins et vous tous abimes :
Feu et grêle, neiges et brouillards ;
Vents impétueux qui exécutez ses ordres ;
Montagnes et toutes les collines ;
Arbres fruitiers et tous les cèdres ;
Animaux et tout le bétail ;
Reptiles et oiseaux ailés ;
Qu’ils louent le nom de l’Eternel
Car son nom seul est élevé ;
Sa majesté est au dessus de la terre et des cieux
Psaume 148 7-10,13
Dans cette séquence (1), frère Richard Rohr partage sur la manière de « voir » et de percevoir Dieu dans les formes de la nature sur la base d’une spiritualité incarnée.
10 octobre 2021
Contempler la création
La spiritualité de la création a ses origines dans les Écrits hébraïques tels que les psaumes 104 et 148. C’est une spiritualité qui est enracinée, en premier, dans la nature, dans l’expérience, et dans le monde tel qu’il est. La riche spiritualité hébraïque a formé l’esprit et le cœur de Jésus ».
Richard Rohr fait remarquer alors combien nous sommes habitués à penser la religion en terme d’idées, de concepts et de formules trouvés dans des livres. « Ce n’est pas là où la religion commence. Ce n’est pas la spiritualité biblique. Celle-ci commence en observant ce qui est ».
La grande connexion
 Vivre au ciel maintenant
Vivre au ciel maintenant
Selon Richard Rohr
Les représentations du Ciel qui nous sont traditionnellement proposées nous renvoient au lointain et au futur, et son accès au conditionnel. Cependant, ce paysage est en voie d’évolution.
Dans une séquence sur « la communion des saints », Richard Rohr nous ouvre une vision évangélique en se fondant sur les paroles de Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples. Ici des interrelations s’affirment. Des barrières tombent : « Jésus leur dit toutes ces choses, et levant les yeux au ciel, il dit « Père, je ne demande pas pour ceux là seulement, mais aussi pour ceux qui croient en moi à travers leur parole : qu’ils puissent tous être un, de même que toi Père, tu es en moi et moi en toi, qu’ils puissent aussi être en nous de manière à ce que le monde puisse croire que tu m’as envoyé » (Jean 17. 1, 20-23).
« On peut voir dans cette prière le plus haut niveau de l’enseignement mystique du Nouveau Testament », écrit Richard Rohr. « Ici Jésus se connecte à tout. Il est dans le Père, le Père en vous, vous en Dieu, Dieu en lui, Dieu dans le monde et vous dans le monde. Tout cela est un ».
Comme la beauté nous accompagne en hiver
Ici, en partage, quelques photos des sites Flickr que nous fréquentons et qui nous apportent des moments d’émerveillement.
Au lever du jour
Au lever du jour, de l’aube à l’aurore, au petit matin, un commencement, ou plutôt un recommencement se manifeste. En contraste avec l’obscurité de la nuit, la lumière apparaît. La vie reprend. En ces moments, bien souvent, la beauté du ciel appelle l’émerveillement. Alors ce premier épisode de la journée revêt une forte signification. Il est perçu en termes symboliques comme l’annonce d’un jour nouveau. La force de la Vie s ‘y exprime. Ainsi y monte également un désir profond. On trouve dans les Psaumes un appel à la prière matinale. « Je veux te chanter et te célébrer de tout mon cœur. Levez-vous mon luth et ma harpe. Je me lèverai dès l’aurore » (Psaume 208.3). Emerveillement…. Pour évoquer le lever du jour, nous présentons ici des photos issues des sites flickr que nous fréquentons
Vers une civilisation écologique
Selon Jeremy Lent
En 2020, l’effroi suscité par l’épidémie de Covid s’est allié aux appréhensions engendrées par d’autres menaces comme le dérèglement climatique. Aujourd’hui, une guerre vient s’ajouter au malheur du temps. Cependant, cette tourmente interpelle. Elle invite les chercheurs et les militants à imaginer et à promouvoir un monde nouveau.
C’est ainsi qu’en 2021, un recueil d’essais est paru aux États-Unis sous le titre : « The new possible » (« Le nouveau possible ») (1). Le sous-titre en précise le contenu : « Visions de notre monde au-delà de la crise ».
Comment nous reconnecter au vivant, à la nature
 L’enquête sauvage, de Anne-Sophie Novel
L’enquête sauvage, de Anne-Sophie Novel
Nous savons que l’humanité est menacée par l’oppression qu’elle exerce sur la nature et par les conséquences qui en résultent : le dérèglement climatique et le recul de la biodiversité. Nous en sommes troublés, inquiets, angoissés. Mais, dans notre société urbaine, n’avons-nous pas perdu également notre connection avec le vivant, avec la nature ? De la symbiose avec la nature qui s’établit, de fait, dans les sociétés rurales d’autrefois, ne sommes-nous pas aujourd’hui devenus prisonniers d’une vie qui tourne sur elle-même sans plus ce contact réel avec le vivant sauvage, c’est-à-dire ce qui ne nous est pas soumis. C’est ainsi qu’un livre d’Anne-Sophie Novel vient nous surprendre : « L’enquête sauvage » (1). Si nous apprenions à nous retrouver avec le vivant, avec la nature, nos engagements écologiques seraient d’autant plus profonds qu’ils seraient l’expression de toute notre personnalité, à la fois de la tête et du cœur. Anne-Sophie Novel nous propose un voyage pour nous plonger dans la nature sauvage en apprenant à écouter, à observer, à ressentir, à s’ensauvager. A partir de là, c’est un nouveau genre de vie qui émerge, un terreau fertile pour l’engagement écologique.
A plusieurs reprises sur ce blog, nous avons rencontré Anne-Sophie Novel, militante écologiste et pionnière d’une économie collaborative. Nous avons rapporté son livre visionnaire : « Vive la co-révolution. Pour une société collaborative » (2). Journaliste indépendante, spécialisée dans les questions d’environnement et d’écologie, Anne-Sophie Novel, anime un blog : « Même pas mal » (3), et collabore à plusieurs organes de presse.
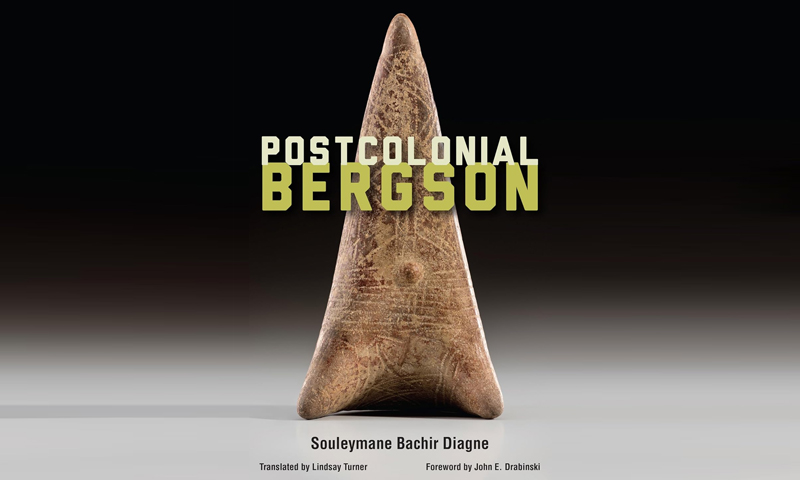
Une nouvelle vision du monde
L’inspiration de Bergson chez deux personnalités d’un nouveau monde : Léopold Sédar Senghor et Mohamed Iqbal selon le philosophe sénégalais, Souleymane Bachir Diagne. Si, au travers de deux œuvres marquantes, ‘L’évolution créatrice’ et ‘Les deux sources de la morale...

Comment l’admiration et l’émerveillement exprimées par le terme ‘awe’ induisent la culture et façonnent la manière dont nous pensons
«Wonderstruck » par Helen De Cruz Si le ressenti d’admiration et d’émerveillement exprimé par le terme anglais ‘awe’ est une réalité immémoriale, la recherche construite à son sujet est toute récente. Elle apparait au début du XXIe siècle et elle est relatée dans...
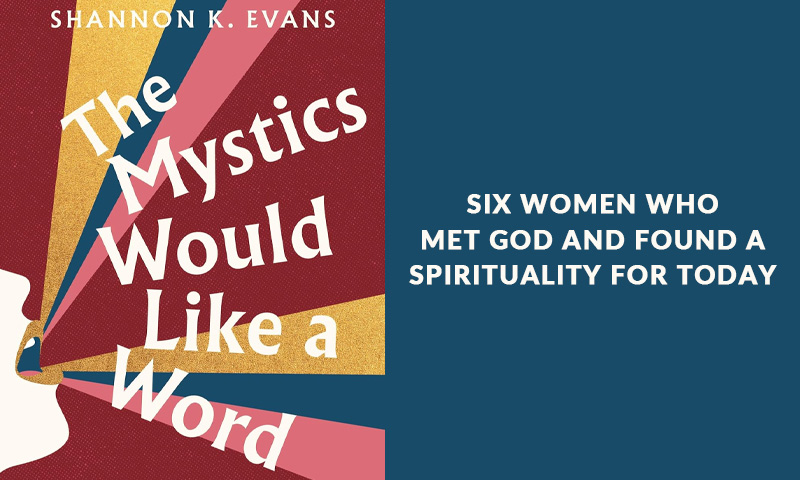
Comment une chrétienne féministe en vient à chercher une inspiration en Thérèse d’Avila
L’apport de femmes mystiques à la spiritualité contemporaine Selon Shannon K Evans Aujourd’hui, aux Etats-Unis, une partie du christianisme vit sous l’emprise d’une hiérarchie conservatrice qui maintient un esprit de domination qui s’exerce, entre autres, vis-à-vis...