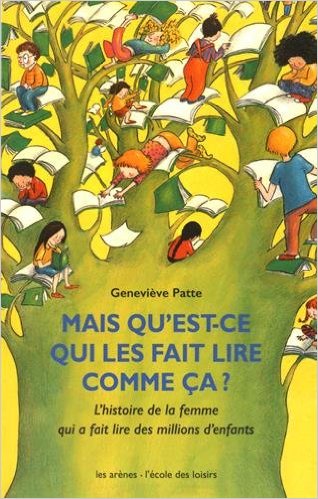par jean | Déc 27, 2014 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Hstoires et projets de vie |
Comment je suis devenue « maman » de soixante orphelins à Brazzaville
Sœur Marie-Thérèse nous raconte comment son amour des enfants l’a conduite à tout quitter pour recueillir des orphelins et enfants des rues à Brazzaville. Au sein de la maison Notre Dame de Nazareth, tous se voient offrir une chance de vivre dans une famille d’adoption régie par l’amour. Sœur Marie-Thérèse nous présente cette grande aventure dans un « talk » diffusée par TEDx Paris (1) : « Comment je suis devenue « maman » de 60 orphelins de Brazzaville ».
En effectuant une visite quotidienne en prison, Sœur Marie-Thérèse a rencontré un petit garçon de trois ans, Albert, qui y vivait avec sa maman incarcérée. Bouleversée par cet enfant, elle l’a accueilli et gardé jusqu’à la libération de sa mère. A partir de là, Marie-Thérèse nous rapporte combien elle a été poussée par une forte motivation : « Cette étincelle est devenue en moi un feu dévorant. Ce feu pousse à prendre des décisions déroutantes, voire scandaleuses pour l’entourage, une folie pour les sages. Ce feu est impérieux. Il bannit la peur… Le 5 septembre 1998, pour être plus disponible aux enfants en détresse, j’ai tout quitté. Je suis partie de ma congrégation avec une vingtaine d’enfants. Je n’avais ni maison, ni argent, ni santé. Ma seule richesse était ma confiance en Dieu ».
C’est une grande aventure qui commence : « Les enfants et moi, étions au même niveau. Nous sommes toujours au même niveau. Je n’ai pas la fierté, la satisfaction et l’orgueil de celui qui donne. Nous vivons de dons. Ce n’est pas toujours facile, mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour donner de la joie aux enfants ! Aujourd’hui, ils sont une soixantaine, filles et garçons. Ils m’appellent maman ».
Cette communauté est organisée dans un esprit d’entraide et de soutien mutuel. « Le travail est le pilier de la maison et notre prière quotidienne en est le ciment ». Il y a quatre groupe de travail qui ont pour tâche : le ménage, la cuisine, la vaisselle, le soin porté aux enfants (toilette et sécurité). « A la tête de chaque groupe, il y a un aîné qui supervise le travail et me donne un compte-rendu. Tous les groupes se permutent chaque semaine de telle sorte que les responsabilités soient partagées en tenant compte des capacités de chacun. Ainsi, personne n’est laissé au bord du chemin. Chacun a sa place et se sent valorisé ».
Cette grande famille est fondée sur la confiance mutuelle : « Il n’y a pas de famille s’il n’y a pas de confiance mutuelle les uns envers les autres. Pour cela, il faut que le dialogue ait une place de choix. Dans le dialogue, la confiance prend racine. La confiance que je leur fais, peut leur permettre d’avoir confiance en eux. Je pense ainsi travailler à l’autonomie. L’entraide est une vertu cardinale de la maison. Les plus grands aident les plus petits. Ils les consolent quand ils ont des chagrins. Les bien portants aident les malades ».
Cette famille est une aventure fondée sur l’amour. « Comme toutes les familles, la nôtre n’est pas parfaite. Il y a beaucoup de problèmes et de soucis. Notre famille est fragile, mais elle est fantastique. Elle est soudée et les aînés donnent le meilleur d’eux-mêmes dans l’adversité, dans la joie comme dans le malheur. Notre famille avance. Elle espère. Elle croit en la vie. Elle remercie. Elle dit toute sa reconnaissance à ceux qui l’aide.
Ce que j’apprend aux enfants lors de leur passage dans la famille est de bien faire ce qu’ils ont à faire et ce, jusqu’au bout, coûte que coûte.
L’amour est le socle de tout sans lequel toute entreprise est vide et stérile ».
J H
(1) « Comment je suis devenue « maman » de soixante orphelins de Brazzaville » : un talk en vidéo sur le site de TED x Paris : http://www.tedxparis.com/comment-je-suis-devenue-maman-de-60-orphelins-de-brazzaville/
Sur ce blog, voir aussi : « De la décharge publique à la musique » : https://vivreetesperer.com/?p=1603
« Sur le chemin de l’école » : https://vivreetesperer.com/?p=1556
Plus généralement, sur la question de l’éducation :
« Et si nous éduquions nos enfants à la joie ? » : https://vivreetesperer.com/?p=1872
par jean | Avr 6, 2014 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
#
Du bon grain et de l’ivraie.
#
#
Quel est notre regard sur nous-même tel qu’il est influencé par notre parcours psychologique et notre héritage religieux (1) ? Comment recevons nous la parabole du bon grain et de l’ivraie rapportée par l’évangile de Matthieu ? Le commentaire de Michèle Jeunet, Sœur Michèle au Cénacle de Versailles (2) nous invite à choisir la bonté : « bonté du grain, bonté de la terre, bonté du monde, bonté de l’homme qui sème, bonté de Dieu ».
« Nous sommes dans le fondamental de la création. « Dieu vit que cela était bon » (Genèse 1). Et nous sommes dans le fondamental d’une création en histoire. Non pas un monde tout fait, statique, immobile. Ce qui est semé est pour une croissance, une création continuée… Croire en ce qui est bon en nous, croire que ce qui a été semé par Dieu en nous est bon et le développer au maximum, en y mettant toute notre énergie, notre créativité. « C’est le développement de la bonté en nous, un « habitus » de bonté qui fera se dessécher l’ivraie ».
#
J H
#
Évangile de Matthieu au chapitre 13 verset 24 à 30
Il en va du Royaume des Cieux comme d’un homme qui a semé du bon grain dans son champ.
Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l’ivraie, au beau milieu du blé, et il s’en est allé.
Quand le blé est monté en herbe, puis en épis, alors l’ivraie est apparue aussi.
S’approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent :
« Maître, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il s’y trouve de l’ivraie ? »
Il leur dit :
« C’est quelque ennemi qui a fait cela ».
Les serviteurs lui disent :
« Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?
Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l’ivraie, d’arracher en même temps le blé.
Laissez l’un et l’autre croître ensemble jusqu’à la moisson ; et au moment de la moisson je dirai aux moissonneurs : Ramassez d’abord l’ivraie et liez-la en bottes que l’on fera brûler ; quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. »
#
Développer la bonté en nous
#
« Il est des titres qui sont trompeurs. Est-ce vraiment la parabole de l’ivraie ?
#
Cette parabole est d’abord en continuité de celle du semeur. Le semeur a semé du bon grain dans un terrain qui est bon. S’il sème ce qui est bon, c’est que lui-même est bon. Une sainte, Thérèse Couderc, disait de lui : « il est bon, il est plus que bon, il est la bonté ». Bonté du grain, bonté de la terre, bonté du monde, bonté de l’homme qui sème, bonté de Dieu. Nous sommes dans le fondamental de la création : « Dieu vit que cela était bon » Gn 1. Et nous sommes dans le fondamental d’une création en histoire. Non pas un monde créé tout fait, statique, immobile. Ce qui est semé est pour une croissance, une création continuée : grain puis épi, puis blé. Entre semailles et moisson, il y a le temps de l’histoire, le temps de la liberté de veiller à la croissance de ce qui est bon. Responsabilité qui est nôtre. Etre veilleur pour que la vie semée par Dieu vienne à maturité. Ce n’est pas du tout fait de toute éternité, immobile mais c’est une semence riche d’avenir, un don à faire qui périrait s’il ne peut s’épanouir grâce à la bonne terre de nos vies, de nos réponses humaines, don et accueil qui vont ensemble porter à maturité la nouveauté de l’épi.
#
Ce titre trompeur est en cohérence avec la réaction des serviteurs qui se focalisent sur l’ivraie, leur question sur son origine et surtout leur doute : « N’est-ce pas du bon grain que tu as semé ? ». Leur doute qui frise le soupçon. Mais leur question n’est-elle pas la nôtre ? Leur doute et leur soupçon ne sont-ils pas les nôtres ? Cette question du mal qui nous taraude tous, qui est souvent un obstacle à la foi. La réponse du propriétaire est la même que celle de la Genèse. C’est un ennemi qui a semé de l’ivraie. La Genèse parle d’un serpent qui insinue le doute sur le don qui est fait, qui insinue le doute sur la bonté du donateur.
Que faut-il donc faire ? Arracher au risque de détruire la bonté des épis de blé ? Ce serait faire le jeu de l’ennemi.
#
Le propriétaire fait une autre option. Celle de la confiance dans le blé semé et dans la terre qui participe à la nouveauté de l’épi. Confiance dans l’épi assez fort pour ne pas se laisser étouffer par l’ivraie. Dans nos vies, il y a du bon grain et de l’ivraie. N’est-ce pas une erreur de se focaliser sur l’ivraie ? L’homme de cette parabole nous conseille un autre chemin. Croire en ce qui est bon en nous, croire que ce qui a été semé en nous par Dieu est bon et le développer au maximum, en y mettant toute notre énergie, notre créativité. C’est le développement de la bonté en nous, un « habitus » de bonté qui fera se dessécher l’ivraie. Et non un arrachage volontariste qui risque de dessécher la vie en nous.
#
Michèle Jeunet
#
(1) Nos représentations sont influencées encore aujourd’hui par notre héritage religieux qui, pour une part, laisse des traces de peur par rapport à Dieu et de condamnation par rapport aux hommes. C’est le contraire de la bonne nouvelle de l’Evangile. Dans un livre récent : « Oser la bienveillance » (Albin Michel, 2014), la théologienne Lytta Basset met en évidence les effets négatifs de la conception du péché originel. Elle décrit « la généalogie et l’impact de cette notion profondément nocive qui remonte à Saint Augustin et qui contredit les premiers Pères de l’Eglise. Elle montre comment ce pessimisme radical est totalement étranger à l’Evangile. Tout au contraire, les gestes et paroles de Jésus nous appelle à développer un autre regard sur l’être humain, fondé sur la certitude que nous sommes bénis dès le départ et le resterons toujours. Appuyé sur le socle de cette Bienveillance originelle, chacun de nous peut oser la bienveillance, envers lui-même et envers autrui et passer ainsi de la culpabilité à la responsabilité » (texte en couverture). On pourra lire aussi sur ce blog une mise en perspective d’un livre de Jacques Lecomte : La bonté humaine, altruisme, empathie, générosité. Odile Jacob, 2012 https://vivreetesperer.com/?p=674
(2) Homélie de Sœur Michèle : le bon grain et l’ivraie (9 décembre 2013). Sur le blog : aubonheurdedieu-soeurmichele : http://aubonheurdedieu-soeurmichele.over-blog.com/article-homelie-de-soeur-michele-le-bon-grain-et-l-ivraie-mt-13-24-30-121518838.html
#
Voir aussi sur ce blog : « geste d’amour » (Odile Hassenforder) : https://vivreetesperer.com/?p=1204
Dans le livre d’Odile Hassenforder : « Sa présence dans ma vie », on pourra lire un chapitre : La bonté de Dieu (p 87-91)
#
Sur ce blog, deux autres contributions de Michèle Jeunet :
Quelle est notre image de Dieu ? https://vivreetesperer.com/?p=1509
Se sentir aimé de Dieu https://vivreetesperer.com/?p=1752
#
De bonnes ressources dans le recueil de textes rassemblés par Michèle Jeunet dans un livre récemment paru : Michèle Jeunet. Méditer une Parole de liberté. Catéchèses bibliques et lectio divina. Editions Croix du Salut, 2013. « Il s’agit pour moi d’aider les gens à ouvrir la Bible pour qu’elle soit vraiment un lieu de méditation qui éclaire leur vie et leur fasse découvrir un Dieu Ami de leur vie, présent au cœur de leur existence ».
par jean | Juil 20, 2019 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |
Vers un nouveau paysage industriel, économique, social

Peter est ingénieur dans une entreprise de haute technologie.
« En recherche d’un nouveau champ d’activité pour son entreprise, il a été amené à travailler sur une innovation en rupture : l’imprimante 3D ». En répondant à nos questions, il nous ouvre un horizon : l’apparition d’un nouveau paysage industriel, économique et social.
Emergence d’un nouveau mode de production
« L’imprimante 3D n’est pas une nouveauté. Elle existe depuis plus de 30 ans. La vraie nouveauté, c’est de l’utiliser dans une phase industrielle. C’est de faire de la « mass production » . Il y a trente ans, on s’en servait pour faire des prototypes, par exemple des concepts de voiture, de moteur. On s’en servait aussi pour faire de la recherche afin de bien comprendre et d’améliorer le fonctionnement et le potentiel de cette imprimante à des fins de réaliser des produits de qualité. Aujourd’hui, on entre dans la phase d’industrialisation pour faire des pièces de qualité qui soient équivalentes à la production classique.
Qu’est-ce que l’imprimante 3D ? Dans la fabrication traditionnelle, on part d’un bloc de matière. On retire de la matière pour réaliser une pièce . Dans l’imprimante 3D, on part de rien. On part d’une poudre et, pour réaliser une pièce, on va agglomérer cette poudre, couche après couche. On peut avoir différents types de matière initiale : polymère, métal, céramique, bois, béton. Ce qui domine, ce sont les polymères et le métal. Aujourd’hui, l’imprimante 3D est utilisée dans trois domaines principaux : l’aérospatial, le médical, la défense.
Vers une économie décentralisée et écologique
Les conséquence sont significatives parce qu’on va développer l’économie locale. L’imprimante 3D permet d’éviter les transports. On envoie le modèle 3D par internet dans les lieux de fabrication. On y dispose de la matière. La production s’effectue dans des micro-usines à partir de quelques imprimantes 3D. Les produits sont fabriqués localement. On n’a plus besoin d’importer des produits de pays lointains. La production pourra à nouveau se développer dans des pays, dits développés, en Europe, en Amérique, et aussi dans des pays pauvres, jusqu’ici peu industrialisés. Cependant, il y a besoin de compétence. Il n’y a plus de dépendance par rapport à des lieux jusque là privilégiés. On pourra de plus en plus travailler en dehors des métropoles et des zones industrielles et réindustrialiser des régions aujourd’hui dépourvues.
Cette transformation va permettre également une personnalisation des produits, une adaptation aux clients. De même, les produits pourront être réparés. Les pièces pourront être changées. L’imprimante 3D favorise le remplacement des pièces. C’est une entrée dans le mouvement de l’économie circulaire qui est une des composantes de l’économie écologique. Moins de transport, moins de consommation d’énergie, tout cela va dans le sens de la transition écologique.
L’imprimante 3D : un développement rapide
Aujourd’hui, l’imprimante 3D est très développée aux Etats-Unis. Initialement, ce fut une innovation française, mais elle a été reprise et développée aux Etats-Unis à partir des années 1990. Elle est également très développée en Asie : Japon, Corée, Chine. Et maintenant, elle se développe en Europe. En France, nous sommes encore très en retard : 3% du marché contre 6% en Angleterre, 9% en Allemagne… et 40% aux Etats-Unis. Nous avons besoin d’une aide de l’Etat pour une démocratisation de l’imprimante 3D. Il y a besoin d’un immense effort d’information, de formation et de conseil. Pour une approche prospective, on peut déjà envisager l’imprimante 4D qui permet de donner mouvement aux objets. Entre autres, l’imprimante 4D permettra de reconstituer les tissus humains de grands brulés.
Dans la transformation en cours, il y a encore en France un temps d’inertie. Mais on peut envisager que la France entre pleinement dans ce processus d’ici cinq ans.
L’imprimante 3D, ce n’est pas seulement une innovation technologique, c’est également un changement de société ».
Interview de Peter recueillie par J H
Sur ce blog, on pourra lire aussi :
« La troisième révolution industrielle » (Jérémie Rifkin) : https://vivreetesperer.com/face-a-la-crise-un-avenir-pour-l’economie/
« Un monde en changement accéléré » (Thomas Friedman) : https://vivreetesperer.com/un-monde-en-changement-accelere/
« Pourquoi et comment innover face au changement accéléré du monde » (Thomas Friedman) : https://vivreetesperer.com/pourquoi-et-comment-innover-face-au-changement-accelere-du-monde/
« Comprendre la mutation actuelle de notre société requiert une vision nouvelle du monde » (Jean Staune)
https://vivreetesperer.com/comprendre-la-mutation-actuelle-de-notre-societe-requiert-une-vision-nouvelle-du-monde/
« Vers une économie symbiotique » (Isabelle Delannoy)
https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
par jean | Mar 8, 2023 | Société et culture en mouvement |
 Y remédier à travers une résonance : Le projet d’Hartmut Rosa
Y remédier à travers une résonance : Le projet d’Hartmut Rosa
Notre inquiétude vis-à-vis de l’évolution actuelle de la société ne tient pas uniquement à une analyse. Elle se fonde sur un ressenti à partir d’indices précis. Et parmi ces indices, il y a l’impression que tout va de plus en plus vite, en consommant le temps disponible. Nous vivons sous la pression d’une accélération. Comme l’écrit le sociologue Hartmut Rosa : « Nous vivons à une époque qui exige de notre part que nous nous adaptions rapidement à de nouvelles techniques et à de nouvelles pratiques sociales. Nous faisons l’expérience qu’avoir du temps est devenu une chose rare. C’est la raison pour laquelle nous inventons des technologies de plus en plus rapides pour nous permettre de gagner du temps. Mais ce que nous avons à apprendre aujourd’hui, c’est que ce projet ne fonctionne pas » (p 20).
Et comme le rappelle le chercheur qui vient l’interviewer, Nathanaël Wallenhorst, nous sommes en présence d’un phénomène puissant : « La période contemporaine est marquée par une triple accélération : l’accélération technique, l’accélération du changement, social et l’accélération du rythme de vie ; Il faut y ajouter la Grande Accélération que constitue l’entrée dans l’Anthropocène » (p 43).
A partir des années 1950, une consommation exponentielle, doublée d’une augmentation de la population humaine, emportent l’ensemble du système Terre dans une course folle et pour un horizon impropre à la vie humaine en société » (p 8).
Que faire ? Bien sûr, cette accélération est « inhérente au capitalisme rentier et spéculatif qui gangrène nos sociétés ». Mais ce système s’inscrit dans une culture qui nous influence de bout en bout.
Bienvenue est la démarche de Harmut Rosa qui « se risque à dessiner les contours d’un remédiation dans le terme d’une « Résonance » (p73). La résonance est à l’œuvre lorsqu’il y a une vraie rencontre « entre le sujet et le monde ». « A une époque où chacun est seul dans la constitution de ses réseaux et dans leur fructification et où l’individu apparaît toujours comme le centre de gravité de l’autonomie » (p 33), c’est mettre l’accent sur la relation. « La forme réussie de l’interaction résonante, c’est lorsque nous sommes prêts à écouter la voix de l’autre et à rendre la nôtre plus perceptible pour que cette résonance soit horizontale » (p 34). Harmut Rosa présente ainsi sa vision : « Un monde meilleur est possible. Une transition devrait avoir lieu entre cette relation au monde qui vise le pouvoir de disposer des choses et de les mettre sous contrôle et une attitude au monde dont la caractéristique principale est l’écoute. Nous devons apprendre à écouter le monde, à le percevoir nouvellement et à lui répondre. C’est tout autre chose que d’en disposer » (p 53).
Ce livre, dans lequel Hartmut Rosa répond aux questions de Nathanaël Wallenhorst est intitulé : « Accélérons la résonance. Pour une éducation en Anthropocène » (1). Cet entretien nous ouvre l’accès à l’œuvre d’Harmut Rosa, un sociologue et philosophe allemand de renommée internationale. « Dans ses deux précédents ouvrages, « Accélération », puis « Aliénation et accélération », il avait su mettre à jour combien nos sociétés ne parviennent à se stabiliser que de façon dynamique. Elles ont besoin de croissance, en somme, alors même que celle-ci est la principale aliénation du temps présent. Dans « Résonance », Rosa se risquait à dessiner les contours d’une remédiation à cette accélération hégémonique et réifiante… ». Ce livret nous parait essentiel, car les lecteurs y trouveront un écho à leur ressenti et une réponse à des questions fondamentales pour l’avenir du monde.
Une vie confrontée à l’accélération
Harmut Rosa nous montre en quoi et pourquoi les êtres humains sont amenés à participer à une accélération grandissante. « Qu’est-ce qu’une vie bonne ? Nous ne savons pas répondre à cette question » (p 16). En attendant, dans un sentiment d’insécurité, nous cherchons à accumuler des biens pour garantir l’avenir. « Comme nous ne savons pas très bien ce qu’est une vie bonne, nous nous disons que nous allons voir si nous y parvenons, mais avant il est important que nous ayons acquis un certain nombre de biens… Ainsi, il serait d’abord important d’obtenir un capital économique. Mais il faudrait également construire un capital culturel. Je dois avant tout disposer d’un certain nombre de savoirs et de savoir-faire nécessitant d’être réactualisés en permanence… Mais j’ai également absolument besoin d’un capital social : je dois avoir des relations, des connexions et des réseaux… Enfin, le plus important, c’est le capital physique… Nous sommes continuellement affairés à améliorer notre base de ressources : assurer nos revenus, entretenir nos connaissances, entretenir nos relations, soigner notre corps » (p 17-18). La société elle-même se développe d’une manière où tout s’accélère. « Notre société ne se stabilise pas, elle doit accélérer toujours plus pour continuer à exister et elle exige en permanence des nouvelles formes de connaissance… » Ainsi envisage-t-on un apprentissage tout au long de la vie. Au total, « nous faisons l’expérience qu’avoir du temps est devenu une chose rare. C’est la raison pour laquelle nous inventons des technologies de plus en plus rapides qui nous permettent de gagner du temps. Mais ce que nous avons à apprendre désormais, c’est que ce projet ne fonctionne pas » (p 20).
Accélération ou décélération
Face à une accélération dommageable, comment réagir ? Peut-on accélérer en mieux ? Peut-on décélérer ?
Harmut Rosa évoque l’idéologie du « slow » : « manger lentement, penser lentement, vivre lentement » et il en fait la critique. « La lenteur n’est pas une vertu en soi. Elle n’est pas souhaitable », mais peut-être cette idéologie traduit-elle le souhait d’une relation différente avec le monde.
Cependant Harmut Rosa critique l’idéologie de l’accélération. « Cette affirmation accélérationniste comporte au moins deux erreurs. La première, c’est l’acceptation sans réserve de la technique et de toutes ses possibilité de réalisation d’une meilleure vie et d’une meilleure société, sans aucune conception de ce qu’est une vie bonne. Nous avons besoin d’une boussole permettant d’identifier ce qu’est une vie meilleure et une communauté réussie » (p 24). Harmut Rosa poursuit ensuite sa critique en réponse à une relance de son interlocuteur ; « le courant accélérationniste s’inscrit dans le registre du possible et de l’impossible. Ce qui est possible doit être réalisé pour la seule raison qu’il est possible » (p 24). « Oui, d’où une utopie aveugle du faisable… Cette quête du faisable est un réel problème, une façon exclusivement prométhéenne d’aborder le monde » (p 25). De même, le transhumanisme est dangereux (p 27). Nous assistons aujourd’hui à une recherche infinie de pouvoir et de contrôle. Cependant aujourd’hui une prise de conscience s’opère. « L’idée de progrès est devenue plus terne » (p 30).
La visée d’une vie bonne et l’importance de la relation
De fait, l’humanité manque d’une boussole.
Sur le plan culturel, nous ne savons plus précisément ce qu’est une vie bonne. Qu’est-ce qu’une vie bonne ? Nous ne savons pas répondre à cette question… » (p 16). Ici, Harmut Rosa nous invite à nous demander : « Quand ai-je fait l’expérience d’une vie réussie ? ». « Nous ne répondons pas en racontant les moments où nous avons augmenté la quantité de nos ressources, mais plutôt en évoquant les moments où nous sommes entrés en contact avec quelqu’un ou quelque chose qui a été important pour nous » (p 32). « Nous pensons aux personnes qui ont été déterminantes pour nous », à un livre, à un paysage, à une musique… ». « C’est dire que nous percevons une forme de réussite liée à la façon d’entrer en relation avec quelqu’un » (p 33).
Ici, Harmut Rosa nous ouvre une vision du monde.
« Le sous-titre de mon livre est : « Sociologie de la relation au monde ». Voilà ce qui m’importe : la relation entre le sujet et le monde, car il n’y a pas de sujet totalement fini, ni de monde totalement fini ; et les deux entrent en contact. La résonance est à l’œuvre lorsqu’il y une rencontre avec un autre » (p 33).
« La relation est la base. Le sujet comme le monde sont déjà le résultat d’une relation… La forme réussie d’interaction résonante, c’est lorsque nous sommes prêts à écouter la voix de l’autre, et à rendre la nôtre plus perceptible pour que cette résonance soit horizontale. En ce sens, la politique et la démocratie sont aussi des formes de résonance. Tout comme le travail. La résonance a partie liée avec ce qui est un fondement de notre existence » (p 34).
Une question concernant l’éducation est alors posée. Il y a une différence entre appropriation des connaissances et assimilation qui conduit à une transformation. « Je peux acquérir des connaissances, apprendre à utiliser des machines et des programmes. Lorsque je m’approprie les choses, j’arrive à les contrôler. L’assimilation est tout autre chose. Elle conduit à une transformation » (p 36). Par exemple, lire un poème peut être une expérience. « Je me laisse transformer et je suis en partie quelqu’un d’autre ». « Dans les processus d’assimilation, j’entre en contact avec le monde. Tout se passe comme si je m’entretenais avec lui. Il a des répercussions sur moi. Il me touche et me transforme ».
Nous avons besoin de l’autre
Y a-t-il des obstacles au développement de vraies relations ? « Effectivement, une logique d’instrumentalisation ou de chosification est très présente dans nos interactions avec les autres ou avec les choses. La façon dont elles ont lieu est régulièrement instrumentale ou causale » (p 39) ». Se rencontrer en tant qu’êtres humains prend beaucoup de temps. Souvent nous ratons cette expérience… ».
« Cependant, je pense que les humains sont depuis toujours doués pour la résonance. Tous ont fait cette expérience et savent en quoi le monde apporte des réponses et rend possible une vraie rencontre. Nous pouvons disposer de toutes les ressources du monde, être en bonne santé, riches, avoir beaucoup de connaissances et de relations, et, malgré cela, avoir l’impression que quelque chose nous manque. Dans notre époque de l’accélération, nous avons besoin de l’autre ». (p 41).
Comment apprendre la résonance ? « Nous n’avons pas besoin d’apprendre la résonnance, parce que nous avons déjà en nous les capacités. En revanche, nous les éloignons, nous apprenons à évoluer dans un monde chosifié et à ne plus laisser les choses parvenir à nous » (p 41).
Une réponse au défi écologique
Notre époque est marquée par « une triple accélération : accélération technique, accélération du changement social et accélération du rythme de vie ». Mais ajoute Nathanaël Wallenhorst, il y en a une quatrième : la Grande Accélération » que constitue l’entrée dans l’Anthropocène. « Cette Grande Accélération signe l’entrée dans une nouvelle époque géologique caractérisée par les effets anthropiques sur le climat et la biosphère dans son ensemble ». (p 44). En regard Harmut Rosa s’intéresse à notre relation à la nature. « Effectivement, nous avons actuellement à faire à un réchauffement climatique de nature anthropique. Nous avons contribué à ce réchauffement » (p 44). Cependant, on peut ouvrir le questionnement. « Ma thèse serait la suivante : la modernité a besoin de la nature pas seulement comme d’une ressource ou d’un souterrain du monde, mais également comme d’une sphère de résonance, comme quelque chose qui entretient une sorte de relation avec nous. Je crois que les mouvements écologiques sont liés à une perception de la perte possible de la nature comme sphère de résonance, comme espace d’action environnemental dans l’espoir d’inverser le cours des choses » (p 45). « Dans notre façon brutale d’aborder la nature, nous percevons bien les mécanismes de chosification et d’aliénation de notre société. Notre rapport aux animaux est à cet égard très significatif… ». « Nous chosifions la nature à bien des égards sans toujours percevoir combien nous en avons besoin pour notre propre compréhension, comme quelque chose qui entretient une relation organique de résonnance avec nous » (p 46).
Que pouvons-nous faire ?
Dans la société capitaliste, on suscite et on amplifie les besoins. Et, par exemple, dans presque toutes les cultures du monde, si mon pantalon est abimé, je vais le réparer. « L’idée que je pourrais avoir un nouveau pantalon plus beau, meilleur, est typique de la modernité. Elle n’est pas intrinsèquement liée à la nature de l’homme ». « Le capitalisme pourtant vit de ce programme d’augmentation. Il doit se modifier sur le long terme » (p 58). De même, nous sommes responsables des personnes qui cousent un T-shirt à l’autre bout du monde… Mais notre responsabilité n’est pas celle d’un individu atomisé. Elle s’inscrit dans un lien, elle renvoie à une coresponsabilité… Nous devons retrouver cette inexorable relation qui nous unit les uns aux autres » (p 59).
L’auteur propose également un revenu de base, sans condition comme « filet de sécurité pour tous ». « Nous n’aurions plus une peur existentielle et matérielle. Une telle mesure contribuerait à créer les conditions pour être autrement dans le monde et pour s’impliquer autrement dans les relations aux autres » (p 55).
« Nous pouvons façonner ensemble le monde et agir sur lui. Cela est possible à la hauteur de nos relations les uns avec les autres ». Ici Harmut Rosa met l’accent sur la dynamique culturelle. « Le dernier grand mouvement qui a eu un effet sur le vivre-ensemble est la révolution de 1968. Ce n’est pas un hasard s’il s’agissait aussi d’une grande révolution musicale… L’expérience musicale et les chants communs étaient des éléments liants… Tout cela s’est passé sur le mode de la résonance… » (p 60).
Harmut Rosa nous appelle à une attitude moins focalisée, plus libre, plus à l’écoute ; « un monde meilleur est possible. Une transition devrait avoir lieu entre cette relation au monde qui vise le pouvoir de disposer des choses et de les mettre sous contrôle et une attitude au monde dont la caractéristique principale est l’écoute. Nous devons apprendre à écouter le monde, à le percevoir nouvellement et à lui répondre. C’est une toute autre chose que d’en disposer » (p 53).
Face au dérèglement de la société humaine, Harmut Rosa propose de nous tourner vers le cœur de la vie sociale, une juste relation. Face à un individualisme exacerbé, entrer dans une résonance.
« La relation est la base. Le sujet comme le monde sont déjà le résultat d’une relation… La forme réussie d’interaction résonante, c’est lorsque nous sommes prêts à écouter la voix de l’autre, et à rendre la nôtre plus perceptible pour que cette résonance soit horizontale… La résonance a partie liée avec ce qui est un fondement de notre existence » (p 34).
Cet accent sur la relation rejoint un courant de pensée qui s’affirme aujourd’hui tant dans les sciences humaines que dans la réflexion théologique « Aujourd’hui, face au malaise engendré par la division, la séparation dans la vie sociale comme dans la vie intellectuelle, des mouvement se dessinent pour une nouvelle reliance. Ainsi est paru un livre avec le titre significatif : « Relions-nous » (2). Les appels à la convivialité et à la fraternité (3) se multiplient et témoignent du grand mouvement communautaire en cours aujourd’hui.
Depuis ses origines, la foi chrétienne manifeste le message d’amour de l’Évangile, mais dans la foulée des empires et d’une société patriarcale, la « religion organisée » s’est souvent écartée de l’inspiration originelle. Et même, Dieu a pu être présenté comme un souverain sur son trône. En regard, s’affirme aujourd’hui un Dieu communion dans sa dimension trinitaire, Dieu Vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient (4). Selon Jürgen Moltmann (5), la vie éternelle s’inscrit dans un univers interrelationnel. « L’être humain n’est pas un individu, mais un être social. Il meurt socialement lorsqu’il n’a pas de relations ». Jürgen Moltmann envisage la création en terme de relations : « Si l’Esprit Saint est répandu sur toute la création, il fait de la communauté entre toutes les créatures avec Dieu et entre elles, cette communauté de le création dans laquelle toutes les créatures communiquent chacune à sa manière entre elles et avec Dieu ».
Dans l’origine du trouble contemporain, Harmut Rosa perçoit une incertitude sur ce qu’est une vie bonne. Jürgen Moltmann répond à cette question en envisageant une vie pleine (full life) de l’homme en communion avec le Dieu Vivant (5). Et Richard Rohr envisage la vie bonne dans la même perspective (6) : « Une vie bonne, c’est une vie en relation. Lorsqu’une personne est isolée, séparée, seule, la maladie menace. La voie de Jésus, c’est une invitation à une vision trinitaire de la vie, de l’amour, et de la relation sur la terre comme au sein de la Divinité. Nous sommes faits pour l’amour et, en dehors de cela, nous mourrons très rapidement ».
Lorsque Harmut vient fonder l’équilibre social en terme de saines relations, une résonance qui vient recomposer un monde en errance, il exprime sa pensée à partir d’une observation et d’une analyse sociologique et philosophique en recourant aux ressources du même registre. La réflexion théologique présentée dans ce commentaire nous paraît rejoindre l’approche de Harmut Rosa en mettant l’accent sur la réalité vitale de la relation.
J H
- Harmut Rosa : Accélérons la résonance ! Entretiens avec Nathanaël Wallenhorst. Pour une éducation en Anthropocène. Le Pommier, 2022
- Tout se tient. Relions-nous : Un livre et un mouvement de pensée : https://vivreetesperer.com/tout-se-tient/
- Pour des oasis de fraternité. Pourquoi la fraternité ? Selon Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/pour-des-oasis-de-fraternite/
- Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-dieu-present-dieu-avec-nous-dans-un-univers-interrelationnel-holistique-anime/
- Le Dieu vivant et la plénitude de vie : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/
- Reconnaître et vivre la présence d’un Dieu relationnel : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-et-vivre-la-presence-dun-dieu-relationnel/
par jean | Nov 22, 2015 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Hstoires et projets de vie |
#
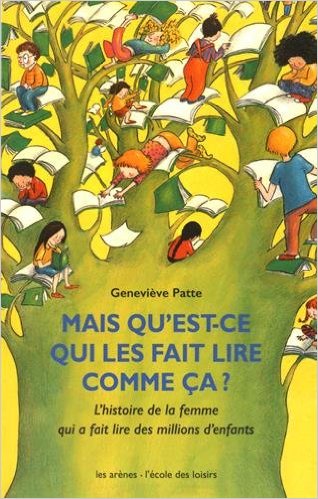 « Mais qu’est ce qui les fait lire comme ça ? ». Oui, il y a bien chez les enfants une puissance de vie qui s’exprime en terme d’exploration, de découverte et d’émerveillement. Et c’est pourquoi on doit tout simplement faciliter ce mouvement, laisser passer et encourager ce courant de vie. « Laissez les lire ! » (1) nous disait Geneviève Patte à travers le titre d’un livre précédent. Et, dans celui-ci, elle réitère ce message : « Mais qu’est-ce qui les fait lire comme ça ? » (2).
« Mais qu’est ce qui les fait lire comme ça ? ». Oui, il y a bien chez les enfants une puissance de vie qui s’exprime en terme d’exploration, de découverte et d’émerveillement. Et c’est pourquoi on doit tout simplement faciliter ce mouvement, laisser passer et encourager ce courant de vie. « Laissez les lire ! » (1) nous disait Geneviève Patte à travers le titre d’un livre précédent. Et, dans celui-ci, elle réitère ce message : « Mais qu’est-ce qui les fait lire comme ça ? » (2).
Comme Maria Montessori dans un autre contexte (3), c’est la reconnaissance de la puissance de vie qui s’exprime dans l’enfant. La communion intuitive et l’écoute nous permettent d’entrer dans cette réalité. L’observation et la réflexion nous aident à en saisir la pleine dimension. Et, pour tout cela, la relation est première. On peut redire ici les mots du philosophe Martin Buber : « Au commencement était la relation » (4). En toute chose, mais combien cela est vrai ici… Et cette dynamique relationnelle apparaît comme première dans l’histoire de vie de Geneviève Patte telle qu’elle nous la présente dans ce livre. Cette histoire se déroule de rencontre en rencontre.
Une famille ouverte aux autres, ouverte à l’étranger
Au départ, Geneviève nous parle de sa famille, une famille résistante durant l’occupation, une famille ouverte aux autres, ouverte à l’étranger. « J’étais bien petite, mais je me rappelle la période de l’Exode à Poitiers. La famille était accueillante. Tous les soirs, en mai-juin 1940, mes frères et sœurs ainés se rendaient à la gare pour offrir l’hospitalité à ceux qui ne savaient pas où passer la nuit. J’aimais alors les grandes tablées du matin où chacun se restaurait avant de reprendre la route… » (p 17)).
Ouverture aux autres, ouverture aux livres. Je suis née et j’ai grandi dans une maison remplie de livres. Mes parents lisaient beaucoup et prenaient le temps de nous lire et de nous raconter des histoires. Il me suffisait d’aller frapper à la porte du bureau de mon père pour qu’il interrompe ses recherches de paléontologie et m’accorde du temps. Il sortait alors du tiroir de sa table de travail quelques albums délicieux dont il me faisait lecture… Ces livres m’ont laissé une forte impression… » (p 13).
Au lycée, Geneviève a fréquenté « les classes nouvelles », crées à la Libération dans un état d’esprit pionnier. « On y privilégiait le travail en équipe, l’autodiscipline et les enquêtes dans la ville pour « l’étude du milieu » (p 21).
Bref, cet environnement familial et scolaire a été un point de départ privilégié pour l’itinéraire pionnier de Geneviève Patte dans la création de « la Joie par les Livres » et la promotion des bibliothèques pour enfants.
Des rencontres fondatrices, de « l’Heure Joyeuse » à « la Joie par les livres »
Mais cet avenir n’était pas écrit d’avance ! Il est advenu à travers des rencontres fondatrices.
La première a été la découverte de « l’Heure joyeuse », une bibliothèque d’avant garde créée à Paris dans l’entre deux guerres à la suite des innovations américaines dans le domaine de la lecture enfantine. « A travers les fenêtres éclairées, je voyais un spectacle qui m’enchantait. Des enfants circulaient librement dans un monde de livres. Certains semblaient accaparés par leurs lectures. D’autres consultaient les fichiers. J’avais remarqué aussi la présence discrète et attentive de deux femmes. Elles conversaient en tête-à-tête avec des enfants. Tout cela me paraissait inhabituel. J’étais émerveillée… » (p 23). Geneviève nous introduit ensuite dans la vie de cette bibliothèque exceptionnelle. Et c’est là qu’elle a pris la décision de devenir bibliothécaire.
Quelques années plus tard, ce fut le début d’une aventure internationale qui allait se poursuivre ensuite tout au long de cette histoire de vie. Geneviève Patte effectue un stage à la Bibliothèque Internationale pour la Jeunesse à Munich. Et puis, dans cette ouverture d’esprit qui est la sienne, elle se laisse interpeller par l’idée de se rendre aux Etats-Unis où les bibliothèques pour enfants sont florissantes. « C’est une décision difficile. A cette époque, New-York est une ville lointaine. On n’y va pas en quelques heures. Le voyage est une véritable aventure… Finalement, je me laisse convaincre. Par chance, à Poitiers, je rencontre un couple américain particulièrement ouvert… » (p 49). Ces amis vont l’aider à réaliser ce voyage. Geneviève obtient une bourse Fulbright et travaille à la « New York Public Library ».
De retour en France, une autre rencontre va ouvrir à Geneviève un champ pionnier : la création et le développement de la bibliothèque : « La Joie par les Livres » à Clamart. C’est la rencontre avec Anne Schlumberger, la mécène de l’association, qui va permettre cette réalisation. « Qui donc est la femme généreuse qui permet cette aventure ? Elle s’appelle Anne Gruner Schlumberger. Elle appartient à une famille de grands industriels protestants d’Alsace, mais aussi d’hommes de lettres et de découvreurs de génie. Sa famille est bien connue dans le monde entier pour ses actions de mécénat exceptionnelles de générosité et d’intelligence… Cependant, sa volonté d’offrir une bibliothèque d’exception à l’intention des enfants et des familles suscite de fortes réticences en France, dans le monde des bibliothèques… Pourtant, pour Anne Schlumberger, il ne s’agit pas d’un coup de tête. C’est une décision longuement murie… » (p 68-69). Malgré les oppositions ambiantes, Geneviève et une petite équipe ont accepté d’entrer dans ce qui a été au départ une aventure, une manifestation extraordinaire de créativité. « Fallait-il donc que nous ayons un courage à toute épreuve ou une incroyable naïveté pour nous lancer dans l’aventure de Clamart ? Nous devinions en fait que ce que nous offrait Anne Schlumberger était unique : la confiance et la liberté pour innover et pour rechercher l’excellence… D’emblée, j’ai aimé l’exigence et l’enthousiasme de la petite équipe. Nous étions liées par une conviction commune et nous aimions travailler ensemble… Anne nous a donné toute liberté pour mettre en place un projet qui ainsi a pu se développer de manière naturelle, à la fois cohérente et solide… Notre désir était clair : révéler aux enfants ce que peut leur apporter une bibliothèque pensée pour eux, un lieu qui leur permette de connaître la joie de lire et de vivre là une part de leur enfance, d’en être en quelque sorte les acteurs ; tout cela dans un contexte de relations simples et naturelles avec des adultes… » (p 74-76). Geneviève nous décrit cette bibliothèque pionnière qui est devenue un lieu attirant et rayonnant.
Ces hommes et ces femmes au cœur intelligent
L’influence de la « Joie par les livres » s’est manifestée tant en France qu’à l’étranger. Et là encore, des rencontres fécondes sont advenues. Geneviève nous raconte ainsi la visite de Joseph Wresinski qui a marqué le début d’une vraie collaboration avec ATD-Quart Monde (p 135-136). C’est aussi le dialogue heuristique qui s’engage avec le pédopsychiatre René Diatkine. « René Diatkine aimait rappeler l’apport des vraies rencontres. Ma rencontre avec lui a été déterminante… Nos intérêts se sont rejoints autour d’un même souci : créer partout les conditions favorisant l’accès de tous à la lecture, en privilégiant ceux qui habituellement sont éloignés du monde de l’écrit… (p 180). Chercheur et thérapeute, René Diatkine a enrichi considérablement nos pratiques, parce que les séminaires qu’il a animé à notre intention ont renforcé chez nous le goût de l’observation… Observez, écrivez, ne négligez pas les détails. Ils sont porteurs de sens… L’observation éclaire nos pratiques. Elle met au cœur de notre métier ce qui est fondamental : la médiation » (p 185-186).
« Avec Serge Boimare, revenir aux histoires qui ont traversé les âges » : voici une autre rencontre impressionnante. « Serge Boimare raconte comment des enfants refusant volontairement tout apprentissage scolaire sont capables de se prendre de passion pour des œuvres classées parmi les grands livres de notre patrimoine littéraire : la Bible, l’Odyssée, les grands mythes classiques, les contes de Grimm ou les œuvres de Jack London et de Jules Verne… » (p 197).
Geneviève nous dit combien toutes ces rencontres ont été fécondes : « René Diatkine, Sarah Hirschman et Serge Boimare, ces hommes et ces femmes au cœur intelligent, pour reprendre l’expression de Hannah Arendt, m’ont, chacun à leur manière, beaucoup inspirée pour ce qui est au cœur même de mon métier… Ils partagent une même confiance : les rencontres que les bibliothèques proposent, peuvent contribuer à transformer les vies les plus difficiles en ouvrant par la lecture, des voies nouvelles… J’ai beaucoup reçu de ces personnes que j’admire pour leur humanité… Voilà ce qui a toujours animé mes interventions en France et dans le vaste monde, notamment dans les pays du Sud, là où des bibliothécaires souhaitent insuffler un esprit nouveau à leurs institutions (p 201-202).
Expériences dynamiques dans les pays du Sud
Au long de cet itinéraire, Geneviève s’est ainsi rendu dans de nombreux pays du Sud qui ont fait appel à elle. Ce livre nous décrit ces nombreuses missions à l’étranger. Ces missions ont été à l’origine de belles rencontres. Parce qu’elle est entrée en sympathie avec ses interlocuteurs, Geneviève a beaucoup appris des expériences en cours aujourd’hui en Amérique latine, en Afrique, en Asie.
Dans un contexte de pauvreté et souvent d’injustice, Geneviève nous décrit une multitude d’expériences de terrain, riches en générosité et en humanité.
« Ce qui me frappe, c’est l’imagination de ces passeurs, la diversité de ces petites unités de lecture parce qu’est prise en compte la diversité des personnes et des situations… Ainsi, à Guanajuato au Mexique, pour offrir le plaisir d’histoires racontées, Liliane n’hésite pas à utiliser les longs moments passés dans ces autocars brinquebalants qui font partie du paysage latino-américain. Et là elle raconte, elle montre des albums au fil des pages… A Mexico, une ou deux fois par semaine, en soirée, Nestor accueille chez lui parents, jeunes et enfants du quartier… L’espace de lecture, aménagé dans une pièce de sa maison, ouvre sur la rue…Ici, on raconte, on lit à haute voix des textes qui touchent, on échange des impressions. L’ambiance est joyeuse… Ailleurs encore, dans un jardin public de Jinotepe, au Nicaragua, entre balançoire et toboggan, il y a comme une sorte de petit abri, fait de bric et de broc, où des enfants s’arrêtent pour de longs moments de lecture. Ils peuvent s’installer à de petites tables. Le choix des livres est remarquable tout comme la concentration des enfants au milieu de l’agitation ambiante (p 248-250). « J’ai donc vu à l’œuvre ces modestes pionniers. J’ai admiré leur simplicité, leur goût de l’excellence, la rigueur de leur jugement. J’ai aimé leur gaieté. Leur enthousiasme est contagieux. Ainsi naissent et se développent ici et là des initiatives qui font tache d’huile. Le travail en réseau est essentiel pour ces petites unités… » (p 250).
Geneviève cite le grand éducateur brésilien : Paolo Freire : « Les hommes s’éduquent en communion et de manière médiatisée à travers le monde ». « J’ai rencontré sur mon chemin des initiatives éclairées par le même esprit et dans des lieux pourtant différents. Les auteurs ont en commun le même désir de rejoindre les marges, de se rapprocher de ceux qui souvent ne sont pas reconnus par les instances éducatives et culturelles. Ils ont une haute idée de la lecture et des bibliothèques. Ils sont habités par un souci de justice qui les amène à porter beaucoup de leurs efforts sur les oubliés. Parce qu’ils s’en rapprochent et les écoutent, ils connaissent la richesse de ces personnes victimes d’exclusion et ils créent des espaces de rencontre où celles-ci peuvent pleinement trouver leur place et avoir voix au chapitre (p 214). Il y a ainsi, dans ces pays du Sud, une chaleur humaine et une vitalité que l’on découvre à travers des récits de rencontres avec des personnes exceptionnelles.
Ce livre se déroule en de courts chapitres, couvrant chacun un thème précis : un épisode de vie, une rencontre, une activité, un livre, une question… au total plus de 130 séquences, des unités de lecture facilement accessibles. On peut lire telle ou telle d’entre elles. On peut également entrer dans le déroulé du livre et le lire de bout en bout. On y découvre un mouvement de rencontre en rencontre, de découverte en découverte. Ce livre nous ouvre un horizon. « La bibliothèque est une terre d’envol. « Donnez-nous des livres, donnez-nous des ailes » selon la belle formule de Paul Hazard. Il y a là comme une source où l’on vient goûter cette eau vive de la lecture et de la rencontre, un lieu où chacun est reconnu et peut faire entendre sa voix, où l’on apprécie un vivre-ensemble singulier. Là, je suis témoin de l’éveil de l’enfant qui, à la faveur de ses découvertes, naît au monde et s’étonne, et j’ai le plaisir de partager cela avec ceux qui sont sensibles à l’esprit d’enfance » (p 262).
J H
(1) Patte (Geneviève). Laissez-les lire ! Mission lecture. Gallimard, 2012. Mise en perspective sur ce blog : « Laissez-les lire. Une dynamique relationnelle et éducative » : https://vivreetesperer.com/?p=523
(2) Patte (Geneviève). Mais qu’est-ce qui les fait lire comme ça ? L’histoire de la femme qui a fait lire des millions d’enfants. Les arènes. L’école des loisirs, 2015
(3) Montessori (Maria). L’enfant. Desclée de Brouwer, 1936
Maria Montessori met en lumière le potentiel de l’enfant et elle le décrit en terme « d’embryon spirituel ». Sur ce blog, l’article : « L’enfant, un être spirituel » : https://vivreetesperer.com/?p=340
Maria Montessori est une des grandes figures pionnières du courant de l’éducation nouvelle qui se poursuit aujourd’hui dans d’autres formes. Sur ce blog : « Et si nous éduquions nos enfants à la joie ? Pour un printemps de l’éducation ! » : https://vivreetesperer.com/?p=1872
(4) « L’« essence » de la création dans l’Esprit est par conséquent la « collaboration » et les structures manifestent la présence de l’Esprit dans la mesure où elles font reconnaître l’« accord général ». « Au commencement était la relation (Martin Buber) » (Jürgen Moltmann, Dieu dans la création. Seuil, 1988 (p25).
Sur ce blog, voir aussi :
« Esprit d’enfance. Amour, humour, émerveillement. Les albums de Peter Spier » : https://vivreetesperer.com/?p=1651
« Papa arbre. Un album intime » : https://vivreetesperer.com/?p=1031