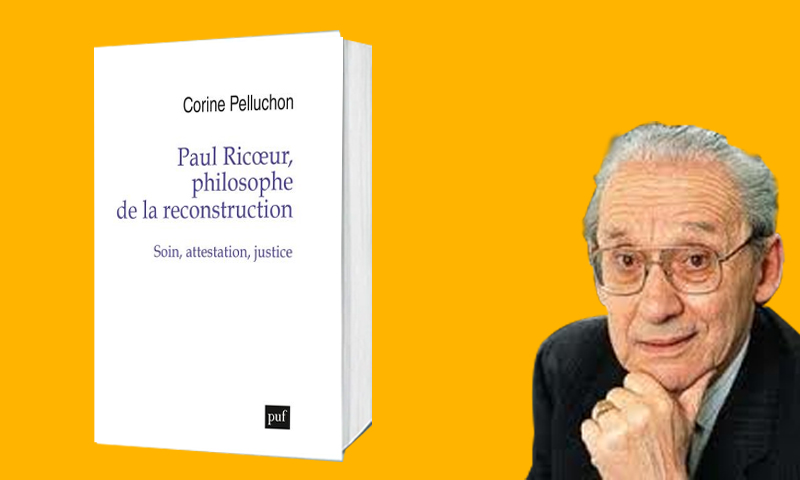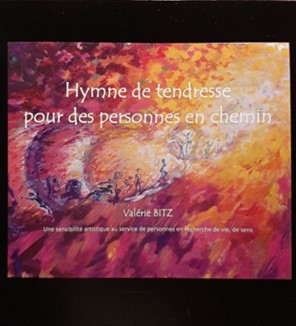par jean | Nov 22, 2015 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Hstoires et projets de vie |
#
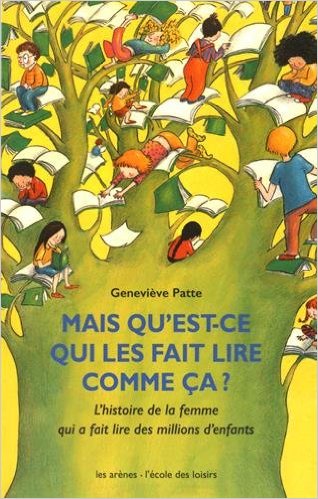 « Mais qu’est ce qui les fait lire comme ça ? ». Oui, il y a bien chez les enfants une puissance de vie qui s’exprime en terme d’exploration, de découverte et d’émerveillement. Et c’est pourquoi on doit tout simplement faciliter ce mouvement, laisser passer et encourager ce courant de vie. « Laissez les lire ! » (1) nous disait Geneviève Patte à travers le titre d’un livre précédent. Et, dans celui-ci, elle réitère ce message : « Mais qu’est-ce qui les fait lire comme ça ? » (2).
« Mais qu’est ce qui les fait lire comme ça ? ». Oui, il y a bien chez les enfants une puissance de vie qui s’exprime en terme d’exploration, de découverte et d’émerveillement. Et c’est pourquoi on doit tout simplement faciliter ce mouvement, laisser passer et encourager ce courant de vie. « Laissez les lire ! » (1) nous disait Geneviève Patte à travers le titre d’un livre précédent. Et, dans celui-ci, elle réitère ce message : « Mais qu’est-ce qui les fait lire comme ça ? » (2).
Comme Maria Montessori dans un autre contexte (3), c’est la reconnaissance de la puissance de vie qui s’exprime dans l’enfant. La communion intuitive et l’écoute nous permettent d’entrer dans cette réalité. L’observation et la réflexion nous aident à en saisir la pleine dimension. Et, pour tout cela, la relation est première. On peut redire ici les mots du philosophe Martin Buber : « Au commencement était la relation » (4). En toute chose, mais combien cela est vrai ici… Et cette dynamique relationnelle apparaît comme première dans l’histoire de vie de Geneviève Patte telle qu’elle nous la présente dans ce livre. Cette histoire se déroule de rencontre en rencontre.
Une famille ouverte aux autres, ouverte à l’étranger
Au départ, Geneviève nous parle de sa famille, une famille résistante durant l’occupation, une famille ouverte aux autres, ouverte à l’étranger. « J’étais bien petite, mais je me rappelle la période de l’Exode à Poitiers. La famille était accueillante. Tous les soirs, en mai-juin 1940, mes frères et sœurs ainés se rendaient à la gare pour offrir l’hospitalité à ceux qui ne savaient pas où passer la nuit. J’aimais alors les grandes tablées du matin où chacun se restaurait avant de reprendre la route… » (p 17)).
Ouverture aux autres, ouverture aux livres. Je suis née et j’ai grandi dans une maison remplie de livres. Mes parents lisaient beaucoup et prenaient le temps de nous lire et de nous raconter des histoires. Il me suffisait d’aller frapper à la porte du bureau de mon père pour qu’il interrompe ses recherches de paléontologie et m’accorde du temps. Il sortait alors du tiroir de sa table de travail quelques albums délicieux dont il me faisait lecture… Ces livres m’ont laissé une forte impression… » (p 13).
Au lycée, Geneviève a fréquenté « les classes nouvelles », crées à la Libération dans un état d’esprit pionnier. « On y privilégiait le travail en équipe, l’autodiscipline et les enquêtes dans la ville pour « l’étude du milieu » (p 21).
Bref, cet environnement familial et scolaire a été un point de départ privilégié pour l’itinéraire pionnier de Geneviève Patte dans la création de « la Joie par les Livres » et la promotion des bibliothèques pour enfants.
Des rencontres fondatrices, de « l’Heure Joyeuse » à « la Joie par les livres »
Mais cet avenir n’était pas écrit d’avance ! Il est advenu à travers des rencontres fondatrices.
La première a été la découverte de « l’Heure joyeuse », une bibliothèque d’avant garde créée à Paris dans l’entre deux guerres à la suite des innovations américaines dans le domaine de la lecture enfantine. « A travers les fenêtres éclairées, je voyais un spectacle qui m’enchantait. Des enfants circulaient librement dans un monde de livres. Certains semblaient accaparés par leurs lectures. D’autres consultaient les fichiers. J’avais remarqué aussi la présence discrète et attentive de deux femmes. Elles conversaient en tête-à-tête avec des enfants. Tout cela me paraissait inhabituel. J’étais émerveillée… » (p 23). Geneviève nous introduit ensuite dans la vie de cette bibliothèque exceptionnelle. Et c’est là qu’elle a pris la décision de devenir bibliothécaire.
Quelques années plus tard, ce fut le début d’une aventure internationale qui allait se poursuivre ensuite tout au long de cette histoire de vie. Geneviève Patte effectue un stage à la Bibliothèque Internationale pour la Jeunesse à Munich. Et puis, dans cette ouverture d’esprit qui est la sienne, elle se laisse interpeller par l’idée de se rendre aux Etats-Unis où les bibliothèques pour enfants sont florissantes. « C’est une décision difficile. A cette époque, New-York est une ville lointaine. On n’y va pas en quelques heures. Le voyage est une véritable aventure… Finalement, je me laisse convaincre. Par chance, à Poitiers, je rencontre un couple américain particulièrement ouvert… » (p 49). Ces amis vont l’aider à réaliser ce voyage. Geneviève obtient une bourse Fulbright et travaille à la « New York Public Library ».
De retour en France, une autre rencontre va ouvrir à Geneviève un champ pionnier : la création et le développement de la bibliothèque : « La Joie par les Livres » à Clamart. C’est la rencontre avec Anne Schlumberger, la mécène de l’association, qui va permettre cette réalisation. « Qui donc est la femme généreuse qui permet cette aventure ? Elle s’appelle Anne Gruner Schlumberger. Elle appartient à une famille de grands industriels protestants d’Alsace, mais aussi d’hommes de lettres et de découvreurs de génie. Sa famille est bien connue dans le monde entier pour ses actions de mécénat exceptionnelles de générosité et d’intelligence… Cependant, sa volonté d’offrir une bibliothèque d’exception à l’intention des enfants et des familles suscite de fortes réticences en France, dans le monde des bibliothèques… Pourtant, pour Anne Schlumberger, il ne s’agit pas d’un coup de tête. C’est une décision longuement murie… » (p 68-69). Malgré les oppositions ambiantes, Geneviève et une petite équipe ont accepté d’entrer dans ce qui a été au départ une aventure, une manifestation extraordinaire de créativité. « Fallait-il donc que nous ayons un courage à toute épreuve ou une incroyable naïveté pour nous lancer dans l’aventure de Clamart ? Nous devinions en fait que ce que nous offrait Anne Schlumberger était unique : la confiance et la liberté pour innover et pour rechercher l’excellence… D’emblée, j’ai aimé l’exigence et l’enthousiasme de la petite équipe. Nous étions liées par une conviction commune et nous aimions travailler ensemble… Anne nous a donné toute liberté pour mettre en place un projet qui ainsi a pu se développer de manière naturelle, à la fois cohérente et solide… Notre désir était clair : révéler aux enfants ce que peut leur apporter une bibliothèque pensée pour eux, un lieu qui leur permette de connaître la joie de lire et de vivre là une part de leur enfance, d’en être en quelque sorte les acteurs ; tout cela dans un contexte de relations simples et naturelles avec des adultes… » (p 74-76). Geneviève nous décrit cette bibliothèque pionnière qui est devenue un lieu attirant et rayonnant.
Ces hommes et ces femmes au cœur intelligent
L’influence de la « Joie par les livres » s’est manifestée tant en France qu’à l’étranger. Et là encore, des rencontres fécondes sont advenues. Geneviève nous raconte ainsi la visite de Joseph Wresinski qui a marqué le début d’une vraie collaboration avec ATD-Quart Monde (p 135-136). C’est aussi le dialogue heuristique qui s’engage avec le pédopsychiatre René Diatkine. « René Diatkine aimait rappeler l’apport des vraies rencontres. Ma rencontre avec lui a été déterminante… Nos intérêts se sont rejoints autour d’un même souci : créer partout les conditions favorisant l’accès de tous à la lecture, en privilégiant ceux qui habituellement sont éloignés du monde de l’écrit… (p 180). Chercheur et thérapeute, René Diatkine a enrichi considérablement nos pratiques, parce que les séminaires qu’il a animé à notre intention ont renforcé chez nous le goût de l’observation… Observez, écrivez, ne négligez pas les détails. Ils sont porteurs de sens… L’observation éclaire nos pratiques. Elle met au cœur de notre métier ce qui est fondamental : la médiation » (p 185-186).
« Avec Serge Boimare, revenir aux histoires qui ont traversé les âges » : voici une autre rencontre impressionnante. « Serge Boimare raconte comment des enfants refusant volontairement tout apprentissage scolaire sont capables de se prendre de passion pour des œuvres classées parmi les grands livres de notre patrimoine littéraire : la Bible, l’Odyssée, les grands mythes classiques, les contes de Grimm ou les œuvres de Jack London et de Jules Verne… » (p 197).
Geneviève nous dit combien toutes ces rencontres ont été fécondes : « René Diatkine, Sarah Hirschman et Serge Boimare, ces hommes et ces femmes au cœur intelligent, pour reprendre l’expression de Hannah Arendt, m’ont, chacun à leur manière, beaucoup inspirée pour ce qui est au cœur même de mon métier… Ils partagent une même confiance : les rencontres que les bibliothèques proposent, peuvent contribuer à transformer les vies les plus difficiles en ouvrant par la lecture, des voies nouvelles… J’ai beaucoup reçu de ces personnes que j’admire pour leur humanité… Voilà ce qui a toujours animé mes interventions en France et dans le vaste monde, notamment dans les pays du Sud, là où des bibliothécaires souhaitent insuffler un esprit nouveau à leurs institutions (p 201-202).
Expériences dynamiques dans les pays du Sud
Au long de cet itinéraire, Geneviève s’est ainsi rendu dans de nombreux pays du Sud qui ont fait appel à elle. Ce livre nous décrit ces nombreuses missions à l’étranger. Ces missions ont été à l’origine de belles rencontres. Parce qu’elle est entrée en sympathie avec ses interlocuteurs, Geneviève a beaucoup appris des expériences en cours aujourd’hui en Amérique latine, en Afrique, en Asie.
Dans un contexte de pauvreté et souvent d’injustice, Geneviève nous décrit une multitude d’expériences de terrain, riches en générosité et en humanité.
« Ce qui me frappe, c’est l’imagination de ces passeurs, la diversité de ces petites unités de lecture parce qu’est prise en compte la diversité des personnes et des situations… Ainsi, à Guanajuato au Mexique, pour offrir le plaisir d’histoires racontées, Liliane n’hésite pas à utiliser les longs moments passés dans ces autocars brinquebalants qui font partie du paysage latino-américain. Et là elle raconte, elle montre des albums au fil des pages… A Mexico, une ou deux fois par semaine, en soirée, Nestor accueille chez lui parents, jeunes et enfants du quartier… L’espace de lecture, aménagé dans une pièce de sa maison, ouvre sur la rue…Ici, on raconte, on lit à haute voix des textes qui touchent, on échange des impressions. L’ambiance est joyeuse… Ailleurs encore, dans un jardin public de Jinotepe, au Nicaragua, entre balançoire et toboggan, il y a comme une sorte de petit abri, fait de bric et de broc, où des enfants s’arrêtent pour de longs moments de lecture. Ils peuvent s’installer à de petites tables. Le choix des livres est remarquable tout comme la concentration des enfants au milieu de l’agitation ambiante (p 248-250). « J’ai donc vu à l’œuvre ces modestes pionniers. J’ai admiré leur simplicité, leur goût de l’excellence, la rigueur de leur jugement. J’ai aimé leur gaieté. Leur enthousiasme est contagieux. Ainsi naissent et se développent ici et là des initiatives qui font tache d’huile. Le travail en réseau est essentiel pour ces petites unités… » (p 250).
Geneviève cite le grand éducateur brésilien : Paolo Freire : « Les hommes s’éduquent en communion et de manière médiatisée à travers le monde ». « J’ai rencontré sur mon chemin des initiatives éclairées par le même esprit et dans des lieux pourtant différents. Les auteurs ont en commun le même désir de rejoindre les marges, de se rapprocher de ceux qui souvent ne sont pas reconnus par les instances éducatives et culturelles. Ils ont une haute idée de la lecture et des bibliothèques. Ils sont habités par un souci de justice qui les amène à porter beaucoup de leurs efforts sur les oubliés. Parce qu’ils s’en rapprochent et les écoutent, ils connaissent la richesse de ces personnes victimes d’exclusion et ils créent des espaces de rencontre où celles-ci peuvent pleinement trouver leur place et avoir voix au chapitre (p 214). Il y a ainsi, dans ces pays du Sud, une chaleur humaine et une vitalité que l’on découvre à travers des récits de rencontres avec des personnes exceptionnelles.
Ce livre se déroule en de courts chapitres, couvrant chacun un thème précis : un épisode de vie, une rencontre, une activité, un livre, une question… au total plus de 130 séquences, des unités de lecture facilement accessibles. On peut lire telle ou telle d’entre elles. On peut également entrer dans le déroulé du livre et le lire de bout en bout. On y découvre un mouvement de rencontre en rencontre, de découverte en découverte. Ce livre nous ouvre un horizon. « La bibliothèque est une terre d’envol. « Donnez-nous des livres, donnez-nous des ailes » selon la belle formule de Paul Hazard. Il y a là comme une source où l’on vient goûter cette eau vive de la lecture et de la rencontre, un lieu où chacun est reconnu et peut faire entendre sa voix, où l’on apprécie un vivre-ensemble singulier. Là, je suis témoin de l’éveil de l’enfant qui, à la faveur de ses découvertes, naît au monde et s’étonne, et j’ai le plaisir de partager cela avec ceux qui sont sensibles à l’esprit d’enfance » (p 262).
J H
(1) Patte (Geneviève). Laissez-les lire ! Mission lecture. Gallimard, 2012. Mise en perspective sur ce blog : « Laissez-les lire. Une dynamique relationnelle et éducative » : https://vivreetesperer.com/?p=523
(2) Patte (Geneviève). Mais qu’est-ce qui les fait lire comme ça ? L’histoire de la femme qui a fait lire des millions d’enfants. Les arènes. L’école des loisirs, 2015
(3) Montessori (Maria). L’enfant. Desclée de Brouwer, 1936
Maria Montessori met en lumière le potentiel de l’enfant et elle le décrit en terme « d’embryon spirituel ». Sur ce blog, l’article : « L’enfant, un être spirituel » : https://vivreetesperer.com/?p=340
Maria Montessori est une des grandes figures pionnières du courant de l’éducation nouvelle qui se poursuit aujourd’hui dans d’autres formes. Sur ce blog : « Et si nous éduquions nos enfants à la joie ? Pour un printemps de l’éducation ! » : https://vivreetesperer.com/?p=1872
(4) « L’« essence » de la création dans l’Esprit est par conséquent la « collaboration » et les structures manifestent la présence de l’Esprit dans la mesure où elles font reconnaître l’« accord général ». « Au commencement était la relation (Martin Buber) » (Jürgen Moltmann, Dieu dans la création. Seuil, 1988 (p25).
Sur ce blog, voir aussi :
« Esprit d’enfance. Amour, humour, émerveillement. Les albums de Peter Spier » : https://vivreetesperer.com/?p=1651
« Papa arbre. Un album intime » : https://vivreetesperer.com/?p=1031
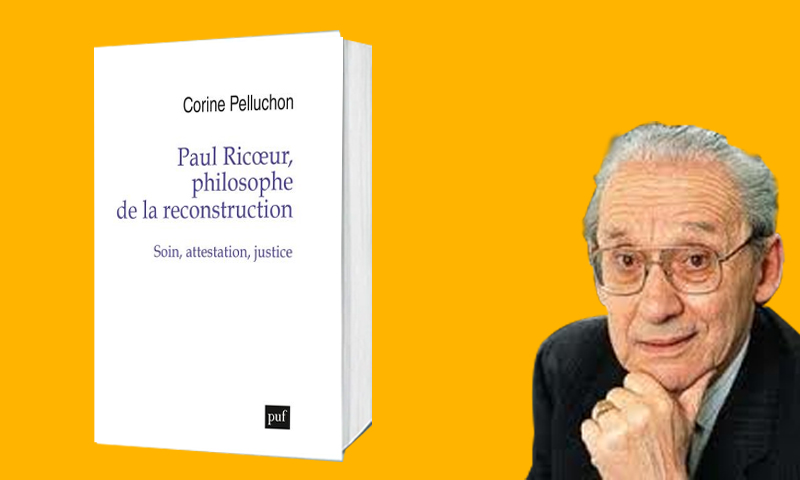
par jean | Mar 8, 2025 | ARTICLES, Hstoires et projets de vie |
Une identité qui se manifeste à travers la narration, d’après la philosophie de la reconstruction de Paul Ricoeur : « Soi-même comme un autre »
Comment nous percevons nous, nous-même ? Comment envisageons-nous notre chemin de vie ? Comment l’exprimons-nous ? Quel regard portons-nous sur notre parcours, sur ses défaillances comme sur ses points forts ? Percevons-nous notre vie en termes de moments dispersés et contradictoires ou bien comme orientée dans une même direction. Et, lorsque nous ressentons le besoin de faire le point, au moyen d’une narration, d’un récit, n’est-ce pas là que peut se manifester une conscience du mouvement de notre personnalité et de la vocation que nous y percevons ? Ce peut être ainsi une manière de prendre davantage conscience de nous-même, de ce qui nous nous tient à cœur, de ce à quoi nous nous sentons appelés. Nous pouvons ainsi exprimer une assurance dans le contexte du témoignage, une ‘attestation’ dans le langage du philosophe Paul Ricoeur pour qui l’idéal de vie consiste à ‘vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes’. Cette identité narrative est étudiée dans un livre de la philosophe Corine Pelluchon (1) : ‘Paul Ricoeur, philosophie de la reconstruction. Soin, attestation, justice’ (2). L’auteure y commente un livre majeur de Paul Ricoeur : ‘Soi-même comme un autre’.
A quelles questions ce livre veut-il répondre ? « Comment retrouver notre capacité d’agir quand nos repères s‘effondrent à la suite d’évènements traumatiques ? Quelle conception du sujet rend justice à la dimension narrative de l’identité ainsi qu’au tôle décisif joué par autrui et par les normes sociales dans la constitution de soi ? … » (page de couverture).
Par ailleurs, dépourvu de formation philosophique stricto sensu, nous ne rendrons pas compte de l’ensemble du livre, mais après avoir repris quelques considérations sur l’œuvre de Paul Ricoeur, nous présenterons l’approche narrative, en évoquant en fin de parcours ‘les prolongements de la théorie narrative en médecine et en politique’.
L’œuvre de Paul Ricoeur
Corine Pelluchon nous raconte d’abord comment ce livre est issu d’un séminaire consacré à l’étude de ‘Soi-même comme un autre’ et intitulé ‘Soin, attestation, justice’ dans le cadre d’un parcours en ‘Humanités médicales’. En 2021, l’auteure a approfondi sa réflexion sur Paul Ricoeur. « C’est ainsi qu’est né ce livre dans le but de faire comprendre une œuvre magistrale » (p 9).
Quel est l’esprit de cette œuvre ? « L’œuvre de Paul Ricoeur est une œuvre de reconstruction. Ce mot doit s’entendre de plusieurs manières qui s’entremêlent dans ‘Soi-même comme un autre’. La reconstruction est le fruit de la réflexion entendue comme réappropriation de notre effort pour exister. La réflexion en tant que telle est ressaisie de soi… Par l’interprétation, le sens, reconfiguré, permet au sujet de faire le lien entre le passé, le présent et l’avenir, c’est-à-dire d’affirmer son identité narrative et de pouvoir se poser comme un sujet capable de tenir ses promesses » (p 10). Ainsi, nous entendons la réflexion de Paul Ricoeur comme un aide « à mener une vie bonne dans un monde qui ne l’est pas » (p 11). C’est nous encourager à exister, à surmonter les crises, à poursuivre une action en personne responsable.
Paul Ricoeur adopte une ‘phénoménologie herméneutique’ qui se manifeste dans une approche constructive. Il s’oppose aux ‘herméneutes du soupçon’. « L’ambition de Paul Ricoeur est d’élaborer une philosophie rendant possible l’action d’un sujet soumis à la passivité… mais également capable d’initiatives… Si on ne rend pas justice à cette faculté qu’a l’être humain de se poser comme un sujet et de se reconnaitre dans ses actes, on ne peut plus parler de liberté et de responsabilité » (p 11). « Dans ‘Soi-même comme un autre’, les différents fils de son œuvre se rassemblent autour d’un motif central : bâtir une ontologie de l’agir qui donne du sens à l’action individuelle en dépit des épreuves et aide aussi à penser les conditions d’une revitalisation de l’espace politique sans laquelle les institutions démocratiques ne sont que des coquilles vides » (p 13).
La réflexion de Paul Ricoeur vient nous aider à être nous-même en traversant les crises et en éclairant notre travail de reconstruction. « Pour assumer sa parole et ses actes, être quelqu’un qui ne dit pas seulement « je », mais « me voici », il est indispensable de se penser comme moi, et non pas comme un moi quelconque. Continuer d’exister, se reconstituer après une dépression ayant provoqué l’effondrement du psychisme, rétablir de la cohérence dans une existence marquée par de nombreuses ruptures, penser sans illusion rétrospective que sa vie possède une unité malgré la discontinuité, redéfinir ses priorités, être disponible pour les autres et, de nouveau pouvoir s’engager parce que l’on croit à l’avenir : tel est le sens de l’herméneutique de soi que Paul Ricoeur parachève dans cet ouvrage dont la notion cardinale est celle d’attestation » (p 14).
Le sens d’une vie
Identité narrative et herméneutique de soi
A travers l’expression d’une histoire de vie, de ce récit, de cette narration, on découvre l’originalité, la singularité de sa personnalité, de son identité, ce qui se traduit en une interprétation, une herméneutique de soi.
« Parler d’identité narrative signifie d’abord que la connaissance de soi passe par le fait de se raconter, de tisser les différents évènements de sa vie pour leur conférer une unité et un sens qui n’est pas définitif et n’exclue pas la remise en question. L’identité n’est pas figée, ni à priori ; elle se transforme et se construit à travers les histoires que nous racontons sur nous-mêmes et sur les autres, et elle se nourrit des lectures et des interprétations qui enrichissent notre perception du monde et de nous. Plus précisément, l’identité narrative fait tenir ensemble les deux pôles dont la fiction littéraire présentant des cas-limites soulignent l’écart maximal. En effet, quand on parle de soi et qu’on veut se connaitre ou se faire connaitre à quelqu’un pour être compris de lui, on se raconte en mêlant des éléments reflétant à la fois son caractère (le ‘quoi’) et le maintien de soi, l’ipse (le ‘qui’). Or l’intérêt de la théorie narrative est de détailler les opérations mises en œuvre pour conjuguer l’unité et la diversité de sa vie » (p 120).
L’auteure met l’accent sur la tension entre unité et diversité au cours des vies. « Notre identité se construit par la manière dont nous agençons les évènements et les interprétons, en reconnaissant que certains s’inscrivent dans une certaine continuité avec ce que nous étions (idem), alors que d’autres nous ont poussé à remanier nos valeurs et à procéder à des changements importants de notre ipséité » (p 121) « Alors, la première opération que la théorie narrative met en avant est la configuration : le récit est un art de composition servant à faire le lien entre la concordance et la discordance. Se raconter, se connaitre, s’interpréter, c’est procéder à une synthèse de l’hétérogène… » (p 121).
Cette approche contribue non seulement à permettre à la personne de reconnaître la dynamique de sa vie, d’en bénéficier et, à la limite, de la partager, mais aussi de traverse des crises et d’en ressortir. « La notion d’unité narrative de la vie est essentielle si l’on veut saisir l’effort par lequel un individu tente de se reconstruire après une crise existentielle » (p 123). Dans une perspective qui débouche sur l’engagement de la personne, Paul Ricoeur en privilégie le ressort : une motivation enracinée dans l’histoire de vie : « Parce que l’identité narrative est une étape dans la construction de son concept d’attestation, Ricoeur privilégie la dimension de cohérence sur celle de discordance » (p 126). La crise peut déboucher sur un rebondissement. « Le sujet se rassemble après l’évènement ou les évènements l’ayant brisé. Bien plus, pour pouvoir répondre à l’appel des autres, il doit retrouver l’estime de soi ». (p 126). « Dans le projet d’ensemble de Paul Ricoeur, la notion d’unité narrative est un des éléments de son ontologie de l’agir, qui est une ontologie de l’homme capable, agissant et souffrant. Cette prise en compte de l’existant toujours situé dans un contexte social et géographique et qui a besoin, pour s’épanouir, de s’affirmer dans plusieurs domaines et d’être reconnu, le mène, pour introduire sa conception de l’unité narrative de la vie à distinguer des plans de vie, c’est-à-dire de vastes unités pratiques comme la vie professionnelle, familiale ou associative » (p 127)
La mise en œuvre d’une identité narrative n’est pas sans rencontrer des difficultés auxquelles l’auteure prête attention.
« Ne raconte-t-on pas uniquement ce qui a été métabolisé ou ce qui est métabolisable ? Jusqu’où et à quelles conditions faut-il accorder du crédit à la notion d’identité narrative, qui implique que le sujet appréhende l’unité de sa vie ? (p 123). Elle aborde aussi le cas des personnes atteintes de la maladie d’Alzeimer. En bref, « ces personnes ne se rappellent plus ce qu’elles ont fait et qui elles étaient… La capacité de rassembler sa vie en un tout est compromise par la maladie d’Alzeimer. L’enfermement dans le présent, caractéristique de cette pathologie, semble rendre la notion d’identité narrative totalement inopérante » (p 137) ; cependant, « il serait inexact de dire que la maladie d’Alzeimer prive la personne de son identité ». L’auteure aborde alors les modalités de son accompagnement.
Corine Pelluchon traite également des difficultés ressenties par les personnes ayant vécu une abomination. « Qu’il existe des narrations empêchées parce que le traumatisme n’est pas dicible, ou parce qu’en faire le récit serait s’infliger une peine supplémentaire puisqu’il ne serait pas reçu, souligne en creux l’importance de la narration. Celle-ci ne vise pas forcément à restaurer l’unité de vie, à rendre acceptable ce qui ne l’est pas ou à réparer l’irréparable. Toutefois, le témoignage peut donner un nouveau sens à la vie, comme on le voit dans l’œuvre de Semprun qui a beaucoup écrit, à partir des années 1960, sur la déportation » (p 135). Là, l’auteure souligne que la difficulté de s’exprimer dans une narration n’entame en rien ‘l’importance du récit dans l’existence’. Parfois, « la difficulté de vivre est aussi une difficulté de raconter et de se raconter… Pourtant, le récit existe. Même brisé, il ouvre le possible, puisqu’aucun récit ne clôt le sens, ne serait-ce que parce qu’il est lu par d’autres » (p 136).
Ainsi, Corine Pelluchon en arrive à affirmer le rôle essentiel du récit : « Le récit est un existential, une structure de l’existence. Notre identité est narrative, même si nous ne pouvons totalement nous rassembler et présenter une synthèse de l’hétérogène conférant une unité à notre existence et nous permettant de regarder l’avenir avec confiance. Dire que le récit est un existential signifie qu’il est nécessaire à la compréhension de soi et qu’il permet aussi de tenir bon, même quand il est différé et qu’il s’agit d’un récit qui parle de l’inénarrable ou met en scène la dissolution du soi… Le récit n’est pas seulement nécessaire sur le plan moral pour être un sujet responsable sachant quelles sont ses valeurs et ses priorités. Pour exister comme sujet, il faut pouvoir se raconter, même par bribes ou en confessant que l’on ne parvient pas à supprimer la déchirure » (p 136). L’auteure évoque également la psychanalyse : « Que la narration soit un existential apparait avec force quand on pense aux personnes qui reproduisent le refoulé sous la forme de symptômes et que la mise en récit de soi, comme la psychanalyse, peut aider (p 137).
L’approche narrative en médecine
Corine Pelluchon poursuit son étude de la mise en œuvre de la théorie narrative de Paul Ricoeur dans les champs de la médecine et de la politique.
L’apparition d’une médecine narrative s’inscrit dans un mouvement d’humanisation d’une profession tentée par une technicisation outrancière.
« Née aux Etats-Unis à la fin des années 1990 sous l’impulsion de Rita Sharon, professeur de médecine clinique à l’Université de Columbia, la médecine narrative, qui connait désormais un certain succès en France, répond à deux objectifs. Le premier est d’établir une relation entre médecins et patients qui soit fondée sur l’empathie et l’écoute attentive, afin que les traitements soient adaptés aux personnes et que le malade ne se sente pas objectivé. Le deuxième objectif de la médecine narrative est d’aider les soignants à réfléchir à leur métier, qui les confronte à la souffrance et à la mort, et à s’interroger sur le sens du soin en prenant en compte à la fois la souffrance des personnes et les contraintes économiques et relationnelles.
Bien que Rita Sharon ne se réfère pas à Ricoeur et que ceux qu’elle a inspiré connaissent souvent mal ce philosophe, la médecine narrative illustre ce qu’il écrit sur la narration et son herméneutique de soi éclaire même certains aspects de cette pratique » (p 141). L’auteure nous montre comment la médecine narrative rejoint l’approche de Paul Ricoeur. « La médecine narrative suppose en premier lieu de reconnaitre que les patients ont des histoires à raconter. Pour se connaitre et se faire connaitre à autrui, il faut se raconter, mettre en récit sa vie… Cet aspect est consonant avec la phénoménologie herméneutique de Ricoeur et avec son insistance sur le récit en première personne, qui découvre un sujet incarné et toujours situé… En termes ricoeuriens, on dira que la première compétence que la médecine narrative cherche à développer est la capacité de reconnaitre que le patient a besoin d’énoncer les symptômes motivant sa demande de soins, et de raconter une histoire lui permettant d’insérer l’épisode pathologique, qui est toujours vécu comme une rupture de l’unité – une discordance – dans une unité, une série d’évènements – une concordance. En mettant en intrigue les évènements de sa vie et en situant sa maladie à un certain moment de son existence, le récit aide le malade à reconfigurer le temps et à donner du sens à ce qui lui arrive » (p 142).
« La médecine narrative passe par un travail sur les textes des patients… Cette analyse doit aider le soignant à appréhender le désir du narrateur, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre de comprendre le sens que le patient donne à sa maladie. Cette manière de procéder évite de faire disparaitre le malade derrière sa maladie et de réduire celle-ci à sa dimension objective (disease) en négligeant sa dimension narrative (illness) » (p 143). Rita Sharon comme Paul Ricoeur critique le positivisme « Non seulement le vécu du malade ne doit pas être éclipsé par une ontologie de l’évènement, mais, de surcroit, la médecine elle-même est un art de l’interprétation… Le choix des traitements et l’accompagnement supposent de s’appuyer sur le vécu du malade et de chercher le sens global qu’il confère à sa maladie. Ainsi la médecine narrative rejoint-elle la phénoménologie herméneutique pour postuler un certain holisme de la compréhension » (p 144). La compétence narrative ne se borne pas à « reconnaitre les histoires des patients, mais aussi à les absorber, les interpréter et être émus par elles ». « Si les récits sont si éclairants, c’est parce que leurs auteurs ne relatent pas seulement des faits, mais décrivent leur vécu » (p 145). Si « le récit est lu au soignant qui va s’en servir comme d’un support pour élaborer avec le patient une démarche thérapeutique », il contribue également à ce que l’identité de la personne puisse se recomposer (p 146).
Cette approche se développe à l’encontre des dérives technicistes de la médecine. « Affirmer que la compétence première du soignant est une compétence narrative vise à répondre aux reproches adressés à la médecine contemporaine qui, en raison de sa haute technicité, tend à devenir impersonnelle et froide. Les contraintes économiques et l’organisation managériale de la santé aggravent ce phénomène. Le défaut d’écoute est compensé par l’inflation technologique et le soin est réduit à une protocolisation souvent déshumanisante (3). Pour briser ce cercle vicieux, la médecine narrative cherche à développer l’empathie, l’écoute attentive, et la capacité à comprendre les malades… Il s’agit de rééquilibrer le système de santé afin que la médecine, qui est une science et un art, et qui passe par la relation entre une équipe de soins et un sujet toujours singulier, soit plus juste et plus efficace » (p 142-143) (4).
Récit et politique
Corine Pelluchon aborde également le rôle du récit dans la constitution et l’entretien de l’identité d’une communauté politique. On se reportera à sa démonstration.
« En traitant des implications politiques du récit… Paul Ricoeur évoque Walter Benjamin qui, dans ‘Der erzähler’, publié en 1936, rappelle que l’art de raconter est ‘l’art d’échange des expériences’ et que celles-ci désignent, non l’observation scientifique, mais ‘l’exercice populaire de la sagesse pratique’. Ce texte, brièvement mentionné par Ricoeur est d’une grande pertinence quand on s’interroge sur le lien entre récit et politique » (p 153). Corine Pelluchon nous montre en quoi un manque de récit collectif pertinent engendre un désarroi politique : « Il y a un rapport étroit entre les crispations identitaires et l’impossibilité pour les individus de s’insérer dans un tissu d’expériences qui les précédent et les dépassent en les interprétant sans clore le sens. C’est pourquoi l’herméneutique est essentielle à la démocratie et contient la promesse d’une éthique interculturelle. Toutefois, avant de parler des conditions permettant à une communauté de construire un récit collectif qui ne s’apparente pas à une mystification et corresponde à une identité narrative, qui est par définition dynamique et ouverte aux influences étrangères, il importe d’insister sur une des affirmations principales de ‘Soi-même comme un autre’ : pour ‘rencontrer l’autre sans avoir peur de lui ni chercher à l’écraser, il faut savoir qui l’on est’. Pour ‘avoir en face de soi un autre que soi, il faut être un soi’ » (p 154).
N’en va-t-il pas de même collectivement ? Pour entrer pacifiquement en contact avec l’étranger, un peuple a besoin de se sentir lui-même.
« L’identité narrative implique l’ouverture à autrui comme aux autres cultures, mais cela exige que le noyau créateur d’un peuple qui renvoie aux images et symboles constituant un fonds culturel soit exploré et transmis » (p 154). C’est là aussi qu’une approche herméneutique, un travail d’interprétation et de réinterprétation est nécessaire. « Il ne s’agit pas de sacraliser un noyau éthico-mytique, mais de le soumettre à l’interprétation afin qu’une culture, prenant conscience d’elle-même, libère sa créativité. En l’absence d’un travail herméneutique visant à déchiffrer ces images et symboles qui forment ‘le rêve éveillé d’un groupe historique’, on ne peut rendre hommage à la diversité des cultures et s’y rapporter ‘autrement que par le choc de la conquête et de la domination’ » (p 153).
Cependant, nous dit Corine Pelluchon, l’âge moderne est marqué par le déclin du récit : manque de recul et manque de lien. On se reportera à son analyse inspirée par la réflexion de Walter Benjamin (p 156-159). Tout se tient. La reconnaissance des autres, la reconnaissance de l’étranger va de pair avec la connaissance de soi que ce livre présente en terme d’identité narrative.
« La connaissance de soi offre la capacité à aller vers l’autre, le travail sur les signes et les symboles de sa culture étant à la fois une condition de possibilité de l’accueil de l’autre et de l’hospitalité linguistique et leur conséquence » (p 161).
Voici une réflexion qui nous concerne. Comment nous percevons-nous ? Quel rapport entretenons-nous avec notre passé ? Et en quoi, le récit que nous pouvons en établir nous aide-t-il à déboucher sur un sens et sur un engagement ? Un autre philosophe, Charles Pépin envisage notre rapport avec le passé dans un livre : « Vivre avec son passé. Aller de l’avant » (5) Ainsi écrit-il :
« La question de l’identité personnelle est un des problèmes philosophiques les plus passionnants…. Qu’est-ce qui nous définit en tant qu’individu singulier, nous distingue de tout autre ? Qu’est-ce qui demeure en nous de manière permanente et constitue ainsi le socle de notre identité ? … Si nous nous interrogeons en ce sens, nous sentons bien combien nous pensons notre être, notre personnalité à travers notre histoire personnelle ». Charles Pépin interroge à ce sujet d’autres philosophes, des écrivains. Nous retrouvons là la pensée éclairante de Bergson (6). Ainsi Bergson écrit : « Dans une conférence donnée à Madrid, Henri Bergson synthétise cette idée de ressaisir notre passé pour nous projeter dans l’avenir sous le concept de récapitulation créatrice ». Et, pour notre part, nous aimons la manière dont il envisage un élan vital : « L’élan vital se particularise en chacun de nous… Notre personnalité est plus que la condensation de l’histoire que nous avons vécue depuis notre naissance… Elle est notre identité, mais propulsée vers l’avant, traversée par cette force de vie qui nous pousse à agir, à créer. »
Si nous revenons à la théorie narrative de Paul Ricoeur, à travers le livre de Corine Pelluchon, nous découvrons combien elle est féconde dans un champ très vaste de l’identité personnelle envisagée sous la forme d’identité narrative jusqu’à la médecine et la politique. Voici une approche à même d’éclairer les histoires de vie dont la rédaction s’est multipliée dans les dernières décennies. C’est aussi un apport pour considérer les reconfigurations qui apparaissent dans les témoignages qui abondent aujourd’hui dans le registre chrétien.
J H
- Les lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/des-lumieres-a-lage-du-vivant/
- Corinne Pelluchon. Paul Ricoeur, philosophe de la reconstruction. Soin, attestation, justice. PUF, 2022
- Pistes de résistance face à la montée d’une technocratie deshumanisante : https://vivreetesperer.com/pistes-de-resistance-face-a-la-montee-dune-technocratie-deshumanisante/
- Le soin est un humanisme : https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/
- Mieux vivre avec son passé : https://vivreetesperer.com/mieux-vivre-avec-son-passe/
- Bergson, notre contemporain : https://vivreetesperer.com/comment-en-son-temps-le-philosophe-henri-bergson-a-repondu-a-nos-questions-actuelles/
par | Sep 11, 2013 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
Les échos d’un groupe de partage
#
Contribution de Valérie Bitz
#
Valérie Bitz a participé récemment à une session sur le thème de la transcendance. Au cours d’une conversation, nous avons recueilli ses observations et ses réflexions au sujet de ce qui s’est dit dans ce groupe de partage.
Mais qu’est ce qu’une expérience de transcendance ? « A certains moments, on sent que quelque chose nous dépasse. Cela passe par un ressenti, mais c’est un ressenti que l’on peut déchiffrer.
Une caractéristique de cette expérience : on la vit, et, en même temps, on sent que cela vient de plus grand que nous ».
Valérie nous donne des exemples de ces expériences :
« Ainsi, se sentir porté par un amour plus grand que celui qui pourrait m’être donné par mes propres forces…. Des personnes qui ont un sens fort de la justice, de la dignité humaine, peuvent ressentir que ces mouvements intérieurs ne sont pas uniquement de leur ressort, mais qu’ils viennent de bien au delà d’eux-mêmes…. En regard de la beauté et de la grandeur d’un paysage, éventuellement d’une œuvre d’art, certaines personnes éprouvent soudainement une émotion esthétique qui les dépasse…
#
Dans ces formes d’expérience, il y a au départ des sentiments que nous connaissons, mais, à ces moments là, nous sentons qu’ils nous dépassent ».
Valérie distingue un deuxième groupe d’expériences où le sentiment d’une présence apparaît : « D’autre formes d’expérience sont accompagnées par le sentiment d’une présence. Cette présence est ressentie comme bienveillante . Elle invite parfois à une relation… Dans d’autres cas, en fonction de leur culture, les gens pensent pouvoir identifier cette présence : Dieu, l’Esprit, Jésus… Pour d’autres encore, elles évoquent une relation avec cette présence ».
#
Mais quels sont les effets de ces différentes expériences ?
« Les gens découvrent une profondeur en eux-mêmes… Aller plus profond en eux-mêmes que ce qu’ils connaissaient d’eux-mêmes….
Les gens découvrent leur être profond. Et, dans ce registre, ils découvrent leurs aspirations essentielles…
On se rend compte de la profondeur de la vie… On prend conscience que nos existences s’inscrivent dans une dimension plus large. Cette expérience suscite de nouvelles orientations de vie.
Certaines expériences produisent une unification, une harmonisation de la pensée de la sensibilité, du ressenti corporel, de tout l’être.
Dans les expériences comprenant le ressenti d’une présence, on constate l’apparition et le développement d’une confiance, et, pour certains, le sentiment d’être aimé, soutenu… »
Les gens ne rencontrent-ils pas parfois aussi des difficultés ?
« On note également des obstacles, des résistances par rapport à ces expériences :
Ne pas repérer certaines expériences parce qu’on recherche quelque chose d’extraordinaire ou de sensationnel.
Avoir peur de perdre le contrôle parce qu’il y a une crainte de perdre sa liberté.
Etre soumis au diktat d’une pensée qui ne permet même pas d’envisager que des expériences de ce type soient possibles ; ou encore croire que ces expériences sont réservées à un petit nombre de personnes ».
« Bien sûr, toutes ces expériences ont été vécues en dehors de la session. La session est le lieu où elle peuvent être réévoquées et déchiffrées. Dans le déchiffrage d’une expérience de transcendance, il y a, à la fois, l’expression du vécu de l’expérience et un constat de l’impact de celle-ci sur la personne et sur sa vie ».
« Cette session s’inspirait d’une recherche en cours à PRH (Personnalité et Relations Humaine) : l’être de la personne est le lieu de son identité, de son agir et de son engagement, des relations en rapport avec cette action. C’est encore le lieu de l’ouverture à la transcendance. C’est au niveau de l’être que la transcendance peut se vivre et c’est là qu’on peut s’y rendre attentif. Il s’agit d’y prêter attention, de l’identifier et de s’y ouvrir ».
#
Propos recueillis auprès de Valérie Bitz.
#
Pour prendre contact : valerie.bitz.art@orange.fr
Tél : 03 89 76 73 62
#
Autres contributions de Valérie Bitz sur ce blog :
« Et si je tentais d’exprimer ce que je ressens par la peinture ou le graphisme pour y voir plus clair » https://vivreetesperer.com/?p=1428
« Apprendre à écouter son monde intérieur et à la déchiffrer. Pourquoi ? Pour qui ? » https://vivreetesperer.com/?p=959
« Exprimer ce qu’il y a de plus profond en moi » https://vivreetesperer.com/?p=501
Sur un thème voisin, on pourra également consulter :
« Reconnaître la présence de Dieu à travers l’expérience »
https://vivreetesperer.com/?p=1008
« Expériences de plénitude »
https://vivreetesperer.com/?p=231
par jean | Jan 15, 2020 | ARTICLES, Beauté et émerveillement, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
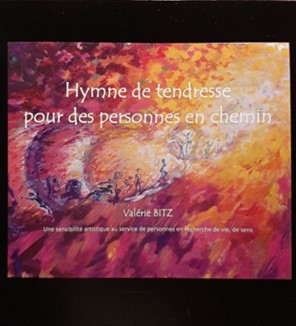 Un recueil d’œuvres peintes par Valérie Bitz
Un recueil d’œuvres peintes par Valérie Bitz
Valérie nous partage son expérience.
« Un désir est à la source de ce recueil : Rendre hommage à notre humanité chercheuse de chemins de vie !
Rejoindre les personnes qui se reconnaissent dans cette pâte humaine…. désireuses d’avancer !
Toucher notre sensibilité profonde, là même où elle conduit vers le cœur de soi, cet intime foyer vivant en chacun, où il pourra puiser!
A la genèse de ces œuvres, une fulgurance qui vous traverse, vous éblouit et en un instant, vous ouvre un chemin devant vous. Là, c’était le déclic suivant : Je suis de cette humanité qui marche, peine, erre, se relève,
en même temps que j’ai beaucoup reçu, de bien des personnes, de groupes et de milieux !
Je réalise alors que quelque chose en moi coule, se donne, déborde, pour d’autres! Vais-je retenir ou laisser circuler?
Ainsi est née la première peinture: «Je suis dans une chaine d’humanité».
D’autres suivront : plusieurs hommes, un à un, grandeur nature presque, par besoin de leur rendre leur dignité.
Qui voudra passer le relais ?
Hymne de tendresse pour des personnes en chemin
Il y a des textes, des poèmes, comme une proposition de voix et de vécus multiples.
Les peintures sont en craies de cire et acrylique, 100×50 cm
recueil disponible : 10€ + 2e si envoi postal
Valérie est peintre et accompagnatrice de vie.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter directement : Valerie Bitz, 06 89 06 77 10 – valerie.bitz.art@orange.fr
Articles de Valérie sur ce blog
Exprimer ce qu’il y a de plus profond en moi
https://vivreetesperer.com/exprimer-ce-qu’il-y-a-de-plus-profond-en-moi/
Des expériences de transcendance, cela peut s’explorer
https://vivreetesperer.com/des-experience-de-transcendance-cela-peut-sexplorer/
Apprendre à écouter son monde intérieur et à le déchiffrer. Pourquoi ? Pour qui ? https://vivreetesperer.com/apprendre-a-ecouter-son-monde-interieur-et-a-le-dechiffrer-pour-quoi-pour-qui/
Au cœur de nous, il y a un espace
https://vivreetesperer.com/au-coeur-de-nous-il-y-a-un-espace/
Le cadeau d’une intuition
https://vivreetesperer.com/le-cadeau-dune-intuition/
par jean | Jan 22, 2017 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |
A la demande de sa grand-mère (1), à dix ans, Manon Aurenche nous communique ses observations sur l’école anglaise dans laquelle elle vient d’entrer. Comment ne pas être admiratif devant ses qualités d’observation, de réflexion, d’expression !

Et il y bien une impression qui ressort : cette école publique municipale d’un quartier populaire de Londres, avec une population en majorité originaire du Pakistan ou du Bangladesh, la « Carlton school », est une école où on vit en relation. On peut s’y exprimer librement. La convivialité est active et encouragée. La diversité est reconnue. La condition, c’est le respect de l’autre. La caractéristique, c’est un climat de confiance.
Manon note :
« L’ambiance anglaise est très différente, car on a le droit de se lever et de parler pour discuter du travail en cours ».
« La maîtresse est tout le temps positive, très attentive aux problèmes des enfants et elle explique très bien ».
« On a, de temps en temps, des réunions de classe pour parler d’un thème, en particulier comme l’amitié ou : c’est quoi une bonne relation ? ».
« « La Rainbow Room (la salle Arc en Ciel) sert à calmer les enfants et à les faire s’expliquer en racontant chacun (e) leur vision du problème. Puis ils demandent à des enfants témoins de donner leur avis… ».
« A l’école, il y a des assemblées (assembly », c’est à dire des moments où toute l’école est réunie. Elles sont différentes à chaque fois. Par exemple, il y en a sur le chant dans lesquelles on chante. Une autre fois, sur le thème du harcèlement… »
Quand un enfant peut ainsi être reconnu, s’exprimer, participer, vivre en bonne entente, il peut être heureux. « J’aime beaucoup mon école anglaise », écrit Manon. « Elle et géniale ».
Depuis des décennies, le courant de l’éducation nouvelle œuvre pour promouvoir une école où l’on puisse apprendre dans un climat de confiance, de partage et d’entraide (2). Cette éducation est fondée sur des valeurs. Celles-ci sont inégalement actives dans les différentes sociétés, et parfois on doit avancer à contre-courant.
L’école anglaise, fréquentée par Manon, n’est pas, en soi, une « école nouvelle » . C’est une école publique d’un quartier populaire de Londres, mais elle participe à la même approche. Les cultures nationales sont différentes (3), mais, en France, de plus en plus de parents désirent que leurs enfants puissent apprendre dans une ambiance conviviale et créative. (4).
Bref, du bonheur à l’école. Ce témoignage tout simple de Manon nous dit : Oui, c’est possible !
J H
(1) Merci à Blandine Aurenche. Bibliothécaire, Blandine Aurenche a publié un article sur ce blog : « Susciter un climat de convivialité et de partage » : https://vivreetesperer.com/?p=1542
(2) « Et si nous éduquions nos enfants à la joie. Pour un printemps de l’éducation » : https://vivreetesperer.com/?p=1872 « Pour une éducation nouvelle, vague après vague » : https://vivreetesperer.com/?p=2497
(3) En France, « Promouvoir la confiance dans une société de défiance » : https://vivreetesperer.com/?p=1306 Dans certains pays, l’enseignement public a muté vers une approche conviviale et créative. C’est le cas en Finlande comme l’expose « le film : Demain » : https://vivreetesperer.com/?p=2422
(4) Ce désir des parents s’expriment par exemple dans le développement rapide des écoles Montessori en France.
Manon à l’école anglaise
Je m’appelle Manon, j’ai 10 ans. J’ai déménagé à Londres en septembre avec ma famille. Je suis à l’école Anglaise de mon quartier. L’école Anglaise est assez différente de l’école Française dans son organisation et pour plein d’autres choses encore…
L’ambiance en classe est très différente car on a le droit de se lever et de parler pour discuter du travail en cours. De plus, si on n’y arrive vraiment pas on peut aller au bureau de la maîtresse et elle vient à notre table, elle nous aide et nous écoute pour voir ce que l’on a compris et regarde sur quoi nous bloquons. En Angleterre, les enfants sont plus attentifs car ils décident de leurs propres règles de classe, tout en respectant celles de l’école qui sont les mêmes pour toutes les classes. Bon, on doit quand même souvent se mettre en ligne sans parler. Pour le silence, il y a un signal : la maîtresse lève la main en l’air et tape 3 tape trois fois dans les mains et tous les enfants répètent après elle. La politesse est aussi très importante.
Ma maîtresse s’appelle Tina, elle a les cheveux violet/rose. Ma prof de sport s’appelle Sharon, elle a plein de tatouages et de piercings. Tout ça pour vous dire qu’à Londres le style n’a pas d’importance ! Nous, par contre, nous sommes tous en uniformes. Contrairement à la France, certaines filles musulmanes portent le voile.
Mais revenons à ma maîtresse ! Je sais qu’elle est allemande car elle m’a dit qu’elle aussi était arrivée à 14 ans en Angleterre sans savoir parler anglais. Elle est tout le temps positive, très attentive aux problèmes des enfants et elle explique très bien. Les maîtresses ne sont PAS SEULES dans la classe, elles ont des aides (Teacher Assistants) pour certains élèves qui ont besoin d’une aide vraiment spéciale et d’autres pour le reste de la classe. Donc, dans ma classe, il y a parfois 5 personnes en plus de la maîtresse ! On a de temps en temps des réunions de classe pour parler d’un thème en particulier comme « l’amitié ou c’est quoi une bonne relation ? ». Et puis, on peut comme cela travailler souvent en petits groupes !
Pour régler les problèmes dans la cour, les Teacher Assistants envoient les enfants dans une salle qui s’appelle la Rainbow Room (la salle arc-en-ciel). C’est une salle qui sert à calmer les enfants et les faire s’expliquer en racontant chacun(e) leur version du problème. Puis ils demandent à des enfants témoins de donner leur avis. Le problème est vite réglé. Ceux qui se sont mal comportés comprennent pourquoi car on leur explique et les autres sont contents d’être écoutés.
A l’école, il y a des assemblées (Assembly) c’est à dire des moments où toute l’école est réunie dans une même salle. Elles sont différentes à chaque fois. Par exemple, il y en a sur le chant dans lesquelles on chante… Une autre fois sur le thème du harcèlement. Elles servent aussi à célébrer les Goldens Stars tous les vendredi. Les Goldens Stars sont les élèves de la semaine qui sont récompensés car ils ont bien travaillé ou qu’ils se sont bien comportés en classe. Les assemblées apprennent aux enfants à prendre la parole en public mais c’est très impressionnant quand on ne parle pas encore anglais !
On commence l’école à 8H45 et on fini à 15H30 tous les jours même le mercredi et on a moins de vacances MALHEUREUSEMENT ! Mais ce qui est super c’est qu’après l’école on peut rester pour faire des afterschools : coding club, musique (j’ai pu commencer la guitare et jouer devant toute l’école à la fête de Noël), football, netball, mandarin, science, cours de cuisine en famille, art, girl’s sport, piscine, etc…
Bref, même si mes copines de France me manquent beaucoup et que je suis pressée de parler Anglais, j’aime beaucoup mon école anglaise, elle est géniale !
Manon Aurenche
Janvier 2017
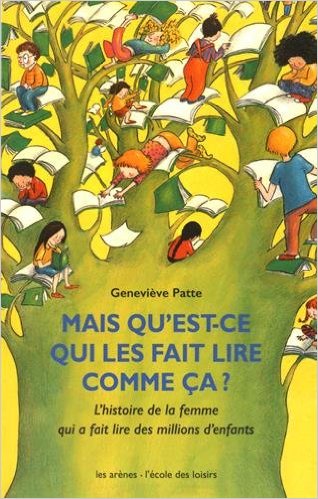 « Mais qu’est ce qui les fait lire comme ça ? ». Oui, il y a bien chez les enfants une puissance de vie qui s’exprime en terme d’exploration, de découverte et d’émerveillement. Et c’est pourquoi on doit tout simplement faciliter ce mouvement, laisser passer et encourager ce courant de vie. « Laissez les lire ! » (1) nous disait Geneviève Patte à travers le titre d’un livre précédent. Et, dans celui-ci, elle réitère ce message : « Mais qu’est-ce qui les fait lire comme ça ? » (2).
« Mais qu’est ce qui les fait lire comme ça ? ». Oui, il y a bien chez les enfants une puissance de vie qui s’exprime en terme d’exploration, de découverte et d’émerveillement. Et c’est pourquoi on doit tout simplement faciliter ce mouvement, laisser passer et encourager ce courant de vie. « Laissez les lire ! » (1) nous disait Geneviève Patte à travers le titre d’un livre précédent. Et, dans celui-ci, elle réitère ce message : « Mais qu’est-ce qui les fait lire comme ça ? » (2).