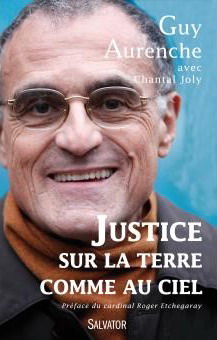Coach pour une vie en rebondissement : L’hypnose comme un outil thérapeutique
Interview de Béatrice Ginguay
Béatrice, depuis plusieurs années, tu t’es engagée professionnellement vers un accompagnement en tant que coach. Peux-tu nous rappeler ton passage de cadre infirmier à la profession de coach (1) ?
Après avoir exercé 30 ans, dont 20 en tant que cadre Infirmier, dans le secteur sanitaire (hospitalier, extra-hospitalier) et médico-social, j’ai éprouvé le besoin d’établir des relations plus proches et plus personnalisées avec les personnes accueillies.
En effet, l’évolution de la situation dans les institutions de Santé et notamment du contexte hospitalier, ne correspondait plus à ce que je souhaitais vivre au niveau humain et ne me permettait plus un exercice professionnel en accord avec mes valeurs de respect, de qualité, d’écoute, d’accompagnement…
J’ai donc suivi une formation afin de me réorienter vers le Coaching. Puis j’ai pris la difficile décision de « lâcher » la sécurité « salariée » pour une réorientation professionnelle : m’établir en libéral et mettre à profit mes expériences personnelles et professionnelles.
Mon cœur de métier et mon parcours professionnel me permettent d’accompagner les personnes confrontées à des accidents de la vie : situations de Handicap, graves maladies, maladie d’Alzheimer, burn out…
De plus, ayant expérimenté personnellement les bienfaits des contacts avec l’animal, et ayant suivi une double formation de thérapie par le biais du cheval et du chien, c’est donc tout naturellement que je propose pour ceux qui le désirent que les séances de coaching puissent se dérouler avec Médiation Animale (2).
En fonction de tes compétences, tu as choisi d’orienter ta fonction de coach vers un accompagnement aux personnes en difficulté, en recherche d’un second souffle, d’un rebondissement. Peux-tu décrire ton expérience ?
En effet, parfois le tourbillon des événements nous blesse profondément et nous entraîne, malgré nous, au fond du trou. Il est alors difficile de se ressaisir, de relever la tête. Nous avons alors souvent besoin d’une main tendue, d’un coup de pouce.
Ma certitude absolue est que nous avons TOUS, au fond de nous, une pulsion de vie qui parfois baisse en intensité, mais qui jamais ne s’éteint.
En tant que professionnelle, il m’appartient de créer ce lien, de redonner confiance à la personne, et de l’accompagner pour retrouver foi en Sa propre Force.
Le nom de REBONDIR m’est venu en voyant des enfants jouer et sauter sur un trampoline. S’ils restent statiques, aucun mouvement ne se produit. En revanche, une chute engendre un système de réaction physique qui le fait, à un moment donné, rebondir.
Et si vraiment la personne reste allongée sur le trampoline sans pouvoir se relever, le mouvement, impulsé par une tierce personne à côté d’elle, suffit à remettre en mouvement ce mécanisme physique de rebond, dont va pouvoir bénéficier la personne qui jusque-là était « inerte » par épuisement.
Cette observation illustre pour moi le mouvement interne à chaque individu, ainsi que l’aide potentielle apportée par le professionnel.
Une fois « remise sur pied », la personne a, comme face à toute difficulté, un choix à faire :
- l’abandon – la capitulation,
- ou bien la résistance et l’engagement par l’action.
La première option peut sembler la voie la plus facile. Néanmoins, elle conduit souvent, à plus ou moins long terme, à une sorte de Mort.
La deuxième option, si elle est plus difficile à court terme, ouvre vers la Vie.
L’impasse dans laquelle nous avons parfois l’impression de nous trouver, vient en partie de notre propre perception.
Un regard extérieur, un accompagnement permet alors de sortir la tête de l’eau, et de percevoir cet entrefilet de lumière, qui pourtant existait bien, mais qu’on ne voyait plus, empêchés par nos larmes de honte, de désespoir, de rage… ., ou notre état de sidération.
Alors, n’hésitons plus ! Il nous faut demander de l’aide.
Que le problème soit matériel, organisationnel, affectif, relatif à la santé…., nos émotions prennent parfois le dessus, nous rendant aveugle à toute issue potentielle, nous laissant penser que plus rien n’est possible.
En réalité, mes différentes formations me permettent de proposer trois approches possibles pour pouvoir REBONDIR :
- par un accompagnement en Coaching, en revisitant votre passé, en trouvant vos forces profondes qui vous permettront de poser des objectifs et de vous projeter dans le futur, et d’avancer, un pas après l’autre,
- grâce à la Médiation Animale, en vous remplissant « d’Ici et Maintenant », en reprenant confiance en vous grâce à l’acceptation inconditionnelle de mes chiens, à leur témoignage débordant de sympathie. Il est parfois, en fonction de notre passé, plus facile de mettre sa confiance, dans un premier temps, dans les animaux que dans les humains.
- en découvrant, grâce à l’Hypnothérapie, la source profonde des freins et des blocages qui nous poursuivent.
C’est alors que ce filet, de manière certaine, va aller en grandissant, au fur et à mesure que nous avançons.
Justement, tu as suivi récemment une formation en hypnose devenir hypno-thérapeute. Pourquoi as-tu choisi cet outil parmi les autres disponibles aujourd’hui ?
Mon expérience de coach m’a permis de constater que lorsque nous sommes accompagnés en coaching, ou même lorsque suivons une thérapie, le matériel avec lequel et sur lequel nous travaillons, ce que nous apportons, « se limite » à ce dont nous avons conscience.
Il s’agit de nos souvenirs, notre expérience professionnelle, personnelle, nos difficultés ou richesses actuelles… Tout ceci est très riche. Néanmoins, cela ne constitue qu’une partie de nous-même.
Notre psychisme est constitué de notre conscient (ce dont nous avons conscience), et de notre inconscient.
Je vais me permettre une comparaison avec un ordinateur :
- notre conscient, c’est l’ensemble des dossiers qui sont sur le bureau, c’est-à-dire, ce qui est à portée de main de façon immédiate, à portée de vue et de mémoire.
- notre inconscient, correspond au disque dur de l’ordinateur. Aucune de nos manipulations effectuées sur l’ordinateur, aucune recherche internet … rien ne lui échappe. Le disque dur de l’ordinateur garde une trace de tout, absolument tout ! C’est ce que fait notre inconscient : il garde une trace de chaque événement de notre vie, de nos émotions, y compris de notre vécu in utéro.
J’ai donc éprouvé le besoin de me former à un outil que je pourrais proposer, outil qui permette à la personne d’accéder à cette partie d’elle-même qui renferme tant d’informations, dont certaines sont les origines et sources profondes de nos malaises, blocages….à savoir notre inconscient.
L’hypnose n’est pas uniquement un outil de remémoration, de prise de conscience. L’hypnose permet également de guérir, de réparer.
Sur le marché des soins, nous disposons de nombreux outils pour accompagner les patients/clients dans le besoin. Certains professionnels optent pour se former en sophrologie, kinésiologie, shiatsu, EMDR, etc …. L’éventail disponible en est large.
Chaque outil peut être plus spécifiquement indiqué pour telle ou telle situation.
Certaines de ces méthodes proposent préférentiellement une approche corporelle, psychocorporelle, psycho neurobiologique, etc …
En tant que professionnels, il nous faut faire un choix, ou en tous les cas, prioriser nos choix de formations, car elles ont un coût, au niveau financier et temporel.
J’ai donc opté pour l’hypno-thérapie. Outre l’outil en lui-même, qui permet d’accéder à notre inconscient, de revivre des situations enfouies…, j’ai été convaincue par la qualité des formateurs, leur exigence éthique, et l’orientation spécifique dans la prise en charge des psycho-traumatismes.
Je ne prétends pas que l’hypnose soit le seul outil possible, valable, efficace. Il est celui que je peux offrir aujourd’hui, et avec lequel je suis en parfait accord.
Il est, à mon sens, fondamental que le thérapeute se sente en cohérence avec l’outil qu’il propose à ses patients/clients, qu’il soit à l’aise avec la méthode utilisée et qu’elle ne s’entrechoque pas avec ses valeurs. Faute de quoi, le thérapeute ne pourra pas se l’approprier parfaitement, et risque de vivre une discordance qui nuira au patient/client.
Peux-tu nous expliquer ce qu’est l’hypnose ? Quelle pratique en as-tu choisi ?
La terminologie exacte lorsqu’on parle d’hypnose, c’est de parler « d’état de transe ». Il s’agit du terme technique exact. Pour ma part, je préfère utiliser le terme d’« état hypnotique ».
En effet, la notion de transe, dans certains milieux culturels, peut être connotée : transe convulsive, chamanique, de possession …… Or l’état dans lequel nous nous trouvons en hypnose, lorsqu’elle est menée par un professionnel qualifié, n’est en rien semblable avec cela.
Avant toute chose, il est important de préciser que « l’état hypnotique » est un phénomène « naturel ». Nous passons tous, à certains moments, par de tels états sans en avoir conscience. Simplement, cela se produit de manière plus superficielle, et sur une durée plus courte.
Dans notre cas d’hypno-thérapie, il s’agit d’aider la personne à être dans un état hypnotique plus profond et sur une durée plus longue.
Le but est de permettre un état de dissociation qui donne, à la personne, accès à son inconscient. Si je veux prendre une image, c’est un petit peu comme une poupée russe. La poupée extérieure représente notre conscient. L’état hypnotique permet de faire coulisser le chapeau/ couvercle de la poupée extérieure, et ainsi d’avoir accès à la poupée plus interne qui représenterait notre inconscient.
Pour ma part, professionnelle de santé, je me suis formée à l’hypnose éricksonienne.
Le client/patient peut choisir de se laisser conduire par son inconscient, sans but précis.
Cependant la plupart des cas, le client /patient consulte par rapport à un objectif très précis. Nous travaillons donc à cet objectif, avant de démarrer l’hypnose à proprement parlé.
Les objectifs peuvent être très variés : vouloir « arrêter de fumer », « perdre du poids », « lever des freins, des peurs », « se sentir mieux », « réparer un dommage corporel » ….
L’objectif peut-être d’ordre physique, psychique, émotionnel…
Ma formation me permet également de traiter les psycho-traumatismes. Dans certains cas, le client/patient n’en a même plus le souvenir. Et pourtant, c’est bien ce trauma enfoui qui est la cause de bon nombre des difficultés de sa vie actuelle. Il le découvrira au fur et à mesure des séances.
L’état hypnotique permet des phénomènes de régression, nous retrouver enfant, bébé. Nous pouvons revivre des situations « in utéro ».
Il est important de se rappeler que l’inconscient est toujours BIENVEILLANT. L’absence de souvenir d’un événement que notre entourage peut nous relater comme ayant été traumatisant, est l’œuvre « bienveillante » de notre inconscient qui a voulu nous protéger au moment « t » de cet événement. La réminiscence en travail d’hypnose se fera au fur et à mesure de nos capacités émotionnelles à gérer cela.
Comme Paul l’écrit dans l’une de ses lettres (l’épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13), « Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. », notre inconscient ne fera pas remonter au niveau de notre conscience un événement, une situation… si nous ne sommes pas à même de les supporter ou de les gérer. Il agira de manière fragmentée, jusqu’à la reconstitution du puzzle.
Dans le contexte d’un « état de conscience modifié », l’hypno-thérapie ne présente-t-il pas un danger d’assujettissement ou celui de l’intrusion de pensées négatives ? ou de résurgence de pensées négatives ? Quelle est l’éthique apportée dans ta formation en hypnose ?
Pour ma part, j’ai été formée par des hypno-thérapeutes, professionnels de santé (médecin généraliste et psychomotricienne), enseignants en université (faculté de médecine).
Les participants à cette formation ont été sélectionnés : nous étions tous des professionnels de santé.
Tout ceci constituait un « cadre » qui était pour moi un gage de sérieux et une garantie que cette formation s’inscrivait dans une perspective éthique, de grand respect du patient accompagné.
L’accompagnement par le thérapeute se fait de manière respectueuse, au rythme du patient. Cet accompagnement se déroule dans un climat bienveillant, soutenant, inconditionnellement positif.
En situation ordinaire, nous avons le sentiment de penser par nous-même, d’analyser, de faire des choix et agir suite à nos réflexions, à notre conscience. En réalité, notre inconscient a un impact certain sur notre vie, nos pensées, nos actions…. sans que nous n’en ayons pleinement conscience.
C’est la raison pour laquelle, il me semblait important de pouvoir proposer à mes clients/patients cet accompagnement, afin de trouver l’origine de leurs freins, de leurs peurs…
En « état hypnotique, de par la dissociation entre notre conscient et notre inconscient (explicitée précédemment), notre inconscient devient plus accessible, et fait « remonter à la surface », au niveau de notre conscience, des souvenirs, des émotions, des sensations oubliées et enfouies, parfois très loin. Rappelons que notre inconscient avait agi comme cela pour nous protéger.
Lorsque je parle de mon activité professionnelle, j’entends beaucoup de crainte, de questions à propos de l’hypnose. Je vais en évoquer quelques-unes, des plus fréquentes.
1 : « Moi je ne peux pas rentrer en hypnose…. ». « et si je n’arrivais pas à rentrer dans cet état ? ». Et bien, on ne peut pas le savoir sans avoir essayé. Et si cet outil qu’est l’hypnose ne vous convient pas, dans ce cas, vous pourrez toujours vous orienter vers une autre approche de soin.
2 : « Je ne suis plus tout à fait moi-même, donc on risque de me faire faire des choses que je ne voudrais pas…. ».
Cette crainte est légitime. Elle prend racine dans une représentation répandue par « l’hypnose spectacle ». Dans ces situations en effet, la personne est « soumise » à l’hypnotiseur, elle est sous son emprise, faisant des choses sous les ordres de « l’hypnotiseur », choses qu’elle ne ferait pas d’elle-même. Il s’agit d’une forme de manipulation
Et ce qui est en cause dans cette situation-là, ce n’est pas l’hypnose, mais la personne qui l’utilise. Ne nous trompons pas d’adversaire.
Moi je parle de SOIN, non de spectacle. L’hypnose que je pratique est un outil thérapeutique, utilisé à des fins thérapeutiques, donc pour améliorer une situation dont le client/patient est acteur, dont il souffre, et pour lequel il désire un changement.
Nous travaillons à partir d’un objectif précis, défini par le client/patient, par lui-même, pour lui-même. C’est lui qui va mettre cela au travail.
L’hypno-thérapie n’a donc rien à voir avec cette « hypnose spectacle », même si elle utilise le même outil. Pour prendre une image, l’outil seringue peut servir à soigner, à se droguer ou à tuer. Faut-il pour autant bannir les seringues ?
L’hypno-thérapie s’inscrit dans un objectif de THERAPIE. Il est donc effectivement fondamental de s’assurer de l’éthique de la personne que nous consultons.
3 : « et si je découvrais des choses épouvantables » : si nous avons une douleur abdominale qui ne cède pas à un traitement médicamenteux, nous pouvons craindre les résultats révélés des examens complémentaires (radio, scanner …).Et pourtant, ils sont nécessaires pour investiguer et aller sur le chemin de la guérison.
Il en est de même en hypnose. Notre mal-être, nos problématiques… peuvent nous handicaper, rendre notre vie terriblement difficile. Si nous n’allons pas à la source, là où tout est inscrit, nous laissons alors passer une chance d’amélioration, voire de guérison.
Si certains événements ont été « enfouis » bien malgré nous au niveau de notre inconscient, il s’agit d’un mécanisme de PROTECTION induit par notre inconscient : certaines choses sont trop douloureuses pour rester au niveau de notre conscience. Il faut alors les mettre sous le tapis. Mais arrive un moment, où elles parasitent bon nombre de nos pensées et actions. Et il faut y travailler.
Une des autres caractéristiques de l’inconscient, c’est qu’il est toujours BIENVEILLANT :
il ne fera remonter au niveau de notre conscience que ce que nous sommes en état de gérer et de supporter. Par exemple, un traumatisme grave ne « resurgira » pas comme cela, comme si on ouvrait une boite renfermant un petit diablotin monté sur ressort.
Notre inconscient le fera alors, petit à petit, en fonction de notre capacité à gérer les souvenirs enfouis. Cela peut se faire en plusieurs séances, sur plusieurs semaines.
De plus, il ne suffit pas d’avoir ramené à notre conscience certains épisodes plus ou moins douloureux. Cela serait inutile, voire difficilement supportable s’il n’y avait pas de possibilité de traitement, de guérison.
Or par l’hypnose, nous pouvons guérir ces événements, ces relations, ces traumatismes.
4 : « j’ai peur de ne plus être moi-même après une séance, que le thérapeute ait changé des choses en moi … ». En hypnose thérapeutique éricksonnienne, c’est le client/patient qui travaille. En tant que thérapeute, je l’accompagne dans son travail personnel. C’est son inconscient qui travaille. Ce n’est pas moi, thérapeute, qui impulse mes idées, mes pensées. Mon rôle est un rôle d’accompagnateur soutenant. L’évolution du client/patient viendra de ses profondeurs à lui, pour un mieux. C’est sa véritable identité qui se révèlera.
5 : « je refuse de consulter un thérapeute car je ne veux pas étaler ma vie, mes problèmes… Je n’ose pas / je ne sais pas parler de moi…. Je suis coincé dans mon corps …. Je ne veux pas qu’on me touche …». Alors l’hypno-thérapie est une bonne orientation. Il s’agit d’une thérapie « non corporelle », « non verbale ». Personne ne vous touchera. Vous ne serez pas tenu de « vous raconter », de parler, de vous dévoiler…. ni pendant, ni à la fin de la séance. C’est un travail entre vous et vous. Pendant la séance, vous vivrez votre présent, votre passé. Et en fin de séance, libre à vous de parler de ce que vous venez de vivre, … ou pas… . Vous pourrez l’évoquer lors de la séance suivante … ou pas.
Vous préserverez totalement votre intimité corporelle, émotionnelle, psychique.
6 : Je souhaiterais enfin à cette occasion, évoquer une question difficile : celle de la Foi. Il s’agit de questions fréquentes et récurrentes dans certains milieux : « je suis chrétien, puis-je utiliser l’hypnose pour me soigner ? ». « Puis-je pratiquer l’hypnose en tant que thérapeute chrétien ? ».
A cela, en tant que chrétienne, je réponds, « OUI ».
Oui, mais pas dans n’importe quelles conditions, et pas avec n’importe qui.
L’hypnose est un outil. Comme tout outil, il ne faut pas le mettre entre les mains de n’importe quelle personne, et il ne faut pas s’y soumettre dans n’importe quelles conditions.
- j’ai évoqué précédemment la nécessité absolue de se former, l’importance des formateurs et de leur éthique, et notre éthique personnelle.
- pour franchir le cap et se laisser aller à rentrer dans cet état d’hypnose, la confiance dans le thérapeute est fondamentale. Celle-ci est la conséquence d’un bon lien qui s’est établi entre les deux personnes. Ceci est valable pour toute relation de soin. Encore plus dans le domaine de l’hypnose, compte tenu de l’état dans lequel nous nous trouvons.
- Le Créateur sait de quoi nous sommes faits. Il connait parfaitement ce qui s’est inscrit sur « notre disque dur », comme évoqué plus haut. Ce qu’Il souhaite, c’est notre bonheur, notre paix intérieure. Les chemins pour y arriver sont multiples. Les professionnels de santé (que ce soit dans le domaine physique, psychologique, médecine parallèle…) peuvent être utilisés par le Seigneur pour participer à notre guérison. En fonction de ce que nous sommes, de notre problématique, de notre personnalité, de nos blocages…. l’outil « Hypnose » et le thérapeute sont, dans ce cas, au service de la foi, pour aboutir à une amélioration de leur état, voire à leur guérison. Parler du fait que je sois chrétienne
Peux-tu nous donner quelques exemples de pratiques ayant entrainé des changements positifs d’attitudes et de comportement ?
1-Une personne est venue me voir suite à des menaces de mort proférées à son encontre dans le cadre d’un conflit. Cela engendrait des peurs, perturbations de son sommeil … En état d’hypnose, elle a revécu une situation de grande détresse alors qu’elle était enfant : elle avait fait une réaction allergique très forte à la suite d’une anesthésie. Dans ce contexte, elle avait frôlé la mort et s’était sentie partir. Je l’ai accompagnée en hypnose pour réparer ce traumatisme d’enfant. Cette démarche l’a aidé à surmonter cette nouvelle angoisse liée à la menace de mort récente.
2-Une personne souffrait de douleur d’épaule. L’hypnose l’a fortement soulagée et elle a recouvré une aisance fonctionnelle.
3-Une personne souffrait d’un mal-être récurrent engendrant des difficultés relationnelles. En état d’hypnose, elle a réussi à revivre des situations in utéro (lorsqu’elle était encore dans le ventre de sa maman). Elle a ressenti, revécu l’angoisse de sa maman qu’elle avait « absorbée » à l’époque en tant que fœtus, bébé en formation. L’accompagnement en hypnose lui a permis de faire le tri et de se détacher de l’angoisse de sa maman lors de sa grossesse, pour devenir plus sereine dans sa vie actuelle.
4-Une dame s’est fracturée plusieurs vertèbres suite à une chute de cheval. L’hypno-thérapie a réduit de moitié le temps de consolidation.
5-Une personne a trouvé grâce à l’hypnose l’origine de son état de mal-être, de ne pas être à sa place, sentiment permanent de vide, de manque: elle a découvert qu’elle avait eu un jumeau décédé prématurément in utéro
6-Une personne a revécu des traumatismes d’enfance (maltraitance et abus) enfouis profondément. La réparation en hypnose lui a permis d’être plus épanouie dans sa vie d’adulte. Elle a retrouvé confiance, et ce travail l’a libérée.
Conclusion
Les différentes parties de notre être (physique, psychique, émotionnel, spirituel …) constituent un tout en interaction. Plusieurs entrées sont donc possibles.
Mon parcours m’a fait rencontrer tellement d’humains en souffrance. Et je sais combien un état intérieur blessé peut constituer un véritable handicap dans la vie quotidienne.
Mon activité professionnelle actuelle me permet d’offrir un accompagnement individualisé, dans le respect de ce que mes clients sont personnellement. J’ai vraiment à cœur de pouvoir les aider en profondeur.
La Thérapie par l’Hypnose répondant à ces objectifs, je suis vraiment heureuse de pouvoir leur proposer et utiliser cet outil qui couvre une multitude de champs d’application,
Béatrice GINGUAY
Hypnothérapeute
- De cadre infirmier à coach de vie : https://vivreetesperer.com/de-cadre-infirmier-a-coach-de-vie/
- Médiation animale : https://vivreetesperer.com/mediation-animale/