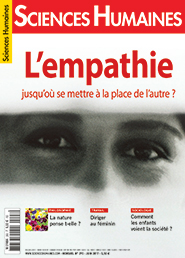par jean | Avr 29, 2012 | ARTICLES, Vision et sens |
Si l’être intime de Dieu est la communion d’amour qui se manifeste dans le Dieu trinitaire, l’Esprit Saint porte et suscite cette communion. Dans notre regard sur l’univers, nous percevons aujourd’hui l’importance primordiale des relations. Tout se tient. « Rien dans le monde n’existe, ne vit et ne se meut par soi. Tout existe, vit et se meut dans l’autre, l’un dans l’autre, l’un avec l’autre, l’un pour l’autre » (p.25). L’Esprit divin est présent dans cette réalité. « En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Actes 1.28). L’Esprit Saint suscite « une communauté de la création dans laquelle toutes les créatures communiquent chacune à sa manière entre elles et avec Dieu » (p.24). A l’encontre de toutes les forces contraires, le projet de Dieu est l’harmonie entre les êtres : « L’essence de la création dans l’Esprit est par conséquent la « collaboration » et les structures manifestent la présence de l’Esprit, dans la mesure où elles font connaître l’ « accord général » (p.25). Nous voyons là un principe qui éclaire notre regard, induit notre discernement et motive notre action. « Etre vivant signifie exister en relation avec les autres. Vivre, c’est la communication dans la communion… » (p.15).
Cette vision nous apporte un principe de discernement : « les structures manifestent la présence de l’Esprit, dans la mesure où elles font connaître l’ « accord général » et une orientation pour notre vie : « Etre vivant signifie exister en relation avec les autres. Vivre, c’est la communication dans la communion ». Partageons concrètement cette pensée
JH
Source
Moltmann (Jürgen). Dieu dans la création. Traité écologique de la création. Cerf, 1988 ( renvoi des citations aux pagination)
Voir : « Dieu dans la création » : www.lespritquidonnelavie.com
par jean | Avr 29, 2012 | ARTICLES, Beauté et émerveillement |
Printemps : expression et dynamisme de vie. Quelle beauté !
J’aime voir l’œuvre de Dieu dans la nature.
Sur ce site : Voir Dieu dans la nature
https://vivreetesperer.com/?p=152
« Le Dieu trinitaire inspire sans cesse la création …La « source de vie » est présente dans tout ce qui existe et qui est vivant. Tout ce qui est existe et vit, manifeste la présence de cette « source de vie » divine » (Jürgen Moltmann. Dieu dans la création (p. 23, 24).
En cette saison , quelques photos extraites des sites Flickr de CaptPiper et Ecstaticist.




par jean | Juil 4, 2022 | Société et culture en mouvement |
 Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.
Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.
C’est le mouvement que décrit Amos Yong (2) dans une séquence sur le Saint Esprit réalisée par Richard Rohr sur le site du Center for action and contemplation. Théologien pentecôtiste américain, d’origine malaisienne, Amos Yong est l’auteur d’une œuvre originale et abondante qui se décline dans de nombreux livres (3). Amos Yong propose ainsi une théologie pionnière où les ressources du pentecôtisme s’inscrivent dans une pensée chrétienne ouverte à une dimension œcuménique et interreligieuse, comme à la culture d’aujourd’hui, notamment scientifique. Amos Yong est professeur à la Faculté Évangélique californienne Fuller où il dirige l’École des études interculturelles, un centre de recherche missiologique. Son œuvre mérite d’être mieux connue au delà de l’univers anglophone.
La dynamique de la Pentecôte
« La vie palestinienne du premier siècle, de beaucoup de manières, semblable à notre village global d’aujourd’hui, était marquée par des suspicions vis à vis de ceux qui parlaient d’autres langues où qui incarnaient d’étranges genres de vie. Ce fut l’œuvre de l’Esprit de rassembler ceux qui étaient étrangers les uns aux autres et de réconcilier ceux qui auraient pu autrement demeurer à l’écart de ceux qui leur étaient dissemblables ».
La Pentecôte ouvre un horizon nouveau. « Elle inaugure un Israël restauré et le royaume de Dieu en établissant de nouvelles structures et de nouvelles relations sociales. A noter que le don de l’Esprit n’est pas réservé aux 120 hommes et femmes qui sont rassemblés dans la chambre haute (Actes 1. 14-15) : Les langues de feu qui se sont divisées, se sont posées sur chacun et ont permis à chacun, soit de parler, soit d’entendre dans des langues étrangères (Actes 2.3-4).
Pour expliquer ce phénomène, Pierre cite le prophète Joël :
« Vos fils et vos filles prophétiseront
Vos jeunes hommes auront des visions
Vos anciens auront des songes
Et sur mes esclaves, hommes et femmes
Je déverserais mon Esprit
En ces jours, ils prophétiseront » (Actes 2. 17-18)
Un changement de société
Amos Yong élargit la réception habituelle. « Les dons de l’Esprit ne sont pas destinés seulement aux individus. Ils ont des effets sociaux en mettant en cause les pouvoirs en place, « the powers that be ».
Pierre comprenait bien que, tandis que l’ancienne ère juive avait un caractère patriarcal, la restauration d’Israël manifesterait l’égalité de l’homme et de la femme. Les deux prophétiseraient dans la puissance de l’Esprit. Tandis que l’ancienne alliance manifestait la direction des anciens, le royaume restauré impliquera la responsabilisation (empowerment) d’hommes et de femmes de tous les âges. En tout ceci, l’œuvre de l’Esprit était annoncée en des langues étranges, et pas dans les langues conventionnelles du statu quo.
En effet, la restauration du royaume de Dieu par la puissance de l’Esprit renversait effectivement le statut quo. Comme il avait été prédit à Marie et Zacharie, ceux qui étaient au bas de l’échelle sociale, les femmes, les jeunes et les esclaves, étaient les récepteurs de l’Esprit et les véhicules d’un revêtement de puissance (empowerment) de l’Esprit (Luc 1.46-55, 1.67-79). Les gens, autrefois divisés par la langue, l’ethnie, la culture, la nationalité, le genre et la classe seraient réconciliés par cette nouvelle version du royaume.
Potentiellement, « toute chair » serait incluse .
Une interpellation
Dans cette vision inspirante, Amos Yong interpelle.
Est-ce que ces caractéristiques continuent à marquer l’église comme une fraternité inspirée par l’Esprit ? Est-ce que l’église parle encore les langues de l’Esprit ? Ou bien restons-nous prisonniers d’une division portée par les langages, les structures et les conventions des empires de ce monde ? (4). Notre prière devrait être : « Viens Saint Esprit » de telle manière à ce que la proclamation de l’épanchement de l’Esprit sur toute chair puisse vraiment encore trouver son accomplissement à notre époque.
Amos Yong
Rapporté en français par J H
- « Paul : Sa vie et son oeuvre selon NT Wright » : https://vivreetesperer.com/paul-sa-vie-et-son-oeuvre-selon-nt-wright/
- A reconciling power : https://cac.org/daily-meditations/a-reconciling-power-2022-06-09/
- Amos Yong . Fuller Seminary : https://www.fuller.edu/faculty/amos-yong/
- L’Esprit Saint à l’œuvre dans les sociétés et pas seulement à l’échelle individuelle : « Pour une vision holistique de l’Esprit. Avec Jürgen Moltmann et Kisteen Kim » : https://vivreetesperer.com/pour-une-vision-holistique-de-lesprit/
par jean | Déc 31, 2011 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |
Nouvel An. Un commencement… Comment est ce que nous considérons l’avenir ? On sait que les représentations de l’avenir varient selon les religions, les civilisations. Notre représentation de l’histoire est inspirée, implicitement ou explicitement par le message que nous avons reçu à travers la Bible, une foi en la promesse de Dieu qui nous met en mouvement à l’exemple d’Abraham ou du peuple juif sortant d’Egypte pour une nouvelle destinée. Et pour les chrétiens, entendre que Christ est ressuscité d’entre les morts et que la puissance de Dieu est à l’œuvre, dès maintenant, pour accomplir la résurrection des morts et la libération de l’humanité et de la nature, nous parle « dans un même mouvement du fondement de l’avenir et de la pratique de la libération des hommes et de la rédemption du monde » (Jürgen Moltmann, Jésus, le Messie de Dieu (Cerf), p. 328). C’est le fondement d’une théologie de l’espérance. C’est une inspiration pour notre société en ce temps de crise où les menaces abondent, et aussi, pour nous personnellement dans un chemin où se mêlent les joies et les épreuves et où parfois on ne voit plus clair.
A un moment où on prend de plus en plus conscience des interrelations entre l’humanité et la nature dans laquelle elle s’inscrit, un exemple issu du monde animal vient nous apporter un éclairage qui fonctionne comme une parabole.
Le magnifique film sorti en 2001 : « Le peuple migrateur » est présent dans nos mémoires … et aujourd’hui accessible sur internet :
http://www.youtube.com/watch?v=ks_nLiTSvb4
Et, sur le site Flickr, on trouve des photos parfois impressionnantes d’oiseaux en migration. En voyant les images des oies sauvages en vol pour échapper au froid de l’Arctique et gagner les pays du soleil, comment ne pas admirer l’instinct qui les conduit. On est saisi par la beauté de ces créatures. Et lorsqu’on sait qu’un vol d’oies sauvages est aussi une expérience collective où une solidarité se manifeste, n’est-ce pas pour nous une source d’inspiration, la métaphore d’un mouvement où la foi s’exercerait dans la communion. Ainsi, en ce Nouvel an, une superbe photo de ces oies en vol nous interpelle :
http://www.flickr.com/photos/warmphoto/6320042255/lightbox/
Elle nous suggère foi, courage, solidarité. N’aspirons-nous pas aussi à faire route les uns avec les autres comme beaucoup d’hommes déjà engagés sur ce chemin ?
JH
par jean | Juin 1, 2017 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement |
La montée de l’empathie.
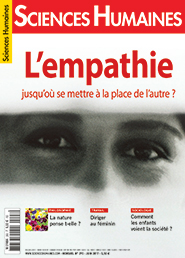 Empathie est un terme de plus en plus fréquemment employé. Sciences Humaines, dans son numéro de juin 2017, nous offre un dossier sur l’empathie (1).
Empathie est un terme de plus en plus fréquemment employé. Sciences Humaines, dans son numéro de juin 2017, nous offre un dossier sur l’empathie (1).
« L’empathie est une notion désignant la compréhension des sentiments et des émotions d’un autre individu, voire, dans un sens plus général de ses états non émotionnels, de ses croyances. En langage courant, ce phénomène est souvent rendu par l’expression : « se mettre à la place de l’autre ». Cette compréhension se traduit par un décentrement, et peut mener à des actions liées à la survie du sujet visé par l’empathie. Dans l’étude des relations interindividuelles, l’empathie est donc différente des notions de sympathie, de compassion, d’altruisme qui peuvent en résulter ». Cette définition de Wikipedia (2) converge avec les significations dégagées par Sciences Humaines : « L’empathie cognitives consiste à comprendre les pensées et intentions d’autrui… L’empathie affective est la capacité de comprendre, non pas les pensées, mais les émotions d’autrui…L’empathie compassionnelle est l’autre nom de la sollicitude. Elle ne consiste pas simplement à constater la souffrance ou la joie d’autrui, mais suppose une attitude bienveillante à son égard ». Ainsi, en regard d’un individualisme égocentré, l’empathie fonde une relation attentionnée à autrui : « Se mettre à la place des autres ». Elle débouche sur la sollicitude, sur la bienveillance, sur la sympathie. C’est une capacité qui nourrit les relations humaines.
La montée de l’empathie
Pour qui perçoit les expressions de ceux qui s’intéressent à la vie humaine et à sa signification, à la fois sur le Web et dans la littérature courante, il apparaît que le terme : empathie est de plus en plus employé. Et on observe la même évolution positive pour un terme comme : bienveillance. On ressent là un changement d’attitude, une évolution dans les représentations comme si un nouveau paradigme émergeait peu à peu dans la vie sociale. A une époque troublée comme la notre, où les menaces abondent, où la violence s’exprime de diverses manières, notamment sur le Web, n’y aurait-il pas là une tendance à long terme qui soit pour nous une source d’encouragement et d’espoir. Dans ce dossier de Sciences Humaines, un article introductif de Jean-François Dortier : « Empathie et bienveillance, révolution ou effet de mode ? », nous aide à y voir plus clair (3).
« Comment un mot quasi inconnu, il y a un demi-siècle, a pris autant d’importance en si peu de temps ? Ce succès du mot en dit long tant sur la façon de penser les rapports humains que sur nos attentes dans ce domaine ». Jean-François Dortier nous présente ainsi un graphique très évocateur sur l’usage du mot « empathie » dans les livres de langue française de 1950 à aujourd’hui. En lente progression durant les décennies 1960, 1970 et 1980, l’usage grimpe en flèche dans les décennies 1990 et 2000.
De fait, cette progression est d’autant plus puissante que la recherche sur ce thème et l’intérêt qu’il éveille, s’exerce dans une grande variété de champs. « Dans le monde animal, l’éthologue Franz de Waal se taille de beaux succès avec ses ouvrages sur l’empathie chez les primates… Dans le règne animal, la solidarité est omniprésente… Chez le petit humain, l’empathie joue un rôle fondamental dès la naissance… ». Et cette disposition est nécessaire dans tout le processus d’éducation. Mais, plus généralement, « l’empathie est devenue un enjeu humain majeur pour comprendre les humains et construire le « vivre ensemble ». Au travail, à l’école, à l’hôpital, et même en politique (4), l’empathie et son corollaire la bienveillance sont sollicitées pour rendre les collectifs humains plus viables ». Il peut y avoir des difficultés et des oppositions, mais progressivement secteur après secteur, la bienveillance gagne du terrain. Ainsi, à la fin du XXè siècle, elle s’impose dans la théorie et la pratique du « care ». Elle va de pair avec l’apparition de la « communication non violente » et l’essor de la psychologie positive au début du XXIè siècle. Et comme en traite deux articles dans ce dossier, elle inspire de plus en plus l’éducation et pénètre dans la gestion des entreprises. A cet égard, nous avons rendu compte sur ce blog du livre phare de Jacques Lecomte : « Les entreprises humanistes. Comment elles vont changer le monde » (5). Par ailleurs, la progression de l’empathie dans les mentalités se réalise à l’échelle internationale comme le montre l’économiste et philosophe américain, Jérémie Rifkin, dans un livre de synthèse : « The empathic civilization. The rise to global consciousness in a world in crisis » (2009) traduit en français sous le titre : Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Vers une civilisation de l’empathie » (6).
Un changement de regard
Face à une vision pessimiste de l’homme qui enferme celui-ci dans le mal et la violence, une vision qui remonte loin dans le temps et s’est appuyée sur des conceptions religieuses et philosophiques (7),
à l’encontre, un puissant mouvement est apparu et met l’accent sur la positivité. Il se manifeste à la fois dans les idées et dans les pratiques. En février 2011, déjà, Sciences Humaines avait publié un dossier : « Retour de la solidarité : empathie, altruisme, entraide » (8). Et Martine Fournier, coordinatrice de ce dossier, pouvait écrire : « L’empathie et la solidarité seraient-elles devenues un paradigme dominant qui traverse les représentations collectives ? De l’individualisme et du libéralisme triomphant passerait-on à une vision portant sur l’attention aux autres ? Le basculement s’observe aussi bien dans le domaine des sciences humaines et sociales qu’à celles de la nature. Ainsi, alors que la théorie de l’évolution était massivement ancrée dans un paradigme darwinien « individualiste » centré sur la notion de compétition et de gêne égoïste, depuis quelques années un nouvel usage de la nature s’impose. La prise en compte des phénomènes de mutualisme, symbiose et coévolution entre organismes tend à montrer que l’entraide et la coopération seraient des conditions favorables de survie et d’évolution des espèces vivantes à toutes les étapes de la vie ».
Il y a là un changement de regard. Les découvertes elles-mêmes dépendent pour une part des questions posées, c’est à dire d’une nouvelle orientation d’esprit. Une transformation profonde de la manière de penser et de sentir est en cours. Cette transformation porte une signification spirituelle. Elle rompt avec des représentations anciennes. Elle s’inscrit dans un contexte d’universalisation où différentes traditions viennent apporter leur contribution. Pour notre part, nous nous référons à la « parabole du bon samaritain » rapportée dans l’Evangile de Luc (10.29-37). L’empathie compassionnelle s’y manifeste puissamment. « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s’en allèrent, le laissant à demi mort… » Passent deux religieux sans lui prêter attention. « Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu’il le vit… Il prit soin de lui ». Dans un livre sur la philosophie de l’histoire : « Darwin, Bonaparte et le Samaritain », Michel Serres voit notre humanité en train de sortir d’un état de violence et de guerre dans lequel elle a été enfermée pendant des millénaires. Et si la paix commence à apparaître, Michel Serres voit dans la figure du Samaritain l’emblème de l’entraide et de la bienveillance. Cette parole de Jésus a grandi et porté des fruits.
Empathie, bienveillance : l’audience de ces notions est-elle un effet de mode ou une révolution ? S’interroge Jean-François Dortier dans le titre de son article en introduction du récent dossier de Sciences Humaines. Dans les tempêtes de l’actualité, on perçoit et on déplore des pulsions de violence et d’agressivité. Mais, par delà, à une autre échelle de temps, on peut apercevoir un autre mouvement. Le montée de l’empathie et de la bienveillance nous parait plus qu’un effet de mode. Lorsqu’on mesure l’ampleur et la pénétration de ce mouvement, on peut y voir une évolution en cours des mentalités.
J H
(1) Dossier : Les pouvoirs de l’empathie, p 24-45. Sciences Humaines, juin 2017
(2) Empathie : Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie
(3) Jean-François Dortier. Empathie et bienveillance. Révolution ou effet de mode ? Sciences Humaines, juin 2017, p 26-31
(4) Pour la première fois à notre connaissance, la bienveillance est apparue en politique. Ce fut dans la campagne présidentielle en marche d’Emmanuel Macron. Edouard Tétreau nous fait part de cette réalité dans un article des Echos : « Les leçons de la start Up Macron » (15 mai 2017) : « Leçon numéro 3 : cette réussite tient aussi – surtout ? – à un mot et une réalité bien rarement vue et entendue dans ma génération et les précédentes, dans le monde du travail en France. Ce mot et cette réalité s’appellent la bienveillance. En jetant les bases de son mouvement et de son pari, Emmanuel Macron a exigé, et obtenu, de ses plus proches collaborateurs, cette qualité-là. La bienveillance entre eux, et vers l’extérieur. Les cyniques du XXème siècle, ceux qui n’ont rien compris au film de ces dernières semaines, doivent s’esclaffer à l’évocation de ce mot, signifiant le « sentiment par lequel on veut du bien à quelqu’un ». La bienveillance n’est pas la faiblesse, ou la gentillesse façon Bisounours. Elle est l’apanage des forts, qui choisissent de mettre de côté leurs petits intérêts privés pour se mettre au service de l’intérêt général. Les médiocres ne pouvant s’occuper que d’eux-mêmes ».
(5) Jacques Lecomte. Les entreprises humanistes. Les Arènes, 2016. Mise en perspective sur ce blog : « Vers un nouveau climat de travail dans une entreprise humaniste et conviviale » : https://vivreetesperer.com/?p=2318
(6) Jérémie Rifkin. Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Vers une civilisation de l’empathie. Les Liens qui Libèrent, 2011. Mise en perspective sur le site de Témoins : « A propos du livre de Jérémie Rifkin » : http://www.temoins.com/vers-une-civilisation-de-lempathie-a-propos-du-livre-de-jeremie-rifkinapports-questionnements-et-enjeux/
(7) Ce regard négatif sur l’homme a été lié à une conception écrasante du péché originel. Voir à ce sujet : Lytta Basset. Oser la bienveillance. Albin Michel, 2014 Voir sur ce blog : https://vivreetesperer.com/?p=1842 Un autre facteur a été le Darwinisme social associé à une conception matérialiste. Voir le chapitre : « The theory of evolution and christian theology : from « the war of nature » to natural cooperation and from « the struggle for existence » to mutual recognition » p 209-223, dans : Jürgen Moltmann. Sun of righteousness, arise ! God’s future for humanity and the Earth. Fortress Press, 2010
(8) Le retour de la solidarité. Dossier animé par Martine Fournier. Sciences humaines, février 2011. Mise en perspective sur ce blog : « Quel regard sur la société et sur le monde ? » : https://vivreetesperer.com/?p=191
(9) Michel Serres. Darwin, Bonaparte et le samaritain. Une philosophie de l’histoire. Le pommier, 2016. Sur ce blog, mise en perspective : « Au sortir de massacres séculaires, vers un âge doux portant la vie contre la mort » : https://vivreetesperer.com/?p=2479
Voir aussi :
« Pour un processus de dialogue en collectivité » : https://vivreetesperer.com/?p=2631
« Branché sur le beau, le bien, le bon » :
https://vivreetesperer.com/?p=2617
« Comment la bienveillance peut transformer nos relations :
https://vivreetesperer.com/?p=2400





 Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.
Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.