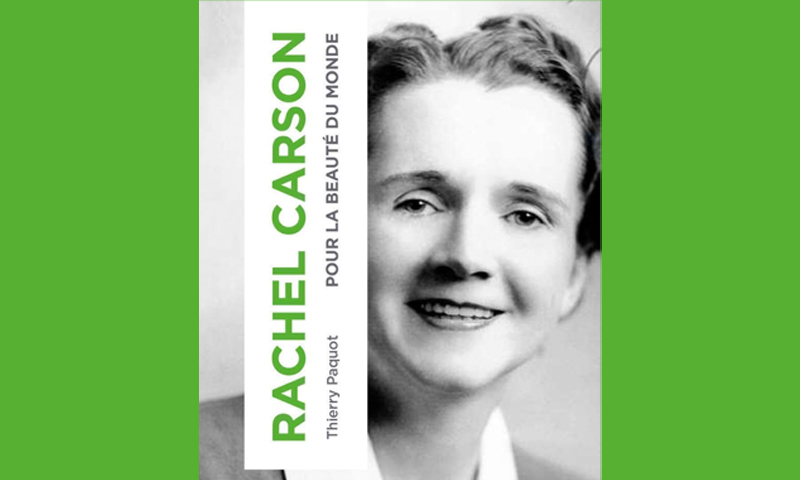par jean | Juil 10, 2012 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
Un nouvel horizon scientifique
D’après le livre de Mario Beauregard : « Brain wars ».
Notre conscience est-elle le produit de notre cerveau et destinée à disparaître avec lui ? Dépend-elle entièrement des mécanismes physiologiques, ainsi soumises aux seules lois de la matière ? Notre personnalité se réduirait-elle au jeu des phénomènes neurologiques comme l’a affirmé le biologiste moléculaire Francis Crick : « Vous, vos joies et vos chagrins, vos souvenirs et vos ambitions, votre conscience d’avoir une identité personnelle et un libre arbitre, ne sont, en fait rien de plus que le comportement d’un vaste assemblage des cellules nerveuses et des molécules associées ». La conscience humaine ne serait-elle qu’un épiphénomène, une forme passagère juste là en attendant de disparaître ? Tout se réduit-il à la matière comme l’envisage la philosophie matérialiste du XIXè siècle qui s’est poursuivie jusqu’à nos jours dans la pensée de certains scientifiques ? Dans leur outrance, les thèses matérialistes qui induisent ces questions, n’emportent pas la conviction, mais elles peuvent susciter un trouble. Et par ailleurs, sous une forme ou sous une autre, elles exercent encore une influence sur la manière de concevoir la recherche dans les neurosciences.
Mais, dans un contexte encore rétif, un changement d’approche commence à apparaître. Un neuroscientifique, Mario Beauregard, nous avait déjà fait part de ce changement dans un livre : « The spiritual mind » traduit et publié en français sous le titre : « Du cerveau à Dieu : Plaidoyer d’un neuroscientifique pour l’existence de l’âme » (1).
Il vient de publier un second ouvrage : « Brain wars » (2) qui traite des conflits autour de la manière de concevoir le rôle du cerveau. Un sous-titre vient utilement préciser le contenu de ce livre : « The scientific battle over the existence of the mind and the proof that will change the way we live our lives », en traduction : « La bataille scientifique autour de l’existence de l’esprit et la preuve qui va changer la manière dont nous vivons nos vies ».
Effectivement, par delà la description du conflit entre des conceptions scientifiques opposées, Mario Beauregard nous apporte des données convergentes qui montrent l’apparition et le développement d’un nouveau paradigme dans lequel l’esprit humain (« mind ») apparaît comme une réalité spécifique : « L’esprit n’a pas de masse, de volume ou de forme et il ne peut être mesuré dans l’espace et dans le temps, mais il est aussi réel que les neurones des neurotransmetteurs et les jonctions synaptiques. Il est aussi très puissant » (p 5).
Mario Beauregard trace une rétrospective des travaux réalisés dans ce champ d’étude. Il critique les postulats méthodologiques de l’approche matérialiste, notamment l’application des principes de la physique classique à ce domaine. Les théories jusque là dominantes ne peuvent expliquer « pourquoi et comment des expériences intérieures subjectives tel que l’amour ou des expériences spirituelles se développent à partir de processus physiques dans le cerveau » (p15). Le livre met en évidence une nouvelle manière de comprendre les rapports entre l’esprit et le corps à partir des données émergentes résultant des recherches menées dans des champs nouvellement explorés comme : l’effet placebo/nocebo, le contrôle cérébral, la neuro plasticité, la connection psychosomatique, l’hypnose, la télépathie, les expériences aux frontières de la mort, les expériences mystiques. En prenant en compte la vision nouvelle que la mécanique quantique nous propose pour la compréhension de la réalité, Mario Beauregard inscrit les recherches sur les rapports entre le cerveau et l’esprit dans un nouveau paradigme. « Dans l’univers quantique, il n’y a plus de séparation radicale entre le monde mental et le monde physique » (p 207). Désormais, la conscience apparaît comme une réalité motrice. En exergue de son chapitre de conclusion, l’auteur propose une citation du physicien et astronome, James Jeans : « L’univers commence à ressembler davantage à une grande pensée qu’à une grande machine ».
Ce nouveau paradigme ne nous apporte pas seulement une compréhension nouvelle, il a des conséquences pratiques pour notre vie. Désormais, nous comprenons mieux comment nous pouvons exercer une influence positive sur notre santé et sur nos comportements, mais nous sommes appelés en même temps « à cultiver des valeurs positives comme la compassion, le respect et la paix » (p 214). A travers la description des expériences aux frontières de la mort et des expériences mystiques, nous entrevoyons des signes de l’existence d’une réalité supérieure empreinte d’amour et de paix (3). Ces représentations nouvelles appellent le développement d’une recherche interdisciplinaire et d’une réflexion théologique innovante (4). Ce regard nouveau appelle aussi une vision spirituelle. Un chercheur britannique, David Hay, a pu définir la spiritualité comme une « conscience relationnelle », avec Dieu, avec la nature, avec les autres, avec soi-même (5). Mario Beauregard rejoint cette représentation lorsqu’il écrit : Quand le mental et la conscience s’unifient, « nous sommes à nouveau connectés à nous-même, aux autres, à notre planète et à l’univers » (p 214). Cette mise en évidence de la conscience est un phénomène qui va entraîner des transformations profondes dans le monde. Un nouvel horizon !
(1) Beauregard (Mario), O’Leary (Denyse). Du cerveau à Dieu. Plaidoyer d’un neuroscientifique pour l’existence de l’âme. Guy Trédaniel, 2008. Mise en perspective sur le site de Témoins : « L’esprit, le cerveau et les neurosciences » http://www.temoins.com/culture/l-esprit-le-cerveau-et-les-neurosciences.html
(2) Beauregard (Marion). Brain wars. The scientific battle over the existence of the mind and the proof that will change the way we live our lives. Harper Collins, 2012.
(3) Sur ce blog : « Les expériences spirituelles telles que les « near-death experiences ». Quels changements de représentations et de comportements ? » https://vivreetesperer.com/?p=670
(4) Une présentation plus approfondie du livre de Mario Beauregard : « Brain wars », accompagnée d’une esquisse de réflexion théologique dans un article à paraître sur le site de Témoins : www.temoins.com. En regard de la vision qui nous est présentée dans cet ouvrage, quelle est notre représentation de Dieu et de sa relation à l’homme ? Nous trouvons une réponse dans le livre de Jürgen Moltmann : « L’Esprit qui donne la vie » : un Dieu à la fois transcendant et immanent, un Dieu trinitaire, communion d’amour, qui appelle l’homme à participer à la création. Voir le site : L’Esprit qui donne la vie : http://www.lespritquidonnelavie.com/
(5) Sur le site de Témoins : « La vie spirituelle comme une conscience relationnelle. Une recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui » http://www.temoins.com/etudes/la-vie-spirituelle-comme-une-conscience-relationnelle-.-une-recherche-de-david-hay-sur-la-spiritualite-aujourd-hui./toutes-les-pages.html Voir aussi sur ce blog : « Expériences de plénitude. Lorsque la réalité spirituelle sort de l’ordinaire » https://vivreetesperer.com/?p=231
par jean | Déc 27, 2011 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |
Aujourd’hui, de plus en plus, la spiritualité se conjugue avec l’expérience. Cette expérience met en jeu toutes les dimensions de notre être : le corps et l’esprit, la tête et le cœur. Cependant des représentations peuvent faire encore barrage. En effet, si le changement culturel opérant à partir de registres convergeant, amène de plus en plus une reconnaissance des interrelations entre les différents aspects de notre être, il y a aussi dans notre héritage des philosophies antagonistes qui, pendant des siècles, ont prôné la séparation et une hypertrophie du mental par rapport aux autres dimensions de l’être humain. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, dans certains milieux « rationalistes » comme dans certains cercles chrétiens où l’exercice de la foi s’opère principalement à travers une réflexion intellectuelle, on observe des réserves vis à vis de l’expérience spirituelle. Et nous pouvons éprouver en nous même des résistances issues de ces représentations. Il est donc important d’en comprendre l’origine pour pouvoir vivre pleinement ce que l’Esprit nous apporte à travers l’expérience. Deux auteurs : Jürgen Moltmann et Leanne Payne, nous apportent sur cette question des éclairages pertinents.
La séparation entre l’âme et le corps.
Ainsi Jürgen Moltmann montre comment la philosophie platonicienne a profondément influencé le christianisme occidental (1) Platon proclame l’excellence d’une âme immortelle. « Si l’homme cherche son identité dans l’âme et non dans le corps, il se trouve lui-même immortel et immunisé contre la mort ». A cette supériorité de l’âme correspond une infériorité du corps, voire un quasi rejet. « Elle enlève à la vie corporelle tout intérêt vital et dégrade le corps en une enveloppe indifférente de l’âme ».
Le dualisme entre le corps et l’âme « sera transposé par Descartes dans la dichotomie moderne du sujet et de l’objet ». C’est seulement la pensée excluant la perception sensible qui induit la conscience de soi. Le sujet pensant exerce un commandement sur son corps et par extension sur la nature.
En regard, Jürgen Moltmann adhère à une anthropologie biblique. L’homme, « engagé dans une histoire divine » apparaît toujours comme un tout et s’inscrit dans des relations existentielles. C’est en terme d’alliance qu’on doit concevoir la relation entre l’âme et le corps.
La déchirure entre la tête et le cœur.
En analysant les obstacles à la prière d’écoute (2), Leanne Payne évoque une « déchirure grave entre la tête et le cœur ». Comment puis-je entendre Dieu, si « je n’intègre pas correctement mes capacités intuitives et imaginatives à mes facultés objectives et rationnelles pour les utiliser dans un juste équilibre ».
Ce dysfonctionnement est liè à ce qu’elle appelle la « faille cartésio-kantienne » entre la pensée et l’expérience. L’héritage intellectuel de Descartes et de Kant a engendré chez beaucoup de chrétiens une déchirure « se caractérisant par le fait qu’ils acceptent une connaissance conceptuelle au sujet de Dieu comme réalité tout en niant simultanément les manières élémentaires d’aimer Dieu, de le connaître et de marcher avec lui, ces dernières étant plus étroitement liées à la connaissance intuitive sans laquelle nous perdons les bienfaits de la raison et ceux de la connaissance conceptuelle » .
« En niant les manières intuitives de connaître, nous ne pouvons plus entendre la voix de Dieu. ».
« A l’inverse de l’idéologie kantienne, les chrétiens affirment que Dieu lui même nous parle d’une manière dont il nous donne le modèle dans l’écriture. Il a façonné nos âmes et nous a donné des oreilles et des yeux spirituels, enracinés dans le fait qu’il vit en nous et nous en lui, afin que nous le voyions, l’entendions et le connaissions ».
Notre propos ici n’est pas de traiter de l’expérience et des conditions de son authenticité spirituelle, mais simplement d’éclairer et donc de lever les barrières culturelles qui peuvent s’y opposer. Oui, c’est en terme de réciprocité que nous percevons la relation entre notre âme et notre corps, entre notre tête et notre cœur.
Leanne Payne raconte qu’une personne ayant découvert le chemin de la prière d’écoute s’attira cette remarque acerbe : « Je vois, vous avez maintenant une ligne directe avec Dieu ». Une amie me disait récemment qu’elle hésitait à faire connaître ce blog parmi les membres d’un groupe chrétien (catholique) très centré sur la réflexion à travers l’étude de livres. Elle pensait que, pour certains de ces membres, le blog leur apparaîtrait comme trop tourné vers l’expérience. Quel est notre vécu à ce sujet ? Quels sont nos cheminements ?
JH
(1) Cette analyse est développée à plusieurs reprises par Jürgen Moltmann. A propos de cette œuvre : www.lespritquidonnelavie.com
(2) Payne (Leanne). La prière d’écoute. Raphaël, 1994 (p.141-143)

par jean | Oct 2, 2024 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |
Un contre récit positif pour traverser le chaos
Nous avons conscience de la grave menace du dérèglement climatique. Mais s’y ajoute une crise économique et sociale : la montée des inégalités. Et l’angoisse ambiante contribue à une augmentation de l’agressivité. Dans un livre récent ‘The life after doom’ (1), le pasteur et théologien américain Brian McLaren n’hésite pas à nous mettre en garde et à nous inviter au courage et à la sagesse dans un monde qui se défait. Cependant, on regarde maintenant généralement l’avenir en terme de transition, une transition écologique pour sortir d’une économie carbonée et enrayer ainsi le réchauffement climatique. Mais est-ce que ce mouvement est suffisamment rapide et profond ? Patrick Viveret (2) et Julie Chabaud ne le pensent pas et proposent une autre approche dans un livre au titre significatif ‘La traversée’ (3). Leur démarche est décrite en ces termes : « la bataille de la transition semble perdue faute d’avoir été réellement menée. Il nous faut faire preuve de lucidité et de radicalité tant dans la perspective que dans le diagnostic. Et, comme la chenille qui se transforme en papillon, raisonner dorénavant en terme de ‘métamorphose’. Voilà un exercice qui est loin d’être évident, car, pour la chenille, l’état de papillon représente la fin d’un monde, en tout cas de son monde ».
Les auteurs estiment que la transition est insuffisante : « Si les principaux responsables économiques et politiques avaient pris au sérieux les avertissements dont ils avaient connaissance dès les années 1980, ‘la transition écologique solidaire’ aurait pu être réussie. Mais ils se sont contentés de greenwashing et de petits gestes au lieu de s’attaquer aux écocides et aux inégalités sociales générées par l’hypercapitalisme ». Dès lors, les auteurs proposent une perspective nouvelle en employant le terme de traversée plutôt que celui de transition. « Cette traversée propose de comprendre et nommer les temps régressifs dans lesquels nous sommes entrés, sans pour autant céder aux perspectives déprimantes de l’effondrisme. Elle engage au réalisme sur la situation actuelle tout en orientant l’action civique par un imaginaire positif et en révélant de nouveaux équipements pour traverser le chaos de la chrysalide sans s’abimer. C’est la projection d’une humanité en voie d’apparition : plus sage et attentive, mieux connectée au vivant, faisant coopérer toutes les intelligences afin d’œuvrer pour l’habitabilité de la planète Terre, défi ultime qui nous relie tous » (page de couverture).
Après nous avoir proposé une métaphore éclairante, comparant notre situation au passage de l’état de chenille et de chrysalide à celui de papillon, les auteurs « ouvrent des chantiers aussi bien théoriques et pluridisciplinaires que pratiques et tournés vers l’action » (p 41) Se succèdent ainsi des chapitres exposant ‘les chantiers de la métamorphose’ en cinq grandes parties : « Comprendre les anticorps des chenilles ; Les ruses de la chenille : pourquoi ne faisons-nous pas ce qu’il faut ; Les travaux de la métamorphose ; Traverser le chaos créateur de la chrysalide ; Se placer en posture de puissance créatrice ».
Dans ces chantiers, les auteurs apportent une vaste information nourrie par leurs connaissances sociologiques, mais aussi, tout particulièrement, par une grande expérience des initiatives innovantes, dans le changement écologique et dans le changement social, prenant en compte la diversité et la créativité des territoires. Les auteurs ont une expertise en ce domaine. Ainsi, Patrick Viveret n’est pas seulement un philosophe et un essayiste, une figure de proue dans le mouvement convivialiste, c’est aussi un homme d’action, issu de la Nouvelle Gauche dans un penchant autogestionnaire, ayant œuvré dans l’entourage de Michel Rocard et de Lionel Jospin et, par la suite très actif dans les mouvements altermondialistes et, aujourd’hui, dans plusieurs associations et collectifs.
Une métamorphose de la chenille au papillon
Comparer l’évolution de la chenille et de la chrysalide au papillon à celle de notre humanité ‘n’est qu’une métaphore’, précise les auteurs à l’entrée de la séquence ‘les travaux de la métamorphose’ (p 91). « Nous ne sommes pas des chenilles en train de devenir des papillons, mais des êtres humains. La métaphore nous est utile pour nous donner de l’espérance et de l’énergie mais elle doit aussi intégrer des données essentielles : nous ne sommes pas dans l’ordre de la simple programmation déterministe du vivant. Là où les cellules imaginales de la chenille la mènent inexorablement au papillon, « nos » cellules imaginales sont des possibles, un papillon en latence » (p 91).
Après avoir rappelé très précisément les menaces et exprimer leur analyse d’un insuccès de la Transition, les auteurs nous proposent une perspective : « L’approche en terme de transition induit dans les esprits l’idée d’une progression linéaire et sans à-coups importants. Or, comme elle se heurte à une réalité contraire, elle finit par entretenir une vision désespérée de la situation. On ne connait pas de progression linéaire, mais souvent des régressions profondes. Il existe des seuils de bouleversement qui conditionnent la capacité de l’humanité à vivre la nouvelle ère écologique dans laquelle elle est désormais rentrée. En revanche, si l’on prend l’exemple de l’une des métamorphoses les plus connues et les plus spectaculaires, celle de la chenille au papillon, nous comprenons que du point de vue de la chenille, le papillon, c’est la fin du monde, ou en tout cas de son monde… L’hypothèse que nous voudrions donc développer dans ce livre est qu’il nous faut nommer et comprendre cette phase critique, si nous voulons saisir les moyens de la surmonter… L’approche que nous proposons permet de comprendre et de nommer les temps régressifs dans lesquels nous sommes entrés sans pour autant céder aux déni des uns ou aux perspectives déprimantes de l’ ‘effondrisme’ des autres ou de l’ ‘aquabonisme’. Elle intègre la situation de temps sombres tout en orientant l’action civique vers un imaginaire positif » (p 20-21).
Les auteurs nous expliquent le processus de la métamorphose de la chenille, puis de la chrysalide au papillon, et comment la compréhension de ce processus peut nous aider à comprendre et à affronter les différents passages du changement auxquels nous sommes confrontés. « La chrysalide est une marmite bouillonnante… où les repères connus disparaissent, fusionnent, se recombinent ou s’hybrident avec des références inconnues. La chrysalide est un chaos. S’y affrontent les forces du passé (la chenille) et les forces de la vie et de l’avenir (le papillon) » (p 22). Cette perspective nous aide à modifier nos manières de voir. « Cela signifie opérer une réforme de la pensée comme le propose Edgar Morin, mais aussi déposer nos armures lourdes et inadaptées. Cela signifie prendre soin… et se doter de nouvelles postures, furtives, créatives, coopératives et apprenantes » (p23).
Les auteurs nous signalent une particularité très éclairante : « De la métaphore de la métamorphose biologique de la chenille en papillon, nous retenons les cellules imaginales, ces cellules déjà présentes dans la chenille qui portent en elles une sorte de code signalant au corps de la chenille la manière de se transformer et de développer les attributs du futur papillon » (p 23). Cependant, « dans le bouillonnement de la chrysalide, les anticorps de la chenille se défendent contre le déploiement des cellules imaginales et donc du papillon ».
Les auteurs prennent appui sur cette image. Il y a des forces en nous et dans l’humanité que nous pouvons nourrir. « Nous ouvrirons un chantier pour nourrir les cellules imaginales des métamorphoses très-humaines, car les nouveaux imaginaires et leurs équipements s’expérimentent partout déjà… Il s’agit de les donner à voir, à sentir et à comprendre pour que chacune et chacun d’entre nous puisse les assembler et les réinventer à notre goût et dans nos réalités » (p 24).
Les chemins de la métamorphose
Voici quelques-unes des pistes que tracent les auteurs :
Ils nous appellent à bien identifier les menaces et les enjeux. « Il y a les menaces qui relèvent des défis écologiques ». Mais « il y a aussi la guerre que nous nous faisons avec l’augmentation des violences ». Dans cette double menace, « ce sont les mêmes forces qui sont à l’œuvre, obsédées dans les deux cas par la peur de voir disparaitre leur ancien monde organisé autour de formes patriarcales, productivistes et autoritaires » (p 25). Face à ce double risque, il est encore temps d’organiser ce que nous pouvons appeler une grande ‘alliance des forces de vie’, car la grande majorité des êtres humains aspirent à vivre dans la paix, la justice et la liberté sur une planète habitable. Il est encore temps de s’appuyer sur le socle positif qui a permis à la planète de renaitre après la seconde guerre mondiale, celui notamment de la Déclaration universelle des droits humains… (p 26).
L’enjeu est celui d’une ‘civilité humaine’. Si le temps nous parait critique, nous pouvons l’envisager comme celui d’une « humanité en travail sur elle-même… » (p 27). « Ce travail sur soi (expression souvent utilisé à propos de la quête de sagesse d’une personne) concerne l’humanité dans son ensemble et aussi tous les corps collectifs qui la constituent : peuples, nations, états, religions, genres, ethnies, cultures, catégories sociales… »
Les auteurs, conscients des pièges du transhumanisme, envisagent la voie du ‘très-humain’… « La voie du très-humain conserve le meilleur de l’émancipation de la modernité sans le pire de la chosification du vivant et des humains eux-mêmes. Elle retrouve le meilleur du lien des sociétés de tradition : lien à la nature, lien social, lien de sens, sans céder à la face sombre de ce lien, celle qui, au lieu de nous libérer, nous contrôle et nous aliène. Elle nous fait grandir en humanité, en intelligence créatrice et en sagesse, mais ne prétend pas, ne souhaite pas nous faire sortir de l’humanité » (p 30).
Ainsi, les auteurs envisagent une société en voie d’apparition et non de disparition. Et, en conséquence, ils nous présentent un vaste chantier dans la promotion de multiples projets de vie et de nouvelles formes économiques… Un tel projet, qui écarte la violence, est aussi « une source de réorientation profonde vers l’essentiel de ce qui fait sens pour tout être humain et pour l’humanité elle-même dans son rapport à l’univers. En ce sens, elle est aussi une source de bien vivre… Nous pouvons nous fixer comme un objectif enthousiasmant celui d’une humanité qui, pour reprendre expression de Philippe Desbrosses, « ne serait pas une société en voie de disparition, mais en voie d’apparition » (p 34).
Les auteurs militent en faveur d’une ‘radicalité créatrice et démocratique’. « La colère est nécessaire et permet d’échapper au sentiment d’impuissance et de dépression, lorsqu’on voit le scandale absolu qu’évoque Oxfam, les 1% les plus riches posséder en fortune, l’équivalent de la moitié de la richesse mondiale et avoir une empreinte carbone égale à cette hypertrophie » (p 34). Cependant les auteurs mettent en garde vis-à- vis des tentations de la violence.
Et même, ils appellent à une lutte contre ce qu’ils appellent le ‘brutalisme’, une ‘éco-convivialité face au brutalisme’. « La résistance est sur deux fronts : celui de l’argent roi qui continue d’être au cœur de l’irresponsabilité écologique et aussi celui de la brutalité qu’exprime le pouvoir de domination sous toutes ses formes, de la brutalisation de la nature à celle des humains » (p 37).
Face au ‘brutalisme’, les auteurs opposent ‘l’éco-convivialisme’. « ‘Eco’, car à l’évidence, la question écologique est non seulement centrale mais vitale. ‘Convivialisme’, car ce terme nous parait mieux adapté que celui historiquement daté de ‘éco-socialisme’ ou celui de ‘éco-humanisme’. L’humanisme classique reste marqué par une vision justement peu écologique… et sa posture trop occidentale… Il nous semble donc que, sur ces deux terrains comme ceux aussi de l’alternative au patriarcat, le convivialisme inspiré à l’origine par les travaux de Ivan Illich et développé dans un manifeste signé par des intellectuels du monde entier, répond mieux à ce défi » (p 38-39).
Effectivement, le convivialisme, ‘philosophie de l’art de vivre ensemble’ (4) se répand dans le monde. En 2020, le mouvement convivialiste a publié un « ‘second manifeste’ qui énonce cinq principes et un impératif pour prendre soin de la nature et des humains ». « Le but du convivialisme est de contribuer à l’édification d’un monde post-néolibéral… en opérant des formes de regroupement entre tous les réseaux qui visent ce même objectif… ». Le ‘Second manifeste convivialiste. Pour un monde post-néolibéral’ (5) est soutenu par près de 300 signataires, venant de 33 pays différents, et pour beaucoup d’entre eux des chercheurs réputés comme le montre la liste publiée en fin de manifeste.
Les auteurs poursuivent en marquant une spécificité et une originalité du convivialisme dans un monde en tensions tenté par la violence et par la guerre. « Cette proposition se fonde sur le fait que le contraire de la dureté n’est pas la mollesse, mais la douceur » (p 39). Le projet préconise de profonds changements dans la vie sociale et économique. Ainsi évoque-t-il « une ‘écolonomie’, une économie réencastrée dans les besoins du vivant et des vivants ». « Notre économie ne peut perdurer que si elle se ‘réencastre’ dans l’écologie et donc dans le rapport au vivant » (p 100). On pourra lire en regard le livre d’Eloi Laurent : « Économie pour le XXIe siècle » (6). C’est un projet ambitieux. « Un tel projet allie bien sûr la transformation personnelle et la transformation sociale » (p 40). Ce n’est pas seulement « un projet politique, mais un projet anthropolitique » (p 40), c’est à dire qu’il envisage la vie humaine en profondeur.
Dans ce livre : « La Traversée » Patrick Viveret et Julie Chabot nous apportent un éclairage pour comprendre et affronter les remous d’une société confrontée aux changements climatiques et aux troubles sociaux engendrés par la montée des inégalités. Ainsi nous permettent-ils d’envisager différemment la transition écologique en nous montrant le chaos dans lequel elle s’effectue, à travers l’image du passage de la chenille et de la chrysalide au papillon et en nous présentant ainsi la transition comme une métamorphose. En terme de ‘chantiers’, les auteurs nous aident alors à influer sur les processus de la métamorphose dans les différents domaines impliqués. A travers l’expertise des auteurs, ce livre nous apporte des ressources. Conjugué à la transformation sociale, la transformation personnelle est mise en valeur. A cet égard, on pourra trouver une inspiration spirituelle dans le livre écrit par Joanna Macy et préfacé par Michel Maxime Egger : ‘L’espérance en mouvement. Comment faire face au triste état du monde sans devenir fou’ (7). Ce livre sur ‘La traversée’ est également éclairant parce qu’il nous offre un horizon social, politique et économique en s’inscrivant dans la dynamique d’un courant de pensée et d’action en pleine expansion : le convivialisme. Nous pouvons ainsi réfléchir aux questions actuelles à l’échelle du monde.
J H
- Brian McLaren. Life after doom. Wisdom and courage for a world falling apart. Hodder and Stouchton, 2024
- Patrick Viveret. Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Viveret
- Patrick Viveret. Julie Chabaud. La Traversée du temps des chenilles à celui des métamorphoses. Un contre récit positif pour traverser le chaos ; Les liens qui libèrent, 2023
- Mieux vivre ensemble : https://convivialisme.org
- Internationale convivialiste. Second manifeste convivialiste. Pour un monde post – néolibéral. Actes sud, 2020
- Eloi Laurent. Économie pour le XXIe siècle. Face à la crise écologique, comment réaliser une transition juste : https://vivreetesperer.com/face-a-la-crise-ecologique-realiser-des-transitions-justes/
- Joanna Macy. Chris Johnstone. L’espérance en mouvement. Comment faire face au triste état de notre monde sans devenir fou : https://vivreetesperer.com/lesperance-en-mouvement/
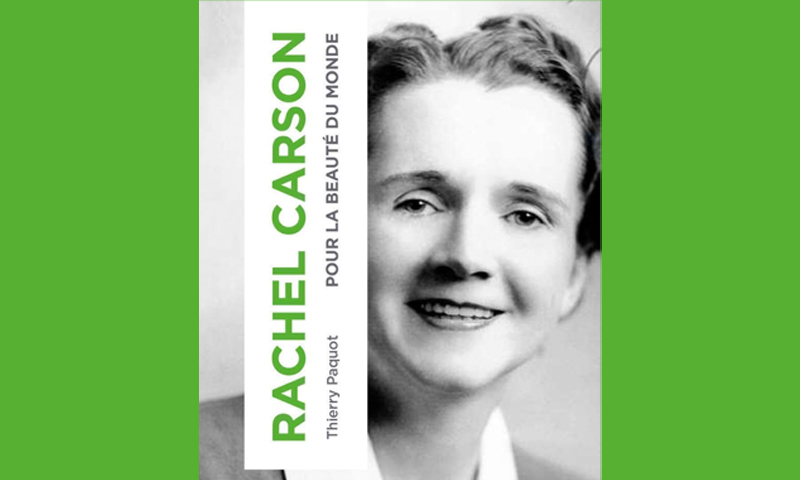
par jean | Oct 17, 2025 | Emergence écologique |
Au début des années 1960, un livre nous vint des Etats-Unis, en traduction sous le titre: « le printemps silencieux ». Dans cet après-guerre, le progrès technique battait son plein. La technique était en vogue et elle paraissait salutaire. Cependant, parce que l’auteure Rache Carson savait évoquer la beauté de la nature avec émerveillement, elle faisait s’autant mieux ressortir les conséquences ravageuses d’un polluant insecticide, le DDT. Biologiste marine, elle était compétente pour démontrer le péril et, malgrè la violente opposition des intérêts, elle fut entendue et le pesticide fut interdit.
Aujourd’hui, la campagne de Rachel Carson nous parait emblématique, car ce fut la première à mettre en cause, à grand bruit, les dangers de la pollution. Aussi, dans le péril actuel, tant le recul de la biodiversité que le dérèglement du climat, il n’est pas étonnant que son exemple inspirant soit retracé par plusieurs livres tel que : « Rachel Carson. Pour le beauté du monde » (1), par Thierry Paquot, lui-même philosophe social à partir d’une profession d’urbaniste. Cependant, notre intérêt a été particulièrement éveillé par l’attention portée à Rachel Carson dans un livre de Helen De Cruz que nous avons présenté sur ce blog : « Wonder Struck. How wonder and awe shape the way we think » (2). Cet ouvrage intervenait à la suite du livre qui, à la suite d’une démarche scientifique et d’une grande enquête, met en évidence le phénomène de la « awe », un émerveillement ébloui : « Awe. The New science of everyday wonder…. » (3). Dans « Wonder Struck », Helen de Cruz consacre une section à l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder) chez Rachel Carson ( p 159-164).
Le parcours de Rachel Carson
Dans son livre : « Rachel Carson. Pour la beauté du monde », Thierry Paquot retrace les étapes du parcours de Rachel Carson : Du plein air au laboratoire ; Exploratrice de l’univers marin ; Ce pesticide qui a rendu muet le printemps ; Un impact retentissant avant un long silence.
Observer et admirer
Née en 1907, Rachel Carson grandit dans une ferme en Pennsylvanie, auprès d’une mère cultivée qui l’initie à une littérature mettant en valeur la nature. « Ainsi donne-t-elle à lire à sa fille le « Handbook of nature study » d’Anna Bostford Comstock. Cette entomologiste et illustratrice, fille d’un quaker, est une grande admiratrice de Ralph Waldo Emerson et d’Henri David Thoreau » (p 15). C’est une indication sur le contexte culturel d l’éducation de Rachel. L’auteur, Thierry Paquot, la décrit ainsi : « C’est une petite fille qui s’intéresse à tout, et qui ne craint pas la solitude, qu’elle recherche pour mieux faire corps avec la nature. Elle se promène dans la campagne et s’initie aux sciences naturelles, apprenant le nom des arbres, des plantes et des fleurs et aussi celui des oiseaux, souvent en compagnie de sa mère. Elle sait s’occuper en lisant, écrivant, rêvant et observant tout autour d’elle. Ce qui la ravit surtout est d’inventer des histoires qu’elle écrit ensuite » ( p 17). Certaines sont même publiées dans un mensuel pour enfants : St Nicholas Magazine. Rachel entreprendra des études universitaires, d’abord en littérature anglaise, puis en s’orientant vers la biologie. Rachel Carson optera ensuite pour une carrière scientifique en dépit de préjugés défavorables à l’égard des femmes. En 1936, « elle devient la deuxième femme assistante-biologiste marin engagée par le Bureau des pêches. Elle va y mêler recherche et vulgarisation, tout en écrivant pour des journaux… ».
Rachel Carson s’est particulièrement distinguée par la publication de plusieurs livres sur l’univers de la mer envisagée tant dans son aspect scientifique que dans un ressenti poétique. Ce furent : « Under the sea wind » en 1941, « The sea around us” en 1951 et “the edge of the sea”en 1955. Le livre : “The sea around us” (Cette mer qui nous entoure ) a rencontré un grand succès, « numéro 1 de la liste des meilleures ventes du New York Times durant quatre-vingt-six semaines » et a été rapidement traduit en de nombreuses langues. Elle nous raconte l’apparition de la mer et son expansion comme une épopée, la montée du vivant. « Cet ouvrage est un récit choral de tous les êtres vivants qui font, défont et refont l’univers marin, sachant que « cette mer qui nous entoure » est aussi entourée par les activités humaines qui viennent en perturber les fragiles équilibres … Rachel Carson assemble les informations les plus précises et actuelles pour décrire un monde qu’elle pense comme une totalité, dans laquelle tous les éléments constitutifs sont interdépendants entre eux. N’est-ce point la définition de l’écologie, par Ernst Haeckel en 1866 ? » ( p 38). L’auteur nous rapporte également la vision spirituelle de Rachel Carson : « Croyant, comme moi à l’évolution, je crois simplement que c’est la méthode par laquelle Dieu a créé et continue de créer la vie sur terre. Et c’est une méthode si merveilleusement conçue que l’étudier en détail, revient à augmenter – et certainement jamais à diminuer – à la fois sa révérence et sa crainte à la fois envers le Créateur et à l’égard du processus » ( p 38). Thierry Paquot commente également le dernier livre de Rachel Carson : « The edge of the sea » (Là ou finit la mer : le rivage et ses merveilles), un ouvrage qui « clôt sa trilogie marine » : « C’est son texte le plus littéraire et le plus personnel, celui que je préfère en raison de son écriture émotionnelle, qui ne dédaigne pas pour autant les détours scientifiques sans la platitude scolaire fréquente des énoncés pédagogiques ».
Dénoncer les méfaits du DDT et des pesticides : un engagement pour le vivant
La connaissance et l’amour de la nature chez Rachel Carson l’ont portée à s’engager. Consciente de la grandeur et de la beauté de la toile du vivant, elle a ressenti les menaces à son égard et elle s’est engagée de toutes ses forces contre les méfaits des pesticides, en l’occurence du DDT en grande vogue à l’époque.
Thierry Paquot nous montre comment elle a recueilli des concours et rassemblé les preuves de la dégradation du vivant par le DDT. Ses arguments résonnent en anticipation aux recherches actuelles établissant les méfaits des pesticides. « Pour son étude, elle rencontre de nombreux médecins et biologistes, dont les spécialistes des « cancers professionnels et environnementaux » … Elle rassemble une très riche documentation, son livre comporte quarante pages de références bibliographiques… Une partie de ses informations a été collectées par une ornithologue amateure du Massachusetts…Elle recueille une abondante documentation de Marjorie Spock, poète et écologiste, pédagogue de l’anthroposophie, maraichère en agriculture biodynamique lorsque le DDT est aspergé sur ses terres… » ( p 51-52)
Rachel Carson a eu à faire à de fortes parties tant est grand à l’époque le prestige du DDT et puissants les intérêts qui le soutiennent. « Le DDT massivement prescrit contre les insectes porteurs du paludisme, du typhus, de la peste bubonique au cours des premières années de la guerre, devient après-guerre le traitement de choc de l’organisation mondiale de la santé (OMS) » (p 56). Puis, il commence à se répandre dans l’agriculture et c’est là qu’apparaissent les dangers de son utilisation, dangers que Rachel Carson va identifier : « l’une des caractéristiques les plus fâcheuses du DDT et des produits imilaires est de passer d’un organisme dans un autre en suivant la chaine alimentaire. En voici un exemple : un champ de luzerne est traité au DDT ; cette luzerne est donnée en pâté aux poules ; les œufs pondus par les poules contiennent du DDT » ( p. 56). « L’équilibre propre à la nature » est bouleversé. « Le tir de barrage chimique… s’abat sur la trame de la vie, sur ce tissu si fragile et délicat en un sens, mais aussi d’une élasticité et d’une résistance admirable… ». Rachel Carson propose « un autre chemin pour une terre habitable demain ». Ainsi, courageusement, car par ailleurs, elle fait face à la maladie, Rachel Carson écrit un livre qu’elle dédie à Albert Schweitzer, grand médecin et homme de paix. Ce livre, « Le printemps silencieux » commence par un constat érigé en des termes émouvants : « Ce fut un printemps sans voix. A l’aube qui résonnait naguère du chant des grives, des colombes, des geais, des roitelets et de cent autres chanteurs, plus un son désormais ne se faisait entendre. Le silence régnait sur les champs, les bois et les marais… Qu’est ce qui a déjà réduit au silence les voix du printemps ans d’innombrables villes américaines ? Ce livre essaie de l’expliquer » ( p 63). « Le printemps silencieux » va rencontrer « un succès planétaire ». « On peut distinguer deux phases dans la réception de Rachel Carson. : d’abord un accueil très favorable à son livre un soutien et une caution des milieux scientifiques… puis une phase d’oubli, due certainement à une contre-offensive des lobbies. Il faudra alors attendre l’émergence des écologistes pour qu’elle devienne une de leurs références et qu’elle en vienne même à toucher un plus large public » ( p 70).
Comment Rachel Carson témoigne du pouvoir de transformation de l’émerveillement et d l’admiration : « awe and wonder ».
« awe » and « wonder » : l’émerveillement et l’admiration
La présentation de la mer par Rachel Carson témoigne de son admiration et de son émerveillement vis-à vis des merveilles de la nature. Cette réalité peut être éclairée aujourd’hui par la découverte récente de l’existence du phénomène de la « awe », un émerveillement ébloui qui apparait dans certaines situations. Aux Etats-Unis en effet, à la fin du dernier millénaire, la psychologie a commencé à porter son attention aux émotions. Et puis, lorsque cette recherche a commencé à aborder le champ des émotions positives, en 1903, Dacher Keltner et un de ses collègues, Jonathan Haig, ont commencé à travailler pour mettre en évidence et définir l’émotion de la « awe ». Puis Dacher Keltner s’est engagé avec le professeur Yang Bei dans une grande enquête internationale à l’échelle mondiale en vue de rassembler de récits de personnes décrivant une expérience de « awe » selon la définition choisie : « Etre en présence de quelque chose de vaste et de mystérieux qui transcende votre compréhension habituelle du monde » (4). Par la suite, dans son livre : « Wonderstruck », une philosophe, Helen De Cruz a poursuivi cette recherche sur un autre plan. « Wonder » and « awe » sont au cœur des questions les plus profondes de la vie. Helen De Cruz démontre que « wonder » et « awe » sont des émotions motrices et que l’humanité a délibérément entretenu ces émotions dans des champs culturels tels que la religion, la science et la culture » (page de couverture). Comment Helen De Cruz envisage-telle « wonder » et « awe » ? « Dans ce livre, je considérerai « awe » et « wonder » comme distinctes, mais comme des émotions apparentées psychologiquement. La « awe » est une émotion où nous ressentons ou conceptualisons l’immensité, reliée à un besoin d’accommodement cognitif. L’immensité peut être physique (la dimension) ou conceptuelle (la complexité)… « Wonder » est l’émotion qui s’élève du terrain inconnu qui se tient juste au-delà des marges de notre compréhension courante. Comme la « awe », elle suscite un besoin d’accommodement cognitif, mais elle ne requiert pas une dimension d’immensité… Helen De Cruz associe « wonder » et « awe » parce qu’elles sont étroitement connectées dans la pensée occidentale. Des mots comme le grec ancien « thauma » ou le terme médiéval « admiratio » recouvrent à la fois « awe » et « wonder ». Les psychologues contemporains les traitent également ensemble ». Quelles sont leurs caractéristiques communes ? L’auteure en distingue deux. Ce sont des émotions épistémiques, c’est-à-dire des émotions qui nous motivent et nous incitent à explorer notre environnement et à apprendre davantage à son sujet . Ce sont également des émotions self-transcendantes . « Elles nous aident à nous mouvoir au-delà de la centration sur nous-mêmes et de nos propres préoccupations ».
« awe » et « wonder », émerveillement et admiration chez Rachel Carson
Dans son livre, Helen De Cruz cherche comment l’émerveillement et l’admiration forgent la manière dont nous pensons : la philosophie, la psychologie, la science, la religion. Cependant, elle considère également que ces deux grandes dispositions contribuent également à la transformation du monde.
L’auteure évoque des articles de psychologie qui mette en évidence les bienfaits psychiques engendrés par la « awe », par l’émerveillement. Cependant, nous dit-elle, les problèmes qui nous affectent comme l’anxiété et le stress, ne viennent pas seulement de nous-mêmes. « Ils sont provoqués par des problèmes sociaux plus généraux. Considérons, par exemple le phénomène répandu de l’anxiété climatique ou plus largement de l’éco-anxiété ». Nous voulons préserver un monde vivable pour les générations futures. L’auteure cite une militante écologiste, Jacquelyn Gill, qui écrit : « Quand les choses son dures, je me tourne souvent vers le monde naturel pour y trouver inspiration, force et même joie. Partager le sens de l’émerveillement avec d’autres, me donne le sentiment d’être plus connectée et plus fondée, m’apporte mon sens de la vie. Cela me rappelle aussi pourquoi je lutte » ( p 158). D’autres chercheurs partagent cette attitude. L’auteure pose une question : « Comment l’admiration et l’émerveillement (awe and wonder ) peuvent être des sources d’espérance ? » Elle s’inspire des vues de Rachel Carson sur l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder ), particulièrement comme elle les a exprimées dans son livre : « The sense of wonder » (1965). Elle veut montrer que Rachel Carson perçoit le sens de la merveille comme une vertu et une émotion transformante. « Je montrerai que l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder) peuvent nous apporter deux visions majeures : que nous sommes connectés avec le reste du monde et que les choses pour lesquelles nous éprouvons de l’émerveillement et de l’admiration sont intrinsèquement valables » ( p 158).
Les trois livres de Rachel Carson , « une trilogie de la mer » et d’autre œuvres précoces sont remarquées pour leur qualité lyrique et le sens de la merveille qu’ils évoquent. L’écriture de Rachel Carson est fortement associée avec l’émerveillement pour la nature » ( p 159).
L’auteure évoque aussi le livre « le printemps silencieux où la peur se manifeste. « le printemps silencieux » est moins lyrique que le reste de l’oeuvre de Rachel Carson . Mais il commence par une fable apocalyptique inoubliable : « Il y avait une fois une ville au cœur de l’Amérique où toute vie semblait en harmonie avec l’environnement » Tout paraissait bien jusqu’ à ce qu’un étrange fléau apparut dans le secteur et que tout commença à changer. Quelque charme maléfique s’était installé sur la communauté. Des maladies mystérieuses balayaient des troupeaux de poulets. Les vaches et les moutons tombaient malades et mouraient. Une ombre de mort régnait partout ». Et elle poursuit : « Il y avait un calme étrange. Les oiseaux, par exemple – où étaient-ils allés ? Beaucoup de gens en parlaient, intrigués et troublés… Les quelques oiseaux aperçus quelque part étaient moribonds. Ils tremblaient violemment et ne pouvaient plus voler. C’était un printemps sans voix… » ( p 160). Helen de Cruz commente ce texte en ces termes : « L’usage efficace de la rhétorique et du sublime scientifique est une caractéristique de l’œuvre de Rachel Carson. Dans ce cas, ce n’est pas une évocation, comme d’habitude de la majesté et de la force de la nature, mais de sa fragilité face aux interventions humaines inconsidérées…. Les premières œuvres de Carson sur la mer communiquaient un sens de la merveille, cherchant à aller au-delà d’un simple exposé de faits sur la nature et comment la contrôler, en vue plutôt de la réenchanter. De l’autre côté, le « Printemps silencieux » nous secoue hors de l’enchantement du techno-optimisme… » ( p 161). Rachel Carson pointe à un mauvais usage de la technologie. En contraste, elle propose une science éclairée, « une famille de disciplines sensibles aux intrications dans la toile de la vie, la relation qui tient tout dans une vie unique et en une communauté en évolution. Cette vision demande que nos actions soit animées par une éthique environnementale » ( p 161).
« L’entrelacement de l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder), du sublime et de la préoccupation morale de Rachel Carspn pour l’environnement sont les traits notables de sa philosophie. » Pendant qu’elle concevait le Printemps silencieux, elle préparait déjà un livre sur la « wonder », un livre sur la merveille. Cependant, le « Printemps silencieux prit le pas comme projet d’écriture, parce que Rachel Carson y vit une nécessité face à une menace urgente. Elle allait vers la fin de sa vie. Elle souffrait d’un cancer du sein qui finira par la tuer. Au lieu d’un gros livre ambitieux sur la merveille, sur la wonder, elle nous laisse un mince volume intitulé : « the sense of wonder ». C’est une édition illustrée posthume d’un essai que Carson écrivit pour le magazine : « Women’s home companion ». Elle y décrit la joie dont elle a fait l’expérience : « Une soirée d’automne orageuse, alors que mon neveu Roger était âgé de 20 mois, je l’enveloppais dans une couverture et l’emmenait en bas sur la plage dans un lieu sombre et pluvieux ». Ils entendaient le bruit tumultueux des vagues. « Ensemble, nous riions de pure joie, – lui, un bébé rencontrant pour la première fois le tumulte sauvage de l’océan ; moi avec le sel de l’amour d’une moitié de vie pour la mer »… Rachel Carson croyait que l’émerveillement et l’admiration étaient des émotions que les enfants possèdent naturellement bien qu’elles puissent diminuer avec le temps si elles ne sont pas nourries et cultivées (p 162). Elle croyait également que l’émerveillement et l’admiration non seulement nous font sentir bons, mais que ces émotions sont aussi une source de force en temps de difficultés (4). L’auteure commente ainsi : » Ceux qui demeurent, parmi les beautés et les mystères de la terre, ne sont jamais seuls et las de la vie. Quelque soient les vexations et les soucis de leurs vies personnelles, leurs pensées peuvent trouver des chemins qui les mènent vers un contentement intérieur et une ardeur de vivre renouvelée. Ceux qui contemplent la beauté de la terre trouvent des réserves de force qui dureront aussi longtemps que leurs vies ».
Dans la vision de Rachel Carson, l’émerveillement et l’admiration (awe and wonder ) sont transformatrices. Ces émotions nous aident à voir le monde différemment et, en voyant le monde différemment, nous changeons aussi. S’émerveiller est un antidote à notre attitude destructrice de contrôler la nature pour notre propre intérêt. « Rachel Carson écrit : « Il semble raisonnable de croire – et je crois – que plus clairement nous pouvons centrer notre attention sur les merveilles de notre univers et moins de gout nous aurons pour la destruction de notre race. L’émerveillement et l’humilité sont des émotions saines et elles ne font pas bon ménage avec un appétit de destruction ». ( p 163).
Helen de Cruz voit en l’émerveillement le potentiel d’une vertu.
Pour une personne qui manifeste la vertu correspondante, un état de chose requiert des actions et des obligations. « La vertu vous harmonise avec l’environnement d’une manière particulière ». Dans ce chapitre consacré à la puissance de transformation intérieure de la « awe », de l’émerveillement, Helen de Cruz donne ainsi Rachel Carson en exemple.
Cette biographie, cette histoire de vie nous renvoie ainsi à la prise de conscience de la « awe » et de ses effets, une prise de conscience assez récente telle que nous l’avons découverte dans la recherche de Dacher Keltner, puis dans Helen De Cruz. Si, au moment de la parution du « Printemps silencieux », Rachel Carson nous apparait comme une militante héroïque de l’écologie, à travers sa vie et à travers son œuvre, elle manifeste la puissance de la awe, la puissance de l’émerveillement.
J H
- Thierry Pacot. Rachel Carson. Pour la beauté du monde. Calype éditions. 2023
- Wonderstruck : https://vivreetesperer.com/comment-ladmiration-et-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-induisent-la-culture-et-faconnent-la-maniere-dont-nous-pensons/
- The new science of everyday wonder: https://vivreetesperer.com/comment-la-reconnaissance-et-la-manifestation-de-ladmiration-et-de-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-peut-transformer-nos-vies/
- Voir aussi : L’enfant: un être spirituel : https://vivreetesperer.com/cooperer-et-se-faire-confiance/
par jean | Mai 4, 2021 | ARTICLES, Vision et sens |
Selon Thomas d’Ansembourg
Thomas d’Ansembourg, que nous rencontrons fréquemment sur ce blog (1), nous parle des émotions dans plusieurs interviews vidéos chez « les dominicains de Belgique ». Parmi les émotions, il y a la peur (2), la tristesse, la colère, mais il y a aussi la joie (3). Nous pouvons bien rejoindre Thomas d’Ansembourg lorsqu’il déclare qu’il y a « une énergie magnifique dans la joie », mais alors comment la cultiver ?
https://youtu.be/B5vyHlEDU04
La joie, est-ce possible ?
A partir de son expérience d’accompagnement de nombreuses personnes, Thomas d’Ansembourg peut estimer que « nous sommes joyeux par nature ». Les enfants ne sont-ils pas naturellement joyeux ? « Pourquoi les adultes ont-ils souvent déserté cette joie là ? ».
Il y a certes des explications en rapport avec la culture. « Les difficultés d’accès à la joie, à la joie durable que l’on peut reproduire et que l’on peut utiliser pour orienter sa vie, cette difficulté d’accès à la joie tient à ce que j’appelle la culture du malheur ». Nous avons grandi dans « une culture ambiante qui est plutôt basée sur les rapports de force » et qui hérite d’une mémoire collective rappelant des guerres, des épidémies, la mortalité infantile… « Tout cela s’est encodé dans notre inconscient ». Thomas d’Ansembourg en voit l’expression dans une inquiétude latente qui implique un repli : « On n’est pas là pour rigoler ». Cela joue comme un « vaccin anti-bonheur ». « On a envie d’être joyeux, mais on n’y accède pas ». Si on est joyeux, ce n’est pas pour longtemps. Car « on a peur d’un retour de manivelle ». « On espère le bonheur, mais on n’y accède pas. On ne s’y autorise pas ». Comme nous avons peur que la joie nous échappe, instinctivement, c’est nous-même qui nous la retirons. Comme cela, nous avons l’impression d’avoir du pouvoir sur notre propre vie. C’est ce qu’on appelle un mécanisme d’auto-sabotage. C’est peu connu. Seulement, si nous savions cela, nous pourrions observer un mécanisme de désamorçage et le réamorcer avant qu’il ne s’enclenche.
J’en parle en connaissance de cause m’étant moi-même retrouvé dans des mécanismes d’auto-sabotage que je n’imaginais pas du tout. Vous m’auriez demandé : « Qu’est-ce que vous cherchez à vivre », j’aurais répondu : j’ai envie d’être joyeux. J’ai envie d’être heureux. Mais je n’avais pas vu que c’était moi qui était en cause. J’attribuais mon problème aux autres, à mon travail, à ma compagne… J’avais du mal à identifier tout ce qui m’empêchait d’être joyeux ».
Apprendre à vivre davantage dans la joie.
Comment apprendre à être dans un état de joie de plus en plus régulier, ce qui n’empêche pas la traversée des difficultés, car nous ne vivons pas dans un monde idéal et nous devons faire face aux contrariétés. « Cependant, je crois que notre intention, notre sentiment profond, c’est de goûter de la joie malgré ces passages difficiles, de conserver de la joue à l’intérieur de soi. Comment apprendre cela ? Thomas d’Ansembourg reprend ici un petit exercice de dialogue avec un sentiment symbolisé par un fauteuil à côté de lui. « Apprendre à côtoyer la joie, à lui faire de la place. Je la goûte, je la savoure, je conjure la culture du malheur… ».
Thomas nous invite à observer les moments de la journée ou nous ressentons de la joie. « Si je suis heureux parce qu’il y a du soleil le matin, parce que le temps est beau, cela veut dire que j’aime la beauté, j’aime la douceur, j’aime la chaleur. Ce ne sont pas là des valeurs négligeables : beauté, douceur, chaleur. Qu’est-ce que je vais faire dans la journée pour reproduire et restaurer cela ?…. »
« Si j’ai partagé un repas avec quelques amis, je vais observer ce qui m’a rendu joyeux : l’amitié, la fidélité, la connivence, la rencontre authentique, la vulnérabilité que chacun accueille chez l’un, chez l’autre… Et j’aime cela. C’est comme cela que je veux vivre. Et donc dans mes rapports, je vais instaurer ou réinstaurer authenticité, intériorité, acceptation de la vulnérabilité, franchise… Je recrée parce que la joie me dit que c’est par là que je veux aller. Je l’instaure. »
Et si, pendant le week-end, j’ai promené les enfants dans la forêt et que je me suis enchanté, je vais décoder ce que me dit ma joie : nature, beauté, silence, présence des enfants… J’ai besoin de garder cela même quand je prends les transports en commun. J’ai besoin de garder le goût de l’émerveillement : regarder les gens, m’intéresser à leur vie… J’ai besoin de goûter le vivant partout où je suis et pas seulement dans une belle forêt, mais aussi dans le métro. Goûter le fait que je suis dans une communauté humaine qui est en marche, qui est en route… ». Ainsi, il est bon de décoder les moments de joie parce qu’ils nous indiquent notre fil rouge, comme une courbe croissante de cette joie que nous voudrions vivre.
« Accompagnant des personnes depuis vingt cinq ans, c’est ma conviction que nous cherchons à vivre cet état de joie profonde que j’appelle toujours un état de paix intérieure, de plus en plus stable, de plus en plus transportable dans les péripéties de la vie, un état de paix intérieure qui se révèle contagieux, généreux. Je pense que c’est notre véritable humanité d’apprendre à trouver cet état de paix intérieure qui permet d’être rayonnant, d’être contagieux dans notre état d’être. Cela ne nie pas les difficultés. Cela ne nie pas les tensions, les moments de désarroi. Mais plus je sais bien traiter ma colère, ma tristesse, ma peur, des parties de moi, pas tout moi, plus je sais écouter ces parties de moi, moins elles m’encombrent. Et plus mon espace qui est la joie prend de la place, s’installe, s’instaure, se stabilise. Pour moi, notre vraie nature, c’est d’être dans un état de plus en plus fréquent de joie intérieure. Et j’observe, dans mes lectures, que la plupart des traditions disent la même chose : être joyeux dans un monde vivant et être contagieux de notre joie ». A ce stade, l’interviewer rappelle la parole de Jésus : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ».
Pourquoi un univers médiatique si peu propice à une expression de joie ?
Constatant une avalanche de mauvaises nouvelles dans les médias, une situation peu propice à une expression de joie, l’interviewer questionne Thomas d’Ansembourg sur cet état de chose. « On se plaint de cette offre de mauvaises nouvelles, mais je pense qu’il n’y aurait pas d’offre si il n’y avait pas de demande. Qu’est-ce qui fait qu’on demande cela ? Une des manières de l’expliquer, à partir de mon travail d’accompagnement, si la vie me paraît plate, ennuyeuse, si je ne fais pas les choses que j’aime, si je sens pas le tressaillement de la vie, si tout me paraît morose, quand je rentre le soir et que j’allume mon petit écran, il y a des catastrophes, il y a des éboulements, il y a des guerres, je me sens vivant parce que je ne suis pas mort. Il y a un effet de comparaison. Je ne me sens pas vivant par l’intérieur, mais par différence avec la mort, avec la tragédie. Nous avons besoin de nous rééduquer par rapport à ce phénomène d’être fasciné par l’horreur et d’attendre cela. Il y a ce phénomène de la culture du malheur. Nous savons ce qui ne va pas. Nous savons nous plaindre, nous lamenter, mais nous ne savons pas bien nous réjouir et nous réjouir durablement. C’est un système de pensée ». Thomas nous invite à imaginer des médias qui diffuseraient autant de bonnes nouvelles que de mauvaises, et cela, bien sûr, en rapport avec la réalité. Mais pour un avion qui s’écrase, des milliers et des milliers arrivent normalement à bon port… « Il y a des prodiges de technologie et de savoir faire humain et cela mériterait notre émerveillement, notre admiration » « Si les gens des médias réinstauraient un peu plus d’équité entre bonnes et mauvaises nouvelles, je pense que cela changerait significativement l’énergie du monde ». Et d’ailleurs, nous savons bien que lorsque nous entendons des bonnes nouvelles qui nous concernent, cela nous dynamise. Thomas rappelle les bienfaits de la gratitude (3). Il y a un rapport entre savoir vivre des moments de gratitude et une meilleure santé. « C’est citoyen que d’apprendre à se réjouir profondément pour pouvoir transformer les choses ».
Dans cet entretien, Thomas d’Ansembourg vient nous rejoindre dans les émotions qui abondent dans notre vie quotidienne. Et il y en a une, la joie qui est un tremplin pour une vie heureuse, tournée vers le bon et vers le beau. Cependant , dans le monde où nous vivons, les circonstances auxquelles nous devons faire face, la joie est souvent étouffée par d’autre émotions. Elle est également empêchée par une culture héritée d’un passé douloureux : une « culture du malheur » comme une culture du deuil et du sacrifice. Thomas d’Ansembourg vient nous aider à y voir clair, à lever les obstacles qui font opposition à la joie et à reconnaître celle-ci en désir d’émergence dans notre vie. Comme cet entretien fait référence à l’apport de traditions religieuses en faveur de la joie, rappelons l’appel de Jésus : « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et votre joie soit complète » (Jean 15.11). Et, en 2013, le pape François publie un texte sur « la joie de l’Evangile » (4). Si l’on pense que l’être humain est fondamentalement un être en relation, avec lui même, avec les autres humains, avec la nature et avec Dieu, alors on imagine que la joie résulte de la qualité et de l’harmonie de ces relations. Dans les chemins où la joie se découvre, il y a cette levée des obstacles à laquelle nous invite Thomas d’Ansembourg.
- Face à la violence, apprendre la paix (avec des liens à d’autres articles rapportant sur ce blog la pensée de Thomas d’Ansembourg) : https://vivreetesperer.com/face-a-la-violence-apprendre-la-paix/
- Une émotion à surmonter : la peur
- Thomas d’Ansembourg : la joie : https://www.youtube.com/watch?v=B5vyHlEDU04
- Evangelii Gaudium : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html