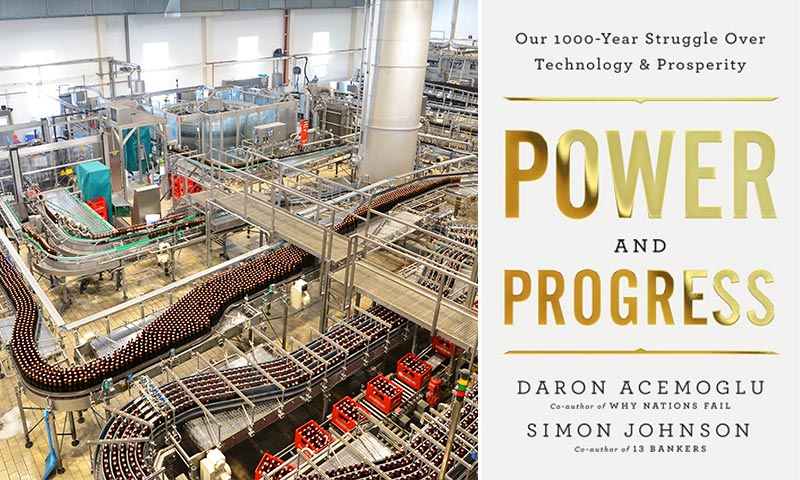par jean | Jan 10, 2024 | Vision et sens |
« Awe and amazement »
Un autre regard
Sur son site : “Center for action and contemplation”, Richard Rohr nous entraine dans une séquence sur les bienfaits de l’admiration et de l’émerveillement dans la vie spirituelle. Cette séquence est intitulée : « awe and amazement » (1)
Le sens du terme de « awe » a évolué dans le temps à partir d’un vocabulaire religieux où la révérence était accompagnée par une forme de crainte. Aujourd’hui, ce terme évoque admiration et émerveillement. Depuis le début de ce siècle, le phénomène correspondant est l’objet d’une recherche. Aujourd’hui, la « awe » attire l’attention des chercheurs en psychologie. Le ressenti de transcendance, qui s’est inscrit dans une histoire religieuse, est reconnu aujourd’hui dans le champ plus vaste de la quotidienneté. Ainsi, Dacher Keltner, professeur de psychologie à l’Université de Berkeley, a écrit un livre : « Awe. The new science of everyday wonder and how it can transform your life” (L’admiration. La nouvelle science du merveilleux au quotidien et comment elle peut transformer votre vie » (2).
Vouloir être surpris
« Willing to be amazed »
Richard Rohr se réfère à Abraham Joshua Heschel et il affirme que la « awe », l’admiration, l’émerveillement, l’’éblouissement sont des expériences spirituelles fondatrices. « Je crois que l’intuition religieuse fondatrice, première, basique est un moment de « awe » », un moment d’admiration et d’émerveillement. Nous disons : « O Dieu, que c’est beau ! ». Pourquoi évoquons si souvent Dieu lorsque nous avons de tels moments ? Je pense que c’est reconnaitre que c’est un moment divin. D’une certaine manière, nous avons conscience que c’est trop bon, trop beau… quand cette « awe », l’admiration éblouie, sont absents de notre vie, nous bâtissons notre religion sur des lois ou des rituels, essayant de fabriquer des moments de « awe ». Cela marche parfois… ».
Richard Rohr met ensuite en valeur les bienfaits de l’admiration et de l’émerveillement. « Les gens dont la vie est ouverte à l’admiration et l’émerveillement ont une « plus grande chance de rencontrer le saint , le sacré (« holy ») que quelqu’un qui va seulement à l’église, mais ne vit pas d’une manière ouverte. Nous avons presque domestiqué le sacré en le rendant si banal ». Richard Rohr marque sa crainte que cela se produise dans la manière dont nous ritualisons le culte. « Jour après jour, je vois des gens venir à l’église sans aucune ouverture à quelque chose de nouveau et de différent. Et si quelque chose de nouveau et de différent arrive, ils se replient dans leur vieille boite. Leur attitude semble être : « je ne serai pas impressionné par l’admiration et l’émerveillement ». Je ne pense pas que nous allions très loin avec cette résistance au nouveau, au Réel, au surprenant. C’est probablement pourquoi Dieu permet que nos plus belles relations commencent par un engouement pour une autre personne – et je n’entends pas seulement un engouement sexuel, mais une profonde admiration et considération. Cela nous permet de prendre notre place comme apprenant et étudiant. Si nous ne faisons pas cela, il ne va rien arriver ».
Plus largement, Richard Rohr évoque la pensée de l’écrivain russe, Alexandre Soljhenitsyne. « Il écrivait que le système occidental, dans son état actuel d’épuisement spirituel, ne paraissait pas attractif. C’est un jugement significatif. L’esprit occidental refuse presque à être encore en émerveillement. Il est seulement conscient de ce qui est mauvais et semble incapable de rejoindre ce qui est encore bon, vrai et beau. Le seul moyen de sortie se trouve dans une imagination nouvelle et une nouvelle cosmologie, suscitée par une expérience de Dieu positive. Finalement, l’éducation, la résolution de problèmes et une idéologie rigide sont toutes, en elles-mêmes, inadéquates pour créer une espérance et un sens cosmique. Seule « une grande religion » peut faire cela et c’est probablement pourquoi Jésus a passé une si grande partie de son ministère à essayer de réformer la religion ».
Richard Rohr peut ensuite évoquer ce qu’apporte une religion saine. « Elle nous donne un sens fondamental de « awe », un émerveillement éveillant la transcendance… Elle réenchante un univers autrement vide. Elle éveille chez les gens une révérence universelle envers toutes choses. C’est seulement dans une telle révérence que nous pouvons trouver confiance et cohérence. C’est seulement alors que le monde devient une maison « home » sure. Alors nous pouvons voir la réflexion de l’image divine dans l’humain, dans l’animal, dans le monde naturel entier, qui est alors devenu intrinsèquement surnaturel ».
Nous sommes ce que nous voyons
« We are what we see”
Selon Richard Rohr, la contemplation approfondit notre capacité à nous étonner, à être surpris. « Les moments d’admiration et d’émerveillement (awe and wonder) sont les seuls fondements solides pour notre sentiment et notre voyage religieux ». Le récit de l’Exode noue en apporte un bon exemple : « Ce récit commence avec l’histoire d’un meurtrier (Moïse) qui s‘enfuit des représailles de la loi et rencontre « un buisson paradoxal qui brule sans être consumé ». Touché par une crainte révérentielle (awe), Moïse enlève ses chaussures et la terre en dessous de ses pieds devient une terre sacrée » (holy ground » (Exode 3.2-6). Parce qu’il a rencontré « Celui qui est » (Being itself) (Exode 3.14). Ce récit manifeste un modèle classique répété sous des formes différentes dans des vies différentes et dans le vocabulaire de tous les mystiques du monde ».
Certes, il y a des obstacles. « Je dois reconnaitre que nous sommes généralement bloqués vis-à-vis d’une grand impression de « awe » comme nous le sommes vis-à-vis d’un grand amour ou d’une grande souffrance. La première étape de la contemplation porte largement sur l’identification et le relâchement de ces blocages en reconnaissant le réservoir d’attentes, de présuppositions, et de croyances dans lesquelles nous sommes déjà immergés. Si nous ne voyons pas ce qu’il y a dans notre réservoir, nous entendrons toutes les choses nouvelles de la même manière ancienne et rien de nouveau n’adviendra »… La contemplation remplit notre réservoir d’une eau pure et claire qui nous permet de réaliser des expériences en étant libérés de nos anciens schémas ».
De fait, ajoute Richard Rohr, nous ne nous rendons pas compte qu’au moins partiellement, notre réaction enthousiaste ou colérique , peureuse n’est pas entrainée uniquement par la personne ou la situation en face de nous. « Si la vue d’un beau ballon dans le ciel nous rend heureux, c’est que nous sommes déjà prédisposés au bonheur. Le ballon à air chaud nous fournit juste une occasion. Et presque n’importe quoi d’autre aurait produit la même impression. Comment nous voyons déterminera largement ce que nous voyons et si cela provoque en nous de la joie ou, au contraire, une attitude de repli émotionnel. Sans nier qu’il y ait une réalité extérieur objective, ce que nous sommes capable de voir dans le monde extérieur, et prédisposé en ce sens, est une réflexion en miroir de notre monde intérieur et état de conscience sur le moment. La plupart du temps, nous ne voyons pas du tout et opérons sur le mode d’un contrôle de croisière.
Il semble que nous, humains, sommes des miroirs à deux faces reflétant à la fois le monde intérieur et le monde extérieur. Nous nous projetons nous-mêmes sur les choses extérieures et ces mêmes choses nous renvoient au déploiement de notre propre identité. La mise en miroir est la manière dont les contemplatifs voient de sujet à sujet plutôt que de sujet à objet ».
Une « awe », émerveillement ébloui, qui connecte
« An awe that connects »
Richard Rohr fait appel à Judy Cannato qui met l’accent sur la surprise, l’ébahissement comme point de départ de la contemplation. « Dans son livre : « Le pleur silencieux », la théologienne allemande Dorothee Sölle écrit : « Je pense que chaque découverte du monde nous plonge dans la jubilation ; une surprise radicale qui déchire le voile de la trivialité ». Quand le voile est déchiré et que notre vision est claire, alors émerge la reconnaissance que toute vie est connectée – une vérité qui n’est pas seulement révélée par la science moderne, mais qui résonne avec les mystiques anciens. Nous sommes tous un, connectés et rassemblés dans un Saint Mystère, au sujet duquel, dans toute son ineffabilité, nous ne pouvons demeurer indifférents »
Or, d’après Sölle, la surprise, l’ébahissement est un point de départ. « Elle maintient qu’une surprise radicale est le point de départ pour la contemplation. Souvent, nous pensons que la contemplation appartient au domaine du religieux, à un stade ésotérique de prière avancée que seuls les gens spirituellement doués possèdent. Ce n’est pas le cas. La nature de la contemplation telle que je la décris ici est qu’elle demeure à l’intérieur de chacun de nous.
Pour utiliser une parole familière, la contemplation consiste à avoir un long regard amoureux vis-à-vis du réel. La posture contemplative qui découle d‘une surprise radicale, d’un ébahissement, nous attrape dans l’amour – l’Amour qui est le Créateur de tout ce qui est, le Saint Mystère qui ne cesse de surprendre, qui ne cesse de prodiguer l’amour en nous, sur nous, autour de nous ».
Mais comment reconnaitre et nous approcher du « réel » ? Judy Cannnato nous répond en ce sens. « La contemplation est un long regard d’amour sur ce qui est réel. Combien de fois ne sommes-nous pas trompés par ce qui imite le réel ? Vraiment nous vivons dans une culture qui affiche le faux et prospère dans une fabrication scintillante. Nous sommes tellement bombardés par le superficiel et le trivial que nous pouvons perdre nos appuis et nous abandonner à un genre de vie qui nous vide de notre humanité… Quand nous nous engageons dans une pratique de surprise radicale (« radical amazement »), nous commençons à distinguer ce qui est authentique de ce qui est frelaté.
Saisis par la conscience contemplative et enracinés dans l’amour, nous commençons à nous libérer de nos conditionnements culturels et à embrasser la vérité qui demeure au cœur de toute réalité : nous sommes un ».
Ainsi la contemplation n’est pas réservée à une élite religieuse ou spirituelle, elle donne à voir à tous. « Ce qui devient plus apparent aujourd’hui, c’est que nous devons devenir des contemplatifs, pas seulement dans la manière où nous réfléchissons ou prions, mais dans la manière où nous vivons éveillés, alertes, engagés, prêts à répondre aux gémissements de la création ».
La dignité de toutes choses
« The dignity of all things”
Le rabbin Abraham Joshua Heschel est connu pour son action prophétique et pour son engagement en faveur d’une surprise radicale. Le théologien Bruce Epperly explique :
« Au cœur de la vision mystique d’Heschel, il y a l’expérience d’une surprise radicale. La merveille est essentielle à la fois pour la spiritualité et la théologie. La « awe », émerveillement ébloui, donne le sens de la transcendance. Elle nous permet de percevoir les signes du divin dans le monde. La merveille mène à la surprise radicale dans l’univers de Dieu. Créé à l’image de Dieu, chacun de nous est surprenant. La merveille mène à la spiritualité et à l’éthique. Comme Heshel le déclare : « Simplement être est une bénédiction. Simplement vivre est saint. Le moment est la merveille ».
Comment cette sensibilité affecte-t ’elle notre vision du monde ? Elle fonde la vision du monde d’Heshel. « Le monde se présente à moi de deux manières : comme une chose que je possède ; comme un mystère qui se présente à moi. Ce que je possède est une bagatelle ; ce qui se présente à moi est sublime. Je prends soin de ne pas gaspiller ce que possède ; je dois apprendre à ne pas manquer ce qui se présente à moi.
Nous traitons ce qui est accessible à la surface du monde ; Nous devons également nous tenir en révérence (« awe ») vis-à-vis du mystère du monde »
Reprenons donc notre approche de la « awe », de l’émerveillement ébloui.
« La « awe » est plus qu’une émotion. C’est une manière de comprendre, une entrée dans un sens plus grand que nous. Le commencement de la « awe », c’est reconnaitre la merveille, s’émerveiller ». Et « le commencement de la sagesse est la « awe », cet émerveillement ébloui et révérenciel. « La « awe » est une intuition de la dignité de toutes choses. C’est réaliser que les choses ne sont pas seulement ce qu’elles sont, mais qu’elles se tiennent là, quelqu’en soit l’éloignement, pour signifier quelque chose de suprême.
L’« awe » est un sens du mystère au-delà de toute chose. Elle nous permet de sentir dans les petites choses le début d’un sens infini, de sentir l’ultime dans le commun et le simple ; de sentir le calme de l’éternel dans la précipitation de ce qui passe. Nous ne pouvons pas comprendre cela par l’analyse ; Nous en devenons conscient par la « awe ». Voilà aussi un éclairage pour la foi : « la foi n’est pas une croyance, l’adhésion à une proposition. La foi est un attachement à la transcendance, au sens au-delà du mystère… La « awe » précède la foi. Elle est à la racine de la foi… »
C’est dire combien la « awe » est fondamentale. « Si notre capacité de révérence diminue, l’univers devient pour nous un marché. Un retour à la révérence est le premier prérequis pour un réveil de la sagesse, pour la découverte du monde comme une allusion à Dieu ».
La pratique spirituelle de la « awe ».
« The spiritual practice of awe”
Comment pouvons-nous vivre dans un état d’esprit d’émerveillement porteur d’une pratique spirituelle ? La question est posée à Cole Arthur Riley, écrivain et liturgiste. Il nous décrit « la « awe » comme une pratique spirituelle ». « Je pense que la « awe » est un exercice à la fois dans le faire et l’être. C’est un muscle spirituel de l’humanité que nous pouvons empêcher de s’atrophier si nous l’exerçons habituellement. Je m’assois dans la clairière derrière ma maison écoutant le chant des hirondelles rustiques se mêlant au bruit des voitures accélérant. J’observe le courant de lait dans mon thé et les petites feuilles danser librement hors de leur enclos… Quand je parle de merveille, j’entends la pratique de contempler le beau. Contempler le majestueux – le sommet enneigé des Himalayas, le soleil se couchant sur la mer – mais aussi les petits spectacles du quotidien… Plus que dans les grandes beautés de nos vies, la merveille réside dans notre présence d’attention à l’ordinaire. On peut dire que trouver la beauté dans l’ordinaire est un exercice plus profond que grimper dans les montagnes… Rencontrer le saint, le sacré dans l’ordinaire, c’est trouver Dieu dans le liminal, la marge d’où nous pourrions inconsciemment l’exclure… »
Arthur Riley décrit comment l’émerveillement développe la capacité de nous aimer, d’aimer notre prochain, d’aimer l’étranger. « L’émerveillement inclut la capacité d’être en « awe », en émerveillement vis-à-vis de nous-même » Arthur Riley nous incite à être attentif à la vie quotidienne. « Qu’à chaque seconde, nos organes et nos os nous soutiennent est un miracle. Quand nos os guérissent, quand nos blessures se cicatrisent, c’est un appel à nous émerveiller de nos corps – leur régénération, leur stabilité et leur fragilité. Cela fait grandir notre sentiment de dignité. Être capable de s’émerveiller du visage de notre prochain, avec la même « awe », le même émerveillement que nous avons pour le sommet des montagne ou la réflexion du soleil, c’est une manière de voir qui nous empêche de nous détruire les uns les autres ». L’émerveillement, ce n’est pas nous dissoudre, mais nous sentir vivement dans notre connexion avec chaque créature. « Dans un saint émerveillement, nous faisons partie de l’histoire ».
Le privilège de la vie elle-même
« The privilege of life itself”
Ici Richard Rohr s’est adressé à Brian McLaren pour lequel l’émerveillement, la « awe » sont essentiel pour rencontrer la création. « Les premières pages de la Bible et les meilleures réflexions des scientifiques actuels sont en plein accord. Au commencement, tout a commencé quand l’espace et le temps, l’énergie et la matière, la gravité et la lumière sont apparus dans une soudaine expansion. A la lumière du récit de la Genèse, nous dirions que la possibilité de l’univers s’est épanchée dans l’actualité comme Dieu, l’Esprit créateur, prononçait l’invitation première, originale : Qu’il en soit ainsi ! (« Let it be »). Et, en réponse, qu’est-ce-qui est arrivé ? La lumière, le temps , l’espace, la matière, le mouvement, la mer, la pierre, le poisson, le moineau, vous, moi, nous réjouissant de ce don inexprimable, ce privilège d’être ici, d’être en vie », Brian McLaren évoque la beauté qu’on peut entrevoir dans la diversité des dons et des talents. Comme les autres auteurs présents dans cette séquence, il exprime son admiration pour la création. « Est-ce que nous ne nous sentons pas comme des poètes qui essaient d’exprimer la beauté et la merveille de cette création ? Est-ce que nous ne partageons pas une commune stupeur en envisageant notre voisinage cosmique et en nous éveillant au fait que nous sommes réellement là, réellement vivant, juste maintenant ? ». Brin McLaren nous entraine dans l’admiration et l’émerveillement vis-à-vis des merveilles de la montagne et de la mer jusqu’à « regarder avec délice un simple oiseau, un arbre, une feuille ou un ami et à sentir qu’ils murmurent au sujet du créateur, de la source de tout ce que nous partageons ».
En exprimant cette admiration, cette « awe » vis-à-vis de toutes les merveilles qu’on peut entrevoir, Brian McLaren, théologien engagé, ne perd pas de vue les maux de nos sociétés et la nécessité de nous y confronter (3). Mais, dans sa vision enthousiaste, il s’appuie sur un fondement biblique. « La Genèse » signifie : commencements. Elle parle à travers une poésie profonde, à plusieurs couches, et des histoires anciennes et sauvages. La poésie et les récits de la Genèse révèlent des vérités profondes qui nous aident à être plus pleinement vivants aujourd’hui. Elles osent proclamer que l’univers est l’expression de Dieu lui-même. La parole de Dieu agit. Cela signifie que toute chose, partout, est toujours sainte, spirituelle, ayant de la valeur, signifiante. Toute matière importe. La Genèse décrit la grande bonté qui apparait à la suite d’un long processus de création. Cet ensemble harmonieux est si bon que le Créateur prend un jour de congé, juste pour s’en réjouir. Ce jour de repos en réjouissance nous dit que le but de l’existence n’est pas l’argent ou le pouvoir ou la renommée, ou la sécurité ou quoique ce soit moins que ceci : participer à la bonté, à la beauté et à la vitalité de la création.
Un autre regard
Les représentations du monde sont multiples en étant influencées par de nombreux facteurs et, tout particulièrement par ce que nous entendons des évènements. Cette séquence inspirée par Richard Rohr est intitulée : « awe and amazement » ; elle nous apprend à nous émerveiller, tout éblouis par les merveilles qui se présentent à nous, à ciel ouvert, mais aussi au départ dissimulées, cachées à nos yeux parce que nous n’y prêtons pas attention. Ce mouvement d’émerveillement exprimé par le terme « awe », dont le sens s’est déplacé à travers l’histoire de « crainte révérentielle » dans un contexte religieux à un émerveillement ébloui accompagné par un sentiment d’ouverture à la transcendance, doit être aujourd’hui pleinement reconnu. Par-delà des apparences souvent trompeuses ou l’assujettissement à de sombres situations, nous sommes appelés à reconnaitre dans la contemplation une Réalité spirituelle, une présence divine. Cet éclairage, et parfois cette illumination peuvent nous surprendre. Cependant, ce sentiment d’admiration, cette « awe », ne sont pas réservés à des moments privilégiés. On peut les éprouver dans le quotidien et même en regardant de belles photos comme l’écrit le rabbin Hara Person dans un texte final : « une part de beauté » (« A slice of beauty »). Bref, au total, nous sommes conviés à un autre regard.
Sans expertise professionnelle de la traduction, rapporté par J H
- Awe and amazement. Avec la présentation et la référence des six textes constituant la séquence : https://cac.org/daily-meditations/awe-and-amazement-weekly-summary/
- Comment la manifestation de l’admiration et de l’émerveillement exprimée par le terme « awe » peut transformer nos vies : https://vivreetesperer.com/comment-la-reconnaissance-et-la-manifestation-de-ladmiration-et-de-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-peut-transformer-nos-vies/
- Reconnaitre aujourd’hui un mouvement émergent pour la justice dans une inspiration de long cours : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-aujourdhui-un-mouvement-emergent-pour-la-justice-dans-une-inspiration-de-long-cours/
On pourra lire aussi :
La participation des expériences spirituelles à la conscience écologique : https://vivreetesperer.com/la-participation-des-experiences-spirituelles-a-la-conscience-ecologique/
Avoir de la gratitude :
https://vivreetesperer.com/avoir-de-la-gratitude/

par jean | Jan 10, 2024 | Expérience de vie et relation |
Notre relation avec le passé varie selon notre contexte de vie et les circonstances. Lorsque nous ressentons des difficultés psychologiques, nous savons aujourd’hui que notre passé n’y est pas étranger. D’une façon ou d’une autre, nous voici appelés à le revisiter. Mais, dans d’autres situations, nous pouvons trouver un réconfort en évoquant des souvenirs heureux. Jusque dans la vie courante, nous sommes appelés à faire des choix, à nous engager dans telle ou telle orientation. Nous envisageons l’avenir en fonction du sens que peu à peu nous avons donné à notre vie. Or, à chaque fois, les pensées qui nous animent dépendent de notre personnalité Et cette personnalité s’est formée peu à peu en fonction de nos rencontres et de nos découvertes qui se rappellent dans nos souvenirs. Quelle conscience avons-nous de nous-même?
Qui sommes-nous ? En regard de ces questions, nous envisageons la rétrospective de notre vie. Cette vie s’enracine dans un passé, non pas pour y demeurer, mais pour se poursuivre et aller de l’avant. Ainsi, lorsqu’un livre parait avec le titre : « Vivre avec son passé. Une philosophie pour aller de l’avant » (1), nous voilà concerné. En même temps, nous découvrons l’auteur, le philosophe Charles Pépin (2). Auparavant, celui-ci a écrit d’autres livres qui nous amènent à réfléchir au cours de notre vie : « Les vertus de l’échec », « la confiance en soi ». Dans ses livres, et dans celui-ci, Charles Pépin témoigne d’une vaste culture. Ainsi, éclaire-t-il son expérience et ses observations à travers la pensée des philosophes, mais aussi les textes des écrivains, sans oublier l’apport des sciences humaines. En traitant ici de la mémoire, il recourt au nouvel apport des neurosciences. En montrant abondamment combien le passé ne disparait pas, mais est toujours là sous une forme ou sous une autre, Charles Pépin nous incite « à établir une relation apaisée et féconde avec notre mémoire…. Les neurosciences nous apprennent que la mémoire est dynamique, mouvante. Nos souvenirs ne sont pas figés…En convoquant sciences cognitives, nouvelles thérapies, sagesses antiques et classiques de la philosophie, de la littérature ou du cinéma, Charles Pépin nous montre que nous pouvons entretenir un rapport libre, créatif avec notre héritage… » (page de couverture). C’est un livre qui ouvre la réflexion et donc entraine des relectures. Cette présentation se limitera donc à quelques aperçus.
Une présence dynamique du passé
Notre passé n’est pas bien rangé dans une armoire close. Nous devons sortir d’une « représentation de la mémoire, statique… accumulative ». Ce n’est pas « un simple espace de conservation du passé » ( p 15).
Cependant, elle a été longtemps peu considérée par la philosophie jusqu’à ce que « Henri Bergson (3) la place au cœur de sa réflexion à la toute fin du XIXè siècle ». « Il a l’intuition assez folle pour son époque, mais confirmée par la science d’aujourd’hui, que notre mémoire n’est pas statique, mais dynamique, que nos souvenirs sont vivants, sujet à des flux et des reflux, affleurant à notre conscience avant de repartir. Et surtout que notre mémoire est constitutive de notre conscience, et donc de notre identité » ( p 16). Nous ne pouvons faire table rase de notre passé. « Nos souvenirs, notre passé irriguent la totalité de notre activité consciente. Notre passé resurgit constamment dans nos perceptions, dans nos intuitions, dans nos décisions… Nous sommes imprégnés d’un passé qui nous parle et nous oriente… » ( p 21). « Notre passé est bien vivant. Il n’est pas seulement passé, mais bien toujours présent » ( p 24). Cette présence peut nous affecter de diverses façons, dérangeante, mais aussi encourageante, réconfortante.. Tout dépend également de l’accueil que nous offrons à nos souvenirs. Charles Pépin nous incité à écouter Bergson qui « nous engage à une attitude d’accueil créatif et d’ouverture à ce passé qui nous constitue. Si notre personnalité condense la totalité de notre histoire personnelle, l’acte libre devient l’apanage de celui qui « prend son passé avec soi », qui l’emporte tout entier pour le propulser vers l’avenir. Nous pouvons nous saisir en même temps de notre passé et de notre liberté : Bergson ne propose rien d’autre qu’une méthode pour y parvenir » ( p 26) .
Ce que nous savons aujourd’hui sur la mémoire
La recherche sur la mémoire a beaucoup progressé. L’auteur dresse un bilan de ces avancées. Ainsi, on identifie aujourd’hui trois mémoires principales : la mémoire épisodique (ou mémoire autobiographique) qui correspond à la « mémoire souvenir » de Bergson, la mémoire sémantique qui est la mémoire des mots et des idées et la mémoire procédurale, rattachée à nos réflexes et à nos habitudes qui se rapproche de la « mémoire habitude » de Bergson ; auxquelles s’ajoutent les mémoires de court terme, de travail et sensorielle ( p 27-28). L’auteur consacre un chapitre à la présentation de ces différents mémoires et de leurs usages telles qu’elles nous apparaissent aujourd’hui grâce à l’apport des neurosciences.
« Notre mémoire épisodique est le souvenir de notre vécu : ces épisodes prêts à se rappeler à notre conscience pour nous réchauffer l’âme ou nous affliger d’un pincement au cœur…. La mémoire épisodique est le siège de notre histoire » (p 28-29). C’est ainsi que nous pouvons nous remémorer notre vie en un récit.
« Le souvenir n’est pas une trace mnésique localisée… mais une manière dont notre cerveau a été affecté, impacté par ce que nous avons vécu ». « Des expériences ont prouvé que notre mémoire ne peut être localisée dans une zone précise du cerveau … Notre mémoire est dynamique et notre cerveau en continuel mouvement et évolution » ( p 33-34). Notre représentation de cette activité est vraiment nouvelle. Elle s’exerce en terme de réseau et dans des modifications constantes. « Notre cerveau se définit par sa plasticité, sa capacité à évoluer sans cesse… Le cerveau se modifie en permanence, et nous pouvons toujours le transformer à nouveau » ( p 35). Dans ces interconnexions, « le souvenir est comme reconfiguré par ce que nous avons vécu depuis, par le contexte présent ». L’imagination prend part au processus.
« Le sens que nous donnons à nos souvenirs dépend également des idées et des valeurs que nous leur attribuons, C’est le rôle de la mémoire sémantique » ( p 37). « La mémoire sémantique contient les mots que nous posons sur les objets, les notions, les concepts, les « vérités générales ». En elle s’inscrit notre connaissance du monde. Elle ne se charge pas, comme la mémoire épisodique, des épisodes, mais de ce que nous en avons déduit ». ( p 38) .Si, à partir de certains évènements vécus, nous avons développé des représentations négatives, une dépréciation de nous-même, cela fait partie également de la mémoire sémantique.. Or, à ce niveau, nous pouvons corriger les croyances qui sont néfastes pour nous en réinterprétant les situations dont elle sont originaires. « Il est tout à fait possible de substituer des croyances dans notre mémoire sémantique implicite. Nous pouvons ainsi « échapper au ressassement d’un souvenir douloureux en travaillant sur celui-ci pour changer d’éclairage » ( p 42). L’auteur cite un écrivain marqué par ses origines sociales et qui parvint à se libérer de ses croyances dévalorisantes en développant une nouvelle interprétation ( p 42-46).
Il y a une troisième mémoire. C’est la mémoire procédurale. C’est « la mémoire de nos habitude ou réflexes, celle qui nous permet de conduire une voiture, de faire du vélo, de jouer du piano… » ( p 46). Les savoir-faire enregistrés dans cette mémoire procédurale résistent au temps qui passe, et même aux atteintes d’Alzheimer.
Aux trois mémoires à long terme évoquées précédemment, s’ajoutent deux mémoires é court terme : la mémoire de travail et la mémoire sensorielle ( p 52-55). « Nous vivons ainsi dans un présent constitué de différentes couches du passé… ».
Le passé, socle de notre identité
« La question de l’identité personnelle est un des problèmes philosophiques les plus passionnants, mais aussi les plus complexes » nous dit Charles Pépin. « Qu’est ce qui nous définit en tant qu’individu singulier, nous distingue de tout autre ? Qu’est ce qui demeure en nous de manière permanente et constitue ainsi le socle de notre identité ? » ( p 85).
Si nous nous interrogeons en ce sens, nous sentons bien combien nous pensons notre être, notre personnalité à travers notre histoire personnelle. L’auteur interroge les philosophes. Ici, nous rejoignons la thèse du philosophe anglais, John Locke : « Les souvenirs nous disent que nous sommes nous-mêmes, ils fondent notre conscience de soi, de cette continuité entre toutes nos perceptions » ( p 86). L’auteur poursuit sa réflexion sur « la fabrique de l’identité » : « Notre mémoire n’est pas seulement le réceptacle de notre itinéraire de vie, susceptible d’éclairer nos comportements, nos réactions et émotions. Nos souvenirs fondent la conviction que la personne qui a vécu tous ces évènements est bien identique à celle qui s’en souvient. Ils fondent la conscience d’une identité qui perdure » ( p 89).
L’auteur évoque ensuite l’œuvre de Marcel Proust : « A la recherche du temps perdu ». Celui-ci explore la portée de ses réminiscences. « Bien que soumis, comme toute chose au passage du temps, le narrateur qui trempe sa madeleine dans son thé et se remémore son enfance réalise que, en dépit des années écoulées, charriant leur lot de plaisirs et de peines… quelque chose de lui est demeuré que Proust nomme « le vrai moi…Ce « vrai moi » prend chez Proust de accents mystiques : il s’agit d’un mois profond, d’un moi immuable, d’une essence de moi qui semble indiquer la possibilité d’une vie éternelle. Et si en effet
ce moi résiste au temps, pourquoi ne résisterait-il pas éternellement ? » ( p 95).
Cette lecture du livre de Charles Pépin nous renvoie à une autre : la lecture du livre de Corinne Pelluchon : « Paul Ricoeur. Philosophie de la recontruction » (4), où elle aborde le thème de l’identité à partir du livre de Paul Ricoeur : « Soi-même comme un autre ». L’auteure envisage l’identité comme « une identité narrative, c’est-à-dire qu’elle se recompose sans cesse » ( p 119). « Parler d’identité narrative signifie d’abord que la connaissance de soi passe par le fait de se raconter, de tisser les différents éléments de sa vie pour leur conférer une unité et un sens qui n’est pas définitif et n’exclut pas les mises en question…. L’identité n’est pas figée ni à priori ; elle se transforme et se construit à travers des histoires que nous racontons sur nous-même et sur les autres, et elle se nourrit des lectures et des interprétations qui enrichissent notre perception du monde et de nous » ( p 120).
Remédier aux blessures du passé
Le passé de chacun est différent. Il s’y trouve des joies et des souffrances, des moments de bonheur et des souffrances, des libérations, mais aussi des blessures dont les effets se poursuivent en forme de ruminations et de dépendances. On peut chercher à oublier ces emprises, mais les souvenirs sont vivaces et parfois reviennent au galop. On peut aussi entrer dans la mémoire pour en transformer les effets. Il y aujourd’hui, de nombreuses approches en ce sens, nous rapporte Charles Pépin. C’est une bonne nouvelle.
Alors on peut rejeter la tentation de l’oubli.
Cependant, l’auteur nous décrit les nombreux comportements qui traduisent une volonté de « tourner le dos à son passé ». Si cette attitude peut réussir dans l’immédiat, elle comporte des risques et peut engendre des situations désastreuses. « L’évitement a un coût psychique ». « Nous n’ignorons pas le passé si aisément…Le garder à l’écart impose une lutte constante, qui peut devenir inconsciente, mais certainement pas gratuite » ( p 110). « Plus dangereux est le traumatisme, plus dangereux est le piège de l’évitement » ( p 116). L’auteur décrit des conduites pathologiques en recherche de l’oubli : travailler pour oublier, boire pour oublier… La situation de l’alcoolique est particulièrement critique. Car son addiction peut déboucher sur une altération de la mémoire « antérograde », c’est-à-dire de la capacité à se constituer de nouveaux souvenirs, à garder en mémoire ce qui vient d’être vécu », une faculté compensatrice.. ( p 122-124). « Puisque l’évitement est dangereux, l’oubli impossible, il nous faut donc apprendre à vivre avec notre passé, à « faire la paix » avec lui » ( p 142).
Durant ces dernières décennies, de grands progrès ont été réalisé en psychologie (5) et la gamme des approches s’est considérablement élargie. C’est dans ce contexte que Charles Pépin a écrit un chapitre : « intervenir dans son passé ». Son approche est globale et ne se limite pas à telle ou telle thérapie. « La vie nous offre parfois de porter un autre regard sur notre passé, de changer notre perception de celui-ci. L’élément déclencheur peut aussi bien être une discussion avec un aïeul, une rencontre qui nous ouvre de nouvelles perspectives, une empathie nouvelle pour quelqu’un qui nous a causé du tort, ou encore le temps qui passe et qui crée une distance salutaire…ou tout simplement une joie de vivre retrouvée, une période plus heureuse qui recolore le passé… Notre histoire nous apparait sous un nouveau jour… Nous voilà tout naturellement apaisés, libérés… » ( p 182)..
« Mais il arrive que la vie ne nous offre pas les conditions suffisantes, propices à une rémission de l’hier…. Nous sommes enfermés dans nos ruminations. Certains passés traumatiques rendent alors nécessaires d’intervenir dans notre passé, parfois avec l’aide d’un thérapeute. Les techniques développées dans ce chapitre sont pour la plupart issues des « thérapies de reconsolidation de la mémoire », mais elles dessinent une voie d’intervention que chacun de nous peut mettre en œuvre seul… Ces techniques reposent sur la méthode suivante : intervenir sur le souvenir en modifiant l’émotion ou l’interprétation qui y sont attachées » ( p 183-184). L’auteur propose donc trois approches : Changer la règle de vie implicite attachée au souvenir ; développer une technique d’habituation au mauvais souvenir ; faire intervenir un personnage fictif dans ses souvenirs : les techniques de reparentage (imaginer une figure aimante et bienveillante appelée figure de « reparentage » qui intervient au cœur de l’épisode douloureux remémoré).
A titre d’exemple, rapportons la première approche. Elle consiste à sortir un souvenir de notre mémoire à long terme pour le retraiter dans notre mémoire de travail avant de le « renvoyer » dans notre mémoire de long terme…. Si nous ne pouvons pas effacer un souvenir de notre mémoire épisodique, nous pouvons en revanche effacer ou réinterpréter une règle de vie implicite dans notre mémoire sémantique, déconstruire cette « vérité émotionnelle, héritée de notre passé qui nous entrave » ( p 184).
Charles Pépin évoque trois penseurs contemporains en fin de de XIXè et début de XXè siècle : Bergson, Freud et Proust qui, tous les trois, ont porté une grande attention à la mémoire et à la question du temps ( p 204-206). Il aborde ensuite « la psychanalyse freudienne, un retour au long cours sur son passé ». il rapporte l’évolution de la pratique psychanalytique. « La cure psychanalytique nous guide dans une nouvelle manière de dire les choses, comme elles viennent, sans souci de cohérence, ni de censure morale. Elle nous apprend à diverger et éclairer soudain notre passé d’un jour nouveau ». L’auteur voit dans « cet art de la divergence », « le meilleur antidote du ressassement » ( p 214).
Prendre appui sur son passé
Si le passé peut nous déranger par le souvenir de certaines expériences malheureuses qui stagnent encore et viennent nous assombrir, à l’inverse nous pouvons y trouver force, soutien et consolation. Charles Pépin évoque cet apport positif dans un chapitre : « Prendre appui sur son passé ». Ici, l’auteur se réfère de nouveau à Bergson. « Un désir authentique, en adéquation avec soi-même, explique Bergson, ressaisit toute notre histoire et nous conduit à un objectif qui prend un sens profond pour nous ».
« Lors d’une conférence donnée à Madrid, Henri Bergson synthétise cette idée de ressaisir notre passé pour nous projeter dans l’avenir sous le concept de « récapitulation créatrice » ( p 149). Comme à son habitude, et c’est un apport très riche de son livre qui, par définition, ne peut être mis en valeur par un simple compte-rendu, Charles Pépin appuie son propos par des exemples vivants. Fils de boulanger, dans sa première jeunesse, cet homme avait quitté sa ville natale pour monter à Paris. A l’aube de la trentaine, il fut pris de doutes. Lassé par un travail qui ne lui apportait pas les satisfactions que procure l’artisanat, il reprit l’affaire familiale et fit prospérer cette boulangerie en usant des savoirs appris par ailleurs. Ainsi doit-il le succès de sa reprise de l’entreprise paternelle à la synthèse qu’il a su faire entre ses souvenirs d’enfance et ses expériences professionnelles. Il a récapitulé l’ensemble de son histoire en se montrant créatif pour inventer sa manière personnelle d’être boulanger » ( p 150).
« Dans son « Essai sur les données immédiates de la conscience », Bergson écrit : « Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l’expriment… ». Cette réflexion peut éclairer nos choix. « Notre acte est libre parce que nous nous y « retrouvons ». Toute notre identité s’y exprime comme si notre vie entière devait nous avoir conduit à ce point et à cette prise de décision ». ( p 156-157).
Dans « La pensée et le mouvement », Bergson emploie une jolie expression, « la mélodie continue de notre vie intérieure » pour évoquer ce moment ou nous rencontrons une activité qui nous correspond et nous offre un espace d’expression nouveau : c’est comme si nous entendions notre mélodie intérieure » ( p 165).
Chez Bergson, ce regard sur la vie s’inspire d’une pensée, d’une métaphysique : « la Vie et un « Elan vital », une force de créativité fondamentale qui pulse au cœur même du vivant, de tous les vivants… l’Elan vital se particularise en chacun de nous et, en ce sens, nous manifestons tous une part de cette Vie, de cette force métaphysique que Bergson qualifie de divine » ( p 186-174). « Notre personnalité est plus que le résultat de notre passé, que « la condensation » de l’histoire que nous avons vécue depuis notre naissance » comme l’écrit Bergson dans « L’Evolution créatrice ». Elle est notre identité, mais propulsée vers l’avant, traversée par cette force de vie qui nous pousse à agir, à créer » ( p 174). « Cet Elan vital nous pousse aussi à nous tourner vers les autres, vers le monde, vers l’avenir. Il nous appelle à prendre notre part de responsabilité et nourrir nos élans de générosité. Ainsi l’Elan vital devient une force de décentrement… Nous sentons que la vie qui pulse en nous n’est pas simplement la nôtre, que nous sommes plus que de simples individus isolés : nous appartenons à un tout dont nous sommes solidaires » ( p 178). Tout cela contribue à éviter de ressasser en nous ouvrant au mouvement de la vie ( p 181).
Aller de l’avant avec son passé
Ainsi, dans un chapitre final, Charles Pépin nous invite à aller de l’avant avec notre passé ». L’auteur aborde là des questions sensibles comme la question du pardon ou l’épreuve du deuil. Ce sont là des passages difficiles à franchir. Comme ces thèmes sont complexes, ils demanderaient une analyse approfondie, et après la présentation déjà approfondie de ce livre, nous renvoyons à une lecture directe de ces textes.
Charles Pépin évoque également le soutien que les souvenirs peuvent apporter dans cette marche en avant. Notre mémoire vivante. De nouvelles expériences, de nouveaux intérêts, de nouvelles joies peuvent susciter de nouveaux souvenirs. Et, le cas échéant, ceux-ci pourront « empiéter » sur les mauvais souvenirs, les diluer, et faciliter ainsi notre acceptation du passé (p 231).
Cependant, en terminant cette présentation, nous mettrons l’accent sur un aspect qui nous parait essentiel : l’usage de notre mémoire positive, la remémoration émotionnelle de nos bons souvenirs. « Nous l’oublions trop souvent, mais nous avons ce pouvoir de redonner vie aux belles choses du passé, de les convoquer avec créativité : nos souvenirs heureux, eux aussi, doivent être reconsolidées. Quel dommage de les laisser à l’état de veille, enfouis dans les limbes de notre mémoire, de nous priver de leur éclat, du réconfort qu’ils peuvent nous apporter, du désir de vivre qu’ils peuvent nourrir ici et maintenant » ( p 217). L’auteur ajoute : « Pour goûter à nouveau les plaisirs passés, il faut se montrer non seulement disponible, mais aussi capable de leur ouvrir la porte, d’en tirer le fil avant de se laisser envahir. Comme Proust nous l’a montré, il faut donner au souvenir l’opportunité de revenir dans sa richesse, et non simplement le laisser passer…» ( p 219). Cette culture de la mémoire peut se développer sur tous les registres. L’auteur cite ainsi un texte paru dans « Les confessions » de Saint Augustin une invitation inspirée à retrouver l’éblouissante présence du passé : « Et j’arrive aux plaines, aux vastes palais de la mémoire, là où se trouvent les trésors des images innombrables… ». « iI n’appartient qu’à nous d’exhumer ces trésors pour les contempler » (p 217).
Le livre de Charles Pépin ne nous apporte pas seulement des orientations de réflexion. Il est nourri par des récits d‘expérience. Il permet à un vaste public de s’interroger sur la manière de mieux vivre avec le passé. Bien sûr, ce livre éveille des échos
Dans nos épreuves, c’est bien aux fondations de notre personnalité que nous faisons appel, telles qu’elles sont imprégnées par l’inspiration qui nous porte. C’est bien la mémoire qui entre en jeu. Nous pouvons évoquer d’autres expériences où les souvenirs peuvent nous encourager et nous soutenir. Ainsi pour ceux qui sont assignés à des lieux clos dans toute leur variété de l’ehpad à la prison, les souvenirs heureux peuvent être revécus et importer une forme de bonheur. Una amie, accompagnatrice de nuit dans un ehpad, nous rapportait que le positif dans ses conversations avec les personnes âgées résidait souvent dans leur évocation de souvenirs heureux.
Si nous savons porter notre regard sur le bon et le beau que nous pouvons voir dans le passé, alors nous pouvons exprimer de la gratitude. Pour moi, j’aime le petit chant qui nous invite à « compter les bienfaits de Dieu » et à manifester ma reconnaissance. La gratitude est une composante de la vie spirituelle (6). Comme nous sommes des êtres interconnectés, cette reconnaissance n’est pas seulement individuelle. Elle est collective et elle apparait ainsi dans l’expression biblique. Et si nous pouvons trouver dans notre passé des motifs de gratitude, on sait maintenant, grâce à la recherche en psychologie et en neurosciences, les bienfaits qu’une expression de gratitude engendre en terme de santé mentale et corporelle (7). En inscrivant le déroulement de notre passé dans cet « Elan vital » que Bergson nous décrit, Charles Pépin nous appelle à entrer dans une dynamique pour « vivre avec notre passé »`
J H
- Charles Pépin. Vivre avec son passé Une philosophie pour aller de l’avant. Allary Editions, 2023. Il y a maintenant plusieurs vidéos dans lesquelles Charles Pépin est interviewé sur son livre :France inter : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=vivre+avec+son+passé++You+Tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:4cf8c2c6,vid:KrKgEkytwxU,st:0 Librairie Mollat : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=vivre+avec+son+passé++You+Tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:6c804f91,vid:RDMoO2srfr0,st:0 Métamorphose. Eveille ta conscience : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=vivre+avec+son+passé++You+Tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:c63c05a8,vid:rAWIN_utqX4,st:0
- Charles Pépin. Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Pépin
- Comment, en son temps, le philosophe Henri Bergson a répondu à nos questions actuelles : https://vivreetesperer.com/comment-en-son-temps-le-philosophe-henri-bergson-a-repondu-a-nos-questions-actuelles/
- Corinne Pelluchon. Paul Ricoeur, philosophe de la reconstruction. Soin, attestation, justice. Presses Universitaires de France, 2022
- Les progrès de la psychologie. Un grand potentiel de guérison : https://vivreetesperer.com/les-progres-de-la-psychologie-un-grand-potentiel-de-guerison/
- Avoir de la gratitude. Bertrand Vergely : https://vivreetesperer.com/avoir-de-la-gratitude/
- La gratitude. Un mouvement de vie. Florence Servan-Schreiber : https://vivreetesperer.com/la-gratitude-un-mouvement-de-vie/

par jean | Jan 10, 2024 | Vision et sens |
Pour une vision du monde incarnationnelle.
Selon Richard Rohr (1)
Il y a plusieurs manières d’envisager le monde et de nous y situer. A cet égard, Richard Rohr distingue quatre grandes visions du monde que nous pouvons identifier en y regardant bien. Richard Rohr prend soin de nous dire qu’elles peuvent s’exprimer de bien des manières et qu’elles ne sont pas nécessairement séparées .
« Ceux qui ont une vision du monde matérielle croient que l’univers extérieur, visible est le monde ultime et « réel ». Les gens qui partagent cette vision du monde nous ont donné la science, la technologie, la médecine et beaucoup de ce que nous appelons aujourd’hui la civilisation. Une vision matérielle du monde tend à engendrer des cultures fortement orientées vers la consommation et vers la compétition et qui sont souvent préoccupées par le manque, puisque les biens matériels sont toujours limités ».
« La vision spirituelle du monde caractérise de nombreuses formes de religion et quelques philosophies idéalistes qui reconnaissent la primauté et la philosophie de l’esprit, la conscience, le monde invisible derrière toutes les manifestations. Cette vision du monde est en partie bonne aussi parce qu’elle maintient la réalité du monde spirituel, laquelle est déniée par de nombreux matérialistes. Mais, portée aux extrêmes, la vision du monde spirituel s’intéresse peu à la terre, au prochain, à la justice, parce qu’elle considère le monde pour une bonne part comme une illusion ».
Richard Rohr décrit ensuite une troisième vision. « Ceux qui adhèrent à ce que j’appellerai une vision du monde « sacerdotale » sont généralement des gens sophistiqués, qualifiés et expérimentés qui pensent que leur travail est de nous aider à mettre ensemble la matière et l’Esprit. Le mauvais côté est que cette vision du monde assume que ces deux mondes sont en fait séparés et ont besoin de quelqu’un pour les lier à nouveau ensemble ».
Richard Rohr fait ressortir une quatrième vision du monde. En contraste avec les trois visions précédentes, c’est une vision incarnationnelle selon laquelle la matière et l’Esprit sont envisagés comme n’avoir jamais été séparés. La matière et l’Esprit se révèlent et se manifestent l’un à l’autre. Cette vision du monde se fie davantage à l’éveil qu’à l’adhésion, davantage au voir qu’à l’obéissance, davantage à la croissance dans la conscience et l’amour qu’au clergé, aux experts, à la moralité, aux écritures ou à la prescription de rituels ».
Mais dans quels milieux les différentes visions du monde se manifestent-elles ? Dans l’histoire chrétienne, la vision incarnationnelle se manifester des plus fortement chez les premiers Pères de l’Eglise orientaux, dans la spiritualité celtique, chez beaucoup de mystiques associant la prière avec un intense engagement social, dans la spiritualité franciscaine en général, chez beaucoup de mystiques de la nature et dans l’éco-spiritualité contemporaine. Dans l’ensemble, une vision matérialiste est répandue dans le domaine technocratique et les domaines que ses adhérents colonisent. La vision du monde spirituelle est portée par toute une gamme de gens ardents et ésotériques et on trouve la vision du monde sacerdotale dans presque toutes les religions organisées ».
Richard Rohr nous introduit ensuite dans le vécu de cette vision incarnationnelle. « Une vision du monde incarnationnelle fonde la sainteté chrétienne dans une réalité objective et ontologique au lieu de seulement une conduite morale. C’est son grand bienfait. Cependant, c’est le saut important qu’un si grand nombre de gens n’ont pas fait. Ceux qui ont franchi le pas peuvent se sentit saint dans un lit d’hôpital ou un bistrot aussi bien que dans une chapelle. Ils peuvent voir Christ dans ce qui parait défiguré et brisé aussi bien que dans ce qui est appelé parfait ou attractif. Ils peuvent s’aimer et se pardonner eux-mêmes parce qu’ils portent également l’image de Dieu (« imago Dei »). La conscience du Christ incarné mènera normalement vers des implications immédiates, pratiques et sociales. Ce n’est jamais une abstraction ou une théorie. Ce n’est pas même une agréable idéologie.
Si c’est un christianisme vraiment incarné, alors c’est toujours une religion vécue comme expérience concrète et non pas seulement de l’ésotérisme, des systèmes de croyance ou une médiation sacerdotale
Pour mieux envisager cette vision du monde incarnationnelle, on se reportera au livre de Richard Rohr : « The divine dance », tel que nous l’avons présenté sur ce blog (2). Nous y voyons un univers sans frontière, interrelationnel, ou circule le flux divin. « Dieu est celui que nous avons nommé Trinité, le flux (« flow » qui passe à travers toute chose sans exception et qui fait cela depuis le début. Ainsi, toute chose est sainte pour ceux qui ont appris à le voir ainsi… Que nous le voulions ou pas… Ce n’est pas une invitation que nous puissions accepter ou refuser. C’est une description de ce qui est en train de se produire en Dieu et dans toute chose créée à l’image et à la ressemblance de Dieu » (p 37-38).
Texte de Richard Rohr rapporté par J H
- « An incarnational Worldview » (Une vision du monde incarnationnelle : https://cac.org/daily-meditations/an-incarnational-worldview/
- La danse divine : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/
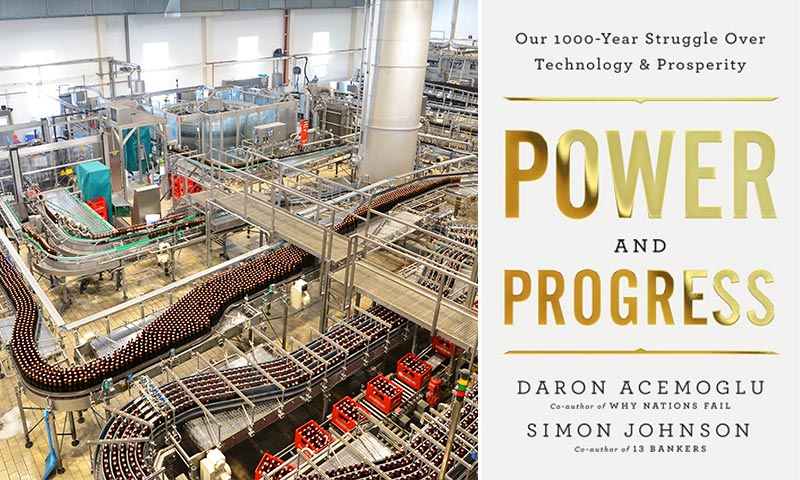
par jean | Déc 25, 2023 | Société et culture en mouvement |
Des exemples de l’histoire aux menaces actuelles.
Power and progress
Par Daron Acemoglu et Simon Johnson
Il n’y a pas très longtemps, tout ce qui paraissait un progrès technologique excitait l’enthousiasme comme la promesse d’une abondance dans une société prospère d’où disparaitrait la pauvreté et la misère. Aujourd’hui, on se rend compte qu’au cours des quatre dernières décennies, les sociétés occidentales et particulièrement la société américaine, ont pris le chemin inverse, en devenant beaucoup plus inégalitaires. Et on prend également conscience que la course au développement économique bouleverse notre écosystème planétaire et dérégule le climat par un usage forcené des énergies fossiles. Aujourd’hui, la conscience écologique suscite une réaction à l’échelle planétaire. Face à des ambitions démesurées, la prudence s’impose et on en appelle même aux mérites de la sobriété.
Deux chercheurs américains au MIT, Daron Acemoglu et Simon Johnson, directement confrontés à la course effrénée à l’automatisation qui bouleverse les équilibres de l’économie américaine, viennent d’écrire un livre qui situe nos problèmes actuels dans une histoire longue où l’on constate qu’en maintes périodes, les acquis du progrès technologique ont été confisqués par un groupe dominant aux dépens des travailleurs ayant porté cette innovation. Les auteurs nous apportent cependant une bonne nouvelle : à d’autres périodes, des forces sociales se sont élevées dans la société et ont permis un développement équilibré au bénéfice de tous. Ce livre : « Power and Progress. Our Thousand-year struggle over technology and prosperity” (1) nous montre comment garder notre autonomie par rapport aux dévoiements de processus économiques contrôlés à leur profit par des élites égoïstes ». « Le progrès n’est pas automatique, mais il dépend des choix que nous faisons en matière de technologie. De nouvelles manières d’organiser la production et la communication peuvent, soit servir les intérêts étroits d’une élite, soit devenir le fondement d’une prospérité étendue ». Ce problème est d’actualité « à un époque où les technologies digitales et l’intelligence artificielle accroissent l’inégalité et minent la démocratie à travers une automatisation excessive, une collecte massive des données et une surveillance intrusive ». « Il n’est pas obligé qu’il en soit ainsi. ‘Power and Progress’ démontre que la voie de la technologie peut être mise sous contrôle. Les formidables avancées informatique du dernier demi-siècle peuvent devenir des outils d’autonomisation et de démocratisation, mais pas si les décisions majeures demeurent dans les mains de quelques leaders technologiques animés par une hubris » (page de couverture). Ce livre, jusqu’à présent non traduit en français, est présenté en cette langue par un expert. On pourra se reporter à son article : « La chaire» a lu pour vous : https://www.chaireeconomieduclimat.org/points-de-vue/la-chaire-a-lu-pour-vous-power-and-progress-our-thousand-year-struggle-over-technology-and-prosperity-de-daron-acemoglu-et-simon-johnson/
Aussi, nous nous bornerons ici à présenter quelques aperçus significatifs de ce livre.
Comment des bénéfices de progrès technologiques substantiels ont été captés par une élite politique ou religieuse
Les auteurs remontent loin dans le passé pour mettre en évidence, la manière dont des progrès technologiques majeurs ont été captés par des élites politiques ou religieuses. Il y a environ douze mille ans, est apparu un processus menant à une agriculture installée, permanente, fondée sur des plantes et des espèces domestiquées. Des genres différents de société apparurent. Mais il y a 7000 ans, un régime particulier se développa dans le Croissant fertile. Le fondement était une agriculture avec une seule récolte. Les inégalités économiques s’intensifièrent et une haute hiérarchie sociale apparut, consommant beaucoup. En Égypte, pyramides et tombes se développèrent dans le cadre d’une élite comparable. C’est là que les auteurs mettent en évidence l’introduction des grains de céréales comme « un exemple d’innovation technologique ». Or, sous les auspices d’états centralisés, la condition des paysans semble avoir été pire que celle de leurs ancêtres. De fait, « les choix technologiques dans les premières civilisations ont favorisé les élites et appauvri la plupart des gens ». Les auteurs décriront une situation comparable au Moyen âge anglais. « Dans les deux cas, le système politique plaçait un pouvoir disproportionné dans les mains d’une élite. La coercition jouait un rôle bien sûr, mais le pouvoir de persuasion de la religion et les leaders politiques étaient souvent un facteur décisif » (p 115-120).
« Cependant, ni la monoculture du grain, ni l’organisation hautement hiérarchisée qui extorquait le surplus aux fermiers, n’a été ordonnée ou dictée par la nature des récoltes correspondantes. Même la culture de céréales n’a pas toujours produit l’inégalité et la hiérarchie comme l’illustrent les plus égalitaires vallées de l’Indus et la civilisation mésoaméricaine. La culture du riz dans l’Asie du Sud-est a pris place dans le contexte de sociétés moins hiérarchiques… (p 122).
« Contrairement à une opinion répandue, il y a eu un changement et une amélioration technologique significative dans la productivité économique de l’Europe au Moyen Age… Cependant, il y a quelque chose de tout à fait sombre à cette époque. La vie des gens travaillant la terre resta dure et le niveau de vie des paysans peut même avoir décliné dans certaines parties de l’Europe. La technologie et l’économie ont progressé d’une manière qui s‘est révélée nuisible pour la plus grande part de la population » (p 100-101). En Angleterre, le développement des moulins a été une innovation décisive. A la fin du XIe siècle, il y a environ 6000 moulins à eau en Angleterre et ce nombre a doublé durant les deux siècles suivants et leur productivité s’est accrue. La productivité agricole s’est également accrue. Malheureusement, il n’y a pas eu une élévation correspondante des revenus chez les paysans. Le surplus a été, de fait, majoritairement consommé par « la hiérarchie religieuse qui a construit des cathédrales, des monastères et des églises » (p 103). Cette construction a été couteuse. Le contrôle féodal a exercé une coercition : « Comme les nouvelles machines se déployaient et que la productivité augmentait, les seigneurs féodaux ont exploité plus intensément la paysannerie ».
Les auteurs nous rapportent ensuite comment s’est déroulée, au XVIIIe siècle en Angleterre, la pression en faveur de la clôture des terres, les « enclosures ». « Cette histoire a montré clairement que cette réorganisation technologique de la production, même lorsqu’elle était proclamée dans l’intérêt du progrès et du bien commun, avait pour conséquence de mettre davantage à bas ceux qui étaient déjà dépourvus de pouvoir ».
Les auteurs envisagent ensuite deux moments de l’histoire très différents où le progrès technologique n’a pas profité aux travailleurs, mais a participé à leur asservissement : l’introduction de l’égraineuse de grains de coton dans les plantations américaines à la fin du XVIIIe siècle ; le développement du machinisme agricole dans les années 1920 en Union soviétique. « Le secteur cotonnier a fleuri Etats-Unis grâce aux nouvelles connaissances comme l’égraineuse de coton et d’autres innovations aux dépens des esclaves noirs travaillant dans les grandes plantations. L’économie soviétique a grandi rapidement dans les années 1920 en utilisant le machinisme, tel que les tracteurs et les moissonneuses batteuses, appliqué aux champs de céréales. Cependant, la croissance s’est produite au détriment de millions de petits paysans » (p 133).
Lorsque la prospérité accompagne le progrès technologique
Les auteurs nous présentent dans ce livre une histoire du progrès technologique. Ils consacrent ainsi le chapitre 5 à la grande révolution industrielle qui a métamorphosé le visage économique de la Grande-Bretagne au XVIIIe et XIXe siècle. Ce fut l’invention bouleversante de la machine à vapeur. Ce livre nous rapporte cette épopée industrielle, le développement des mines de charbon, la fulgurante expansion des chemins de fer et une dynamique d’invention et de réalisation de nouvelles machines.
Un changement technologique et économique aussi conséquent et radical apparait dans l’histoire comme un phénomène original. Les auteurs s’interrogent donc sur les facteurs originaux de cette irruption. Ils mettent l’accent sur un facteur « souvent sous-estimé » : « l’émergence d’une classe moyenne nouvellement enhardis : entrepreneurs et hommes d’affaires. Leurs vies et leurs aspirations étaient enracinés dans les changements institutionnels qui avaient commencé à donner du pouvoir à ce milieu social depuis le XVIe et le XVIIe siècle. La Révolution industrielle peut avoir été propulsée par les ambitions de gens nouveaux essayant d’améliorer leur richesse et leur standing social, ce qui était loin d’une vision inclusive » (p 45-46).
En effet, au début de la Révolution industrielle, si des hommes ont participé à un enthousiasme innovant, « la première phase de cette Révolution a été appauvrissante et affaiblissante pour la plupart des gens. C’était la conséquence d’un fort parti pris d’automatisation et dans le manque de voix ouvrière en regard de la fixation des salaires. Ce ne sont pas seulement les moyens de subsistance qui ont été affectés négativement par l’industrialisation mais aussi la santé et l’autonomie d’une bonne part de la population.
Cette affreuse image a commencé à changer dans la seconde partie du XIXe siècle quand des gens ordinaires se sont organisés et ont provoqué des réformes politiques et économiques. Les changements sociaux ont modifié l’orientation de la technologie et fait monter les salaires. Ce fut seulement une petite victoire pour une prospérité partagée et les pays occidentaux auront à cheminer plus longuement sur un chemin contesté, technologique et institutionnel, pour réaliser une prospérité partagée » (p 56).
Selon les auteurs, l’emploi dépend des modes d‘industrialisation. Au début de la révolution industrielle, l’automatisation de la filature et du tissage a nui à l’emploi. Au contraire, dans la période ultérieure, le développement des chemins de fer a suscité toute une gamme d’emploi.
« Les avancées dans les chemins de fer suscitèrent beaucoup de nouvelles tâches dans l’industrie des transports et les emplois requéraient toute une gamme de capacités de la construction à la vente de tickets, maintenance, ingénierie, et management » (p 196). Des contrepoids sont apparus permettant le partage des bénéfices du progrès technologique. « Un machinisme et des méthodes de production se sont développés et ont accru la productivité de l’industrie britannique, en même qu’elle étendait aussi la gamme de tâches et d’opportunités pour les travailleurs. Mais le progrès technologique n’est jamais suffisant en lui-même pour élever les salaires. Les travailleurs ont besoin de développer un plus grand pouvoir de négociation vis-à-vis des employeurs ». C’est en 1871 que les syndicats devinrent pleinement légaux en Grande-Bretagne (p 202).
Il y a d’autres périodes où le progrès technologique a contribué à une diversification et à une multiplication des emplois. Les auteurs étudient en ce sens le développement de l’électrification et celui de la production d’automobiles aux Etats–Unis. Ils envisagent la grande période de progrès technologique, de croissance économique et de bien-être social qu’ont été les trois décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale. « Les Etats-Unis et les nations industrielles ont fait l’expérience d’une croissance économique rapide qui a été largement partagée par la plupart des groupes démographiques. Ces tendances économiques ont été de pair avec d’autres améliorations sociales, incluant l’expansion de l’éducation, les soins de santé et l’augmentation de l’espérance de vie. Ce changement technologique n’a pas seulement automatisé le travail mais il a aussi créé de nouvelles opportunités pour les travailleurs et ceci s’est inscrit dans un cadre institutionnel qui a renforcé les contre-pouvoirs » (p 36).
« Quelle a été la sauce secrète de la prospérité partagée dans les décennies ayant suivi la seconde guerre mondiale ? La réponse réside en deux éléments : une direction de la technologie qui a créé de nouvelles tâches et emplois pour des travailleurs de tous les niveaux de qualification et un cadre institutionnel permettant aux travailleurs de partager les gains de productivité entre employés et employeurs » (p 240). Les auteurs traitent de cette histoire aux Etats-Unis en montrant comment elle a notamment bénéficié des réformes du New Deal et il aborde cette histoire équivalente de progrès en Europe dans le contexte de la reconstruction après la guerre et un esprit social tel qu’il a été exprimé en Angleterre dans le Rapport Beveridge qui proclame « l’abolition du besoin » (p 249).
Faire face aujourd’hui à la nouvelle crise économique qui est venue s’inscrire dans la révolution digitale à travers un accroissement des inégalités et la menace d’une automatisation dévastatrice.
Née aux Etats-Unis et portant d’extraordinaires promesses, la révolution digitale y a été détournée à la fin du XXe siècle. « Les technologies digitales sont devenues le cimetière de la prospérité collective. L’augmentation des salaires a baissé, la part du travail dans le revenu national a diminué fortement et l’inégalité des salaires a surgi autour de 1980. Bien que de nombreux facteurs, incluant la globalisation et l’affaiblissement du mouvement syndical, aient contribué à cette transformation, le changement opéré dans la technologie est le plus important. Les technologies digitales ont automatisé le travail et désavantagé le travail par rapport au capital et les travailleurs peu qualifiés par rapport aux diplômés universitaires » (p 257). Dans la plupart des économies industrialisées, la part du travail a diminué. Aux Etats-Unis, la régression a pris un tour particulièrement défavorable. Un fossé s’est à nouveau accru entre les salaires des blancs et des noirs. L’inégalité s’est considérablement accrue.
Les auteurs en imputent la cause principale à un automatisation massive. Dans les décennies précédant la seconde guerre mondiale, l’automatisation est également rapide, « mais elle était contrebalancée par d’autres changements technologiques qui augmentaient la demande de travail.
La recherche récente montre que depuis 1980, l’automatisation s’est accélérée significativement et qu’il y a moins de tâches et de technologies nouvelles qui créent des opportunités pour les gens. Ces changements entrent pour beaucoup dans la détérioration de la position des travailleurs dans l’économie…
L’automatisation a été aussi un accélérateur majeur de l’inégalité en affectant des tâches remplies particulièrement par des travailleurs peu ou moyennement qualifiés » (p 261).
Les auteurs soulignent qu’il n’y a pas là une fatalité. « La technologie a accru les inégalités à cause des choix que des entreprises ou de puissants acteurs ont effectué. La globalisation n’est pas séparée de cette question… De fait, il y a eu une synergie entre automatisation et globalisation avec le même souci de réduire les coûts du travail et le nombre de travailleurs moins qualifiés. Ce processus a été facilité à la fois par le manque de contre-pouvoirs dans le milieu du travail et par l’évolution politique depuis 1980 (p 263). Les auteurs dressent un tableau des pressions exercées par les grandes entreprises et les milieux d’affaire et ils mettent en évidence les idéologies correspondantes telles que la « doctrine Friedman ». Dans d’autres pays, les dérives ont été moins marquées. Les auteurs mentionnent les cas de l’Allemagne et du Japon où on a combiné l’automatisation et la création de tâches nouvelles (p 286).
Les auteurs critiquent une nouvelle ‘utopie digitale’ : « la transformation de l’éthique des hackers en une utopie digitale corporative est largement liée à une poursuite de l’argent et du pouvoir social » (p 289). C’est une idéologie de la ‘disruption’, une forme sauvage d’innovation qui détruit les anciens équilibres. « Ce biais technologique est très largement un choix, et un choix construit socialement. Alors les choses ont commencé à devenir bien pires économiquement, politiquement et socialement, alors que les nouveaux visionnaires trouvent un nouvel outil pour refaire la société : l’intelligence artificielle » (p 296).
Pourquoi considérer l’intelligence artificielle avec réserve et avec prudence
Dans la perspective de l’histoire récente de l’usage d’internet, l’emballement de certains vis-à-vis de la promotion de l’intelligence artificielle parait suspect.
Les auteurs consacrent un chapitre à l’intelligence artificielle en en montrant les usages potentiels, les apports, les risques et aussi les limites. Nous renvoyons à ce chapitre écrit avec maitrise et expertise ; ‘Artificial struggle’ (p 297-338). Nous en rendrons compte ici par une courte présentation des auteurs. « Ce chapitre explique que la vision d’internet post-1980 qui nous a égarés, en est venue aussi à définir comment concevoir la nouvelle phase des technologies digitales, ‘l’intelligence artificielle’ et comment l’intelligence artificielle exacerbe les tendances vers l’inégalité économique.
En contraste des proclamations effectuées par beaucoup de leaders de la tech, nous verrons aussi que dans la plupart des tâches humaines, les technologies actuelles de l’intelligence artificielle apportent seulement des bénéfices limités. De plus, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la surveillance au lieu de travail ne propulse pas seulement l’inégalité, mais elle prive également les travailleurs de leur pouvoir d’action (disempower). Pire, un usage courant de l’intelligence artificielle risque de renverser des décennies de gain économique dans les pays en développement en exportant globalement l’automatisation. De tout cela, rien n’est inévitable. Ce chapitre développe une argumentation selon laquelle l’intelligence artificielle, et même l’accent sur l’intelligence de la machine, reflète une approche très spécifique du développement des technologies digitales, une approche qui a de profonds effets dans la répartition des richesses, en bénéficiant à quelques personnes et en laissant le reste derrière.
Plutôt que de se focaliser sur l’intelligence des machines, il serait plus profitable de lutter pour une utilité des machines (‘machine usefulness’) en envisageant combien les machines peuvent être très utiles aux humains, par exemple en complétant les capacités des travailleurs. Comme elle s’est mise en œuvre dans le passé, l’utilité des machines conduit à quelques-unes des applications les plus importantes et les plus productives des technologies digitales, mais qui ont été de plus en plus mises de côté par l’intelligence de la machine et l’automatisation » (p 37).
Cependant l’intelligence artificielle se déploie à un autre niveau, au niveau de la société elle-même. Et elle y pose problème, car « la collecte et la moisson massive de données utilisant l’intelligence artificielle sont en voie d’intensifier la surveillance des citoyens par les gouvernements et les entreprises. En même temps, les modèles d’affaire fondés sur la publicité s’appuyant sur la puissance de l’intelligence artificielle propagent la désinformation et amplifient l’extrémisme ». Les auteurs nous mettent ainsi en garde vis-à-vis de l’intelligence artificielle. « Son utilisation courante n’est bonne ni pour l’économie, ni pour la démocratie et ces deux problèmes malheureusement se renforcent l’un l’autre ». (p 37)
Dans la situation critique dans laquelle nous nous trouvons, comment réorienter la technologie ?
Les auteurs ne se bornent pas à un diagnostic critique de la situation. Déjà, à travers l’examen de l’histoire longue auquel ils ont procédé, nous avons compris que le progrès technologique n’est pas une panacée, que ses effets dépendent d’un contexte plus général, des orientations qui sont prises, d’un choix de société. Bref, le progrès technologique n’est pas la réponse à tous nos problèmes. Et on peut, on doit ne pas considérer son orientation présente comme une fatalité.
Dans le dernier chapitre du livre, les auteurs nous apprennent et nous invitent à rediriger le changement technologique (‘redirecting technology’).
Aujourd’hui rediriger le changement technologique, c’est en premier, faire face à la menace existentielle du changement climatique. Or, à cet égard, il y a eu « de remarquables avancées dans les technologies de l’énergie renouvelable ».
Finalement, « Aujourd’hui, les énergies du soleil et du vent sont produites à meilleur marché que les énergies fossiles » (p 389). La différence est devenue significative. Comment ce changement a-t-il pu intervenir ? Les auteurs mettent l’accent sur le rôle du ‘changement de narratif’ ; du développement du mouvement écologique qui s’en est suivi et l’a accompagné, et des mesures qui en sont résultées.
« Du point de vue du défi posé par les technologies digitales, on peut apprendre beaucoup de la manière dont la technologie est redirigée dans le secteur de l’énergie. La même combinaison – changer le narratif, développer des pouvoirs faisant contrepoids et développer et mettre en œuvre des politiques spécifiques – voilà ce qui peut également marcher pour rediriger la technologie digitale» (p 392). Les auteurs posent les problèmes de la technologie digitale en ces termes : « La puissance concentrée des entreprises digitales nuit à la prospérité parce qu’elle limite le partage des gains réalisés grâce au changement technologique. Mais son effet le plus pernicieux se manifeste dans l’orientation de la technologie qui se dirige excessivement vers l’automatisation, la surveillance, la collecte des données et la publicité. Pour regagner une prospérité partagée, nous devons rediriger la technologie et cela signifie une version de la même approche que celle qui a fonctionné pour les progressistes, il y a plus d’un siècle » (p 393). « Cela doit commencer par changer le narratif et les normes ». On retrouve dans ce chapitre les mises en garde et les orientations qui parcourent cet ouvrage avec comme grandes recommandations : changer le narratif, bâtir des pouvoirs faisant contre-poids et développer des techniques, des régulations et des politiques pour traiter des aspects spécifiques du biais social de la technologie » (p 38). Voilà un ouvrage auquel nous pouvons nous référer pour mieux comprendre les enjeux actuels de la technologie digitale et faire face aux menaces présentes.
J H
- Daron Acemoglu, Simon Johnson. Power and Progress. One thousand-year struggle over technology and prosperity. London, Basic Books, 2023.

par jean | Déc 25, 2023 | Vision et sens |
« A spring within us » (1)
Selon Richard Rohr
C’est le titre d’un article de Richard Rohr autour de la source intérieure dont parle Jésus dans l’épisode de la femme samaritaine au chapitre 4 de l’Évangile de Jean. Il y voit le flux incessant de la grâce de Dieu envers nous.
« Dans les Écritures chrétiennes, nous lisons un texte au sujet de Jésus encourageant une femme samaritaine à puiser de l’eau d’un puit public et à lui en donner (Jean 4.7). A cet ancien puit, les rôles attendus sont renversés. Une vulnérabilité réciproque se révèle comme Jésus invite la femme à être à la fois la réceptrice et « la source », la donatrice de l’eau vive. Dans un genre de flux presque trinitarien, Jésus décrit ce transfert comme « l’eau que je vous donnerai sera comme une source à l ’intérieur de vous se déversant jusque dans la vie infinie » (Jean 4.14).
Une source à l’intérieur de nous
Richard Rohr nous invite à voir là une œuvre de personnalisation. « En d’autres mots, l’ancien puit spirituel est entièrement transféré à la personne individuelle. C’est maintenant une œuvre intérieure et elle a un effet de jaillissement qui est exactement l’image que des mystiques espagnols du XVIe siècle : Francisco de Osuna, Thérèse d’Avila et Jean de la Croix, aimaient tant. Ce thème est également répété quand Jésus dit que, de son cœur, jailliront des courants d’eau vive (Jean 7.38).
Richard Rohr met l’accent sur l’intériorité. Ce qui se joue est à l’intérieur, non à l’extérieur. « La plus merveilleuse métaphore de Jésus pour décrire cette expérience intérieure de grâce, c’est « une source à l’intérieur de vous ». La source n’est pas à l’extérieur de nous. Elle est à l’intérieur et elle bouillonne jusque dans la vie éternelle ».
Reconnaissons que le Ciel est déjà donné et le don délivré
A partir de là, Richard Rohr nous appelle à un travail de reconnaissance. « En réalité, la cognition et la connaissance spirituelles sont toujours re-cognition, reconnaissance. C’est la reconnaissance de ce que nous savons déjà être vrai à un niveau profond. Nous avons eu une intuition où nous avons soupçonné que nous pouvions être un enfant bien-aimé de Dieu, mais nous pensons souvent que c’est trop bon pour être imaginé ». Richard Rohr revient sur la réalité d’une présence divine déjà là. « Le Ciel est déjà donné et le don a déjà été délivré. Jésus le dit très directement à la femme au bord du puit. « Si vous saviez le don de Dieu, vous lui auriez demandé et il vous aurait donné de l’eau vive » (Jean 4. 10). A elle et à nous, Jésus dit que nous avons déjà le don de Dieu. L’Esprit a été déversé dans nos cœurs au moment de notre création. Nous sommes déjà des enfants de Dieu. L’eau bouillonne à l’intérieur de nous, mais souvent nous n’osons pas y croire ».
Arrêtons de chercher notre dignité et apprenons à jouir du don de Dieu
Richard Rohr comprend bien notre embarras. « La bonne nouvelle est juste trop bonne, trop impossible, trop éloignée. Nous disons : « Seigneur, je ne suis pas digne ». Mais la bonne nouvelle, c’est que cette dignité n’est pas même le problème. Qui, parmi nous, est digne ? Suis-je digne, est-ce que l’évêque est digne ? Est-ce que les prêtres sont dignes ? Je ne le pense pas. Nous sommes tous à des degrés divers d’indignité ou de faillibilité, mais quand nous commençons à nous rendre à cette réalité/identité/connaissance, la fontaine de grâce commence à couler et nous commençons à connaitre le don de Dieu. Nous arrêtons de chercher notre propre dignité et nous commençons à connaitre le don de Dieu. Nous commençons à réaliser que c’est tout don et que c’est tout gratuit, que nous l’avons déjà. Tout ce que nous pouvons faire, c’est d’apprendre à en jouir. Cela change tout ».
D’après Richard Rohr, J H
- A spring within us : https://cac.org/daily-meditations/a-spring-within-us/