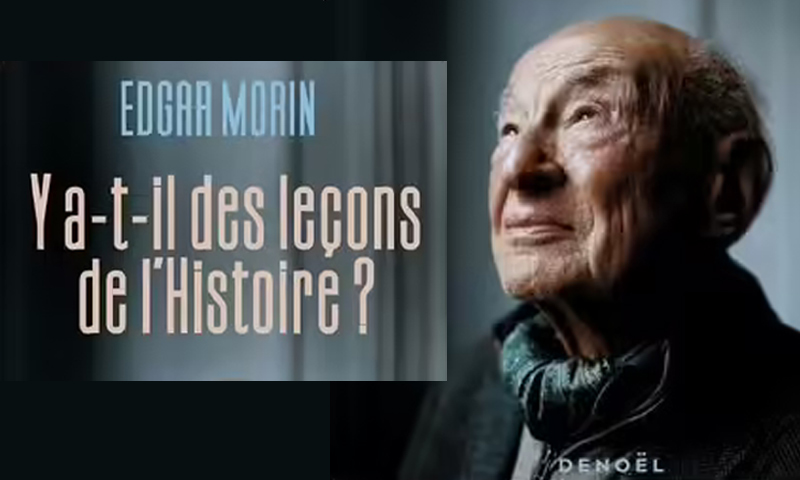par jean | Août 19, 2025 | ARTICLES, Hstoires et projets de vie |
Une éducation au Cameroun
Je suis née à Yaoundé, au Cameroun, où j’ai grandi au sein d’une famille polygamique. Mon père avait trois épouses et je suis la benjamine d’une fratrie nombreuse. J’ai grandi dans un foyer où régnaient le respect, le partage et le pardon. Ces valeurs étaient profondément ancrées dans la foi chrétienne de mon père, qui a fréquenté différentes églises.
Très jeune, mes parents m’ont transmis le sens du devoir et des responsabilités. Chaque grande vacance, je retournais dans mon village où je cultivais une parcelle de terre que mes parents m’avaient confiée. En récompense de mon travail, mon père m’offrait les frais de scolarité. Cette expérience m’a appris que rien n’est acquis sans effort, et que la réussite est toujours une question de mérite.
Étant la plus jeune, on me sollicitait souvent pour rendre service. J’y prenais plaisir, et c’est ainsi que, dès l’enfance, j’ai ressenti le désir d’aider les autres.
Le début de ma vie adulte
Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire, j’ai travaillé comme secrétaire dans plusieurs services à Yaoundé. Plus tard, je suis venue en France pour rendre visite à ma sœur, aide-soignante elle-même. Ses conseils, nourris par son expérience, m’ont poussée à rester en France et à envisager une reconversion professionnelle.
Mon intégration n’a pas été immédiate, mais au fil du temps, j’ai suivi diverses formations, dont celle d’aide-soignante, qui m’a permis de me reconnecter à mes valeurs fondamentales.
Devenir aide-soignante
J’ai choisi le métier d’aide-soignante car il incarne les principes qui me tiennent à cœur : l’empathie, le partage et l’entraide. Les valeurs professionnelles associées à ce métier – le respect, la responsabilité, la bienveillance – ont renforcé ma motivation.
Lors de ma formation, les périodes de stage ont été décisives. J’y ai découvert les réalités du terrain : la dépendance, le handicap, la fin de vie. Ces expériences m’ont permis de comprendre la profondeur et la complexité de ce métier.
Mon parcours professionnel
Depuis l’obtention de mon diplôme, je travaille dans un EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), où je suis en poste depuis plusieurs années.
Ce parcours m’a permis de développer un grand nombre de compétences :
- La bientraitance
- La méthode Humanitude
- Les règles d’hygiène et de sécurité
- L’ergonomie
- Le respect de l’autonomie, de la dignité, des croyances et des valeurs
- L’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne
Chaque résident est unique. Je m’adapte à chacun, car le soin doit être personnalisé.
Bien sûr, des difficultés existent : les urgences vitales, le manque d’effectif parfois, le stress… Mais grâce au soutien de ma hiérarchie et à l’esprit d’équipe de mes collègues, ces obstacles sont surmontables.
L’un des aspects les plus délicats reste le décès des résidents. Malgré la distance professionnelle, nous nous attachons aux personnes que nous accompagnons. Dans ces moments, le soutien d’une psychologue nous est proposé
Mais ce métier m’apporte aussi de nombreuses joies. Voir un sourire après un soin, entendre un remerciement sincère, ou simplement sentir qu’on a pu soulager quelqu’un, me procure une immense satisfaction. Il m’arrive même de chanter spontanément pendant les soins, tant je ressens parfois une joie profonde dans l’acte de soigner.
Vers la profession d’infirmière
Aujourd’hui, je poursuis mon évolution professionnelle en entamant des études d’infirmière, avec le soutien de mon établissement. Forte de mon expérience concrète auprès des patients, je souhaite élargir mes compétences, tant sur le plan relationnel que paramédical.
Je suis convaincue que la qualité de la relation entre soignant et soigné a un impact direct sur le moral, et donc sur la santé.
Un fil conducteur
En regardant mon parcours, je réalise combien mon éducation a façonné ma vocation. En tant que benjamine, j’ai appris à écouter, à observer, à suivre les conseils de mes aînés. J’ai grandi dans le respect des autres, le sens du partage, l’amour du prochain et l’entraide.
Toutes ces valeurs ont facilité mon intégration dans le métier d’aide-soignante.
Aujourd’hui encore, l’amour des autres reste ma plus grande motivation.
Lucie
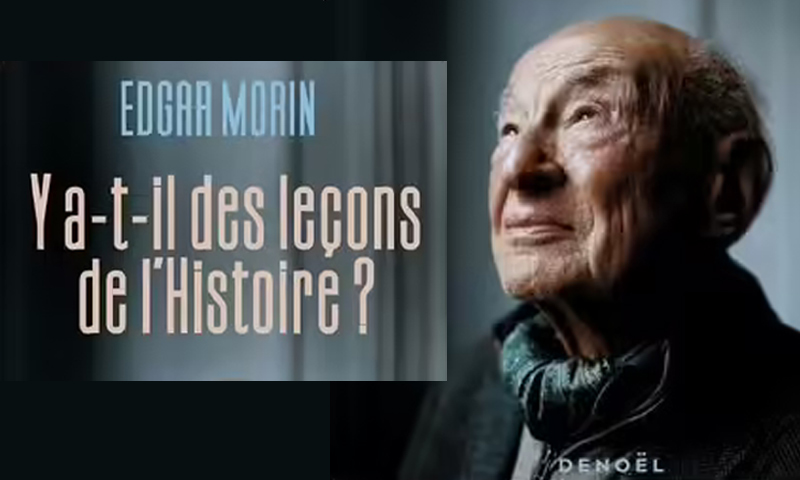
par jean | Août 19, 2025 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |
En ces temps troublés où apparaissent des menaces imprévues, gardant le souvenir d’époques plus calmes, ces bouleversements nous inquiètent. Nous sommes d’autant plus amenés à poser un regard sur le passé, un regard sur l’histoire. Or un livre vient de paraitre : « Y a-y-il des leçons de l’histoire ? (1) En seize leçons et une centaine de pages, il propose les réflexions d’une grande personnalité de la recherche en sciences sociales : Edgar Morin, sociologue et philosophe. Théoricien de la pensée complexe, Edgar Morin est notamment l’auteur de ‘la Méthode’, une « somme en six volumes qui se veut une méthodologie de la transdisciplinarité » (wikipedia). Cependant, à l’âge de cent-quatre ans, l’auteur n’a pas seulement un savoir universitaire sur l’histoire, il en a une expérience personnelle, celle d’un siècle.
Si l’auteur a particulièrement étudié la complexité, on retrouve au premier chef cette réalité en histoire. « Les causes des évènements historiques sont toujours multiples et enchevêtrées » (p 19). Il cite l’exemple de la décadence de l’empire romain.
L’histoire peut être étudiée selon des approches différentes. Ainsi l’auteur met l’accent sur « la grande influence des mythes de l’histoire » (p 23) A cet égard, il mentionne l’expansion des religions monothéistes. Il met l’accent sur « la réalité historique de l’imaginaire » (p 69).
Edgar Morin attire l’attention sur les limites d’une approche rationnelle de l’histoire. « La rationalité de l’histoire n’est souvent qu’une post-rationalisation » (p 45). « Le regard sur l’histoire est tiraillé entre deux réalités contradictoires, que peu d’historiens se risquent à assumer ensemble : celle du caractère rationnel des processus historiques et celle de l’irrationalité – sound and fury – et du rôle majeur des ‘grands hommes’ qui impriment leurs marques sur leur temps, mais aussi sur une longue durée. Ainsi, Alexandre le Grand anéantit-il l’empire perse, conquit-il l’Egypte et une partie de l’Asie, changea-t-il le monde antique en y introduisant la civilisation hellénistique ». « La tendance rationnalisatrice est particulièrement affirmée en France avec l’Ecole des Annales animée par Lucien Fèbvre, Marc Bloch, puis Fernand Braudel. Les mérites de cette école furent de mettre en relief les déterminants économiques, sociaux, voire idéologiques… Le défaut des Annales fut de négliger le rôle des évènements et des fortes personnalités. Je fus un protagoniste du retour de l’évènement dans l’histoire en organisant un numéro de ma revue ‘Communications’ sous ce titre… J’y rappelais que le monde physique est soumis à d’innombrables évènements… que l’histoire de la vie comporte des évènements eux-mêmes innombrables… et qu’il était donc absurde de ne pas prendre en compte les évènements de l’histoire humaine non moins innombrables que dans le monde physique et le monde vivant » (p 46-47). L’auteur souligne également le rôle et l’influence des guerres.
Edgar Morin conteste également une idée absolue du progrès. « L’idée que le progrès est la loi absolue de l’histoire s’est imposée au cours du XIXe siècle. Elle a été clairement formulée par Condorcet, adoptée par l’Occident comme vérité de l’histoire, puis répandue dans le monde. L’auteur reconnait les grands progrès techniques accomplies depuis le début de l’histoire de l’humanité. « Au cours des siècles, les puissances scientifiques, techniques, économiques ont suscité de plus en plus de bien-être et de bien-vivre pour la partie la plus privilégiée de la population. Mais, fait extraordinaire, deux guerres mondiales, des massacres de masse, Hiroshima, ou des fanatismes délirants n’ont ébranlé que provisoirement cette croyance en le progrès qui s’est imposée à nouveau lors des Trente glorieuses. Cette nouvelle ère de développement de la société de consommation et de bien-être réservée à une part croissante, mais partielle de la population, a créé une amélioration fragile. Une forme d’industrialisation de la vie s’est opérée dans les programmes, la chronométrisation, la réduction à l’économie de tout ce qui est humain, et, on l’a oublié, l’affectivité, le bonheur, le malheur, la joie, la tristesse, c’est-à-dire les réalités humaines essentielles » (p 77). « La croyance dans le progrès s’est atténuée lorsque est apparue la conscience que le progrès scientifico-technico-économique tendait vers la dégradation écologique de la planère, mais aussi la dégradation de sociétés et de civilisations humaines » (p 78).
Il y a de puissantes tendances dans l’histoire, si puissantes parfois qu’il semble difficile à l’initiative humaine d’en infléchir le cours. Bienvenu est le propos d’Edgar Morin lorsqu’il intitule une de ses leçons : « Un seul individu peut changer le cours de l’histoire mondiale » (p 55). « L’histoire est une combinaison de forces anonymes, d’évènements décisifs et d’interventions non moins déterminantes d’individus investis d’autorité : empereurs, chefs, rois, généraux, ministres, voire rebelles ou régicides. Le temps de crise et les guerres favorisent l’apparition de grands hommes, de grandes femmes ou du moins de personnalités dont les virtualité (qui sans cela seraient restées latentes), s’actualisent de façon exceptionnelle ». Ils modifient le cours de l’histoire ‘en stratèges le plus souvent militaires ou politiques’. Ainsi, « la personnalité de De Gaulle ne fut-elle pas décisive par trois fois dans l’histoire de France ? ». Le courage politique de Churchill a eu un rôle décisif dans le déroulement de la seconde guerre mondiale : « Si Churchill n’avait pas été élu Premier ministre en remplacement du frêle Chamberlain, à la suite de la défaite anglaise en Hollande et en Belgique, le Royaume-Uni aurait probablement accepté les propositions de paix d’Hitler, laissant ce dernier devenir maitre de l’Europe » (p 56). A côté de ces personnalités positives, il y malheureusement un grand nombre de criminels mégalomanes. « La mégalomanie peut être une maladie du pouvoir » (p 58). « Mussolini, Staline, Hitler, Mao ont organisé leur propre culte et ont été quasiment divinisés ».
‘L’improbable peut advenir’. Edgar Morin rapporte son expérience. « Ces cent dernières années, que d’épisodes inattendus, voire imprévisibles : le pacte germano-soviétique de 1939 entre deux ennemis apparemment irréductibles, la bataille de Stalingrad en 1942, le rapport Khrouchtchev, le putsch des généraux d’Alger en 1958, le retour de De Gaulle au pouvoir, le terrorisme islamique, etc. » (p 20). Il y a de nombreuses trajectoires imprévisibles dans l’histoire contemporaine. C’est le cas quand on considère l’histoire récente d’Israël. L’expansion illégitime de l’état israélien a débouché sur un désastre : les massacres de Gaza. Ainsi, par un renversement de l’histoire, « le peuple qui a le plus souffert de persécution est devenu une nation dominatrice, colonisatrice, persécutrice » (p 33). L’auteur nous propose un autre exemple d’une trajectoire inattendue : « le destin incroyable de la révolution russe » (p 37). « Mon dernier exemple du triomphe de l’inattendu et du rôle capital du mythe dans l’Histoire est celui de la révolution d’octobre en Russie ». « La révolution fut d’une haute improbabilité… ». Puis « l’échec humain du socialisme comme société égalitaire et fraternelle, patent dès les débuts de l’URSS, fut totalement masqué par l’idéologie… La dictature du prolétariat fut en fait une dictature tentaculaire du Parti ». « Deuxième triomphe de l’inattendu : en 1991, ce régime s’effondra de lui-même après soixante-dix ans de pouvoir… l’échec historique le plus total » (p 39).
Il arrive que le vent tourne juste au moment où le ciel s’obscurcit. Ce fut le cas à la fin de l’année 1941 au moment où l’Allemagne hitlérienne était en passe de dominer toute l’Europe. « En deux jours, le probable, la prise de Moscou et la victoire nazie, devint improbable, et l’improbable devint probable : l’URSS disposait désormais du soutien matériel et militaire des Etats-Unis entrés en guerre après Pearl Harbour » (p 87).
A une époque tourmentée où des périls ont surgi de part et d’autre, nous pouvons être surpris et désemparés. En sociologie et philosophe, mais aussi en homme d’expérience, dans ce livre, Edgar Morin vient nous rappeler la complexité de l’histoire. Ses points de vue ne sont pas nécessairement incontestables, mais il nous apprend à considérer les menaces et à les envisager dans la vigilance. Cependant, si nous voulons regarder le positif, il nous enseigne aussi que des hommes ont pu l’emporter sur des forces contraires et qu’on peut échapper à ce qui paraissait une impasse. C’est un livre qui accroit notre capacité de faire face.
J H
- Edgar Morin. Y a -t-il des leçons de l’histoire ? Denoël, 2025
Sur ce blog, voir aussi :
Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François, Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
Pourquoi la fraternité, selon Edgar Morin. Pour des oasis de fraternité : https://vivreetesperer.com/pour-des-oasis-de-fraternite/

par jean | Juil 20, 2025 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |
La prise de conscience écologique appelle aujourd’hui une nouvelle vision du monde. Sociologue et théologien, Michel Maxime Egger a écrit plusieurs livres sur les incidences spirituelles de l’écologie (1). Dans un nouvel ouvrage : « Gaïa et Dieu-e (2) , avec Charlotte Luycke, il aborde aujourd’hui l’approche écoféministe. Ce mouvement, pour une bonne part, est ouvert à la dimension spirituelle. Mais il se heurte à la culture dominatrice qui lui parait s’être imposée dans l’histoire du christianisme. Dans cet ouvrage, Charlotte Luycke et Michel Maxime Egger se pose donc la question : « Un écoféminisme chrétien est-il possible ? » et ils y répondent par l’affirmative. Il se trouve en effet que des théologiennes peu connues dans l’univers francophones, ont, très tôt, ouvert une voie en ce sens. Ainsi, les auteur(e)s « explorent la rencontre entre l’écoféminisme et le christianisme à travers les réflexions visionnaires de grandes théologiennes, d’horizons variés, comme Rosemary Redford Ruether, Sallie McFaguen et Ivone Gebara ». Leurs textes présentés « dans cette anthologie inédite ouvrent de nouvelles voies critiques et créatives pour penser le divin et la nature à partir de l’expérience des femmes. Une manière de nourrir des engagements pour la libération et la justice, étendues à l’ensemble du vivant. Ce livre se veut un ouvrage essentiel pour réinventer la tradition chrétienne à l’ère de l’urgence écologique et des combats féministes » (page de couverture).
Un mouvement écoféministe
Le mouvement écoféministe est apparu « au cours des années 1970-1980…. Né en Amérique du nord et en Europe, avant de se diffuser dans d’autres parties du monde, il est à la fois un champ de recherche théorique et un espace de militance qui se nourrissent mutuellement…. Après une période d‘expansion, l’écoféminisme a connu une phase de déclin à partir de 1995. Il vit une forme de résurgence depuis 2015. Jeanne Burgart Goural l’explique par plusieurs phénomènes : « Une repolitisation de l’arène publique » liée notamment au « renouveau du féminisme « avec le mouvement MeToo, « l’inquiétude massive autour de l’urgence climatique » particulièrement forte autour de la Cop 21, la poussée des dynamiques de transition, mais aussi « une expansion du développement personnel et de la spiritualité » avec la vogue des sorcières et du féminisme sacré » ( p 15-16).
Qu’est-ce qui génère l’écoféminisme ? « L’intuition fondatrice et fédératrice au sein de l’écoféminisme est qu’il existe des interrelations profondes — historiques et actuelles, discursives et pratiques, symboliques et structurelles, culturelles et socio-économiques – entre l’oppression de la nature et celle des femmes. Les deux se renforcent mutuellement et obéissent à un même système de domination. Comme l’écrit Mary Judith Tess : « L’oppression des femmes et la destruction de la planète ne sont pas deux phénomènes distincts, mais deux formes de la même violence, avec toutes les injustices qui en découlent » ( p 16). Ainsi les deux causes sont liées. « Dans la mesure où le sexisme et l’anthropocentrisme sont en partie indissociables, on ne pourra pas surmonter l’un sans dépasser l’autre ». Dans l’écoféminisme, deux courants s’allient pour ouvrir une perspective constructive. « L’enjeu de l’écoféminisme est « la construction d’un nouvel ordre social coopératif, au-delà des principes de hiérarchie, de pouvoir et de compétition. Sa visée et son sens sont de tracer des chemins d libération, de guérison, d’« empowerment », justice et de paix…. L’écoféminisme relie les dominations conjointes de la nature et des femmes à celles liées au genre, la classe sociale, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’histoire coloniale…. » (p 16-17).
On en arrive à diagnostiquer une racine des maux auxquels nous sommes confrontés. C’est la culture patriarcale. « La culture patriarcale qui a instauré ka domination du sexe masculin sur le sexe féminin est la même que celle qui a favorisé les cadres de pensée favorisant la subordination de la nature. Elle est à la fois le fruit et le moteur d’un développement civilisationnel, qui a commencé au néolithique, s’est cristallisé avec la modernité occidentale à partir de la fin du XVè siècle. Pour Maria Miess, le patriarcat constitue le fondement de la technoscience et de l’économie capitaliste à partir du XVIIè et dy XVIIIè siècke. Il est en cela indissociable de la chasse aux sorcières, de la traite des esclaves, de la colonisation et du développement de la technoscience.
La société patriarcale a engendré un mode de pensée.
« Ce développement s’est produit à travers plusieurs processus qui – à partir notamment de la civilisation grecque et des monothéismes -ainsi qu’avec l’émergence des sciences modernes – ont masculinisé et extériorisé Dieu-e, domestiqué, féminisé et désenchanté la nature, naturalisé et féminisé les femmes. Il en est résulté une série de dualismes qui ont nourri ls logiques de domination : d’un côté, la transcendance de Dieu-e, la culture, l’esprit, l’âme, la raison et les hommes ; de l’autre, l’immanence divine, la nature, la matière, le corps, les émotions et les femmes. Ces différents pôles sont non seulement opposés, mais hiérarchisés…. ». En conséquence, on peut évoquer : « un cadre conceptuel oppressif » : « un ensemble de représentations, croyances, valeurs et attitudes qui constituent les lunetttes – en l’occurrence patriarcales et anthropocentriques – à travers lesquelles le monde est perçu » ( p 19).
« D’une manière générale, l’écoféminisme exprime le désir de guérir les blessures causées par ces divisions. L’une des clés de cette mutation est le dépassement des cadres de pensée sclérosés qui maintiennent en place les logiques de domination ». Le changement pourra par exemple se manifester par l’introduction d’un nouveau « récit cosmologique comme celui de l’hypothèse Gaïa où l’être humain est un membre parmi d’autres de la communauté du vivant…. ». » Cela demande également de se réapproprier des modes de représentations traditionnellement associés aux femmes pour les transformer en outils d’émancipation : réhabiliter le corps, le sacré immanent, la capacité de « penser avec sensibilité » ou « avec émotion » ( p 20).
Ecoféminisme et spiritualité
L’écoféminisme, par nature, n’est-il pas enclin à considérer le plus grand que soi ? Les auteur(e)s mettent l’accent sur la diversité de l’écoféminisme qui se manifeste en de nombreuses tendances. S’il y a « un écoféminisme du « social », d’arrière-fond matérialiste, il y a un écoféminisme du culturel » ou du « spirituel ». L’écoféminisme, à cet égard, est l’un des rares courants de pensée contemporain à donner une place centrale – non exclusive -à la spiritualité comme source d’ancrage, d’inspiration, d’orientation et de motivation pour la guérison de la terre et la libération des femmes. Autrement dit, comme vecteur de transformation écilogique, sociale, philosophique et politique, L’écoféminisme spirituel peut à ce titre être considéré comme une « écologie intégrale » ( p 24). L’écoféminisme se manifeste à travers une diversité de courants spirituels. C’est « une nébuleuse » où s‘exerce une « grande créativité ». « Une partie s’inscrit dans des cadres religieux. Ainsi Ruether, Gebara, Sallie McFague et d’autres théologiennes présentes dans cette anthologie font référence au christianisme ». Certaines se rattachent au judaïsme, à l’hindouisme, au bouddhisme. Une autre partie se veut plutôt a-, trans- ou post-religieuse. Certaines revendiquent une spiritualité néopaïenne inspirée par la figure de la Déesse. D’autres s’inspirent de la sagesse chamanique et animiste, liées maintenant aux peuples premiers ou à la redécouverte du celtisme ». Cette grande diversité n’exclue pas certaines attitudes et représentations communes. « Toutes ces autrices, cependant, à travers ces différentes voies, sont à la recherche de nouvelles images pour exprimer le « Mystère ultime », d’une manière qui corresponde à la sensibilité et aux connaissances d’aujourd’hui. Toutes, malgrè parfois de profondes divergences, tentent de revaloriser ce que la culture religieuse dominante, jugée patriarcale et écocidaire, a dévalorisé : la nature et la force vitale qui l’anime, le sacré dans ses dimensions immanentes et féminines, la Terre mère comme matrice du vivant et source de sagesse, souvent personnifiée à travers Gaïa » ( p 25) « Dans la mouvance de l’écoféminisme spirituel qui se développe en marge des religions instituées », on peut distinguer quelques tendances comme « la résurgence de la Déesse », la réhabilitation de la sorcière, le Féminin sacré ».
L’écoféminisme chrétien.
Le développement de la pensée écologique s’est heurté à des représentations anthropocentriques et patriarcales présentes dans l’histoire du christianisme. « Dans certains de ses fondements et de ses incarnations, le christianisme est fortement imprégné du cadre conceptuel patriarcal, anthropocentrique et dualiste qui conduit à la dépréciation de la Terre et des femmes… » ( p 32). Face à ces « distorsions patriarcales, sexistes et antiécologiques, des théologiennes écoféministes redessinent une nouvelle théologie chrétienne. « Pour les autrices qui sont au cœur de cet ouvrage, transformer la tradition chrétienne est, certes, une tâche immense et ardue., mais elle n’est pas impossible. Elle est même impérative si le christianisme entend garder une pertinence face aux enjeux actuels. Ultimement, la question est la suivante : comment construire une théologie et développer une praxis qui soient à la fois fidèles aux meilleurs aspects de la tradition, critiques envers les distorsions passées, signifiantes face aux enjeux actuels, sensibles au vivant et ouvertes aux apports de l’écoféminisme ?
Pour relever ce défi, un équilibre est à trouver qui revient à cheminer sur une ligne de crête.
Deux écueils sont à éviter. Le premier consiste à nier les travers dualistes, anthropo- et androcen- triques en adoptant une attitude apologétique à coup de réponses auto-justificatrices. Il est donc capital que les églises et leurs fidèles reconnaissent les faiblesses de leurs traditions en matière écologique et féministe. Une telle autocritique est la condition sine qua non pour retrouver une légitimité et une crédibilité, mais aussi pour ouvrir de nouveaux chemins – théologiques, liturgiques et pratiques – à la lumière des enjeux. Le second écueil consiste à absolutiser les critiques et à réduire toute la tradition à ses défauts….. » (p 35-36). Ici, on appelle à la nuance, à la prise en compte de la complexité, au constat des différences. Les théologiennes chrétiennes écoféministes se sont engagées dans un grand mouvement de « reclaim », c’est-à-dire, selon les auteur(e)s, en traduction du terme anglais, un mouvement de « réhabilitation et réinvention « ou, pour le dire autrement, de « réappropriation et refondation » ( p 37).
Comment se mettent en œuvre ces démarches de réappropriation ? « Le point de départ est le corpus biblique et théologique qu’il s’agit de revisiter et d’ouvrir à de nouvelles perspectives plus inclusives, égalitaires, écologiques, favorables aux femmes….La démarche de Ruether est mentionnée. C’est la revalorisation de quatre composantes de la tradition chrétienne / primo, le prophétisme biblique dont l’approche unitive est étrangère « aux dualismes entre le sacré et le profane, l’individuel et la société, le spirituel et le matériel que le christianisme a absorbé à travers la culture de l’hellénisme tardif. Secundo, la vision de l’alliance entre Dieu et toutes les créatures qui contredit le dualisme entre l’histoire et la nature Elle nous rappelle que nous sommes appelé(e)s à créer une communauté juste, attentive aux besoins des étrangers, des pauvres et du vivant. Tertio, la tradition sacramentelle qui met en relief la présence incessante et la manifestation de Dieu-e dans la création, complétant ainsi l’accent sur l’altérité et la transcendance divine. Quarto, les apports des femmes mystiques de l’époque médiévale qui comme Hildegarde de Bingen, Hadewijch d’Anvers, les béguines ou encore Julienne de Norwich ont exprimé, souvent de manière novatrice et audacieuse, leur vision du cosmos, leur conception du salut ou leur intimité avec Dieu-e ou le Christ » ( p 38).
Il y a également un travail de réinvention et de restauration.« Il ne s’agit pas seulement de regarder en arrière dans le rétroviseur pour voir ce qui peut être récupéré, mais vers l’avant en « apprenant à penser autrement » et, au besoin, « en « abandonnant des notions chères », transformant les « constructions théologiques et interprétations traditionnelles » de la Bible et des dogmes. Le point de départ pour cela n’est pas la tradition, mais l’expérience des femmes, le système Terre dans ses beautés et ses souffrances et la science contemporaine qui a apporté une nouvelle vision du vivant, en particulier comme toile d’interdépendances ainsi que matrice de la vie et de la conscience humaine. « Concevoir le christianisme à la lumière d’une cosmologie évolutive nécessite des réévaluations substantielles et élargit le cadre historique au-delà de l’histoire religieuse et humaine ». C’est par exemple ce que propose Anne Primavest. Elle relit la Genèse et donne une dimension sacrée à la Terre qu’elle convoque comme hypothèse scientifique et pas seulement comme symbole. Cette oeuvre de refondation passe par une démarche non seulement de réinterprétation, mais aussi de déconstruction et reconstruction à tous les niveaux de la réflexion et de la praxis théologique.
Ce réexamen vaut en particulier pour l’exégèse biblique. L’écoféminisme interroge les méthodes d’interprétation des Écritures et leurs usages, dans la mesure où ils obéissent souvent à des grilles de lecture patriarcales, anthropocentriques et androcentriques….. » ( p 40).
Cette nouvelle approche théologique requiert également un changement de langage. « Dans ce processus, il s’agit également de se libérer de « l’esclavage du langage religieux consacré », majoritairement masculin. … le défi est de trouver ou inventer un langage et un imaginaire adéquats, porteurs et signifiants pour aujourd’hui.
« En résumé, le défi écoféministe lancé à la théologie est profond et imprègne toutes les couches de la réflexion et de la pratique théologique » ( p 44).
Charlotte Luycke et Michel Maxime Egger nous présentent ensuite les chantiers de la théologie écoféministe, les grands thèmes envisagés avec un nouveau regard. Ces thèmes s’énoncent en plusieurs séquences. Relectures théologiques : Dieu-e et la création, sortir du modèle patriarcal ; Réappropriation de la tradition : la matrice primordiale, la Trinité, la Sagesse ou Sophia, le Christ cosmique ; Refondation de la tradition : Dieu-e comme mère, le monde comme corps de Dieu ; Équilibre entre la transcendance et l’immanence ; Relectures anthropologiques : vision de l’être humain, unité avec le vivant, spécificités humaines, corps et âme ; Relectures eschatologiques : le mal et le bien : question du péché, création et rédemption, fins dernières ; Engagements éthiques et politiques : justice écologique et sociales, luttes sans frontières ; Chemins spirituels : espaces de célébration, convergences dans l’amour, marche dans l’inconnu .
Un nouvel horizon
Charlotte Luycke et Michel Maxime Egger nous ouvrent ici un nouvel horizon. Nous découvrons des femmes théologiennes jusqu’ici largement ignorées dans le monde francophone. Cette méconnaissance ne doit-elle pas nous interpeller ? Un nouveau courant théologique apparait : une théologie écoféministe. Cependant, cette théologie écoféministe s’inscrit dans ce qui est devenu un vaste univers : la théologie écologique si bien qu’on y retrouve certaines orientations déjà développées par ailleurs. Mais la théologie ecoféministe est un lieu de convergence. Nous y découvrons combien l’expérience des femmes apporte une nouvelle dimension tant par la manière dont elles expriment le vivant que par un vécu de subordination qui engendre un puissant désir de libération.
Jürgen Moltmann, tant pionnier en de nombreux domaines de la théologie (3), de la théologie de l’espérance à une nouvelle théologie trinitaire, une théologie de la création et une théologie de l’Esprit a, très tôt, développé une approche écologique et, à cet égard on pourra noter qu’il y a associé une remise en cause du patriarcat et du rôle subordonné des femmes. On pourra apprécier sa vigilance dans un article intitulé : « Comment dimension écologique et égalité hommes-femme vont de pair et appellent une nouvelle vision théologique » (4). « Le monde », nous dit Jürgen Moltmann, « a été perçu à travers un certain nombre de symboles. La pensée biblique, la pensée théologiques sont entrées en dialogue avec ces symboles…. Au terme d’une longue histoire de la culture et de l’esprit, la vision du monde comme « entente secrète », la métaphysique des forces vitales, de leurs accords et de leurs désaccords, a été détruite, et ce d’une part par le monothéisme, et d’autre part par le mécanisme scientifico-technique par lequel, d’ailleurs, le monothéisme a conquis la place, en désacralisant et en désenchantant la nature…… » Moltmann évoque la montée parallèle du patriarcat qui a partie liée à une représentation du monde comme ouvrage et comme machine. « Il parait raisonnable de chercher à remplacer la vision mécaniste du monde, car c’est une image marquée de façon unilatérale par le patriarcat. Le passage à une vision écologique du monde fait davantage justice, non seulement aux environnements naturels du monde humain – mais au caractère naturel de ce monde humain lui-même – hommes et femmes.
C’est pourquoi il implique de nouvelles formes égalitaires de communauté dans laquelle la domination patriarcale est abolie et une communauté fraternelle est construite. Les centralisations de la conception mécaniste du monde cèdent le pas à des ententes dans le réseau des relations réciproques ». L’enjeu majeur, c’est une transformation de la vision théologique. Jürgen Moltmann propose « une doctrine chrétienne de la création qui prend au sérieux le temps messianique qui a commencé avec Jésus et qui tend vers la libération des hommes, la pacification de la nature et la délivrance de notre environnement à l’égard des puissances du négatif et de la mort ». L’épouse de Jürgen Moltmann, Elisabeth Moltmann-Wendel était elle-même une théologienne féministe et ils ont collaboré (5).
Aujourd’hui, on découvre le potentiel de l’écoféminisme chrétien.
J H
- Ecospiritualité. Une nouvelle approche spirituelle : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
- Réenchanter notre relation au vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/
- Charlotte Luicke. Michel Maxime Egger. Gaïa et Dieu-e. Un écoféminisme chrétien est-il possible ? Edition de l’atelerr,2025. Gaïa et Dieu-e. Interview des auteur(e)s You tube : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=you+tube+Gaia+et+Dieu&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:e91ef01c,vid:MHFomIzruPo,st:0
- Une théologie pour notre temps. L’autobiographie de Jürgen Moltmann : https://www.temoins.com/une-theologie-pour-notre-temps-lautobiographie-de-juergen-moltmann/
- Comment dimension écologique et égalit hommes-femmes vont de pair et appellent une nouvelle vision théologique : https://vivreetesperer.com/comment-dimension-ecologique-et-egalite-hommes-femmes-vont-de-pair-et-appellent-une-nouvelle-vision-theologique/
- Femme et hommes en coresponsabilité en Eglise : https://www.temoins.com/femmes-et-hommes-en-coresponsabilite-dans-leglise/

par jean | Juil 1, 2025 | ARTICLES, Vision et sens |
Selon la définition du dictionnaire Le Robert, la conscience est ‘la connaissance immédiate de sa propre activité psychique’. Selon une recherche google, ‘la conscience est la présence constante et immédiate de soi à soi’. Cette définition se poursuit ainsi : ‘C’est la faculté réflexive de l’esprit humain, c’est-à-dire la capacité de faire retour sur soi-même. C’est la conscience qui permet à l’homme de se prendre lui-même comme objet de se penser, au même titre que les objets extérieurs’. La conscience est ainsi au cœur de l’existence humaine. Mais n’est-ce pas la réduire que de la limiter à cette existence ? Depuis quelques décennies, un mouvement s’opère pour en élargir le champ. Nous le ressentons à travers de nombreuses découvertes. Le titre du nouveau livre de Patrice Van Eersel est à cet égard très significatif en se portant à l’extrême : ‘Le soleil est-il conscient ? Et les dauphins ? Et les baobabs ? Et l’IA ? Et vous-même ?’ (1) Le bas de couverture explicite l’intention de l’auteur : « Elucider le mystère de la conscience ». On comprend que cet ouvrage est la résultante ultime d’une quête engagée depuis des décennies.
« Ecrivain à Libération et à Actuel, rédacteur-en-chef de Nouvelles Clés Patrick van Eersel a longuement enquêté sur différents sujets alternatifs qui ont débouché sur des livres : ‘La Source noire’ (1986) sur les Expériences de Mort Imminente ; ‘Le Cinquième Rêve’ (1993) pour les contacts avec les animaux et les dauphins.; ‘La Source blanche’ (1996) sur l’histoire des dialogues avec l’Ange ; ‘J’ai mal à mes ancêtres’ (2002) sur la psychogénéalogie ; ‘Mettre au monde’ (2008) sur de nouvelles façons d’envisager la naissance » (page de couverture). Plus récemment, en 2021, Patrice van Eersel a publié un livre intitulé ‘Noosphère’ qui présente le cheminement de la pensée de Teilhard de Chardin (2). Tous ces livres sont réalisés à partir d’interviews d’acteurs et d’experts. Au long de plusieurs décennies, Patrice van Eersel a fréquenté un grand nombre de découvreurs et c’est sur eux qu’il s’appuie pour écrire ce nouveau livre sur la conscience. Dans un entretien avec Anne Guesquière sur le site Métamorphoses, il raconte sa quête, de rencontre en rencontre, avec des personnalités remarquables (3). C’est un chemin de découverte relaté en page de couverture : « Cela parait fou, mais les faits sont là. La conscience parait habiter l’univers entier. Dans toutes les cultures anciennes, la conscience habite l’intégralité des êtres de l’univers. Les monothéismes puis les modernes l’ont progressivement réduite à une exclusivité humaine. D’universelle, elle est devenue le propre de nos cerveaux hyper-complexes. – et nous sommes supposés être ‘seuls dans l’immensité indifférente de l’univers d’où nous avons émergé par hasard’, comme dit le credo matérialiste. Or ce monopole glacé craque de tous les côtés » (page de couverture). A partir d’une immense culture qui s’est forgée dans la rencontre avec tous ceux qui mettaient en évidence des réalités et des compréhensions nouvelles, ‘une cinquantaine de scientifiques, thérapeutes, philosophes et témoins de l’extraordinaire’, Patrice van Eersel fait apparaitre des convergences, l’émergence d’un paysage nouveau. « C’est une révolution à double sens. D’une part descendant des sommets de la théorie, les découvertes de la physique quantique démontrent que la réalité intime de la matière présente des similarités troublantes avec ce que nous appelons ‘conscience’. D’autre part, remontant de la base, d’innombrables observations et expériences empiriques nous mettent en relation de résonance intelligente et sensible avec les animaux, mais aussi avec les végétaux, voire les minéraux, et peu à peu avec l’univers entier visible et invisible » (page de couverture). L’auteur entre alors dans une nouvelle vision : « Tout se passe avec une constante troublante comme si, à chaque niveau, la conscience ressemblait à une musique. Une musique issue d’un silence infiniment subtil » (page de couverture).
Nous trouvons dans ce livre la description de phénomènes déjà plus ou moins abordés au cours de notre parcours et exposés sur ce site https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/. Il y a dans ce livre de 450 pages une abondance d’informations et une piste de réflexion qui se poursuit dans un va-et-vient d’un interlocuteur à l’autre. C’est dire que nous ne pouvons pas le présenter selon notre manière habituelle. Nous nous bornerons à en présenter quelques extraits.
Aux origines de la quête
En 1981, l’auteur part enquêter en Californie au sujet des expériences de mort imminente appelé à cette époque ‘Near death experiences’ (NDE). Il reconnait l’impasse des chercheurs voulant expliquer le phénomène par la neurochimie. Il rencontre les pionniers qui mettent en évidence le caractère extraordinaire du phénomène, le psychiatre Raymond Moody et le psychosociologue Kenneth Ring. Pour l’auteur, c’est un point de départ de cette recherche sur la conscience. « Quelque fut leur fascination, ce n’était pas la mort que ces chercheurs s’acharnaient à élucider. Comment était-il possible qu’au moment où leur cœur avait cessé de battre, certaines personnes aient pu connaitre une lucidité extraordinaire, unique dans leur vie, doublée le plus souvent du souvenir d’un bonheur si ineffable que leur existence s’en était trouvée changée à jamais, la peur de mourir les ayant définitivement quittés » ? (p 21).
« Cette impression se trouvait renforcée par toutes sortes de témoignages. Ces témoins-là rapportaient des expériences en tous points semblables aux EMI (Expérience de mort imminente)… sauf qu’ils n’avaient jamais couru le risque de mourir… Pour certains, le décollage hors corps vers la grande lumière d’amour et de connaissance s’était effectuée depuis le quotidien le plus banal, à la terrasse d’un café ou lors d’une balade en forêt » (p 21) (4).
Une autre convergence se dessinait. « De grands professionnels de la méditation, venus notamment du yoga, du zazen ou du tantrisme apportaient une contribution inattendue. Selon eux, la description de l’EMI correspondait à s’y méprendre à ce que leurs disciplines respectives nommaient ‘pur éveil’ ou ‘conscience cosmique’ » (p 21).
A la même époque, Patrice rencontre le mouvement naissant des soins palliatifs. La confrontation avec la mort l’interroge. Il sort bouleversé de sa participation à un séminaire animé par cette personnalité pionnière que fut Elisabeth Kübler-Ross. Il s’était trouvé avec une centaine de personnes en extrême souffrance. La compassion transformait toute l’assemblée en chœur de pleurs… « Ce que j’allais découvrir, c’est qu’accompagnés par une praticienne aussi chevronnée qu’Elisabeth Kübler-Ross, qui avait tenu la main de milliers de mourants, mes compagnes et compagnons de grande infortune réussissaient à traverser cette vallée de larmes pour atteindre l’autre rive » (p 23). C’était un nouvel état d’esprit. « J’étais donc revenu de ce séminaire avec la conviction que, sans les femmes fondatrices des soins palliatifs, sans leur incroyable capacité à réveiller l’humain moderne de sa transe technicienne, la recherche des hommes qui ont mis en évidence le phénomène des expériences de mort imminente aurait paru si fantasque, si déracinée du réel… qu’à mon avis, elle n’aurait pu être intégrée au corpus commun » (p 24).
L’apparition d’une convergence
En remontant dans son passé, Patrice van Eersel y voit la manière dont sa quête et apparue et s’est affirmée, nourrie par des rencontres qui ont révélé une multitude de convergences.
« Presque un demi-siècle s’est écoulé depuis mes premières explorations américaines. Et, tout à coup, prenant du recul, cela s’est imposé à moi comme le nez au milieu de la figure : si tous mes reportages pour Actuel, et plus tard Nouvelles Clés, puis Clés n’ont pas exclusivement tourné autour de l’énigme de la conscience, je peux dire que ce fut bien le cas de ceux qui ont vraiment compté pour moi. Depuis le musicien Jim Nollman qui joue de la guitare dans un canoé en concert avec les orques du Pacifique, jusqu’à l’astronaute américain Edgar Mitchell revenant de la lune amoureux de la terre, en passant par la nageuse et dessinatrice Gitta Mallasz, dernier témoin de l’aventure prophétique des Dialogues avec l’ange, ou du pianiste Ray Lema, découvrant comment les villages de la forêt congolaise sont régulés par des ‘roues rythmiques’, j’ai eu la chance immense de pouvoir rencontrer des dizaines d’hommes et de femmes passionnants et géniaux dont l’essentiel de la quête tournait finalement autour de l’énigme de la conscience » (p 15).
Un nouveau regard scientifique sur le monde : la mécanique quantique
Plusieurs mouvements convergent pour entrainer un changement de notre vision du monde et donc de notre représentation de la conscience
« Je suggère que pour la plupart de nos contemporains, la façon de se figurer la conscience a fortement évoluée au cours du dernier siècle avec la double poussée d’un mouvement ‘top down’ et d’un mouvement ‘bottom up’. Peut-on dire ce qui s’est passé quand ces deux mouvements se ont rencontrés ? Se pourrait-il que cela ait profondément changé l’ADN de nos sociétés ? » (p 186). L’auteur envisage le mouvement ‘bottom up’ comme celui qui se manifeste dans de nouvelles expériences humaines comme les visions suscitées par les psychadéliques, la découverte des ‘gymnosophies d’orient’, un nouveau regard sur la mort engendré par les expériences de mort imminente. Et d’autre part, il envisage ce qu’il intitule le mouvement ‘top down’ comme la nouvelle représentation du monde qui nous est communiquée par des scientifiques : la mécanique quantique.
« Aujourd’hui, malgré sa grande complexité mathématique originelle, le concept de ‘quantique’ s’est répandu du sommet vers le bas dans un mouvement ‘top down’, une vulgarisation décomplexée que l’on retrouve propagée dans toutes sortes de réseaux… » (p 75). Selon l’auteur, ‘la mécanique quantique reconstruit notre vision du monde de A à Z’. L’auteur a, très tôt, rencontré un chercheur en ce domaine, le physicien David Bohm. Il rapporte son propos : « Au bout de la logique quantique, toute solitude s’avère désormais partielle, voire illusoire : il n’existe plus d’entité ni d’individu isolé, l’univers entier est relié et se comporte comme un seule gigantesque interconnexion, cachée derrière une mosaïque infiniment morcelée des apparences ». L’auteur va encore plus loin dans cette représentation révolutionnaire « Pris dans un ‘tissu supral’, comme l’a baptisé Emmanuel Ransford, toile d’araignée invisible qui relie les milliards de billiards de trilliards de particules cosmiques, chacun de nous peut, s’il sait donner à sa vigilance une densité et une sérénité suffisantes, non seulement communiquer avec les organes qui composent son propre corps – pour les connaitre, les harmoniser et les soigner en leur envoyant ‘des intentions bienveillantes’ – mais entrer en contact avec les autres éléments de l’univers, sans limite dans l’espace-temps » (p 77). Certes, ce bouleversement des représentations rencontre des résistances. En effet, les enjeux sont immenses. « Deux millénaires et demi après Aristote, les axiomes de base de la science occidentale ne demeurent désormais valides que dans un périmètre restreint. L’essentiel devient flou. La matière n’existe plus en tant que ‘chose’, mais laisse la place à un ‘tissu relationnel’ obéissant à de probabilités aléatoires, qui s’étendent à l’univers entier » (p 78). « Même au bout d’un siècle, comment notre système des pensée cartésien-newtonien, matérialiste, mécaniste, réductionniste et individualiste jusqu’au bout des ongles, pourrait avaler pareille métamorphose » (p 78). Une question se pose également, ‘comment peut-on passer du micro au macro ?’. Cette interrogation s’exerce dans le champ de la biologie. Selon l’auteur, la logique quantique se manifeste très largement. « Ce qui est vrai pour nos technologies de pointe l’est a fortiori pour les processus autrement sophistiqués qui meuvent les organismes vivants… De plus en plus de biologistes, de généticiens, de thérapeutes abondent en ce sens… Depuis vingt ans, les publications se multiplient. Sur l’essentiel, les arguments convergent : aucun phénomène biologique – en première ligne, citons l’olfaction, la photosynthèse, la machinerie génétique et toute l’activité neuronale – ne serait explicable sans faire appel aux lois quantiques, ne serait-ce que pour des raisons de temps et de vitesse » (p 81). « Selon Morvan Salez, ‘nos molécules communiquent les unes avec les autres. Elles chantent ensemble’. N’est-ce pas dans cet esprit qu’un biophysicien a eu (l’idée de faire pousser des légumes dans le désert en stimulant leur métabolisme, non avec de l’eau, mais avec des musiques, c’est-à-dire des résonances, processus éminemment quantique » (p 80).
Le post-matérialisme nait du croisement de deux révolutions
Patrice van Eersel nous décrit un puissant mouvement de transformation culturelle. « Il y a un siècle des calculs sophistiqués de la haute physique théorique, ce que je propose d’appeler le mouvement ‘top-down’, est peu à peu descendu jusque dans la société civile, où il suscite une multitude de pratiques de tous acabits, généralement qualifiées de ‘quantiques’. En sens inverse, le mouvement ‘bottom-up’, fonde une foule d’expériences subjectives, psychédéliques dans les cas extrêmes, mais aussi de vécus spirituels ou mystiques, parfois dits paranormaux (l’EMI étant la plus connue), et a progressivement informé la société entière de bas en haut, jusqu’à son sommet, obligeant les élites intellectuelles à le prendre en considération, avec beaucoup de réticence d’abord, mais de façon irréversible » (p 109). L’auteur nous rapporte un exemple de cette diffusion des nouvelles manières de voir. Ainsi, début 2019, est-il invité au colloque ‘Etats de conscience aux frontières de la mort’ à la Faculté de médecine de Paris. C’est donc une entrée de l’examen du phénomène des EMI dans l’espace même de l’Université française. L’organisatrice du colloque, Laurence Lucas Skalli, psychiatre et psychanalyste, veut « inciter la médecine française à s’ouvrir au champ immense de l’étude de la conscience et de son impact sur la guérison » (p 109). « Laurence Lucas Skalli ne visait rien de moins que la fondation d’une association internationale qui sera bientôt baptisée ‘Conscience sans frontières’. Pour lancer ce projet, elle a réussi à convaincre… d’éminents universitaires et chercheurs qui vont intervenir dans ce colloque. Ces personnalités reconnues dans leur domaine de compétence ont donc accepté ‘de réfléchir ensemble au fait que, aux frontières de la vie, la conscience s’avère décidément plus insaisissable que tout ce que la science avait supposé jusque là’ ». Patrice découvre en même temps d’innombrables initiatives du même acabit à travers le pays. Dès lors, à lui qui travaillait sur ces questions depuis longtemps, il apparait « que notre société s’ouvre à nouveau comme quand dans les années 1980, sous l’égide de François Mitterand et de son amie Marie de Hennezelle, s’ouvrirent en France les premières unités de soins palliatifs » (p 118).
« La conclusion de cette semaine passionnante porte le nom philosophique ‘phénoménologie’. La phénoménologie ouvre la voie à une foule d’actions pratiques, puisqu’elle signifie qu’on ne cherche plus les causes premières ni l’essence des choses, mais que l’on se concentre sur le ressenti, le subjectif, l’intériorité » (p 112). Cette séquence se poursuit par des interviews de Patrice avec des thérapeutes engagés autour de la compréhension et la mise en valeur des EMI. Elle débouche sur une rencontre avec le chercheur québécois Mario Beauregard (5). Et avec lui, nous allons pouvoir envisager le postmatérialisme en mouvement.
Patrice van Eersel fut invité à un atelier sur les synchronicités auquel Mario Beauregard participait. Il nous raconte la vie de celui-ci. « Né dans une ferme, Mario Beauregard a grandi très proche de la nature… Il est encore gamin quand il vit une expérience mystique de fusion avec la forêt (5) qu’il n’oubliera jamais et fait naitre en lui le rêve d’exercer un métier qui lui permettrait de comprendre ce qui lui est arrivé. Il vivra plusieurs autres expériences spirituelles très fortes dont ‘une sortie du corps’ d’autant plus marquante qu’il est alors atteint d’une maladie très inquiétante que personne ne sait soigner. Un ‘être de lumière’ lui apparait alors, qui le rassure en lui annonçant qu’il survivra à ce qu’il doit considérer comme une forme d’initiation. Son rêve d’enfance se trouve galvanisé – il veut absolument comprendre ce que tout cela signifie et donc étudier la nature de la conscience ». (p 120). Il devient docteur en neurologie et docteur en neurobiologie. Il parvient à utiliser les grosses machines à imagerie de sa faculté pour observer des états modifiés de conscience. En 2006, son étude sur les cerveaux d’une communauté de carmélites en prière le rend célèbre. « Il établit que les pratiques spirituelles peuvent à ce point influencer le cerveau que de vieilles religieuses censées être atteintes de maladies neurologiques graves – car leurs réseaux corticaux s’avèrent passablement délabrés – tiennent en fait vaillamment le coup. Comme si leur esprit pouvait avoir sur leur corps des effets plus qu’insoupçonnés » (p 121). Ses recherches dérangent les autorités de la faculté de Montréal. En 2013, il rejoint l’Université d’Arizona où il travaille sous la houlette de Gary Schwartz, directeur du Laboratoire de recherche sur la conscience et la santé à Tucson. Ils décident d’organiser une rencontre internationale entre des scientifiques non conformistes. « L’accord principal n’a pas été long à émerger : l’approche matérialiste réductionniste a apporté à l’humanité des découvertes prodigieuses, mais elle en a profité pour faire passer sa méthodologie au niveau ontologique, c’est-à-dire qu’elle prétend avoir le dernier mot sur la nature du réel, qu’elle réduit à la matière. Comme si, en dehors de celle-ci, rien n’existait » (p122) (6). Le paradigme dominant actuel ne parvient pas à prendre compte en grand nombre de phénomènes nouvellement identifiés. « C’est le cas avec des phénomènes comme la perception extrasensorielle, la psychokinésie, la télépathie, la clairvoyance, les VSCD (Vécus Subjectifs de Contact avec un Défunt), les EMI, les sorties du corps ou la lucidité terminale. Mais la liste ne s’arrête pas là. Comment expliquer plus généralement l’intuition, le processus de création, l’hypermnésie ou le génie des autistes Asperger… » (p 124). En regard, différentes hypothèses sont envisageables. « Pour tenter d’expliquer que la conscience n’émerge pas, mais qu’elle est comme une donnée primordiale qui transcende ce que nous croyons savoir de la matière-énergie et de l’espace-temps, Robert Sheldrake, par exemple, plaide pour une approche ‘panpsychique’ – un terme repris à Francesco Patrizi, philosophe italien du XVIe, qui suppose que dans l’univers, toute entité fondamentale ou organisée a une forme de conscience. D’autres chercheurs se réfèrent plutôt au ‘monime neutre’ qui, de Spinoza à Bertrand Russell, avance l’idée que la conscience et la matière sont deux aspects complémentaires et irréductibles l’un à l’autre, de la même mystérieuse réalité fondamentale… » (p 125).
Communiquer avec les animaux
Le changement de vision relaté dans ce livre s’étend aux animaux et aux plantes. Comme nous avons pu déjà nous en rendre compte, ce livre échappe à un résumé tant par son étendue que par son bouillonnement. Les différents chapitres ne peuvent être rapportés de la même manière. Certains s’écrivent à partir de vécus rapportés par des personnalités originales. Ainsi les récits de rencontres avec les grands animaux marins comme les dauphins et les orques nous surprennent en nous entrainant dans un univers féérique où la communication parfois intime avec des hommes et des femmes se réalise à travers des rêves ou à travers la télépathie. L’auteur aborde également la communication animale telle qu’elle s’exerce au plan terrestre. Il cite les livres sur la subjectivité animale écrits par Viviane Despret, psychologue éthologue (7), comme ‘Habiter en oiseau’ ou ‘Penser comme un rat’.
« Nous vivons une époque étrange où, d’une part, se multiplient les initiatives de communication animale inter espèces, et où, de l’autre, nous exterminons, sans même y penser des millions d’animaux » (p 180). C’est à travers des interviews que l’auteur nous décrit des initiatives de communication animale.
Ainsi nous entretient-il de Karine lou Matignon, auteur du livre ‘Sans les animaux, le monde ne serait pas humain’, et de beaucoup d’autres. « Grande amie des chevaux, Karine en a sauvé un certain nombre de l’abattoir. Cette femme ultrasensible a consacré sa vie à tenter de faire comprendre les animaux à ses congénères… ». Elle constate des progrès dans cette compréhension : « Depuis que j’ai commencé à creuser ma piste, même en France, le pays le plus conservateur et le plus matérialiste que je connaisse, les mentalités ont énormément évolué. Quand, avec des dizaines d’experts, nous avons rédigé ‘Révolutions animales’, qui est une sorte d’encyclopédie, je me suis rendu compte qu’en soixante-dix ans, notre regard sur les animaux avait franchi plusieurs paliers.
L’un des premiers acteurs du changement a été Konrad Lorenz quand, dans les années 1950, il a exigé de pouvoir étudier les animaux hors des labos dans leur milieu de vie. C’est lui qui a inspiré Jane Goodhall (7) et les autres grandes primatologues. Si aujourd’hui, on peut aller jusqu’à parler sérieusement de ‘l’individualité de la fourmi’, du ‘blues de l’araignée’ ou de la ‘conscience du poisson’, j’ai envie de dire que c’est grâce à lui » (p 183).
Karine Lou Matignon est également une soignante. L’auteur rapporte un de ses récits. « Elle avait recueilli un pauvre vieux chat de gouttière tout mité. Mais ce chat était farouche. Il ne fallut pas moins de huit mois pour que sa protectrice puisse enfin poser la main sur lui… ‘Je l’ai caressé et il a léché ma main pour la première fois. J’étais toute contente… Un mois plus tard, une nuit, j’ai fait un rêve où il me disait ‘Je meurs’… Le lendemain, une voisine l’a découvert gisant devant son portail. Il avait tenu à me dire au revoir comme pour me remercier’ » (p 184). « En soi, le fait de communiquer par rêve ou par télépathie avec autrui, humain ou animal, n’a pas étonné Karine. Elle a ce don depuis l’enfance ».
Dans cette riche séquence sur les animaux, l’auteur a également rassemblé « huit toutes petites histoires de chien, de chat, de chouette et de perroquet » (p 287). Nous y avons noté l’histoire de ce chien qui allait s’assoir devant la porte d’entrée pour attendre sa maitresse rentrant du travail. En observant, on s’aperçut que ce manège n’était pas lié à une ouïe très fine. De fait, il commençait « à l’instant précis où sa maitresse décidait de rentrer chez elle » (p 189).
Cette séquence se termine par une enquête émouvante : l’expérience terrifiante que l’écrivaine Isabelle Sorente a vécu dans un élevage industriel de porcs, un processus horrible décrit en ces quelques mots ‘calcul ultrarationnel qui métamorphose en coulée de matière organique des êtres vivants – des mammifères proches de nous à plus d’un titre’. Cependant, un jour, il se produisit un évènement remarquable. « Un après-midi quand l’écrivaine, dans sa combinaison, s’apprête à sortir de cet espace de mort, des centaines de truies, enserrées dans l’acier, le sentent aussitôt et braquent leurs regards sur cette visiteuse étrangère bien repérée depuis plusieurs jours. Alors, elle se mettent à crier toutes ensembles. Un hurlement insensé. Comme si elles appelaient au secours ». L’auteur va plus loin dans son commentaire ; « comme si elles suppliaient Isabelle de ne pas oublier la ‘magie de sympathie’ qui met les vivants en résonance les uns avec le autres ».
« La plongée d’Isabelle Sorente pourrait bien nous rappeler une vérité que les temps civilisés nous ont fait oublier : les animaux connaissent la ‘magie de sympathie’ de façon innée. Mieux que nous parce que c’est ainsi qu’ils communiquent » (p 193).
L’expression des végétaux
La nature n’est pas passive. Elle n’est pas indifférente. Elle n’est pas muette Tout communique. Pout le monde végétal, c’est une grande découverte et elle est récente. Patrice van Eersel consacre une séquence à cette prise de conscience.
On peut désormais reconnaitre, capter et diffuser la musique émise par les végétaux. L’auteur nous raconte sa rencontre avec deux pépiniéristes installés dans les Landes, Jean et Frédérique Thoby. « Leurs jardins et leurs terres sont des merveilles où s’entremêlent toutes sortes de végétaux aux couleurs, aux parfums et aux goûts les plus variés, des plus petits légumes aux plus grandes fleurs ». C’est dans ce lieu qu’au cours d’une conférence, l’auteur a pu entendre la musique jouée par ces plantes. Ce fut un enchantement. « Une musique des plus étonnante. A la fois, impressionniste dans sa douceur – on la dirait composée par des elfes ou des fées – et expressionniste dans son phrasé très accidenté. Quand ce sont plusieurs plantes qui jouent en même temps, vous vous dites que le jardin d’Eden ne pouvait pas déployer des jeux d’harmonie plus surprenants » Mais comment cela fonctionne-t-il techniquement ? « Spontanément, cette musique n’est pas audible pour nos oreilles. Pour que sa subtilité apparaisse dans la portion du spectre sonore que capte notre ouïe, il faut qu’on ait branché sur les feuilles et dans les racines de la plante, les électrodes d’un biodynamiseur, une machine inventée par des ingénieurs ayant suivi les directives du physicien Joël Sternheimer… » (p 197).
L’auteur commente ainsi cette réalisation. « Les plantes ne jouent pas de la musique au sens strict… Ce qui est certain, c’est que, comme tous les êtres vivants, leur vitalité s’exprime à chaque instant par des activités électriques. Captées par des sondes, ces impulsions peuvent être traduites de toutes sortes de manières ; cependant, cette traduction musicale correspond, bel et bien et subtilement, aux plantes elles-mêmes. Elles y réagissent en effet illico, en modifiant leurs mélodies et harmonies dans un mouvement de feed-back – si la traduction ne leur plait pas, elles se taisent ». Des chercheurs ont établi que les activités électriques des végétaux émettaient en fait des ultrasons (dont la gamme des fréquences correspondait à celles qu’émettent aussi les chauve-souris). Mais le plus fou est que ces sons influencent le métabolisme des autres espèces, végétales mais aussi animales. Cette influence inter-espèce et même inter-règne, constitue en soi une énigme colossale (p 198).
Cependant, nous découvrons ensuite que des exploitations agricoles utilisent avec succès des ‘protéodies’, c’est-à-dire, à la suite des recherches de Joël Sternheimer, une mélodie de protéine. Le conférencier écouté par l’auteur, Jean Thoby, raconte qu’un de ses voisins viticulteurs ne parvenant pas à se débarrasser de l’oïdium malgré un usage massif de produits phytosanitaires a réussi à s’en débarrasser grâce à l’utilisation de leur biodynamiseur pendant un an. Il assure que « nous disposons aujourd’hui de centaines d’expériences prouvant, à grande échelle, que notre mode de culture est efficace et même très efficace, puisque que dans certaines exploitations, les rendements ont augmenté de 30 ou 40%, et cela alors que les agriculteurs n’utilisent plus le moindre gramme d’intrants chimiques ! » (p 200).
L’auteur poursuit en racontant une expérience spectaculaire, ‘L’homme qui fait pousser des tomates dans le désert’. Un jeune ingénieur, Pedro Ferrandez, voulant contribuer à prouver l’efficacité de l’approche de Joël Sternheimer expérimente la technique correspondante dans une culture de tomates de ses parents. Plusieurs protéodies de tomate sont utilisées, notamment celle d’une protéine active dans la floraison et une autre dans la résistance à la sécheresse. Résultats renversants : en pleine chaleur estivale de 2004, les feuilles des plantes qui ont reçu de la musique… restent vertes alors que les autres sont sèches. D’abord menée en Suisse, l’expérience fut ensuite invitée à faire ses preuves, dans une exploitation horticole sénégalaise où Joël démontre que les protéidies permettent de résister aux insectes et que l’on peut obtenir de très belles tomates avec dix fois moins d’eau » (p 297).
Patrice en vient à s’interroger également aux ressentis des plantes. Ainsi, il nous raconte comment deux chevaux très différents ont été guéris par l’expression musicale de fougères, bien vivantes. Or on constata que les expressions furent différentes en s’adaptant à la condition de chaque cheval. « Tout s’était donc passé comme si chacune s’adaptait à son patient. Donc qu’une communication s’était établie entre l’animal malade et la plante thérapeute. Comme si une communication s‘était manifestée entre l’individu végétal et l’individu animal. Par quel mystérieux jeu de résonance ? (p 213).
En s’interrogeant sur ‘la compassion des végétaux’, un univers revint à la mémoire de l’auteur, celui des Kogis, « une ethnie précolombienne restée intacte, protégée par les montagnes, où elle s’est réfugiée de plus en plus haut pour échapper aux envahisseurs » (p 51). On pouvait retrouver dans cette ethnie une mentalité humaine en osmose avec la nature telle qu’elle avait émergée au début de l’humanité. Pour les Kogis, « les choses étaient claires : soit tu comprends que la nature constitue un vaste corps, vivant et conscient, que tu dois respecter avec le maximum d’humilité, et alors tu peux poursuivre ta route, soit tu ne comprends pas et tu es malheureusement fichu » (p 52).
En s’interrogeant sur ‘la compassion des végétaux’, Patrice van Eersel se rappelle que pour les habitants de la Serra Nevada de Santa Marta, tout notre malheur écologique et climatique actuel vient de ce que nous sommes devenus sourds aux innombrables communications (notamment musicales) que tous les êtres vivants tissent entre eux à chaque instant et que les cultures anciennes semblaient entendre, au moins en partie, les imitant par exemple dans leurs chants de guérison, comme en témoignent encore certaines communautés en Australie, en Amérique latine et en Afrique » (p214).
Une nouvelle vision du monde
Pour rapporter ce livre et contribuer à en faire connaitre l’apport décisif, nous avons présenté quelques-unes des fenêtres ouvertes par cet ouvrage. A la simple lecture de ces échappées, on comprend la richesse phénoménale de cette enquête tant par l’ampleur de son champ, la richesse de la documentation, les rencontres avec un grand nombre de découvreurs, la persévérance de la réflexion. Le sujet est immense. Si on relit le titre ‘Le soleil est-il conscient ? Et les dauphins ? et les baobabs ? Et le cristal ? Et l’IA ? Et vous-même ?’, on se rend compte combien nos aperçus sont très loins d’avoir couvert ce grand continent. Ils encouragent seulement à lire cet ouvrage de bout en bout.
De même, la fin de l’ouvrage appelle une lecture réfléchie, pas à pas. L’auteur nous y propose des chemins d’interprétation et de discernement. Il y évoque, bien sûr, le péril actuel, « la mortelle mise en danger de notre biosphère » (p 318) et les moyens d’y faire face. Les dernières séquences ouvrent une voie.
« Pourquoi chanter relie la Terre au Ciel » (p 389). Ainsi Jill Purce, enseignante de méditation par le chant en Angleterre sait expliquer de quelle façon chanter pour ouvrir notre conscience sur les plus hautes sphères et nous faire accéder au cœur d’une guérison à la fois physique, émotionnelle et spirituelle » (p 398). Elle a exploré également de nombreuses voies spirituelles notamment auprès des Tibétains et des Amérindiens (p 381). « Le pouvoir absolu de la musique, c’est qu’elle est le dernier phénomène qui vient nous rassembler (religere en latin), ravivant le sentiment d’appartenance à un tout, que Spinoza nommait joie (p 401), conclut l’auteur.
La dernière séquence explore la dimension spirituelle et évoque la méditation et le silence : « Et si la conscience jaillissait d’un silence très subtil » (p 403). Ici, Patrice van Eersel interview, entre autres, son ami, Jean-Yves Leloup, ‘prêtre orthodoxe, théologien très suivi’. L’auteur retient l’idée que, dans différents contextes, « on puisse remonter à la même source d’inspiration, mais avec des niveaux de conscience étalés sur un immense éventail ». Et, « Quel que soit ‘le niveau de conscience’ d’une personne visitée ou non par une inspiration supérieure, la question est surtout de savoir quelle est l’origine, la source de sa conscience. Si je prends le prologue de Saint Jean, je lis que le commencement est un Logos qui nous échappe. C’est une pure lumière, une vacuité, un Silence. Et notre conscience nait de ce silence… Saint Jean précise aussi que ce Logos est créateur, habité d’Eros, de désir. C’est par lui que toute existence prend forme. La conscience est donc première » (p 429-420). Jean-Yves Leloup distingue la conscience des états de conscience qui s’étalent dans l’horizontalité alors que le retour à la conscience nous dresse dans une verticalité qui passe du Silence pour y retourner » (p 422). Il précise aussi que « la conscience n’est pas de l’ordre de la substance, mais de l’ordre de la relation… Le fond de l’Être, c’est une relation. Dans la tradition chrétienne, c’est ce que nous appelons la Trinité » (p 424).
La pensée de Jean-Yves Leloup prend en compte l’état du monde dans lequel nous vivons. « Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que peut-être, la seule chose que nous puissions faire pour être utiles à l’humanité – et au cosmos, puisque tout est inter-relié – c’est de nous asseoir et de méditer plutôt que de nous activer. L’Internationale des consciences créée par Catherine Arno et Jean-Yves Leloup avec l’aide d’ Ines Weber et Abdennour Bidar, de l’association Sésame, se veut liée à la Terre, aux cinq continents, parce que partout il y a des femmes et des hommes, de chair et d’os, qui prennent le temps de s’asseoir, de se tenir en silence, de tenter de se relier à ce qui est la Source à la fois de la vie, de la conscience, de l’intuition, de l’amour. Ces gens qui méditent sont de plus en plus nombreux dans le monde et ont envie d’être reliés les uns aux autres ». Et de rappeler que « des recherches scientifiques ont permis de constater que là où plusieurs personnes méditaient, la violence baissait » (p 425-426).
Ce livre nos parait quasiment incomparable, car, de tous côtés, il y converge de connaissances nouvelles à partir d’interviews avec un grand nombre de découvreurs et de penseurs. Et de plus, l’auteur nous présente ces découvertes avec pédagogie. Ici, Patrice van Eersel nous fait partager sa quête sur la manière d’envisager la conscience aujourd’hui et il débouche sur une vision : « Oui, décidément oui cette dimension mystérieuse que nous appelons ‘conscience’ habite l’univers entier et pas seulement le cerveau et le cœur d’ ‘Homo sapiens’ (p 435).
Une vision chrétienne en réception de la perspective du livre de Patrice van Eersel
Patrick van Eersel nous apporte une nouvelle vision du monde : l’affirmation de la conscience à partir de convergence d’un grand nombre de faits et de ressentis qui vienne s’ajuster comme dans un puzzle. C’est une vision qui rompt avec une conception matérialiste et individualiste longtemps dominante telle qu’elle s’est exprimée dans ‘Le hasard et la nécessité’ de Jacques Monod. Cependant, peut-on dire qu’elle vient également corriger une pensée théologique qui s’était enfermée dans l’humain et était sortie de la création. La vision nouvelle de la conscience généralisée vient rebattre les cartes. Elle peut être bien accueillie par les théologiens que nous consultons sur ce blog : Jürgen Moltmann, auteur du livre ‘Dieu dans la création’ paru dans les années 1980, Richard Rohr, animateur du Centre pour l’action et la contemplation et auteur du livre ‘La Danse divine’ qui met en évidence la présence dans le monde d’un Dieu trinitaire et donc communion, Michel Maxime Egger, dont la pensée théologique s’inscrit dans la révolution écologique. Quelques extraits de auteurs viendront résonner avec la perspective émergente de Patrice Van Eersel.
En 2019, dans son livre : ‘The Spirit of hope’ (9), Jürgen Moltmann reprend le fil d’une pensée qui s’est développée pendant plusieurs décennies :
« Une approche historique montre qu’à partir du XVIe siècle, une volonté de puissance s’est imposée à partir d’une approche scientifique et d’une interprétation biblique. L’humanité est devenue « le centre du monde ». Seul l’être humain a été reconnu comme ayant été créé à l’image de Dieu et supposé soumettre la terre et toutes les autres créatures. Il devint ‘le Seigneur de la Terre’ et dans ce mouvement, il se réalise comme le maitre de lui-même… La vision de la nature a été la conséquence d’une représentation de Dieu… ‘Dieu a été pensé comme sans le monde, de la façon à ce que le monde étant sans Dieu puisse être dominé et que le monde puisse vivre sans Dieu’. Et le monde étant compris comme une machine, l’humain est menacé d’être considéré également comme une machine.
Mais, aujourd’hui, une compréhension écologique de la création est à l’œuvre. « Le Créateur est lié à la création non seulement intérieurement, mais extérieurement. La création est en Dieu et Dieu dans la création. Selon la doctrine chrétienne originelle, l’acte de création est trinitaire. Le monde est une réalité non divine, mais il est interpénétré par Dieu… » Ce qui ressort d’une vision trinitaire, c’est l’importance et le rôle de l’Esprit. « Dans la puissance de l’Esprit, Dieu est en toute chose et toute chose est en Dieu… » Au total, « l’Esprit divin est la puissance créatrice de la vie. Le Christ ressuscité est le Christ cosmique et le Christ cosmique est ‘le secret du monde’… » Aujourd’hui, « l’essentiel est de percevoir en toutes choses et dans la complexité et les interactions de la vie, les forces motrices de l’Esprit de Dieu et de ressentir dans nos cœurs l’aspiration de l’Esprit vers la vie éternelle du monde futur ».
Dans son livre : ‘la danse divine’, Richard Rohr en revenant aux sources du christianisme affirme une vision relationnelle de Dieu. « Dieu est celui que nous avons nommé Trinité, le flux (flow) qui passe à travers toute chose sans exception et qui fait cela depuis le début. Toute impulsion vitale, toute force orientée vers le futur, tout élan vers la beauté, tout ce qui tend vers la vérité… est éternellement un flux du Dieu trinitaire… Maintenant, nous voyons bien que Dieu n’est pas, n’a pas besoin d’être ‘une substance’ dans le sens d’Aristote et de quelque chose d’indépendant de tout le reste. En fait, Dieu est lui-même relation. Comme la Trinité, nous vivons intrinsèquement dans la relation. Nous appelons cela l’amour. Nous sommes faits pour l’amour. En dehors de cela, nous mourrons très rapidement… » Le mystère trinitaire peut être également entrevu dans le code de la création. « Ce qu’à la fois les physiciens et les contemplatifs affirment, c’est que le fondement de la réalité est relationnel. Chaque chose est en relation avec une autre ».
Dans un de ses livres ‘Ecospiritualité’, Michel Maxime Egger nous appelle à ‘réenchanter notre relation à la nature’. L’envergure de cette réflexion se marque à travers six grandes parties : Relier écologie, science et religion ; réenchanter la nature ; redécouvrir la sacralité de la terre ; être un pont entre la terre et le ciel ; transforme son cosmos intérieur ; devenir un méditant militant. « La prise de conscience écologique appelle une nouvelle conscience spirituelle, mais aussi un renouvellement des héritages religieux… » « Le préfixe ‘trans’ est un mot latin qui signifie par-delà. Il sied bien à l’écospiritualité. Celle-ci est transcendante, transreligieuse, transdisciplinaire, transmoderne… ».
L’auteur note également le rapport avec une évolution scientifique et nous retrouvons là la recherche de Patrice van Eersel. « L’écospiritualité se nourrit également des apports de la science postmoderne vulgarisés par des figures comme Frank Capra et Rupert Sheldrake. Ce vaste chantier a été ouvert par de nouvelles approches qui se sont développées au XXe siècle entre l’infiniment grand et l’infiniment petit » Michel Maxime Egger évoque lui aussi les voies du ‘panenthéisme’. « Le panenthéisme est une voie du tout en Dieu et de Dieu en tout. C’est l’approche de Jürgen Moltmann. C’est aussi la voie des théologiens orthodoxes, mais aussi de nombreux théologiens très divers de Teilhard de Chardin à Léonardo Boff… Le panenthéisme unit le divin et la nature sans les confondre… Au total, quel que soit la forme du panenthéisme, la nature est plus qu’une réalité matérielle obéissant à des lois physiques et chimiques. Elle est un mystère habité d’une conscience et d’une présence ».
Voici donc quelques pistes théologiques en regard de la réflexion de Patrice van Eersel sur la vision nouvelle du monde qu’il nous propose. Manifestement, la lecture de son livre est un point de départ indispensable pour une réflexion commune en vue de compréhension de la réalité telle qu’elle nous apparait aujourd’hui.
J H
- Patrice van Eersel. Le soleil est-il conscient ? Et les dauphins ? Et les baobabs ? Et le cristal ? Et l’IA ? Et vous même ? Elucider le mystère de la conscience. Guy Trédaniel, 2025
- Un horizon pour l’humanité : la noosphère. Selon Patrice van Eersel : https://vivreetesperer.com/un-horizon-pour-lhumanite-la-noosphere/
- Interview de Patrice van Eersel sur son livre au site : Métamorphoses : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=métamorphose+patrice+van+Eersel+you+tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:382bdaf7,vid:dbqjd70KuRI,st:0
- La participation des expériences spirituelles à la conscience écologique : https://vivreetesperer.com/la-participation-des-experiences-spirituelles-a-la-conscience-ecologique/
- Comment nos pensées influencent la réalité ? : https://vivreetesperer.com/comment-nos-pensees-influencent-la-realite/
- Une nouvelle science de la conscience : https://vivreetesperer.com/la-nouvelle-science-de-la-conscience/
- Une vision nouvelle des animaux : https://vivreetesperer.com/une-vision-nouvelle-des-animaux/
- Jane Goodhall. Une recherche pionnière sur les chimpanzés : https://vivreetesperer.com/jane-goodall-une-recherche-pionniere-sur-les-chimpanzes-une-ouverture-spirituelle-un-engagement-ecologique/
- Un avenir écologique pour la théologie moderne : https://vivreetesperer.com/un-avenir-ecologique-pour-la-theologie-moderne/
- La danse divine : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/
- Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
Voir aussi
Spiritualité et psychiatrie :
https://vivreetesperer.com/spiritualite-et-psychiatrie/
Lytta Basset. Une approche nouvelle de l’au-delà : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/

par jean | Mai 16, 2025 | ARTICLES, Hstoires et projets de vie |
Dans la routine des EHPADs, on peut entrevoir des moments de lumière, Il y a des paroles, des sourires, des gestes qui réconfortent. La vie circule à travers des relations bienveillantes. Cependant, il y a certains soignants qui, tout particulièrement, irradient la confiance. Ces porteurs de vie et de soin répandent la joie parmi les démunis. Quelques portraits de personnes, quelques évocations de pratiques en témoignent ici
Notre ADN, c’est l’amour
Lid est une aide-soignante confirmée qui a décidé d’entreprendre des études d’infirmière. Nous évoquerons donc sa pratique au passé.
il y avait chez Lid une aisance. Elle abordait chacun avec respect. Une prévenance qui se manifestait jusque dans la toilette, auparavant une petite annonce de sa part comme une demande d’accord avant de commencer :1 2 3. Dans une vraie écoute, elle couvrait l’ensemble des besoins. Une relation ouverte permettait en dialogue où les préoccupations pouvaient affleurer et y trouver un apaisement.
Au travail dans cet EHPAD, Lid en connaissait les ressources et les obligations et elle exerçait sa fonction avec une conscience professionnelle assumée. Elle ne se contentait pas des tâches classiques. Elle se comportait comme une accompagnante, attentive aux besoins latents. Ainsi, dans un environnement complexe, elle permit à une des personnes à sa charge de changer de régime alimentaire. Pour réaliser cette opération, il lui avait fallu croire à un nouveau possible et négocier avec les parties concernées. Bref, Lid n’était pas seulement une sauvegarde, elle était un recours.
Face à des situations diverses et parfois très lourdes, si la fatigue l’atteignait à certains moments, il y avait chez Lid un dynamisme qui s’entendait parfois par des voix et des rires audibles dans le couloir de l’étage. Le matin, à son arrivée, on pouvait se dire : lid est bien là. C’était comme si la vie se manifestait à nouveau. Oui, Lid était une personne vivante.
Un jour proche de la Saint Valentin, elle aborda le sujet et, si la réaction en retour put lui paraitre mi-figue, mi-raisin, elle s’exprima plus avant, en évoquant la force de l’amour au sens le plus large. Et c’est là qu’elle s’exclama en parlant des aide-soignantes : Notre ADN, c’est l’amour ! Merci Lid ! vous serez une bonne infirmière…
J H
Le sourire de Nat
Pour éclairer la vie en EHPAD, on peut écrire de petits portraits de soignants qui, par leur attitudes, répandent une bonne humeur. Et par exemple, nous pensons à Nat, une aide-soignante dynamique d’origine africaine.
En s’occupant des résidents, il nous parait que transparait chez elle une grande conscience professionnelle et comme le sentiment d’une mission. Un jour, dans une conversation, je l’ai entendu dire avec enthousiasme : « Je suis une soignante ». Elle sait combien les personnes âgées sont vulnérables et combien, en conséquence il est important de veiller immédiatement aux dérives. Dans une courte conversation lors d’un passage pour apporter le gouter, j’ai pu entendre avec bonheur qu’elle reconnaissait naturellement l’importance de la manifestation d’une présence des aide-soignantes pour des gens isolés dans un ehpad. « Une attention ! un sourire ! ». Et oui, elle sait combien le moral a une influence sur la santé. Les tempéraments sont différents et, dans le travail, sont appelés à se compléter.
Nat est vive et enthousiaste. Il est bon et beau également, de pouvoir, à certains moments, observer chez elle un sourire rayonnant. Merci Nat
J H
Elle apprivoisait le temps et l’espace
Aide-soignante en service de nuit dans un EHPAD : une pratique remarquable
Partir d’une étude de cas pour analyser et comprendre les pratiques, c’est aussi pouvoir mettre ainsi en évidence un comportement positif, contribuer à en répandre les bienfaits. Bien sûr, telle pratique est liée au profil de la personne, à ses qualités, à ses dons et elle n’est donc pas reproductible telle quelle, mais en montrant un déroulé d’actes concrets, on peut dégager une orientation qui est susceptible d’attirer et de se répandre
Relégué dans cet EHPAD, depuis plusieurs années et devant porter le nuit une protection vis-à-vis de l’urine, celle-ci devant être suivie pour éviter les débordements éventuels, j’ai donc pu observer les comportements du personnel, les étapes principales étant un contact le soir avant le coucher et le change de la protection en fin de nuit. La situation se complique si, pour une raison ou pour une autre : insuffisance de la protection ou abondance d’urine, des fuites se produisent pendant la nuit.
Cependant, une aide-soignante de nuit dans un EHPAD a beaucoup d’autre rôles puisqu’elle est en charge de l’état général des assistés et des perturbation correspondantes : manque de sommeil, anxiété etc
Au cours des mois, nous avons vu bien des intervenant(e)s souvent de passage en vacation et nous pouvons essayer de décrire la pratique dominante.
Dans l’ensemble, on peut distinguer deux variétés. Dans la première variété (majoritaire), le passage du soir s’accompagne de quelques paroles, parfois un début de dialogue. Dans les gestes techniques, on note une attitude de prévenance. Je puis garder un souvenir positif de certaines relations. La seconde variété est dépourvue de sens relationnel : le soir, un bonjour formel, des gestes techniques accomplis sans prévenance et quasiment sans parole, l’assisté ressentant parfois une absence de considération, voire sa réduction à un objet à traiter.
Sur ce fond général, est apparue, en fin d’année 2023, une aide-soignante innovante et relationnelle. Ce fut un changement remarquable et remarqué. C’est parce qu’il nous parait exemplaire que nous essayons ici de le présente en terme d’étude de cas
Nous nous permettrons de l’appeler ici par son prénom : Vanessa. Vanessa est donc apparue en se présentant, puis en amorçant un dialogue. Ce pouvait être au sujet du vécu de la journée, et par la suite, ce moment de dialogue a pu être apaisant pour l’assisté.
Et ce dialogue portait naturellement sur les requis de l’assistance. Il y eut une séquence ou des fuites se manifestaient en fin de nuit. L’aide fut adaptée aux circonstances, ici par un suivi attentif, un change de protection vers 1 heure du matin.
Cette assistance s’est caractérisée également par son attention au temps : annoncer le moment des passages, et même le jour de la prochaine séquence d’intervention, en terme familier : « à jeudi ! ». Ces au revoir s’accompagnaient souvent d’un petit geste de salut. Cette intervention apprivoisait le temps.
Elle apprivoisait aussi l’espace, en l’inscrivant dans une dimension plus vaste, plus « communautaire », le tout étant symbolisé par un geste très fort symboliquement : en quittant la chambre, « Voudriez-vous que je laisse la porte entrouverte ? ». A travers cette demande et la réponse positive qui s’en suivait, se créait un espace commun fondé sur la confiance, une confiance qui s’étendait à la nuit. C’est bien cela, l’écoute attentive, la prévenance de Vanessa entrainaient la confiance. Quel bonheur ! Quelle différence avec un univers impersonnel !
Cependant, à quelques indices, j’ai pu constater aussi combien cette attitude s’inscrivait dans une vision professionnelle. A plusieurs reprises, non seulement, Vanessa est intervenue rapidement lorsqu’un incident lui fut signalé, mais elle me remercia de l’avoir prévenu. Rendu résigné par l’expérience, je fus surpris par son encouragement à téléphoner en cas de fuite de la protection. C’était une expression d’une haute conception de la responsabilité collective. Elle manifestait qu’il y avait bien une présence dans la nuit. Par ailleurs, un incident de voisinage m’a permis de constater qu’elle savait se faire respecter en tant que professionnelle. Je peux ainsi présumer que la pratique décrite ci-dessus s’inscrit dans un professionnalisme, une vision à la fois personnelle et collective de sa fonction.
Cette description peut paraitre louangeuse. Si je suis effectivement reconnaissant vis-à-vis de cette aide-soignante, j’ai voulu rédiger ce bilan en terme de description, la plus objective possible, comme une étude de cas, pour que cette étude permette une réflexion pour l’amélioration des pratiques. Si cet exemple est remarquable, il doit pouvoir inspirer sans décourager. Chaque personne est singulière. Globalement,
nous avons noté qu’une variété majoritaire des pratiques observées est acceptable . On doit mesurer le mérite de ce travail patient dans un contexte qui entraine de la fatigue et où les prestations doivent se maintenir dans la durée. Voici de quoi être reconnaissant. Cette étude ne doit donc pas susciter une quelconque culpabilité et des réactions en retour.
Mon écriture ici n’allait pas de soi. Si nous avons voulu rassembler nos observations pour apporter une description cohérente, c’est pour faire connaitre une pratique remarquable parce qu’elle nous parait pouvoir amener à réfléchir et à inspirer dans le dialogue
Il y a des aides-soignantes remarquables. J’en ai rencontré
J H
Il y a de belles âmes parmi les soignantes en EHPAD
Au cours d’une conversation, ce fut une bonne surprise d’entendre Léo, une aide- soignante chaleureuse parler de son parcours en s’exclamant qu’elle avait rencontrer de belles âmes en EHPAD
Léo-Paul-Dine, venue de Haïti dans les années 1990 a grandi et vécu en France, en surmontant les épreuves qu’elle y a rencontrées. Elle a choisi la profession d’aide-soignante et elle nous dit pourquoi : « C’est un métier de cœur. Pour exercer cette profession, il faut avoir de l’humain en soi ». Effectivement, rencontrer Léo, c’est vivre une relation bienfaisante.
Engagée dans la profession d’aide-soignante, avec quelques pauses dans d’autres emplois, Léo a rencontré des situations très diverses. Et, par exemple, elle raconte que pendant trois ans, en aide à domicile, elle a eu en charge une femme qui était sourde, muette et aveugle. De plus, cette femme avait été abandonnée à la naissance, élevée à l’assistance publique. Léo a communiqué avec elle par le toucher. Elle la tenait par la main et ainsi elle l’orientait. Autre situation, dans un EHPAD, face à un conflit entre fils et mère. Léo raconte comment il y avait là deux copines d’enfance qui vivaient là au même étage face à face. L’une d’elle avait un enfant, mais lorsque celui-ci venait, il l’ignorait en parlant seulement à sa copine. Car il disait avoir souffert de sa mère et lui reprochait d’être cruelle. Cette femme rejetait sa haine sur nous. Lorsque copine est décédée, le fils n’est plus revenu. La mère est décédée sans avoir plus jamais revu son fils. Pour les aide-soignantes, cette situation a été difficiles é supporter, mais Léo a respecté ces personnes.
Au cours de ces années et dans différents emplois, Léo a rencontré beaucoup de soignants et de patients, et parmi elles, de belles personnes. Mais qu’est-ce qu’une belle personne ? Selon Léo, « Une belle personne, c’est une personne qui travaille avec le cœur., qui ne fait pas semblant. C’est une personne qui est juste ».
Léo se rappelle de « Marie, ASH, qui faisait son travail avec le cœur, qui avait le cœur en or, qui apportait une lumière. Les résidents l’aimaient beaucoup. Les autres soignants aussi.
Rosette avait une vie personnelle assez compliquée, mais elle faisait du bon boulot et on avait du plaisir à travailler avec elle. On rigolait avec elle C’était une très bonne collègue.
Suzelle, aide-soignante, était d’une justesse et d’une précision incroyable Lorsqu’on bossait derrière elle, le travail était toujours fait correctement.
Toutes ces personnes aimaient ce qu’elles faisaient et nous étions dans la même pensée. Il y avait toujours de l’entraide. Elles étaient faciles à vivre. C’était des soignantes appréciées de tous les résidents et du personnel ».
Au final, Léo nous parle des conditions de travail. Les « belles personnes », dont elle nous a parlé, sont très efficaces. « Ce sont de bons éléments. Malheureusement, les structures ne savent pas les fidéliser ».
Venant d’une personne qui aime son métier et sait observer, une interpellation à écouter. Plus encore, Léo nous ouvre à la gratitude en partageant une dynamique de vie et en évoquant toutes ces » belles personnes » qui y participent.
Rapporté par J H
Et encore…
A ces textes jusqu’ici non publiés, nous en ajouterons un autre paru sur Vivre et espérer
Une infirmière dans une écoute active
Dans cet EHPAD, les infirmières passent chaque matin apporter les médicaments. Ce peut être une routine. Je me souviens du jour où une nouvelle infirmière apparut en se présentant avec enthousiasme : « Je m’appelle Yo ». Ce fut le point de départ d’un parcours en confiance et en dialogue ouvert par l’attitude de Yo témoignant de convictions profondes telles qu’elle les exprime dans son article :
« Pour moi, infirmière, c’est être dans une écoute active, avoir de l’empathie, tout en étant authentique…. De par ma culture africaine, le respect, la proximité, l’intimité sont des éléments fondamentaux. Quand dans un EHPAD, un ainé me parle, je prends l’habitude de me taire et d’écouter. Cela me permet de donner une réponse. Je suis donc dans une écoute active dans laquelle je mobilise mes connaissances et puis ainsi apporter une réponse adaptée. Je continue à apprendre constamment…
Les journées sont souvent longues et épuisantes, mais, en fin de parcours, je me réjouis d’avoir été au service de personnes vulnérables et de leur avoir apporté, outre les soins, réconfort et soutien. Cela donne un sens à ma vocation de soignante, ce que j’ai toujours voulu faire. C’est un accomplissement de ma vie selon tout ce que je crois : un ordre divin, qui, par mon entreprise, prend soin de ses créatures ».
De Yaoundé à Paris. D’aide-soignante à infirmière. Une vie au service du care et de la santé :
https://vivreetesperer.com/de-yaounde-a-paris/
Textes initiés et rassemblés par J H
On pourra consulter également :
De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin : Cynthia Fleury. Le soin est un humanisme : https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/
L’apport de l’immigration africaine à la culture du care : https://vivreetesperer.com/apport-de-limmigration-africaine-a-la-culture-du-care/

par jean | Avr 5, 2025 | ARTICLES, Vision et sens |
Selon Ilia Delio
La réflexion sur la vie et la mort est au cœur de notre existence. Dans notre société, elle est ravivée au temps de Pâques. Dans un contexte chrétien, la résurrection de Jésus est proclamée, mais, dans certains milieux, des doctrines et des rites accordent beaucoup d’importance à l’empreinte de la mort. Cependant, c’est bien sur la victoire de la Vie que repose notre espérance. Dans son site : « Center for Christogenesis », Ilia Delio aborde cette question existentielle dans un essai intitulé : « Death anxiety and the cross » (1) (l’angoisse de la mort et la croix). Ilia Delio est une sœur franciscaine américaine, à la fois neuroscientifique et théologienne (2). Inspirée par la pensée de Teilhard de Chardin, en phase avec une culture émergente, elle exprime ici une dynamique spirituelle.
Angoisse de la mort
Selon Ilia Delio, l’angoisse de mort est propre à l’homme.
« La nature vit dans la radicalité de l’amour en étant simplement elle-même. Les arbres et les fleurs, le poisson et la volaille, et toutes les créatures vivantes de la terre existent dans leur unique statut de créature ». « Un arbre ne fait rien de plus que d’être un arbre, mais en étant un arbre, il rend gloire à Dieu », écrit Thomas Merton. La nature ne souffre pas d’angoisse de mort ou de peur de la mort comme les humains en souffrent. Plutôt, toute la nature cède à la mort dans un flux de vie. La vie jaillit à travers les restes carbonisés des arbres morts et dans les cendres de violentes explosions volcaniques. La vie trouve un chemin en poussant à nouveau miraculeusement, en émergeant triomphalement dans une vie nouvelle. Le dernier mot de la vie est la Vie elle-même – et c’est Dieu ».
Au contraire, l’angoisse de mort affecte l’humanité.
L’homme est confronté à la peur de la mort. « La violence délibérée de la nature commence avec l’évolution humaine et la montée d’une conscience auto-réflexive. Et ce que nous savons, c’est que nous mourrons ». On trouve des traces de cette conscience jusque dans l’art préhistorique puisque, entre autres, on trouve des symboles de mort dans la grotte de Lascaux. La mort est présente dans l’histoire d’Adam et Eve dans le livre de la Genèse. « L’angoisse de mort est un état psychologique qui a tourmenté les humains à travers les siècles ».
« Aujourd’hui, le monde moderne est tombé dans une nouvelle angoisse de mort à la pensée de la guerre nucléaire et de l’extinction de masse. Notre vie peut disparaitre en un instant. La pensée d’être personnellement effacé de l’univers par la mort a poussé la personne moderne à faire tout ce qui était en son pouvoir pour préserver son empreinte cosmique, depuis des actions héroïques de dévouement à l’accumulation de richesses pour bâtir des monuments, Nous désirons qu’on se rappelle de nous pour quelque chose de petit ou grand ».
Angoisse de mort et pensée religieuse. Péché originel et expiation
Ilia Delio se demande si l’angoisse de mort ne s’est pas incarnée dans une pensée religieuse mortifère. « Je me demande si l’angoisse de mort ne se tient pas derrière la construction de la doctrine du péché originel… Car il y a un écart logique entre le Nouveau Testament et la formulation tardive de la doctrine chrétienne. Le théologien Paul Tillich faisait remarquer que la doctrine du XIe siècle de Saint Anselme, connue comme la ‘théorie de la satisfaction’ (définition : ‘Christ ayant souffert en tant que substitut de l’humanité, satisfaisant par son infini mérite, les exigences requises par l’honneur de Dieu’) retenait l’attention parce qu’elle apaisait le fardeau de la culpabilité… D’autres théories de l’expiation, incluant la substitution pénale ont également été proposées pendant des siècles pour apaiser le fardeau de la culpabilité dans une humanité difforme qui craint le jugement final et la punition éternelle ».
Ilia Delio montre combien cette doctrine est contraire au message de Jésus. « La doctrine de l’expiation et les théories ultérieures de la substitution pénale sont des développements plutôt tardifs dans le christianisme. En d’autres mots, elles ne sont pas immédiatement associées à Jésus de Nazareth. Dans les quelques premiers siècles de l’Église, l’accent a été mis sur la Résurrection et la vie nouvelle en Dieu plutôt qu’une ‘satisfaction’ due au péché ». Ilia Delio explique comment la théorie de l’expiation a émergé après Augustin. « Comme Dieu s’éloignait de la puissance de la vie, vivante en Jésus-Christ, pour aller vers un Être parfait, immuable, intérieur, essentiel, de même ainsi, le péché originel formulé par Augustin, a commencé à forger une humanité déchue (3). L’omnipotence divine et la dépravation humaine devint corrélée. Le christianisme a été construit sur l’angoisse de mort et la menace existentielle du néant de telle façon que nous n’avons jamais pu parvenir à boire à la source de la vie ressuscitée, la vie spontanée, féconde de l’Esprit qui est créativement nouvelle, porteuse d’espérance et orientée vers le futur ».
En Jésus, la conscience divine
« Depuis le début de sa vie, il y a eu quelque chose de différent en Jésus. Elevé dans une famille juive et fidèle aux rituels et aux fêtes juives, Jésus a fait l’expérience du Dieu d’Abraham et de Moïse au cœur de sa propre vie. L’Esprit du Seigneur était sur lui de telle façon qu’il ressentait l’expérience de Dieu en lui. Il était un homme simple et probablement sans instruction, et il a travaillé comme charpentier jusqu’à il se soit senti poussé à parler au nom du royaume de Dieu, comme si quelque chose de nouveau faisait irruption à travers lui – ce que Larry Hurtado et d’autres ont appelé une mutation de conscience (4). La puissance de Dieu s’enflamma en lui, et de cette puissance, un nouveau genre de personne, une personne divine (Godly-person) émergea. La puissance de Dieu brûlait en lui, et de cette puissance, un nouveau genre de personne, une personne divine (Godly-person), a émergé. Jésus a changé les frontières humaines, se montrant être humain et divin à la fois. La puissance du Dieu d’Abraham s’exprimait maintenant dans une personne humaine.
L’ ‘incarnation’ était si contraire au sens commun qu’elle a déstabilisé des catégories chosifiées. Se montrant délibérément comme un humain avec une conscience divine, Jésus a révélé l’arbitraire et le caractère construit de ce que d’autres considéraient être la norme. Sa vie et son ministère ont déstabilisé des valeurs établies. La présence de Dieu ressentie profondément en lui, a poussé Jésus au-delà de la norme. Il devint un perturbateur, un dérangeur, celui qui choquait les autres en ne répondant pas à leurs attentes. ‘N’est-ce pas le fils du charpentier ?’ demandaient-ils ». Ilia Delio nous montre Jésus brouillant les frontières et les habitudes de pensée. « Jésus était incontrôlable parce qu’il était complétement libre. Il y avait en lui une puissance à l’œuvre, non pas une puissance de domination, mais une puissance d’amour, de pardon, de compassion, un pur désir de relever les déchus, d’aider les blessés et de soigner les malades. Jésus se sentait concerné par la personne humaine et par son inclusion dans la communauté. Il a déplacé la focalisation sur le Dieu d’en haut à celle sur le Dieu de l’intérieur… Il a vécu de l’énergie spontanée de l’amour qui vous propulse vers une relation créative ».
« Jésus est un formidable modèle quant à la manière d’être une personne humaine ouverte à et en relation avec la puissance de la vie elle-même, la puissance de Dieu. Jésus est Dieu vivant et aimant dans la chair. Nous ne pouvons pas nous détourner du fait que Dieu est le nom de la Vie elle-même, non un Être, mais le dynamisme d’un Être vivant, relationnel, actif, orienté vers davantage de vie. Prier Dieu, ce n’est pas simplement réaliser un acte d’adoration, mais plutôt prier est être conscient de la vitalité de Dieu en nous et autour de nous. Adorer requiert une vitalité nouvelle en célébration et en communauté, anticipant un nouveau futur ensemble et célébrant la vie nouvelle émergeant parmi nous ».
La croix et une vie invincible
« Il est important de porter attention aux derniers jours de la vie de Jésus telle qu’elle est racontée dans les Évangiles. Un homme innocent, trahi, humilié, injustement accusé de subversion politique, et puis jeté dans une foule en colère qui demande sa mort en échange de la libération d’un criminel. ‘Il a été conduit comme un agneau à l’abattage’ acceptant le destin de la mort sans résistance. Quel genre de personne accepterait volontairement la mort à un âge jeune à moins qu’il ne soit conduit par une croyance ou un engagement plus fort que la mort ? »
Ilia Delio apporte à cette occasion sa réflexion sur la mort : « La mort de Jésus était déjà inscrite le jour où il est né. De la même façon que notre mort est déjà une donnée quand nous ouvrons nos yeux dans l’univers. Nous vivons dans la perspective de mourir, parce que la mort est la forme finale de notre personnalité, l’empreinte que nous laissons dans le cosmos pour toute l’éternité. La mort n’est pas la fin, mais le premier acte plénier de notre personnalité. Comment nous vivons jusqu’à ce premier acte plénier de notre personnalité est le chemin de la vie elle-même. Le plus limité nous vivons, le plus égoïste nous sommes, moins nous contribuons à l’éternelle créativité cosmique de la vie ».
« Jésus a agi comme celui qui était subversif, mais cependant comme celui qui était sans ego séparé. Sa liberté radicale était la liberté de l’amour, compassion, pardon, miséricorde, guérison et espérance. Agir dans un amour subversif, c’est savoir que l’amour fait partie de la vie. Jésus commença son ministère sans avoir peur de mourir parce que la puissance de Dieu était si forte en lui que la vie elle-même ne pouvait être éteinte. L’amour radical vous demande de vivre dans la victoire ultime de la vie, qui est Dieu ».
Ilia Delio envisage la mort de Jésus dans la plénitude de l’amour. « Jésus est mort dans la plénitude de l’amour. ‘Tout est accompli’ a-t-il dit. L’amour est complet quand nous avons fait tout ce que nous pouvons pour réaliser l’amour dans les personnes que nous sommes. Jésus est mort dans une mort terrible parce qu’il croyait que Dieu ne pouvait être anéanti par la terreur d’un pouvoir humain. Et il avait raison ». Notre véritable ennemi, « c’est la distorsion du pouvoir, un pouvoir qui s’érige à partir d’un niveau de pensée enfermé dans nos propres peurs égoïstes ».
Ilia Delio fait le procès de l’intellectualisme : « Nous nous enorgueillissons du pouvoir des idées, nous pensons qu’elles peuvent nous sauver, mais nous oublions comment être nous-mêmes ».
Au moment des célébrations de Paques, Ilia Delio ne se reconnaît pas dans ‘des liturgies interminables ou des prières en termes de formules’. « Cela devait être une célébration tous azimuts de la vie ». Elle appelle des « cris exprimant que la vie ne peut être anéantie par la mort, un engagement dans tout ce nous avons et tout ce que nous sommes, envers la plénitude de vie, la conviction que Dieu est actif et vivant dans la personne humaine, dans les arbres, les plantes, les petits animaux, les créatures vivantes de la terre… ». « Si nous nous sentions nous-mêmes remplis par ce Dieu de vie, alors nous nous précipiterions dans les chemins où la vie est bloquée par l’injustice, la guerre, l’insouciance, l’avidité, la pauvreté ». Ilia Delio évoque le remue-ménage fécond qu’on peut observer dans la vie de Jésus. C’est le fruit d’ ‘une vie remplie de l’Esprit’.
Les compétences conjuguées d’Ilia Delia, sa référence à la pensée de Teilhard de Chardin, sa perception de l’évolution des mentalités lui permettent de fonder sa théologie dans un champ de vision très large. Certes, certains de ses points de vue peuvent être contestés comme comportant trop de distance avec une interprétation biblique classique, mais, comme dans ce texte, elle apporte des éclairages qui font sens. Ici, en effet, elle aborde une question existentielle : la manière dont la condition mortelle de l’homme engendre une angoisse profonde qui se manifeste tout au long l’histoire de l’humanité et qui nous concerne chacun. Il arrive que la religion amplifie cette angoisse, comme ce fut le cas avec la théorie de l’expiation. Ici, Ilia Delio nous apporte une réponse libératrice. En effet, elle sait nous présenter comment, à un tournant de l’histoire juive, Jésus a fait l’expérience du Dieu d’Abraham et de Moïse au cœur de sa propre vie. La puissance de Dieu se manifesta en lui et, de cette puissance, un nouveau genre de personne, une personne divine émergea. Dans une puissance d’amour, de pardon, de compassion, il bouscula les habitudes et les frontières. Ce mouvement se heurta à une violente opposition qui provoqua sa mort terrible sur la croix. Mais, au total, c’est la dynamique de la vie divine qui l’a emporté. Jésus avait commencé son ministère sans avoir peur de mourir parce que la puissance de Dieu était si forte en lui que la vie elle-même ne pouvait être éteinte. Il est mort dans une mort terrible parce qu’il croyait que Dieu ne pouvait être anéanti par la terreur d’un pouvoir humain. Jésus est mort dans la plénitude de l’amour. L’amour radical nous demande de vivre dans la victoire ultime de la vie, qui est Dieu. Le texte d’Ilia Delio se termine sur une affirmation de la victoire finale de la Vie.
J H
- Death anxiety and the cross (les extraits sont traduits à partir de la version anglaise (traduction personnelle non professionnelle). Il existe une traduction française automatique) https://christogenesis.org/death-anxiety-and-the-cross
- Une spiritualité de l’humanité en devenir : https://vivreetesperer.com/une-spiritualite-de-lhumanite-en-devenir/
- Lytta Basset. Oser la bienveillance : https://vivreetesperer.com/bienveillance-humaine-bienveillance-divine-une-harmonie-qui-se-repand/
- Comment la conscience de la divinité de Jésus est apparue : https://vivreetesperer.com/comment-la-conscience-de-la-divinite-de-jesus-est-apparue/