
par jean | Jan 10, 2024 | Expérience de vie et relation |
Notre relation avec le passé varie selon notre contexte de vie et les circonstances. Lorsque nous ressentons des difficultés psychologiques, nous savons aujourd’hui que notre passé n’y est pas étranger. D’une façon ou d’une autre, nous voici appelés à le revisiter. Mais, dans d’autres situations, nous pouvons trouver un réconfort en évoquant des souvenirs heureux. Jusque dans la vie courante, nous sommes appelés à faire des choix, à nous engager dans telle ou telle orientation. Nous envisageons l’avenir en fonction du sens que peu à peu nous avons donné à notre vie. Or, à chaque fois, les pensées qui nous animent dépendent de notre personnalité Et cette personnalité s’est formée peu à peu en fonction de nos rencontres et de nos découvertes qui se rappellent dans nos souvenirs. Quelle conscience avons-nous de nous-même?
Qui sommes-nous ? En regard de ces questions, nous envisageons la rétrospective de notre vie. Cette vie s’enracine dans un passé, non pas pour y demeurer, mais pour se poursuivre et aller de l’avant. Ainsi, lorsqu’un livre parait avec le titre : « Vivre avec son passé. Une philosophie pour aller de l’avant » (1), nous voilà concerné. En même temps, nous découvrons l’auteur, le philosophe Charles Pépin (2). Auparavant, celui-ci a écrit d’autres livres qui nous amènent à réfléchir au cours de notre vie : « Les vertus de l’échec », « la confiance en soi ». Dans ses livres, et dans celui-ci, Charles Pépin témoigne d’une vaste culture. Ainsi, éclaire-t-il son expérience et ses observations à travers la pensée des philosophes, mais aussi les textes des écrivains, sans oublier l’apport des sciences humaines. En traitant ici de la mémoire, il recourt au nouvel apport des neurosciences. En montrant abondamment combien le passé ne disparait pas, mais est toujours là sous une forme ou sous une autre, Charles Pépin nous incite « à établir une relation apaisée et féconde avec notre mémoire…. Les neurosciences nous apprennent que la mémoire est dynamique, mouvante. Nos souvenirs ne sont pas figés…En convoquant sciences cognitives, nouvelles thérapies, sagesses antiques et classiques de la philosophie, de la littérature ou du cinéma, Charles Pépin nous montre que nous pouvons entretenir un rapport libre, créatif avec notre héritage… » (page de couverture). C’est un livre qui ouvre la réflexion et donc entraine des relectures. Cette présentation se limitera donc à quelques aperçus.
Une présence dynamique du passé
Notre passé n’est pas bien rangé dans une armoire close. Nous devons sortir d’une « représentation de la mémoire, statique… accumulative ». Ce n’est pas « un simple espace de conservation du passé » ( p 15).
Cependant, elle a été longtemps peu considérée par la philosophie jusqu’à ce que « Henri Bergson (3) la place au cœur de sa réflexion à la toute fin du XIXè siècle ». « Il a l’intuition assez folle pour son époque, mais confirmée par la science d’aujourd’hui, que notre mémoire n’est pas statique, mais dynamique, que nos souvenirs sont vivants, sujet à des flux et des reflux, affleurant à notre conscience avant de repartir. Et surtout que notre mémoire est constitutive de notre conscience, et donc de notre identité » ( p 16). Nous ne pouvons faire table rase de notre passé. « Nos souvenirs, notre passé irriguent la totalité de notre activité consciente. Notre passé resurgit constamment dans nos perceptions, dans nos intuitions, dans nos décisions… Nous sommes imprégnés d’un passé qui nous parle et nous oriente… » ( p 21). « Notre passé est bien vivant. Il n’est pas seulement passé, mais bien toujours présent » ( p 24). Cette présence peut nous affecter de diverses façons, dérangeante, mais aussi encourageante, réconfortante.. Tout dépend également de l’accueil que nous offrons à nos souvenirs. Charles Pépin nous incité à écouter Bergson qui « nous engage à une attitude d’accueil créatif et d’ouverture à ce passé qui nous constitue. Si notre personnalité condense la totalité de notre histoire personnelle, l’acte libre devient l’apanage de celui qui « prend son passé avec soi », qui l’emporte tout entier pour le propulser vers l’avenir. Nous pouvons nous saisir en même temps de notre passé et de notre liberté : Bergson ne propose rien d’autre qu’une méthode pour y parvenir » ( p 26) .
Ce que nous savons aujourd’hui sur la mémoire
La recherche sur la mémoire a beaucoup progressé. L’auteur dresse un bilan de ces avancées. Ainsi, on identifie aujourd’hui trois mémoires principales : la mémoire épisodique (ou mémoire autobiographique) qui correspond à la « mémoire souvenir » de Bergson, la mémoire sémantique qui est la mémoire des mots et des idées et la mémoire procédurale, rattachée à nos réflexes et à nos habitudes qui se rapproche de la « mémoire habitude » de Bergson ; auxquelles s’ajoutent les mémoires de court terme, de travail et sensorielle ( p 27-28). L’auteur consacre un chapitre à la présentation de ces différents mémoires et de leurs usages telles qu’elles nous apparaissent aujourd’hui grâce à l’apport des neurosciences.
« Notre mémoire épisodique est le souvenir de notre vécu : ces épisodes prêts à se rappeler à notre conscience pour nous réchauffer l’âme ou nous affliger d’un pincement au cœur…. La mémoire épisodique est le siège de notre histoire » (p 28-29). C’est ainsi que nous pouvons nous remémorer notre vie en un récit.
« Le souvenir n’est pas une trace mnésique localisée… mais une manière dont notre cerveau a été affecté, impacté par ce que nous avons vécu ». « Des expériences ont prouvé que notre mémoire ne peut être localisée dans une zone précise du cerveau … Notre mémoire est dynamique et notre cerveau en continuel mouvement et évolution » ( p 33-34). Notre représentation de cette activité est vraiment nouvelle. Elle s’exerce en terme de réseau et dans des modifications constantes. « Notre cerveau se définit par sa plasticité, sa capacité à évoluer sans cesse… Le cerveau se modifie en permanence, et nous pouvons toujours le transformer à nouveau » ( p 35). Dans ces interconnexions, « le souvenir est comme reconfiguré par ce que nous avons vécu depuis, par le contexte présent ». L’imagination prend part au processus.
« Le sens que nous donnons à nos souvenirs dépend également des idées et des valeurs que nous leur attribuons, C’est le rôle de la mémoire sémantique » ( p 37). « La mémoire sémantique contient les mots que nous posons sur les objets, les notions, les concepts, les « vérités générales ». En elle s’inscrit notre connaissance du monde. Elle ne se charge pas, comme la mémoire épisodique, des épisodes, mais de ce que nous en avons déduit ». ( p 38) .Si, à partir de certains évènements vécus, nous avons développé des représentations négatives, une dépréciation de nous-même, cela fait partie également de la mémoire sémantique.. Or, à ce niveau, nous pouvons corriger les croyances qui sont néfastes pour nous en réinterprétant les situations dont elle sont originaires. « Il est tout à fait possible de substituer des croyances dans notre mémoire sémantique implicite. Nous pouvons ainsi « échapper au ressassement d’un souvenir douloureux en travaillant sur celui-ci pour changer d’éclairage » ( p 42). L’auteur cite un écrivain marqué par ses origines sociales et qui parvint à se libérer de ses croyances dévalorisantes en développant une nouvelle interprétation ( p 42-46).
Il y a une troisième mémoire. C’est la mémoire procédurale. C’est « la mémoire de nos habitude ou réflexes, celle qui nous permet de conduire une voiture, de faire du vélo, de jouer du piano… » ( p 46). Les savoir-faire enregistrés dans cette mémoire procédurale résistent au temps qui passe, et même aux atteintes d’Alzheimer.
Aux trois mémoires à long terme évoquées précédemment, s’ajoutent deux mémoires é court terme : la mémoire de travail et la mémoire sensorielle ( p 52-55). « Nous vivons ainsi dans un présent constitué de différentes couches du passé… ».
Le passé, socle de notre identité
« La question de l’identité personnelle est un des problèmes philosophiques les plus passionnants, mais aussi les plus complexes » nous dit Charles Pépin. « Qu’est ce qui nous définit en tant qu’individu singulier, nous distingue de tout autre ? Qu’est ce qui demeure en nous de manière permanente et constitue ainsi le socle de notre identité ? » ( p 85).
Si nous nous interrogeons en ce sens, nous sentons bien combien nous pensons notre être, notre personnalité à travers notre histoire personnelle. L’auteur interroge les philosophes. Ici, nous rejoignons la thèse du philosophe anglais, John Locke : « Les souvenirs nous disent que nous sommes nous-mêmes, ils fondent notre conscience de soi, de cette continuité entre toutes nos perceptions » ( p 86). L’auteur poursuit sa réflexion sur « la fabrique de l’identité » : « Notre mémoire n’est pas seulement le réceptacle de notre itinéraire de vie, susceptible d’éclairer nos comportements, nos réactions et émotions. Nos souvenirs fondent la conviction que la personne qui a vécu tous ces évènements est bien identique à celle qui s’en souvient. Ils fondent la conscience d’une identité qui perdure » ( p 89).
L’auteur évoque ensuite l’œuvre de Marcel Proust : « A la recherche du temps perdu ». Celui-ci explore la portée de ses réminiscences. « Bien que soumis, comme toute chose au passage du temps, le narrateur qui trempe sa madeleine dans son thé et se remémore son enfance réalise que, en dépit des années écoulées, charriant leur lot de plaisirs et de peines… quelque chose de lui est demeuré que Proust nomme « le vrai moi…Ce « vrai moi » prend chez Proust de accents mystiques : il s’agit d’un mois profond, d’un moi immuable, d’une essence de moi qui semble indiquer la possibilité d’une vie éternelle. Et si en effet
ce moi résiste au temps, pourquoi ne résisterait-il pas éternellement ? » ( p 95).
Cette lecture du livre de Charles Pépin nous renvoie à une autre : la lecture du livre de Corinne Pelluchon : « Paul Ricoeur. Philosophie de la recontruction » (4), où elle aborde le thème de l’identité à partir du livre de Paul Ricoeur : « Soi-même comme un autre ». L’auteure envisage l’identité comme « une identité narrative, c’est-à-dire qu’elle se recompose sans cesse » ( p 119). « Parler d’identité narrative signifie d’abord que la connaissance de soi passe par le fait de se raconter, de tisser les différents éléments de sa vie pour leur conférer une unité et un sens qui n’est pas définitif et n’exclut pas les mises en question…. L’identité n’est pas figée ni à priori ; elle se transforme et se construit à travers des histoires que nous racontons sur nous-même et sur les autres, et elle se nourrit des lectures et des interprétations qui enrichissent notre perception du monde et de nous » ( p 120).
Remédier aux blessures du passé
Le passé de chacun est différent. Il s’y trouve des joies et des souffrances, des moments de bonheur et des souffrances, des libérations, mais aussi des blessures dont les effets se poursuivent en forme de ruminations et de dépendances. On peut chercher à oublier ces emprises, mais les souvenirs sont vivaces et parfois reviennent au galop. On peut aussi entrer dans la mémoire pour en transformer les effets. Il y aujourd’hui, de nombreuses approches en ce sens, nous rapporte Charles Pépin. C’est une bonne nouvelle.
Alors on peut rejeter la tentation de l’oubli.
Cependant, l’auteur nous décrit les nombreux comportements qui traduisent une volonté de « tourner le dos à son passé ». Si cette attitude peut réussir dans l’immédiat, elle comporte des risques et peut engendre des situations désastreuses. « L’évitement a un coût psychique ». « Nous n’ignorons pas le passé si aisément…Le garder à l’écart impose une lutte constante, qui peut devenir inconsciente, mais certainement pas gratuite » ( p 110). « Plus dangereux est le traumatisme, plus dangereux est le piège de l’évitement » ( p 116). L’auteur décrit des conduites pathologiques en recherche de l’oubli : travailler pour oublier, boire pour oublier… La situation de l’alcoolique est particulièrement critique. Car son addiction peut déboucher sur une altération de la mémoire « antérograde », c’est-à-dire de la capacité à se constituer de nouveaux souvenirs, à garder en mémoire ce qui vient d’être vécu », une faculté compensatrice.. ( p 122-124). « Puisque l’évitement est dangereux, l’oubli impossible, il nous faut donc apprendre à vivre avec notre passé, à « faire la paix » avec lui » ( p 142).
Durant ces dernières décennies, de grands progrès ont été réalisé en psychologie (5) et la gamme des approches s’est considérablement élargie. C’est dans ce contexte que Charles Pépin a écrit un chapitre : « intervenir dans son passé ». Son approche est globale et ne se limite pas à telle ou telle thérapie. « La vie nous offre parfois de porter un autre regard sur notre passé, de changer notre perception de celui-ci. L’élément déclencheur peut aussi bien être une discussion avec un aïeul, une rencontre qui nous ouvre de nouvelles perspectives, une empathie nouvelle pour quelqu’un qui nous a causé du tort, ou encore le temps qui passe et qui crée une distance salutaire…ou tout simplement une joie de vivre retrouvée, une période plus heureuse qui recolore le passé… Notre histoire nous apparait sous un nouveau jour… Nous voilà tout naturellement apaisés, libérés… » ( p 182)..
« Mais il arrive que la vie ne nous offre pas les conditions suffisantes, propices à une rémission de l’hier…. Nous sommes enfermés dans nos ruminations. Certains passés traumatiques rendent alors nécessaires d’intervenir dans notre passé, parfois avec l’aide d’un thérapeute. Les techniques développées dans ce chapitre sont pour la plupart issues des « thérapies de reconsolidation de la mémoire », mais elles dessinent une voie d’intervention que chacun de nous peut mettre en œuvre seul… Ces techniques reposent sur la méthode suivante : intervenir sur le souvenir en modifiant l’émotion ou l’interprétation qui y sont attachées » ( p 183-184). L’auteur propose donc trois approches : Changer la règle de vie implicite attachée au souvenir ; développer une technique d’habituation au mauvais souvenir ; faire intervenir un personnage fictif dans ses souvenirs : les techniques de reparentage (imaginer une figure aimante et bienveillante appelée figure de « reparentage » qui intervient au cœur de l’épisode douloureux remémoré).
A titre d’exemple, rapportons la première approche. Elle consiste à sortir un souvenir de notre mémoire à long terme pour le retraiter dans notre mémoire de travail avant de le « renvoyer » dans notre mémoire de long terme…. Si nous ne pouvons pas effacer un souvenir de notre mémoire épisodique, nous pouvons en revanche effacer ou réinterpréter une règle de vie implicite dans notre mémoire sémantique, déconstruire cette « vérité émotionnelle, héritée de notre passé qui nous entrave » ( p 184).
Charles Pépin évoque trois penseurs contemporains en fin de de XIXè et début de XXè siècle : Bergson, Freud et Proust qui, tous les trois, ont porté une grande attention à la mémoire et à la question du temps ( p 204-206). Il aborde ensuite « la psychanalyse freudienne, un retour au long cours sur son passé ». il rapporte l’évolution de la pratique psychanalytique. « La cure psychanalytique nous guide dans une nouvelle manière de dire les choses, comme elles viennent, sans souci de cohérence, ni de censure morale. Elle nous apprend à diverger et éclairer soudain notre passé d’un jour nouveau ». L’auteur voit dans « cet art de la divergence », « le meilleur antidote du ressassement » ( p 214).
Prendre appui sur son passé
Si le passé peut nous déranger par le souvenir de certaines expériences malheureuses qui stagnent encore et viennent nous assombrir, à l’inverse nous pouvons y trouver force, soutien et consolation. Charles Pépin évoque cet apport positif dans un chapitre : « Prendre appui sur son passé ». Ici, l’auteur se réfère de nouveau à Bergson. « Un désir authentique, en adéquation avec soi-même, explique Bergson, ressaisit toute notre histoire et nous conduit à un objectif qui prend un sens profond pour nous ».
« Lors d’une conférence donnée à Madrid, Henri Bergson synthétise cette idée de ressaisir notre passé pour nous projeter dans l’avenir sous le concept de « récapitulation créatrice » ( p 149). Comme à son habitude, et c’est un apport très riche de son livre qui, par définition, ne peut être mis en valeur par un simple compte-rendu, Charles Pépin appuie son propos par des exemples vivants. Fils de boulanger, dans sa première jeunesse, cet homme avait quitté sa ville natale pour monter à Paris. A l’aube de la trentaine, il fut pris de doutes. Lassé par un travail qui ne lui apportait pas les satisfactions que procure l’artisanat, il reprit l’affaire familiale et fit prospérer cette boulangerie en usant des savoirs appris par ailleurs. Ainsi doit-il le succès de sa reprise de l’entreprise paternelle à la synthèse qu’il a su faire entre ses souvenirs d’enfance et ses expériences professionnelles. Il a récapitulé l’ensemble de son histoire en se montrant créatif pour inventer sa manière personnelle d’être boulanger » ( p 150).
« Dans son « Essai sur les données immédiates de la conscience », Bergson écrit : « Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l’expriment… ». Cette réflexion peut éclairer nos choix. « Notre acte est libre parce que nous nous y « retrouvons ». Toute notre identité s’y exprime comme si notre vie entière devait nous avoir conduit à ce point et à cette prise de décision ». ( p 156-157).
Dans « La pensée et le mouvement », Bergson emploie une jolie expression, « la mélodie continue de notre vie intérieure » pour évoquer ce moment ou nous rencontrons une activité qui nous correspond et nous offre un espace d’expression nouveau : c’est comme si nous entendions notre mélodie intérieure » ( p 165).
Chez Bergson, ce regard sur la vie s’inspire d’une pensée, d’une métaphysique : « la Vie et un « Elan vital », une force de créativité fondamentale qui pulse au cœur même du vivant, de tous les vivants… l’Elan vital se particularise en chacun de nous et, en ce sens, nous manifestons tous une part de cette Vie, de cette force métaphysique que Bergson qualifie de divine » ( p 186-174). « Notre personnalité est plus que le résultat de notre passé, que « la condensation » de l’histoire que nous avons vécue depuis notre naissance » comme l’écrit Bergson dans « L’Evolution créatrice ». Elle est notre identité, mais propulsée vers l’avant, traversée par cette force de vie qui nous pousse à agir, à créer » ( p 174). « Cet Elan vital nous pousse aussi à nous tourner vers les autres, vers le monde, vers l’avenir. Il nous appelle à prendre notre part de responsabilité et nourrir nos élans de générosité. Ainsi l’Elan vital devient une force de décentrement… Nous sentons que la vie qui pulse en nous n’est pas simplement la nôtre, que nous sommes plus que de simples individus isolés : nous appartenons à un tout dont nous sommes solidaires » ( p 178). Tout cela contribue à éviter de ressasser en nous ouvrant au mouvement de la vie ( p 181).
Aller de l’avant avec son passé
Ainsi, dans un chapitre final, Charles Pépin nous invite à aller de l’avant avec notre passé ». L’auteur aborde là des questions sensibles comme la question du pardon ou l’épreuve du deuil. Ce sont là des passages difficiles à franchir. Comme ces thèmes sont complexes, ils demanderaient une analyse approfondie, et après la présentation déjà approfondie de ce livre, nous renvoyons à une lecture directe de ces textes.
Charles Pépin évoque également le soutien que les souvenirs peuvent apporter dans cette marche en avant. Notre mémoire vivante. De nouvelles expériences, de nouveaux intérêts, de nouvelles joies peuvent susciter de nouveaux souvenirs. Et, le cas échéant, ceux-ci pourront « empiéter » sur les mauvais souvenirs, les diluer, et faciliter ainsi notre acceptation du passé (p 231).
Cependant, en terminant cette présentation, nous mettrons l’accent sur un aspect qui nous parait essentiel : l’usage de notre mémoire positive, la remémoration émotionnelle de nos bons souvenirs. « Nous l’oublions trop souvent, mais nous avons ce pouvoir de redonner vie aux belles choses du passé, de les convoquer avec créativité : nos souvenirs heureux, eux aussi, doivent être reconsolidées. Quel dommage de les laisser à l’état de veille, enfouis dans les limbes de notre mémoire, de nous priver de leur éclat, du réconfort qu’ils peuvent nous apporter, du désir de vivre qu’ils peuvent nourrir ici et maintenant » ( p 217). L’auteur ajoute : « Pour goûter à nouveau les plaisirs passés, il faut se montrer non seulement disponible, mais aussi capable de leur ouvrir la porte, d’en tirer le fil avant de se laisser envahir. Comme Proust nous l’a montré, il faut donner au souvenir l’opportunité de revenir dans sa richesse, et non simplement le laisser passer…» ( p 219). Cette culture de la mémoire peut se développer sur tous les registres. L’auteur cite ainsi un texte paru dans « Les confessions » de Saint Augustin une invitation inspirée à retrouver l’éblouissante présence du passé : « Et j’arrive aux plaines, aux vastes palais de la mémoire, là où se trouvent les trésors des images innombrables… ». « iI n’appartient qu’à nous d’exhumer ces trésors pour les contempler » (p 217).
Le livre de Charles Pépin ne nous apporte pas seulement des orientations de réflexion. Il est nourri par des récits d‘expérience. Il permet à un vaste public de s’interroger sur la manière de mieux vivre avec le passé. Bien sûr, ce livre éveille des échos
Dans nos épreuves, c’est bien aux fondations de notre personnalité que nous faisons appel, telles qu’elles sont imprégnées par l’inspiration qui nous porte. C’est bien la mémoire qui entre en jeu. Nous pouvons évoquer d’autres expériences où les souvenirs peuvent nous encourager et nous soutenir. Ainsi pour ceux qui sont assignés à des lieux clos dans toute leur variété de l’ehpad à la prison, les souvenirs heureux peuvent être revécus et importer une forme de bonheur. Una amie, accompagnatrice de nuit dans un ehpad, nous rapportait que le positif dans ses conversations avec les personnes âgées résidait souvent dans leur évocation de souvenirs heureux.
Si nous savons porter notre regard sur le bon et le beau que nous pouvons voir dans le passé, alors nous pouvons exprimer de la gratitude. Pour moi, j’aime le petit chant qui nous invite à « compter les bienfaits de Dieu » et à manifester ma reconnaissance. La gratitude est une composante de la vie spirituelle (6). Comme nous sommes des êtres interconnectés, cette reconnaissance n’est pas seulement individuelle. Elle est collective et elle apparait ainsi dans l’expression biblique. Et si nous pouvons trouver dans notre passé des motifs de gratitude, on sait maintenant, grâce à la recherche en psychologie et en neurosciences, les bienfaits qu’une expression de gratitude engendre en terme de santé mentale et corporelle (7). En inscrivant le déroulement de notre passé dans cet « Elan vital » que Bergson nous décrit, Charles Pépin nous appelle à entrer dans une dynamique pour « vivre avec notre passé »`
J H
- Charles Pépin. Vivre avec son passé Une philosophie pour aller de l’avant. Allary Editions, 2023. Il y a maintenant plusieurs vidéos dans lesquelles Charles Pépin est interviewé sur son livre :France inter : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=vivre+avec+son+passé++You+Tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:4cf8c2c6,vid:KrKgEkytwxU,st:0 Librairie Mollat : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=vivre+avec+son+passé++You+Tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:6c804f91,vid:RDMoO2srfr0,st:0 Métamorphose. Eveille ta conscience : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=vivre+avec+son+passé++You+Tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:c63c05a8,vid:rAWIN_utqX4,st:0
- Charles Pépin. Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Pépin
- Comment, en son temps, le philosophe Henri Bergson a répondu à nos questions actuelles : https://vivreetesperer.com/comment-en-son-temps-le-philosophe-henri-bergson-a-repondu-a-nos-questions-actuelles/
- Corinne Pelluchon. Paul Ricoeur, philosophe de la reconstruction. Soin, attestation, justice. Presses Universitaires de France, 2022
- Les progrès de la psychologie. Un grand potentiel de guérison : https://vivreetesperer.com/les-progres-de-la-psychologie-un-grand-potentiel-de-guerison/
- Avoir de la gratitude. Bertrand Vergely : https://vivreetesperer.com/avoir-de-la-gratitude/
- La gratitude. Un mouvement de vie. Florence Servan-Schreiber : https://vivreetesperer.com/la-gratitude-un-mouvement-de-vie/
par jean | Mar 5, 2021 | ARTICLES, Vision et sens |
 « Ci-git l’amer. Guérir du ressentiment » de Cynthia Fleury
« Ci-git l’amer. Guérir du ressentiment » de Cynthia Fleury
Il nous arrive, il nous est arrivé de rencontrer des gens qui manifestent un profond ressentiment. Nous avons pu nous-même éprouver du ressentiment envers quelqu’un ou à notre égard. Nous savons combien il est précieux de pouvoir sortir de cette situation. Et, plus généralement dans la vie sociale, et tout particulièrement si nous fréquentons certains réseaux sociaux et parcourons certains commentaires sur internet, nous y percevons parfois des bouffées de haine, des violences verbales dont nous percevons le rapport avec un profond ressentiment. Le ressentiment est donc une réalité assez répandue qui ne nous est pas inconnue et que nous avons besoin de comprendre pour y faire face, car c’est une réalité pernicieuse.
Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, vient d’écrire à ce sujet un livre intitulé : « Ci-git l’amer » avec pour sous-titre : « Guérir du ressentiment ». C’est un ouvrage conséquent de plus de 300 pages qui, en 54 chapitres, étudie le problème du ressentiment dans ses dimensions personnelles et collectives, à partir d’une culture psychanalytique, philosophique et littéraire qui mobilise de nombreuses références, ainsi, parmi d’autres : Scheler, Nietzche, Winnicott, Mallarmé, Montaigne, Fanon… La culture de Cynthia Fleury est très vaste et se manifeste sur de nombreux registres. Lorsqu’on ne dispose pas des mêmes outils de compréhension, on peut donc hésiter à entrer dans cette lecture et encore plus à s’engager dans la présentation du livre. Il nous paraît que ce serait fort dommage de se passer d’un tel apport, car l’écriture de Cynthia Fleury est claire, compréhensible et elle sait mettre les mots appropriés sur les différents aspects du ressentiment. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». Cette qualité d’écriture nous paraît remarquable. Elle nous aide dans la compréhension du phénomène.
La pensée de Cynthia Fleury se déploie dans une grille d’analyse d’inspiration psychanalytique. « D’où vient l’amertume ? De la souffrance et de l’enfance disparue, dira-t-on d’emblée. Dès l’enfance, il se passe quelque chose avec l’amer et ce Réel qui explose dans un monde serein. Ci-git la mère. Ci-git la mer. Chacun fera son chemin, mais tous connaissent le lien entre la sublimation possible (la mer), la séparation parentale (la mère) et la douleur (l’amer), cette mélancolie qui ne relève pas d’elle-même… L’amer, la mère, la mer, tout se noue » (p 13). Et comment traiter avec l’amer ? Cynthia Fleury évoque son travail de psychanalyste et les ressources de la « rêverie océanique ». La mer n’est pas une affaire de navigation, mais de grand large existentiel, de la sublimation de la finitude et de la lassitude » (p 14). « Universelle amertume », tel est le titre du premier chapitre. Le livre s’intitule : « Ci-git l’amer ». Notre propos n’est pas de commenter la vision de la vie qui est celle de l’auteur, mais de nous instruire de son analyse du ressentiment. Nous voici donc à la découverte du ressentiment d’abord dans sa version individuelle, puis dans sa vision collective.
Le ressentiment
Cynthia Fleury nous fait part de la définition du ressentiment telle que nous la communique Max Scheler dans un essai publié à ce sujet en 2012 : « L’expérience et la rumination d’une certaine réaction affective dirigée contre un autre qui donnent à ce sentiment de gagner en profondeur et de pénétrer, peu à peu, au cœur de la personne, tout en abandonnant le terrain de l’expression et de l’activité ». Cynthia Fleury commente en ces termes : « Le terme clé pour comprendre la dynamique du ressentiment est la rumination… Il s’agit de revivre une ré-action émotionnelle qui, au départ, pouvait être adressée à quelqu’un de particulier. Mais le ressentiment allant, l’indétermination de l’adresse va prendre de l’ampleur. La détestation se fera moins personnelle, plus globale… » (p 19). Il y a là un processus destructeur.
« Cela gronde, comme l’écrit Max Scheler à travers le mot allemand : groll. « Groll, c’est la rancœur, le fait d’ « en vouloir à » ; et l’on voit comment ce « en vouloir à » prend la place de la volonté, comment une énergie mauvaise se substitue à l’énergie vitale joyeuse… Le ressentiment allant, l’indétermination se fait plus grande… Tout est contaminé. Tout fait boomerang pour raviver le ressentiment ». L’effet est dévastateur. « Scheler évoque l’auto-empoisonnement pour décrire les « malfaits » du ressentiment »… « Le sens du jugement est vicié de l’intérieur. La pourriture est là » (p 22). Ainsi, le sens du jugement, « instrument possible de libération » est détourné vers « le maintien dans la servitude devant une pulsion mortifère ».
Si le ressentiment a un visage personnel, il débouche également sur une pulsion collective. Aujourd’hui, celle-ci s’exprime particulièrement sur les réseaux sociaux.
https://youtu.be/ElNNOOXQEv4
Guérir du ressentiment
Confronté au ressentiment, Cynthia Fleury perçoit la difficulté d’en sortir pour ceux qui s’y emprisonnent. « Seule aptitude du ressentiment à laquelle il excelle : aigrir, aigrir la personnalité, aigrir la situation, aigrir le regard sur. Le ressentiment empêche l’ouverture. Il ferme, il forclôt, pas de sortie possible ; le sujet est peut-être hors de soi, mais en soi, rongeant le soi, et, dès lors, rongeant la seule médiation possible vers le monde » (p 24). D’autant que le ressentiment peut se radicaliser : « Je puis tout te pardonner sauf d’être ce que tu es, sauf que je ne suis pas toi. Cette envie porte sur l’existence même de l’autre » (p 25). Dès lors, dans la relation clinique, « l’extraction hors de cette emprise sera extrêmement compliquée. Il faut poser comme idée régulatrice que la guérison est possible, mais que la clinique est sans doute insuffisante dans son soin. Il est impossible de dépasser le ressentiment sans que la volonté du sujet entre en action. C’est précisément cette volonté qui est manquante, enterrée chaque jour par le sujet lui-même » (p 25).
Cependant, quel est le chemin de guérison proposée par Cynthia Fleury ? « L’homme qui échappe au ressentiment n’y échappe pas d’emblée . C’est toujours le fruit d’un travail… la sublimation des instincts… Celle-ci est « un talent » de faire avec les pulsions autre chose que du pulsionnel régressif, de les tourner vers un au delà d’elles-mêmes, d’utiliser à bon escient l’énergie créatrice qui les parcourt » (p 65). C’est apprendre à bien utiliser son énergie. « La grande santé, c’est choisir l’avenir, choisir le numineux » (p 71). Cynthia Fleury prône l’accès à la création. « Choisir l’œuvre, c’est toujours choisir l’ouvert ». « L’œuvre crée l’air, l’ouverture, la fenêtre. Elle crée l’échappée » (p 73).
Le ressentiment collectif
Les ressentiments individuels peuvent s’exprimer collectivement, par exemple en empruntant la voie d’internet. En quelque sorte, ils s’agglutinent dans un déchainement de violence verbale. Cependant, le phénomène n’est pas nouveau parce que, dans l’histoire, on a pu observer des comportements analogues, par exemple dans un lien entre la passion de l’égalité et le ressentiment collectif. « La structure du ressentiment est égalitaire. Celui-ci surgit au moment où le sujet se ressent certes inégal, mais surtout lésé parce qu’égal… La frustration se développe sur un terreau de droit à… Je me crois lésé parce que je crois à mon dû ou à mon droit » (p 28). Il y a là un processus dangereux. « Dénigrer les autres ne suffit pas au ressentiment. Il faut un pas de plus : la mise en accusation. Celle-ci étant toutefois sans objet réel, elle vire à la délation, à la désinformation… Dorénavant, l’autre sera coupable. Une forme de dépréciation universelle s’enclenche » (p 29). Cette fureur engendre évidemment la fin du discernement : « Ne plus faire le point des choses, viser la « tabula rasa » sans autre projet »… « Il se produit un « éthos renversé », une « disposition générale » à produire de l’hostilité comme d’autres produisent de l’accueil au monde » (p 30). C’est bien ce que l’on observe dans une violence répétitive qui marque certains commentaires politiques apparaissant sur internet.
Cynthia Fleury nous décrit « l’homme ressentimiste » qui se manifeste ainsi. « L’une des manifestations les plus explicites et audibles du ressentiment demeure l’utilisation ordurière du langage. L’homme du ressentiment… se lâche et vomit, par son langage, sa rancœur (p274-275). L’homme ressentimiste choisit délibérément de n’user du langage que pour dégrader l’autre, le monde, les rapports qu’il entretient avec lui ». C’est une manifestation de haine. « Cette haine dresse un cadre de vie et de pensée assez nauséeux, car du ressentiment au délire conspirationniste, il n’y a qu’un pas. Telle est la version collective du désir de persécution. (p 284). On assiste à une logique implacable où les valeurs s’inversent. « Si vous êtes riche et bien portant dans cet univers inique, c’est que vous êtes complice de cet univers inique. Le ressentiment est une idéologie, un rapport de force qui cherche à s’établir et à promouvoir les intérêts d’un nouveau groupe qui se trouve spolié » (p 286). Il y a donc un renversement de la mentalité. « La notion de « mundus inversus » est très importante pour comprendre le lien manifeste entre ressentiment et pensée conspirationniste. Elle correspond à une sorte de solution magique ayant réponse à tout, pouvant expliquer toutes les vexations narcissiques de l’individu ressentimiste et permet par ailleurs une merveilleuse dissolution de ses responsabilités… Le raisonnement conspirationniste est bien connu dans la psychiatrie, car il est l’apanage des structures paranoïaques » (p 288).
Réduire le ressentiment collectif
Cependant, si ces processus de pensée sont malheureusement répandus, on peut s’interroger sur les conditions qui peuvent en favoriser le développement. Ainsi combien il est important de respecter les singularités, l’originalité de chacun. La question a été posée au niveau des institutions de soin, des asiles. « Il est intéressant de voir que cette analyse peut être élargie de nos jours au fonctionnement plus global de la société. Que faire de l’attention au petit, à l’infime, aux détails du singulier ? y a-t-il une place pour cela dans la politique ? » (p 262). C’est prendre garde à la « réification », à la chosification, à la normalisation qui s’opèrent dans les institutions publiques comme « si elles prenaient plaisir à détruire les positions de l’individu pour le mettre sous tutelle et enlever tout goût d’individuation » (p 261). Cynthia Fleury met en évidence des facteurs favorisant des dysfonctionnements individuels et des dysfonctionnements collectifs. « Il s’agit de comprendre que la santé psychique des individus produit un impact tout à fait indéniable sur le fonctionnement de la société… Dans « Les irremplaçables », j’avais cherché à démontrer ce lien à l’égard d’un individu réifié, se sentant remplaçable, interchangeable, non respecté par un environnement notamment institutionnel et professionnel, donc public au sens large. Comment cet individu, petit à petit, se clivait pour résister à cette maltraitance psychique » (p 271). « Nos institutions doivent produire assez de soin pour ne pas renforcer les vulnérabilités inhérentes à la condition humaine, à savoir ses conflits pulsionnels… et prendre garde à ne pas produire de la réification qui après s’être retournée contre les individus, les avoir rendu malades, se retourne contre la démocratie elle-même en développant la traduction politique de ces troubles et notamment dudit ressentiment » (p 273).
Plus généralement, le ressentiment collectif se nourrit d’une angoisse sociale en lien avec un manque de relations humanisantes. Cynthia Fleury cite Michel Angenot dans une analyse qui s’inspire de Max Weber. « Les idéologies du ressentiment sont intimement liées aux vagues d’angoisse face à la modernité, à la rationalisation, à la déterritorialisation. La mentalité de la « gemeinshaft », homogène, chaude et stagnante a tendance à tourner à l’aigre dans les sociétés ouverts et froides, rationnelles et techniques. Le ressentiment qui recrée une solidarité entre pairs rancuniers et victimisés… apparaît comme un moyen de réactiver, à peu de frais, de la chaleur, de la communauté dans l’irrationnel chaleureux » (p 290). Ainsi, pour Cynthia Fleury, prévenir le ressentiment collectif autant que faire se peut, c’est veiller à ne pas renforcer les processus extrêmes de rationalisation et de déterritorialisation qui provoquent immanquablement un sentiment de réification et donc, par réaction, une résistance qui, très vite, préfère se soumettre à une passion victimaire » (p 291).
Cette présentation du livre de Cynthia Fleury nous fait comprendre l’importance du ressentiment et en éclaire les ressorts. Mais il est très loin de rendre compte de la richesse de cet ouvrage. Ainsi, l’auteure traite également des incidences de la colonisation et des processus du fascisme. Et aussi, on découvre des réflexions sur des sujets de grande importance comme le discernement (p 30-31) ou la pratique d’écriture en thérapie (p 257-258). Dans ce livre, Cynthia Fleury entre en dialogue avec ses pairs, analystes et psychologues. Si notre culture est différente, il reste que Cynthia Fleury ouvre au lecteur non expert des fenêtres de compréhension. Dans cette tâche, elle est servie par une écriture riche et précise autant que par sa vaste culture. A une époque où nous sommes confrontés au ressentiment, au moins dans sa forme collective, il serait dommage d’ignorer l’apport de ce livre.
Cynthia Fleury aborde la question à partir de sa culture et de sa pratique d’analyste. D’autres points de vue sont envisageables. Ainsi peut-on envisager la prévention du ressentiment à partir d’une culture spirituelle qui met en avant l’amour, la miséricorde, le pardon, d’une culture relationnelle de la fraternité et de la communauté. C’est l’enseignement de Jésus qui, dans la dynamique de l’Esprit, nous appelle à un amour universel et à un pardon inépuisable. Nous voici, aujourd’hui interpellé par les manifestations de ressentiment. Cynthia Fleury nous permet d’envisager les dimensions de ce phénomène, d’en comprendre les ressorts et de participer ainsi à la « guérison du ressentiment ». Voila un précieux éclairage.
J H
- Cynthia Fleury. Ci-git l’amer. Guérir du ressentiment. Gallimard, 2020. Cynthia Fleury est interviewée sur son livre dans plusieurs vidéos : France culture. Dépasser le ressentiment pour sauver la démocratie : https://www.youtube.com/watch?v=ElNNOOXQEv4
Voir aussi :
De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin
https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/
par jean | Sep 24, 2013 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement, Vision et sens |
 Un avenir pour l’humanité dans l’inspiration de l’Esprit.
Un avenir pour l’humanité dans l’inspiration de l’Esprit.
#Pippa Soundy est une amie anglaise qui, au long des années, a effectué un parcours spirituel qu’elle poursuit actuellement comme pasteure-prêtre dans l’Eglise anglicane, constamment en recherche des émergences positives. Pippa a pris connaissance du livre de Anne-Sophie Novel et Stéphane Riot : « Vive la Co-révolution. Pour une société collaborative », en lisant, sur ce blog, la présentation de cet ouvrage (1). Dans une dimension internationale, elle en perçoit toute l’originalité. Pour elle, cette perspective prend tout son sens dans la vision d’un Dieu lui-même communion. Elle répond ici à quelques questions.
#Pippa, peux-tu nous décrire brièvement ton parcours ?
#J’ai été une enfant studieuse et c’est au cours de mes années d’études à l’université d’Oxford que j’ai connu le Christ comme personne vivante. Depuis lors, j’ai été membre de plusieurs églises et cela fait six ans que j’exerce un ministère. Au départ, je considérais l’Église comme la « société alternative » inaugurée par Jésus, un peu à part de la société en général. Mais ces dernières années, je suis devenue plus consciente que l’Esprit de Dieu agit à travers toutes sortes de personnes et d’institutions et, aujourd’hui, je me considère moins comme ‘leader d’église’ que comme facilitateur de communauté et je pense que le partenariat est la clé d’une transformation de la société.
#Pourquoi t’intéresses-tu particulièrement aujourd’hui aux changements culturels et aux innovations sociales ?
#Le monde change plus vite aujourd’hui qu’à tout autre moment de l’histoire de l’humanité et la culture change aussi, à la fois au niveau mondial et local. Il est urgent que nous trouvions des solutions innovantes et créatives aux problèmes rencontrés sur toute la planète et cela m’intéresse de réfléchir à la façon dont nous, chrétiens, permettons à notre relation avec Dieu de donner forme à notre engagement dans ce processus de changement. Je pense que c’est un « impératif évangélique » et je suis donc partie prenante pour tenter « d’éveiller » l’Église aux mouvements de changement culturel et d’innovation sociale. En termes de mission, nous vivons un moment extrêmement favorable.
#Tu connais bien aujourd’hui la littérature internationale. Ce livre : « Pour une société collaborative » te paraît apporter une contribution originale. En quoi ?
#Je pense que ce qui met ce livre à part, c’est la reconnaissance d’une science intuitive et communautaire – « soyons davantage en prise avec notre cœur ». Cela va au-delà de l’utilitarisme et suggère l’émergence d’un « sens du bien commun » qui transcende l’individualisme et la compétition. La plupart des ouvrages séculiers que j’ai lus présument que nous ne pourrons jamais sortir de nos tendances individualistes et donc que toutes les solutions devront en fin de compte faire appel à notre désir de gain personnel, laissant beaucoup moins d’espoir pour une vraie collaboration.
#Quelle avancée vois-tu dans le mouvement vers une société collaborative ?
#Je le vois d’abord dans l’attitude de la génération montante. J’observe que les jeunes qui grandissent dans ce monde émergent attachent de l’importance à l’amitié au-delà des frontières nationales, raciales, religieuses et économiques, et cette amitié est facilitée par les média sociaux. Il en ressort que tandis que ma génération d’Occidentaux cherchait « comment puis-je améliorer ma vie », la génération montante semble comprendre que la façon d’améliorer notre propre vie est de chercher à améliorer celle des autres. Peut-être cette prise de conscience augmente-t-elle du fait que nous acceptons que notre être-même a besoin des autres. Un article récent du Huffington Post était intitulé « Comment améliorer votre vie (Petit tuyau : Cela commence par améliorer la vie des autres » (http://huff.to/1fSfsn5).
La révolution de l’information nous met davantage au courant des problèmes du monde qu’auparavant (spécialement les problèmes de justice). La popularité des campagnes internationales lancées sur la toile par des mouvements comme Avaaz (http://avaaz.org) montrent que les gens ne sont pas indifférents à la souffrance des autres, mais ont une approche instinctive de la façon dont le monde pourrait et devrait marcher, dans une optique de collaboration. On pense de plus en plus qu’il est important de faire preuve « d’intelligence du cœur » autant que « d’intelligence de la raison », même si je ne suis pas sûre que notre système éducatif ait encore pris ce tournant.
De la même façon, les mouvements concernant l’environnement, qui ont été tant marginalisés au XXe siècle, prennent de l’importance sur le terrain, même si nos leaders politiques continuent à se battre sur les accords internationaux. Certains de ces mouvements proposent avec succès une collaboration directe – ainsi l’Alliance Pachamama (http://www.pachamama.org) qui a commencé avec comme objectif les forêts primaires d’Amazonie et tente d’aider les gens à comprendre l’interconnexion de la vie sur notre planète et à prendre des mesures concrètes pour le changement.
Nous observons aussi l’effondrement des hiérarchies intellectuelles. Les gens n’ont plus peur des « experts » et l’expertise concerne de plus en plus l’expérience plus que le savoir. Cela fournit une excellente base pour la collaboration, avec des échanges qui s’opèrent sur un fond de connaissances communes et porteurs d’idées créatives plus que d’information pure. Au niveau universitaire, l’école Martin à Oxford (http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk) met en oeuvre une approche interdisciplinaire pour essayer de s’attaquer aux problèmes les plus importants de ce XXIe siècle, dans l’espoir d’une fertilisation croisée des idées, d’une collaboration concernant des scientifiques de haut niveau, mais aussi le grand public. On y fait l’hypothèse que chacun peut apporter une contribution valable au débat, quel que soit son niveau de formation.
Si l’on considère la société du Royaume uni aujourd’hui, la crise économique (avec la réduction significative des budgets publics) entraîne une meilleure collaboration entre les secteurs salariés et bénévoles et des partenariats sans précédents, par exemple entre les pouvoirs locaux (les institutions locales) et les églises. Nous le voyons dans la création de toutes sortes de services communautaires, y compris l’éducation, les bibliothèques, les refuges pour les sans abris et les banques alimentaires et, à l’occasion de toutes ces opportunités nouvelles, les églises et différents groupes de fidèles commencent à collaborer comme jamais ils ne l’avaient fait.
#Pour toi, comment cette perspective fait-elle écho à ta manière de te représenter Dieu et son œuvre ?
#h bien, à partir de mes 33 ans d’expérience comme chrétienne et spécialement de mon étude de la Trinité ces dernières années, j’ai compris que Dieu était une relation d’amour mutuel et que les êtres humains avaient le privilège de participer à cet amour. Nous ne vivons à l’image de Dieu que si nous sommes en relation avec Dieu et les autres et nous sommes tellement faits pour la relation, la vie ensemble, que nous sommes incapables de refléter Dieu en étant des individus séparés. En d’autres termes, une société collaborative commence à refléter un Dieu qui est Collaboration dès avant le Commencement. J’ai montré le Dieu Trinité comme Celui qui prend soin, l’Incarné et l’Esprit co-créateur et notre collaboration à l’image de ce Dieu comprend le renouveau de notre pensée, de notre corps et de notre esprit dans l’aide que nous nous apportons mutuellement de tant de façons.
De même que la Trinité a exprimé son amour dans la Création, nous sommes aussi invités à participer ensemble au renouveau de notre environnement et, bien que nous puissions chacun faire quelque chose, la taille même de notre monde implique que nous travaillions ensemble de plus en plus. L’importance croissante des mouvements environnementaux témoigne du fait que nous et notre monde sommes sauvés ensemble. Le salut est un exercice de collaboration ! Depuis que l’Esprit du Christ a été répandu sur tous, une invitation a été lancée à tous de se joindre à l’œuvre divine de re-Création et je considère que ce mouvement de collaboration est une preuve de l’Esprit dans le monde d’aujourd’hui.
#Comme chrétienne, quelle inspiration reçois-tu en ce sens ?
#D’abord je reçois l’espérance. Au cœur de la bonne nouvelle du Christ il y a la restauration des relations et la fin du besoin de nous détruire mutuellement (ou notre monde) psychologiquement, économiquement ou corporellement. Lorsque je vois des gens qui vivent à l’image de Dieu dans une société collaborative, je me souviens que le Royaume de Dieu est là et que je n’ai pas à attendre la mort pour commencer à jouir de la Terre nouvelle que Jésus est venu inaugurer.
#Interview de Pippa Soundy
Traduction par Edith Bernard
#(1) Sur ce blog : « Une révolution de « l’être ensemble ». La société collaborative : un nouveau mode de vie »
https://vivreetesperer.com/?p=1394
Voir aussi le livre publié sous la direction de Carine Dartiguepeyrou : « La nouvelle avant-garde. Vers un changement de culture » où se manifeste un nouveau courant de pensée qui allie : sciences, arts et spiritualité. Sur le site de Témoins (sept. 2013) : « Emergence d’une vision du monde « évolutionnaire ». Un changement de culture au Club de Budapest » http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1029&catid=4
Sur ce blog, on pourra lire aussi : « Une vision de la liberté » : https://vivreetesperer.com/?p=1343
par jean | Fév 3, 2016 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Hstoires et projets de vie |
Une ressource spirituelle
Grâce à des recherches comme celles de Rebecca Nye (1), nous apprenons aujourd’hui à découvrir la spiritualité de l’enfant comme un univers original, original et merveilleux… Pour nous qui sommes devenus adultes, cette découverte nous invite à revisiter notre enfance comme une ressource qui peut nous éclairer et nous inspirer. C’est ce à quoi Rebecca Nye nous encourage lorsqu’elle écrit : « Nous avons vu que la spiritualité de l’enfant et celle de l’adulte ne sont pas complètement distinctes. Elles ont beaucoup en commun. Les enfants deviennent des adultes pour lesquels les expériences avec Dieu pendant l’enfance sont souvent très formatrices. Il serait précieux de vous interroger sur votre propre vie avec Dieu, celle que vous vivez aujourd’hui et celle que vous viviez étant enfant… Une des façons d’être à l’écoute de votre être et, en particulier de votre âme d’enfant est de faire l’inventaire de quelques moments marquants de votre enfance » (p 41).
Un moment d’enfance
Nous voici donc en train de nous remémorer un moment d’enfance. Dans cette enfance environnée par la guerre et finalement protégée, il y a eu bien des moments heureux. Cependant, dans la réévocation d’une histoire spirituelle, il y a un événement qui est toujours revenu à ma mémoire. C’est un moment où, dans le mouvement de ce qui était alors la « communion solennelle », sans doute au moment où on me prenait en photo, j’ai remis en pensée ma vie à Jésus. Mais quand je me remémore ce printemps 1942, il y a eu finalement une « période sensible » que je découvre comme une oasis à l’orée d’une adolescence inquiète. Mon père était médecin militaire. Fin 1941, on lui confie la direction de l’hôpital Bégin qui accueille des prisonniers de guerre rapatriés pour raison de santé. A Noël 1941, j’arrive donc avec ma mère habiter le grand appartement de fonction qui nous était destiné. Mon père était très bon. Ce fut une grande joie de le retrouver après la séparation de la guerre, puis de son poste à Chateauroux en « zone libre ». Enfant unique, j’étais aussi objet d’affection et d’attention pour mon père, et je me rappelle combien, dans ces mois là, j’ai cherché à l’initier à ma jeune culture, à mes lectures, à mes apprentissages scolaires. Je lui faisais partager mes découvertes avec mon intuition enfantine, source de bonheur pour l’un et pour l’autre. On avait finalement trouvé pour moi à Vincennes une petite école privée destinée à un public de filles, mais où on acceptait un petit groupe de garçons. Le climat était familial et j’en perçois rétrospectivement la douceur. L’hôpital se situait dans un grand parc où je me promenais librement. Dans les beaux jours lorsque des familles s’installaient sur la pelouse, j’aimais jouer avec les plus petits et participer à ce bonheur. Cependant, il me revient aussi la forte mémoire des rencontres que j’ai eu à cette période avec des prisonniers de guerre africains rapatriés pour raison de santé. Je les rencontrais au tournant d’une allée. J’allais vers eux, je leur manifestais ma sympathie, parfois en leur offrant des fleurs cueillis au bord du chemin. Spontanéité et empathie de l’enfance…
Au printemps 1942, il y eut donc cette communion solennelle dans une grande église bondée. Avec papa, j’avais été acheter à Saint Sulpice des images de Jésus, de Marie, de saints et j’en avais tapissé le mur de ma chambre. Et sur la cheminée de ma chambre, initiative quelque peu singulière, j’avais disposé un Ancien et un Nouveau Testament illustrés par des grands dessins peut-être de Gustave Doré. Tous les soirs, j’invitais mon père à venir prier. Je ne me rappelle pas ce qui se disait, mais c’était un vrai élan de foi. Cependant, le point d’orgue de tout ceci, c’est la paix qui m’a imprégné pendant ces quelques semaines alors que j’étais un enfant très peureux, vivant dans la crainte des bombardements. C’est un souvenir très prégnant d’autant que j’ai vécu ensuite à nouveau dans la peur de cette menace. Ce fut donc une oasis par rapport aux craintes et aux tourments qui allaient monter par la suite. Je me souvenais de ce mouvement de mon cœur où j’avais confié ma vie à Jésus… En revisitant cette période, je me rends compte qu’il y a eu là une « période sensible » où amour, confiance et foi se sont conjugués dans mon vécu, un moment de grâce. Et puis les nuages sont arrivés. Le paysage intérieur s’est brouillé. Des années difficiles ont suivi.
Enfance : nos racines
A la suite de l’invitation de Rebecca Nye dans son livre sur « la spiritualité de l’enfant », nous nous sommes donc engagés dans cette exploration de la mémoire en faisant le choix de ce moment d’enfance. Certes, nous avons chacun une relation différente avec les différentes étapes de notre vie. Et de telle ou telle période, on peut garder des souvenirs qui, pour les uns, ont besoin d’être guéris (2), et qui, pour les autres, nous porteront. Pour moi, si l’adolescence a été souffrante, je puis entrer dans la vision d’Antoine de Saint-Exupéry lorsqu’il écrit dans « Pilote de guerre » (1942) : « D’où suis-je ? Je suis de mon enfance comme d’un pays ». Cette dynamique nous paraît correspondre à l’émerveillement que suscite le livre de Rebecca Nye.
A travers les expériences positives qui transparaissent dans nos vies, sachons apprécier l’œuvre de l’Esprit, et, par delà, sa puissance de guérison et de transformation dans l’immédiat et dans la durée (4).
J H
(1) Nye (Rebecca). La spiritualité de l’enfant. Comprendre et accompagner. Empreinte Temps présent, 2015. Présentation sur le site de Témoins : http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1106:l’enfant-est-un-être-spirituel&catid=14:developpement-personnel&Itemid=84
Voir aussi sur ce blog : « L’enfant : un être spirituel » :
https://vivreetesperer.com/?p=340
(2) Lecomte (Jacques). Guérir de mon enfance. Odile Jacob, 2004
(3) Nous renvoyons ici à nouveau à la pensée théologique de Jûrgen Moltmann : Moltmann (Jürgen). De commencements en recommencements. Une dynamique d’espérance. Empreinte Temps présent, 2012. Sur ce blog : « Une dynamique de vie et d’espérance » : https://vivreetesperer.com/?p=572
Mise en perspective de la pensée théologique de Jürgen Moltmann sur le blog : « L’Esprit qui donne la vie » : http://www.lespritquidonnelavie.com
par jean | Sep 2, 2022 | Société et culture en mouvement |
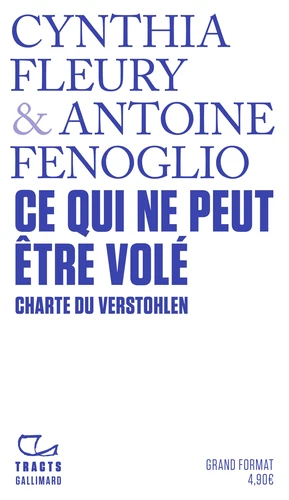 Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury
Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury
Sans que nous en ayons toujours conscience, il y a dans notre vie quotidienne, notre vie sociale, un essentiel, et, en quelque sorte, des conditions fondamentales pour que notre vie puisse être vécue humainement dans une «vie bonne ». Et, par exemple, avons-nous besoin de silence, et, le sachant, en voyons-nous toute l’importance, ou bien, si nous vivons dans un lieu bouché, ressentons-nous de même le manque d’horizon pour en revendiquer l’importance ? Dans les multiples contraintes de la vie d’aujourd’hui, parvenons nous à garder notre liberté, à préserver notre humanité et à faire mouvement dans ce sens ?
Ces questions, et bien d’autres, sont traitées dans le manifeste que Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio viennent de publier dans un livret ayant pour titre : « Ce qui ne peut être volé. Charte du Verstohlen » (1). Ce titre interroge. Y aurait-il des voleurs qui pourraient dérober ce qui est essentiel pour nous ? On imagine les enchainements qui risquent de nous asservir. Mais, en premier temps, il y a là une affirmation. Oui, il y a des conditions essentielles pour vivre une vie humaine, une vie bonne. Le vocable : « charte du verstohlen » est énigmatique pour les non initiés. En se référant à l’expression allemande correspondante, les auteur(e)s évoquent une affirmation et une reconnaissance d’un mouvement de « furtivité ». Cependant, il s’agit là d’un terme qui nous paraît peu usité jusqu’ici. On peut le comprendre comme le refus d’être emprisonné dans une assignation, dans une catégorisation, dan une localisation. Par là, la furtivité serait, en quelque sorte, le garant de la liberté.
Ce terme témoigne de l’inventivité conceptuelle qui se manifeste dans cette charte, Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio associant dans cette recherche des compétences et des champs complémentaires. La première, philosophe et psychanalyste, est pionnière dans le domaine du care et de l’éthique du soin. Le second œuvre dans le design et l’architecture. Ils sont associés à la Chaire de philosophie, à l’hôpital/CHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Notre attention pour ce texte a été attirée par notre appréciation de l’œuvre de Cynthia Fleury dont nous avons présenté deux livres sur ce blog : « Le soin est un humanisme » et « Ci-git l’amer : guérir du ressentiment » (2). Ce livre nous paraît plus difficile à rapporter ; car cette pensée subtile est, par nécessité très conceptuelle et elle s’exprime parfois avec des mots peu usités. Pour mieux en rendre compte au public de ce blog, nous ne résumerons pas un texte qui, de surcroit, vogue en liberté, mais nous essaierons simplement de présenter quelques pensées fortes de ce manifeste comme une ressource pour la compréhension et l’action, et participant ainsi à un travail de conscientisation.
Avant d’entrer dans cette présentation, nous rapportons ici une mise en perspective de France Culture.
Un manifeste en dix points
« Inappropriable, bien commun, bonheur national brut,… « Nommez-le comme vous voulez », nous dit le tract : « Ce qui ne peut être volé : Charte du Verstohlen », un manifeste en dix points coécrit par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste et le designer Antoine Fenoglio : « Dix points non négociables qui nous paraissent évidents, mais qui ne le sont plus » déclare Cynthia Fleury. « Cela va du silence à la santé en passant par le droit d’accéder à une vue… »
Les auteurs définissent tous les objets et les méthodes pour les défendre. Le « proof of care », le climat de soin, l’enquête, la furtivité, autant de moyens pour protéger ce qui peut nous être volé. Ainsi c’est l’écrivain, Alain Damasio, auteur notamment du roman « Les furtifs » (2019), qui a inspiré aux auteurs le concept de « furtivité », auquel le titre est dédié, « Verstohlen » renvoyant littéralement au terme « furtivement » en allemand. Le furtif, politisé, nous parle des manières de s’exfiltrer de la réalité telle qu’elle nous est proposée aujourd’hui, réduite, nous disent les auteurs, aux processus de réification quasi quotidienne ». « En défendant ce qui peut nous être volé, c’est aussi une certaine conception de la démocratie, mais aussi de la vulnérabilité qui est défendue. La vulnérabilité devient un vecteur de connaissance et non plus un objet de discrimination ou de stigmatisation » (3).
Des éclairages pour la compréhension et l’action
Voici donc quelques exemples des pensées fortes présentes dans ce livret et accessibles à chacun de nous pour une conscience des conditions essentielles d’une « vie bonne ».
La perspective. Accéder à une vue
Lorsque notre fenêtre débouche sur un horizon : un ciel, des arbres, une étendue, nous n’avons pas toujours conscience de l’effet engendré par un manque de perspective. Et pourtant, il y a bien là matière à avertissement : « Les mondes urbains et ruraux ne peuvent se transformer en prison où tout édifice arrête le regard : murs et bêtise ont ceci de commun qu’ils tuent la perspective » (p 5). « Une chambre avec « vue » désigne parfaitement ce qu’une ressource matérielle peut devenir, à savoir une ressource essentielle… Accéder à une vue, dans l’espace privé ou l’espace public, est une nécessité journalière. Voir l’horizon, voir la beauté , voir la lumière naturelle… nous inspire, nous soutient, et sollicite notre prendre soin en retour » (p 5). Il en ressort une réflexion sur l’architecture. « Premier critère de l’architecture. Elle est « biologique »… Et, ne jamais oublier que la destination d’un lieu, d’un objet, est d’être humain » (p 6).
La vertu du silence
Ne savons-nous pas que le bruit engendre le stress et le déséquilibre ? Le texte réaffirme la vertu du silence. « Véritable porte d’accès au monde, le sonore est un élément d’équilibre personnel fondamental dans notre relation aux autres et au monde ». « Le silence est un des facteurs-clés contribuant au bien-être, comme constitutif de la santé physique et mentale… » (p 7). Le texte dégage quatre grandes fonctions du silence. « La première peut être désignée comme spirituelle, dans la mesure où elle nous permet d’accéder au sacré, à l’espace du secret, à la solennité d’un moment, au ressourcement et au recueillement… la deuxième fonction du silence peut se définir comme intellective, cognitive, agente, dans la mesure où nous en avons besoin pour penser, réfléchir… La troisième fonction est clinique, thérapeutique… » (p 7). Enfin, les auteur(e)s mettent en évidence la contribution du silence dans « la vie publique, citoyenne ». En regard du bruit qui se manifeste souvent sur la place publique, ils rappelle que « le silence conditionne la civilité, l’urbanité, le fait de concilier vivre ensemble, extrême mobilité et circulation, libertés politiques et individuelles, dans le climat le moins hostile et agressif possible ; et l’exercice libre de la rationalité démocratique, soit la délibération ». « Nulle enceinte délibérative digne de ce nom qui n’organise les temps de parole et de silence de façon équitable, transparente et respectueuse des individualités de chacun » (p 8).
Ce silence, si important, ne doit pas être monopolisé par des milieux privilégiés. « Créer des espaces privés et publics, des architectures, des services, des paysages… qui permettent l’accès gratuit et durable au silence, c’est se soucier de préserver la qualité de notre attention au monde, à soi-même et aux autres, humains et non- humains, soit la condition d’un penser et d’un agir plus connectés… » (p 8).
Reconnaître la vulnérabilité
Cynthia Fleury accorde une grande place à la vulnérabilité dans son manifeste : « Le soin est un humanisme » (2). Et, ici, la vulnérabilité est reconnue et prise en charge. « Nos vulnérabilités ne sont ni des hontes, ni des fatalités » (p 9). Elles s’inscrivent dans la condition humaine.
Ce peut être un point de départ : « L’autonomie n’est pas un fait, mais un processus qui part du fait vulnérable et qui grâce aux ressources portées par les milieux environnants et par soi-même, se dégage de cette vulnérabilité, la rend réversible et capacitaire ». Ce mouvement comporte une dimension collective. « La politisation de la question sociale est précisément cette construction collective de l’autonomie, autrement dit la prise en considération par les ressources publiques de la vulnérabilité originelle et sociale, de la sortie de celle-ci du seul domaine privé et individuel, ou de la charité de certains » (p 9).
Une approche de care
Si la conscience du prendre soin, du care est apparue avec Carol Gilligan dans les années 1980 aux Etats-Unis (4), elle s’est répandue en France et à travers le monde. Dans ce manifeste, Cynthia Fleury a introduit une forte présence du care jusqu’à l’emploi d’une terminologie professionnelle. Ainsi évoque-t-elle les « proofs of care », les « preuves de soin », héritiers des « proofs of concept », qui sont des dispositifs de formats multiples dédiés à la vérification de l’efficacité, de la pertinence de la faisabilité, de la maturité de tels ou tels usage, technique, protocole, architecture, sachant que l’expérimentation doit être relativement frugale et rapide et absolument in situ » (p 9-10). « Le « proof of care » est au service du capacitaire humain ». « Il permettra de vérifier si le passage de l’a priori à l’a posteriori s’opère réellement et comment il est diffusable sur d’autres territoires avec d’autres parties prenantes qui à leur tour détermineront les « formes » que la « preuve » doit prendre dans leur réel… » (p10-11).
« Pas de soin du climat sans climat de soin ». « Le seul « proof of care » ne suffit pas. L’expérimentation doit s’étendre et former comme une culture, « un climat de soin » (« clouds of care »), certes par l’activation de différents « proofs of care », mais par une manière à chaque fois spécifique et pourtant reliée (donc universellement compatible, au sens où l’universel se tisse plus qu’il n’est en surplomb) » (p 12).
Le soin aux morts
Dans la société moderne, les morts, on le sait, sont repoussés à la périphérie. Le temps long est peu reconnu. Les trajectoires individuelles se dispersent. Ici, les auteur(e)s redressent la perspective. « Limiter le soin aux vivants est une hérésie » (p 15 ). « Nous formons communauté avec les vivants et les morts » p 16) (5). Cette affirmation s’inscrit dans le cadre de la prise de conscience d’une connexion généralisée : « Nous allons vers un monde plus conscient des interactions fondamentales entre humains » (p 16).
« Le soin des morts ne concerne pas exclusivement les humains. Nous formons communauté avec les non-humains et nos vies urbanisées et « modernes » ont hélas déconsidéré ce lien essentiel… Les activités hyper-capitalistiques humaines effacent les traces du vivant, font disparaitre des écosystèmes entiers. Nous avons désacralisé la reconnaissance due au non-humain. ». « Nos villes, nos espaces publics et privés, doivent pouvoir accueillir cette dimension anthropologique première qui n’est pas sans rappeler celle que nous cultivons avec le sacré et l’invisible. Si la religion est une option, le sacré ne l’est pas. L’homme se tient debout grâce à une verticalisation tout aussi physique que psychique et spirituelle » (p 16 ).
Le texte rapporte une conférence d’Heidegger « évoquant la nécessité de quadriparti de la terre, du ciel, des dieux et des mortels ». Et « l’homme est pour autant qu’il habite… Habiter est la manière dont les mortels sont sur terre ». « Habiter, c’est demeurer, prendre conscience du temps long qui nous traverse » (p 18). Si le « furtivement » préconisé par la charte va plutôt dans le sens du nomadisme, « il s’agit de comprendre ce qui nous lie émotionnellement, cognitivement, au mouvement et au fait de demeurer » (p 18).
Furtivité
Les auteurs développent plusieurs approches pour influer sur le cours des choses : une démarche furtive, l’enquête, le compagnonnage. Concernant la furtivité, nous appelons le lecteur à consulter l’exposé des chapitres correspondants. La société actuelle est perçue en terme de pression et d’immixtion. « Dans un premier temps, la vie furtive est un simple acte de résistance et de refondation de la liberté individuelle et publique, ensevelie sous la tyrannie de la traçabilité… Il fallait retrouver la possibilité d’être sous les radars. Il fallait être furtif… » (p18-19). Dans cette démarche, les auteurs se sont inspirés « des enseignements conjoints de l’écrivain Damasio et du neuroscientifique Damasio… Ils nous ont permis d’inventer une technique de furtivité, de maintien au monde, en consolidant nos pouvoirs d’agir et de liberté » (p 19). « Le Verstohlen, c’est d’abord cela : avoir le droit de demeurer pour prendre soin, avoir le droit d’agir et de transformer le monde sans subir la domination et la confiscation incessante de la décision politique, ne pas être en danger, posséder en partage, faire surgir le réel dans les interstices de l’invisible » (p 19).
Enquêter. Les humanités démocratiques
Lorsqu’on aménage un lieu, un paysage, lorsqu’on conçoit un service, un protocole… il faut s’occuper des habitants, de ses publics, de ses patients et médecins, de ses espèces végétales et animales. Anciens, actuels, futurs. Cela semble une évidence, c’est surtout une nécessité » (p 24). « L’enquête est par définition le grand outil méthodologique des sciences humaines et sociales, notamment de la sociologie et de l’anthropologie ». « Dans le moment de l’enquête, d’abord distanciée, puis familière, il se joue plusieurs étapes : la découverte des âmes du territoire, errantes et notabilisées, ou encore des espérances enfouies, des traumatismes passés, des parcours de vie et de soin des individus.
Ces « enquêtes » peuvent se réaliser à l’aide d’outils sociologiques classiques, statisticiens, mais plus ils sont affinés, capables d’intégrer la parole singulière des acteurs, de respecter leur demande de confidentialité, plus ils seront riches pour créer un projet pertinent. Autrement dit, il est possible d’avoir recours à ce que l’on nomme « les savoirs expérientiels » ou encore d’utiliser l’éthique narrative pour décrire la subtilité de ces vécus » (p 25).
On en vient donc ici à nous parler de « médecine narrative », comme ce dire des patients, réflexif, littéraire, (auto)biographique lorsqu’ils décrivent, avec toute leur sensibilité et leur expertise personnelle, la maladie dont ils sont atteints » (p 26). « En errance diagnostique, la médecine narrative demeure parfois le seul lien avec la raison et le sentiment de ne pas devenir fou ». « L’Université des patients de Sorbonne Université est notamment une instance où la parole des patients est accueillie, mais surtout valorisée, diplômée. Elle devient « enseignante » à l’attention de tous, patients, soignants, médecins. Elle permet d’analyser et de redessiner les parcours de soin, la démocratie sanitaire » (p 26).
En compagnonnage
L’idée et la réalité du compagnonnage ne sont pas nouvelles, mais elles sont mises en exergue dans ce texte. « L’objet essentiel du compagnonnage est la transmission des savoirs, être et faire, et la formation non discontinuée des individus se faisant en faisant » (p 28). Le compagnonnage s’exerce dans « la durée, le temps long, ce qui perdure au-delà ». « A la différence d’une institution peut-être davantage tournée vers l’activité d’un pouvoir décisionnaire et régulateur, le compagnonnage peut se contenter de « produire », de « créer », de persévérer dans son être par la seule pertinence du maintien de son ethos et des objets différents qu’il induit ». « Il demeure un idéal communautaire, fraternel… » (p 28). Les auteurs mettent l’accent sur l’actualité du compagnonnage, sa pertinence aujourd’hui. « Le compagnonnage n’est nullement qu’une affaire traditionnelle et rituélique mais une incarnation très existentielle, de concepts, d’outils méthodologiques et de valeurs » (p 29). Les auteurs ouvrent encore plus loin la conception du compagnonnage. « Aujourd’hui, les plus belles refondations de ce compagnonnage se situent du coté d’une activité des liens avec le monde vivant, dans sa variété multiple… Nous formons communauté, compagnonnage avec l’ensemble du vivant, dans sa pluralité, non pour rendre équivalents les rapports qui nous unissent, mais pour les expérimenter de façon plus subtile et plus dense » (p 29).
Les auteurs s’engagent dans la voie du compagnonnage « autour de trois axes : enquêter, expérimenter, déployer, pour édifier des formes institutionnelles furtives qui garantissent une sorte de propriété à ceux qui prennent soin, qui entretiennent le lieu naturel et patrimonial, mais aussi les communautés vivantes et mobiles qui l’inspirent » (p 31).
Si cette charte s’exprime dans un langage apte à manier les concepts et à communiquer dans un milieu expert, elle porte des idées originales et des valeurs humanistes et écologiques que nous avons voulu rapporter ici pour un public plus vaste.
J H
- Cynthia Fleury. Antoine Fenoglio. Ce qui ne peut être volé. Charte du Verstohlen. Gallimard, 2022 (Tracts). Interview vidéo de Cynthia Fleury sur cette charte : https://www.youtube.com/watch?v=EJpkyrsk9IU
- De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin. Le soin est un humanisme : https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/ Face au ressentiment, un mal individuel et collectif aujourd’hui répandu. Ci-git l’amer : https://vivreetesperer.com/face-au-ressentiment-un-mal-individuel-et-collectif-aujourdhui-repandu/
- Ce qui ne s’achète pas. La définition du bonheur selon Cynthia Fleury : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/ce-qui-ne-s-achete-pas-la-definition-du-bonheur-selon-cynthia-fleury-7074646
- Une voix différente. Pour une société du care : https://vivreetesperer.com/une-voix-differente/
- Selon Jürgen Moltmann : la communion avec les vivants et les morts : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/




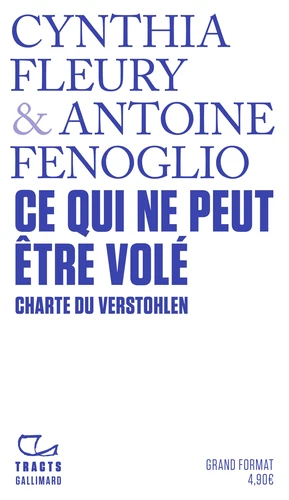 Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury
Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury