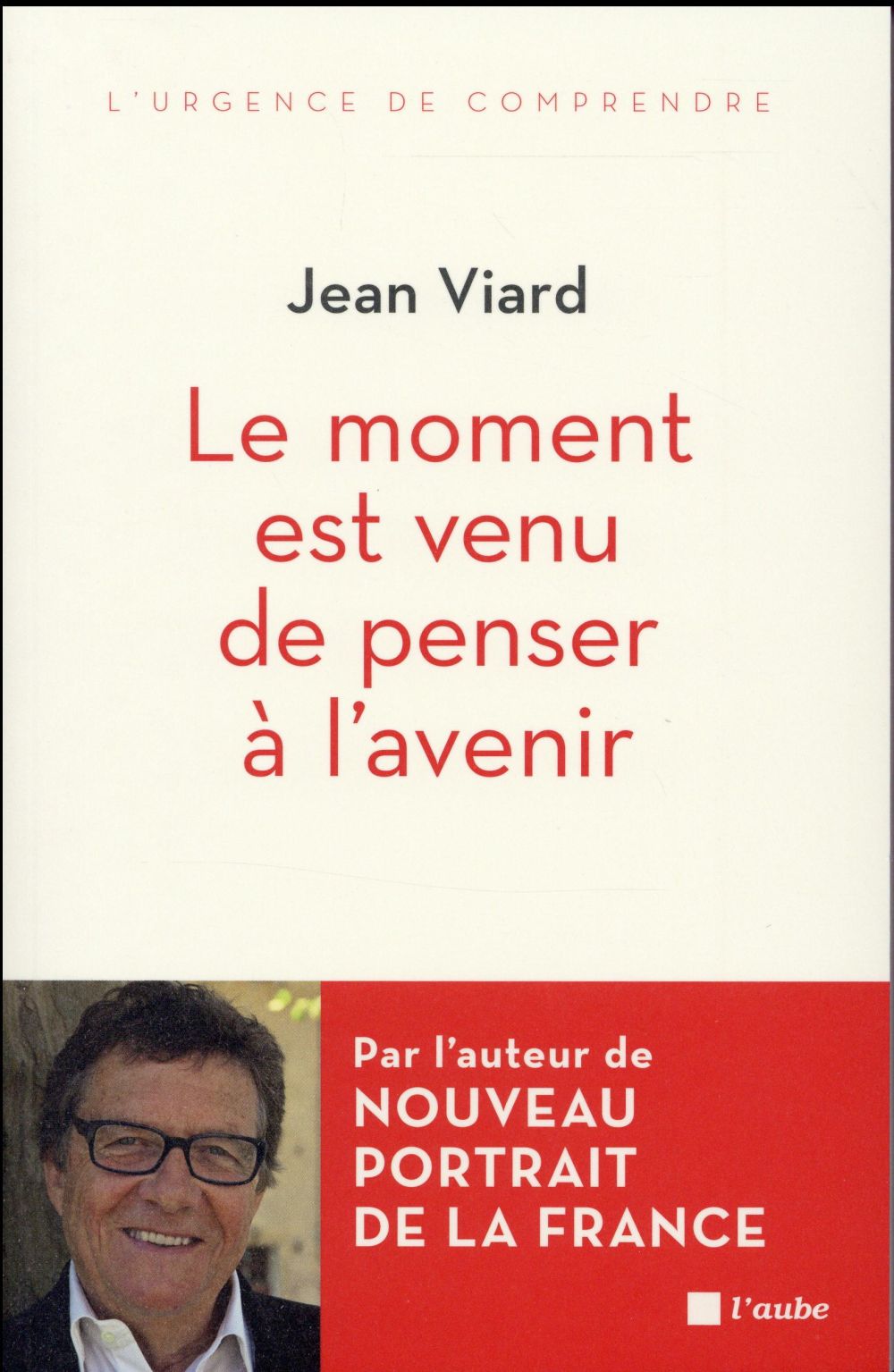par jean | Jan 20, 2021 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |

« Unveiling » selon Richard Rohr
Et si, face à une conjoncture catastrophique, nous apprenions à voir plus profond, plus vrai, plus loin.
Nous vivons dans une conjoncture anxiogène, pressés par les menaces de la pandémie et du réchauffement climatique. Nos habitudes, nos certitudes sont bousculées. C’est l’occasion d’une prise de conscience, d’un regard nouveau sur la réalité. Nous voici appelés à « enlever le voile » (unveiling) comme nous l’explique Richard Rohr, fondateur et animateur du « Center for action and contemplation » à Albuquerque dans l’état du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis(1). Richard Rohr est un moine franciscain, un penseur œcuménique qui témoigne de la sagesse de la mystique chrétienne et œuvre pour une intégration de l’action et de la contemplation. En réponse aux aspirations spirituelles de notre temps, il a écrit de nombreux livres, notamment « The divine dance » présenté sur ce blog (2). Chaque jour, sur le site du Centre pour l’action et la méditation, Richard Rohr partage avec nous une réflexion dans un parcours annuel dont le thème sera cette année : « A time of unveiling » (un temps de dévoilement) (3) : « En dépit de l’incertitude et du désordre, le moment présent est une grande opportunité pour nous éveiller à une transformation profonde dans l’amour et dans l’espérance… La réalité nous invite à entrer en profondeur pour découvrir ce qui dure et ce qui compte ».
Une conjoncture apocalyptique
Aujourd’hui, les menaces abondent. Nous vivons cette situation comme catastrophique. Un terme remonte à notre esprit pour la qualifier : apocalyptique, mais il est très souvent entendu à mauvais escient. « Ce mot est utilisé pour faire peur aux gens et les entrainer dans des conduites de peur, d’exclusion, de réaction dans la perspective d’une fin des temps ». Richard Rohr nous apporte le sens véritable du mot : apocalyptique. Il vient du grec : « apokalupsis » qui en réalité veut dire simplement : dévoilement. Il y a ainsi des textes apocalyptiques dans le Nouveau Testament : Mathieu 24, Luc 21, Marc 13, et le livre entier de l’Apocalypse. Mais quelle est l’intention de cette littérature ? Ce n’est pas d’effrayer, mais de dévoiler. Nous sommes bousculés dans notre conception du normal pour pouvoir le redéfinir. Ainsi, « il y a un langage et des images hyperboliques tels que les étoiles tombant du ciel et la lune se changeant en sang pour nous aider à reconnaître que nous ne sommes pas dans un état normal. Cela ne veut pas dire que nous sommes à la fin du monde, mais cela nous aide à imaginer la fin de « notre monde ».
Un nouveau regard
Dans ce tohu bohu, rien n’est plus « normal ». Les mauvais systèmes paraissent à la fois de plus en plus éffrontés et banals. Et pourtant, écrit Richard Rohr, dans tout cela, « Dieu nous invite à une transformation plus profonde ». « Quand les choses sont dévoilées, nous cessons de les tenir pour acquises. C’est ce que des évènements majeurs comme la pandémie produisent. Ils recadrent la réalité d’une manière radicale et nous invitent à une plus grande profondeur ». Richard Rohr inscrit cette relecture dans la compréhension de l’œuvre de Dieu. « La création est en cours de transformation et nous allons vers le bon et le nouveau ». C’est la réalité de l’évolution. La fin est le point de départ d’un nouveau commencement. Comme chrétiens, nous pensons que l’univers a un sens. L’expression biblique : « l’alpha et l’omega » marque les deux extrémités du temps cosmique. « Dans la trajectoire du monde, la conscience se déploie . « Toute la création gémit dans un grand acte d’enfantement (Romains 8.22) ». Nous sommes trop impatients. Les humains comme l’histoire grandissent lentement.
Une voie pour le discernement : la prière contemplative
« Nos problèmes commencent quand nous nous opposons à la réalité, la repoussons ou déclarons que la manière dont nous « voyons » la réalité, de notre perspective limitée, est la seule réalité valide ». « Toute pratique contemplative qui cherche à accueillir la réalité telle qu’elle est, nous changera ». « La prière contemplative est une forme de dévoilement, car elle révèle ce qui se passe en dessous de la surface de notre mental. Quand nous arrivons à être assez tranquille, la contemplation peut advenir en nous dans des moments d’ouverture, juste ici, juste maintenant ». A travers la contemplation, nous plongerons positivement dans la réalité dévoilée, et même désagréable, en disant « Viens mon Dieu et enseigne moi tes bonnes leçons ». Nous avons besoin d’une telle pratique pour abaisser notre résistance au changement et notre agrippement aux choses. Cherchons à prier en ce sens aussi longtemps qu’il nous faudra pour dire pleinement oui à la réalité . C’est alors seulement que nous pourrons en voir les leçons ». Ainsi, dans la situation troublée qui est la nôtre aujourd’hui, Richard Rohr nous propose un chemin.
J H
- Center for action and contemplation : https://cac.org
- La danse divine : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/ et : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-et-vivre-la-presence-dun-dieu-relationnel/
- A time of unveiling Semaine du 3 au 9 janvier 2021 https://cac.org/a-time-of-unveiling-weekly-summary-2021-01-09/ Ce texte est écrit à partir des méditations du 3 et du 8 janvier (Pulling back the veil. When things are unveiling), et aussi du lundi 4 janvier 2021 (The prayer of unveiling)
par jean | Déc 26, 2016 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |
Dans une actualité tourmentée, comprendre les forces en présence et le jeu des représentations pour avancer vers un nouvel horizon.
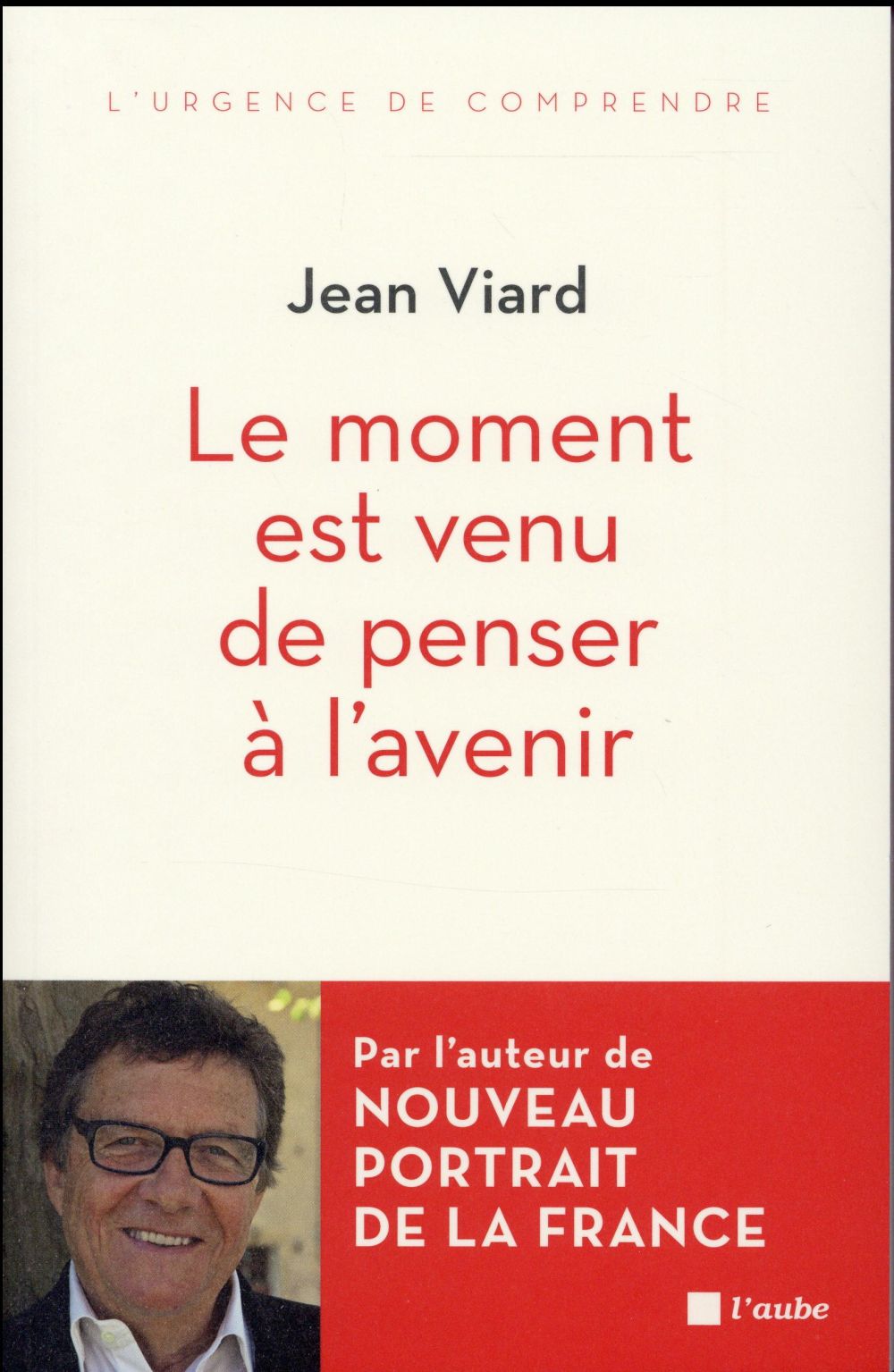 Le climat politique international s’est assombri durant l’année 2016. Des forces marquées par l’autoritarisme et l’hostilité à l’étranger sont apparues sur le devant de la scène. Elles s’appuient sur les frustrations, les peurs, les agressivités. Elles viennent bouleverser les équilibres au cœur du monde occidental. Elles portent atteinte à ce qui fondent nos valeurs : le respect de l’autre. Ces forces régressives constituent ainsi une grave menace. Notre premier devoir est donc de nous interroger sur les origines de cette dérive. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre les transformations sociales en cours. Cette recherche emprunte différentes approches. Et, par exemple, comme Thomas Piketty, on peut mettre l’accent sur les effets néfastes d’un accroissement des inégalités. Mais il y a place également pour des analyses sociologiques comme celle de Jean Viard dans son dernier livre : « Le moment est venu de penser à l’avenir » (1). Cet ouvrage s’inscrit dans une recherche de long terme sur les transformations de la société française (2), notamment dans sa dynamique géographique. Comment les différents milieux socio-culturels et les orientations induites s’inscrivent-elles dans l’espace, et bien sûr, dans le temps ? Des analogies apparaissent au plan international. Dans une approche historique, Jean Viard met aussi en valeur l’importance des représentations. Les catégories du passé s’effritent et s’effacent tandis que d’autres plus nouvelles, peinent encore à s’affirmer.
Le climat politique international s’est assombri durant l’année 2016. Des forces marquées par l’autoritarisme et l’hostilité à l’étranger sont apparues sur le devant de la scène. Elles s’appuient sur les frustrations, les peurs, les agressivités. Elles viennent bouleverser les équilibres au cœur du monde occidental. Elles portent atteinte à ce qui fondent nos valeurs : le respect de l’autre. Ces forces régressives constituent ainsi une grave menace. Notre premier devoir est donc de nous interroger sur les origines de cette dérive. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre les transformations sociales en cours. Cette recherche emprunte différentes approches. Et, par exemple, comme Thomas Piketty, on peut mettre l’accent sur les effets néfastes d’un accroissement des inégalités. Mais il y a place également pour des analyses sociologiques comme celle de Jean Viard dans son dernier livre : « Le moment est venu de penser à l’avenir » (1). Cet ouvrage s’inscrit dans une recherche de long terme sur les transformations de la société française (2), notamment dans sa dynamique géographique. Comment les différents milieux socio-culturels et les orientations induites s’inscrivent-elles dans l’espace, et bien sûr, dans le temps ? Des analogies apparaissent au plan international. Dans une approche historique, Jean Viard met aussi en valeur l’importance des représentations. Les catégories du passé s’effritent et s’effacent tandis que d’autres plus nouvelles, peinent encore à s’affirmer.
« Ce livre », nous dit-on, « est le récit des réussites de nos sociétés, mais aussi celui de leurs bouleversements : alors qu’une classe créative rassemble innovation, mobilité et initiative individuelle au cœur des métropoles productrices de richesse, les classes hier « dominantes » se retrouvent exclues, perdues, basculant leur vote vers l’extrême droite. Jean Viard propose une analyse sans concession des limites du politique dans la société contemporaine et exhorte les acteurs culturels à se réapproprier le rôle de guide en matière de vision sociétale à long terme. Des propositions innovantes pour repenser le vivre ensemble dans un monde qui a besoin de recommencer à se raconter » (page de couverture).
Comment la révolution économique transforme-t-elle le paysage géographique ? Quels sont les gains ? Quelles sont les pertes ?
Si la mutation dans laquelle nous sommes entrés engendre une grande crise, quelles sont les pistes pour y faire face ? Ce livre est particulièrement dense en données et en propositions originales. Nous nous bornerons à en donner quelques aperçus.
Une nouvelle géographie.
Le flux de la production qui irrigue le monde se déploie à travers les grandes métropoles. Les villes sont devenues un espace privilégié où se manifeste la créativité économique. « La révolution culturelle, économique et collaborative rassemble l’innovation, la mobilité, la liberté individuelle et la richesse au sein d’une « classe créative » de plus en plus regroupée au cœur des très grandes métropoles. Cœur des grandes métropoles où est produit aujourd’hui par exemple 61% du PIB français… On y est « Vélib » et high tech, low cost, usage plus que propriété, université, start up, communication, colocation, finance, COP 21. On y est nomade et mondialisé » (p 15).
Mais en regard, d’autres espaces reçoivent tous ceux qui ne sont pas parvenus à s’intégrer dans la nouvelle économie. Ce sont les zones périurbaines. « Les ouvriers de l’ancienne classe ouvrière sont partis vers les campagnes rejoindre dans un vaste périurbain, comme beaucoup de retraités, la précédente « classe dominante », celle des paysans. Le pavillon a remplacé la maison du peuple. L’idée de compenser par une mission historique les difficultés du quotidien a disparu. On y est face à son destin et on le vit sans perspective. 74% des salariés y partent travailler en voiture, plutôt diésel, sans autre choix possible ».
Les quartiers des anciennes banlieues ouvrières ont été abandonnées par une partie de leurs habitants et sont peuplés maintenant par des immigrants arrivés en vagues successives de différentes origines. Pauvres, mal desservis, ces quartiers sont néanmoins riches en potentiel.
Une nouvelle analyse de la société.
Notre représentation de la société en termes de classes sociales bien caractérisées est aujourd’hui bouleversée. Les anciens concepts qui ordonnaient notre vision du monde sont de plus en plus dépassés. Jean Viard exprime, avec clairvoyance ces bouleversements. « Ce que nous appelions « nation » ne peut plus être une totalité, car elle est elle-même dominée par la nature. Et elle vit grâce à un monde nomade en croissance qui lie des hommes, des savoirs, des biens, des services et des imaginaires au travers les grands vents de la planète. Les classes que nous avions pensées pour organiser le corps politique des nations se défont. Les anciennes classes dominantes, celles qui se sont raconté un destin historique, les paysans d’hier, puis les ouvriers, ne sont plus alors autre chose que des groupes en marge de l’histoire… » (p 25).
Une véritable révolution culturelle bat son plein. Elle est portée par une « classe nomade créative » » avec des guillemets, car ce n’est pas une classe au sens marxiste, faute de conscience de classe, mais un outil de classement aux sens culturel, esthétique, économique » (p 37). Cette « classe créatrice » est urbaine. Elle est internationale. Elle porte une nouvelle culture, un nouveau genre de vie.
Urbaine, elle porte New York et Paris, Toulouse, Nantes et Bordeaux, Montpellier et elle intègre une bonne part des 2,5 millions de Français qui sont allés vivre à l’étranger » (p 38). Elle se développe rapidement. « Les six plus grandes métropoles françaises n’ont pas cessé de créer des emplois depuis 2008 ».
Internationale, cette classe créatrice est « planétaire et non nationale et non continentale. Elle se structure autour des hubs de la mondialisation et non autour des ronds points autoroutiers ou des gares TGV. Nous sommes entrés dans une époque de multi-appartenances avec des nomades rapides…Nous avons à la penser, à la rêver et à l’organiser. L’Europe en est un échelon, une puissance, mais elle ne peut être notre nouvelle totalité… » (p 40).
Cette classe créatrice porte une nouvelle culture. Au fil de ses recherches, Jean Viard est bien placé pour nous en décrire l’origine et la trajectoire, comme la diversité et la cohérence de ses manifestations. Elle s’inscrit dans une révolution technologique et culturelle qui change profondément les rapports humains. « Sur les quatre millions et demi d’emplois créés en France en quarante ans, trois millions et demi sont occupés par des femmes. Un million seulement par des hommes ! » (p 40)
Tensions, oppositions, blocages.
Des évènements politiques récents comme le Brexit ou l’élection de Donald Trump, la progression des mouvements « populistes » en Europe, au delà des particularités de tel contexte, traduisent bien des oppositions radicales aux transformations induites par « la classe créative nomade ». Et d’ailleurs, la répartition des votes est significative. Les partisans du repli échouent dans les grandes villes.
Jean Viard nous éclaire sur ces affrontements. D’un côté, des forces nomades « « qui bousculent nos pays de l’intérieur et de l’extérieur. Au début du XXIè siècle, la révolution numérique est venue accélérer leur développement et rendre irrésistible ce qui était balbutiant. En 2015, avec la COP 21, on a admis qu’une nouvelle culture commune du développement était obligatoire. Jamais l’humanité n’a ainsi pensé ensemble, ni espéré pour sa survie…Nous vivions dans un monde de sédentaires avec des déplacements. Nous sommes dorénavant dans un monde de mobilité où l’enjeu est de chercher à associer liberté, mobilité et individus » (p 33).
« En face de ce monde accéléré et de cette contrainte écologique, sourdent partout, si l’on peut dire, des volontés de retrouver un sens perdu, un projet dépassé, un territoire déjà balisé, une croyance ancestrale, un mythe national » (p 35). L’affrontement revêt à la fois une dimension sociale et une dimension culturelle ». « Les groupes dominants du passé, paysans, ouvriers en particulier, mais aussi bourgeois, voire classes moyennes, se défont en tant que groupes et ne forment plus peuple. Leurs souvenirs collectifs, leurs luttes héritées ou vécues n’intéressent plus… Ne reste qu’une foule souvent exclue du cœur des métropoles, sans récit, ni destin, ni ascenseur social. Pour ce peuple défait, cette foule malheureuse, seules les pensées extrémistes tirées du passé font sens, car elles en appellent au déjà connu… » (p 16).
« Cette société tripolaire : classe nomade créatrice, anciennes classes dominantes, « quartiers populaires », n’a pas encore de mot et de récit… L’enjeu est de penser la place des nomades créatifs émergents et, en même temps, les liens et les lieux respectueux des anciens groupes sociaux et qui leur ouvrent un chemin vers le futur » (p 27).
Ouvrir un nouvel espace. Faciliter la mobilité.
Comment remédier aux tensions croissantes entre groupes sociaux ? De fait, les inégalités se manifestent de plus en plus dans la dimension de l’espace, dans la distance entre le centre et la périphérie.
Évoquant les propos de l’historien Pierre Nora, Jean Viard nous dit que, depuis les années 70, la France vit sa plus grande mutation historique. « La mutation la plus forte n’étant pas de passer d’un roi à un président de la République, mais de passer d’un système du « haut en bas », avec une domination du parisien et du central sur la province, à un système largement horizontal où il y a une relation à inventer entre le centre et la périphérie. Cela vaut d’ailleurs pour les classes sociales, pour les populations comme pour les espaces » (p 63).
La nouvelle dynamique économique se manifeste dans les grandes villes et plus généralement dans une civilisation urbaine. « La production de richesse se concentre depuis trente ans dans le monde urbain porté par la classe créatrice ». Les vieux métiers sont restructurés par la révolution numérique ou envoyés vers la périphérie des métropoles vers un monde rural de plus en plus ouvrier et résidentiel pour milieux populaires et retraités. Et, par ailleurs, les villes se transforment, associant production innovante, art de vivre et mise en valeur du patrimoine historique. « Les « deux formes de ville » que nous n’avons pas réussi à transformer : le périurbain et les « quartiers » sont les lieux des pires tensions. Là est l’enjeu urbain des trente prochaines années si nous voulons y rencontrer de la ville et du vivre-ensemble. Sinon, c’est entre ces territoires que se cristalliseront les tensions politiques » (p 50). De fait, ces tensions sont déjà là comme le montre la géographie électorale. En France, le Front National prospère dans le périurbain. Et récemment aux États-Unis, c’est à l’extérieur des grandes villes que Donald Trump l’a emporté.
Et par ailleurs, une nouvelle hiérarchie des territoires s’est imposée avec l’apparition des territoires délaissés : « Les anciennes régions du Nord et de l’Est, une part des périurbanités, mais aussi le nord de Londres, le sud de Rome « (p 55).
En regard, Jean Viard énonce différentes approches à même de redonner de la fierté aux habitants des friches industrielles. Ainsi la création d’un musée à Lens n’a pas été sans conséquences positives pour l’ensemble de la population. « Aujourd’hui, dans notre société de l’art de vivre, c’est la qualité du commun qui attire l’habitant, et l’entreprise suit sa main d’œuvre rare » (p 55). Et, de même, face à la géographie clivée de nos sociétés, il faut chercher les voies de la réunification en exploitant les atouts des territoires excentrés. « Parce que l’économie de la résidence, du tourisme, de la retraite, opère aussi de gigantesques transferts, que les cas particuliers sont nombreux : traditions locales, entreprises familiales, positions logistiques, et que le hors métropole produit quand même 40% de la richesse » (p 57).
Rompre les cloisonnements, c’est aussi accroitre la mobilité. Cette mobilité va permettre d’éviter une fixation sur le passé, là où il n’y a plus de restauration possible. La mobilité, c’est aussi susciter un brassage permettant à la jeunesse d’éviter un enfermement dans des contextes immobiles. Dans le contexte de la révolution productive, définissons « un droit à la ville/ métropole » pour la jeunesse afin que les jeunes passent quelques années au cœur de la métropole ». La construction d’un million de logements d’étudiants au centre des dix plus grandes métropoles ouvrirait un avenir à des centaines de milliers de jeunes venant des champs et des quartiers ». C’est au moins aussi important que de parler anglais » (p 59).
Recréer du récit
S’il n’y a plus de mémoire commune et pas de projet commun, il n’y a plus de points de repère et les gens se sentent abandonnés. Et lorsque les valeurs communes s’effritent, le pire est possible. Ainsi le peuple ouvrier, qui se sentait autrefois porteur d’une mission collective, se réduit de plus en plus à un ensemble d’individualités frustrées et désemparées. Dans ces conditions, une instabilité dangereuse apparaît. Jean Viard compare ainsi le peuple et la foule. « Le peuple a une mémoire et un vécu, des luttes partagées, des foucades et des haines. C’est ainsi qu’il forme groupe. Mais la foule, elle, est « individu voisinant » et se réfugie dans la sédentarité cherchant une identité dans le territoire, dans les frontières, dans les appartenances d’hier sociales ou religieuses. Contre « les autres » généralement. Il y a danger, car alors « la foule écrase le peuple et souvent le trahit » comme le disait Victor Hugo « (p 15).
Aujourd’hui, au moment où les concepts de « classe » et de « nation » perdent en pertinence par rapport aux réalités nouvelles de la vie, nous avons besoin d’un récit collectif qui rende compte des dynamiques et des aspirations nouvelles et qui rassemble tous ceux qui sont à la recherche d’un avenir. La société change. Elle n’est plus structurée par des statuts, des métiers. « Le social qui avait remplacé la religion comme organisateur exclusif, se trouve marginalisé. La religion revient en force comme toutes sortes de groupes structurés par habitus, origines, pratiques amoureuses. Chacun a besoin d’une identité multiple. Si l’on n’est pas capable de fournir la pensée et les mots de cette appartenance plurielle et complexe, chacun va penser dans sa boite à outils d’identités héritées monistes : la nation, la religion, la classe sociale… vieux mots auxquels on peut s’accrocher en période de peur et de désarroi … Alors, en regard, inventons plutôt un commun positif qui intègre, par une vision du futur et des mots nouveaux pour le dire, ces croyances qui deviennent certitudes par désarroi » (p 45).
L’individu aujourd’hui est au centre de notre société. Comment « attirer les individus vers le commun qui peut nous rassembler et vers la création vivante ou héritée ? C’est le rôle à la fois du monde numérique et de la culture, des évènements urbains, d’un nouveau langage politique et du projet à faire humanité et de survivre » (p 46).
Jean Viard note que déjà, au niveau du local, on peut observer un désir de partage. « Toutes les structures de proximité : familles, amis, entreprises, communes, ont une image positive » (p 47).
Et puis, à une échelle plus vaste, on peut également discerner des tendances positives et les mettre en valeur. « Dire la métropolisation comme mine numérique et écologique, dire société horizontale, mobilité, individu, liberté. Dire économie locale, économie de production et économie présentielle…Dire cela et avec ces mots là, permet à la fois de sortir des mots devenus creux de la révolution industrielle et de dessiner un chemin possible pour l’action de millions d’acteurs, autonomes, mais inscrits dans des réseaux, des compétences, des croyances et des peurs » (p 181).
Si dans notre imaginaire français, le mot révolution s’inscrit le plus souvent dans un vocabulaire politique, cette révolution là n’est pas du même ordre. « C’est l’épanouissement d’une révolution culturelle, née à la fin de la reconstruction et des Trente Glorieuses, qui a emporté avec elle l’hégémonie du politique, y compris les totalitarismes et les colonialismes » (p 181).
Et, pour nous tourner vers l’avenir, il est important de ne pas nous enfermer dans le regret et la déploration, mais de pouvoir nous appuyer sur la conscience des changements positifs qui, au cours des dernières décennies, sont intervenus dans les mentalités. « Cette immense révolution culturelle permet enfin aux femmes d’accéder au statut d’adultes à part entière dans tous les domaines de leur vie, et, à l’humanité de vivre dans la nature et non dans la domination, les deux étant profondément liés » (p 182). La conscience écologique grandissante modifie nos perceptions politiques et elle devient maintenant l’axe majeur d’un projet et d’un récit commun. « La seule vraie échelle de notre avenir est la terre comme totalité écologique. Cette conviction, depuis la Cop 21, surplombe l’ensemble de nos actions et de nos nations… » (p 185). « Sur le marché mondial du sens, proposons un chemin de progrès pour un écosystème terre en cogestion nécessaire » (p 185).
Dans un monde en crise, quelle perspective ?
Cette année 2016, la montée des frustrations, des peurs, des agressivités ont entrainé une victoire des extrémismes comme autant de chocs au coeur du monde occidental. Pour faire face à cette situation, il est urgent de comprendre les ressorts de cette poussée. Ce livre nous apporte une réponse. L’analyse de Jean Viard ouvre des horizons.
Sur ce blog, dans une approche d’espérance, nous cherchons à considérer la crise actuelle en terme de mutations (3) et à discerner les courants émergents (4), parfois encore peu visibles, qui traduisent cependant une transformation des mentalités et le développement de nouvelles pratiques. Oui, une nouvelle vision du monde commence à apparaître comme en témoigne l’enthousiasme de plusieurs amis ayant récemment visionné le film « Demain » (5). Nous rejoignons ici l’approche de Jean Viard lorsqu’il met en évidence la nécessité d’un récit rassembleur et mobilisateur.
La construction d’un tel récit requiert différents apports, jusqu’à associer par exemple « rationalité occidentale et pensée mythique » (p 41). A cet égard, si le religieux est aujourd’hui, dans certaines formes et dans certains lieux, tenté par un retour en arrière, nous proposons ici le regard d’une foi chrétienne, inspirée par une théologie de l’espérance (6) et alors, dans le mouvement de la résurrection du Christ et la participation à une nouvelle création, orientée vers l’avenir. De cette foi là, on peut attendre une contribution à un grand récit fédérateur. Comme l’exprime un verset biblique : « Sans vision, le peuple périt » (7).
Dans cette actualité tourmentée, nous avons besoin d’une boussole pour analyser les changements en cours et développer des stratégies pertinentes. Trop souvent, les débats politiques actuels ne prennent pas en compte une approche prospective de la vie sociale. Ce livre nous apporte un éclairage qui renouvelle nos représentations et nous permet de mieux entreprendre. C’est une lecture mobilisatrice.
J H
(1) Viard (Jean). Le moment est venu de penser à l’avenir. Editions de l’Aube, 2016
(2) Jean Viard, sociologue, éditeur, a écrit de nombreux livres aux Editions de l’Aube. Sur ce blog : « Émergence en France de la « société des modes de vie » : autonomie, initiative, mobilité… » : https://vivreetesperer.com/?p=799
(3) « Quel avenir pour le monde et pour la France ? » (Jean-Claude Guillebaud. Une autre vie est possible) : https://vivreetesperer.com/?p=937 « Un chemin de guérison pour l’humanité. La fin d’un monde. L’aube d’une renaissance » ( Frédéric Lenoir. La guérison du monde » : https://vivreetesperer.com/?p=1048 « Comprendre la mutation actuelle de notre société requiert une vision nouvelle du monde » (Jean Staune. Les clés du futur) : https://vivreetesperer.com/?p=2373
(4) « Une révolution de l’être ensemble. La société collaborative » (Anne-Sophie Novel et Stéphane Riot. Vive la co-révolution » : https://vivreetesperer.com/?p=1394 « Appel à la fraternité. Pour un nouveau vivre ensemble » : https://vivreetesperer.com/?p=2086 « Un mouvement émergent pour le partage, la collaboration et l’ouverture : OuiShare » : https://vivreetesperer.com/?p=1866 « Un nouveau climat de travail dans des entreprises humaniste et conviviales. Un parcours de recherche avec Jacques Lecomte » : https://vivreetesperer.com/?p=2318 « Cultiver la terre en harmonie avec la nature. La permaculture : une vision holistique du monde » : https://vivreetesperer.com/?p=2405 « Pour une éducation nouvelle, vague après vague » (Céline Alvarez. Les lois naturelles de l’enfant) : https://vivreetesperer.com/?p=2497
(5) « Le film : Demain » : https://vivreetesperer.com/?p=2422
(6) Une vue d’ensemble sur la théologie de Jürgen Moltmann : « Une théologie pour notre temps » : http://www.temoins.com/une-theologie-pour-notre-temps-lautobiographie-de-juergen-moltmann/ Auteur d’une théologie de l’espérance, Jürgen Moltman nous en parle comme une force vitale qui nous incite à regarder en avant : « Nulle part ailleurs dans le monde des religions, Dieu n’est liée à l’espérance humaine de l’avenir…Un « Dieu de l’espérance » qui marche « devant nous » et nous précède dans le déroulement de l’histoire, voilà qui est nouveau. On ne trouve cette notion que dans le message de la Bible… De son avenir, Dieu vient à la rencontre des hommes et leur ouvre de nouveaux horizons…Le christianisme est résolument tourné vers l’avenir et invite au renouveau…Avoir la foi, c’est vivre dans la présence du Christ ressuscité et tendre vers le futur royaume de Dieu… ». La force vitale de l’espérance, p 109-110 (Jürgen Moltmann. De commencements en recommencements. Empreinte, 2012) Sur ce blog : « Une dynamique de vie et d’espérance » : https://vivreetesperer.com/?p=572
(7) « Lorsqu’il n’y a pas de vision, le peuple périt » (Proverbes 29.18)
par jean | Fév 6, 2021 | ARTICLES, Beauté et émerveillement, Expérience de vie et relation |
Un ami, Sylvain, apprécie Vivre et espérer.
Ainsi a-t-il écrit quelques commentaires sur certaines livraisons de Vivre et espérer.
En voici un concernant la livraison de février 2012(1) C’est un dialogue qui s’ouvre ainsi à travers le temps.
Merci Sylvain !
 Cet article qui a abordé la peinture comme un mode de communication (parler de Dieu, parler à Dieu) me plait beaucoup, car comme tu le sais j’apprends la peinture, mais aussi les corrélations avec des états qui rapproche l’artiste, dans son exécution, d’états modifiés, de transe, plus connu sous le nom de flow.
Cet article qui a abordé la peinture comme un mode de communication (parler de Dieu, parler à Dieu) me plait beaucoup, car comme tu le sais j’apprends la peinture, mais aussi les corrélations avec des états qui rapproche l’artiste, dans son exécution, d’états modifiés, de transe, plus connu sous le nom de flow.
La peinture comme moyen de se lier à la vie, à la spiritualité, est une nouvelle perspective pour moi, qui m’enchante.
Je trouve que c’est une belle démarche qui pourra apporter de la profondeur à mes œuvres.
Un moyen de me dépasser, de communiquer aux hommes et pourquoi pas avec Dieu ?
Quel présence Dieu a-t-il dans ma vie ? Je ne le dis pas encore clairement.
Odile était très claire avec cela, tout comme toi. Pas d’hésitation, de demie mesure. Une confiance totale, le dévouement, l’amour. La foi, une force qui permet de voir la vie autrement et d’en donner un véritable sens.
D’accepter, ou plutôt de comprendre que la vie est telle qu’elle est, et qu’il ne faut pas se focaliser sur les résultats sans prendre de recul, mais belle et, bien sûr, ce que les expériences positives ou négatives peuvent réellement nous apporter.
Cela parle du bien qu’il y a en toute chose a partir du moment où l’on se donne les moyens de le voir.
Pour apprécier la vie, il faut l’aimer.
La chanson de Jacques Brel est un hymne à la vie, au partage.
Cette article parle aussi de cette valeur incommensurable qu’est le don de soi.
Lorsque l’on arrive à casser toutes ses barrières mentales et que l’on se donne pleinement sans se soucier de ce que pensent les autres, mais plutôt de ce que l’on peut offrir à l’autre, alors le message que l’on peut véhiculer devient intemporel, et touche tout le monde.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on devient pur amour.
Et dans les situations plus compliquées de l’existence quand on a que l’amour devient alors cette force qui nous raccroche à la vie, qui nous lie a ce qu’il y a de plus beau en nous grâce au regard de l’autre, et qui nous fait comprendre que notre existence a un sens,
Il est difficile de penser que malgré qu’il y ait une existence après la mort, qu’un fossé nous sépare de ce que nous sommes actuellement.
De savoir qu’il y a un lien entre la vie et la mort, beaucoup plus simple a appréhender que tout ce qui est proposé, me parait plus apaisant.
Il suffit de penser en toute simplicité à l’autre pour se connecter. Cela veut dire que l’autre peut aussi se connecter à nous. Ce qui veut dire que quoi qu’il advienne, nous ne sommes jamais seul.
Toutes ces manières de penser et d’appréhender l’existence sont tellement riches et variées. Cela peut donner le tournis et peut parfois prendre des allures compliquées. C’est avec les personnes qui ont une pensée claire que l’on trouve le plus de simplicité. Et c’est dans la simplicité que l’on touche à la compréhension de l’autre, que l’on retrouve des vérités, justes, belles, réconfortantes et apaisantes.
Il faut évoluer avec son temps et profiter de toutes ces ressources que l’on a la chance d’avoir autour de soi pour apprendre et mieux comprendre ce qu’est la vie, afin de pouvoir mieux communiquer avec son prochain et le soutenir.
Rester rigide dans des idées, dans des principes, n’a aucun sens car la vie montre que c’est dans la capacité l’adaptation que survit le plus sage.
Un esprit dicté par des principes figés évoluera dans la contrainte, alors que l’esprit ouvert, saura s’adapter, rester fidèle à lui-même et donner le meilleur à tout ce qui l’entoure.
Sylvain
- Livraison 2012 Peindre, c’est aussi parler, Horizon de vie, Quand on a que l’amour, Sur la Terre comme au Ciel, Une vie qui ne disparaît pas , Vivre et espérer février 2012 : https://vivreetesperer.com/2012/02/

par jean | Sep 2, 2024 | ARTICLES, Emergence écologique |
La société jardinière
La société jardinière : c’est le titre du livre de Damien Deville, un géographe et anthropologue, qui y rapporte sa découverte des jardins potagers implantés dans la ville d’Ales, un exemple des jardins urbains qui, en France et dans le monde, répondent à un besoin de subsistance dans différents contextes. On peut situer cette activité jardinière dans une histoire qui débute à la fin du XIXe siècle dans l’œuvre de l’abbé Lemire pour le développement des jardins familiaux. Plus généralement, cette activité jardinière en milieu urbain a connu dans les dernières décennies une remarquable impulsion dans le mouvement qui s’est répandu en France sous le vocable : ‘Les Incroyables comestibles’ (1) Et aujourd’hui, à travers diverses initiatives, certaines villes sont à la recherche de la réalisation d’une autonomie alimentaire (2).
Certes, évoquer une société jardinière éveille en nous le rêve d’une société pacifiée, mais ce n’est pas une pure utopie puisqu’il y aujourd’hui des expériences concrètes d’activités jardinières en milieu urbain. Dans son livre : ‘La société jardinière’ (3), Damien Deville nous décrit l’une d’entre elle, dans une ville profondément perturbée par la désindustrialisation, Ales à la porte de Cévennes. « Là, pour les anciennes populations ouvrières, se vit une façon de retour à la terre. Là, chacun plante, bêche ; tout le monde échange outils, semences, et savoir-faire. Si bien qu’à la motivation économique, forcément première, viennent se mêler des préoccupations d’ordre social, écologique, ou paysager. Cernant les contours d’une écologie de la précarité, l’auteur souligne comment de simples lopins de terre deviennent d’authentiques lieux d’émancipation. Partant, il ébauche le modèle de ce que pourrait être la société si elle était jardinière » (page de couverture).
Parcours d’une innovation sociale
L’apparition de jardins familiaux en milieu urbain remonte à la fin du XIXe siècle.
« C’est à Hazebrook, capitale de Flandre intérieure, que nait au milieu du XIXe siècle celui qui restera dans les mémoires comme le père fondateur des jardins familiaux : l’abbé Lemire ». L’auteur esquisse sa biographie. Jeune prêtre à Hazebrook, « touché par la misère de la commune, par les besoins des uns et les rêves des autres, l’abbé Lemire s’attacha rapidement aux besoins des habitants » En retour, il reçut un soutien populaire. Élu député en 1893, il mena une carrière politique indépendante par rapport à l’Église. Élu maire d’Hazebrook en 1914, il fit face aux périls de la guerre et mena une politique sociale très active si bien qu’il devint ‘un héros local’. « Attaché à la dignité des ouvriers, et persuadé que le lien à la terre est un besoin fondamental des humains, l’abbé cultiva une politique dont lui seul se faisait le gardien. Et c’est dans cette perspective que l’abbé fonda en 1896, le mouvement : La Ligue française du coin de terre et du foyer. Ce mouvement existe toujours. Il a survécu à l’abbé et continue de tracer une partie des territoires français. Il se nomme désormais Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs » (p 29). L’auteur rapporte comment son influence s’est répandue au début du XXe siècle, atteignant la ville d’Ales. Là, se conjuguant à l’époque avec la société Sant-Vincent-de- Paul, la Ligue suscite, en 1916, de premiers jardins. « A destination d’abord des femmes et des excusés du front, les jardins devinrent rapidement un soutien, une épaule, un guide. Greniers à fruits et légumes, ils participèrent à la résilience alimentaire des familles s’implantant dans plusieurs quartiers ». Puis, « les ouvriers de la mine en devinrent les premiers bénéficiaires. Jusque dans les années 1950, la surface jardinée à Ales s’étendit, année après année, pour atteindre un point d’orbite avec plus de 400 jardins cultivés sur la commune » (p 34).
Cependant, la situation des jardins familiaux à Alès participe à une conjoncture nationale. « Les temps changèrent. Les Trente Glorieuses et le faste des projets urbains dont elles se firent l’étendard sonnèrent le glas de l’aventure jardinière. Les champs, les pâtures et les vergers furent recouverts de chapes de béton… Les jardins familiaux ont rapidement perdu force et espace dans un flot répété d’urbanisation qui dura jusque dans les années 2000 » (p 35). Cependant, à la fin du XXe siècle, toute la France a été impactée par la désindustrialisation et le choc a été particulièrement violent à Ales. « En 1986, après plusieurs années de licenciements massifs, le dernier puits de mine d’Alès cessa définitivement ses activités. La métallurgie, autre fleuron, connut le même déclin… » (p 37)
Comme pour d’autres villes françaises, Ales doit chercher une autre voie. « Ales dut se réinventer et, au tournant des années 1990, la ville décide de s’orienter vers de nouvelles filières, vers une économie de services diversifiés. Parallèlement, Ales cherche à s’enraciner de nouveau dans le paysage cévenol » (p 38). Elle cherche à ancrer de nouveau la ville dans le paysage. « Ces politiques d’embellissement ne sont pas sans effet sur l’histoire des jardins… Elles ont permis à de nouveaux potagers d’émerger dans des quartiers populaires : des fleurs et des choux ont poussé là où il n’y avait que du béton… » (p 39). L’auteur décrit les différentes logiques à l’œuvre dans la politique locale. La vie des jardins s’inscrit dans une histoire locale.
Jardins et jardiniers à Ales
Damien Deville a observé ces jardins et la manière dont ils témoignent d’une grande créativité. Il a parlé avec ces hommes et entendu leurs parcours dans la diversité des histoires de vie. Il met en lumière les nouvelles relations qui s’établissent ainsi.
Le jardinage à Ales se déroule en plusieurs lieux. « les jardins du Chemin des Sports » sont issus d’une autre histoire que les jardins de la fédération des jardins familiaux, portant une image de marque. Bricolés sur des terrains oubliés, épousant la forme de réseaux souterrains, s’échangeant de manière informelle d’un jardinier à l’autre par un bouche-à-oreille judicieusemant maintenu dans des cercles restreints, arpentés par des personnes venant, pour l’essentiel, des quartiers populaires de la ville, ils correspondent à ce qu’Ananya Roy désigne par « urbanisme subalterne ». Ce sont des espaces urbains oubliés des grandes annales de la géographie et des politiques de la commune où s’invente la vie quotidienne des dépossédés… » (p 49). A la différence d’autres jardins potagers, bien reconnus, « se donnant à voir et s’offrant à la reconnaissance des habitants, les jardins du chemin des Sports, relèvent plutôt de bastions enfouis dans la verdure… Ils s’effacent derrière une image austère et précaire » (p 50). Lorsqu’on entre dans ces jardins, on y découvre un paysage coloré et une végétation luxuriante abondamment décrite par l’auteur « Tomates bronzées au soleil, plants de haricots parcourant des fils noués à des tuteurs, des framboisiers le long des murs dansent de leurs ombres, tandis que des plantes aromatiques, tantôt cultivées en pot, tantôt laissées en pleine terre parsèment le jardin… » (52). « Ce qui saute aux yeux, c’est une quête centrale de productivité. L’espace consacré aux fruits et aux légumes est agencé de manière à produire le plus possible. Lorsque la parcelle se fait étroite, les jardiniers rivalisent d’ingéniosité pour gagner quelques centimètres et conquérir les hauteurs » (p 53). L’auteur décrit des dispositifs ingénieux comme « une immense pyramide entrelacée de fils et de barres de fer… au service des plantes : fèves, haricots, courges grimpantes… » (p 54). Ici, le peuple des jardiniers a une origine caractérisée. « La plupart sont retournés à la terre pour se doter d’une certaine autonomie alimentaire. Les jardiniers du chemin des Sports sont des marqués. Ce sont d’anciens serruriers et ouvriers des aciéries, des employés du public ou des retraités à petits revenus. Leurs trajectoires familiales ont été percutées par la fermeture des industries alésiennes, par la série d’emplois précaires qui s’en est suivie, puis, plus récemment par la fuite des offres d’emploi et de services vers les grandes métropoles » (p 55). Ainsi s’est développé un genre de vie à vocation utilitaire. « La débrouille est devenu un art de vivre… Toutes les personnes rencontrées au fil de notre enquête l’ont partagé sans s’en cacher : devenir jardinier fut une adaptation nécessaire à différentes formes de précarité… L’agencement spatial du chemin des Sports autant que le choix des matériaux s’entendent ainsi, en premier lieu, au regard de conditions matérielles d’existence » (p 57). Cependant, tout ne résume pas à une recherche de subsistance. Les jardins témoignent aussi d’une inventivité artistique. « Les planches de culture sont parées d’objets de toutes sortes : des pots richement décorés, des épouvantails faits main, des souvenirs s’intègrent aux cultures potagères… Les jardins répondent autant aux besoins quotidiens de qui les arpente et les façonne qu’à ses aspirations, son savoir-faire, sa créativité. Car, dans sa manière d’agencer l’espace, le jardinier cherche à le rendre agréable à regarder et à vivre… C’est que les ‘espaces subalternes’ ne sont pas seulement des zones de débrouillardise et d‘adaptation, ils sont encore des agencements populaires traversés par tout ce qui fait la créativité, les joies et les envies des âmes humaines » (p 60).
Ces jardins engendrent une vie sociale et ils en sont l’expression. Ainsi Damien Deville nous présente des portraits de jardiniers. Il fait aussi écho à une mémoire collective : « Le jardin de Max, au cœur de l’association des jardins familiaux, dans le quartier de la Prairie, est un bel exemple de cette mémoire collective. Du haut de ses 70 ans, Max est un ancien de la Fédération des jardins familiaux d’Ales. Ici tout le monde le connait. Son papa était un jardinier très actif dans la communauté. Max éprouve pour lui une grande admiration : « son travail, son parcours de vie, le pilier qu’il était dans les jardins familiaux d’Ales » le ramène à sa propre enfance autant qu’aux heures de gloire qu’a connues la ville ». L’auteur rappelle ces souvenirs. « Ils se lisent à même le jardin de Max, démontrant combien les jardins sont des outils de réappropriation de récits urbains… Son jardin est également un mémorial à la figure de son père, Henri… Féru de bons conseils, son père était le premier à organiser des barbecues collectifs, à donner des coups de main aux voisins, à diffuser de bonnes pratiques et à échanger quelques légumes. Tant et si bien que le nom du papa revient souvent, indélébile dans les mémoires collectives » (p 76-77).
Damien Deville décrit la géographie sociale de la région : « Les zones de relégation sont en centre-ville, tandis que les espaces de gentrification se situent dans les quartiers périphériques, caractérisés par des villas cosy ou dans les villages au charme d’antan. Face à cette campagne qui se ferme aux personnes les plus pauvres, les jardins sont ces lieux où se forge une nouvelle réciprocité. Et là encore, c’est un jardinier, d’origine maghrébine, qui m’a mis la puce à l’oreille ». L’auteur nous décrit le parcours de Moustapha. « Moustapha est arrivé sur le tard dans les jardins familiaux privés du quartier de la Prairie, sur le chemin des sports. Il a repris la parcelle d’un voisin devenu trop âgé pour s’en occuper. Les Cévennes, l’homme ne les a jamais connues auparavant. Il a mené l’intégralité de s vie professionnelle en Algérie avant de rejoindre ses enfants à Ales pour sa retraite. Resté pendant longtemps sans allocation, Moustapha a dû se débrouiller pour arrondir ses fins de mois que sa petite retraite affiliée au régime algérien ne lui permettait pas de combler. Le jardin est arrivé dans sa vie à point nommé » (p 85). C’est, avec lui, que l’auteur découvre une ouverture de ce milieu urbain vers les campagnes voisines. « C’est en échangeant avec les autres jardiniers que Moustapha s’est rendu compte que les montagnes qui l’entouraient regorgeaient de trésors : d’aiguilles de pin pour amender ses cultures, de champignons à vendre auprès de sa communauté, d’éleveurs où aller chercher le mouton pour l’Aïd à des prix réduits. Moustapha s’est mis, par lui-même, à découvrir les coins cachés des campagnes avoisinantes » (p 86). Cependant, la relation de Moustapha avec les Cévennes s’étend au-delà puisqu’en fin de semaine, il fréquente en famille « des lieux de baignade où ses petits-enfants jouent maintenant l’été ». « Son jardin a été une fenêtre sur le monde, un livre pour réapprendre le milieu dans lequel il évolue au quotidien, et en faire naitre des usages à des fins d’émancipation personnelle ou familiale » (p 86). Mais l’auteur perçoit ce même attrait pour les Cévennes chez d’autres jardiniers. « Le jardinier algérien n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Tous, d’une manière ou d’une autre, pratiquent la campagne avoisinante. Pour certains, cela est lié à un héritage familial. Pour d’autres jardiniers récemment arrivés, c’est toujours le jardin qui nourrit les perspectives des montagnes et des villages alentour. Les usages qu’en font les jardiniers sont pluriels en fonction des envies et de la personnalité de chacun, mais ils participent dans tous les cas à une réappropriation spatiale et collective d’un territoire qui devient, enfin, de nouveau partagé » (p 86). Ainsi les jardiniers interviennent dans la vie collective. « Les Cévennes s’ouvrent à nouveau aux classes populaires. De cette réconciliation, dont la ville d’Ales a tellement besoin, les jardins en sont le premiers étendards… C’est une invitation à penser le territoire autrement » (p 87).
La société jardinière
La société jardinière : quelle expression évocatrice ! Il y a tant de formes de société que l’on déplore et que l’on redoute ! Une société jardinière, cela évoque pour le moins un respect et un amour de la nature et un état d’esprit constructif par le genre même de la tâche entreprise. Une société jardinière, c’est aussi une société nourricière et on peut imaginer qu’elle requiert et engendre la coopération.
Géographe, Damien Deville pense également en sociologue et en historien. Ainsi, si sa recherche a pour objet la ville d’Ales, il inscrit les jardins potagers en milieu urbain dans une histoire qui remonte à la fin du XIXe siècle. Mais, concentré sur son objet, il n’aborde pas la vague toute récente, celle des « incroyables comestibles » à travers laquelle la culture de fruits et de légumes s’est répandue à l’intérieur même d’un grand nombre d’agglomérations (1). Et aujourd’hui, des villes et des territoires s’engagent dans la recherche d’une autonomie alimentaire. Ainsi François Rouillay et Sabine Becker préconisent le développement de « paysages nourriciers », y incluant la « végétalisation des villes » (3) ;
A partir de l’étude des jardins potagers dans la ville d’Ales, Damien Deville nous montre, lui aussi, comment on peut « penser autrement la ville et l’urbain ». C’est bien de ‘vivre autrement’ (p 117-118) qu’il s’agit.
Déjà, dans un monde qui nous bouscule, la vie jardinière permet un enracinement. Ainsi, « les jardins alésiens sont cultivés par des personnes peu diplômées, laissées à l’arrière-plan des grands récits de l’histoire. La plupart ont quitté l’école tôt pour tenter leurs chances dans les grandes industries du territoire. Certaines ont été percutées par des évènements traumatisants. D’autres encore, arrivées sur le tard à Ales, parlent mal le français et s’intègrent avec peine. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui ont su, face aux crises urbaines, s’adapter et construire des interfaces inédits ave la ville. Leurs jardins sont fleuris ; ils remettent des couleurs dans les rues. Ils sont poreux aux autres réseaux urbains, catalysant relations et occasions. Ils sont ces espaces où se réinventent une certaine idée de prestance et de présence à soi, des oasis dessinant un autre bien vivre » (p 119).
Dans les jardins se réalise également une rencontre entre le monde végétal et ceux qui en prennent soin. « Ces jardins sont avant tout des mondes végétaux ». L’auteur fait l’éloge du déploiement des plantes et de leur vitalité. Elles s’agencent comme en une danse. Or, « le jardinier accompagne cette danse. Ses choix sont primordiaux et conditionnent le développement des plantes. Finalement, c’est bien cette rencontre inédite entre les plantes d’un côté, et le caractère du jardinier de l’autre, qui traduit l’évolution des lieux et des récits qui s’y écrivent. L’humain devient ici un être hybride, inondé et inspiré par les plantes qu’il a vu naitre, ou qui sont revenues naturellement dans son jardin » (p 121-123).
Damien Deville voit là se développer une dynamique de relation. « A l’image de ce lien unique au végétal, les jardins participent à l’émancipation globale des jardiniers par leur capacité à catalyser sans cesse les relations qui composent les individus » (p 123). L’auteur voit dans cette activité jardinière un potentiel de relation. « Les jardins guident d’autres possibles urbains quand ils permettent à chaque ville de devenir une terre de relations » (p 123). L’auteur décrit les terres des Cévennes abandonnées. « La seule solution pour sauver le vivant, c’est de retourner y habiter et de faire de la relation une œuvre » (p 125). Dans le même esprit, Damien Deville sort des limites de l’hexagone et évoque un paysan du Burkina Fasso qui a résisté à la désertification et arrêté le désert en plantant des arbres, Yacouba Sawadogo, à l’histoire duquel il a consacré un livre (4).
« Si Yacuba était parti comme les autres, habitants dans les années 1980, le désert aurait cassé la porte et continué vers le village voisin. C’est parce qu’il est resté, tout en tissant autrement sa relation avec le territoire, qu’il a pu sauver le vivant… ».
Ainsi, « Ales et les Cévennes, autant que le Burkina Fasso, invitent à un nouveau front scientifique et politique. Trouver les égards que l’on doit au vivant, pour reprendre l’expression du philosophe Baptiste Morizot, demande, non pas de fuir certains territoires, pour se concentrer sur d’autres, mais bien de réfléchir aux manières de vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écosystémiques. L’humain a été une machine à détruire, mais les initiatives se multiplient… ». Damien Deville en évoque certaines dans la Drôme, dans les Cévennes, en Bretagne. « Tous ces exemples forgent au quotidien une nouvelle manière de faire lien, et reconstruisent des filières d’activité dans l’environnement local. Ils permettent aussi aux citoyens et citoyennes de se réapproprier le territoire et de participer aux décisions locales. En un mot, ils façonnent un droit pour toutes et tous à habiter le territoire et à le coconstruire au quotidien » (p 128).
En considérant l’activité jardinière, Damien Deville y perçoit un « monde ordinaire » dans une fécondité méconnue. Il met en valeur la manière dont les jardins génèrent des relations quotidiennes. « Les économistes Cécile Renouard et Gaël Giraud ont créé un indicateur qui pourrait bien inspirer les territoires d’ici et d’ailleurs, ‘l’indicateur de capacité relationnelle’. Ce dernier mesure la qualité des relations qu’entretiennent les personnes entre elles, et leur capacité de s’autonomiser à partir de ces mêmes relations… ». « Pensé dans le cadre ouest-africain, cet indicateur insiste sur la qualité du tissu social et sur les relations interpersonnelles comme autant de dimensions du développement humain ». Ainsi, des pauvres ‘financièrement’ peuvent être néanmoins tellement entourés qu’ils ne manquent de rien, et inversement. « La relation est finalement plus importante que le seul revenu. Penser en ces termes le développement permet d’accorder de nouveau de l’importance à ce qui est invisibilisé dans les grands récits de développement. Les jardins d’Ales changent le visage d’un quartier et les dynamiques sociales et écologiques d’une ville ». Dans son analyse, Damien Deville se réfère à Michel de Certeau. « Dans son livre maître : « L’invention du quotidien », l’historien et sociologue Michel de Certeau analysait déjà les actes ordinaires comme une production permanente de culture et de partage. Selon lui, les citadins ne se contentent pas de consommer : ils produisent et inventent le quotidien par d’innombrables mécanismes de créativité et par des politiques sociales originales. Pour emprunter l’expression de Claude Levi-Strauss, les citadins « bricolent » avec les espaces qu’ils fréquentent et les contraintes d’un modèle sociétal pour s’inventer un parcours de vie qui participe de leur émancipation. Ils créent de la relation » (p 131).
Un mouvement innovant
« Qu’elle favorise le retour des oiseaux et des hérissons, protège les villes des vagues caniculaires offrant de l’ombre et refroidissant l’air, l’agriculture urbaine a, en nos temps assombris de l’Anthropocène, le vent en poupe » (p 7). En s’inscrivant dans un courant de recherche en plein développement, Damien Deville analyse les fonctions et les configurations de l’agriculture urbaine.
« Laboratoires d’un monde possible, les jardins potagers des grandes métropoles européennes – qui produisent assez peu et se déploient sur des espaces restreints – s’offrent comme des lieux où s’expérimente une éducation renouvelée, plus douce, plus responsable, aux techniques de jardinage et aux arts de la table » (p 8). Cependant, la plupart des jardins répondent à une fonction plus élémentaire, celle de ressource alimentaire. « La Havane, Bobo-Dioulasso, Hanoï ou encore Rabat, autant de villes pour lesquelles les jardins potagers demeurent des greniers participant de l’autonomie alimentaire des familles » (p 8). « Dans les villes du sud de l’Europe, telles qu’Athènes ou Porto, frappées par la crise économique de 2008, des familles ayant subi des pertes économiques importantes ont mobilisé les jardins comme des espaces d’adaptation » (p 14). Récemment, sous l’impulsion de l’association A9 présidé par Rodolphe Gozegba de Bombembe, théologien, des lopins de terre autour des habitations sont mobilisés en jardin potager dans la ville de Bangui, en République Centre-Africaine (5). Dans son livre, Damien Deville étudie particulièrement le rôle des jardins potagers dans des villes moyennes appauvries par la désindustrialisation, en concentrant sa recherche sur l’exemple de la ville d’Alès. A cette occasion, il milite pour « une décentralisation guidée par la diversité des territoires et la qualité des relations que nouent les uns et les autres » (p 135). Si on ajoute le mouvement pour l’agriculture urbaine en vue d’une autonomie alimentaire dans une perspective écologique, on comprendra que le développement des jardins en ville n’est pas un phénomène mineur, mais qu’il s’inscrit dans une recomposition de grande ampleur.
Damien Deville a bien choisi le titre de son livre : la société jardinière, non seulement parce qu’il y étudie, sous toutes ses coutures, le développement des jardins en ville, mais parce que il présente, sous cette appellation, un phénomène de société en y percevant un potentiel d’exemplarité humaine. Oui, la société jardinière, n’est-ce pas une vision d’avenir ?
J H
- Comment les « Incroyables comestibles se sont développés en France ? : https://vivreetesperer.com/incroyable-mais-vrai-comment-les-incroyables-comestibles-se-sont-developpes-en-france/
- En route pour l’autonomie alimentaire : https://vivreetesperer.com/en-route-pour-lautonomie-alimentaire/
- Damien Deville. La société jardinière. Le Pommier, 2023
- Yacouba Sawadogo. Damien Deville. L’homme qui arrêta le désert. Tana éditions, 2022 (Le temps des imaginaires)
- Centre-Afrique : l’agriculture urbaine pour lutter contre la faim : https://www.temoins.com/centrafrique-lagriculture-urbaine-pour-lutter-contre-la-faim/
par jean | Mai 1, 2023 | Expérience de vie et relation |
…https://vivreetesperer.com/une-voix-differente/ Théïa Lab : https://theialab.fr La société canadienne d’anthropologie : https://www.cas-sca.ca/fr/a-propos-d-anthropologie/qu-est-ce-que-l-anthropologie De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin : https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/ Les Lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/des-lumieres-a-lage-du-vivant/…