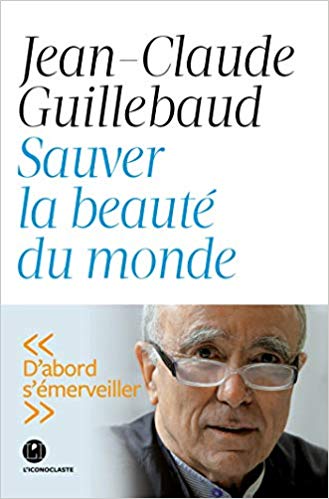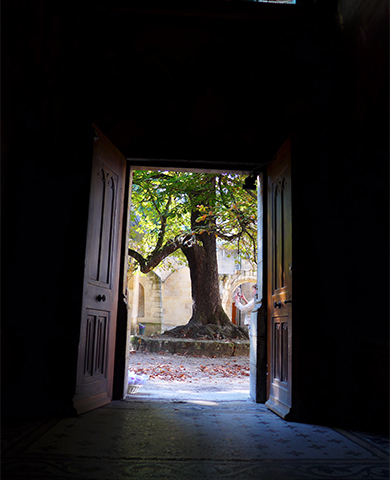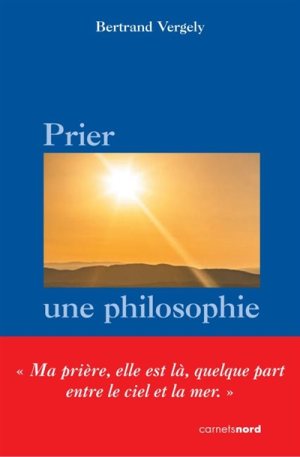par jean | Jan 21, 2019 | ARTICLES, Beauté et émerveillement |
…en macrophotographie https://vivreetesperer.com/couleurs-et-formes-merveilles-en-macrophotographie/ Effets de lumière dans une campagne bocagère https://vivreetesperer.com/couleurs-et-formes-merveilles-en-macrophotographie/ Comme les oiseaux du ciel https://vivreetesperer.com/comme-les-oiseaux-du-ciel/ A la découverte des grands espaces américains https://vivreetesperer.com/comme-les-oiseaux-du-ciel/ La lumière du matin https://vivreetesperer.com/la-lumiere-du-matin/…
par jean | Nov 2, 2019 | ARTICLES, Beauté et émerveillement, Société et culture en mouvement |
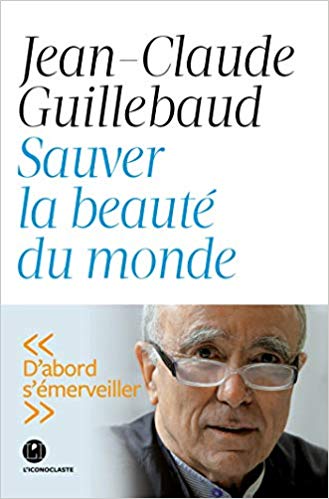 Enthousiasme de la beauté. Enthousiasme de la vie
Enthousiasme de la beauté. Enthousiasme de la vie
Un nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud
« Sauver la bonté du monde » (1), c’est le titre d’un nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud. Nous savons aujourd’hui combien la nature et l’humanité sont conjointement menacées par les désordres engendrés par les excès humains. Le milieu urbain s’est éloigné de la nature. Les équilibres naturels sont déréglés. La pollution défigure les paysages. Allons-nous perdre de vue la beauté de la nature ? Nous les humains, nous participons au monde vivant. Si nous nous reconnaissons dans le mouvement de la création, nous percevons l’harmonie du monde, nous sommes mus et transportés par sa beauté. Alors, oui, si quelque part, cette beauté là est menacée, notre premier devoir, c’est de proclamer combien elle nous est précieuse, indispensable. Ensuite nous pourrons la défendre. C’est dans cet esprit que nous entendons l’appel de Jean-Claude Guillebaud : Sauver la beauté du monde.
Certes, pour sauver la planète du désastre, conjurer la fin du monde, « une énorme machinerie diplomatique et scientifique est au travail » (p 15). Et, on le sait, il est nécessaire d’accélérer le mouvement. Une grande mobilisation est en train de se mettre en route. Cependant, si la peur vient nous avertir, elle n’est pas à même de nous entrainer positivement. Alors, Jean-Claude Guillebaud est à même de nous le rappeler : « Si l’on veut mobiliser les terriens, il faut partir de l’émerveillement. Serait-ce naïf ? Bien sur que non. C’est un Eveil » (p 17). L’émerveillement, ce n’est pas un concept. C’est une expérience. L’auteur sait nous en parler dans un mouvement d’enthousiasme. « Chaque émerveillement me remet debout sur mes jambes, heureux d’être vivant. La beauté fait lever en nous tous une exaltation ravie qui ressemble au bonheur. Et, qu’on ne s’y trompe pas. Beaucoup de savants, parmi les plus grands, ont parlé de ces moments radieux. Oui d’abord s’émerveiller. C’est sur cet émerveillement continuel qu’il fait tabler si l’on veut sauver la beauté du monde… » (p 18-19).
Jean-Claude Guillebaud est bien la personne adéquate pour nous adresser cet appel (2). Dans ses missions de journaliste, correspondant de guerre pour de grands journaux, il connait la face sombre de l’humanité et le poids de la souffrance et de la mort. Résidant, dans sa vie quotidienne au plus près de la nature, dans un village de Charente à Bunzac, il sait se nourrir de la beauté qui transparait de la présence du vivant. Et enfin, éditeur, familier de grands chercheurs, c’est un homme de savoir et il sait traduire cet émerveillement dans les termes d’une pensée construite. A partir de 1995, à travers une série d’essais, face au désarroi contemporain, il a su faire le point en alliant les savoirs issus des sciences humaines et une réflexion humaniste. Effectivement, pour ce faire, il a pu puiser à de très bonnes sources : « Plus j’avance en âge, mieux je comprend ce que je dois à de grandes figures de l’histoire de la pensée : Jacques Ellul, René Girard, Edgar Morin, Cornelius Castoriadis et Maurice Bellet » (p 227). Chez Jean-Claude Guillebaud, la dimension humaniste se joint à une dimension spirituelle. En 2007, il en décrit un mouvement : « Comment je suis redevenu chrétien ».
Dans ce contexte, ce livre de J C Guillebaud nous apparaît comme un témoignage personnel dans une grande diversité de registre. L’auteur rend hommage à la nature, mais pas seulement. Sauver la beauté du monde, c’est aussi reconnaître les grandes œuvres de l’humanité, la puissance de la créativité qui s’y manifeste. Ainsi dans cette dizaine de chapitres, Jean-Claude Guillebaud nous parle des nouveaux moyens de communication au service de la découverte du monde (« Un monde « augmenté »), du mystère de l’art préhistorique (« La beauté inaugurale », du « grand secret des cathédrales ». D’autres chapitres explorent les visages de l’humain.
Les belles personnes
Son expérience de la vie l’amène à consacrer un chapitre sur « les belles personnes ». « C’est un être humain qui irradie je ne sais quelle douceur pacifiée, une trêve dans la grande bagarre de la vie » (p 207). « C’est une disposition de l’âme énigmatique comme la beauté elle-même » (p 208). L’auteur nous en trace des portraits très divers. Face aux cyniques, au déni des autres et de soi-même, Jean-Claude Guillebaud milite pour la reconnaissance des qualités humaines. Et il peut s’appuyer sur une littérature scientifique toute nouvelle. « Plaisir de donner, préférence pour l’aide bénévole, choix productif de la confiance, dispositions empathiques du cerveau, stratégies altruistes et réciprocités coopératives : on découvre dans l’être humain des paramètres qui remettent en cause la vision noire de l’être humain… » (p 217). Il y a là un nouveau paradigme qui nous inspire et que nous mettons en évidence sur ce blog (3).
Les passions humaines
L’auteur se risque à parler des passions humaines. « Un homme sans passions est un roi sans sujets (Vauvenargues). Mais c’est là un sujet ambigu. Il y a bien des passions mauvaises. Le titre du chapitre reconnaît cette disparité : « la dangereuse beauté des passions humaines ». Mais il y a aussi dans la passion une force motrice qui porte de grandes causes pour le plus grand bien. Jean-Claude Guillebaud envisage les passions comme des « écrins » (p 253). Face au calcul et à une excessive prudence, il met en évidence des passions pour le bien. « On ne cite presque jamais certains élans alors qu’ils sont en tous points admirables » (p 254). « La générosité et le souci de l’autre conjugués avec le courage du partage, de toute évidence, composent la plus irremplaçable des passions humaines » (p 239).
Un hymne à la nature.
Cependant, le parcours de ce livre a bien commencé par un hymne à la nature. Et cet hymne peut être entonné parce qu’il est la résultante d’un choix de vie. Au chapitre 2 : « Heureux comme à Bunzac », Jean-Claude Guillebaud nous raconte comment, depuis plusieurs décennies, il a choisi, avec son épouse Catherine, de partager sa vie, chaque semaine, entre Paris (deux jours) et un village de Charente (cinq jours), Bunzac où il s’est installé dans une grande maison familiale. Et il sait nous parler avec enthousiasme de la vie des champs et des bois, des multiples rencontres avec des animaux sauvages sur les petites routes de cette campagne. « Un essayiste assure que tous ces animaux, petits ou grands, représentent la part sauvage de nous-même. L’expression est belle… C’est cette part sauvage que depuis des années, j’essaie de mettre à l’abri, autour de ce que nous appelons avec Catherine, ma femme, la grande Maison devant la forêt » (p 30). C’est le choix d’un genre de vie, où le temps a une autre épaisseur et où l’année est ponctuée par le rythme des saisons. « Mon idée de bonheur est liée à un instant très fugitif du mois d’avril où les lilas s’épanouissent et se fanent en deux semaines. Ce qui m’émeut, c’est l’agencement rigoureux des dates, des floraisons… ».
Sauver la beauté du monde
Sauver la beauté du monde : c’est qu’aujourd’hui elle est menacée. L’avant dernier chapitre intitulé : « Quand la Terre pleure » est introduit par une citation de Thich Nhat Han : « Ce dont nous avons le plus besoin, c’est d’écouter en nous les échos de la Terre qui pleure » (p 261). Les menaces abondent. Parmi elles, Jean-Claude Guillebaud cite l’enlaidissement. Lecteur engagé d’Albert Camus, il raconte comment celui-ci « venu du grand soleil d’Algérie, a découvert avec effroi la laideur des banlieues d’Europe ». Revenu meurtri d’Europe, Albert Camus raconte son retour à Tipisa, un site sur le rivage de la Méditerranée… (p 267). Jean-Claude Guillebaud évoque à ce sujet quelques lignes d’Albert Camus dans « l’Eté » : « Je redécouvrais à Tipisa qu’il fallait garder intactes en soi une fraicheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l’injustice, et retourner au combat avec cette lumière conquise… J’avais toujours su que les ruines de Tipisa étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. Ce recours dernier était aussi le nôtre… Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invincible » (p 268). Visitant ce lieu, Jean-Claude Guillebaud en est impressionné. « Grâce à Camus, j’avais l’impression d’être tenu debout par la beauté du monde. Ou ce qu’il en reste » (p 269).
Face à un « enlaidissement du monde qui s’accélère » (p 270), le chapitre se poursuit par un questionnement de l’auteur sur la manière de remédier aux méfaits du capitalisme. Cependant le problème n’est pas seulement économique, politique et social, il est aussi culturel et spirituel, l’auteur explore cette question éminemment complexe.
Changer de regard
Au terme de ce voyage dans l’espace et dans le temps, Jean-Claude Guillebaud s’emploie à répondre à son questionnement initial. Et si il nous fallait changer de regard et « avoir d’autres yeux ».
« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux » (Marcel Proust) (p 293). « Cette citation », nous dit l’auteur, « m’émeut toujours… Elle signifie, au bout du compte, que la beauté est – aussi – une grâce humaine. C’est elle qui enchante, désenchante et réenchante le monde. Un des proches conseillers de Nicolas Hulot, le philosophe Dominique Bourg, rejoignait Proust quand il affirmait que le seul choix qui nous reste, était de repenser notre manière de voir le monde, c’est à dire d’être au monde » (p 296).
Et « changer notre manière d’être au monde, d’avoir d’autres yeux, implique une révolution intérieure… » (p 296). Appel à une mystique (Pape François), à un nouveau récit personnel (Cyril Dion ). « Yann Arthus Bertrand a cent fois raison quand il dit que la révolution écologique sera spirituelle » (p 297). « Avec le monde en danger, nous devons accéder à une véritable conscience amoureuse », nous dit Jean-Claude Guillebaud, rappelant qu’il avait intitulé le premier chapitre de ce livre : « Une déclaration d’amour à la terre » (p 297). Et ceci implique et induit des changements de comportements face à un consumérisme à tout-va.
En fin de compte, sauver la beauté du monde, c’est aussi la reconnaître, et donc vivre l’émerveillement. C’est un enthousiasme. « Le marquis de Vauvenargue est l’auteur d’un aphorisme : « C’est un grand signe de médiocrité que de louer toujours modérément ». Cette maxime a du faire son chemin au plus profond de moi au point de me constituer. S’émerveiller– du monde, de la vie, des humains – me semble aujourd’hui la moindre des choses » (p 305).
Une dynamique de vie
Le monde est en crise. Devant la menace climatique, le péril est déclaré. C’est dans ce contexte que Jean-Claude Guillebaud écrit ce livre : « Sauver la beauté du monde ». Il y participe aux alarmes et aux interrogations concernant l’avenir de l’humanité. Le trouble est sensible aujourd’hui. Sans boussole, le voyageur se perd. Nous avons besoin de comprendre et d’espérer. Il y a donc lieu de rappeler qu’en 2012, Jean-Claude Guillebaud a écrit un livre intitulé : « Une autre vie est possible. Comment retrouver l’espérance ? » (4). Si le péril nous semble plus grand aujourd’hui qu’hier, il reste que cet ouvrage nous paraît toujours d’actualité. Et, déjà à l’époque, il y avait en France une propension au négatif. « Depuis longtemps, l’optimisme n’est pas tendance. On lui préfère le catastrophisme déclamatoire ou la dérision ». Ce livre nous aide à mesurer « la mutation anthropologique » dans laquelle nous sommes engagés sur plusieurs registres à la fois. Mais, en même temps, des chemins nouveaux commencent à apparaître : « Partant de nous, autour de nous, un monde germe. Un autre monde respire déjà ».
Nous nous retrouvons sur ce blog dans le même esprit. Aujourd’hui, une civilisation écologique commence à germer. Ce sera nécessairement, une civilisation relationnelle. C’est dans ce sens que nous sommes appelés à avancer. Comme l’écrit Jürgen Moltmann, « Sil y a une éthique de crainte pour nous avertir, il y a une éthique d’espérance pour nous libérer » (5). Nous voici en mouvement. « Les sociétés fermées s’enrichissent aux dépens des sociétés à venir. Les sociétés ouvertes sont participatives et elles anticipent. Elles voient leur futur, dans le futur de Dieu, le futur de la vie, le futur de la création éternelle » (6)
Il y a dans ce monde des voix qui anticipent et nous ouvrent un chemin. Parmi elles, on compte Joanne Macy, militante écologiste américaine engagée depuis plus de cinquante ans pour la paix, la justice et la protection de la terre et chercheuse associant plusieurs approches et inspirations. Labor et Fides vient de publier un de ses livres : « L’espérance en mouvement » (7), coécrit avec Chris Johnstone et préfacé par Michel Maxime Egger. Il y a là une démarche qui contribue à baliser le chemin. « L’humanité se trouve à un moment crucial où elle doit faire le choix entre trois manières de donner du sens à l’évolution du monde : le « on fait comme d’habitude », la grande désintégration, ou le « changement de cap ». Cette dernière histoire est « la transition d’une société qui détruit la vie vers une société qui la soutient à travers des relations plus harmonieuses avec tous les êtres, humains et autres qu’humains ». Engagée dans une approche de partage et de formation, Joanne Macy ouvre le champ de vision à travers la gratitude, l’acceptation de la souffrance pour le monde, la reliance… Sur ce blog, on retrouve cette dimension d’ouverture et de mise en relation dans la vision théologique de Jürgen Moltmann (6) et de Richard Rohr (8).
Une intelligence éclairée, multidimensionnelle vient également à notre secours. C’est la démarche de Jérémy Rifkin dans son livre : « Le New Deal Vert mondial » (9) qui nous montre comment l’expansion des énergies renouvelables va réduire la pression du CO2 et contribuer à l’avènement d’une civilisation écologique.
Comme l’a écrit Jean-Claude Guillebaud, « Changer notre manière d’être au monde implique une révolution intérieure », il y a bien un profond mouvement en ce sens. Ainsi, Bertrand Vergely a écrit un livre sur l’émerveillement (10) : « C’est beau de s’émerveiller… Qui s’émerveille n’est pas indifférent. Il est ouvert au monde, à l’humanité, à l’existence. Il rend possible un lien entre eux… Tout part de la beauté. Le monde est beau, l’humanité qui fait effort pour vivre avec courage et dignité est belle, le fond de l’existence qui nous habite est beau… Quand on vit cette beauté, on fait un avec le monde. On expérimente le réel comme tout vivant. On se sent vivre et on s’émerveille de vivre… Beauté du monde, mais aussi beauté des êtres humains, autre émerveillement… Beauté des être humains témoignant d’une beauté autre. Quelque chose nous tient en vie. Une force de vie, la force de la vie. Une force venue d’un désir de vie originel. Personne ne vivrait si cette force n’existait pas. Cela donne du sens à Dieu, source ineffable de vie… » (p 9-11). Le livre de Jean-Claude Guillebaud nous dit comment on peut vivre cet émerveillement dans la vie d’aujourd’hui. C’est un hymne à la beauté. Il ya chez lui, un enthousiasme, enthousiasme de la beauté, enthousiasme de la vie. Et, par là, comme l’écrit Bertrand Vergely, il y a une force qui s’exprime. Dans un contexte anxiogène, Jean-Claude Guillebaud nous permet de respirer. Il ouvre un espace où nous engager avec lui, dans une dynamique de vie et d’espérance.
J H
- Jean-Claude Guillebaud. Sauver la beauté du monde. L’Iconoclaste, 2019-10-13
- Biographie et bibliographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Guillebaud
- « Empathie et bienveillance : révolution ou effet de mode ? » : https://vivreetesperer.com/empathie-et-bienveillance-revolution-ou-effet-de-mode/
- Jean-Claude Guillebaud. Une autre vie est possible. Choisir l’espérance. L’Iconoclaste, 2012 « Quel avenir pour le monde et pour la France ? » : https://vivreetesperer.com/2012/10/
- « Agir et espérer. Espérer et agir » : https://vivreetesperer.com/agir-et-esperer-esperer-et-agir/
- « Le Dieu vivant et la plénitude de vie. Eclairages apportés par la pensée de Jürgen Moltmann » : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie/
- Joanna Macy et Chris Johnstone. Préface de Michel Maxime Egger. L’espérance en mouvement. Labor et Fides, 2018Une vidéo de Michel Maxime Egger présente la formation mise en œuvre par Joanna Macy : le travail qui relie : https://www.youtube.com/watch?v=CRk5dpvoUDQ
- Reconnaître et vivre la présence d’un Dieu relationnel. Extraits du livre de Richard Rohr : « The divine dance » : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-et-vivre-la-presence-dun-dieu-relationnel/
- Jeremie Rifkin. « Le New Deal Vert mondial ». Pourquoi la civilisation fossile va s’effondrer d’ici 2028. Le plan économique pour sauver la vie sur la terre. Les liens qui libèrent, 2019
- Bertrand Vergely. Retour à l’émerveillement. Albin Michel, 2010 (Format de poche : 2017). « Le miracle de l’existence » : https://vivreetesperer.com/le-miracle-de-lexistence/
par jean | Avr 12, 2023 | Vision et sens |
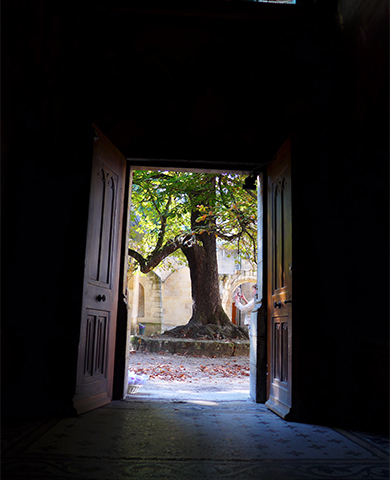 Selon Bertrand Vergely
Selon Bertrand Vergely
A plusieurs reprises, nous avons présenté sur ce blog des écrits de Bertrand Vergely (1). Bertrand Vergely, philosophe de culture et de conviction chrétienne orthodoxe, vient de publier un nouveau livre : « Voyage en haute connaissance. Philosophie de l’enseignement du Christ » (2). En page de couverture, ce livre est présenté dans les termes suivants : « Il existe aujourd’hui une crise morale et spirituelle très profonde en Occident, qui rend la vie fondamentalement absurde. L’absence de sens se traduit par une fuite dans les illusions et l’irresponsabilité. Bertrand Vergely propose une lecture stimulante et novatrice de l’enseignement christique qui nous montre comment naître à la vie spirituelle et grandir en conscience.
Quand la religion sort des visions politiques et dogmatiques léguées par l’histoire, spiritualité et philosophie se rencontrent. Le Christ n’est pas un adepte du dolorisme, ni uniquement un missionnaire social, il révèle surtout que nous avons en nous une destinée et des potentialités inouïes qu’il s’agit de découvrir ! ».
Ce livre est foisonnant. Les points de vue, les ouvertures se succèdent autour de l’enseignement du Christ, lui-même inépuisable. On ne peut résumer un tel ouvrage et nous ne nous sentons pas en mesure d’en rendre compte. C’est une approche originale. Bertrand Vergely ouvre et renouvelle les angles de vue. Nous ne le suivons pas toujours. Souvent, il nous déconcerte et nous nous interrogeons sur ses propos. Mais lorsque nous sommes perplexes, cela nous appelle à réfléchir plus avant.
A travers son interprétation des textes, son herméneutique, son exégèse, Bertrand Vergely nous ouvre de nouveaux horizons. Dans ce « voyage en haute connaissance », les visions se succèdent. Le parcours se déroulent en quelques grandes parties : « I Naître. S’ouvrir à la connaissance. II Grandir. Rompre avec l’agitation. III Libérer. Sortir du dolorisme. IV Resplendir. Rentrer dans la vie divine.
L’auteur nous aide à encourager chacun de ces mouvements : naître, grandir, libérer, resplendir dans une meilleure compréhension et un immense émerveillement. Parce que nous constatons fréquemment un écart entre cette élévation et un repli en terme de culpabilité, en terme de complaisance et d’enfermement dans la souffrance, nous évoquerons ici la séquence : « Libérer. Sortir du dolorisme ».
L’auteur décline cette partie en six chapitres : Sortir de la culpabilité, sortir de la malédiction, sortir du mérite, sortir de la punition, sortir de l’ignorance, sortir de l’obscurité.
Sortir de la culpabilité
Issu de Saint Augustin, le dogme du péché originel a assombri le christianisme occidental pendant des siècles. Dans son livre : « Oser la bienveillance » (3), la théologienne Lytta Basset a mis en évidence le mal-être engendré par cette représentation pervertie de la nature humaine. Elle-même en a souffert pendant de nombreuses années. Elle a vécu au départ une hantise de la question de la culpabilité, de la faute et du péché. « Autre préoccupation qui appartient à la préhistoire de ce livre : Dans les déclarations publiques comme dans les accompagnements spirituels, je suis frappée par l’image négative que les gens ont d’eux-mêmes et des humains en général ». « Ma réflexion a donc eu pour point de départ mon propre malaise par rapport à la question du péché et à l’image désastreuse qu’elle nous avait donné de nous-mêmes ». Il y a dans ce livre un parcours particulièrement utile pour engager un processus de libération par rapport à des représentations qui emprisonnent et détruisent. A partir de cette perspective, Lytta Basset propose une vision nouvelle fondée sur son expérience de la relation humaine et sur sa lecture de l’Evangile.
Dans un autre contexte, l’historienne et théologienne américaine, Diana Butler Bass, a vécu, dans sa jeunesse, une emprise religieuse mortifère dont elle a pu s’échapper (4). Ainsi a-t-elle, à l’époque, fréquenté un séminaire où elle s’est sentie formatée dans une vision de plus en plus sombre de l’humanité. Les humains étaient considérés comme de misérables pécheurs. « Il y avait désormais un fossé entre la dépravation de l’humanité et la sainteté divine ». Le culte devenait un exercice « de réaffirmer le péché et d’implorer le pardon ». « Je m’effondrais dans l’obscurité, intellectuellement convaincue que l’humanité était mauvaise, tombée si bas qu’il ne restait plus rien de bien, entièrement dépendant d’un Dieu qui pouvait dans sa sagesse, choisir de sauver quelques-uns parmi lesquels je priais avec ferveur de figurer ». Par la suite, Diana, à travers des études historique, a pu déconstruire cette impérieuse « certitude théologique ».
Dans d’autres contextes encore, on pourrait évoquer une incessante auto-surveillance dans une délibération sur la qualification des péchés, entre péché mortel et péché véniel, dans la perspective de la confession. A l’époque, un livre était paru ave un titre significatif : « L’univers morbide de la faute ».
Bertrand Vergely décrit avec justesse l’univers socio-religieux dans lequel la culpabilité s’impose. « A l’origine, est-il dit, on trouve le Bien et le Mal. Le Bien est l’ordre voulu par Dieu, le Mal, ce qui s’oppose à cet ordre. Agir consiste à obéir au Bien. Lorsqu’on choisit le Bien et qu’on lui obéit, on va au paradis. Lorsqu’on choisi le mal, on va en enfer. Le Christ est venu faire triompher le Bien contre le Mal. En acceptant de souffrir et de mourir sur la croix, il a été et il est le modèle absolu de l’obéissance qu’il convient de suivre. Il a été le mérite même en montrant comment il faut mériter. Cette vision-là a beaucoup existé de par le passé. Elle existe encore, bien plus qu’on ne le pense » (p 164). Bertrand Vergely impute cette conception à une volonté de puissance de l’organisation. « Pour tout un christianisme, si l’on veut demeurer une réalité collective qui dure à travers le temps, il n’y a pas d’autre solution que d’organiser cette réalité de façon militaire en créant un ordre et l’obéissance à cet ordre… Pour des raisons politiques, le christianisme a été organisé sur la base d’un modèle à la fois militaire et méritocratique. Il continue de l’être. Modèle ambigu. En apparence, il respecte la foi et Dieu. En profondeur, il les évacue subtilement » (p 165).
En remontant à l’origine, à la Genèse, « tout est créé par le Verbe. Il s’agit là d’une rupture radicale avec toute culpabilité…
Le Verbe est la divine intelligence qui rend toute chose lumineuse en la rendant parlante. Dieu créant tout par le Verbe, il y a là une nouvelle vertigineuse. Tout existe parce que tout est amené à l’existence par une divine information… Autre trait qui rompt ave la culpabilité : Dieu crée la terre et trouve cela bien. Dieu crée, mais le bien n’est pas donné au départ. Il résulte de la création qui apprend quelque chose à Dieu. Pour que le bien existe, il a fallu que la création ait lieu. Le bien étant ainsi création accomplie, on comprend le divin contentement… Un troisième élément vient confirmer cette vision très déculpabilisée. Dieu ne veut pas garder Dieu pour lui. Quand il crée l’homme, il le crée non seulement à son image, mais pour sa ressemblance avec lui. L’homme qui est créé par Dieu, est habité par le Verbe divin et l’information céleste qui lui permettent d’être ce qu’il est. Par cette information, il est appelé à informer le monde, l’humanité et l’existence… Cette vision dépourvue de toute honte est couronnée par l’état dans lequel sont l’homme et la femme. Nus, ils n’en ont pas honte. La nudité désigne l’état de connaissance absolue… » (p 167-168).
Bertrand Vergely ne voit également aucune culpabilité dans la chute de l’homme. « Quand il est raconté que l’homme, ayant le choix entre le bien et le mal, a choisi le mal en raison de sa volonté mauvaise, on invente, le récit de la chute montrant tout autre chose. Le récit, dit du péché originel, se trouve au chapitre 3 de la Genèse. Comme toute la Genèse, ce récit est un récit de libération. Il s’agit de comprendre la condition humaine. Tout vient de la connaissance. L’homme est invité à tout connaître, mais il importe de ne pas tout connaître avant l’heure. La connaissance est inséparable du temps de la connaissance qui renvoie à l’assimilation intérieure… » (p 171). Que nous enseigne le récit de la chute ? « Avant tout, à l’origine, il n’y a nullement une volonté mauvaise, mais bien plutôt une perte de volonté. Qui n’est plus lui-même, rompt sa relation avec la divine connaissance, non parce qu’il est méchant et révolté, mais parce qu’il n’est plus capable de vouloir. Quand on se laisse capturer par la séduction, ne connaissant plus rien d’autre, on cesse de connaître ce que l’on aimait…(p 171-172). C’est un drame, mais « tout n’est pas perdu pour autant. Après la mise au point sur le péché de l’homme, à savoir son éloignement de Dieu », une autre réalité apparaît : « Quand on a mal agi, il est beau d’en avoir honte, d’être conduit à le dire. Commence alors le début d’un retournement intérieur conduisant à retrouver la connaissance perdue. La Genèse le signifie par l’homme et la femme qui se cachent quand ils entendent la voix de Dieu. La divine connaissance ne peut pas être vécue sans un état intérieur divin. Quand cet état n’existe pas, c’est en séparant la connaissance divine de ce qui n’est pas divin, que l’on préserve la connaissance. Dans la Genèse, c’est exprimé à travers l’exclusion du jardin d’Eden. Cette exclusion prépare le renouveau de la connaissance » (p 172-173).
On s’interroge à propos de l’origine du mal. Le mal est supposé venir d’un principe méchant. Mais, l’interprétation de Bertrand Vergely est autre. « C’est l’éloignement de Dieu et avec lui, l’ignorance qui rend méchant et non une méchanceté foncière. On ne sait pas qui on est. Voilà pourquoi on ne sait pas ce que l’on fait, et ce que l’on fait de pire. Cette ignorance n’est pas un accident. Elle provient d’un état intérieur, en l’occurrence d’un manque total d’intériorité… » (p 173).
Dans ce mouvement de libération à l’égard de la culpabilisation, Bertrand Vergely nous appelle à lire le prologue de l’évangile de Jean après la Genèse. Dans ce prologue, on retrouve ce qui se trouve déjà dans le récit de la Genèse. « Dieu qui crée, crée le monde et l’Homme par la Parole. Il crée pour que la vie divine se diffuse partout, dans l’invisible comme dans le visible » (p 174). Le concept de transmission est très présent « Le Royaume, qui veut dire transmission, est diffusion » Dans le prologue de Jean, on lit : « La lumière a été envoyée dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas retenue ». « Cette parole a été mal traduite. Ne pas recevoir ne veut pas dire rejeter, mais ne pas pouvoir contenir. La Lumière divine est tellement lumineuse que rien ne peut la contenir ni l’arrêter. On a là le fondement de la connaissance divine… Dans la Genèse, l’échec concernant la connaissance de Dieu vient de la faiblesse et des limites humaines. Dans le prologue de Jean, l’échec concernant la connaissance de Dieu est la gloire même de Dieu. Dans la Genèse, l’homme retrouve la connaissance à travers la noble honte. Dans le prologue de Jean, il trouve la connaissance dans l’humilité » (p 175).
Sortir de la punition
Bertrand Vergely aborde la question du mal. C’est là, qu’entre autres, il évoque l’usage de punition dans un prétendu service du bien.
« Lorsqu’il fait passer le mal pour le bien, le mal se sert toujours de la justice. En punissant, il peut faire du mal en toute impunité. Il ne punit pas. Il œuvre pour le bien. Il purifie… Il est tentant de punir. Les bourreaux ne résistent jamais à se faire passer pour des justiciers venant punir afin de rétablir la justice. Cela éclaire l’autre face du mal. S’il ne va pas de soi de ne pas subir, il ne va pas de soi de ne pas faire subir. A chaque fois que l’on a affaire à une tentative de prise de pouvoir, cela ne manque jamais : l’aspirant au pouvoir ne dit pas qu’il veut le pouvoir, il veut la justice… » (p 206).
En regard, l’attitude du Christ est claire. « Le Christ n’est pas venu punir. Il n’est pas venu condamner la femme adultère. Il est venu au contraire mettre fin au mensonge de la punition permettant par exemple de lapider une femme en toute bonne conscience au nom de la justice. Il a ensuite été condamné à mort et exécuté. Ce n’est pas étonnant. Dénonçant le mensonge de la punition, il a été puni par ceux qui entendent pouvoir punir en toute impunité » (p 206).
« On ne remet pas facilement en cause la morale et la religion punitive… Dans le domaine religieux, on s’en rend compte. La difficulté voire l’impossibilité de se délivrer d’une religion punitive et sacrificielle en témoigne. L’impossibilité de se délivrer d’un Dieu punitif et sacrificiel aussi » (p 207).
« La tradition qui pense que le Christ est venu souffrir pour nous les hommes est inséparable de celle qui punit et qui magnifie le sacrifice. Souffrir, punir, se sacrifier, la logique est la même. Il faut mériter. Pour mériter, il faut souffrir. On souffre quand on se sacrifie. On se sacrifie quand on se sacrifie pour se sacrifier. Afin de parvenir à un tel résultat, un rituel sacrificiel s’impose. Il faut qu’il y ait le sacrifice suprême, à savoir la mort pour la mort, pour que, le sacrifice absolu étant fondé, le sacrifice le soit. Avec un coupable, il y a de la justice. Avec un innocent, la mort étant la mort pour la mort, il n’y en a pas. La mort est alors sure d’être sacrée. Sacrée, elle peut fonder le sacrifice, la souffrance, l’obéissance et le mérite » (p 207).
Dans les sociétés hiérarchisées, une pression s’exerce en faveur de l’obéissance. « Les sociétés humaines sont perdues quand les hommes n’obéissent pas. Présenté comme l’innocent qui accepte de mourir pour mourir, faisant vivre une mort sacrée à travers une mort absolue, le Christ devient celui qui fonde l’obéissance et le mérite, et sauve les sociétés humaines. Il conforte l’idée qu’il faut obéir à la société. Dieu veut qu’on lui obéisse et il offre son fils pour cela » (p 208).
On peut s’interroger sur la position du christianisme sur cette question dans l’histoire. Bertrand Vergely a démonté les mécanismes de la religion punitive et sacrificielle. Le christianisme ne doit pas être une religion de la souffrance et du sacrifice. « Le pouvoir, le mérite, l’obéissance, la souffrance ne sont pas les buts célestes. Dieu attend des hommes qu’ils fassent mieux que mériter, souffrir, obéir et se sacrifier. Les premiers chrétiens l’entendent. C’est la raison pour laquelle ils ne poursuivent pas de but politique… » (p 208). L’auteur s’interroge ensuite sur l’attitude de Paul et les conséquences du désir de celui-ci de rallier une communauté juive traditionnaliste.
Sortir de l’ignorance
Bertrand Vergely évoque un texte de Péguy qui reproche aux « honnêtes gens », caricaturant ainsi les bourgeois du XIXe siècle, de se draper dans une armure, de refuser toute vulnérabilité et de ne se prêter à aucune repentance. « Ils ne présentent pas cette entrée à la grâce qu’est essentiellement le péché. Parce qu’ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables… Parce qu’ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne panse point celui qui n’a pas de plaies… » (p 211). Bertrand Vergely commente ce texte en le situant dans son contexte. « Ce texte qui souhaite au bourgeois sûr de lui de souffrir est un texte de salut, sur le salut et pour le salut. Si le bourgeois souffre, comprenant qu’il ne peut pas se sauver tout seul, il va devenir humble. Il sera sauvé. Certes, il y a le salut, mais à quel prix ! Péguy s’inscrit dans la tradition d’un christianisme doloriste. Pour lui, cela ne fait pas de doute : la souffrance rend humble et Dieu sauve les humbles qui souffrent. Il oublie qu’il n’y a pas que la souffrance qui rend humble. La lumière divine rend humble. Le Verbe rend humble. L’aventure de la connaissance rend humble » (p 213) Un autre danger de ce genre de raisonnement, c’est d’induire que « Dieu fait exprès de faire chuter l’homme et de le faire souffrir pour mieux le sauver ». Ainsi Bertrand Vergely conclut que « pour aller vers le salut, occupons-nous de ce qui nous illumine et non de ce qui nous assombrit. Dieu se trouve dans ce qui sauve l’humanité et non dans ce qui fait exprès de la faire chuter pour mieux la sauver » (p 214). L’auteur pointe également un autre danger : l’exaltation de la souffrance. « Péguy a choisi les siens. Il est du côté des victimes, de ceux qui souffrent. Ce sont eux qui sauvent le monde. Tout un christianisme se fonde donc sur la figure du pauvre, de celui qui souffre, de la victime. Dieu, c’est eux. Le salut, c’est eux… Cet élan du cœur se comprend. Il n’en est pas moins désastreux. En faisant de la douleur ce qui sauve, on finit par faire d’elle non seulement un Dieu, mais ce qui le crée. C’est parce que l’homme est à terre que Dieu peut sauver et sauve, dit Péguy. Donc, c’est la douleur qui crée Dieu » (p 217). Selon Bertrand Vergely, il y aurait une complaisance dans la douleur. « Le moi, afin de s’imposer, crée un Dieu à sa mesure. Avec la douleur, il en va de même. Les victimes ayant besoin d’être réconfortées, elles créent une vision de la douleur qui invente Dieu et le salut… » (p 217). Bertrand Vergely situe cette attitude vis à vis de la souffrance au XIXe siècle et jusqu’à nos jours. Et en évoquant « la dérive qui enfonce le monde au lieu de le libérer », il en voit la traduction dans une représentation du Christ « crucifié, les yeux fermés, le visage ensanglanté par une couronne d’épines, les mains transpercées par des clous, seul, absolument seul » (p 218). A vrai dire, cette représentation remonte très loin dans le temps. L’auteur l’évoquait au début de son livre : « A Belem, non loin de Lisbonne, au Portugal, dans l’église du monastère des Hiéronymites, on peut voir un Christ grandeur nature crucifié, souffrant et ensanglanté. On est loin du Christ glorieux. Il faut souffrir, dit ce Christ, et il faut faire souffrir parce qu’il faut obéir et faire obéir. Message politique venu de loin, des légions romaines avec leur culte de l’ordre qui a inspiré tout un christianisme et l’inspire encore » (p 16-17).
Bertrand Vergely en vient à évoquer comment il envisage la confrontation avec la souffrance. « Face à la souffrance, la douleur est une attitude possible. Il y en a une autre. Elle repose sur l’être. La souffrance renvoie à l’expérience du retournement qui fait passer du refus de subir à la capacité de supporter. Entre les deux, il y a cet entre-deux qui forme l’attente consistant à être en souffrance » (p 218). On cherchera à comprendre cette manière de voir en se reportant aux explications de l’auteur. Il envisage cet entre-deux comme un hors temps. « Qui fait le vide, fait silence. Qui fait silence, fait taire le mental. Qui fait taire le mental fait taire la tentation d’être la victime… Quand ce silence se fait, l’être pouvant parler, il peut enseigner. Pouvant enseigner, il peut vraiment guérir et sauver » (p 219). Bertrand Vergely voit dans cette réflexion un éclairage pour envisager ce qu’il appelle : le sommeil céleste. Il nous introduit là dans un univers chrétien où la croix n’apparaît pas en termes morbides. C’est l’exemple du christianisme orthodoxe. « L’orthodoxie ne représente pas le Christ sous la forme d’un crucifié sur une croix. Quand il y a des représentations de la croix, celles-ci sont des icônes et non des tableaux. Une icône n’est pas un tableau et un tableau n’est pas une icône. Un tableau a pour but de représenter la réalité matérielle. Une icône a pour but de laisser passer la lumière divine… Avec une icône, la réalité matérielle et humaine est le reflet du ciel et du divin » (p 219). Bertrand Vergely engage une méditation sur la signification de la Croix auquel sera consacré son chapitre : « Sortir de l’obscurité ». Ici, il traite de la victoire sur la mort : « Par la mort, il a vaincu la mort », clame l’hymne pascal des églises orthodoxes pour célébrer la résurrection du Christ. Mourir, c’est aller au ciel et non dans la mort. La mort ne met pas le ciel en échec. C’est plutôt le ciel qui met la mort en échec. Le Christ dormant sur la croix est là pour le rappeler. Il est là pour que l’on fasse silence en stoppant le mental. Ne donnant pas à voir une victime dévorée par la douleur, mais un endormi céleste, l’icône de la croix rend impossible toute la mécanique mentale et politique qui se met en marche dès que le regard aperçoit une victime ».
(p 220).
Certes, aujourd’hui, le dolorisme a reculé en France. Mais, une telle mentalité religieuse associée à des justifications théologiques laisse des traces. Comme l’écrit Bertrand Vergely, « cette vision-là a beaucoup existé dans le passé. Elle existe encore bien plus qu’on ne le pense » (p 164). Récemment encore, une amie me faisait part d’un vif ressenti à cet égard. Dans les années 1970, au cours d’une séance de catéchisme le vendredi saint, ses garçons avaient été contraints de venir embrasser le Christ souffrant en croix. Et ils en étaient revenus très choqués. « Maman, je ne veux plus aller au catéchisme. Ce n’est pas nous qui avons tué Jésus-Christ ». On pourrait évoquer aussi des prédications où la résurrection compte peu par rapport à une crucifixion salvatrice. Refuser le dolorisme, c’est choisir une autre perspective théologique. C’est l’approche de Bertrand Vergely. Dans un autre contexte, nous évoquerons le livre de Jürgen Moltmann : « The living God and the fullness of life » (Le Dieu vivant et la plénitude de vie) (5). Il y écrit : « Pourquoi le christianisme est-il uniquement une religion de la joie, bien qu’en son centre, il y a la souffrance et la mort du Christ sur la croix ? C’est parce que, derrière Golgotha, il y a le soleil du monde de la résurrection, parce que le crucifié est apparu sur terre dans le rayonnement de la vie divine éternelle, parce qu’en lui, la nouvelle création éternelle du monde commence. L’apôtre Paul exprime cela avec sa logique du « combien plus ». « Là où le péché est puissant, combien plus la grâce est-elle puissante ! » (Romains 5.20). « Car le Christ est mort, mais combien plus, il est ressuscité » (Romains 8.34). Voilà pourquoi les peines seront transformées en joie et la vie mortelle sera absorbée dans une vie qui est éternelle » (p 100-101).
J H
- Avant toute chose, la vie est bonne : https://vivreetesperer.com/avant-toute-chose-la-vie-est-bonne/ Avoir de la gratitude : https://vivreetesperer.com/avoir-de-la-gratitude/ Dieu vivant : rencontrer une présence : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-rencontrer-une-presence/ Dieu veut des dieux : https://vivreetesperer.com/dieu-veut-des-dieux/ Le miracle de l’existence : https://vivreetesperer.com/le-miracle-de-lexistence/
- Bertrand Vergely. Voyage en haute connaissance. Philosophie de l’enseignement du Christ. Le Relié, 2023
- Bienveillance humaine. Bienveillance divine : une harmonie qui se répand : https://vivreetesperer.com/bienveillance-humaine-bienveillance-divine-une-harmonie-qui-se-repand/
- Libérée d’une emprise religieuse : https://vivreetesperer.com/liberee-dune-emprise-religieuse-2/
- Le Dieu vivant et la plénitude de vie : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie/
par jean | Mai 5, 2018 | ARTICLES, Vision et sens |
Selon Bertrand Vergely. Prier, une philosophie
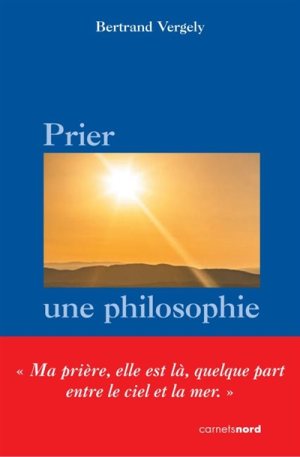 Nous avons de plus en plus conscience que l’approche intellectuelle dominante dans le passé tendait à diviser la réalité, à en opposer et en séparer les éléments plutôt que d’en percevoir les interrelations et une émergence de sens dans la prise en compte de la totalité. Ainsi, dans « Petite Poucette », Michel Serres met en évidence des changements que la révolution numérique suscite actuellement dans la manière d’être et de connaître (1). Il constate que l’ordre qui quadrillait le savoir est en train de s’effriter. Et il remet en cause les cloisonnements universitaires. « L’idée abstraite maitrise la complexité du réel, mais au prix d’un appauvrissement de la prise en compte de celui-ci ». Et, de même, dans une œuvre théologique de longue haleine, Jürgen Moltmann montre l’émergence d’une nouvelle approche intellectuelle et culturelle qui se départit du penchant dominateur à l’œuvre dans la prépondérance d’une pensée analytique généralisée. Ainsi, dans son livre : « Dieu dans la création » (2), paru en France en 1988, Jürgen Moltmann écrit : « Le traité de la création dans son rapport écologique doit s’efforcer d’abandonner la pensée analytique avec ses distinctions sujet-objet, et apprendre une pensée nouvelle communicative et intégrante. Dans cette critique de la pensée analytique, Moltmann évoque l’antique règle romaine de gouvernement : « divide et impera » (diviser et régner). Aujourd’hui, des sciences nouvelles comme la physique nucléaire et la biologie mettent en œuvre des approches nouvelles. « On comprend beaucoup mieux les objets et les états de chose quand on les perçoit dans leurs relations avec leur milieu et leur monde environnant éventuels, l’observateur humain étant inclus » (p 14). Cette approche préalable appuie une part de la réflexion de Bertrand Vergely dans son livre : « Prier, une philosophie » (3).
Nous avons de plus en plus conscience que l’approche intellectuelle dominante dans le passé tendait à diviser la réalité, à en opposer et en séparer les éléments plutôt que d’en percevoir les interrelations et une émergence de sens dans la prise en compte de la totalité. Ainsi, dans « Petite Poucette », Michel Serres met en évidence des changements que la révolution numérique suscite actuellement dans la manière d’être et de connaître (1). Il constate que l’ordre qui quadrillait le savoir est en train de s’effriter. Et il remet en cause les cloisonnements universitaires. « L’idée abstraite maitrise la complexité du réel, mais au prix d’un appauvrissement de la prise en compte de celui-ci ». Et, de même, dans une œuvre théologique de longue haleine, Jürgen Moltmann montre l’émergence d’une nouvelle approche intellectuelle et culturelle qui se départit du penchant dominateur à l’œuvre dans la prépondérance d’une pensée analytique généralisée. Ainsi, dans son livre : « Dieu dans la création » (2), paru en France en 1988, Jürgen Moltmann écrit : « Le traité de la création dans son rapport écologique doit s’efforcer d’abandonner la pensée analytique avec ses distinctions sujet-objet, et apprendre une pensée nouvelle communicative et intégrante. Dans cette critique de la pensée analytique, Moltmann évoque l’antique règle romaine de gouvernement : « divide et impera » (diviser et régner). Aujourd’hui, des sciences nouvelles comme la physique nucléaire et la biologie mettent en œuvre des approches nouvelles. « On comprend beaucoup mieux les objets et les états de chose quand on les perçoit dans leurs relations avec leur milieu et leur monde environnant éventuels, l’observateur humain étant inclus » (p 14). Cette approche préalable appuie une part de la réflexion de Bertrand Vergely dans son livre : « Prier, une philosophie » (3).
En effet, aux yeux de certains, la prière et la philosophie sont deux domaines séparés. Au contraire, Bertrand Vergely met en évidence les interrelations. Ainsi met-il en exergue une pensée de Wittgenstein : « La prière est la pensée du sens de la vie ». « Quand on considère les relations entre philosophie et religion, celles-ci s’opposent. Si on envisage philosophie et religion de l’intérieur, il en va autrement. Au sommet, tout se rejoint » (p 15). Et, de même, Bertrand Vergely montre qu’il n’est pas bon, de séparer l’action et la prière. Il ouvre des portes par rapport au déficit engendré par un exercice de la pensée autosuffisant et coupé de la réalité existentielle. « La modernité, qui poursuit un idéal de rationalité et de laïcité, divise la réalité en deux, avec d’un côté, l’action, et, de l’autre, la prière. Les choses sont-elles aussi simples ? » (p 10). De fait, « il y a quelque chose que nous avons tous expérimenté, à savoir la présence. Devenir présent à ce que nous sommes éveillant la présence en nous, on fait advenir la présence de ce qui vit autour de nous » (p 11)… Mettons nous à vivre dans le présent, on rentre dans la présence. En restant dans la présence, on rencontre ce qui demeure stable à travers le changement et le multiple… Présence emmenant loin au delà de soi vers le supra-personnel, le supra-conscient comme le dit Nicolas Berdiaeff. « Nul ne sait ce que peut le corps » dit Spinoza. La présence est en relation avec une présence qui dépasse tout, la divine présence… (p 12). D’où l’erreur de penser que la condition humaine est fermée. Quand on prie en allant de toutes ses forces dans son être profond, ce qui semble impossible devient possible » (p 13).
Bertrand Vergely nous parle à la fois en philosophe et en chrétien de confession et de culture orthodoxe. Ce livre nous emmène loin : « Prier ? Prier les dieux, Prier Dieu ? ; Quand la prière humanise ; Quand la philosophie spiritualise ; Quand la prière divinise ». Il témoigne d’une immense culture. Certes, nous pouvons parfois nous sentir dépassé par le langage philosophique. Mais l’auteur recherche l’accessibilité, notamment en découpant le livre en de courts chapitres. Il n’est pas nécessaire de le lire en continu. Et, dans cette présentation, nous ne couvrirons pas l’ensemble de l’ouvrage ; nous nous centrerons sur une démarche de l’auteur qui rejoint quelques autres, celles de Jürgen Moltmann et de Richard Rohr.
Dons et requêtes de la vie
Dans son approche, à de nombreuses reprises, Bertrand Vergely appelle à la conscience de la vie dans tout ce qu’elle requiert et tout ce qu’elle entraine. C’est ainsi qu’on débouche sur une démarche spirituelle et sur la prière.
Et, pour cela, on doit aussi se démarquer d’un monde dominé par notre intellect prédateur et sa rationalité morbide ».
« Transformer son intelligence. Laisser passer le Vivant, l’Unique en soi. On y parvient par la métanoïa, la sur-intelligence. Quand on vit, il n’y a pas que nous qui vivons. Il y a la Vie qui se vit en nous et qui nous veut vivant. Il y a quelque chose à la base de l’existence. Un principe agissant, une force, un premier moteur, comme le dit Aristote, une lumière qui fait vivre. (p 220)… Quand nous rentrons en nous-mêmes afin de savoir qui nous sommes, ce n’est pas un moi bavard que nous découvrons, mais un moi profond porté par la Vie avec un grand V. d’où la justesse de Saint Augustin quand, parlant de Dieu, il a cette formule : « la vie de ma vie » (p 221).
Répondons-nous oui à la vie ? Vivons-nous vraiment ? Ou bien sommes-nous prisonniers de principes auxquels nous nous assujettissons ? La morale et la religion peuvent ainsi s’imposer comme un esclavage. Au contraire, « la morale et la religion sont en nous et non à l’extérieur… C’est ce que le Christ rappelle. L’enfant, qui est la vie même, est le modèle de la morale et de la religion. Ce que n’est pas le pharisien qui ne se laisse plus porter par la vie qui est en lui… » (p 236).
« La Vie. La Vie avec un grand V. Ce n’est pas un terme grandiloquent. Il y a en nous une présence faisant écho à ce que nous avons de plus sensible, d’où la justesse de parler de divine présence.
C’est « une conscience profonde à la base de l’étonnante capacité que nous avons de demeurer le même à travers le temps et que Jankélévitch appelle l’ipséité ». C’est « une conscience vivante avec laquelle rien n’est désincarné, ni impersonnel, le moi étant lié au monde comme le Je est lié au Tu et le Tu au Je pour reprendre l’idée majeure qui guide la pensée de Martin Buber (p 237).
« Chaque fois qu’un sujet se met à être le monde au lieu d’être en face de lui, apparaît une expérience lumineuse, étincelante, faisant tout exister et quelque chose de plus. Une liberté supérieure, divine » (p 238).
Dieu vivant
On peut s’interroger sur les raisons de croire en Dieu en terme de réponse à une recherche de cause. « Quand la raison cherche à démontrer l’existence de Dieu par la raison banale, elle ne convainc personne… Quand une cause a été démontrée rationnellement, nul besoin d’y croire… » (p 225). La relation à Dieu est d’un autre ordre. Elle implique notre être profond. « Il faut exister pour comprendre quelque chose à l’existence de Dieu. Quand on est dans la raison objective qui aborde le monde à distance, il est normal qu’il n’existe pas » (p 226)… Ainsi la foi implique et requiert une intensité de vie.
« Le monde occidental ne croit plus aujourd’hui que Dieu est la cause du monde. En revanche, quand Dieu est pensé comme sur-existence, il en va autrement. Il se pourrait que nous ne soyons qu’au début de la vie de Dieu et que son temps ne soit nullement passé. La preuve : quand on pense Dieu, on pense toujours celui-ci sur un mode théiste. Jamais ou presque sur un mode trinitaire. D’où deux approches de Dieu pour le moins radicalement différentes. Posons Dieu en termes théistes. Celui-ci est un principe abstrait sous la forme d’une entité dans un ciel vide. Il est comme la raison objective. Unique, mais à quel prix ! A part lui, table rase… Posons à l’inverse Dieu en termes trinitaires. Dieu n’est plus Dieu, mais Père, source ineffable de toute chose. Il n’est plus seul, mais Fils, c’est à dire passage du non manifesté au manifesté… Dans le visible et non dans l’invisible. Dans le théisme, on a affaire à un Dieu, froid, glacial même. Avec le Dieu trinitaire, on a affaire à une cascade de lumière, d’amour et de vie… (p 227-228).
Importance du passage. Des Hébreux au Christ, une continuité, un même souffle : diffuser la vie et non la mort, et, par ce geste, glorifier le Père, la source de vie, source ineffable. On est loin du Dieu qui ne fait qu’exister, du Dieu cause. Le Dieu qui cause le monde ne le transforme pas. Le Dieu qui sur-existe le transforme. Il fait vivre en appelant l’homme à la vie afin qu’il sur-existe en devenant comme lui hyper-vivant » (p 229).
Dieu vivant, communion d’amour, puissance de vie
En lisant le livre de Bertrand Vergely sur la prière, nous voyons de convergences avec le courant de la pensée théologique que nous avons découvert dans les ouvrages de Jürgen Moltmann, puis dans le livre de Richard Rohr : « The Divine Dance » (4).
Dans les années 1980, Jürgen Moltmann a été le pionnier d’une nouvelle pensée trinitaire qui nous présente un Dieu relationnel, un Dieu communion. Dans son livre le plus récent : « The living God and the fullness of life » (5), il écrit : « la foi chrétienne a elle-même une structure trinitaire parce qu’elle est une expérience trinitaire avec Dieu »… « Nous vivons en communion avec Jésus, le Fils de Dieu et avec Dieu, le Père de Jésus-Christ, et avec Dieu, l’Esprit de vie… Ainsi, nous ne croyons pas seulement en Dieu. Nous vivons avec Dieu, c’est à dire dans son histoire trinitaire avec nous » (p 60-62).
De même, Robert Rohr nous parle de la révolution trinitaire comme l’émergence d’un nouveau paradigme spirituel. Et, comme Moltmann, pour exprimer Dieu trinitaire, il emprunte aux Pères grecs, l’image de la « danse divine ». « Tout ce qui advient en Dieu, c’est un flux, une relation, une parfaite communion entre trois, le cercle d’une danse d’amour ».
Et comme Bertrand Vergely nous appelle à rencontrer Dieu à travers l’expérience, à travers le vivant, Richard Rohr raconte comment, découvrant le plein sens de Dieu trinitaire, à travers un livre savant, il l’a ressenti comme une expérience intérieure. « La Trinité n’était pas une croyance, mais une voie objective pour décrire ma propre expérience de la transcendance et ce que j’appelle le flux. La conviction venait de l’intérieur. Quelque chose résonnait en moi ».
Le premier chapitre du livre de Jürgen Moltmann : « L’Esprit qui donne la vie » (6) s’intitule : « Expérience de la vie, expérience de Dieu ». C’est donner à l’expérience une place primordiale. « L’expérience de Dieu devient possible dans, avec et sous toute expérience quotidienne du monde dès lors que Dieu est dans toute chose et que toute chose est en Dieu, et que, par conséquent, Dieu lui-même, à sa manière, fait « l’expérience de toute chose ».
La pensée trinitaire donne toute sa place à la troisième composante divine, l’Esprit de Dieu, l’Esprit qui donne la vie. » (7) L’agir de l’Esprit de Dieu qui donne la vie est universel et on peut le reconnaître dans tout ce qui sert la vie » (p 8). Il y a unité dans « l’agir de Dieu dans la création, le rédemption et la sanctification de toutes choses » (p 27). « Les recherches conduisant à une « théologie écologique », à une christologie écologique et à une redécouverte du corps ont pour point de départ la compréhension hébraïque de l’Esprit de Dieu et présupposent l’identité entre l’Esprit rédempteur du Christ et l’Esprit de Dieu qui crée et donne la vide ». C’est pourquoi l’expérience de l’Esprit, qui donne vie, qui est faite dans la foi du cœur et dans la communion de l’amour, conduit d’elle-même au delà des frontières de l’Eglise vers la redécouverte de ce même Esprit dans la nature, les plantes, les animaux et dans les écosystèmes de la terre » (p 28).
Richard Rohr nous parle également du Saint Esprit comme « la relation d’amour entre le Père et le Fils. C’est cette relation qui nous est gratuitement donnée. Ou mieux, nous sommes inclus dans cet amour » (p 196). Dans la création, l’Esprit engendre la diversité et, en même temps, il est Celui qui relie et qui rassemble. Richard Rohr nous fait part d’un texte significatif de Howard Thurman, un inspirateur de Martin Luther King. « Nous sommes dans un monde vivant. La vie est vivante (alive) et nous aussi, comme expression de la vie, nous sommes vivant et portés par la vitalité caractéristique de la vie. Dieu est la source de la vitalité, de la vie et de toutes les choses vivantes » (p 189).
L’univers est relationnel. Il est habité. « Il est parcouru par le flux de l’amour divin qui passe en nous » (p 56). C’est un flux de vie. Dieu est la force de vie qui anime toute chose et nous invite à reconnaître sa présence.
Tout au long de son œuvre, Jürgen Moltmann a développé une théologie de la vie fondée sur la résurrection et manifestée dans une approche trinitaire. Il l’exprime bien cette démarche dans le titre de son dernier livre : « Le Dieu vivant et la plénitude de vie (5). « Ce que je souhaite faire ici est de présenter une transcendance qui ne supprime, ni n’aliène notre vie présente, mais qui libère et donne vie, une transcendance dont nous ne ressentions pas le besoin de nous détourner, mais qui nous remplisse de la joie de vivre » (p X).
Richard Rohr nous apporte une vision enthousiaste et libératrice de la présence divine en un Dieu trinitaire. « Dieu n’est pas un être parmi d’autres, mais plutôt l’Etre lui même qui se révèle… le Dieu dont Jésus parle et s’y inclut, est présenté comme un dialogue sans entrave, un flux inclusif et totalement positif, la roue d’un moulin à eau qui répand un amour que rien ne peut arrêter » (p 43).
Cette reconnaissance de la vie divine rejoint celle à laquelle nous appelle Bertrand Vergely dans son livre : « Prier, une philosophie ».
« Il y a en nous une présence faisant écho à ce que nous avons de plus sensible et de plus profond, d’où la justesse de parler d’une divine présence ». « Laissons passer le vivant… Quand on vit, il n’y a pas que ce que nous vivons. Il y a la Vie qui se vit en nous et qui nous veut vivant » (p 237 et 220).
J H
(1) « Une nouvelle manière d’être et de connaître ». (Michel Serres. Petite Poucette) : https://vivreetesperer.com/?p=836
(2) Jürgen Moltmann. Dieu dans la création. Traité écologique de la création. Cerf, 1988
(3) Bertrand Vergely. Prier, une philosophie. Carnetsnord, 2017
(4) Richard Rohr. With Mike Morrell. The Divine Dance. The Trinity and your transformation. SPCK, 2016. Mise en perspective sur ce blog : https://vivreetesperer.com/?p=2758
(5) Jürgen Moltmann. The living God and the fullness of life. World Council of Churches, 2016 Mise en perspective sur ce blog : https://vivreetesperer.com/?p=2697 et https://vivreetesperer.com/?p=2413
(6) Jürgen Moltmann. L’Esprit qui donne la vie. Une pneumatologie intégrale. Cerf, 1999
(7) « Un Esprit sans frontières » : https://vivreetesperer.com/?p=2751
Voir aussi : « L’émerveillement est le fondement de l’existence. Propos de Bertrand Vergely » : https://vivreetesperer.com/?p=1089
Odile Hassenforder. « La grâce d’exister » : https://vivreetesperer.com/?p=50
Jean-Claude Schwab. « Accéder au fondement de son existence » : https://vivreetesperer.com/?p=1295

par jean | Jan 10, 2024 | Vision et sens |
« Awe and amazement »
Un autre regard
Sur son site : “Center for action and contemplation”, Richard Rohr nous entraine dans une séquence sur les bienfaits de l’admiration et de l’émerveillement dans la vie spirituelle. Cette séquence est intitulée : « awe and amazement » (1)
Le sens du terme de « awe » a évolué dans le temps à partir d’un vocabulaire religieux où la révérence était accompagnée par une forme de crainte. Aujourd’hui, ce terme évoque admiration et émerveillement. Depuis le début de ce siècle, le phénomène correspondant est l’objet d’une recherche. Aujourd’hui, la « awe » attire l’attention des chercheurs en psychologie. Le ressenti de transcendance, qui s’est inscrit dans une histoire religieuse, est reconnu aujourd’hui dans le champ plus vaste de la quotidienneté. Ainsi, Dacher Keltner, professeur de psychologie à l’Université de Berkeley, a écrit un livre : « Awe. The new science of everyday wonder and how it can transform your life” (L’admiration. La nouvelle science du merveilleux au quotidien et comment elle peut transformer votre vie » (2).
Vouloir être surpris
« Willing to be amazed »
Richard Rohr se réfère à Abraham Joshua Heschel et il affirme que la « awe », l’admiration, l’émerveillement, l’’éblouissement sont des expériences spirituelles fondatrices. « Je crois que l’intuition religieuse fondatrice, première, basique est un moment de « awe » », un moment d’admiration et d’émerveillement. Nous disons : « O Dieu, que c’est beau ! ». Pourquoi évoquons si souvent Dieu lorsque nous avons de tels moments ? Je pense que c’est reconnaitre que c’est un moment divin. D’une certaine manière, nous avons conscience que c’est trop bon, trop beau… quand cette « awe », l’admiration éblouie, sont absents de notre vie, nous bâtissons notre religion sur des lois ou des rituels, essayant de fabriquer des moments de « awe ». Cela marche parfois… ».
Richard Rohr met ensuite en valeur les bienfaits de l’admiration et de l’émerveillement. « Les gens dont la vie est ouverte à l’admiration et l’émerveillement ont une « plus grande chance de rencontrer le saint , le sacré (« holy ») que quelqu’un qui va seulement à l’église, mais ne vit pas d’une manière ouverte. Nous avons presque domestiqué le sacré en le rendant si banal ». Richard Rohr marque sa crainte que cela se produise dans la manière dont nous ritualisons le culte. « Jour après jour, je vois des gens venir à l’église sans aucune ouverture à quelque chose de nouveau et de différent. Et si quelque chose de nouveau et de différent arrive, ils se replient dans leur vieille boite. Leur attitude semble être : « je ne serai pas impressionné par l’admiration et l’émerveillement ». Je ne pense pas que nous allions très loin avec cette résistance au nouveau, au Réel, au surprenant. C’est probablement pourquoi Dieu permet que nos plus belles relations commencent par un engouement pour une autre personne – et je n’entends pas seulement un engouement sexuel, mais une profonde admiration et considération. Cela nous permet de prendre notre place comme apprenant et étudiant. Si nous ne faisons pas cela, il ne va rien arriver ».
Plus largement, Richard Rohr évoque la pensée de l’écrivain russe, Alexandre Soljhenitsyne. « Il écrivait que le système occidental, dans son état actuel d’épuisement spirituel, ne paraissait pas attractif. C’est un jugement significatif. L’esprit occidental refuse presque à être encore en émerveillement. Il est seulement conscient de ce qui est mauvais et semble incapable de rejoindre ce qui est encore bon, vrai et beau. Le seul moyen de sortie se trouve dans une imagination nouvelle et une nouvelle cosmologie, suscitée par une expérience de Dieu positive. Finalement, l’éducation, la résolution de problèmes et une idéologie rigide sont toutes, en elles-mêmes, inadéquates pour créer une espérance et un sens cosmique. Seule « une grande religion » peut faire cela et c’est probablement pourquoi Jésus a passé une si grande partie de son ministère à essayer de réformer la religion ».
Richard Rohr peut ensuite évoquer ce qu’apporte une religion saine. « Elle nous donne un sens fondamental de « awe », un émerveillement éveillant la transcendance… Elle réenchante un univers autrement vide. Elle éveille chez les gens une révérence universelle envers toutes choses. C’est seulement dans une telle révérence que nous pouvons trouver confiance et cohérence. C’est seulement alors que le monde devient une maison « home » sure. Alors nous pouvons voir la réflexion de l’image divine dans l’humain, dans l’animal, dans le monde naturel entier, qui est alors devenu intrinsèquement surnaturel ».
Nous sommes ce que nous voyons
« We are what we see”
Selon Richard Rohr, la contemplation approfondit notre capacité à nous étonner, à être surpris. « Les moments d’admiration et d’émerveillement (awe and wonder) sont les seuls fondements solides pour notre sentiment et notre voyage religieux ». Le récit de l’Exode noue en apporte un bon exemple : « Ce récit commence avec l’histoire d’un meurtrier (Moïse) qui s‘enfuit des représailles de la loi et rencontre « un buisson paradoxal qui brule sans être consumé ». Touché par une crainte révérentielle (awe), Moïse enlève ses chaussures et la terre en dessous de ses pieds devient une terre sacrée » (holy ground » (Exode 3.2-6). Parce qu’il a rencontré « Celui qui est » (Being itself) (Exode 3.14). Ce récit manifeste un modèle classique répété sous des formes différentes dans des vies différentes et dans le vocabulaire de tous les mystiques du monde ».
Certes, il y a des obstacles. « Je dois reconnaitre que nous sommes généralement bloqués vis-à-vis d’une grand impression de « awe » comme nous le sommes vis-à-vis d’un grand amour ou d’une grande souffrance. La première étape de la contemplation porte largement sur l’identification et le relâchement de ces blocages en reconnaissant le réservoir d’attentes, de présuppositions, et de croyances dans lesquelles nous sommes déjà immergés. Si nous ne voyons pas ce qu’il y a dans notre réservoir, nous entendrons toutes les choses nouvelles de la même manière ancienne et rien de nouveau n’adviendra »… La contemplation remplit notre réservoir d’une eau pure et claire qui nous permet de réaliser des expériences en étant libérés de nos anciens schémas ».
De fait, ajoute Richard Rohr, nous ne nous rendons pas compte qu’au moins partiellement, notre réaction enthousiaste ou colérique , peureuse n’est pas entrainée uniquement par la personne ou la situation en face de nous. « Si la vue d’un beau ballon dans le ciel nous rend heureux, c’est que nous sommes déjà prédisposés au bonheur. Le ballon à air chaud nous fournit juste une occasion. Et presque n’importe quoi d’autre aurait produit la même impression. Comment nous voyons déterminera largement ce que nous voyons et si cela provoque en nous de la joie ou, au contraire, une attitude de repli émotionnel. Sans nier qu’il y ait une réalité extérieur objective, ce que nous sommes capable de voir dans le monde extérieur, et prédisposé en ce sens, est une réflexion en miroir de notre monde intérieur et état de conscience sur le moment. La plupart du temps, nous ne voyons pas du tout et opérons sur le mode d’un contrôle de croisière.
Il semble que nous, humains, sommes des miroirs à deux faces reflétant à la fois le monde intérieur et le monde extérieur. Nous nous projetons nous-mêmes sur les choses extérieures et ces mêmes choses nous renvoient au déploiement de notre propre identité. La mise en miroir est la manière dont les contemplatifs voient de sujet à sujet plutôt que de sujet à objet ».
Une « awe », émerveillement ébloui, qui connecte
« An awe that connects »
Richard Rohr fait appel à Judy Cannato qui met l’accent sur la surprise, l’ébahissement comme point de départ de la contemplation. « Dans son livre : « Le pleur silencieux », la théologienne allemande Dorothee Sölle écrit : « Je pense que chaque découverte du monde nous plonge dans la jubilation ; une surprise radicale qui déchire le voile de la trivialité ». Quand le voile est déchiré et que notre vision est claire, alors émerge la reconnaissance que toute vie est connectée – une vérité qui n’est pas seulement révélée par la science moderne, mais qui résonne avec les mystiques anciens. Nous sommes tous un, connectés et rassemblés dans un Saint Mystère, au sujet duquel, dans toute son ineffabilité, nous ne pouvons demeurer indifférents »
Or, d’après Sölle, la surprise, l’ébahissement est un point de départ. « Elle maintient qu’une surprise radicale est le point de départ pour la contemplation. Souvent, nous pensons que la contemplation appartient au domaine du religieux, à un stade ésotérique de prière avancée que seuls les gens spirituellement doués possèdent. Ce n’est pas le cas. La nature de la contemplation telle que je la décris ici est qu’elle demeure à l’intérieur de chacun de nous.
Pour utiliser une parole familière, la contemplation consiste à avoir un long regard amoureux vis-à-vis du réel. La posture contemplative qui découle d‘une surprise radicale, d’un ébahissement, nous attrape dans l’amour – l’Amour qui est le Créateur de tout ce qui est, le Saint Mystère qui ne cesse de surprendre, qui ne cesse de prodiguer l’amour en nous, sur nous, autour de nous ».
Mais comment reconnaitre et nous approcher du « réel » ? Judy Cannnato nous répond en ce sens. « La contemplation est un long regard d’amour sur ce qui est réel. Combien de fois ne sommes-nous pas trompés par ce qui imite le réel ? Vraiment nous vivons dans une culture qui affiche le faux et prospère dans une fabrication scintillante. Nous sommes tellement bombardés par le superficiel et le trivial que nous pouvons perdre nos appuis et nous abandonner à un genre de vie qui nous vide de notre humanité… Quand nous nous engageons dans une pratique de surprise radicale (« radical amazement »), nous commençons à distinguer ce qui est authentique de ce qui est frelaté.
Saisis par la conscience contemplative et enracinés dans l’amour, nous commençons à nous libérer de nos conditionnements culturels et à embrasser la vérité qui demeure au cœur de toute réalité : nous sommes un ».
Ainsi la contemplation n’est pas réservée à une élite religieuse ou spirituelle, elle donne à voir à tous. « Ce qui devient plus apparent aujourd’hui, c’est que nous devons devenir des contemplatifs, pas seulement dans la manière où nous réfléchissons ou prions, mais dans la manière où nous vivons éveillés, alertes, engagés, prêts à répondre aux gémissements de la création ».
La dignité de toutes choses
« The dignity of all things”
Le rabbin Abraham Joshua Heschel est connu pour son action prophétique et pour son engagement en faveur d’une surprise radicale. Le théologien Bruce Epperly explique :
« Au cœur de la vision mystique d’Heschel, il y a l’expérience d’une surprise radicale. La merveille est essentielle à la fois pour la spiritualité et la théologie. La « awe », émerveillement ébloui, donne le sens de la transcendance. Elle nous permet de percevoir les signes du divin dans le monde. La merveille mène à la surprise radicale dans l’univers de Dieu. Créé à l’image de Dieu, chacun de nous est surprenant. La merveille mène à la spiritualité et à l’éthique. Comme Heshel le déclare : « Simplement être est une bénédiction. Simplement vivre est saint. Le moment est la merveille ».
Comment cette sensibilité affecte-t ’elle notre vision du monde ? Elle fonde la vision du monde d’Heshel. « Le monde se présente à moi de deux manières : comme une chose que je possède ; comme un mystère qui se présente à moi. Ce que je possède est une bagatelle ; ce qui se présente à moi est sublime. Je prends soin de ne pas gaspiller ce que possède ; je dois apprendre à ne pas manquer ce qui se présente à moi.
Nous traitons ce qui est accessible à la surface du monde ; Nous devons également nous tenir en révérence (« awe ») vis-à-vis du mystère du monde »
Reprenons donc notre approche de la « awe », de l’émerveillement ébloui.
« La « awe » est plus qu’une émotion. C’est une manière de comprendre, une entrée dans un sens plus grand que nous. Le commencement de la « awe », c’est reconnaitre la merveille, s’émerveiller ». Et « le commencement de la sagesse est la « awe », cet émerveillement ébloui et révérenciel. « La « awe » est une intuition de la dignité de toutes choses. C’est réaliser que les choses ne sont pas seulement ce qu’elles sont, mais qu’elles se tiennent là, quelqu’en soit l’éloignement, pour signifier quelque chose de suprême.
L’« awe » est un sens du mystère au-delà de toute chose. Elle nous permet de sentir dans les petites choses le début d’un sens infini, de sentir l’ultime dans le commun et le simple ; de sentir le calme de l’éternel dans la précipitation de ce qui passe. Nous ne pouvons pas comprendre cela par l’analyse ; Nous en devenons conscient par la « awe ». Voilà aussi un éclairage pour la foi : « la foi n’est pas une croyance, l’adhésion à une proposition. La foi est un attachement à la transcendance, au sens au-delà du mystère… La « awe » précède la foi. Elle est à la racine de la foi… »
C’est dire combien la « awe » est fondamentale. « Si notre capacité de révérence diminue, l’univers devient pour nous un marché. Un retour à la révérence est le premier prérequis pour un réveil de la sagesse, pour la découverte du monde comme une allusion à Dieu ».
La pratique spirituelle de la « awe ».
« The spiritual practice of awe”
Comment pouvons-nous vivre dans un état d’esprit d’émerveillement porteur d’une pratique spirituelle ? La question est posée à Cole Arthur Riley, écrivain et liturgiste. Il nous décrit « la « awe » comme une pratique spirituelle ». « Je pense que la « awe » est un exercice à la fois dans le faire et l’être. C’est un muscle spirituel de l’humanité que nous pouvons empêcher de s’atrophier si nous l’exerçons habituellement. Je m’assois dans la clairière derrière ma maison écoutant le chant des hirondelles rustiques se mêlant au bruit des voitures accélérant. J’observe le courant de lait dans mon thé et les petites feuilles danser librement hors de leur enclos… Quand je parle de merveille, j’entends la pratique de contempler le beau. Contempler le majestueux – le sommet enneigé des Himalayas, le soleil se couchant sur la mer – mais aussi les petits spectacles du quotidien… Plus que dans les grandes beautés de nos vies, la merveille réside dans notre présence d’attention à l’ordinaire. On peut dire que trouver la beauté dans l’ordinaire est un exercice plus profond que grimper dans les montagnes… Rencontrer le saint, le sacré dans l’ordinaire, c’est trouver Dieu dans le liminal, la marge d’où nous pourrions inconsciemment l’exclure… »
Arthur Riley décrit comment l’émerveillement développe la capacité de nous aimer, d’aimer notre prochain, d’aimer l’étranger. « L’émerveillement inclut la capacité d’être en « awe », en émerveillement vis-à-vis de nous-même » Arthur Riley nous incite à être attentif à la vie quotidienne. « Qu’à chaque seconde, nos organes et nos os nous soutiennent est un miracle. Quand nos os guérissent, quand nos blessures se cicatrisent, c’est un appel à nous émerveiller de nos corps – leur régénération, leur stabilité et leur fragilité. Cela fait grandir notre sentiment de dignité. Être capable de s’émerveiller du visage de notre prochain, avec la même « awe », le même émerveillement que nous avons pour le sommet des montagne ou la réflexion du soleil, c’est une manière de voir qui nous empêche de nous détruire les uns les autres ». L’émerveillement, ce n’est pas nous dissoudre, mais nous sentir vivement dans notre connexion avec chaque créature. « Dans un saint émerveillement, nous faisons partie de l’histoire ».
Le privilège de la vie elle-même
« The privilege of life itself”
Ici Richard Rohr s’est adressé à Brian McLaren pour lequel l’émerveillement, la « awe » sont essentiel pour rencontrer la création. « Les premières pages de la Bible et les meilleures réflexions des scientifiques actuels sont en plein accord. Au commencement, tout a commencé quand l’espace et le temps, l’énergie et la matière, la gravité et la lumière sont apparus dans une soudaine expansion. A la lumière du récit de la Genèse, nous dirions que la possibilité de l’univers s’est épanchée dans l’actualité comme Dieu, l’Esprit créateur, prononçait l’invitation première, originale : Qu’il en soit ainsi ! (« Let it be »). Et, en réponse, qu’est-ce-qui est arrivé ? La lumière, le temps , l’espace, la matière, le mouvement, la mer, la pierre, le poisson, le moineau, vous, moi, nous réjouissant de ce don inexprimable, ce privilège d’être ici, d’être en vie », Brian McLaren évoque la beauté qu’on peut entrevoir dans la diversité des dons et des talents. Comme les autres auteurs présents dans cette séquence, il exprime son admiration pour la création. « Est-ce que nous ne nous sentons pas comme des poètes qui essaient d’exprimer la beauté et la merveille de cette création ? Est-ce que nous ne partageons pas une commune stupeur en envisageant notre voisinage cosmique et en nous éveillant au fait que nous sommes réellement là, réellement vivant, juste maintenant ? ». Brin McLaren nous entraine dans l’admiration et l’émerveillement vis-à-vis des merveilles de la montagne et de la mer jusqu’à « regarder avec délice un simple oiseau, un arbre, une feuille ou un ami et à sentir qu’ils murmurent au sujet du créateur, de la source de tout ce que nous partageons ».
En exprimant cette admiration, cette « awe » vis-à-vis de toutes les merveilles qu’on peut entrevoir, Brian McLaren, théologien engagé, ne perd pas de vue les maux de nos sociétés et la nécessité de nous y confronter (3). Mais, dans sa vision enthousiaste, il s’appuie sur un fondement biblique. « La Genèse » signifie : commencements. Elle parle à travers une poésie profonde, à plusieurs couches, et des histoires anciennes et sauvages. La poésie et les récits de la Genèse révèlent des vérités profondes qui nous aident à être plus pleinement vivants aujourd’hui. Elles osent proclamer que l’univers est l’expression de Dieu lui-même. La parole de Dieu agit. Cela signifie que toute chose, partout, est toujours sainte, spirituelle, ayant de la valeur, signifiante. Toute matière importe. La Genèse décrit la grande bonté qui apparait à la suite d’un long processus de création. Cet ensemble harmonieux est si bon que le Créateur prend un jour de congé, juste pour s’en réjouir. Ce jour de repos en réjouissance nous dit que le but de l’existence n’est pas l’argent ou le pouvoir ou la renommée, ou la sécurité ou quoique ce soit moins que ceci : participer à la bonté, à la beauté et à la vitalité de la création.
Un autre regard
Les représentations du monde sont multiples en étant influencées par de nombreux facteurs et, tout particulièrement par ce que nous entendons des évènements. Cette séquence inspirée par Richard Rohr est intitulée : « awe and amazement » ; elle nous apprend à nous émerveiller, tout éblouis par les merveilles qui se présentent à nous, à ciel ouvert, mais aussi au départ dissimulées, cachées à nos yeux parce que nous n’y prêtons pas attention. Ce mouvement d’émerveillement exprimé par le terme « awe », dont le sens s’est déplacé à travers l’histoire de « crainte révérentielle » dans un contexte religieux à un émerveillement ébloui accompagné par un sentiment d’ouverture à la transcendance, doit être aujourd’hui pleinement reconnu. Par-delà des apparences souvent trompeuses ou l’assujettissement à de sombres situations, nous sommes appelés à reconnaitre dans la contemplation une Réalité spirituelle, une présence divine. Cet éclairage, et parfois cette illumination peuvent nous surprendre. Cependant, ce sentiment d’admiration, cette « awe », ne sont pas réservés à des moments privilégiés. On peut les éprouver dans le quotidien et même en regardant de belles photos comme l’écrit le rabbin Hara Person dans un texte final : « une part de beauté » (« A slice of beauty »). Bref, au total, nous sommes conviés à un autre regard.
Sans expertise professionnelle de la traduction, rapporté par J H
- Awe and amazement. Avec la présentation et la référence des six textes constituant la séquence : https://cac.org/daily-meditations/awe-and-amazement-weekly-summary/
- Comment la manifestation de l’admiration et de l’émerveillement exprimée par le terme « awe » peut transformer nos vies : https://vivreetesperer.com/comment-la-reconnaissance-et-la-manifestation-de-ladmiration-et-de-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-peut-transformer-nos-vies/
- Reconnaitre aujourd’hui un mouvement émergent pour la justice dans une inspiration de long cours : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-aujourdhui-un-mouvement-emergent-pour-la-justice-dans-une-inspiration-de-long-cours/
On pourra lire aussi :
La participation des expériences spirituelles à la conscience écologique : https://vivreetesperer.com/la-participation-des-experiences-spirituelles-a-la-conscience-ecologique/
Avoir de la gratitude :
https://vivreetesperer.com/avoir-de-la-gratitude/