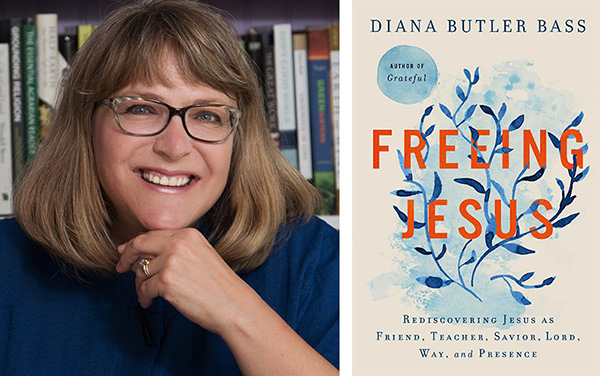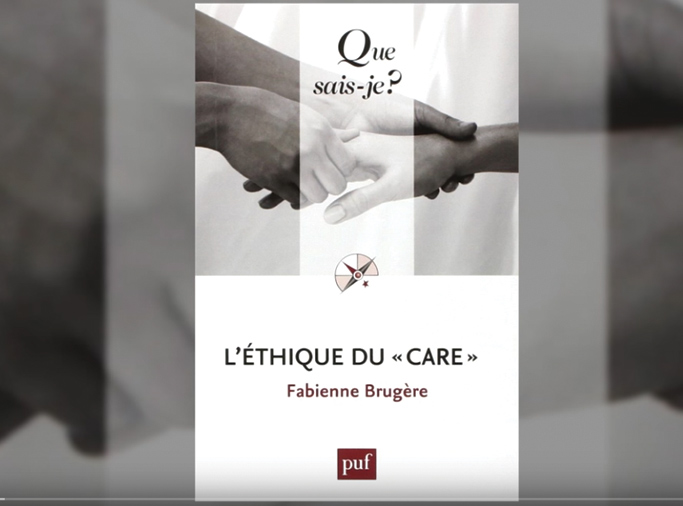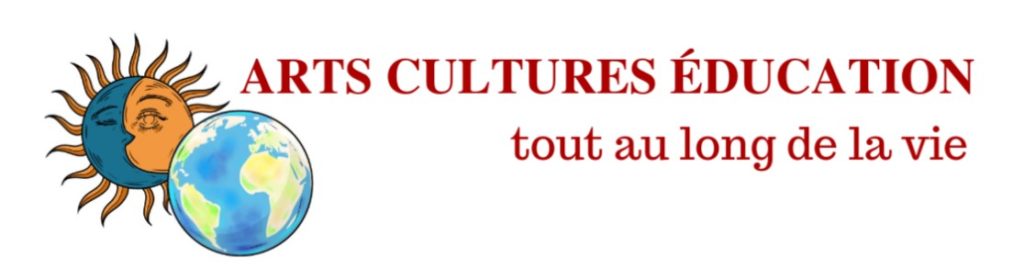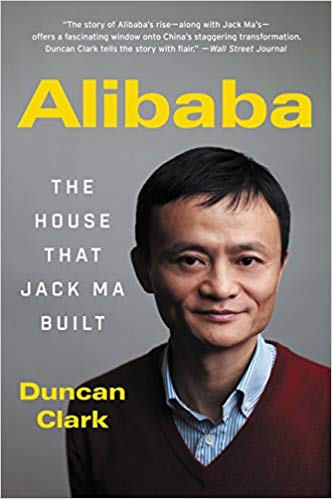Un usage de facebook
L’usage d‘internet a transformé entièrement notre genre de vie dans la plupart de secteurs de notre activité du travail et de commerce à l’information aux loisirs. On pourrait énumérer les cas où il s’est révélé ou se révèle indispensable. Cependant, on peut sans doute se demander s’il n’y a pas là aussi un revers de la médaille. Effectivement, on redoute aujourd’hui la dépendance que l’usage d’internet peut susciter jusqu’à un effet d’addiction. C’est la crainte exprimée par Sophie Lavault, docteure en neurosciences et psychologie clinique. « L’hyper connectivité nous procure tant de shoots de dopamine qu’elle nous coupe du lien authentique avec nous-mêmes et avec les autres ; sous l’emprise de nos écrans, nous ne prenons plus le temps de ressentir, ni d’observer. Déconnectés de notre propre corps, nous le sommes de notre environnement naturel au point de détruire plutôt que de préserver ». Aussi a-t-elle écrit un livre qui engage à « revenir à soi » (1). De même, si on peut reconnaitre, pour une part, dans la montée des réseaux sociaux , une extension des liens sociaux et une émergence de conscience commune, on peut également redouter y voir apparaitre la formation de clans, une agressivité mimétique, une violence numérique, une manipulation de l’information. Nous sommes interpellés.
On connait aujourd’hui l’extension et la répartition des réseaux sociaux dans le monde. Si Facebook est le réseau social le plus fréquenté dans le monde avec près de 3000 milliards d’utilisateurs actifs mensuels en 2023, en France, il totalise 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Si il est en perte de vitesse parmi les plus jeunes, passant au cinquième rang des réseaux fréquentés chez les 18-24 ans, il continue une légère progression chez les plus âgés (2).
Dans ce grand nombre d’usagers, chacun est singulier dans sa fréquentation. Comme les interpellations vis-à-vis de l’utilisation d’internet s’adresse à tous, chacun peut également y apporter une réponse personnelle. Nous nous sommes interrogés sur notre propre usage de Facebook.
Contexte de notre présence sur Facebook
Facebook se présente ainsi : « Facebook est un réseau social grand public. Il permet à ses utilisateurs de rester en contact avec leurs amis, familles, connaissances, en interagissant grâce à des publication, des commentaires, des likes, de participer à des groupes en fonction de leurs intérêts ». Nous sommes entrés sur Facebook, il y a une douzaine d’années, engagé dans une recherche personnelle se traduisant par une écriture pour un blog : « Vivre et espérer », et, à l’époque, la mise en valeur de l’œuvre du théologien ; Jürgen Moltmann dans un autre blog : « L’Esprit qui donne la vie ». Parallèlement, depuis des années, nous participions au site de Témoins, association chrétienne interconfessionnelle. En entrant dans Facebook, nous souhaitions y trouver, pour une part, un espace de dialogue. Dans une condition de veuvage, pouvoir élargir mon éventail de relations était également un souhait. Cependant, je ressentis très tôt ma particularité d’arrivant relativement isolé. De nombreux participants fréquentaient Facebook avec un réseau bien constitué, y partageant les apports de leurs loisirs, notamment de leurs vacances, parfois des réflexions ou des émotions. J’en étais un spectateur bienveillant et reconnaissant pour la vie bonne qui s’y exprimait. Progressivement, je découvris la vie des uns et des autres et à travers les « j’aime », une attention plus ou moins mutuelle put s’instaurer. A travers les demandes, le public s‘élargit puisqu’il compte aujourd’hui 530 amis. On doit dire ici également que mon savoir-faire dans l’usage de Facebook est limité. Par exemple, je ne recours pas à la messagerie : Messenger.
Aujourd’hui, depuis quatre ans, relégué dans un Ehpad, à la suite d’un covid, puis de l’épidémie et de l’impossibilité de retrouver mon genre de vie initial, mon isolement s’est accru. Mais Facebook s’avère alors véritablement secourable par l’accès ouvert sur la nature et sur l’art par de magnifiques photos et par une ambiance bienveillante. Et il continue à être une source d’information très efficace où je puise abondamment tant pour mes choix de livres que pour ma participation à Témoins. A plusieurs reprises, j’ai relaté sur ce blog, mon usage de Facebook (3). Ce furent des étapes dans l’expression de mon ressenti. Je réitère ici avec un peu plus de recul.
Une ouverture à la beauté
Comment est-ce que je perçois les principaux apports de mon fil Facebook?
Un des apports majeurs, c’est une ouverture à la beauté au moins sous un double aspect : la beauté de la nature et la beauté des œuvres d’art. Nombreux sont les ami(e)s qui partagent des photos de paysage, aujourd’hui entre autres, L P , JM T , F S , N H , L P…Plus largement, ce sont des photos de nature, comme des fleurs. Je pense actuellement à de superbes photos de montagne. On peut admirer aussi des photos d’un auteur de livres publiant de sublimes photos de paysages méridionaux, de la Drome notamment, D Massivement, les organismes de tourisme de toutes les régions de France diffusent de magnifiques photos de paysage. Je revisite ainsi un pays que j’ai aimé et admiré: le golfe du Morbihan. Cependant circulent aussi de nombreuses peintures de paysage. J’ai découvert ainsi le grand nombre et la variété des peintures de Claude Monet, ébloui par l’expression de son ressenti, une beauté toujours actuelle. Mais la proposition est variée et je trouve des perles dans les multiples expressions actuelles de l’art naïf. Certains nous font connaitre des peintures peu connues d’autres pays européens ( P S)
Expressions de vie
Le philosophe et sociologue, Charles Taylor, nous a montré comment nous sommes entrés dans un âge de l’authenticité (4). « Les historiens et sociologues s’accordent pour reconnaitre un tournant majeur dans la vie sociale et culturelle des pays occidentaux dans les année 60…L’individualisme s’est désormais déplacé sur un axe nouveau sans abandonner les anciens pour autant. En plus de l’individualisme moral/spirituel et instrumental se répand désormais un individualisme « expressif ». Cette expressivité, cette expression de soi est très présente sur Facebook. Certes, elle prend des formes différentes. Certains sont discrets, d’autres expriment leurs états d’âme. Cependant, communiquer sur Facebook, c’est évidemment exprimer ce qui vous tient à cœur sur différents registres. Mais cette expression est tournée vers le partage. Pour certains, cette expressivité se manifeste dans une manifestation de leur vie personnelle. Ainsi, une « amie » anglaise J E , partage non seulement de belles contributions picturales, mais elle nous associe à sa vie quotidienne et à son histoire familiale. Sensible au visage de l’humain, elle aime partager des photos de ceux qui l’entourent. D’autres expressions sont plus discrètes. Ainsi, MF R nous fait découvrir la beauté dans sa campagne, mais exprime aussi sa vision de la vie. Et P S ne nous entretient pas seulement de la vie de sa province, mais il participe à un site protestant et, de temps à autres, laisse transparaitre ses opinions politiques.
Propositions spirituelles et religieuses
La part des relations chrétiennes, catholiques et protestantes ou autres, est ici importante au point où il est difficile de toutes les mentionner. Il y a donc des commentaires journaliers d’évangile ( J T et M CT), de nombreux commentaires bibliques (Reg P, Prot B, L P), des messages d’ouverture chrétienne (C C M J) des textes engagés concernant la vie des églises ( R P, C P, A S, Conf bapt, , H L… ) Bien sûr, il se trouve des réflexions théologiques ( Transcend , P L , J C, DF) de libres expressions (M M, J C S, MH M C, H RG ), des témoignages d’acteurs engagés ( R G , B C) On peut ajourer à ce groupe des acteurs spirituels comme Hum N et ses interviews en vidéo, D GQ et ses dialogues en quête spirituelle ou encore JP O.. On ajoutera ce qui tient aux relations entre psychologie et spiritualité. La poésie est également très présente, notamment dans écrits de Christian Bobin et de Jean Lavoué. Ajoutons à cette énumération très vaste et qui parait fastidieuse en l’absence des noms et des contenus, l’apport de B C qui se manifeste en terme d’un flux de vidéos et de textes qui concernent à la fois le religieux et le politique . L’offre est conséquente et, dans cet ensemble, des affinités peuvent s’établir. De temps à autre, une lueur vient nous éveiller De plus, nous pouvons recueillir là nombre d’informations pour le site de Témoins
Vie sociale, économique et politique
La vie sociale, économique et politique apparait à travers la contribution de quelques ami(e)s et quelques publicités d’organisme. Sur notre fil, ce secteur a une place seconde. Parmi les thèmes abordés, l’écologie occupe une place majeure. Les grands évènements se répercutent très vite, notamment l’information concernant les décès de grandes personnalités. Il me semble que les questions politiques se manifestent très différemment selon les périodes. Actuellement, leur présence ne me parait pas à la mesure des enjeux. Notons à nouveau la richesse du flux de vidéos et de textes communiqués par B C. C‘est un apport précieux.
Les vidéos
Facebook comporte également une rubrique vidéos, mais celles-ci ne sont pas choisies par des « ami(e)s. Elles sont très variées quant à leurs origines et à leurs sujets. Ainsi elles concernent-elles la vie des animaux, les relations humaines, la psychologie, la philosophie, les sciences, le message chrétien dans ses différentes formes, voire un message musulman. La tonalité induit fréquemment des sentiments positifs : les vidéos de Thomas d’Ansembourg se proposent de nous aider à comprendre notre manière de vivre en relation., les courts interviews réalisées par Human Nadj auprès de personnes témoignent d’un humanisme psychologique et spirituel dans une sphère où la culture musulmane est bien représentées, des vidéos nous montrent une entraide chez des humains ou des animaux, la présentations d’initiatives humaine innovantes (Brut), des messages chrétiens de différents origine, notamment d’origine africaine entre autres l’Église méthodiste de Cote d’Ivoire, le récit d’expériences spirituelles, des messages qui nous apportent des visions nouvelle sur la conscience, la santé, l’histoire africaine.. C’est un espace de découverte. En ce moment, pourtant crucial, cette rubrique manifeste une grande discrétion sur le plan politique
Diversité
Notre description est incomplète . En présentant notre fil, nous avons choisi d’énoncer les noms par des initiales par discrétion et dans l’impossibilité d’une exhaustivité. Il y a des thèmes présents de temps en temps sur notre fil, notamment à travers des publicités d’organisme, comme la santé par exemple.
Facebook comme cadeau
A l’heure où les critiques se multiplient contre les réseaux comme propagateur de fausses nouvelles ou porteur de ségrégation sociale, notre expérience personnelle nous permet de mettre en évidence la diversité des situations
Il y a bien un premier enseignement qui apparait. Si le dispositif du réseau prédispose, l’usage personnel de chacun est déterminant.
Si Facebook encourage finalement une interaction positive à travers l’usage prédominant des « like », est-ce que nous-même, nous sentons-nous heureux de manifester abondamment notre attention, notre estime, notre sympathie. Tout en gardant une volonté de sincérité, j’ai choisi cette attitude, même si elle me semble peu payée de retour. A travers ce que les gens disent d’eux-mêmes et de leurs activités sur le fil Facebook, nous finissons par les connaitre pour une part. Et nous pouvons leur être reconnaissant, car, en s’exposant, ils nous accordent une part de confiance dans le partage de leurs joies et parfois de leurs inquiétudes et de leurs peines. Cela me fait penser au coq d’un livre d’enfant qui de son clocher, disant aux gens du village : « je t’ai vu ». Et bien à nous de faire le choix de la sympathie. Nous nous rappelons ici une pensée d’Antonio Spadaro dans son livre : « Quand la foi passe par le réseau ». Il nous appelle, dans un esprit de convivialité et de fraternité à faire évoluer le net d’un lieu de « connexion » à un lieu de « communion ». « La connexion en soi ne suffit pas à faire du Net un lieu de partage pleinement humain. Travailler en vue d’un tel partage est la tâche spécifique du chrétien » (5). Il y a la une exigence qui m’interpelle et qui m’invite à grandir spirituellement.
Cependant, il y a également dans l’offre de Facebook des propositions qui suscitent L’admiration, l’émerveillement, la « awe » (6) et, en conséquence, la reconnaissance, e la gratitude (7). Ce sont là deux réalités éminemment spirituelles et également bienfaisantes Certains paysages, certaines peintures nous paraissent admirables. Pour moi, cette admiration peut déboucher sur la louange et la reconnaissance. C’est la parole d’un psaume : « Que tes œuvres sont grandes, O Éternel. Et je chante avec allégresse l’ouvrage de tes mains » (Ps 92).
Cette offre est d’autant plus précieuse lorsqu’on vit dans un isolement relatif et qu’elle vient compenser des manques comme une accession difficile à la nature
On peut ajouter que Facebook permet aussi d’esquisser une forme de dialogue à travers des commentaires. C’est un germe de réflexion partagée
En manque
Certes, de nombreux messages appellent la réflexion. D’autres suggèrent une méditation. Mais, au total, sur notre fil, nous voyons peu de réflexions étayées, construites Nous y portons des extraits de textes des différentes rubriques de Vivre et espérer : histoires et projets de vie, expérience de vie et relation, culture et société, émergence écologique, vision et sens. Et nous abondons en même temps, notre page Facebook : Vivre et espérer. Dans ces textes, nous nous sommes donnés pour but d’apporter, de la manière la plus accessible possible, un éclairage qui puisse contribuer à rendre plus justes , plus pertinentes, nos représentations, en pensant que ces représentations ont ensuite des effets sur nos actes. Ainsi présentons-nous des livres français et étrangers qui s’appuient sur l’expérience de leurs auteurs, mais aussi sur des apports sociologiques, psychologiques, scientifiques, philosophiques et théologiques. Nous remercions les quelques-uns qui marquent leur appréciation de cet apport, souvent ou de temps à autre. Notre regret est que ces textes ne suscitent davantage d’attention dans un public qui, au total, apparait plutôt comme cultivé et spirituel. En regard, nous nous réjouissons de l’attention que certains portent aux photos de nature extraites de notre collection de photos flickr
Se remettre en question
Lorsque Sophie Lavault nous met en garde vis-à-vis de l’hyperconnectivité et, en conséquence un danger d’addiction et de déconnexion avec soi-même, lorsqu’on y réfléchit, c’est notre propre usage d’internet qui est mis en question. Je m’interroge sur mon usage de Facebook. Certes, dans ma condition, il m’apporte un lien essentiel avec la nature et avec la vie sociale. Il suscite des sentiments qui fondent la vie comme la sympathie, l’émerveillement, la gratitude. Le danger réside dans une consultation accélérée : passer d’un post à un autre sans prendre le temps suffisant pour le gouter. Il y a un risque de banalisation qui entrainerait un émoussement de notre émerveillement. ou de notre attention. Lorsque Saint-Exupéry écrit le « Petit Prince », il nous montre combien l’édification d’un lien requiert un apprivoisement lequel requiert du temps. Si nous passons trop rapidement d’une perle à une autre, il y a danger de banalisation. « Ralentir pour sentir », c’est l’expression qui sert d’identifiant à un « ami » de Facebook. Je me suis rendu compte combien il était bienfaisant de m’attarder sur une belle photo et de la contempler. La même attitude vaut pour notre attention aux moments de vie qui nous sont présentés sur Facebook et sur les sentiments qui y sont évoqués. Dans quelle mesure, ma louange ou ma prière sont-elles mobilisées ?
A deux reprises, sur ce blog, je me suis interrogé sur mon usage de Facebook (3) Sans doute, la perception de cet usage varie selon la condition du moment. Aujourd’hui, je mesure le cadeau qui m’est fait, et qui, quelles qu’en soient les limites, m’appelle à en faire un sage usage et à en prendre soin.
J H
- Sophie Lavault. Revenir à soi Comment le numérique nous déconnecte de nous-mêmes. Albin Michel. 2023
- Facebook : les chiffres essentiels : https://blog.digimind.com/fr/agences/facebook-chiffres-essentiels
- Mon expérience de Facebook 2017 https://vivreetesperer.com/mon-experience-de-facebook/ Facebook en question 2020 : https://vivreetesperer.com/facebook-en-question/
- L’âge de l’authenticité : https://www.temoins.com/lage-de-lauthenticite/
- Cyberespace et théologie : https://www.temoins.com/cyberespace-et-theologie/
- Ebloui par l’émerveillement : https://vivreetesperer.com/ebloui-par-lemerveillement/ Comment la manifestation de l’admiration et de l’émerveillement exprimées par le terme de « awe » peut transformer nos vies : https://vivreetesperer.com/comment-la-reconnaissance-et-la-manifestation-de-ladmiration-et-de-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-peut-transformer-nos-vies/
- La gratitude, un mouvement de vie : https://vivreetesperer.com/la-gratitude-un-mouvement-de-vie/
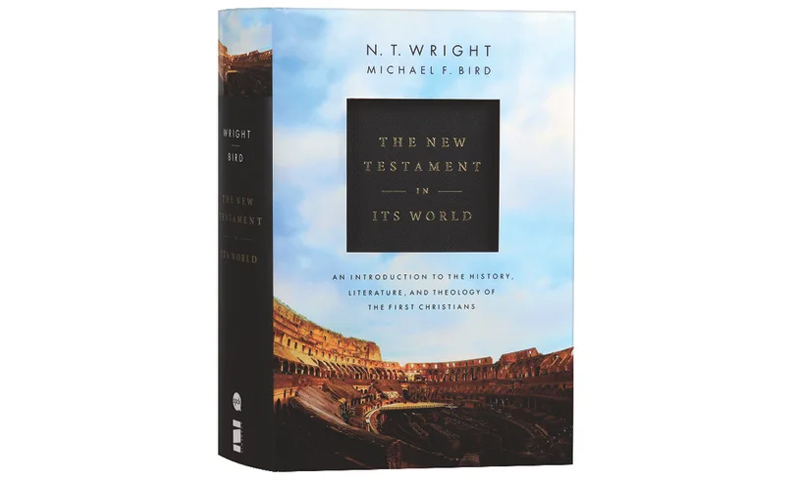
La vision du monde selon le Nouveau Testament
D’après N T Wright, exégète et théologien anglais
Au départ, dans les années 1970, N T Wright (1) est un exégète innovant qui prend en compte le milieu et la culture de l’époque où Jésus a vécu et où l’Évangile s’est propagé. Son parcours s’est poursuivi dans des fonctions pastorales. De 2003 à 2010, il est évêque anglican de Durham. N T Wright a écrit de nombreux livres. Il présente dans leur contexte les livres du Nouveau Testament pour le grand public. Théologien, il met l’accent sur le rôle majeur de Paul (2). Il proclame la réalité fondamentale de la résurrection. Il présente la foi chrétienne à un grand public dans une vision dynamique. Ainsi, dans un livre bien accueilli : « Surprised by Hope », Wright met en avant l’accent sur la Résurrection comme un fondement de l’espérance partagée par tous les chrétiens. Il critique la polarisation sur une conception du salut comme « aller au ciel quand vous mourrez ». Il s’élève contre la doctrine de « l’enlèvement de l’Église », prisée par certains milieux aux Etats-Unis.
Or, en 2019, NT Wright, avec Michaël F Bird vient de réaliser une grande œuvre, un livre de près de mille pages, une « introduction à l’histoire, à la littérature et à la théologie des premiers chrétiens » : « The New Testament and its world » (le Nouveau Testament et son monde » (3). Ce livre est « votre chemin de passage du XXIè siècle à l’ère de Jésus et des premiers chrétiens ». Il « replace le Nouveau Testament et le premier christianisme dans son contexte original ». « Rassemblant plusieurs décennies de la recherche innovante de NT Wright, cet ouvrage présente les livres du Nouveau Testament comme un phénomène historique, littéraire et social localisé dans le monde du judaïsme du Second Temple au milieu de l’univers politique et culturel gréco-romain et à l’intérieur du premier christianisme ». (Page de couverture). Un commentateur peut écrire : « « La grande et hardie interprétation du Nouveau Testament construite par NT Wright parait ici dans un volume accessible ». Cet ouvrage est donc destiné à nous permettre de lire intelligemment le Nouveau Testament, mais son auteur NT Wright désire également que cette lecture compte pour nous aujourd’hui : « Making the New Testament matter for today » (p 878). Ainsi, le dernier chapitre s’intitule : « Bringing it all together ». En quoi tout ceci nous concerne et importe pour nous ? Nous débouchons ici sur une vision du monde.
Rendre le Nouveau Testament pertinent pour aujourd’hui
« Naturellement, le Nouveau Testament porte une foi à confesser ». Cependant, « la vérité dont parle le Nouveau Testament est toujours profondément personnelle. C’est une personne, Jésus, le Messie d’Israël et le Seigneur du monde, Celui dans lequel la vérité de Dieu est incarnée et son projet accompli. En dernière analyse, la vérité biblique n’est pas une série de propositions à mettre dans leur ordre logique. C’est une l’histoire, une histoire qui culmine dans le Messie d’Israël, Jésus, et trouve son issue ultime dans la nouvelle création finale » (p 879). NT Wright situe le Nouveau Testament par rapport à l’Ancien. Les citations de ce dernier ne sont pas tant un mode de preuve. « Les premiers chrétiens se virent eux-mêmes comme s’inscrivant dans des récits de création, l’exil d’Israël et l’espoir d’un nouvel exode dans le récit de l’évangile de l’église »… Ainsi, « Abraham s’inscrit dans une grande histoire, celle d’Israël de telle manière qu’Abraham est le point de départ de l’opération divine de sauvetage, le Messie étant la conclusion dramatique et inattendue en charge de mettre le tout en pratique. La communauté croyante est le peuple à la dimension du monde sous la conduite de l’Esprit ». L’auteur s’interroge sur les résistances de certains vis-à-vis de ce narratif, soit qu’il leur apparaisse comme réduisant la grâce à un simple surplus d’un progrès historique immanent, soit qu’il soit confondu avec une pensée Hégélienne. Mais « quand nous saisissons le monde de la pensée et particulièrement le monde narratif du Second Temple, des juifs, tels que Paul, Pierre et Jean…. nous voyons comment, pour eux, la bonne nouvelle de Jésus le Messie, crucifié et ressuscité faisait sens dans ce monde. Leurs allusions à Adam, Abraham et Israël n’étaient pas des preuves auxquelles ils faisaient appel. Ils savaient plutôt qu’ils puisaient dans une histoire singulière, linéaire. Par exemple, Abraham était perçu comme le commencement de la réponse divine à Adam nécessitant une pleine réponse dans l’accomplissement ultérieur du Messie. De surcroit, il y a une étroite connexion entre Abraham et la maison de David »… « il y a le sens qu’Esaïe 40-55 est maintenant devenu vrai en Jésus et est maintenant en train de devenir vrai dans l’église conduite par l’Esprit. L’œuvre du « serviteur » a accompli le projet divin de mettre fin au long exil d’Israël et de restaurer la création elle-même ». NT Wright met en évidence les oublis qui ont longtemps affecté l’exégèse occidentale et engendré une perte de sens : on avait perdu de vue que « le projet de Dieu à travers Abraham était de sauver la race humaine » et que, pour ce sauvetage, Dieu travaillait à l’intérieur de la création à travers ses « porteurs d’image (« image-bearers ») si bien que sauver les humains du péché et de la mort n’était pas accompli pour leurs seuls bénéfices, mais, de telle manière qu’à travers des humains renouvelés, Dieu sauve la création elle-même ». A la suite des exils d’Israël et des souffrances engendrées, le nouvel exode est le sauvetage d’Israël – dans la personne du Messie qui a vaincu la puissance des ténèbres et est ressuscité des morts – et, avec cela, le sauvetage de la race humaine dans son ensemble » (p 880).
Quelle vision du monde ?
« La théologie chrétienne est une théologie narrative (storied theology). Elle parle d’un grand narratif au sujet de Dieu et de la relation de Dieu avec le monde de la création à la nouvelle création avec Jésus au milieu… le narratif concerne un créateur et sa création : des humains faits à l’image du créateur et appelés à réaliser certaines tâches ». Le créateur a agi pour remédier à la rébellion des humains, à travers Israël et à l’extrême à travers Jésus. L’histoire continu : « Le créateur agit par son Esprit dans le monde pour y apporter sa restauration et une nouvelle floraison, ce qui est son but ».
Cependant, « ce narratif constitue également une vision du monde, une manière de comprendre les réalités et les relations dans le monde comme nous les percevons ». « Une vision du monde n’est pas ce que nous regardons, mais ce à travers quoi nous regardons. Elle génère une représentation de la manière dont nous devrions vivre dans le monde et, par-dessus tout, le sens de l’identité et de la place qui permet à des êtres humains d’être ce qu’ils sont. Les visions du monde procurent des réponses généralement non définies et implicites, mais d’autant plus puissantes pour des questions qui commencent avec : « qui ? », « où ? », et « quoi ? », « comment ? », et « quand ? ». Des croyances et des actions émergent de cette combinaison sous-jacente de récits, de symboles, de pratiques, et de questions qui constituent la vision du monde » (p 881).
NT Wright présente alors les réponses apportées par la théologie chrétienne à ces cinq questions qui fondent une vision du monde.
° Qui sommes-nous ? « Nous sommes des humains faits à l’image du créateur. Nous avons des responsabilités vocationnelles qui correspondent à ce statut. Fondamentalement, nous ne sommes pas déterminés par la race, le genre, la classe sociale, la localisation géographique, et nous ne sommes pas de simples pions dans un jeu déterministe ».
° Où sommes-nous ? « Nous sommes dans un monde bon et beau bien que passager, la création de Dieu dans l’image duquel nous sommes faits. Nous ne sommes pas dans un monde étranger et hostile (comme les gnostiques l’imaginent), ni dans un cosmos auquel nous devons allégeance comme à un être divin (comme les panthéistes le suggéreraient) et non plus dans un monde dépourvu de sens (comme l’épicurianisme, ancien et moderne, le suggère) ».
° Qu’est ce qui est mauvais ? « L’humanité s’est rebellée contre le créateur. Cette rébellion reflète une dislocation cosmique entre le créateur et la création et le monde est en conséquence désaccordée avec son intention créatrice. Une vision chrétienne du monde rejette le dualisme qui associe le mal à la création et à la nature physique. Elle rejette également le monisme qui analyse le mal simplement en terme de quelques humains en partie désaccordés avec leur environnement. Son analyse du mal est plus subtile et va plus loin… » Elle refuse également d’ériger en vérité des analyses partielles comme celles de Marx et de Freud.
° Comment ceci peut être mis à l’endroit ? « Le créateur a agi, est agissant et agira à l’intérieur de sa création pour traiter avec le poids du mal amené par la rébellion humaine et ainsi ramener le monde à la finalité pour laquelle il a été fait, c’est-à-dire qu’il résonne pleinement avec sa présence et sa gloire. Naturellement, cette action trouve son centre, son moteur en Jésus et dans l’esprit du créateur ». Les solutions partielles sont écartées.
° Quelle heure est-il ? « De l’ancien Israël aux juifs du second Temple et jusque dans le premier christianisme, il y a toujours eu un sens de là où nous sommes dans l’histoire. Du point de vue chrétien, nous sommes dans le temps de l’accomplissement, le temps où le royaume de Dieu a déjà été lancé d’une façon décisive sur terre comme au ciel à travers l’œuvre de Jésus lui-même. Toutes choses, y compris la mort, sont soumises à son règne. C’est le cinquième acte de la scène cosmique de cinq actes qui commença avec la création, continue avec la rébellion humaine, a vu l’appel d’Abraham et de sa famille, et puis a vu cela porter le fruit ultime en Jésus. L’église menée par l’esprit est appelée à vivre la vie humaine authentique anticipant dans le présent la vie de « l’âge à venir », dans la libération de la puissance du mal qui a été lancée par la mort et la résurrection de Jésus » (p 882).
N T Wright nous montre en quoi la vision du monde chrétienne induit un genre de vie.
« La vision du monde chrétienne engendre un mode particulier d’être au monde ». Et là, l’auteur cite l’épitre à Diognète, écrite par un auteur chrétien de la fin du IIe siècle. Il y est dit que « ce que l’âme est dans le corps, c’est ainsi ce que sont les chrétiens dans le monde, c’est-à-dire : moyens de vie, préservation, guérison et amour répandus dans le monde ».
En fait, dans le cas du christianisme, on pourrait mieux l’exprimer comme étant « pour » le monde puisque, fondamentalement, dans la vision du monde chrétienne, l’humanité s’inscrit dans le dispositif du créateur de prendre soin du monde, et les chrétiens, en particulier, sont en charge d’apporte la guérison dans le monde » (p 882-883). Naturellement, comme pour d’autres visions du monde, ceux qui y adhèrent ne sont pas forcément à la hauteur, mais, en principe, la vision chrétienne du monde incite à la guérison du monde et à l’anticipation de l’accomplissement final.
Quelle sont les croyances de base ? s’interroge NT Wright. Il passe en revue les affirmations de base des premiers siècles. « Inspiré directement par le Nouveau Testament lui-même, le IIe siècle a insisté sur le fait que la rédemption signifiait la réaffirmation de la bonté de la création originelle. Les IIIe et le IVe siècles, faisant à nouveau écho au Nouveau Testament, ont insisté sur le fait que Jésus était et doit être identifié comme incarnant dans une forme humaine le Dieu unique d’Israël. Les IVe et Ve siècle, s’appuyant sur les écrits bibliques ont insisté sur le fait que la vie chrétienne, œuvre et témoignage, était et est elle-même l’œuvre du même Dieu vivant en la personne de son esprit… Le Nouveau Testament fournit ainsi la base pour une théologie et une vision du monde que nous pouvons expliquer et énoncer dans la guidance de l’Esprit, quelques réalités universelles dans l’expérience humaine : la justice, la spiritualité, la relation, la beauté, la liberté, la vérité et la puissance. Une vision chrétienne du monde nous dit ce que ces réalités signifient, qu’en faire, comment nous en réjouir et comment ne pas en abuser. Une vision chrétienne du monde centrée sur ces réalités nous rend capable de nous engager dans une adoration authentique, d’accomplir la vocation chrétienne et de promouvoir l’épanouissement des humains, individuellement et collectivement » (p 884).
Une vision du monde qui ouvre un chemin
Ce chapitre se poursuit par deux développements, l’un sur « la mission » et l’autre sur « une manière de vivre chrétien ». Nous y renvoyons le lecteur. Cependant, en lien avec la perspective de NT Wright sur la vision du monde chrétienne, nous l’entendons préciser sa manière d’envisager la mission de l’Église.
« La mission de l’église – ou plus justement la mission de Dieu à travers l’église, la tâche en cours pour laquelle le Dieu vivant envoie et équipe l’église – peut être justement comprise seulement à la lumière d’une eschatologie pleinement biblique. Cela veut dire adopter fermement la vision biblique de la nouvelle création, du nouveau ciel et de la nouvelle terre, inaugurée quand Jésus a annoncé le royaume de Dieu et a ressuscité des morts après avoir vaincu les puissances des ténèbres et appelée à être consommée à son retour en gloire quand il rendra toute chose nouvelle. La mission de l’église dérive de cette inauguration, dynamisée par le même esprit par le pouvoir duquel Jésus est ressuscité et elle pointe en avant vers cette consommation, l’anticipant, démontrant sa vie transformant la réalité même dans le moment présent, et appelant les hommes, les femmes et les enfants à prendre part à la vie nouvelle commune et personnelle qui est déjà une réalité et qui sera pleinement réalisée à la fin… Dans cette perspective, le rôle de l’église est de proclamer le seigneur Jésus, d’appeler les gens à le suivre avec foi, à nourrir les croyants de manière à ce qu’ils deviennent de saint disciples et pratiquent la miséricorde et la justice dans chaque contexte et chaque environnement… » (p 884).
En espérance
Ce chapitre s’achève par une grande évocation de l’espérance qui vient nous éclairer au milieu des ombres que nous rencontrons en chemin et dans l’écart que nous ressentons parfois ente la vision et le vécu quotidien. « En Romains 15.4, Paul nous indique que le but de l’écriture est de nous permettre d’avoir une espérance. Il parlait naturellement des écritures d’Israël, mais le même rôle est dévolu aux premiers écrits chrétiens. Si il en est ainsi, alors, un but éminent de l’étude du nouveau Testament est d’expliquer et d’éclairer la substance de cette espérance. En fait, nous pourrions même dire que la mission de l’église est de partager et de refléter l’espérance future telle que le Nouveau Testament la présente ». Cette espérance n’est-elle pas à porter dans un monde plus ou moins désespéré, là où on voit « les effets du chaos financier global », là où il y a « du chômage et des familles brisées », là où « les réfugiés se sentent étrangers et méprisés », là où « l’injustice raciale parait hideusement naturelle et où la xénophobie fait partie de la rhétorique politique habituelle ». Et NT Wright continue d’énumérer les situations marquées par la souffrance sociale,… « un monde dans lequel les riches ne cessent de devenir plus riches et les pauvres ne cessent de devenir plus pauvres ». « L’église dans la puissance de l’esprit doit marquer dans sa vie et son enseignement qu’il y a plus pour être humain que la simple survie, plus que l’hédonisme et le pouvoir, plus que l’ambition et la distraction… Il y a quelque chose de plus puissant que l’économie et les bombes ». « Il y a une manière différente d’être humain et elle a été lancée, d’une façon décisive par Jésus. Il y a un nouveau monde et il a déjà commencé et il œuvre par la guérison et le pardon, et se manifeste à travers de nouveaux départs et une fraiche énergie ».
« L’église, parce qu’elle est la famille qui croit en la nouvelle création, une croyance constamment réaffirmée dans le Nouveau Testament, devrait se manifester dans chaque ville et chaque village comme l’espace où l’espérance éclate. Non pas seulement l’espérance qu’il y a quelque chose de meilleur dans l’au-delà : plutôt, une croyance que le nouveau monde de Dieu a été semé, comme des graines dans un champ et qu’il est déjà en train de produire des fruits surprenants. La vie du nouveau monde a déjà été déchargée dans le temps présent. Et ce que nous faisons comme résultat de cette vie, cette énergie et cette direction données par l’esprit, est déjà en soi, une partie du nouveau monde que Dieu est en train de créer. Quand cette espérance prend racine, l’histoire racontée par l’ensemble du Nouveau Testament prend vie à nouveau et à nouveau, à travers Jésus et par son esprit. Le nouveau monde est né ». (p 889).
Inspiré par une connaissance intime du Nouveau Testament, NT Wright développe une théologie qui va de pair avec une vision chrétienne du monde et l’espérance qui l’accompagne. Dans la perspective de NT Wright, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, en réponse aux attentes prophétiques, nous sommes engagés dans une nouvelle création et appelés à participer à « un nouveau monde ». Certes, dans notre actualité si brutale, ce « nouveau monde » est parfois difficile à reconnaitre. A nous d’en faire l’expérience et de le découvrir. Cette dynamique théologique vient bousculer une piété repliée sur elle-même et exclusivement tournée vers un salut individualiste. Ainsi l’auteur émet un reproche : « Nous avons Platonisé (suivant la philosophie de Platon) notre eschatologie, substituant les âmes allant au paradis à la nouvelle création promise » (p 878). Cette théologie se fonde sur une histoire et accorde une grande importance à l’église. On peut envisager l’œuvre du Saint Esprit, au-delà. Engagée dans le monde, cette théologie a été bien reçue dans les milieux de l’Église émergente, comme il en a été de même pour la théologie de Jürgen Moltmann, théologie elle aussi à dimension eschatologique. Ce fut dans sa « théologie de l’espérance » que Jürgen Moltmann rencontra une vaste audience (4) et le texte de NT Wright sur la vision chrétienne du monde s’achève par un accent sur l’espérance.
J H
- N T Wright. Wikipedia. The free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/N._T._Wright
- Paul : sa vie et son œuvre, selon NT Wright : https://vivreetesperer.com/paul-sa-vie-et-son-oeuvre-selon-nt-wright/
- N T Wright. Michaël Bird. The New Testament in its world. An introduction to the history, literature and theology of the first Christians. Zondervan, 2019
- Quelle vision de Dieu, du monde, de l’humanité en phase avec les aspirations et les questionnements de notre époque ? Genèse de la pensée de Jürgen Moltmann : https://vivreetesperer.com/quelle-vision-de-dieu-du-monde-de-lhumanite-en-phase-avec-les-aspirations-et-les-questionnements-de-notre-epoque/

Comment la conscience de la divinité de Jésus est apparue
Comment la conscience de la divinité de Jésus est apparue, engendrant une nouvelle psyché humaine et le bouleversement du monothéisme traditionnel ?
« When did Jesus become God ?” par Ilia Delio
Dans notre monde en mutation, notre culture en pleine transformation, nous cherchons une nouvelle compréhension de notre état religieux et spirituel qui prenne en compte ce bouleversement. Dans cette recherche, il est bon de conjuguer une réflexion théologique et une compétence scientifique. Or, il y a bien des lieux où cette recherche est en cours, entre autres au ‘The Center for Christogenesis’ (1) animé, aux Etats-Unis par Ilia Delio (2), une sœur franciscaine hautement diplômée et qualifiée dans le domaine de la biologie et des neurosciences et théologienne notamment inspirée par Teilhard de Chardin. Délivrée des arcanes d’un catholicisme traditionnel, elle travaille dans un espace irrigué par une avancée scientifique et technologique spectaculaire et la conscience d’une transformation des mentalités. Nous présentons ici un des essais publié sur son site : « When did Jesus become God ? » (3). Dans d’autres textes, son approche des enseignements induits par la révolution scientifique et technologique en cours donne lieu à controverse. Mais ici, sa réflexion théologique, fondée sur une approche historique et psychologique à partir du Nouveau Testament, nous parait éclairante. Elle nous montre comment la prise de conscience de la divinité de Jésus dans les premiers temps va de pair avec la transformation de la psyché humaine qui s’est réalisée à l’époque. Cette analyse est une porte ouverte pour nous aider à reconnaitre aujourd’hui le transcendant divin à l’intérieur de nous : « recognize the transcendant divine ground within us ».
En avant-propos, Ilia Delio nous indique le sens de sa démarche : Dieu est un autre nom pour désigner la personne. La mutation chrétienne est le développement de la personnalité dans la liberté et l’amour ( « God is another name for personhood. The christian mutation is the development of personhood in freedom and love »).
L’émergence de la dévotion envers Jésus dans l’Église primitive.
Ilia Delio commence par nous inviter à mesurer combien la divinité de Jésus n’était pas évidente au départ dans le groupe de ses premiers disciples. A ce sujet, elle cite une théologienne australienne Anne Hunt : « Être chrétien avec la conviction de foi chrétienne que Jésus est divin et que Dieu est trinitaire, tend à voiler le caractère profondément révolutionnaire et radical qu’a représenté le développement de la conscience divine de Jésus pour ses disciples. Comme ceux-ci, Jésus était juif. Fidèles à leur tradition, ils tenaient une notion monothéiste exclusiviste de Dieu et de la dévotion à Dieu. Cependant leur expérience de Jésus suscitait chez eux un changement vraiment incroyable dans leur conscience de Dieu et une réinterprétation radicale de leur foi en un Dieu unique qui en viendrait éventuellement à s’exprimer dans la doctrine chrétienne de la Trinité ».
Ilia Delio trouve qu’il y a là « un mouvement vraiment fascinant ». « Comment est-ce qu’une compréhension de Dieu entièrement nouvelle a-t-elle émergé dans la vie d’un jeune homme juif, du nom de Jésus de Nazareth ? Les chercheurs s’accordent sur le fait que la mentalité religieuse des premiers chrétiens étaient façonnée par la tradition juive et que les disciples cherchaient à comprendre la signification de la vie de Jésus dans la relation à l’ancien Testament. La mort de Jésus et l’expérience de la résurrection de Jésus a conduit les disciples à proclamer que Jésus est Seigneur.
Quelle a été l’expérience psychologique transformante des premiers disciples ?
Ilia Delio fait appel à la recherche d’un chercheur bénédictin Sebastian Moore qui a cherché à déchiffrer l’expérience psychologique des premiers disciples.
« Ce qui comptait dans cette nouvelle expérience de la conscience de Dieu en la personne de Jésus, c’était une conscience nouvelle qui ne pouvait refléter plus longtemps un strict monothéisme (un Dieu), mais une nouvelle compréhension de la puissance de Dieu, une puissance partagée exprimée dans une perspective binitarienne (le Père et le Fils), qui éventuellement évoluerait vers la doctrine de la Trinité ». Ilia Delio se réfère ensuite à un chercheur spécialisé dans le Nouveau Testament tardif, Larry Hurtado : « Les premiers disciples ont vécu une mutation de conscience qui les a mené à chercher un fondement scripturaire pour la révolution chrétienne. Tandis que l’Ancien Testament utilise l‘imagerie d’un agencement divin tel qu’en Psaume 110.1 : « l’Éternel a déclaré à mon Seigneur : « Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’ai fait de tes ennemis ton marchepied » et le Livre de Daniel 7.14 : « On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et langues le serviront… » et ainsi aussi les écrits du Nouveau Testament tels que Romains 1.4 utilisent l’agencement divin pour décrire la divinité de Christ, « né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté par la résurrection d’entre les morts ». De même, en Actes 2.36, la résurrection de Jésus est conçue comme impliquant son exaltation à une position céleste d’importance majeure dans le plan de rédemption de Dieu. Essentiellement, comme Hurtado le souligne, Jésus de Nazareth a été associé à l’agencement divin que Paul a hérité du premier cercle de chrétiens juifs palestiniens et qu’il a lui-même élaboré partir de sa propre réflexion sur la signification de Christ ».
Le changement est apparu également dans les modes de dévotion. Selon Hurtado, « la dévotion chrétienne précoce a constitué une mutation significative dans le monothéisme juif. Il y a eu là une émergence d’une association étroite entre Dieu et Jésus-Christ et d’un mode monothéiste binitarien d’adoration et de prière ». « Les disciples ont fait l’expérience d’une présence énergétique nouvelle de Dieu en la personne de Jésus. Et une nouvelle conscience religieuse de la puissance d’amour de Dieu a jailli en eux. La transition du Jésus juif à Jésus- Christ, fils de Dieu, a fait irruption soudainement et rapidement et non graduellement et tardivement ». A partir de son origine, elle s’est rapidement étendue.
Une conscience nouvelle de la présence de Dieu
Ilia Delio nous parle ici en terme d’expérience spirituelle. « Si les disciples ont eu une conscience unique de Jésus comme Dieu, c’est parce que Jésus lui-même a manifesté une conscience nouvelle de la présence de Dieu. Comme Carl Jung l’a noté, Jésus est parvenu à un niveau supérieur, un niveau nouveau de la conscience de Dieu à l’intérieur de lui-même, réalisant un processus d’individuation et atteignant un niveau nouveau de liberté et ainsi un nouveau sens de mission. Selon Jung, les religions monothéistes ont évité la dimension psychique de le personnalité humaine, ce qui a conduit à une conception rétrécie de Dieu ». En ce sens, Ilia Delio pousuit : « Les chrétiens, en particulier, ont exclu la dimension psychique de la vie de Jésus de toute considération doctrinale, alors que c’est exactement ce qui distingue Jésus de Nazareth, une conscience nouvelle de la présence de Dieu qui l’a mené à ses actions radicales d’inclusivité, de guérison, de compassion et ultimement de sacrifice de soi.
L’expérience d’une nouvelle expérience immanente de Dieu est à l’origine de la dévotion à Jésus ». En suivant l’analyse de Sebastian Moore, Ilia Delio retrace trois étapes dans le développement de cette dévotion. La première étape fut « un éveil du désir lorsque les disciples firent l’expérience d’une joie et d’une extase dans leur interaction avec Jésus en Galilée, un sens nouveau et captivant de Dieu, un sens de Dieu délivré du fardeau du péché et de la culpabilité, le sens d’un Dieu ni éloigné, ni dominateur, mais une présence aimante et compatissante ». Cependant, au cours d’une deuxième étape marquée par la mort terrible de Jésus, les disciples ont fait « l’expérience de la désolation et du sentiment que tout était perdu. La mort de Jésus les a précipité dans une profonde crise spirituelle marquée par le désespoir, la honte et la confusion… Au sens jungien, les disciples subissait la mort de l’ego ».
Une troisième étape a suivi. « Moore suggère que la mort de Jésus a créé un sentiment de la mort de Dieu chez les disciples et que, avec l’apparition de Jésus ressuscité, ils ont fait l’expérience de Jésus ressuscité comme rien de moins que l’expérience renouvelée de Dieu en leur sein. Le Dieu de Jésus, le Père qui était mort avec Jésus et qui maintenant déclare son amour dans la résurrection de Jésus, Le Dieu qui est l’auteur de ce plan aimant et donneur de vie, réémergeait dans une puissance nouvelle ». Ils ressentaient que Jésus était Dieu. « Au début, ce fut un déplacement de la divinité vers Jésus qui devint le centre de leur nouvelle conscience de Dieu. Cependant, les disciples ne pouvaient appréhender cette extension de la divinité à Jésus sans que quelque chose prenne place à l’intérieur d’eux-mêmes. C’est au niveau de la conscience personnelle que cette nouvelle réalité a émergé. Selon Moore, c’est le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus qui a été la clef de la transformation radicale de la conscience de Dieu, une transformation qui a commencé avec leur expérience de Jésus dans son ministère terrestre et qui a été purifiée par la mort et la résurrection de Jésus ».
Une révolution théologique
Ilia Delio met en valeur le rôle majeur de la résurrection dans la transformation de la vision des disciples. « Pour eux, Dieu a émergé à nouveau vivant dans la personne même de Jésus, vivant comme jamais avant, avec une nouvelle compréhension d’eux-mêmes et de Jésus, radicalement transformée, libérée, énergisée ». C’est ainsi qu’une nouvelle vision théologique a émergé. « La mutation chrétienne a été une révolution théologique et une évolution de la personne humaine. La puissance du Dieu monothéiste a été éveillée dans la personne humaine comme la puissance d’une vie nouvelle révélée en Jésus et énergétisée par l’Esprit. Le langage de la Trinité a été une sténographie de la puissance partagée de l’amour, étendue dans la création par la Divinité… La transition du monothéisme au théisme binitarien, puis au théisme trinitarien, est une évolution de la conscience religieuse qui a des implications radicales pour une présence nouvelle de Dieu dans le monde et un nouveau genre de personne dans la montée d’un nouvel ordre mondial ».
Ultérieurement, une grande déviation théologique
La politisation de Dieu au Concile de Nicée en 325 et le mariage entre Athènes et Jérusalem ont mené à une héllénisation de la doctrine qui a provoqué une abstraction du langage philosophique dépouillé de sa dimension psychique. Le langage de la nature divine, essence, être et substance, devint une sémantique logique. La mutation chrétienne était avortée et la révolution de la puissance divine introduite par Jésus de Nazareth ne murit jamais. Au lieu d’une nouvelle puissance divine d’amour agissant dans le monde à l’intérieur de la personne humaine et à travers elle, ce qui a émergé, c’est l’internalisation du pouvoir divin exprimé dans un Dieu patriarcal… Comme la doctrine était institutionalisée, l’accent est passé de l’orthopraxie à l’orthodoxie. Le triomphe de l’institution patriarcale a supprimé la psyché humaine et a rendu impuissante la mutation chrétienne ».
Ilia Delio met en évidence l’ampleur du désastre. « Si la mutation chrétienne avait échappé à la politique de puissance et à la main-mise du patriarcat…, nous aurions probablement une église et un monde entièrement différents. Mais le nouveau mouvement était trop jeune et trop fragile pour y échapper : l’institutionnalisation du christianisme lui donna le pouvoir de modeler le premier millier d’années de la civilisation occidentale donnant naissance à une psyché sans Dieu et une humanité sans aucun vrai projet collectif ».
La primauté de l’expérience
Quelle est la portée de formulations doctrinales si elles ne s’appuient pas sur l’expérience ? Ilia Delio exprime la primauté de l’expérience : « Il me semble qu’à notre époque, le premier besoin théologique est que le psychologique assure la médiation du transcendant ». Elle précise : « Le seul vrai but du christianisme est d’éveiller le transcendant divin au niveau de la psyché. Tout le reste est mortel. La divinité de Jésus ressuscité et la nature trinitaire de l’être divin ne sont pas seulement des doctrines théologiques, mais des réalités profondément psychologiques. L’expérience des mystères à un niveau profondément psychologique est nécessaire avant leur expression dans la prière et la dévotion et avant l’articulation à une doctrine. La tâche de porter la foi et le sens religieux à la conscience contemporaine demande une médiation expressément psychologique, un éveil profondément personnel par lequel l’histoire de Jésus rencontre et transforme notre propre histoire personnelle »
Un enjeu majeur
Ilia Delio n’est pas seulement une théologienne, elle est également une scientifique qui suit de près l’avancée des sciences et des technologies. Elle est attentive à l’évolution du monde et à la mutation en cours de celui-ci. C’est dans cette perspective qu’elle situe la requête spirituelle et l’offre de la foi chrétienne. « Nous sommes aujourd’hui dans une étape de vie entièrement nouvelle au sein d’un univers en expansion. Nous en savons beaucoup plus sur la matière et l’esprit et nous avons une opportunité de changer le cours de l’histoire en portant la mutation chrétienne en alignement avec la science moderne et la cosmologie. Si nous ne le faisons pas, nous serons confrontés à des conséquences désastreuses. Aussi longtemps que la psyché humaine demeure évincée de son foyer naturel en la divinité, nous, humains, sommes des coquilles vides à la recherche de notre fondement de sens le plus profond. C’est le moment de reconnaitre en nous un terreau divin et transcendant et d’entrer dans une mutation qui peut mener à une réalité plus riche de la vie planétaire, pleinement vivante dans la gloire de Dieu ».
Cet texte d’Ilia Delio nous parait remarquable, car il éclaire notre expérience de foi, en la situant à l’image d’une première expérience, celle des disciples eux-mêmes inspirés par l’expérience de Jésus.
J H
- Center for Christogenesis : https://christogenesis.org/about/ilia-delio/
- Ilia Delio. Wikipedia. The free encyclopedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Ilia_Delio
- When did Jesus become God? : https://christogenesis.org/when-did-jesus-become-god/
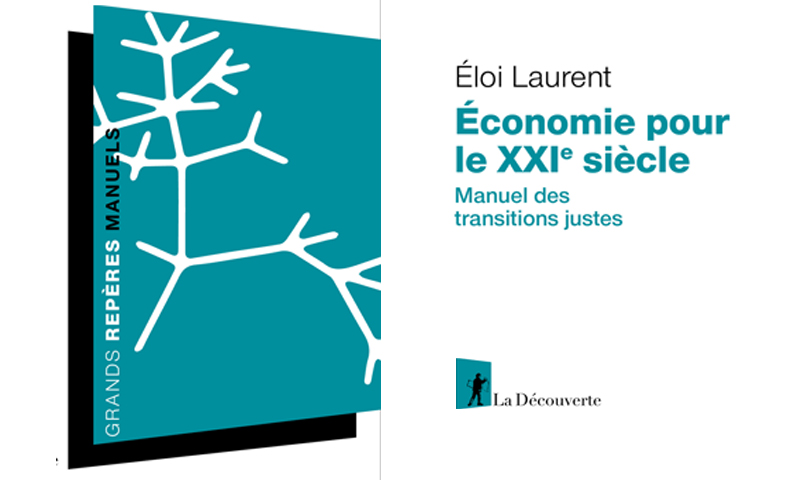
Face à la crise écologique, réaliser des transitions justes
Une nouvelle pensée économique selon Eloi Laurent
Pour réaliser les transformations économiques requises urgemment par la crise écologique, nous avons besoin de considérer l’économie sous un jour nouveau. C’est pourquoi Eloi Laurent nous propose un livre intitulé : « Économie pour le XXIe siècle. Manuel des transitions justes » (1). Eloi Laurent est enseignant-chercheur à l’OFCE/Sciences Po et à Ponts Paris Tech et à l’international ; il a enseigné dans les universités Harvard et Stanford. Il est donc bien placé pour constater « la perplexité croissante des étudiants » vis-à-vis de l’enseignement d’une « économie aveugle à l’écologie comme s’il s’agissait de deux mondes parallèles ».
« Économiste engagé dans le débat public, il jette ici un regard critique et constructif sur sa discipline ». « Ce manuel innovant propose une économie pour le XXIe siècle, qui intègre défis écologiques et enjeux sociaux : une économie qui part de la biosphère plutôt que de la traiter comme une variable d’ajustement ; une économie qui place au centre la crise des inégalités sociales plutôt que l’obsession de la croissance ; une économie organique en prise avec le vivant dont nous dépendons ; une économie en dialogue avec les autres disciplines. En somme, une économie mise au service des transitions justes qui ont pour but de préserver notre planète et nos libertés » (page de couverture).
Comme la prise de conscience écologique nous a appelé à étudier sur ce blog des pistes de transformation dans différents domaines, depuis l’économie (2) et la socio-politique (3) ou l’environnementalisme (4) jusqu’à la philosophie (5) et la spiritualité (6), cet ouvrage est particulièrement bienvenu car il nous offre un chemin qui allie la prise en compte des effets mortifères des inégalités et des politiques écologiques pour tracer le chemin de ‘transitions justes’.
Ce livre s’organise en deux grandes parties .« La première partie présente un cadre, une méthode et des outils pour insérer l’économie entre la réalité écologique et les principes de justice. La seconde partie applique cette approche social-écologique à toutes les grandes questions de notre temps : la biodiversité, les écosystèmes, l’énergie, le climat, etc… et donne à voir tous les leviers d’action pour mener à bien des transitions justes : Nations unies, Union européenne, gouvernement français, territoires, entreprises, communautés » (page de couverture). On se reportera à ces différents champs d’étude. Nous introduirons ici le lecteur à la manière dont Eloi Laurent présente les attendus de la nouvelle économie et l’approche sociale-écologique au cœur de cette vision nouvelle
Ce que l’économie savait, ce qu’elle a oublié, ce qu’elle peut encore nous apprendre.
Pour réussir la transition écologique, il serait bon de pouvoir éclairer et guider les changements économiques nécessaires par des savoirs économiques. C’est là que l’auteur met en évidence le manque de pertinence des sciences économiques actuelles. « L’économie standard s’est enfermée au cours des dernières décennies du siècle précédent dans une approche beaucoup trop étroite de la coopération sociale et du développement humain, fixée sur des obsessions abstraites telle que l’efficacité, la rentabilité ou la croissance, qui la rendent trop inopérante aujourd’hui. Ce faisant, elle a méprisé sa propre richesse, ignoré son écodiversité, et négligé de s’interroger sur les conditions de possibilité de l’activité économique » (p 10).
Or, en remontant aux origines, puis dans l’histoire de l’économie politique, on découvre que celle-ci a longtemps tenu grand compte des ressources naturelles et de l’environnement.
« Contrairement aux apparences contemporaines, il apparait que l’analyse économique a développé très tôt une double préoccupation pour la justice et pour la question écologique et même pour l’articulation de ces deux thématiques » (p 15). L’auteur remonte aux origines. L’économie a été inventée en Grèce, il y a 2500 ans par Xénophon, propriétaire administrant un domaine agricole, et par Aristote dans sa ‘Politique’. Chez Aristote, l’économie, c’est « la discipline de la sobriété au service des besoins essentiels. C’est donc une discipline qui concilie les besoins des humains avec les contraintes de leur environnement. Quand l’économie devient ‘économie politique’ à l’époque moderne, les premiers « économistes font de la nature la source de la richesse et l’origine du pouvoir ». (p 15-16). C’est au XVIIIe siècle qu’une pensée économique émerge à nouveau. « Les premiers économistes sont les physiocrates, un groupe de philosophes et de responsables politiques français. Ils ont été les premiers à construire un modèle cohérent de représentation de l’économie où les ressources naturelles jouaient un rôle central. Les physiocrates nous aident à comprendre le lien essentiel entre ressources naturelles, pouvoir politique et justice sociale. Cette analyse se prolonge avec les travaux de l’école classique anglaise » (p 16-19). L’auteur évoque ici David Ricardo et John Stuart Mill. Alors qu’en 1848, la première révolution industrielle atteint son pinacle, John Stuart Mill envisage un ralentissement de la croissance, un ‘état stationnaire’. « Où tendons nous ? A quel but définitif la société marche-t-elle avec son progrès industriel ?… Les économistes n’ont pas manqué de voir plus ou moins distinctement que l’accroissement de la richesse n’est pas illimité ; qu’à la fin de ce qu’on appelle l’état progressif se trouve l’état stationnaire… ». Et, dès cette époque, il pressent et envisage la question écologique : « Si la terre doit perdre une grande partie de l’agrément qu’elle doit aux objets, que détruirait l’accroissement continu de la richesse et de la population… j’espère sincèrement pour la postérité qu’elle se contentera de l’état stationnaire longtemps avant d’y être forcée par la nécessité ». Eloi Laurent commente ainsi : « La nature révolutionnaire du questionnement de John Stuart Mill sur les finalités mêmes de l’économie capitaliste libérale réside dans sa compréhension de l’impact profond que les sociétés humaines ont déjà, de son temps, sur la biosphère ». D’une manière positive, John Stuart Mill précise : « Ce ne sera que quand, avec de bonnes institutions, l’humanité sera guidée par une judicieuse prévoyance, que les conquêtes faites sur les forces de la nature par l’intelligence et l’énergie des explorateurs scientifiques deviendront la propriété commune de l’espèce et un moyen d’améliorer et d’élever le sort de tous » (p 41-42).
Eloi Laurent nous montre ensuite le tournant intervenu dans les sciences économiques au XXe siècle. D’après Dani Rodrik, « l’économie serait différente des autres sciences sociales (et pour tout dire supérieure), du fait de sa maitrise des modèles, autrement dit de représentations simplifiées et opératoires des comportements humains, lesquels permettraient d’identifier des relations causales. L’économie du XXe se serait ainsi progressivement singularisée par l’amélioration de ses techniques quantitatives, prenant appui sur la formalisation mathématique pour développer l’économétrie, la théorie des jeux jusqu’à l’économie computationnelle et le big data d’aujourd’hui. En réalité, la question des instruments apparait secondaire dans l’émancipation de l’économie au XXe siècle. La véritable rupture n’est pas formelle mais substantielle : c’est la rupture avec la philosophie, l’éthique et la justice » (p 42). L’auteur rappelle que les enjeux de répartition et les principes de justice étaient au cœur de l’œuvre des pères fondateurs de ce qu’on a appelé ‘l’économie politique’. Mais force est de constater que ces enjeux ont été marginalisés et finalement presque oblitérés dans les dernières décennies du XXe siècle. Cet aveuglement progressif dans les travaux de l’école néoclassique a été aggravé par la focalisation sur le court terme par l’approche keynésienne.
L’auteur met en évidence « la relégation de l’enjeu de la justice par rapport à celui de l’efficacité » dans les publications en économie à partir de la fin du XIXe siècle. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que « l’économie des inégalités a fait un retour remarqué ».
Eloi Laurent nous propose également une histoire du développement de l’économie de l’environnement à partir du milieu du XIXe siècle. Au début des années 1960, une économie écologique émerge comme une réponse au défi de la soutenabilité déjà cristallisé par la publication du rapport Brundtland publié dans le cadre d’une commission des Nations Unies en 1987, qui définit pour la première fois le ‘développement soutenable’ (ou durable) comme « un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (p 50).
Cependant, malgré les recherches sur l’économie de l’environnement pendant un siècle et demi, cette discipline est encore négligée dans le domaine de l’économie. « Dans leur grande majorité, les économistes ignorent les questions environnementales, au double sens de l’inculture et de l’indifférence » (p 50). Cette affirmation s’appuie sur un examen de la littérature économique contemporaine. « Ce désintérêt est d’autant plus préjudiciable que la transition écologique est désormais un enjeu de sciences sociales : les sciences dures ont largement œuvré pour révéler l’ampleur et l’urgence des crises écologiques ». Aujourd’hui, « ce sont les sciences sociales, dont l’économie, qui détiennent la clé des problèmes que les sciences dures ont révélés » (p 56).
Une approche sociale-écologique
Pour des transitions justes.
Un constat s’impose aujourd’hui : les ravages provoqués par la montée croissante des inégalités. « Nos sociétés sont devenues de plus en plus inégalitaires., fragmentées et polarisées au cours des quarante dernières années tandis que les dégradations environnementales s’accéléraient pour atteindre des niveaux inédits. La crise des inégalités et les crises écologiques marchent du même pas. Les 35 pays considérés comme les plus riches, qui ne représentent que 15% de la population mondiale sont ainsi responsables de75% de la consommation démesurée des ressources naturelles depuis 1970. Et la moitié des émissions de CO2 depuis 1990 est le fait de seulement 10% des humains » (p 8). « Nos systèmes sociaux – à commencer par nos systèmes économiques – sont devenus autodestructeurs et l’avidité d’une partie des humains est devenue préjudiciable à la poursuite de l’avenir de l’humanité. C’est pourquoi nous devons trouver un moyen d’inverser la spirale social-écologique vicieuse dans laquelle nous sommes pris » (p 9).
C’est dans cette perspective qu’Eloi Laurent met en évidence le rapport réciproque entre les inégalités et les effets de la crise écologique.
« ° La non-transition écologique – c’est-à-dire la situation actuelle dans laquelle les crises écologiques s’aggravent sans trouver de réponse adéquate – est génératrice d’inégalités sociales qui touchent d’abord les plus démunis.
° La nécessaire réduction des inégalités sociales peut atténuer les crises écologiques et réciproquement les politiques de transition écologique peuvent réduire les inégalités sociales et améliorer le bien-être des plus démunis.
° On peut concevoir des politiques social-écologiques qui, aujourd’hui, comme dans la durée, réduisent simultanément les inégalités sociales et les dégradations environnementales » (p 100).
Eloi Laurent consacre un chapitre à l’approche social-écologique (p 74-98). Il y aborde en premier les questions relatives à la gestion des communs : « De la tragédie des communs à la gouvernance des communs ». Mal gouvernés, les communs peuvent dégénérer. C’est ainsi qu’en 1968, Garett Hardin évoque ‘la tragédie des communs’. L’image est celle de « bergers épuisant le pâturage qu’ils partagent sans le posséder, faute de s’en répartir équitablement l’usage ». Hardin propose comme remède « soit de privatiser la ressource naturelle, soit d’instituer ‘une coercition réciproque par acceptation mutuelle’, autrement dit de recourir à un autorité centrale qui monopolisera le pouvoir de choisir et qui ressemble fort à un gouvernement dictatorial » (p 75). Pendant les décennies qui suivirent, l’article de Hardin « fut annexé par une pensée néolibérale en plein essor qui en fait l’emblème de sa lutte en faveur de la propriété exclusive comme seul outil rationnel de gestion des ressources » (p 75).
Cependant, si on a décrit deux solutions à la ‘tragédie des communs’ : la centralisation politique ou la privatisation, une troisième option apparait : « une révolution des communs dont Ostrom est le porte-étendard ». « Les travaux d’Ostrom et de ses nombreux coauteurs vont démontrer que les institutions qui permettent la préservation des ressources par la coopération sont engendrées par les communautés humaines elles-mêmes et pas par l’État, ni par le marché. Des centaines de gouvernances décentralisées évitent, partout dans le monde et depuis des millénaires, la tragédie des communs en permettant l’exploitation soutenable de toutes sortes de ressources : eau, forêts, poissons, etc » (p 78). En exemple, le partage de l’eau depuis le début de l’agriculture, il y a 10000 ans… « Ces principes de gouvernement écologique émanent des communautés humaines elles-mêmes, pas d’une autorité extérieure ». Toutes les informations sont ainsi à portée et nourrissent l’action. Quant à elle, la privatisation engendre l’inégalité.
« Dans ce cadre d’analyse, on voit clairement l’importance de la relation – horizontale, mais souvent négligée – entre préservation naturelle et confiance. Ce n’est donc pas un hasard si Ostrom a aussi contribué de manière décisive à la littérature sur la confiance en lien avec la coopération » (p 78). « Selon Ostrom, les individus qui coopèrent sont capables d’apprendre des autres ; Ils se souviennent des comportements de coopération et plus généralement de la fiabilité des personnes auxquelles ils ont affaire ; ils utilisent leur mémoire et d’autres indices… pour évaluer la fiabilité de leurs partenaires dans l’échange, avant de leur accorder leur confiance ; ils s’efforcent de se bâtir une réputation de fiabilité… ils adoptent des horizons temporels qui excèdent le passé immédiat… La coopération est une quête de connaissances partagées » (p 79). Ainsi, « grâce à Ostrom, on sait maintenant que des institutions communes enracinées dans des principes de justice, même réduites à leur plus simple expression, favorisent les comportements coopératifs. La théorie des communs d’Ostrom constitue donc la première matrice de l’approche sociale-écologique » (p 80).
L’approche sociale-écologique considère la relation réciproque entre dynamique sociale et dynamique environnementale en se concentrant sur le caractère imbriquée des deux crises qui caractérisent le début du XXIe siècle. A cet égard, l’approche sociale-écologique fonctionne à double sens : les inégalités sociales alimentent les crises écologiques tandis que les crises écologiques aggravent à leur tour les inégalités sociales » (p 80).
« L‘impact social des crises écologiques n’est pas le même pour les différents individus et groupes compte tenu de leur statut socio-économique » (p 81). L’auteur étudie l’incidence des riches et des pauvres sur l’environnement. « Du côté des riches, le sociologue Thomas Veblen a montré dans sa ‘Théorie de la classe de loisir’ que le désir de la classe moyenne d’imiter les modes de vie des classes les plus favorisées peut conduire à une épidémie culturelle de dégradations environnementales ». C’est l’attrait d’une ‘consommation ostentatoire’. Dans un autre registre, Indira Gandhi faisait remarquer que dans les pays les plus démunis, « la pauvreté conduit à des dégradations environnementales du fait de l’urgence sociale ». La richesse des pays pauvres du monde résidant d’abord dans les ressources naturelles, ils sont contraints à y puiser excessivement. « L’éradication de la pauvreté est donc souhaitable non seulement socialement, mais aussi sur le plan environnemental, à condition qu’elle ne prenne pas la forme d’un rattrapage consumériste, mais s’inscrive dans une redéfinition de la richesse globale » (p 83). « Les inégalités augmentent le besoin d’une croissance économique néfaste pour l’environnement et socialement inutile… Si l’accumulation de richesse dans un pays donné est accaparée par une petite fraction de la population, le reste de la population réclamera une croissance économique supplémentaire pour que son niveau de vie ne stagne pas ». Et, dans l’état actuel des choses, ce surplus de croissance « se traduira par davantage de dégradations environnementales ».
Comment réduire les inégalités ? « Par définition, il existe deux manières de les réduire: du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Réduire les niveaux des groupes des plus riches de la population mondiale (les 10% qui émettent un peu moins de la moitié du CO2 mondial, d’après les analyses du GIEC en 2022) via une fiscalité adéquate se traduira logiquement par d’importantes réductions d’émission. De plus, les biens de ‘luxe’ engendrent beaucoup plus d’émissions de carbone que les biens de ‘nécessité’ (p 86).
Dans ce cadre, veiller à une transition juste : « Dans l’Union européenne, alors que les émissions par habitant ont baissé en moyenne de l’ordre de 25% entre 1990 et 2013, les émissions de 1% des plus riches ont augmenté de 7% (principalement sous l’effet du transport aérien et, dans une moindre mesure, terrestre) tandis que celles des 50% des plus pauvres ont baissé de 32%. Nous vivons donc une transition injuste dans le continent le plus avancé dans l’atténuation de la crise climatique » (p 87).
De plus, « Les inégalités augmentent l’irresponsabilité écologique des plus riches à l’intérieur de chaque pays et entre les nations ». On constate ainsi que le dommages environnementaux (activités polluantes, déchets) sont souvent affectés aux zones pauvres. « Les inégalités, qui affectent la santé des individus et des groupes, diminuent la résilience social-écologique des communautés et des sociétés, et affaiblissent leur capacité collective à s’adapter à l’accélération du changement environnemental global ». « Un important corpus de recherches… a confirmé l’impact négatif des inégalités sociales sur la santé physique et mentale aux niveaux local et national (via le stress, la violence, un moindre accès aux soins de santé etc.) » (p 91). Selon Paul Farmer, l’inégalité constitue un « fléau moderne » sur le plan sanitaire aussi redoutable que les agents infectieux. De même, la dynamique des inégalités sociales influe sur la résilience ou au contraire la vulnérabilité des populations exposées à de grands chocs. Et de plus, « Les inégalités entravent l’action collective visant à préserver les ressources naturelles… De nombreuses études ont montré comment l’inégalité nuit à la gestion durable des ressources communes car elle perturbe, démoralise et désorganise le communautés humaines » (p 92). De même, « les inégalités réduisent l’acceptabilité politique des préoccupations environnementales et la possibilité de compenser les effets socialement régressifs potentiels des politiques environnementales » (p 94).
Les horizons de la transition juste
« L’approche sociale-écologique, dont on vient de détailler les deux facettes, trouve depuis quelques années une traduction institutionnelle porteuse d’avenir dans l’idée de ‘transition juste’ qui monte en puissance dans le champ académique et dans la sphère politique. Ainsi, lors de la Cop 26 (novembre 2021), plusieurs chefs d‘état et de gouvernement ont co-signé une déclaration sur « la transition internationale juste » (p 96). Eloi Laurent nous rapporte l’évolution de cette notion. « Elle est née au début des années 1990 dans les milieux syndicalistes américains comme un projet social défensif visant à protéger les travailleurs des industries fossiles des conséquences des politiques climatiques sur leurs emplois et leurs retraites ». Ce projet a trouvé par la suite un écho dans d’autres contextes. « Dans cette perspective défensive, ce sont les politiques de transition qu’il s’agit de rendre justes. Or l’amplification des chocs écologiques (inondations, sécheresses, pandémies, etc.), indépendamment des politiques d’atténuation qui seront mises en œuvre pour y faire face, appelle une définition plus large et plus positive de la transition juste. Cet élargissement a été entamé sous l’influence de la Confédération internationale des syndicats, puis de la confédération européenne des syndicats, qui ont fait évoluer la transition juste vers une tentative de conciliation de la lutte contre le dérèglement climatique et la réduction des inégalités sociales, autour du thème des « emplois verts »… Eloi Laurent se réjouit de cette évolution, mais appelle à aller encore plus loin. « Il convient d’élargir encore le projet de transition juste en précisant ses exigences et surtout en s’efforçant de la rendre opératoire de manière démocratique… La transition juste ne doit plus seulement s’entendre comme un accompagnement social ou une compensation financière des politiques d’atténuation des crises écologiques, mais plus largement comme une stratégie de transition social-écologique intégrée » (p 97).
Eloi Laurent formule en conclusion trois exigences:
1) analyser systématiquement les chocs écologiques et les politiques correspondantes, sous l’angle de la justice sociale…
2) accorder la priorité dans les politiques de transition juste au bien-être humain dynamique éclairé par des enjeux de justice en vue de dépasser l’horizon de la croissance économique… Ce dépassement de la croissance économique est en train de devenir un élément de consensus dans la communauté globale environnementale
3) construire ces politiques de transition juste de manière démocratique en veillant à la compréhension, à l’adhésion et à l’engagement des citoyens… » (p 98).
Eloi Laurent présente ensuite la palette des transitions justes.
En économiste ouvert à un vaste horizon, Eloi Laurent nous apprend beaucoup sur la transition, un leitmotiv de notre époque. C’est ainsi que nous avons découvert son approche dans un podcast du journal Le Monde : « Comment rendre la transition heureuse », une approche qui nous a paru particulièrement ajustée (7). En présentant ce livre : « Manuel des transitions justes », nous n’en rendons compte que d’une petite part, car cet ouvrage aborde toute une gamme de questions relatives à la transition depuis : « la transition vers la préservation du monde vivant », « la transition vers la coopération et le bien-être » jusqu’à la « transition vers la pleine santé ». Il nous apparait ainsi comme une pièce marquante d’un des quelques thèmes que nous abordons sur ce blog. Certes, son propos est dense, mais il est accessible et, manifestement, il aborde la question majeure de la transition écologique sous un angle qui nous parait à la fois éthique et réaliste, cette « transition juste » qui se déploie dans une approche « social-écologique ».
J H
(1) Eloi Laurent. Économie pour le XXIe siècle. Manuel des transitions justes. La Découverte, 2023
(2) Sortir de l’obsession de l’efficience pour entrer dans un nouveau rapport avec la nature : https://vivreetesperer.com/sortir-de-lobsession-de-lefficience-pour-entrer-dans-un-nouveau-rapport-avec-la-nature/ Vers une civilisation écologique : https://vivreetesperer.com/vers-une-civilisation-ecologique/
Vers une économie symbiotique : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
(3) Face à une accélération et à une chosification de la société : https://vivreetesperer.com/face-a-une-acceleration-et-a-une-chosification-de-la-societe/
Comment la puissance technologique n’engendre pas nécessairement le progrès : https://vivreetesperer.com/comment-la-puissance-technologique-nengendre-pas-necessairement-le-progres/
(4) L’humanité peut-elle faire face au dérèglement des équilibres naturels ? : https://vivreetesperer.com/lhumanite-peut-elle-faire-face-au-dereglement-des-equilibres-naturels/
(5) Les lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/des-lumieres-a-lage-du-vivant/
(6) Réenchanter notre relation au vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/ Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
(7) Comment rendre la transition heureuse ? le Monde. Eloi Laurent : https://podcasts.lemonde.fr/chaleur-humaine/202404090500-climat-comment-rendre-la-transition-heureuse

Ubuntu : une vision du monde relationnelle
Au sein de la culture occidentale, en fonction de différents facteurs comme la perception des effets néfastes d’un extrême individualisme et la montée d’une vision écologique, on prend de plus en plus conscience d’une réalité jusque-là méconnue : la relation, la reliance, la connexion. (1) Tout se tient. Cependant, cette évolution des esprits doit surmonter et dépasser une culture individualiste qui s’est installée dans le monde occidental depuis des siècles.
En regard, issue de la culture bantou, et par extension, africaine, « L’Ubuntu met l’accent sur le vivre ensemble, et l’interdépendance des individus au sein de la communauté. Des relations positives et une harmonie communautaire rehaussent notre humanité. L’idée force est de valoriser l’empathie, la compassion, la dignité et la valeur intrinsèque de chaque personne. Dans la philosophie de l’Ubuntu, le bien de la communauté est essentiel pour le bien de chaque individu. Être dans l’esprit de l’Ubuntu, c’est aussi apprécier la valeur de la coopération, le soutien mutuel, et le bien commun dans la prise de décision… Ubuntu est fondée sur la compréhension que chaque personne possède une valeur et une dignité intrinsèque. Elle renforce l’idée qu’étant un être social, un individu n’est pas intrinsèquement une entité solitaire, existant tout seul sur son île comme Robinson Crusoé. En vérité, l’être d’une personne est tissé avec celui des autres dans un tissu complexe de connexions sociales. Ubuntu se réalise dans un environnement social inclusif et des relations interconnectées. Une communauté régie par Ubuntu favorise le respect, la compassion, et une responsabilité partagée. En Afrique, la philosophie de l’Ubuntu se manifeste dans de nombreuses expressions culturelles, notamment dans la musique, les processus de prise de décision, qui promeuvent l’inclusivité, la construction de consensus, des systèmes de gouvernance et de résolution de conflits » (p 229-230).
Un homme, l’archevêque Desmond Tutu a fait connaitre la philosophie de l’Ubuntu dans le monde à travers son œuvre de réconciliation dans la période post-apartheid de l’Afrique du Sud… « L’archevêque Desmond Tutu, comme ancien président de la Commission Vérité et Réconciliation, a incarné l’esprit de l’Ubuntu dans le processus de réconciliation. Il a mis l’accent sur la valeur du pardon, de la guérison et du dialogue en se confrontant aux divisions et aux cicatrices du passé » (p 220).
Un livre, paru en 2024, aux Presses Universitaires de l’Université de Louvain se présente comme un recueil de textes examinant la vision de l’Ubuntu dans ses rapports avec la philosophie occidentale et ses contributions innovantes dans différents champs de la société et de la culture : « Ubuntu. A comparative study of an african concept of justice » (2). Parmi les autres livres portant sur Ubuntu, nous nous référons également ici à un livre publié à l’Harmattan : « Comprendre Ubuntu » (3) qui porte en sous-titre les noms de deux personnalités : Placide Tempels, un prêtre qui a mis en évidence l’originalité de la philosophie de l’Ubuntu en provenance de la culture Bantou et L’archevêque Desmond Tutu, grand acteur de la mise en œuvre de cette philosophie dans le champ politique et judiciaire.
Nous nous interrogerons d’abord sur l’origine de cette philosophie et ses caractéristiques ainsi que sur la vision qui en découle. Nous reviendrons sur la mise en œuvre de l’esprit Ubuntu dans le processus de libération post-apartheid en Afrique du sud. Nous évoquerons la comparaison entre Ubuntu et la philosophie occidentale.
De la culture bantou à la philosophie de l’Ubuntu : Une vision du monde
Pour « comprendre Ubuntu » l’auteur du livre, Kaumba Lafunda Samajiku, envisage la culture bantu à partir d’une approche linguistique. Un prêtre missionnaire, Placide Tempels « a étudié les langages, les comportements, les institutions et les coutumes des bantu » A partir de là, il a rapporté un système de pensée bantu. Son livre : « la philosophie bantu », publié en 1945 et traduit en anglais en 1959 a beaucoup favorisé la compréhension occidentale de la philosophie africaine. Il y traite de métaphysique, de sagesse, d’anthropologie, d’éthique et de restauration de la vie (p 15). « Pour Tempels, les bantu ont une conception essentiellement dynamique de l’être. Alors que pour la pensée occidentale, l’être est ‘ce qui est’, conçu de manière statique, la philosophie bantu conçoit l’être comme ‘ce qui possède la force, l’être est force’…. Tous les êtres sont des forces : Dieu, les hommes vivants et trépassés, les animaux, les plantes, les minéraux » (p 16). Chez Tempels, le contenu de la philosophie bantu se résume autour du « concept fondamental de force vitale… ». Des valeurs fondamentales de vie, fécondité et union vitale fondent l’ontologie des Bantu, l’idée qu’ils se font de l’être, ainsi que la formulation des règles éthiques et socio-juridiques » (p 21). Cette philosophie bantu est à la source de Ubuntu. Selon Wikipedia, « le mot Ubuntu issu de langues bantues d’Afrique centrale, orientale et australe, désigne une notion proche des concepts d’humanité et de solidarité ». Selon Kaumba Lufunda Samajiku, au cours de ces dernières décennies, l’esprit Ubuntu n’a pas seulement inspiré le processus de reconstruction de l’Afrique du sud dans la justice et la réconciliation, mais il exerce une influence plus générale, ainsi que l’herméneutique déployée par Barbara Cassin et Philipe Joseph Salazar ou la réalisation d’un logiciel open-source et gratuit construit à partir d’un noyau linux portant le nom d’Ubuntu et que des millions d’utilisateurs peuvent utiliser.
Selon un théologien zambien, Teddy Chalwe Sakupapa (4), le cadre conceptuel met bien en évidence « la centralité de la vie et des interrelations entre les êtres dans la vision africaine du monde ». « Le cadre conceptuel de l’ontologie et de la cosmologie bantu, telle qu’exprimée par Tempels et interprétée et appropriée par les théologiens africains, indique un sens fort du respect de la vie. C’est une mise en valeur de la centralité de la vie et de l’interrelation entre les êtres. Dans cette réalité interreliée, il n’y a pas de séparation entre le séculier et le sacré » ; La relationalité est au cœur de l’ontologie africaine ». Teddy Chalwe Sakupapa ouvre une réflexion théologique. La vie et la relationalité sont des thèmes centraux dans l’Écriture aussi bien que dans la récente réflexion pneumatologique de théologiens comme Jürgen Moltmann. La relationalité est également devenue particulièrement centrale dans les discours sur la Trinité et l’écologie (5).
Ubuntu pour la vérité et la réconciliation dans le processus de liquidation de l’apartheid et la construction d’une nouvelle société africain
A travers une lutte non violente, Gandhi et Mandela sont parvenus à obtenir la libération de peuples opprimés (6). Sous la direction de Mandela, l’Afrique du Sud a également évité les affres de la guerre civile. Son rôle a été décisif. Barack Obama a rendu hommage à son humanisme spirituel. Mandela « comprenait les liens qui unissent l’esprit humain… ‘L’Ubuntu’ incarne son plus grand don : celui d’avoir reconnu que nous sommes tous unis par des liens invisibles, que l’humanité repose sur un même fondement, que nous nous réalisons en donnant de nous-même aux autres ». L’action de Nelson Mandela a été de pair avec celle de Desmond Tutu. Celui-ci a recouru au concept d’Ubuntu qui a inspiré la Constitution provisoire de la Transition de l’Afrique du Sud (1993), ainsi que la loi de 1995 relative à la promotion de l’unité nationale et de la réconciliation. C’est dans ce contexte que va apparaître la Commission Vérité et Réconciliation sous l’impulsion de l’archevêque anglican Desmond Tutu. C’est la mise en œuvre d’un processus de réconciliation et de guérison collective. Dans un contexte de médiation, puissamment portée par une dimension spirituelle et religieuse d‘inspiration chrétienne, une expression concrète des victimes et des bourreaux va pouvoir advenir. Les victimes sud-africaines pourront dire à haute voix les coups reçus, les peines vécues, et les bourreaux d’hier, le mal qu’ils ont fait, en tant qu’agents institutionnels du régime. Dans ce processus, éclot une « justice réparative ». Cette forme de justice cherche à mobiliser tous et chacun dans la quête de solutions pragmatiques permettant la réponse d’une vie commune apaisée (5). Kaumba Lufunda Samajiku voit dans tout ce processus la mise en œuvre d’une « vision du monde Ubuntu » (p 23). « La réparation est une restauration de la vie, une restauration de l’ordre ontologique… La réparation consiste toujours, en fait, à éloigner le mal… La question de la vérité comme étape obligée de la réconciliation se comprend dans la mesure où la réconciliation est une reconstitution des relations entre les forces vitales dans leur intégrité… » De même, l’auteur rappelle l’importance majeure de l’interrelation entre les êtres humains. « L’être humain ne peut pas être solitaire. Il est inséré dans un réseau de relations en tant que membre lié à d’autres membres… ». Ainsi, « la restauration des liens sociaux apparait dans le processus mis en œuvre par la Commission Vérité et Réconciliation. Elle met dans une même continuité la conception de la nature de l’homme et la conception de la nature de la justice… » (p 27-30).
Ubuntu : la dimension internationale
Le livre : « A comparative study of an african concept of justice », présente une compréhension internationale et systématique d’Ubuntu en examinant les nuances à travers les différentes cultures africaines. De plus, il juxtapose Ubuntu avec des concepts dominants des philosophies occidentales, incluant « la justice comme équité » de John Rawls, la justice sociale, l’individualisme libéral, l’éthique des relations et des affaires et les droits humains » (p 231).
Les auteurs mettent en évidence « une distinction entre Ubuntu et l’individualisme libéral occidental ». « Ce sont deux perspectives philosophiques différentes en ce qui concerne la nature des êtres humains et les relations entre individus et société ». « Par exemple, le philosophe américain John Rawls déclare dans une « Theory of Justice » que chacun a des droits inaliénables fondés sur la justice, que même l’intérêt collectif de la société ne peut outrepasser… Ainsi, les individus sont envisagés comme des entités indépendantes et autonomes avec des droits et des libertés inhérentes à ce que Michael Sadler considère comme « un soi libre de toute entrave ». « Pour le soi libre de toute entrave, ce qui importe au-dessus de tout, ce qui est le plus essentiel pour notre personnalité, ce ne sont pas les fins que nous choisissons, mais notre capacité de les choisir ». De même, Alasdair MacIntyre pense que l’individualisme libéral occidental déforme les relations sociales. L’histoire de ma vie est toujours incluse dans l’histoire des communautés dont dérive mon identité. Je suis né avec un passé. Et essayer de se couper soi-même de ce passé, dans une approche individualiste, c’est déformer ma relation actuelle ». En regard, Ubuntu tourne autour de la communauté et de l’interdépendance parmi ses membres. Il reconnait une nature humaine communautaire et met l’accent sur notre bien-être partagé ». « Alors que l’éthique des droits est à la base de la philosophie de l’individualisme libéral, Ubuntu se fonde sur la mise en œuvre de relations positives et la réalisation d’une harmonie parmi les gens. Selon Ubuntu, une conduite éthique découle de la compréhension des relations intersubjectives et des obligations des individus les uns envers les autres ». C’est une perspective bien différence de celle de l’individualisme libéral occidental où prévaut le gain et l’intérêt personnel. Les auteurs citent l’économiste anglais du XVIIIe siècle, Adam Smith, auteur du livre : « Wealth of Nations » : « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre repas, mais de la manière dont il met en œuvre son propre intérêt. Nous nous adressons nous-même, non pas à leur humanité, mais à leur amour pour eux-mêmes et nous ne leur parlons jamais de notre nécessaire, mais de leur intérêt ». L’ethos d’Ubuntu est fondé sur la croyance dans l’intérêt collectif et dans la coopération. Les individus peuvent améliorer leur humanité en contribuant au collectif et en établissant des relations positives (p 231-232).
Cependant, on doit dire que Ubuntu ne se limite pas à une dichotomie entre communautarisme et individualisme ; sinon, nous aurions perdu de vue des éléments fondamentaux du discours sur l’humanisme africain. La philosophie de l’Ubuntu maintient qu’un accomplissement et une prospérité individuelle dépend d’une communauté soutenante… Mais ainsi, au lieu de nier une identité individuelle, en fait, Ubuntu la renforce » (p 233). En regard d’une conception abstraite du soi et de la rationalité, Ubuntu met en valeur le rôle des relations et de la communauté dans la formation de l’identité personnelle et la croissance éthique.
Si les conceptions de Ubuntu et de la philosophie de la justice différent, elles s’accordent pour défendre la dignité des individus et soutenir les plus vulnérables. Cependant, « en intégrant les principes de l’Ubuntu, la philosophie occidentale pourrait étendre son cadre éthique, adopter des interprétations relationnelles et contextuelles de la personnalité, et explorer de nouvelles méthodes pour l’éthique sociale, la justice, et la construction d’une communauté. Ubuntu pourrait enrichir la philosophie occidentale en portant son attention sur des aspects négligés de l’existence humaine, en cultivant une compréhension plus intégrée de l’éthique, et en plaidant pour des valeurs d’empathie, de compassion et de bien-être communautaire » (p 233).
Cependant, Ubuntu intervient également dans d’autres domaines. Ainsi, elle porte des idées concernant « la richesse sociale et un capitalisme inclusif ». Comme on peut l’imaginer, elle introduit un principe de responsabilité dans la vie économique. De même, Ubuntu est particulièrement propice à une politique économique et environnementale. « Ubuntu envisage les individus, les communautés et le monde naturel dans un mode symbiotique. La mise en œuvre d’Ubuntu dans le développement durable s’appuie sur une vision holistique qui reconnait l’interdépendance des systèmes sociaux, économiques et environnementaux ». C’est « le passage d’une vision anthropocentrique à une vision écocentrique, la reconnaissance de la corrélation entre le bien-être humain et la santé environnementale. La philosophie d’Ubuntu met également en valeur le système de connaissance indigène qui offre des approches pertinentes pour une gestion durable des ressources et la préservation écologique (p 234).
Si, au cours des derniers siècles, la globalisation du monde a résulté, pour une part d’une activité effrénée et d‘une prétention insensée de vastes portions de la société occidentale, en regard, elle a également permis la rencontre de civilisations qui ont exercé une influence envers elle, comme le montrent David Graeber et David Wengrow dans leur livre sur l’histoire de l’humanité (7). Aujourd’hui, à une époque, où l’impérialisme antérieur s’est largement effondré, l’influence des cultures autochtones, en Afrique comme en Asie, peut témoigner de leurs sagesses et s’exercer à l’échelle du monde. Il en va ainsi pour la sagesse bantu : Ubuntu, qui a donné lieu à plusieurs publications. Ainsi, aux précédentes déjà évoquées, on peut rajouter un livre écrit par la petite-fille de Desmond Tutu, Mungi Ngomané ,aujourd’hui très active sur la scène internationale : « Ubuntu. Leçons de sagesse africaine » (8). Cet ouvrage porte en sous-titre une maxime qui caractérise la philosophie d’Ubuntu : « Je suis, car tu es ». En regard d’un individualisme qui se suffit à lui-même, c’est la relation humaine qui, ici, est première. Or, aujourd’hui, dans la culture européenne, un courant de pensée, qui va en grandissant, met l’accent sur l’importance et la nécessité de la relation (1). Le terme de « reliance » commence à apparaitre. La spiritualité est envisagée en terme de relation entre les humains, avec soi-même, avec la nature et avec Dieu. Et, Dieu lui-même est un Dieu trinitaire, un Dieu relationnel. Cette approche apparait fréquemment sur ce blog dans les écrits de théologiens comme Richard Rohr et Jürgen Moltmann. La référence à ce dernier apparait chez des théologiens africains qui apprécient la philosophie de Ubuntu. Ainsi envisager Ubuntu aujourd’hui, ce n’est pas considérer un phénomène exotique, mais prêter attention à un état d’esprit qui est source d’inspiration.
J H
- Relions-nous ! Un livre et un mouvement de pensée : https://vivreetesperer.com/tout-se-tient/ La vie spirituelle comme une conscience relationnelle ; une recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/ Reliance ; une vision spirituelle pour un nouvel âge : https://vivreetesperer.com/reliance-une-vision-spirituelle-pour-un-nouvel-age/ Reconnaître et vivre la présence d’un Dieu relationnel : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-et-vivre-la-presence-dun-dieu-relationnel/
- A comparative study of an African concept of justice. Edited by Paul Nnodim and Austin C. Okigbo. Leuven University Press. 2024
- Kaumba Lufunda Samajiku; Comprendre Ubuntu. R.P. Placide Tempels et Mgr Desmond Tutu Sur une toile d’araignée. L’Harmattan, 2020
- Esprit et écologie dans le contexte de la théologie africaine : https://www.temoins.com/esprit-et-ecologie-dans-le-contexte-de-la-theologie-africaine/
- Pour une vision holistique de l’Esprit : https://vivreetesperer.com/pour-une-vision-holistique-de-lesprit/
- Mandela et Gandhi, acteurs de libération et de réconciliation : https://vivreetesperer.com/non-violence-une-demarche-spirituelle-et-politique/
- David Graeber, Davis Wengrow. Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité. Les liens qui libérent, 2023
- Mungi Ngomane. Ubuntu. Leçons de sagesse. Je suis, car tu es. Harper Collins, 2019

Un esprit de solidarité, du récit biblique à la présence de Jésus (1)
Quel est le sens biblique de la solidarité ? La question est posée à Renny Golden qui , dans les années 1980, s’est engagé en faveur de l’accueil aux Etats-Unis, des réfugiés d’Amérique Centrale fuyant la violence.
« Le mot : solidarité n’apparaît pas tel quel dans la Bible. Cependant, comme pratique de foi, il capte l’essence des traditions juives et chrétiennes. La Bible est l’histoire multimillénaire des israélites essayant de maintenir une solidarité avec leur Dieu et avec les pauvres ». Quel est l’esprit de cette solidarité, « Lorsque au début, Dieu appelle Moïse à sortir le peuple de l’esclavage, celui-ci rechigne et cherche des excuses ( Exode 3.13, 4.1, 10). Mais Dieu promet : « Je serai avec toi » Ce n’est pas du paternalisme ou de la pitié. C’est travailler épaule contre épaule dans une œuvre de libération ».
Dieu manifeste sa solidarité avec l’humanité en Jésus. « La naissance de Jésus, l’incarnation de Dieu dans le monde est l’acte paradigmatique de la solidarité. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a pris une forme humaine. C’est une identification complète avec la condition humaine, une solidarité totale avec l’histoire humaine. Jésus a du fuir les excès du pouvoir impérial. Il a été une menace pour l’ordre établi et il a du fuir les escadrons de la mort du gouvernement romain ( Matt 2.13-14). Jésus a commencé sa vie non pas comme membre d’une élite, mais comme un réfugié, un sans abri. Ainsi, l’amour de Dieu pour le monde se manifeste très particulièrement pour les persécutés, les rejetés, les fugitifs ».
Comme le montre Robert Chao Romero, le ministère de Jésus a manifesté la solidarité. « Dieu est devenu chair et a lancé son mouvement parmi ceux qui étaient méprisés et rejetés à la fois par les romains et par l’élite du peuple. Jésus n’est pas allé vers la grande ville en cherchant à recruter parmi l’élite religieuse, politique et économique. Pour changer le système, Jésus devait commencer avec ceux qui étaient exclus du système. Bien que la bonne nouvelle de Jésus était pour l’ensemble de la famille humaine, elle va d’abord aux pauvres et à ceux qui sont marginalisés. Comme un père aimant (ou une mère), Dieu aime tous ses enfants également, mais se préoccupe particulièrement de ceux ou celles qui souffrent le plus ».
Les gens, qui souffraient du double fardeau du colonialisme romain et de l’oppression spirituelle et économique des élites, attendaient de Dieu une libération ». Effectivement, les plus faibles ont été considérés comme indispensables. « Bien qu’ils aient été considérés comme les moins honorables, Jésus leur a porté le plus grand honneur. Jésus a accordé le plus grand honneur à ceux qui en manquaient ( 1 Corinthiens 12. 22-25).
Un esprit de solidarité et pas de jugement (2)
Richard Rohr envisage le cœur du christianisme comme la solidarité aimante de Dieu avec tous le gens. « A travers Jésus, la propre vision du monde de Dieu, vaste, profonde et entièrement inclusive est rendue accessible à tous. En fait, j’irai jusqu’à dire que la marque de la vie chrétienne et de se tenir en solidarité radicale avec tout autre. C’est l’effet final et intentionnel – symbolisé par la croix, qui est le grand acte de solidarité de Dieu à la place du jugement. Voilà comment nous sommes appelés à imiter Jésus, cet homme juif bon qui voyait et appelait le divin dans les « gentils », comme la femme syro-phénicienne et les centurions romains qui l’ont suivi, dans les collecteurs d’impôt juifs qui collaboraient avec l’Empire, dans les zélotes qui s’y opposaient, et tous ceux « en dehors de la loi ». Jésus n’avait pas de problème quelque il soit avec l’altérité ».
Jésus a inclus. Il n’a pas exclu. « La seule chose que Jésus a exclus, c’est l’exclusion elle-même ».
A cet égard, comment envisager aujourd’hui notre attitude vis–à-vis de personnes pratiquent d‘autres modes de sexualité que celui qui dérive directement de notre interprétation des écritures. Ici, la parole est donnée à Shannon Kearns, prêtre transgenre. Il nous apporte « un exemple de la solidarité inclusive de Dieu avec les eunuques, minorités sexuelles à l’époque du prophète Esaïe. En Esaïe ( 56. 3b-5), le prophète déclare : « Et ne laissez pas les eunuques dire : « Je ne suis qu’un arbre sec ». Le Seigneur déclare : « Aux eunuques qui gardent mes sabbats, choisissent ce qui m’est agréable et qui persévéreront dans à mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférables à mes fils et à mes filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas ». C’est une parole de réconfort et d’espérance. C’est une parole de guérison ». En commentaire, Shannon Kearns nous dit comment ces paroles bibliques « résonnent fortement pour beaucoup de gens transgenre et non-binaire ». « Ils résonnent aussi fortement pour les nombreuses personnes qui se sont senties exclues et rejetées d’une entrée dans un espace religieux à cause de leur diversité de genre ».
Nous sommes donc invités à regarder autour de nous et à nous poser des questions : « Qui est en train d’être exclu ? Qui n’est pas bienvenu ? Pour qui il n’y a pas de place ? Le message est en Esaïe 56 et dans le récit de l’eunuque éthiopien en Acte 8 : « Il y a une place aussi pour eux dans le Royaume de Dieu. Ils n’ont pas besoin de changer pour être inclus. Ils sont rendus dignes d’être inclus en désirant l’être ».
La spiritualité de la solidarité (3)
Barbara Holmes, à qui on a fait appel dans cette séquence, nous invite, à la suite de Jésus, « à discerner les signes des temps et à être un baume toujours présent dans ce monde troublé ». « Le physicien Neill de Grasse Tyson nous rappelle que notre solidarité n’est pas un choix, c’est une réalité. Nous sommes tous connectés les uns aux autres, biologiquement, à la terre chimiquement, et, au reste de l’univers atomiquement. Notre solidarité est un fait scientifique aussi bien que l’acte de salut d’un Sauveur aimant et un Saint Esprit sage et guidant. Et même cet appel à la solidarité est incarné par le Divin. Parce que Jésus est venu et a vaincu et renversé les systèmes de ce monde, il nous appelle à faire de même ».
Mais est-ce bien possible ? « Les systèmes disent que les changements ne peuvent pas arriver, que la gravité gagne, que la religion n’a pas d’utilité excepté de calmer les gens, que vous faites mieux de mettre votre confiance dans des fonds communs de croissance. Mais Jésus déclare qu’il y a une autre voie la – voie prophétique – et même maintenant, il nous appelle à nous avancer sur la parole, à nous rassembler en un, et à exercer nos dons. Alors seulement, nous pourrons faire la paix avec nos voisins, mettre fin à la violence du canon et arrêter notre addiction à la division. La solidarité et la compassion, c’est l’amour en action ».
Mais comment envisager une spiritualité de la solidarité ? Selon l’écrivaine Margaret Swedish, cette spiritualité commence à se manifester « en honorant la présence divine en chaque être humain ».
« Je crois que Dieu nous a donné le plus grand exemple de solidarité lorsque Dieu a envoyé son fils Jésus vivre avec nous » (réfugié salvadorien). Nous sommes appelés à un état d’esprit dans lequel nous sommes persuadés que les autres ont une valeur égale à la notre. « Ma vie n’est pas plus valable ou digne, de plus grande ou de moindre signification que celle d’un autre être humain. Je ne suis pas plus ou moins méritant. Mes droits ne sont pas plus importants que ceux de cette autre personne. Cette spiritualité commence à un endroit douloureux – avec l’acceptation du fait que le monde est brisé et que nous sommes brisés. Dans cela, nous cherchons des liens profonds avec les personnes blessées de notre monde. Et en cette place vulnérables, nous cherchons le cœur de la solidarité : la compassion ».
La séquence sur la solidarité présentée sur le site : « Center for action and contemplation » se poursuit ensuite dans d’autres éléments, notamment par une méditation de Richard Rohr sur la solidarité divine avec la souffrance. Ce texte, tant par la densité émotionnelle du propos que par les questions qu’il soulève requiert un traitement particulier. Nous nous bornerons ici à cette première évocation de la solidarité, un thème qui correspond bien à notre conscience actuelle et qui en met la signification chrétienne en valeur.
J H
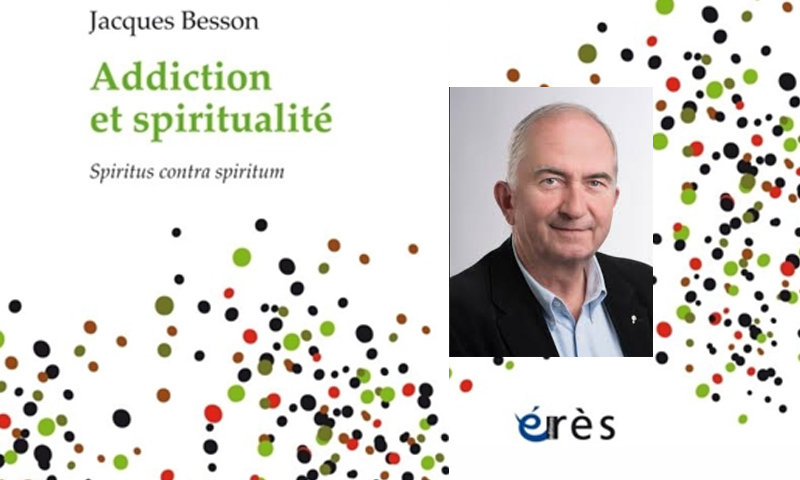
Spiritualité et psychiatrie
La vision spirituelle du médecin psychiatre, Jacques Besson dans la découverte de nouveaux horizons : les neurosciences, les synchronicités, la lutte contre les addictions, l’usage des psychédéliques, le chamanisme…
Auteur d’un livre sur : Addiction et spiritualité (1), Jacques Besson, médecin psychiatre, addictologue, ancien chef du département de psychiatrie communautaire du département de psychiatrie du centre hospitalier universitaire vaudois, professeur honoraire de l’Université de Lausanne, a été fréquemment interviewé dans des vidéos sur You tube (2). Il y met en évidence des relations sensibles entre spiritualité, présence d’une conscience, lutte contre les addictions, usage des psychédéliques, expérience de mort imminente, expérience du chamanisme. En même temps, Jacques Besson se présente comme un croyant enraciné dans une foi chrétienne d’inspiration protestante. En écoutant Jacques Besson, nous découvrons des réalités qui se manifestent aujourd’hui et sur la signification desquelles nous nous interrogeons. A partir de son expérience et des connaissances, il nous apporte un éclairage précieux. Voici donc quelques aperçus à partir d’une interview de jacques Besson par Didier Reinach : « Spiritualité et créativité de soi – l’esprit du bonheur » (3).
Cheminement professionnel et spirituel de Jacques Besson
Au départ, l’intervieweur rappelle les intérêts de Jacques Besson : « la psychiatrie communautaire, la santé mentale, les rapports entre la psychiatrie, la religion, la spiritualité et les neurosciences ». Il pose donc une première question : « Pourquoi la spiritualité est-elle un chemin de guérison ? » Et il l’interroge sur ses motivations : « Qu’est-ce qui te pousse, qu’est-ce qui te porte à introduire la dimension spirituelle ? ». La réponse porte d’abord sur les racines : « Je viens d’une longue tradition protestante. Comme enfant, j’ai eu des visions, des intuitions, des aspirations sur l’invisible, sur la lumière du monde. Cela m’a toujours intrigué et passionné. Depuis l’âge de cinq ans environ, je m’intéresse à l’individu, à la question de l’esprit ». Jacques Besson s’est donc dirigé vers la médecine ; puis, il s’est intéressé à la neurologie. Il est passé ensuite à la psychiatrie, puis à la psychanalyse. Et de la psychanalyse, il s’est dévoué pour des populations vulnérables, pour la médecine des pauvres au Centre Saint-Martin qui a accueilli des milliers toxicomanes. C’était une médecine communautaire, généreuse. De là, Jacques Besson est devenu un expert en addictologie, une science interdisciplinaire qui rassemble un ensemble de savoirs pour faire face à la complexité du problème de l’addiction. Il s’est engagé dans des psychothérapies et c’est là qu’il s’est rendu compte petit à petit que « la question du sens était centrale ». Jacques Besson a également été médecin dans l’Armée du Salut. Il a vu là un témoignage magnifique et il y a beaucoup appris. C’est là qu’il a rencontré « les alcooliques anonymes », un mouvement spirituel et non religieux qui a commencé dans les années 1930, où les participants se remettent à une puissance supérieure, à plus grand qu’eux-mêmes, pour leur rétablissement. Les « alcooliques anonymes » ont actuellement plusieurs dizaines de millions d’adeptes en traitement qui vont bien. Jacques Besson, bien au fait de la biologie moléculaire, a considéré les bienfaits engendrés par l’approche des alcooliques anonymes : les différentes étapes, le lâcher-prise et la conscience dans l’univers. Il s’est alors demandé : est-ce qu’il y aurait une neuroscience des alcooliques anonymes ? La réponse est oui. Il y a eu beaucoup de recherches en imagerie sur l’impact de la prière, de la méditation. Dans les années 1990, au cours d’une année sabbatique à Harvard, il a pu suivre les débuts de l’imagerie fonctionnelle cérébrale et il a découvert la puissance de l’instrument. « Entre addiction et spiritualité, il y a un rapport très étroit. D’un côté, l’addiction est une impasse de sens. De l’autre côté, la spiritualité est une ouverture à plus grand que soi. Donc la spiritualité est un instrument puissant pour la prévention et le rétablissement des addictions ». Après avoir fait une thèse sur la correspondance échangée entre Freud et le pasteur Pfister où les fondements du dialogue entre psychanalyse et religion étaient posés, Jacques Besson s’est engagé dans une étude de la pensée de Carl Jung et, pendant une dizaine d’années, il s’est formé à la psychanalyse jungienne en autodidacte, puisque celle-ci n’est pas agréée dans l’enseignement officiel. Il y a trouvé les ingrédients dont il avait besoin pour établir un lien entre science et spiritualité. « Il peut y avoir une science de l’esprit qui est plus grande que celle du cerveau ou de la psychologie, et la question de l’inconscient collectif, la question du Dieu inconscient, la question de ce qui nous transcende et de ce qui nous traverse sont des questions qui ont habité les humains depuis toujours et Jung a été un investigateur de génie sur ces questions ». Par la suite, Jacques Besson s’est tourné vers l’œuvre du sociologue médical, rescapé d’Auschwitz, Aaron Antoniovsy. Il a observé la vie dans les camps et « il en a tiré la conclusion que les humains avaient besoin de sens et de cohérence, de cohérence permettant d’aligner le somatique, le psychique et le spirituel, et d’être droit dans ses bottes, d’avoir un sens dans la vie. Voilà ce qui est générateur de ce qu’il a appelé lui-même la salutogenèse. La salutogenèse, à travers ses origines latines entend le salut à la fois comme santé et comme salut. La salutogenèse est le concept génial qui créé la promotion de la santé. Les médecins obsédés par les causes des maladies s’intéressent beaucoup moins aux attracteurs de santé et je me suis passionné pour le ‘solutionnisme’, c’est à dire conjuguer toutes les approches disponibles dans un champ comme les addictions où la médecine était très pauvre et pouvoir venir ainsi à l’aide de populations vulnérables ».
Mais, si l’on peut distinguer des groupes vulnérables, « nous sommes tous aujourd’hui vulnérables d’une certaine manière… Nous avons tous des carences, nous avons tous des maltraitances… la condition humaine fait que la vie est imparfaite et que nous sommes sur un chemin entre l’inaccompli et l’accompli. C’est une voie mystique qui ne me fait pas peur parce qu’elle est compatible avec la vision scientifique d’un monde évolutionnaire ».
Aujourd’hui, « l’humanité est traumatisée et elle n’accède pas, pas encore, aux instruments de guérison, cet alignement entre le physique, le psychique et le spirituel, entre la science de la nature, la science humaine et, peut-être la science de l’esprit. Donc, j’ai toujours cherché cette cohérence, cet alignement… Je n’ai jamais quitté cette ligne et je suis ‘le capitaine de mon âme’ » (cette expression en écho à celle du poème récité en priant, par Nelson Mandela dans sa prison).
L’être humain et la spiritualité
L’entretien se poursuit au sujet de la nature humaine. Nous ressentons aujourd’hui les effets nocifs du matérialisme. « Ce matérialisme, dans lequel nous sommes désespérément plongés, nous coupe de ce que les peuples premiers savaient très bien… C’est que le monde est un. Nous sommes dans une totalité ». En demandant à ses étudiants en médecine : où est l’esprit, Jacques Besson les amenait à penser qu’il n’était pas seulement dans le cerveau, dans le corps, mais que, pour vivre, l’être humain avait besoin d’un langage, de relations, d’une culture ; « il faut une humanité, il faut une planète, il faut un univers. Pour un seul être humain, il faut la totalité de l’univers et le grand mystère, c’est que chaque être humain représente une singularité ». Mais cette singularité se vit en complémentarité, dans un ensemble. « Plus on va vers soi-même, disent les sages du premier millénaire chrétien, plus on s’approche de Dieu, mais il s’agit de soi-même, au sens de Jung, c’est à dire d’une individuation. Il s’agit de bien comprendre le rapport entre le soi et la totalité ».
C’est un apport de la psychanalyse jungienne qui, elle-même, peut être envisagée comme une étape pour aller plus haut. A partir d’un épisode vécu et rapporté par Jung, du ‘rêve d’un scarabée par un patient et l’apparition de cet insecte à la fenêtre’, la conversation s’engage sur le phénomène des synchronicités. Jacques Besson a vécu de nombreuses synchronicités dans sa carrière et « il est convaincu que ce phénomène introduit une fenêtre sur un rapport différent au temps, au temps qui nous dépasse, au temps vertical, le grand temps, celui qui s’est déployé avec le big bang… ». L’accueil des synchronicité requiert « une grande ouverture au monde, à l’univers, à la conscience, qui est bien plus grande que ce qu’on peut imaginer, et pour les scientifiques, beaucoup d’humilité », vertu trop peu répandue… « Il faut être bien conscient des limites de la science pour accéder à un monde plus grand… La foi et la science ne s’oppose pas. On peut être scientifique et mystique. La science s’occupe des ‘comments’. Elle propose des modèles. La métaphysique propose des intuitions, des visions ».
La conversation se poursuit sur les ressources du cerveau humain. « Le cerveau a de nombreuses fonctions… Le cerveau est un univers à lui tout seul. C’est un microcosme. L’univers du cerveau est un univers infiniment complexe ». Ainsi, s’il y a un infiniment petit et un infiniment grand, « comme l’a intuitivement prédit, le génial Blaise Pascal, l’homme est le milieu de toutes choses et l’être humain est entre les deux infinis, le petit et le grand, et je suis arrivé à la conclusion qu’il détient le troisième infini qui est l’infiniment complexe… La science se préoccupe d’objectiver. La ligne de la science, c’est bien l’objectivité, mais nous autres, êtres humains, nous vivons aussi d’une subjectivité et la science du sujet est extrêmement importante. C’est la science de la conscience précisément… La totalité implique d’avoir recours à la science et à la conscience, à la science et à la spiritualité ».
Spiritualité, soin, médecine
Une question de l’interviewer : Est-ce que la spiritualité peut soigner des égos blessés, des égos malades ? Jacques Besson répond en évoquant « une nouvelle science qui a fait d’énormes progrès depuis une quinzaine d’années : la psycho-traumatologie. La psycho-traumatologie est l’étude interdisciplinaire des traumatismes psychiques. Nous avons tous un certain capital de santé mentale et nous pouvons supporter ainsi un certain nombre de souffrances. Mais s’il y a effraction, un abus trop fort, une agression trop violente, la blessure psychique qui en résulte est un traumatisme. La question du traumatisme est très importante parce qu’elle participe au diagnostic d’une vulnérabilité particulière chez certaines personnes qui peut être investiguée et surtout peut être traitée.
Puis, une grande question se pose : pourquoi moi ? Pourquoi à moi, m’est-il arrivé tel accident, tel malheur ? Et le ‘pourquoi moi’, est un grand mystère. C’est une blessure parce que c’est incompréhensible. Le monde est imparfait. L’arrivée d’un accident nous dépasse et la spiritualité nous aide à redonner du sens, à recouvrir notre âme… C’est la technique chamanique. C’est l’extraction d’esprit et le recouvrement d’âme. Les chamans sont spécialistes du trauma à leur manière. L’extraction d’esprit, c’est se détourner de ce qui nous a blessé, peut-être l’extraire ou tout au moins s’en détacher. Le recouvrement d’âme, c’est aller vers plus grand que soi. Et voilà un mouvement salutogénique. Et voilà, les peuples premiers ont cette intuition qu’il y un rétablissement possible. La santé mentale est le fruit d’une plasticité. Et cela, c’est tout l’espoir que peut avoir un psychiatre, un psychiatre psychothérapeute en l’occurrence. Le cerveau est plastique. C’est à dire que les connexions s’adaptent à l’environnement, à la culture. Les neurones dialoguent entre eux et se connectent. Et cela laisse de la trace.
Donc, du coup, l’expérience spirituelle, cela laisse de la trace. Pour en donner un exemple, la méditation en pleine conscience, qui s’est occidentalisé récemment, se révèle modifier la connectivité cérébrale, ainsi que montre les nouvelles techniques d’imagerie. On devient plus autonome affectivement et cognitivement, plus souple. Ce sont des encouragements très forts pour relier la médecine psychiatrique, la médecine somatique et la psychothérapie. Depuis plusieurs années, j’ai eu la chance d’introduire la santé spirituelle à la faculté de médecine, notamment à la suite de la rencontre publique avec le Dalaï Lama en 2013.
Je lui ai posé la question des trois ordres de la médecine et il m’a répondu avec beaucoup de chaleur que c’était une question qu’il fallait absolument explorer en Occident, car, pour la médecine tibétaine, il est évident que le premier rang de la santé est la santé spirituelle. En découle la santé psychique dont découle la santé physique. Or, en Occident, nous faisons très exactement le contraire. Nous avons jeté les bases d’une santé somatique, nous avons élaboré correctement une psychiatrie qui tient la route, mais nous somme encore très loin de la singularité du sujet, de la question du lien, de la question du sens qui sont les vraies questions qui mobilisent la salutogenèse et le rétablissement ».
Une création de sens ? suggère l’interviewer. C’est inné ou cela se travaille ? demande-t-il. « Les deux à la fois » répond Jacques Besson. « Je crois qu’il y a du divin dans l’homme, pour citer les Pères de l’Église ». En reprenant une expression latine, « l’homme est capable de Dieu. C’est-à-dire, il a une intuition du beau, du bien, du vrai, du juste, et il peut suivre ce chemin. C’est un possible. Alors cela nécessite évidemment un travail. Le Bouddha a dit : « Le bonheur est sur le chemin ». Alors, cheminons.
Psychédéliques, chamanisme, médecine ouverte
Jacques Besson envisage son approche de la guérison sous différents angles. Ainsi, dans un cadre psychiatrique, il participe à « la réhabilitation des psychédéliques (champignons hallucinogènes, Lsd, certaines formes d’ecstasy) », à des fins thérapeutiques. Historiquement, ces substances ont été stigmatisées après le premier développement de leur usage aux Etats-Unis, mais on observe aujourd’hui un retour parce qu’on a compris que ce n’est pas le même groupe de drogues que les opiacés, la cocaïne ; un groupe différent qui a la capacité de perturber l’ordre psychique, mais à petites dose, bien contrôlées et dans un cadre thérapeutique, cela peut permettre de modifier un ordre établi dans le sens d’ouvrir certaines mémoires qui étaient dans des tiroirs. Lorsqu’un traumatisme désorganisateur infecte une existence, il vaut mieux le sortir, l’aérer. Et cela, c’est l’extraction d’esprit et le recouvrement d’âme opérés par les chamans, c’est ce que la psychanalyse essaie de faire laborieusement avec de longs processus, c’est ce que l’hypnose essaie de faire par des conditionnements, mais les psychédéliques sont aujourd’hui le moyen le plus prometteur pour accéder aux souvenirs traumatiques dans un contexte sécurisé et élargir la conscience… On pense que les psychédéliques ont le pouvoir d’accroitre la plasticité neuronale, et notamment les champignons, ce que les peuples premiers savaient très bien. Aujourd’hui les médicaments les plus prometteurs en psychiatrie sont ceux qui ont été les plus ostracisés et maudits quand j’étais jeune. Le cannabis ouvre des perspectives intéressantes en médecine curative et les psychédéliques ouvrent des pistes intéressantes pour la santé mentale ».
Jacques Besson critique les préjugés engendrés par un matérialisme réductionniste vis-à-vis des pratiques des peuples premiers. « J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui se sont intéressées scientifiquement au chamanisme. Ainsi le docteur Olivier Chambon en France qui a écrit un texte de référence : « Psychothérapie et chamanisme ». Il évoque la psychologie transpersonnelle, notamment Stéphane Gros. Ce sont des psychologues qui acceptent qu’on puisse communiquer d’inconscient à inconscient et communiquer avec plus grand que soi. Le chamanisme, c’est aussi une communication avec un monde plus grand. Le chamane et à la fois prêtre et médecin. Aujourd’hui, nous avons rejeté le prêtre et garder le médecin.
Il est grand temps de réconcilier le prêtre et le médecin, le spirituel et le scientifique ». il y a un fossé à combler. Cependant, en médecine scientifique, on enseigne la psychologie médicale, les fondements de la relation médecin-malade, l’alliance thérapeutique et il y a maintenant une science établie de l’effet placebo. Le médecin revient au prêtre par des voies détournées. Et il utilise très largement, souvent inconsciemment, le chemin de la suggestion (suggestion que Freud n’aimait pas trop). Pour ma part, je pense que le médecin de famille est un homme de confiance. Il a le manteau du druide. Il fait de la suggestion. Et c’est une bonne chose ! Les médicaments parfois peuvent avoir un effet placebo sans le savoir ». Jacques Besson évoque une recherche sur les antidépresseurs qui montre qu’il n’y a que 5% de variance entre le placebo et le médicament. « Cela rend modeste quand on pense qu’on a dépensé des milliards pour des antidépresseurs.
« Je crois qu’il faut être juste et humble. Il y a un ordre somatique de la médecine. Il y a des gènes. Il y a des molécules. Il y a un déterminisme biologique. Il y a une génétique. Mais il y a aussi une épigénétique. Les gènes dialoguent avec l’environnement. Le sujet a une histoire dans sa nature, dans son contexte. Et c’est toute la force de l’ordre psychique. Nous avons une éducation, un environnement, une culture, des valeurs et cela produit de la plasticité ». Il y a des intuitions. L’intuition est une dimension de l’appareil psychique qui n’est pas étudiée en psychothérapie. Elle est souvent destinée aux « bonnes femmes » alors que la femme a beaucoup plus d’intuition que l’homme.
C’est probablement avec les femmes que l’on a eu les plus grandes découvertes de la sacralité. Certes, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, mais ces différences ne sont pas absolues. « Il y a l’ordre psychique, les apprentissages, les valeurs qui ont été transmises. Mais je pense que la réponse la plus appropriée est dans la psyché, les archétypes, l’animus et l’anima… La santé psychique, c’est le dialogue, le mariage entre l’animus et l’anima. C’est la rencontre des opposés. Pour atteindre la totalité, l’individuation, il faut avoir marié l’anima et l’animus… ». Cette analyse se poursuit au niveau de l’univers. « La rencontre du ciel et de la terre se fait pour que l’homme puisse accéder à plus grand que lui. Henri Bergson disait : « la terre est un incubateur de Dieu ». Tout se passe comme si la matière voulait être spiritualisée… ». C’est une vision de réconciliation.
Puis, Jacques Besson évoque l’amour des autres comme l’amour de soi. » Pour les bouddhistes, pas de sagesse sans compassion. Pour les chrétiens, pas de vérité sans charité. La conscience ne suffit pas… il faut passer par le don de soi ; par la créativité, par le nouveau. Si nous sommes dans un univers évolutionnaire, alors nous faisons partie de l’évolution. Nous avons une responsabilité. Nous sommes des co-créateurs ».
« La méditation, la prière, la sagesse des peuples premiers et la religion peuvent nous apporter quelque chose. La spiritualité n’a pas besoin d’être religieuse ; mais je pense qu’il y a des religions qui peuvent être spirituelles. Personnellement, j’ai beaucoup d’admiration pour le soufisme… Soyons humble. Gandhi a dit : « celui qui va au fond de sa religion, va au fond de toutes les religions ». Le noyau dur des religions, c’est la spiritualité, c’est la sacralité, c’est le rapport entre la vérité et la charité. C’est cela le noyau dur ».
Quelles lectures éclairantes ? Une inspiration biblique
L’intervieweur demande à Jacques Besson de nous conseiller. Et, entre autres, quelles lectures comptent pour lui ? La réponse va à l’encontre de la mode. C’est « lire la Bible ». « Parce que c’est, quand même, un livre incroyable. Ce sont des centaines d’auteurs qui écrivent ensemble dans des moments différents, dans des contextes différents, pour exprimer une forme de vérité profonde dont ils ont eu l’inspiration, la révélation pour le bien de la communauté. Il y a, bien sûr, des chapitres plus difficiles, mais lire la Bible avec la psychologie des profondeurs, avec de l’éveil, avec un regard chamanique, c’est très riche de sens, de lien, d’expérience d’autres humains, d’autres situations. Quand Moïse va chercher les tables de la loi et qu’il trouve les « couillons » avec le veau d’or, c’est une modernité effrayante. Et le Christ sur sa croix qui est plus fort que la mort – après, on peut l’interpréter de plusieurs manières – c’est actuel, je pense. Si on ne s’occupe pas trop de la mort, on devient tellement plus vivant. Il faut vivre l’instant ». Et donc, si la Bible n’est plus toujours appréciée, Jacques Besson s’écrie : « moi, je la lis ». Certains passages le touchent davantage ; « Ma petite préférence va à l’Évangile de Jean. Dans l’Ancien Testament, j’aime beaucoup le Livre de Job, le malheur de l’innocent… Il y a les psaumes qui sont merveilleux aussi et bien sûr les Évangiles. Septante trois guérisons du Christ. Le Christ est un exorciste. C’est un immense chaman. Le Saint-Esprit, vu par la spiritualité et les neurosciences, c’est le Grand Esprit, c’est l’âme du monde ». Paracelse est cité en évoquant ‘la lumière, l’âme du monde’. « Lisez Paracelse, lisez Jung, lisez la Bible, regardez la biographie de Gandhi ».
Interrogé sur l’esprit qui l’anime, Jacque Besson revient à son enfance : « Quand j’avais quatre ans, mon grand-père est mort dans des conditions assez tristes et ma mère a fait une assez grave dépression ; je me suis mis à avoir peur du noir. C’était assez angoissant. Un jour que ma nourrice s’occupait de moi, elle a remarqué que j’avais peur du noir et elle s’est adressée à moi avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d’humanité, elle m’a dit : Jacques, il ne faut pas avoir peur du noir. Non, il ne faut pas avoir peur du noir parce que, dans le monde, il y a une lumière invisible. Oui, c’est une lumière qui éclaire et qui réchauffe le cœur des enfants. C’est un enfant aussi qui la donne. Il s’appelle Jésus. Cela m’a intéressé : il y aurait une lumière invisible et un autre enfant qui la donne. Et il est d’un autre ordre… Donc, à partir de quatre-cinq ans, je me suis intéressé à cette figure. On m’a envoyé à l’école du dimanche. Je me suis passionné pour les personnages de la Bible : Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et les pharaons, Moïse, David, Goliath et puis, après, le Christ. J’ai toujours eu cette intuition qu’il y a du visible dans l’invisible. Et plus tard, j’ai découvert, avec les Pères du premier millénaire chrétien ce qu’ils appellent l’intelligible, non pas au sens de l’intelligence, mais au sens que dans l’invisible, il y a des choses qu’on peut comprendre, auxquelles on peut accéder, c’est une grâce divine. Alors, toute ma vie a été éclairée, d’un côté par mon intérêt sincère et rigoureux pour la science et mon intérêt sincère et rigoureux pour la spiritualité. Et, un jour j’ai découvert, je crois que c’est Jean Calvin qui l’a dit, « la science permet l’émerveillement ». J’avais une passerelle….
Cette contribution de Jacques Besson nous parait particulièrement éclairante et innovante. Elle reconnait et prend en compte des réalités émergentes comme par exemple les résultats de l’imagerie cérébrale, les synchronicités et le chamanisme. Des courants de pensée et de recherche, encore minoritaires sont pris en compte. Un nouveau paysage apparait.
Cette contribution nous parait doublement précieuse. A l’encontre d’un matérialisme encore puissant, elle instaure une nouvelle compréhension de la nature humaine et de l’ordre du monde d’autant qu’en plus des phénomènes mentionnés dans cet interview, on peut en ajouter d’autres comme les expériences de mort imminente présentées par l’auteur dans une autre vidéo. En même temps, elle installe la spiritualité dans la préservation et le recouvrement de la santé.
On peut ajouter un autre apport qui nous parait précieux dans la configuration religieuse actuelle où certains courants fondamentalistes manifestent une étroitesse d’esprit en considérant négativement des phénomènes émergeants jusqu’à les condamner et à les rejeter avec violence au nom d’une interprétation littérale de la Bible. Or, ici, Jacques Besson conjugue la reconnaissance de ces phénomènes avec un témoignage de foi chrétienne et une lecture de la Bible à la fois instruite et enthousiaste.
Ainsi, à tous égards, cette contribution nous parait appeler une particulière attention.
Rapporté par J H
1.Jacques Besson. Addiction et spiritualité. Spiritus contre spiritum. Erès, 2017. « L’auteur propose un voyage depuis l’aube de l’humanité en compagnie des substances psycho-actives jusqu’à l’épidémie addictive contemporaine. Il montre comment l’addiction représente une pathologie du lien et du sens. Les relations entre addiction et spiritualité sont explorées par les dernières recherches neuroscientifiques sur la méditation et la prière, dans ce qui est devenu une nouvelle science, la neurothéologie »
2. La CONSCIENCE , moteur de la prochaine REVOLUTION : https://www.youtube.com/watch?v=-bA52VG7wZg
Expériences de mort imminente : la science face à une énigme : https://www.youtube.com/watch?v=REoY0EwwnMM
3.Spiritualité et créativité de soi. L’esprit du bonheur : https://www.youtube.com/watch?v=M7C1FXvMzSA
Voir aussi :
The Awakened brain ( Cerveau et spiritualité) : https://vivreetesperer.com/the-awakened-brain/
La nouvelle science de la conscience : https://vivreetesperer.com/la-nouvelle-science-de-la-conscience/
Comment nos pensées influencent notre réalité : https://vivreetesperer.com/comment-nos-pensees-influencent-la-realite/
Les expériences spirituelles : https://vivreetesperer.com/les-experiences-spirituelles/
Une révolution spirituelle. Une approche nouvelle de l’au-delà (Lytta Basset) : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/
Jésus le guérisseur (Tobie Nathan) : https://vivreetesperer.com/jesus-le-guerisseur/
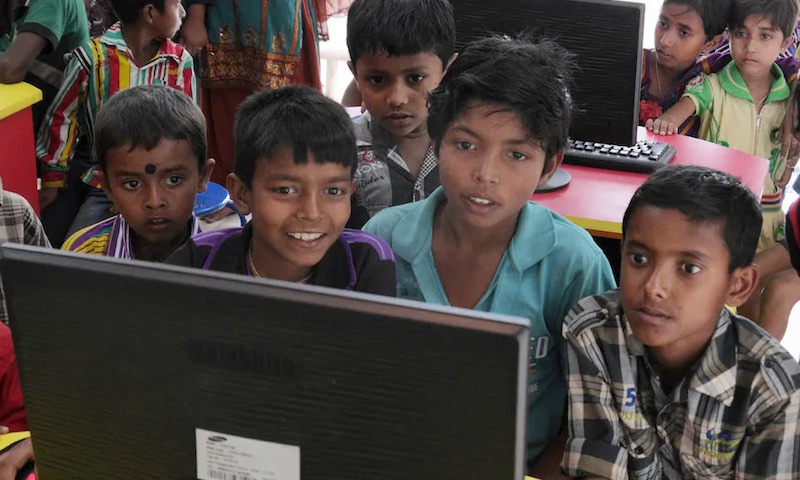
Sugata Mitra : un nouveau processus pédagogique
La réussite d’enfants apprenant librement en petit groupe auprès d’un ordinateur en puisant dans le savoir d’internet.
Comment l’expérimentation de Sugata Mitra s’est propagée en Inde et à travers le monde : des environnements d’apprentissage auto-organisés, une école dans le nuage (school in the cloud).
Il y a une dizaine d’années, le nouveau processus pédagogique initié et propagé par un ingénieur indien, Sugata Mitra, à partir d’une expérience initiale en 1999 : la réussite d‘un groupe d’enfants d’un bidonville indien à utiliser un ordinateur mis à leur portée ‘The hole in the wall’, était reconnue par le dispositif Ted qui diffuse les idées nouvelles dans l’univers anglophone à travers des ‘talks’, courtes interventions en vidéo ; en 2013, Ted lui décerne un prix accompagné d’un crédit qui va lui permettre d’engager une expérimentation à grande échelle en créant sept espaces propices à cette pédagogie : 2 en Grande-Bretagne et 5 en Inde. Nous avons rendu compte de la première étape du parcours de Sugata Mitra, celle des grandes innovations qui, durant la première décennie du XXIe siècle, ont engendré un nouveau processus pédagogique (1). Or en 2019, Sugata Mitra publie un livre qui dresse le bilan de l’ensemble de l’innovation et trace des perspectives d’avenir : « The school in the cloud. The emerging future of learning » (2). « L’Éducation a essayé d’exploiter la “promesse” de la technologie de l’éducation pendant des décennies pour aucun profit, mais nous avons appris que des enfants en groupe – quand l’accès à internet leur est donné – peuvent apprendre par eux-mêmes n’importe quoi (learn anything by themselves)… » En 1999, Suga Mitra a mené la fameuse expérience du ‘trou dans le mur’ qui a donné matière à trois causeries TED et lui a permis de gagner le premier prix TED d’un million de dollars pour la recherche. Depuis lors, il a mené une nouvelle recherche à propos des environnements d’apprentissage auto-organisés (self-organized learning environments, SOLE), construisant des ‘Écoles dans le Nuage’ (Schools in the Cloud) à travers le monde. Ce nouveau livre partage les résultats de cette recherche… Dans ce livre révolutionnaire, vous apercevrez le futur émergent de l’apprentissage avec la technologie. Il en ressort que la promesse n’est pas dans la technologie elle-même. Elle est dans « un apprentissage dirigé par les enfants eux-mêmes utilisant la technologie » (page de couverture).
Cet ouvrage se déroule en trois grandes parties : Qu’est ce qui arrive quand les enfants rencontrent internet ? – Les écoles dans le nuage – Aperçus sur le futur de l’apprentissage.
Internet peut être un fabuleux moyen d’apprentissage pour les enfants
Avec son esprit curieux, en mettant un ordinateur en accès à des enfants d’un bidonville indien, l’ingénieur Sugata Mitra a fait apparaitre un phénomène insoupçonné : la capacité d’enfants défavorisés et sans instruction, mais s’entraidant les uns les autres de découvrir le fonctionnement d’un ordinateur et d’apprendre à partir d‘internet. A l’entrée de son premier chapitre intitulé : ‘Self–organizing systems in learning’ (les systèmes d’apprentissage s’organisant eux-mêmes), Sugata Mitra résume en ces termes le nouvel horizon : « Quand on leur donne l’accès à internet en groupe, les enfants peuvent apprendre n’importe quoi tout seuls » (p 3). Il décline ensuite ce constat à travers les résultats d’expérimentation auprès d’enfants d’âge divers en des lieux différents et dans des conditions variées. En Inde, dans les régions rurales ou les faubourgs misérables, puis dans d’autres pays, au Bhutan, au Cambodge et en Afrique du sud, « les résultats ont toujours été les mêmes : la capacité digitale a jailli de ce qui paraissait de nulle part » (Digital literacy sprang out of seemingly nowhere) (p 4). Sugata Mitra en précise les conditions : « Au cours des années, nos expériences ont montré que des groupes d’enfants, se voyant donner accès à internet dans des espaces publics et sûrs apprendrons à utiliser les ordinateurs et internet sans instruction venant des adultes. Nos expériences montrent que les enfants en groupe apprennent à des vitesses beaucoup plus grandes que des enfants travaillant individuellement par eux-mêmes. La mentalité de la ruche collective se montre un enseignant efficace. Il m’a fallu des années pour réaliser que cette situation collective d’apprentissage était un exemple d’un système s’auto-organisant… » (p 7).
Des environnements d’apprentissage auto-organisés
Nommé professeur de technologie de l’éducation à l’université de Newcastle en novembre 2006, Sugata Mitra arrive en Angleterre. En 2009, un film indien célébrant un effet de promotion sociale de l’expérience, ‘The hole in the wall’, le rend célèbre et il est contacté par une institutrice anglaise d’une petite école élémentaire Saint-Alban à Gateshead. Il engage la conversation avec des élèves de huit ans et leur propose d’essayer une expérience d’apprentissage avec des ordinateurs. Le 6 juillet 2009, les 24 élèves enthousiastes, âgés de huit ans, se voient proposés cinq questions concernant les avantages de l’adaptation pour la survie, questions correspondant à un niveau supérieur de quatre années. « Les enfants ont accès à un ordinateur par groupe de quatre en toute liberté. Au bout de trente minutes, les enfants reviennent avec leurs réponses sur un bout de papier. Puis, on demanda à chaque groupe de poser sa propre question. Il fut demandé à l’institutrice de retenir les réponse et de reposer individuellement et sans recours à l’ordinateur, les mêmes questions deux mois après (p11). Les résultats furent remarquables : « Les groupes peuvent répondre aux questions de l’examen classique, avec des années d’avance. Et, après avoir appris en groupe, beaucoup d’entre eux peuvent assimiler leur réponse dans une compréhension personnelle. Et deux mois après, ils ont retenu les résultats » (p 12). Ce fut là une nouvelle ouverture pour la recherche. L’expérience a ensuite été de nombreuses fois répétées montrant que les enfants pouvaient répondre à des questions encore plus difficiles correspondant à un niveau d’âge plus élevé. Sugata Mitra a trouvé un nouveau nom pour désigner cette méthode. Dans ces classes, l’ordre avait été remplacé par un doux chaos dans l’espoir d’un ordre émergeant spontanément. J’ai trouvé un nouveau nom pour ce que nous avions réalisé : nous avions découvert le « Self-organized learning environment » (SOLE) (Environnement d’apprentissage auto-organisé )» (p 14).
A partir de là, Sugata Mitra a développé quelques environnements expérimentaux en Inde.
En récapitulant les résultats obtenus par les enfants durant plusieurs années, Sugata Mitra peut mettre en évidence des gains remarquables :
- Devenir un bon usager autonome d’internet
- Apprendre assez d’anglais pour utiliser les moteurs de recherche ou un chat en mail
- Apprendre à chercher sur internet pour répondre aux questions
- Améliorer sa prononciation anglaise
- Améliorer ses scores en mathématiques et en sciences à l’école
- Évaluer les opinions et détecter l’endoctrinement et la propagande (p 15)
Les enfants à qui on donne accès à internet en groupe peuvent apprendre n’importe quoi tout seuls
Dès lors, Sugata Mitra s’est posé la question : « Y a-t-il une limite à ce que les enfants peuvent comprendre en utilisant internet ? ».
Pour répondre à cette nouvelle question, une nouvelle expérience a été entreprise à kalikuppam, un village de l’Inde du sud. « Nous avons posé une question dont nous pensions que les enfants ne parviendraient pas à y répondre : quel est le processus de réplication de l’ADN ? Est-ce que des enfants Tamil âgés de 12 ans à Kalikuppan peuvent apprendre et comprendre le processus de réplication de l’ADN en anglais à partir d‘un ordinateur, trou-dans-le-mur, sans guidance d’un adulte ? A ma stupéfaction la réponse a été : oui » (p 15) ». Un matériel universitaire de biotechnologie avait été déchargé sur l’ordinateur. Au bout de deux mois, ces enfants qui comprenaient à peine ce langage sur un sujet bien en avance de ce qui leur était enseigné à leur âge, sont parvenus tout seuls à un score de 30%. Puisqu’on ne pouvait trouver un professeur de biochimie pour cette école, Sugata Mitra a eu l’idée de chercher une ‘médiatrice’. « Cette personne était juste une figure adulte amicale qui encouragerait les enfants à aller plus loin, simplement à travers des expressions chaleureuses comme : ‘Formidable. Comment tu as pu comprendre cela ?’ ou ‘Je n’aurais jamais pu comprendre cela tout seul’… pareil à la manière dont une grand-mère admire ses petits-enfants. La médiatrice n’avait aucune connaissance du sujet. Elle avait de l’affection pour les enfants et elle les admirait. J’ai appelé cela la ‘méthode de la grand-mère’. En quelques semaines, la ‘méthode de la grand-mère’ a mené les enfants de Kalikuppan au même niveau que des enfants plus âgées qui recevaient l’enseignement d’un professeur formé de biochimie dans un école urbaine de Delhi ».
Cette expérience de Kakikuppan a appris deux grandes leçons à partir desquelles Sugata Mitra a pu déclarer : « Les enfants à qui on donne accès à internet en groupes peuvent apprendre n’importe quoi tout seuls ». Dès lors, les déclarations de Sugata Mitra ne sont plus apparues comme naïves, mais comme dangereuses. Cette expérience a également montré que l’admiration est un puissant outil d’apprentissage. L’apprentissage auto-organisé est tout au long aidé par l’admiration. J’ai appelé cette méthode : ‘Une éducation envahissante au minimum’ (minimally invasive education) » (p 16).
Comment des grands-mères viennent encourager les enfants sur skype
A partir de là, Sugata Mitra s’est dit que la ‘méthode des grands-méres’ était efficace et il a décidé d’essayer à nouveau. Est-ce que cette pratique pourrait se réaliser avec skype ? En 2009, comme Sugata Mitra est interviewé par le ‘Guardian’, il fait savoir que son dispositif est associé à un service de téléphone skype à Hyderabad comme près de Newcastle. Et il raconte : « Quand je suis allé en Inde récemment, j’ai demandé aux enfants comment ils aimeraient utiliser skype au mieux et ils m’ont répondu qu’ils souhaiteraient que des grands-mères anglaises leur lisent des contes de fée ». L’intervieweur en a fait part dans le Guardian et du coup des mails sont arrivés. Sugata Mitra s’est adressé aux volontaires pour leur donner les principes de la ‘méthode des grands-mères’ : ne pas enseigner, entrer en conversation, poser des questions et demander aux enfants d’éventuelles réponses. En d’autres mots, elles peuvent conduire une session SOLE sur skype. Nous décidâmes d’appeler ce groupe de volontaires ‘The Granny Cloud’ (le nuage de la grand-mère). Parmi ces volontaires, certaines personnalités se sont révélées particulièrement ajustées. Aujourd’hui, des ‘grannies’ opèrent à l’échelle mondiale (p 17-18). Cette intervention a eu notamment un effet bénéfique sur le langage des enfants (p 32).
Les Écoles dans le Nuage
Dans ce livre, Sugatra Mitra nous rapporte comment l’expérimentation s’est poursuivie à travers l’implantation d’ ‘environnements d’apprentissage auto-organisés’ (SOLE) à travers le monde ; effectivement, des expériences sont apparues dans de nombreux pays : Australie, Argentine, Uruguay, Chili, Etats-Unis. Et bien sûr, elle a continué à s’étendre en Angleterre et surtout en Inde. L’Inde a été le grand champ d’expérimentation des ‘Schools in the Cloud’. Ce livre nous rapporte, par le menu, l’histoire de chaque innovation dans son environnement spécifique : les atouts, les oppositions, les difficultés, les gains qui, à chaque fois, viennent confirmer la réussite de cette nouvelle approche.
Au total, Sugata Mitra peut dresser un bilan : « Qu’est-ce que nous avons appris des écoles dans le nuage ? » (p 125-140). « Nous savons maintenant que les enfants peuvent apprendre à se servir des appareils tout seuls. Ils peuvent même apprendre plus vite dans des groupes non supervisés… Ils peuvent aussi enseigner aux adultes les usages de la nouvelle technologie. Nous voyons là une génération qui peut utiliser n’importe quelle technologie digitale pour résoudre des problèmes… Ils peuvent calculer (compute) des solutions aux problèmes. Calculer est la nouvelle arithmétique (Computing is the new arithmetic). On constate également une amélioration de la ‘compréhension de lecture’ lorsque les enfants utilisent l’Ecole dans le Nuage. « Il est important de noter que la ‘compréhension de lecture’ est seulement un des aspects de la compréhension des contenus. En plus des textes imprimés, les enfants ont affaire à beaucoup d’autres genres de médias incluant des représentations visuelles, audio et vidéo ». « Ainsi il vaudrait mieux parler de ‘compréhension de multimédias’. Dans les ‘Écoles dans le Nuage’, cette compréhension s’améliore à des niveaux au-dessus de celle qui prévaut dans l’éducation standard ». Au total, les enfants apprennent à lire mieux et plus vite dans l’École du Cloud. Il est peut-être possible de commencer avec des enfants aussi jeunes que cinq ans. Voici une génération qui peut comprendre le monde à partir du nuage massif de données qui les entoure ».
« Nous savons que des groupes d’enfants cherchant sur internet réussissent mieux dans leur recherche et habituellement détectent les erreurs dans l’information ou dans leur perception. A la différence des écoles traditionnelles, dans les Ecoles dans le Nuage, les enfants apprennent à chercher en groupe, se corrigent les uns les autres, et discutent entre eux quelle découverte est la plus authentique. En se comportant ainsi, les enfants apprennent à communiquer avec le réseau, à répondre aux bonnes questions de la bonne manière, et expliquer et discuter leurs découvertes les uns avec les autres. Communiquer est la nouvelle écriture.
Quand les enfants recherchent sur internet et sont complimentés sur leurs découvertes, il est naturel de s’attendre à ce que la confiance en eux-mêmes s’accroisse… Voilà une génération qui a confiance dans ses capacités digitales.
Les enfants n’ont pas peur de la technologie moderne. Ils ont seulement besoin d’y avoir accès. C’est une vision d’espoir.
Finalement, ‘le Trou dans le Mur’ et ‘l’École dans le Nuage’ nous montrent qu’il y a un changement fondamental dans les capacités dont les enfants ont besoin pour la nouvelle époque dans laquelle ils sont en train de grandir. Une transition se produit : un mouvement de la lecture, l’écriture, l’arithmétique à la compréhension, la communication et le calcul ».
Une réflexion prospective
Dans un dernier chapitre, Sugata Mitra s’engage dans une réflexion prospective ‘Looking for the future’. Sugata Mitra est impressionné par la rapidité du changement technologique. « Nous sommes dans une trajectoire technologique pour le développement humain qui est maintenant dans une phase exponentielle » (p 166). Son attention se porte sur l’organisation des réseaux et de leur évolution. Comme physicien, il envisage les ‘systèmes dynamiques complexes’ et il rapporte des changements où on passe spontanément d’une situation chaotique à un ordre supérieur. « Quand des systèmes complexes passent du chaos à l’ordre, nous les appelons des systèmes s’auto-organisant » (p XXXVIII). Sugata Mitra entrevoit cette réalité dans la nature et il la perçoit dans son expérimentation pédagogique dans un processus où on passe du brouhaha à une construction collective. Il aperçoit un phénomène analogue dans l’émergence d’internet aujourd’hui. « Cette époque est caractérisée par un ordre spontané dans un réseau global de gens » (p 173). Nous ne le suivons pas dans des extrapolations qui apparaissent aujourd’hui dans le courant transhumaniste. Nous ne nous arrêtons donc pas à ce court épilogue, car il ne rapporte en rien l’apport majeur de ce livre : l’invention d’une pédagogie nouvelle fondée sur la créativité des enfants dans des petits groupes en phase avec internet. La recherche et l’innovation menées par Sugata Mitra nous paraissent à la fois spectaculaires et révolutionnaires.
Dans cette innovation épique, le nouveau processus pédagogique initié par Sugata Mitra s’appuie sur l’élan créatif des enfants et, à cet égard, on peut y voir une parenté avec d’autres formes d’éducation nouvelle, comme l’invention montessorienne (3). Cependant, comme les innovations précédentes, celle-ci s’est heurtée et se heurte encore à un système scolaire marqué par la hiérarchie, la compétition, l’individualisme. Certes, ce système est de plus en plus contesté dans l’aire anglophone comme dans l’aire francophone. En l’occurrence, Sir Ken Robinson, qui remit le prix TED à Sugata Mitra, auteur et conférencier anglais, expert dans le domaine de l’éducation artistique, a fréquemment dénoncé les effets pervers des systèmes scolaires forgés à l’image de la production industrielle (4). Il déclarait ainsi : « L’école nous introduit dans une voie standardisée et annihile la créativité que chaque enfant porte en lui à la naissance ». Ken Robinson montrait comment le système scolaire actuel est le produit d’une autre époque où un intellectualisme individualiste issu du XVIIIe siècle s’est combiné à une organisation industrielle associant uniformisation, standardisation et division du travail. Aujourd’hui, nous avons besoin de passer d’un « processus mécanique » à un « processus organique ». Les nouveaux modes de communication changent la donne et permettent le changement. Sans doute, percevons-nous aujourd’hui davantage non seulement les bienfaits d’internet, mais également les risques potentiels. Cependant, cette analyse nous permet de comprendre en quoi l’innovation de Sugata Mitra s’est heurtée au conservatisme de l’institution scolaire. Cette opposition apparait bien dans le commentaire d’un chercheur anglais, James Nottingham : « Ce livre met en question une représentation conventionnelle et vous pousse à entrer dans une nouvelle manière de penser au sujet du comment apprendre. Par exemple, pensez aux millions dépensés pour fournir un ordinateur à chaque étudiant alors que Sugar Mitra montre que les enfants apprennent mieux lorsqu‘ils se rassemblent auprès d’un grand écran… » Et de même, cet auteur fait ressortir la vanité du bachotage des tests au regard des résultats durables obtenus dans les ‘environnements d’apprentissage auto-organisés’. Une caractéristique majeure de cette innovation éducative est l’apprentissage en petits groupes. C’est aussi un élément majeur de sa réussite. Ainsi la rupture avec le système traditionnel n’est pas seulement technique, elle est aussi sociale.
J H
- Sugata Mitra , un avenir pédagogique prometteur https://vivreetesperer.com/sugata-mitra-un-avenir-pedagogique-prometteur-a-partir-dune-experience-dauto-apprentissage-denfants-indiens-en-contact-avec-un-ordinateur/
- Sugata Mitra. The School in the Cloud. The emerging future of learning. Corwin, 2020. On pourra voir parallèlement un film documentaire réalisé par Jerry Rothwell : https://www.platform-mag.com/film/the-school-in-the-cloud.html
- L’invention montessorienne : https://vivreetesperer.com/linvention-montessorienne-2/
- Une révolution en éducation : https://vivreetesperer.com/une-revolution-en-education/

Dans la communion du Saint Esprit
In the fellowship of the Holy Spirit
« In the fellowship of the Holy Spirit », c’est le titre d’un chapitre du livre de Jürgen Moltmann : « The source of life. The Holy Spirit and the theology of life » (1). A la suite d’un premier ouvrage de Moltmann : « The Spirit of life » (1992) traduit en français et publié en 1999 sous le titre : « L’Esprit qui donne la vie », ce livre, inédit en français, se propose d’apporter une théologie du Saint Esprit à l’intention d’un vaste public. Dans ce chapitre, Jürgen Moltmann nous introduit dans la personnalité du Saint Esprit à travers une caractéristique majeure : la « fellowship », ce terme évoquant par ailleurs le potentiel chaleureux de la vie associative, et pouvant dans ce cas, se traduire en français par toute une gamme de termes : amitié, fraternité, communion… « Dans la communion d’un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint Esprit, le Saint Esprit vient à notre rencontre et il communique avec nous, comme nous avec lui. De fait, il nous permet d’entrer en communion avec Dieu (« fellowship with God »). Avec lui, la vie divine nous est communiquée et Dieu participe à notre vie humaine. Ce qui advient ainsi dans la manifestation de l’Esprit, n’est rien moins qu’une communion avec Dieu (« fellowship with God ») (p 190). Cette lecture nous est précieuse parce qu’elle nous permet d’apprendre à vivre aves le Dieu vivant (« The living God ») en nous, pour nous, avec nous (2).
La communion : une caractéristique de l’Esprit
« Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ et l’amour de Dieu et la communion (« fellowship ») de l’Esprit soient avec vous tous ». Ainsi s’énonce une ancienne bénédiction chrétienne (II Corinthiens 13.13). Jürgen Moltmann s’interroge. « Pourquoi le don particulier de l’Esprit est-il perçu comme la communion (fellowship), alors que la grâce est attribuée à Christ et l’amour à Dieu le Père ? ». Cette caractéristique a des conséquences considérables. « Dans cette communion, l’Esprit est davantage qu’une force vitale neutre. L’Esprit est Dieu lui-même en personne. Il entre en communion avec les croyants et les attire en communion avec lui. Il est capable de communion et désire la communion » (p 89).
Les vertus de la communion fraternelle
Le terme « fellowship » est difficile à traduire ici, car, dans la vie courante, il s’applique aussi à l’esprit associatif et on peut l’évoquer en terme de fraternité ; nous utiliserons ici le terme : communion fraternelle. « La communion fraternelle ne s’impose pas par la force et par la possession. Elle libère. Nous offrons une part de nous-même et nous partageons la vie d’une autre personne. La communion fraternelle se vit dans une participation réciproque et une acceptation mutuelle. La communion fraternelle surgit quand des gens qui sont différents, trouvent quelque chose en commun, et, que ce quelque chose en commun est partagé par différentes personnes… Il y a communion fraternelle dans une relation mutuelle : des fraternités engendrées par une vie partagée. Dans la plupart des fraternités humaines, les objectifs et les relations personnelles sont liés » (p 89). Et la communion fraternelle peut s’établir entre gens semblables, mais aussi entre gens différents.
La communion de Saint Esprit : un phénomène original
Si on considère ainsi la communion fraternelle, la fraternité dans le genre humain, qu’en est-il dans la communion fraternelle, telle qu’elle se manifeste à travers le Saint Esprit ? « Si nous nous rappelons les différentes connotations et les différents significations de la fraternité humaines, alors la communion du Saint Esprit avec nous tous, devient un phénomène tout à fait étonnant. Dans l’Esprit, Dieu rentre en communion avec les hommes et les femmes : La vie divine nous est communiquée et Dieu participe à notre vie humaine. Dieu agit sur nous à travers sa proximité éveillante et vivifiante et nous agissons sur Dieu à travers nos vies, nos joies et nos souffrances. Ce qui advient en étant dans l’Esprit de vie n’est rien moins que la « fellowship », la communion fraternelle avec Dieu. Dieu est impliqué en nous, nous répond et nous lui répondons. C’est pourquoi l’Esprit peut porter de bons fruits en nous et c’est pourquoi nous pouvons aussi peiner et éteindre l’Esprit. En l’Esprit, Dieu est comme un mari, une épouse, un partenaire. Il nous accompagne et partage nos souffrances. Le Saint Esprit ne se comporte pas avec nous d’une manière dominatrice, mais avec tendresse et prévenance. De fait dans un esprit de communion fraternelle » (p 90).
Avec le Saint Esprit, entrer dans la communion de Dieu trinitaire.
Cependant, nous devons envisager la communion fraternelle de l’Esprit avec nous dans un paysage bien plus vaste. « Le Saint Esprit n’entre pas seulement en communion avec nous et ne nous attire pas simplement en communion avec lui. L’Esprit lui-même – elle-même – existe en communion avec le Père et le Fils, « d’éternité en éternité », et est adoré et glorifié ensemble avec le Père et le Fils comme le dit le credo de Nicée. Ainsi, la communion de l’Esprit avec nous se cache dans la communion éternelle avec Christ et le Père de Jésus – Christ. La communion du Saint Esprit avec nous correspond à sa communion divine éternelle. Elle ne correspond pas seulement à cette communion, elle est elle-même cette communion. Ainsi dans la communion de l’Esprit, nous sommes liés au Dieu trinitaire, pas seulement extérieurement, mais intérieurement. A travers l’Esprit, nous sommes attirés dans la symbiose éternelle ou la communion vivante du Père, du Fils et de l’Esprit, et nos vies humaines limitées participent au mouvement circulaire éternel de la vie divine. Ainsi, dans la communion du Saint Esprit avec nous tous, nous faisons l’expérience de la proximité de la vie divine et aussi l’expérience de notre vie mortelle comme une vie qui est éternelle. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous… Dans la communion du Saint Esprit, la Trinité divine est si grande ouverte que la création entière peut y demeurer. C’est une communion qui invite : « Qu’ils puissent tous être en nous », telle est la prière de Jésus dans l’Evangile de Jean ( Jean 17.21) » (p 90-91).
Une unité respectueuse de la diversité
Cette description de la place et du rôle du Saint Esprit dans la communion trinitaire peut-elle nous apprendre quelque chose sur le genre d’unité que les croyants vont développer dans la communion de l’Esprit ? Est-ce que l’Esprit se manifeste essentiellement dans l’animation de la communauté ou bien particulièrement dans la vie individuelle des croyants ? Jürgen Moltmann récuse cette alternative tranchée. « La communion du Saint Esprit ne renforce ni l’individualisme protestant dans la foi, ni le collectivisme ecclésial catholique. L’expérience de la riche variété des dons de l’Esprit est aussi primordiale que l’expérience de la communion dans l’Esprit. « Il y a une variété de dons, mais c’est le même Esprit » (I Cor 12.4)… L’expérience de la liberté qui donne à chacun ce qui lui est propre (I Cor 12.11) est inséparable de l’expérience de l’amour qui unit les gens ensemble dans l’Esprit. La vraie unité des croyants dans la communion de l’Esprit est une image et un reflet de la Trinité de Dieu et de la communion de Dieu dans des relations personnelles différentes. Ni une conscience collective qui réprime l’individualité des personnes, ni une conscience individuelle qui néglige ce qui est commun, ne peuvent exprimer cela. Dans l’Esprit, personnalité et socialité viennent ensemble et sont complémentaires » (p 92).
Le chapitre : « In the fellowship of th Spirit » se poursuit en deux autres séquences : « L’Église dans la communion de l’Esprit », et « La communion fraternelle entre les générations et les sexes ».
La pensée théologique de Moltmann est entrée dans une nouvelle étape créative au début des années 1990 à travers sa théologie de la création, sa nouvelle théologie trinitaire et sa théologie de l’Esprit (2). Ce livre : « La source de vie » s’inscrit dans ce mouvement. Nous avons été inspiré par ce passage qui évoque pour nous la présence divine en terme de communion, dans un rapport à l’expérience de la communion fraternelle.
Rapporté par J H
- Jürgen Moltmann. The source of life. The Holy Spirit and the theology of life. Fortress Press, 1997
- Pour une vision holistique de l’Esprit : https://vivreetesperer.com/pour-une-vision-holistique-de-lesprit/
Ecothéologie et pentecôtisme
Ecothéologie et pentecôtisme
 Dans la prise de conscience écologique, une nouvelle vision théologique est apparue au point de porter un nom : écothéologie. Michel Maxime Egger nous en a montré les différents visages (1). Nous savons aussi comment le théologien Jürgen Moltmann a sous-titré son livre : « Dieu dans la création » paru dès 1988 : « Traité écologique de la création » et poursuivi ensuite constamment son œuvre en ce domaine (2). En 2015, le pape François publie dans ce domaine une encyclique retentissante : « Laudato si’ » (3). Dans la dernière décennie, ce mouvement est également apparu dans le champs pentecôtiste, du moins chez certains théologiens anglophones. Sachant l’expansion actuelle du pentecôtisme dans le monde, ce fait est important d’autant que certaines manifestations politiques du pentecôtisme dans certains pays ont pu être contestées. A J Swoboda est pasteur et professeur de théologie, notamment à la faculté Fuller (4). Il se déclare un environnementaliste pentecôtiste : « Le soin porté à la création est un aspect intégral de l’œuvre relationnelle du Saint Esprit dans le monde » (5). A J Swoboda a écrit sur cette questions plusieurs livres qui font référence : « Tongues and trees. Towards a Pentcostal Ecological Theology » (6) ; « Introducing Evangelical Ecotheology. Foundations in Scripture, Theology, History and Praxis ». Aussi a-t-il édité un recueil d’écrits théologiques : « Blood cries out. Pentecostals, Ecology and the Groans of Creation » (Pentecostals, Peacemaking and Social Justice) (7).
Dans la prise de conscience écologique, une nouvelle vision théologique est apparue au point de porter un nom : écothéologie. Michel Maxime Egger nous en a montré les différents visages (1). Nous savons aussi comment le théologien Jürgen Moltmann a sous-titré son livre : « Dieu dans la création » paru dès 1988 : « Traité écologique de la création » et poursuivi ensuite constamment son œuvre en ce domaine (2). En 2015, le pape François publie dans ce domaine une encyclique retentissante : « Laudato si’ » (3). Dans la dernière décennie, ce mouvement est également apparu dans le champs pentecôtiste, du moins chez certains théologiens anglophones. Sachant l’expansion actuelle du pentecôtisme dans le monde, ce fait est important d’autant que certaines manifestations politiques du pentecôtisme dans certains pays ont pu être contestées. A J Swoboda est pasteur et professeur de théologie, notamment à la faculté Fuller (4). Il se déclare un environnementaliste pentecôtiste : « Le soin porté à la création est un aspect intégral de l’œuvre relationnelle du Saint Esprit dans le monde » (5). A J Swoboda a écrit sur cette questions plusieurs livres qui font référence : « Tongues and trees. Towards a Pentcostal Ecological Theology » (6) ; « Introducing Evangelical Ecotheology. Foundations in Scripture, Theology, History and Praxis ». Aussi a-t-il édité un recueil d’écrits théologiques : « Blood cries out. Pentecostals, Ecology and the Groans of Creation » (Pentecostals, Peacemaking and Social Justice) (7).
Le ‘Jour de la Terre’
L’instauration d’un ‘Jour de la Terre’ aux Etats-Unis en 1970, initiative suivie internationalement, témoigne d’une éclosion de la prise de conscience écologique. C’était un jour de méditation et d’action pour restaurer la relation humaine avec la terre. Le fondateur et le visionnaire du ‘jour de la Terre’ fut John McConnell Jr. Dans son livre : « Blood cries out », (7) A J Swoboda nous décrit cette personnalité dans son parcours spirituel, nous signifiant par là que la préoccupation écologique a pu être présente en quelqu’un fortement marquée par une inscription familiale pentecôtiste. Les parents de McConnell ont été membres fondateurs de la charte des assemblées de Dieu en 1914. Son propre grand-père fut même un participant au grand réveil de la Rue Azuza à Los Angeles en 1906. Ainsi le ‘Jour de la Terre’ a commencé avec de fortes convictions religieuses. McConnell ,voyant la crise écologique à travers sa culture religieuse, « envisageait un jour où les chrétiens pourraient montrer la puissance de la prière, la valeur de leur charité et leur préoccupation pratique pour la vie et les gens de la terre ». Ce rappel historique est une entrée en matière qui légitime une approche théologique pentecôtiste de l’écologie.
Univers écologique et univers pentecôtiste : tout est relation
Brandon Rhodes était étudiant à l’université d’Oregon (Etats-Unis) et il y fréquentait deux univers : l’écologie et le pentecôtisme (6). Dans la communauté pentecôtiste, il se voit proclamer l’importance de la relation : « Le Royaume de Dieu porte entièrement sur les relations ». A travers leur vie ensemble, les étudiants pentecôtistes « apprenaient à voir et à nommer l’œuvre de l’Esprit dans leur vie et dans leurs relations quotidiennes ». Cependant, dans ses études en écologie, Brandon Rhodes s’éveillait à « l’interconnexion de toutes choses, comme les champignons qui s’emploient à constituer un réseau relai entre les arbres de la forêt. Quand un feu, une sécheresse ou une tronçonneuse frappe un arbre, la forêt entière en frisonne de conscience. En écologie, la relation, c’est tout. Cette prise de conscience a profondément influencé la manière dont je voyais la terre ». « La Création brille de vie, de relation et déborde d’un saint mystère ». « Avec le temps, cette résonance entre l’écologie et le pentecôtisme me devint tout-à-fait évidente. Le Royaume de Dieu porte entièrement sur la relation et il en va de même pour l’écologie. Le royaume de Dieu dans l’Esprit est écologique et vice versa. Je le ressentais d’une manière palpable dans cet environnement verdoyant des montagnes de l’Oregon ».
A la recherche d’une rencontre entre la réflexion théologique et l’expérience
Brandon Rhodes constata pourtant que le pastorat pentecôtiste percevait rarement la connexion entre les deux approches, et plus généralement la valeur de l’écologie. Ce fut donc avec joie qu’il accueillit la parution du livre de A J Swoboda, un ouvrage qui établissait un pont par dessus la division entre écologie et pentecôtisme. Et, encore mieux, il rencontra l’auteur habitant dans le même voisinage. Le livre de Swoboda : « Tongues and trees : toward a pentecostal ecological theology » formule sa thèse de doctorat pour un public plus large. Cependant, Brandon Rhodes s’interroge sur le format académique qui peut donner l’impression que le message descend d’en haut vers des réalités sociales qui montent d’en bas. « Le défi majeur pour Swoboda est de transmettre des idées académiques de haut en bas vers une tribu à la base, celle de l’église pentecôtiste. A J Swoboda trace bien quelques pistes comme « imposer les mains à la terre pour sa guérison, ou bien prêcher des eschatologies créationnelles ». Mais Brandon Rhodes reste en partie sur sa faim.
« Un épilogue plus développé en terme de pratiques pentecôtistes, expériences écologiques, incursions liturgiques, comportements mystiques à l’intention de l’église locale aurait idéalement arrondi ce travail ».
Un témoignage et un parcours de recherche
Brandon Rhodes partage avec nous sa vision de foi. « Le pentecôtisme, ce n’est pas seulement une manière de prêcher, chanter, se rassembler et prier. C’est fondamentalement développer des cœurs ouverts à l’activité de l’Esprit. C’est une imagination active se demandant où Jésus peut être à l’œuvre à travers l’Esprit ».
« Cependant ce comportement pentecôtiste tourné vers l’Esprit refuse d’être commodément institutionnalisé, planifié, préemballé pour une consommation ecclésiale ».
« Swoboda semble appeler l’écothéologie à nourrir notre capacité de voir la création comme une arène où se montre la vie de Dieu. Si je le lis fidèlement en pentecôtiste, il désire nous amener à devenir des magiciens verts plutôt que des écothéologiens – des guides mystiques à même de nous faire voir la magie dont ce monde est abreuvé par le Saint Esprit. L’Esprit holistique, baptisant la création, vers où « Tongues and Trees » dirige le pentecôtisme, est vivant et actif dans le monde ». Brandon Rhodes nous appelle « à avoir des yeux pour le voir et à répondre dans la repentance ».
Aperçus
Suite à son analyse, Brandon Rhodes présente un résumé détaillé du livre : « Tongues and Trees ». En voici quelques extraits.
Swoboda présente les apports des différentes dénominations à l’écothéologie. En ce qui concerne le pentecôtisme, il perçoit certaines dispositions favorables. « D’abord, le pentecôtisme met l’accent sur ce que Miroslav Wolf appelle : « la matérialité du salut » ce qui historiquement s’est prêté à une attention pour des questions de justice sociale – une disposition qui s’ouvre tout naturellement à honorer le monde matériel et, dans de nombreux cas, là où la dégradation écologique accroit les injustices existantes. Deuxièmement, l’accent pentecôtiste sur l’Esprit se prête au témoignage biblique de l’Esprit de Dieu vivifiant et même baptisant toute la création. Ainsi nous devons attendre les charismes non seulement de l’église charismatique, mais du reste du royaume de la création.
Swoboda résume son bilan des écothéologies charismatiques en deux points majeurs : « D’abord si l’Esprit de Dieu crée et vit dans la création et le peuple de Dieu, les deux sont en voie de restauration à la relationalité. La relationalité est la force même de la théologie et de la pratique pentecôtiste. Ultimement, c’est la force des théologies Esprit/création. L’accent pentecôtiste sur une église interconnectée – par – l’Esprit, nous enjoint de joindre la ‘conversation’. J’ai trouvé dans mon enseignement de l’écologie l’interconnexion de la terre elle-même. Deuxièmement, Swoboda conclut de cette recherche que notre tâche future est de nourrir une imagination pneumatologique concernant le « care » écologique.
Le développement de l’approche écologique transforme notre vision du monde. Elle nous incite à considérer qu’il y plus grand que nous et que nous nous inscrivons dans un tissu de relations. Cette vision nous invite à entrer dans une vision spirituelle où la Pentecôte apparaît comme une figure privilégiée. On comprend qu’un théologien pentecôtiste assume l’approche écologique en espérant que cette attitude se répande dans sa dénomination comme elle s’étend dans d’autres églises.
Rapporté par J H
- Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
- Dieu dans la création : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
- Convergences écologiques :Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François et Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
- A J Swoboda Ph D : https://www.bushnell.edu/faculty/a-j-swoboda/
- A J Swoboda : I am a pentecostal environmentalist : https://faithandleadership.com/aj-swoboda-im-pentecostal-environmentalist
- Book Review, Tongues and trees. Toward a pentecostal ecological theology : https://christandcascadia.com/2014/08/01/book-review-tongues-and-trees-toward-a-pentecostal-ecological-theology/
- A J Swoboda. Blood cries out : https://www.amazon.com/Blood-Cries-Out-Pentecostals-Peacemaking/dp/1625644620
La nouvelle science de la conscience
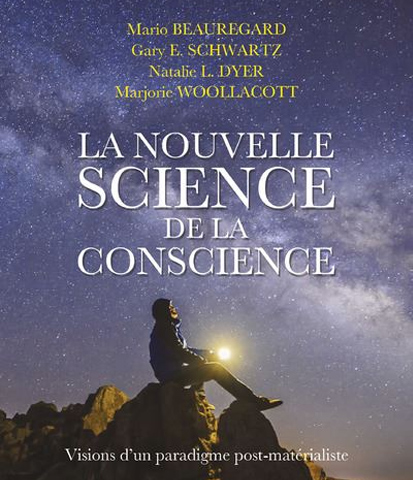 Pour une science post-matérialiste
Pour une science post-matérialiste
Le terme matérialisme évoque des sens différents selon le contexte auquel on l’applique. Ainsi, dans la vie quotidienne, on peut désigner comme « matérialiste », « une personne qui cherche des jouissance et des biens matériels » (définition google). Ainsi, beaucoup de gens dans notre société ont pu être perçus à la fois comme individualistes et matérialistes. Aujourd’hui, on peut constater, au plan social, le développement d’attitudes et de comportements en réaction contre ce matérialisme pratique. En ce sens, le sociologue américain Ronald Inglehart désigne, en terme de post-matérialiste, une évolution culturelle dans les pays économiquement avancés dans laquelle les gens cherchent moins à satisfaire des besoins physiques élémentaires et davantage des besoins immatériels tels que l’estime, l’épanouissement de la personne ou les satisfactions esthétiques.
Cependant, sur un autre registre, le matérialisme désigne une philosophie d’après laquelle « il n’existe d’autre substance que la matière », « une doctrine qui rejetant l’existence d’un principe spirituel ramène toute la réalité à la matière et à ses modifications » (Google). L’origine de cette philosophie remonte à l’antiquité où elle figurait en regard d’autres écoles philosophiques. Cependant, dans la foulée du progrès scientifique, une métaphysique matérialiste a influé sur l’activité scientifique si bien qu’on peut évoquer un « matérialisme scientifique ». Dans le chapitre d’un livre qui œuvre en faveur du développement d’un paradigme post-matérialiste, ‘La nouvelle science de la conscience’ (1), Mario Beauregard répond à une question préalable : Qu’est-ce que le matérialisme scientifique aujourd’hui ? : « Peu de scientifiques sont conscients que ce que l’on appelle « la vision scientifique du monde » repose sur un certain nombre de postulats métaphysiques – c’est-à-dire des hypothèses sur la nature de la réalité – qui ont été proposées pour la première fois par certains philosophes présocratiques. Ces postulats comprennent le matérialisme – l’idée selon laquelle tout ce qui existe est constitué exclusivement de particules et de champs matériels / physiques (les termes « matérialisme » et « physicalisme » peuvent être utilisés de manière interchangeable dans ce chapitre) – et le réductionnisme, le concept selon lequel les choses complexes ne peuvent être appréhendées qu’en les réduisant aux interactions des parties qui les constituent, ou à des choses plus simples et plus fondamentales telles que de minuscules particules matérielles. Le « mécanisme », l’idée que le monde fonctionne comme une machine, représente un autre de ces postulats. Au cours du XXe siècle, ces postulats se sont durcis, puis transformés en dogmes et en un système de croyances connus sous le nom de « matérialisme scientifique » (p 18). Cette idéologie exerce une influence dans le domaine des neurosciences. « Selon ce système de croyances, l’esprit et la conscience – et tout ce que nous vivons subjectivement (par exemple, nos souvenirs, nos émotions, nos objectifs et nos épiphanies spirituelles)… ne sont rien de plus que des processus électriques et chimiques dans le cerveau : ces processus cérébraux étant en définitive réductibles à l’interaction entre des éléments physiques fondamentaux. Une autre implication de ce système de croyances est que nos pensées et nos intentions ne peuvent avoir aucun effet sur nos cerveaux et nos corps, sur nos actions et le monde physique, puisque l’esprit ne peut impacter directement les systèmes physiques et biologiques. En d’autres termes, nous les êtres humains, ne sommes rien d’autres que des machines biophysiques complexes. En conséquence, notre conscience et notre spiritualité disparaissent automatiquement lorsque nous mourrons » (p 18).
Cependant, aujourd’hui, de plus en plus de découvertes viennent contredire les théories matérialistes. On peut envisager « une vague d’éveil pour une science et une société post-matérialiste » (p 63). « La science connaît actuellement un changement fondamental. Le matérialisme sur lequel elle s’est appuyée pendant plusieurs siècles fait aujourd’hui place à un nouveau paradigme dans lequel la conscience est considérée comme étant causale et fondamentale » (page de couverture).
Un mouvement pour une science post-matérialiste
De nombreux scientifiques se conjuguent aujourd’hui pour promouvoir un paradigme post-matérialiste. « L’Académie pour l’avancement des sciences post-matérialistes » a organisé en février 2014 en Arizona, un « Sommet international sur la science, la spiritualité et la société post-matérialiste ». Des scientifiques couvrant des domaines d’expertise allant de la biologie et des neurosciences à la psychologie, la médecine et la recherche psi ont participé à cet événement déterminant. Il en est résulté « un manifeste pour une science post-matérialiste » (2) auquel plus de 300 scientifiques et philosophes du monde entier ont apporté leur soutien » (p 14). Pendant le sommet, plusieurs participants ont décidé de réaliser « une anthologie des perspectives et des preuves relative à la science post-matérialiste », ouvrage publié en français sous le titre : « La nouvelle science de la conscience » (1). « Coordonné par Mario Beauregard et Guy E Schwartz, cet ouvrage appréhende les concepts post-matérialistes relatifs à l’esprit, au corps et à la santé. En s’appuyant sur de nombreuses preuves, il aborde l’organisation et les fonctions spécifiques des phénomènes non physiques, ouvrant la voie à la possibilité de considérer leur nature et leur influence dans le cadre d’une future science globale » (page de couverture).
Une recherche pionnière : Mario Beauregard
Dans un premier chapitre, Mario Beauregard nous introduit à une « prochaine grande révolution scientifique ». Ce chercheur travaille depuis longtemps en ce sens et nous avions rapporté une de ses conférences dans un article : « Comment nos pensées influencent la réalité » (3) et présenté un de ses livres : « Brain wars » (4).
En s’inscrivant dans la perspective du changement des paradigmes énoncée par Thomas S Kuhn, Mario Beauregard écrit : « Les scientifiques qui travaillent actuellement dans le domaine de la recherche sur la conscience et qui s’intéressent au problème : « esprit-cerveau », se trouvent dans une situation similaire à celle des physiciens au début du XXe siècle. Ils sont indéniablement confrontés à une quantité croissante de preuves d’anomalies qui ne peuvent être élucidées par les théories de la pensée matérialiste » (p 21). Mario Beauregard nous présente ensuite quelques unes de ces preuves.
« Les différentes preuves examinées ici sont regroupées en deux catégories. La catégorie I comprend les preuves comme quoi une explication matérialiste, bien que couramment présentée, est moins appropriée qu’une explication post-matérialiste. Cette catégorie comprend les phénomènes suggérant que l’esprit ne soit limité ni par l’espace, ni par le temps. La catégorie II comprend des preuves qui sont rejetées d’emblée par les théories de la pensée matérialiste, mais qui viennent soutenir une perspective post-matérialiste, celle-ci étant incompatible avec la perspective matérialiste selon laquelle l’esprit et la conscience sont produits uniquement par le cerveau » (p 22). Ces différents éléments de preuve apparaissent dans la complexité de leur nature et de leur mise en œuvre, aussi notre compte-rendu sera sommaire en renvoyant le lecteur à la description formulée dans ce chapitre.
L’esprit au delà de l’espace et du temps
« L’un des éléments de preuve concerne les phénomènes dit « psi » qui comprennent la perception extra-sensorielle (PES), et la psychokinésie (PK). La perception extra-sensorielle désigne l’acquisition d’informations sur des événements ou des objets extérieurs par des moyens autres que la médiation d’un vecteur de communication sensorielle connu. Cela comprend la télépathie – l’accès aux pensées d’une autre personne sans l’utilisation d’aucun de nos vecteurs sensoriels connus, la clairvoyance – la perception d’évènements ou d’objets qui ne peuvent être perçus par les sens connus, et la précognition – la connaissance d’un événement futur qui ne peut être déduit à partir d’informations connues dans le présent. La psychokinésie (PK) se réfère à l’influence de l’esprit sur un système physique qui ne peut être totalement expliqué par la médiation d’un moyen physique connu » (p 22). Depuis plusieurs décennies, des expériences répétées à travers des dispositifs sophistiqués ont prouvé la réalité de ces phénomènes.
L’esprit au delà du cerveau
D’autres phénomènes concernent « l’esprit au delà du cerveau » : les expériences de la mort imminente pendant un arrêt cardiaque et la mort clinique ; recherches sur la réincarnation et les vies antérieures ; recherches sur la médiumnité ; communications sur le lit de mort ». « Les expériences de mort imminente (EMI) sont des expériences intenses et réalistes qui transforment généralement profondément la vie des personnes qui ont été proches de la mort psychologiquement et physiologiquement. Les principales caractéristiques des EMI sont un souvenir clair de l’expérience, une activité mentale décuplée, et la conviction que l’expérience vécue est plus réelle que celle de la conscience ordinaire à l’état de veille. L’expérience hors du corps (EHC) est une autre caractéristique typique des EMI ; la personne a l’impression réelle d’être sortie de son corps et d’observer les évènements qui se déroulent autour d’elle, ou parfois dans un lieu éloigné. Les EMI sont fréquemment évoquées lors d’un arrêt cardiaque… Étant donné que les structures cérébrales qui soutiennent l’expérience consciente et les fonctions mentales supérieures ( par exemple la perception, la mémoire et la conscience) sont gravement endommagées, on ne s’attend pas à ce que les survivants d’un arrêt cardiaque aient des expériences mentales claires et lucides dont ils se souviendront… Il convient de noter que les personnes ayant vécu une EMI déclarent avoir perçu des choses qui coïncident avec la réalité alors qu’elles étaient cliniquement mortes » (p 25). Un autre chapitre du livre, sous la plume de Pim Van Lommel, médecin cardiologue réputé, est consacré aux expériences de mort imminente, « une forte indication en faveur de la conscience non locale » (p 191-209).
L’auteur évoque également le cas de « jeunes enfants ayant rapporté des vies antérieures ». « Au cours des cinquante dernières années, plus de 2500 cas de ce genre ont été étudiés ». « La plupart de ces enfants ont des souvenirs de vie antérieure entre deux et cinq ans… Environ 80% des supposés souvenirs de vie antérieure des enfants évoquent des morts violentes… Beaucoup d’enfants ont des marques de naissance qui coïncident avec des blessures qui seraient associées à leur vie antérieure… il arrive souvent que l’on parvienne à identifier la personne à laquelle l’enfant fait référence… » (p 26-27). L’auteur propose des interprétations : « Il est possible que ces enfants se souviennent de vies antérieures qu’ils ont vécues comme ils le suggèrent ou qu’ils accèdent aux informations d’un individu décédé par des moyens inconnus (c’est-à-dire la théorie du super-psi appelée également « super ESP », la récupération d’informations par le canal psychique » (p 28).
Une autre approche de recherche est engagée auprès de médiums, « personnes déclarant pouvoir communiquer avec les personnes décédées », en présumant la bonne de foi de certains d’entre eux. Des protocoles sophistiqués ont été utilisés par certains chercheurs comme le Dr Gary E Schwartz, auteur d’un chapitre technique sur ce thème dans ce même livre. « Les résultats montrent qu’avec des essais réalisés en triple aveugle dans des conditions rigoureuse, certains médiums peuvent recevoir des informations justes et précises sur des personnes décédées. » (p 29).
Mario Beauregard mentionne également « les communications sur le lit de mort ou DBC (Deathbed communication) », une autre source de preuve suggérant que la conscience et la personnalité peuvent perdurer après la mort physique. Il s’agit de toute communication entre le patient et des amis ou des parents décédés… Ce type d’expériences a été rapporté dans diverses cultures à travers l’histoire. Les DBC incluent des aspects auditifs, visuels et kinesthésiques et se manifestent souvent pat des processus communicatifs non verbaux… Un type fréquent de DBC inclue des rencontre avec des présumés esprits de personnes décédées qui semblent accueillir l’expérienceur dans l’au-delà et converser avec lui/elle d’une façon interactive… Des recherches menées auprès d’infirmières et de médecins en soins palliatifs suggèrent que ces expériences sont relativement courantes… Il existe des cas de DBC qui ne peuvent être expliqués comme de simples hallucinations… : dans de tels cas, la personne mourante semble voir une personne qu’elle croyait vivante, mais qui est en fait décédée récemment, et exprime de la surprise » (p 30).
Une nouvelle vision postmatérialiste
« Prises ensemble, les différentes preuves empiriques montrent clairement que l’idée que l’esprit et la conscience sont produits par le cerveau est erronée et obsolète… Vers la fin du XIXe siècle, le psychologue américain, William James a suggéré que le cerveau pouvait jouer un rôle permissif et transmissif concernant les fonctions mentales et la conscience. Il a en outre émis l’hypothèse que le cerveau pouvait agir comme un filtre qui limite / contraint / restreint l’accès à des formes de conscience élargie. Cette hypothèse a également été défendue par les philosophes Ferdinand Schiller et Henri Bergson… » (p 31). « Cette hypothèse de la transmission apporte un cadre théorique utile… ».
« Le moment est venu de nous libérer des chaines et des œillères de l’ancien paradigme matérialiste et d’élargir notre vision de l’Univers et du vivant. Même si nous n’avons pas encore toutes les réponses, il est toutefois possible d’esquisser les grandes lignes d’un paradigme post-matérialiste » (p 31). Mario Beauregard nous présente, de son point de vue, quelques éléments clés de ce nouveau paradigme.
1° « L’esprit est irréductible et son statut ontologique est aussi primordial que celui de la matière, de l’énergie et de l’espace-temps. De plus, l’esprit ne peut être issu de la matière et réduit à quelque chose de plus élémentaire. A ce propos, le philosophe David Chalmers et le cosmologiste, Andrei Linde ont tous deux soutenu que la conscience est un constituant fondamental de l’univers. Il semble plausible que les processus / phénomènes mentaux, y compris l’intériorité subjective, existent à des degrés divers et à tous les niveaux d’organisation de l’univers… A ce sujet, le physicien Freeman Dyson suggère que puisque les atomes se comportent en laboratoire comme des agents actifs et non comme de la matière inanimée… ils doivent posséder la capacité réflexive de faire des choix… au niveau moléculaire, il est prouvé que les molécules composées de quelques protéines simples ont la capacité d’interagir de manière complexe, comme si elles possédaient leur propre intelligence… Dans cette perspective, chaque niveau d’organisation comprend un aspect physique (extérieur) et un aspect mental/ expérientiel (intérieur) (p 32-33).
2° « Comme le révèlent les phénomènes psi, il existe une profonde interaction entre le monde mental (psyché) et le monde physique (physis) qui ne sont pas vraiment séparés – ils ne le sont qu’en apparence. En fait, la psyché et la physis sont profondément interconnectées, car elles sont des aspects (ou des manifestations) complémentaires issus d’une base commune. On peut concevoir que cette base représente un niveau transcendant de l’esprit / conscience qui constitue le principe fondamental qui sous-tend l’ensemble de la réalité… » (p 33).
3° « L’esprit / volonté agit comme une force, c’est-à-dire qu’il peut impacter l’état du monde physique et agir de manière non locale. Cela implique qu’il n’est pas limité à des points spécifiques dans l’espace tels que les cerveaux et les corps, ni à des points spécifiques dans le temps comme le moment présent. Les preuves présentées dans ce chapitre de façon succincte indiquent également que les phénomènes mentaux exercent une influence sur le fonctionnement du cerveau et du corps ainsi que sur le comportement… » (p 34).
4° « Le cerveau agit comme un émetteur récepteur de l’activité mentale, c’est-à-dire que l’esprit fonctionne grâce au cerveau mais n’est pas produit par lui. Le fait que les fonctions mentales soient perturbées lorsque le cerveau est endommagé ne prouvent pas que l’esprit et la conscience soient produits par le cerveau… Dans l’idée que le cerveau puisse être une interface pour l’esprit, cet organe peut être comparé à un poste de télévision qui reçoit des signaux de diffusion et les convertit en images et en sons ». Si il est endommagé, il y a des perturbations dans la réception. « De même, une lésion dans une région spécifique du cerveau peut perturber les processus mentaux médiés par cette structure cérébrale, cependant cette perturbation n’implique pas que ces processus soient réductibles à l’activité neuronale dans cette région du cerveau » (p 34-35).
Pour une science post-matérialiste
Mario Beauregard a participé à la rédaction du manifeste pour une science post-matérialiste (2). Une bonne partie de son argumentation se retrouve dans ce manifeste. La perspective est vaste Elle s’inspire également de la révolution intervenue en physique dans le surgissement de la mécanique quantique : « A la fin du XIXe siècle, les physiciens découvrirent des phénomènes empiriques qui ne pouvaient être expliqués par la physique classique. Durant les années 1920 et au début des années 1930, cela a conduit au développement d’une nouvelle branche révolutionnaire de la physique, appelée : mécanique quantique. La mécanique quantique a mis en question les fondations matérielles de l’univers en montrant que les atomes et les particules subatomiques n’étaient pas des objets réellement solides – ils n’existent pas avec certitude à des emplacements spatiaux définis et à des moments définis. Plus important, la mécanique quantique a introduit notre esprit dans sa structure conceptuelle de base puisqu’il a été trouvé que les particules étant observées et l’observateur –le physicien et la méthode utilisée pour l’observation – sont liés. Suivant une interprétation de la mécanique quantique, ce phénomène implique que la conscience de l’observateur est décisive pour l’existence des évènements physiques observés et que les évènements mentaux peuvent affecter le monde physique. Les résultats d’expériences récentes soutiennent cette interprétation. Ces résultats suggèrent que le monde physique n’est plus la première ou la seule composante de la réalité et que celle-ci ne peut être pleinement comprise sans faire référence à l’esprit ». Le manifeste se poursuit en mettant l’accent sur l’influence que la pensée peut exercer sur le comportement et la santé. Et il poursuit l’argumentation apportée ici par Mario Beauregard. Au total, le manifeste proclame que l’adoption du paradigme post-matérialiste aura des effets bénéfiques pour l’ensemble de la civilisation humaine. C’est dans la même perspective que s’achève le chapitre de Mario Beauregard.
« Individuellement et collectivement, le paradigme post-matérialiste a des implications d’une portée considérable. Ce paradigme réenchante le monde et modifie profondément notre vision de nous-mêmes en nous rendant notre dignité et notre pouvoir en tant qu’êtres humains. Le paradigme post-matérialiste favorise également des valeurs positives telles que la compassion, le respect, la bienveillance, l’amour et la paix, car il nous fait prendre conscience que les frontières entre nous-mêmes et les autres sont perméables. Ce faisant, ce paradigme favorise une prise de conscience de la profonde interconnexion entre la nature et nous au sens large, y compris tous les niveaux d’organisation de l’univers. Ces niveaux peuvent englober des domaines non physiques et spirituels. A ce sujet, il convient de rappeler que le paradigme post-matérialiste reconnaît les expériences spirituelles qui se réfèrent à une dimension fondamentale de l’expérience humaine et qui sont fréquemment rapportées dans toutes les cultures… Et enfin, ce paradigme favorise également une prise de conscience concernant les questions environnementales et la nécessité de préserver notre biosphère, en mettant l’accent sur le lien profond qui nous unit à la nature » (p 35).
Une ouverture
Ce livre nous présente différentes approches du nouveau paradigme scientifique post-matérialiste. Dans sa présentation des phénomènes qui permettent d’envisager l’esprit au delà du cerveau, on constate l’universalité de ces phénomènes répandus dans toutes les cultures. Il en découle une universalité de la réalité spirituelle dont ils témoignent. Cette universalité peut embarrasser certains groupes religieux voulant s’approprier un monopole de « la vie après la vie ». En regard, un récent livre de la théologienne chrétienne Lytta Basset nous offre une approche inclusive dans son livre : « Cet Au-delà qui nous fait signe ». (5). Cette approche de l’Au-delà apparaît comme une révolution spirituelle. Le paradigme post-matérialiste nous présente une réalité interconnectée. Ainsi, « il existe une profonde interaction entre le monde mental et le monde physique qui ne sont pas vraiment séparés ». « La conscience apparaît comme un constituant fondamental de l’univers ». « Le nouveau paradigme favorise une prise de conscience de la profonde interconnexion entre la nature et nous, au sens large, y compris tous le niveaux d’organisation de l’univers » « C’est dans une perspective analogue que, selon le théologien Jürgen Moltmann, nous envisageons l’œuvre de Dieu dans la création (6). Ici, la création apparaît comme une « communauté dans laquelle toutes les créatures communiquent chacune à sa manière entre elles et avec Dieu ». Mario Beauregard envisage les incidences considérables de l’approche scientifique post-matérialiste sur notre culture. Sur le plan conceptuel, le matérialisme scientifique s’opposait à l’approche religieuse et à la perspective du salut. Ici cet obstacle est levé. « Le paradigme post-matérialiste reconnait les expériences spirituelles qui se réfèrent à un dimension fondamentale de l’expérience humaine ». Le nouveau paradigme « réenchante le monde ». C’est une perspective dans laquelle peut s’inscrire Michel Maxime Egger dans son livre : « Réenchanter notre relation au vivant » (7). Ce livre nous apporte une grande ouverture
J H
- Mario Beauregard, Gary R Schwartz, Natalie L Dyer, Marjorie Woollacott. La nouvelle science de la conscience. Visions d’un paradigme, post-matérialiste. Guy Trédaniel, 2021
- Manifesto for a post-materialist science : https://opensciences.org/files/pdfs/Manifesto-for-a-Post-Materialist-Science.pdf
- Mario Beauregard . Comment nos pensées influencent la réalité : https://vivreetesperer.com/comment-nos-pensees-influencent-la-realite/
- Potentiel de l’esprit humain et dynamique de la conscience : https://vivreetesperer.com/potentiel-de-lesprit-humain-et-dynamique-de-la-conscience/
- Une révolution spirituelle. Une nouvelle approche de l’Au-delà : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/
- Dieu dans la création : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
- Réenchanter notre relation au vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/
La pensée espérante est la pensée des possibles
Selon Jürgen Moltmann
Apparue dans les années 1960, la théologie de l’espérance de Jürgen Moltmann a répondu à une grande aspiration et suscité une dynamique qui s’est poursuivie à travers le temps (1). Cette dynamique se poursuit et garde toute son actualité comme en témoigne un petit livre publié chez Labor et Fides et intitulé : « Utopie » (2). Cet ouvrage reprend quelques textes fondateurs de Moltmann en les introduisant par un avant-propos de Marion Muller-Colard et en les accompagnant des éclairages de quelques théologiens. Nous présentons ici le premier des trois chapitres de Moltmann : « Utopie et pensée utopique ». La tonalité du chapitre nous apparaît dans cette profonde pensée : « La pensée espérante est la pensée des possibles » (p 17).
Du passé, du présent et du futur
Jürgen Moltmann nous appelle à réfléchir sur notre rapport avec le passé et avec le futur en passant par notre vécu du temps présent.
« La vie humaine est le temps de l’histoire. Elle est en tension entre le futur et le passé. Le futur est le domaine du possible, le passé, celui du réel ; quant au présent, c’est la ligne de front sur laquelle des possibilités peuvent être réalisées ».
Mais comment entrons-nous en rapport avec notre passé ? Comment notre mémoire s’exerce-t-elle et quel est son rôle ?
« Par le souvenir, nous rendons présentes les expériences passées, et par la mémoire, nous relions la réalité présente à la réalité passée » (p 13) ; Ainsi s’établit une « continuité rétrospective ». C’est la mémoire qui engendre également l’identité. « Aussi bien individuellement que collectivement, nous trouvons et confirmons notre identité grâce à une identification remémorant notre passé » (p 13). Notre ressenti de ces souvenirs peut être bien différent. Cependant, « ce passé peut influencer notre présent et notre futur, de telle façon que nous revenons toujours à ces évènements dont nous reconnaissons qu’ils font partie de notre histoire ».
Notre regard sur le futur est moins contraint. « Au regard de l’avenir, nous rendons présentes des expériences futures possibles par l’attente » (p 14). Là aussi, notre regard peut être différent. Ainsi la peur nous rend inquiet, mais peut-être aussi pré-voyant. « Nous devenons « pré-voyant » ». Autrement, « dans nos espoirs, nous anticipons également le futur et nous imaginons ce que serait le devenir des choses si nos désirs et nos attentes étaient exaucés. Par l’espérance, nous nous figurons un avenir désirable et concevons plans et projets pour le réaliser. Sans espoirs, ni plans, ni projets, nous passerions, aussi bien individuellement que collectivement, à coté de nos meilleures possibilités, pour la simple raison que nous ne les percevrions même pas » (p 15).
En mouvement
« Selon la forme que prend l’anticipation d’une expérience future possible, nous la nommons rêve, vision, utopie, projet ou planification ». C’est une ouverture. « Aux modes temporels du passé et du futur, correspondent les modes d’être du réel et du possible ». Certes, il n’est facile de prendre du large par rapport à des situations bien installées et à leurs effets, mais il y a des marges : « A la différence du passé, ces possibilités ne sont pas fixées ; en tant que possibilités futures, elles comportent toujours un facteur de hasard, de contingence, de surprise ou de déception.
« Pour l’expérience du présent comme tel, il est tout aussi important de se représenter un futur que de se souvenir du passé. Les attentes futures marquent l’expérience du présent autant que l’agir actuel… Qui envisage le futur avec sérénité y investira… Pour la vie dans l’histoire, l’orientation vers le futur est d’importance vitale. C’est la raison pour laquelle nous connaissons une grande variété de modalités selon lesquelles nous regardons vers le futur : de la peur à l’espoir, de l’attente à la planification » (p 16-17). Nous dépendons de cet horizon. « Si il ne se passe « rien de neuf sous le soleil, nous n’avons plus qu’à nous résigner ». Alors dans quelles conditions et comment pouvons nous embrasser l’espérance ? « Tant que les systèmes politiques et économiques dans lesquels nous vivons sont « des systèmes ouverts », l’espérance nous fait vivre. Dans des « systèmes clos », il ne reste que la mort. Notre espérance subjective dépend de l’ouverture du monde objectif pour lequel elle s’engage en prenant soin. La pensée espérante est une pensée des possibles » (p 17).
L’approche planificatrice
« Nous pratiquons la pensée des possibles par la planification et par l’utopie ». Jürgen Moltmann décrit et analyse l’activité planificatrice courante et parfois centrale dans nos sociétés. « Sous le terme de « planification », nous comprenons une disposition anticipante pour l’avenir. La croissance de la masse des possibilités dans la société scientifique et technique ainsi que le nombre croissant des changements sociaux en jeu rendent plus signifiante une planification à moyen et long terme, destinée à éviter « les mauvaises surprises » (p 17). On entend procéder à partir des causes et de leurs effets.
« Mais si des prévisions causales sont effectivement possibles pour des phénomènes isolés, elles ne peuvent être appliquées à des « systèmes ouverts » dont le futur est encore partiellement indéterminé. Pour intervenir dans les systèmes ouverts, on doit faire appel aux calculs des probabilités. Par ailleurs, « référées à des réalités plus complexes et à des possibilités multiples, les planifications se trouvent toujours dans un rapport dialectique avec l’histoire faite et vécue » (p 19). Elles interfèrent avec le cours des évènements.
La planification implique et engage un choix de valeurs. « D’année en année, nous sommes mieux équipés pour atteindre ce que nous voulons, mais que voulons-nous au juste ? Il n’existe pas de planification indépendante de choix de valeurs » (p 20).
La planification est mise en œuvre par ceux qui disposent du pouvoir de l’entreprendre. « Dans notre société, les planifications d’envergure présupposent le pouvoir économique et politique, et servent à élargir et consolider le pouvoir. Le futur doit être réalisé comme progrès du présent… Ces planifications sont au service d’une image du futur dégagée à partir des tendances et des faits, du statu quo. La mentalité planificatrice est de part en part articulée à la conservation du pouvoir. Elle ne perçoit pas le futur comme l’arrivée de nouvelles possibilités, mais comme la continuation du présent. Il ne s’agit pas de rendre réel le futur, mais d’étendre le présent » (p 20).
La pensée utopique
« Par le terme « utopie », nous désignons des images d’un avenir souhaitable qui n’a pas encore trouvé d’autres lieux de réalisation que les rêves ou les désirs des hommes ». Jürgen Moltmann évoque des œuvres écrites dans le passé et décrivant des sociétés imaginées idéales comme « La Cité de Dieu » de Saint Augustin, « l’Utopie » de Thomas More ; « L’Abbaye de Thélème » de François Rabelais, « La Cité du soleil » de Tommaso Campanelle. « On peut enfin dire que la « Réforme Radicale » vit foncièrement d’une pensée ou d’une quête utopique ». « Depuis la Révolution française et par delà les Lumières européennes, l’Utopie… apparaît dans le futur de l’histoire dans un avenir à accomplir » (p 21-22). Dans les criss actuelles, « la pensée utopique est devenue pertinente pour l’avenir, prenant la forme d’un rapport révolutionnaire au statu quo… On projette ses espoirs sur une vie dans l’avenir et on les confronte à un présent porteur de mort ou lourd d’aliénations. Les utopies du bonheur et de la liberté deviennent l’espoir d’avenir de ceux qui souffrent et sont prisonniers ; elles les mobilisent dans la réalisation de leurs buts » (p 22).
« On peut distinguer les buts réellement possibles et les facteurs d’espérance qui nécessairement les dépassent ». Jürgen Moltmann rappelle de grandes luttes où l’espérance a joué un grand rôle. « Sans le « rêve » de liberté et d’égalité, les noirs opprimés des Etats-Unis ne seraient pas descendus dans la rue avec le Mouvement pour les droits civiques de Martin Luther King. Sans le rêve d’une dignité propre, bien des peuples ne se seraient pas soulevés contre la dictature qui les opprimait, ni Nelson Mandela contre le régime d’apartheid de l’Afrique du Sud ».
Dans les Temps modernes européens, les utopies se sont mobilisées, soit pour l’égalité, soit pour la liberté, utopies socialistes ou utopies démocratiques. Mais l’un ne va pas sans l’autre. « Pas de liberté sans justice, pas de justice sans égalité » (p 24). Ainsi, l’utopie socialiste de l’Union soviétique s’est effondrée. Aujourd’hui, « l’utopie capitaliste de la marchandisation globale de toutes choses et de la démocratie libérale a pris sa place. Selon Francis Fukuyama, la société du marché global doit être « la fin de l’histoire ». Mais tant que le libre marché récompensera les forts et pénalisera les faibles, il y aura des utopies opposées qui maintiendrons vivante l’espérance du peuple. Car cette « utopie universelle du statu quo » n’est souhaitable que pour le premier monde. A long terme, elle détruit l’humanité et la planète » (p 25).
Le Royaume de Dieu : nouvel avenir de l’humanité
Jusqu’ici, ce sont des utopies partielles qui ont été présentées. « La forme ultime du désir humain a toujours été appelée le « Bien Suprême » et identifiée à une réalité totalement nouvelle qui supprimerait cette réalité temporelle infirme et endommagée. Ce furent les religions, et, parmi elles, avant tout les religions d’espérance abrahamiques – judaïsme, christianisme, islam – qui attendent de l’avenir de l’histoire cette alternative totale ». Là où il y a espérance, elle tient lieu de religion, et la vérité de la religion est la lumière de cette utopie alternative et totale, « espérance en finalité et totalité » (p 25).
Au chapitre suivant, Jürgen Molmann abordera la pensée eschatologique. En christianisme, le Royaume de Dieu est une réalité primordiale. « L’utopie totale du « Royaume de Dieu » n’apporte pas un nouvel avenir historiquement situé, mais un nouvel avenir de l’histoire toute entière. Avec lui prend fin le temps historique et s’ouvre l’éternité. C’est pourquoi, dans ce « Royaume de Dieu », non seulement prennent fin famine et esclavage, mais avec eux disparaît tout le « schème » de ce monde à l’envers : péché, mort et diable ». (p 26). Cette nouvelle réalité est appelée à s’étendre au monde entier. « Cet accomplissement n’est pas seulement attendu par le monde humain n’ayant pas encore été racheté, mais également par « la création gémissant dans les douleurs de l’enfantement » (Rom 8.19). Il figure le dépassement de toute détresse et l’exaucement de tous les désirs. Puisque tout agir humain produit de nouvelles détresses, cette utopie totale a été liée à l’expérience religieuse et rapportée à la présence de la transcendance, c’est-à-dire à Dieu » (p 26-27).
Dans un avant-propos, l’écrivaine et théologienne protestante Marion Muller-Colard nous dit « l’actualité » du texte de Jürgen Moltmann qui date pourtant des années 1990 (p 7). Avec elle, nous pouvons considérer l’utopie en terme de « dynamique » et « c’est dans cette perspective que Jürgen Moltmann nous offre une perspective inspirante ». Nous retrouvons ici quelques paroles décisives de Moltmann comme : « Pour la vie dans l’histoire, l’orientation vers le futur est d’importance capitale ». Et, dans cette démarche, elle aussi reprend l’affirmation : « La pensée espérante est la pensée des possibles » (p 8).
J H
- Quelle vision de Dieu, du monde et de l’humanité en phase avec les aspirations et les questionnements de notre époque ? : https://vivreetesperer.com/quelle-vision-de-dieu-du-monde-de-lhumanite-en-phase-avec-les-aspirations-et-les-questionnements-de-notre-epoque/
- Jürgen Moltmann. L’Utopie. Avant-propos de Marion Muller-Colard. Labor et Fides, 2023 (Dossier de l’encyclopédie du protestantisme N° 10)
Comment la reconnaissance et la manifestation de l’admiration et de l’émerveillement exprimées par le terme : « awe », peut transformer nos vies
 A certains moments, dans certaines circonstances, nous ressentons une irruption de beauté, un passage où nous sommes subjugués par un sentiment d’admiration et d’émerveillement, la manifestation d’une réalité qui nous dépasse. Dans la langue anglaise, il y a un terme qui désigne cette situation et l’émotion qui l’accompagne : « awe ». Certes, ce terme vient de loin et il véhicule des connotations différentes, mais, dans cette histoire, il s’est dégagé des ombres qui l’accompagnaient. Et aujourd’hui, cette « awe » attire l’attention des chercheurs en psychologie soucieux de contribuer au « Greater good », au meilleur bien. Il évoque aussi un ressenti de transcendance qui s’inscrit dans une histoire religieuse et qui, aujourd’hui, se manifeste dans un champ plus vaste jusqu’à une reconnaissance possible dans la quotidienneté. Dans ce contexte, vient de paraître un livre écrit par Dacher Keltner, professeur de psychologie à l’université de Berkeley (Californie), également directeur au « Greater Good Centre » (1) ; cet ouvrage nous rapporte une avancée de la recherche en ce domaine : « Awe. The new science of everyday wonder and how it can transform your life » (L’admiration. La nouvelle science du merveilleux au quotidien et comment elle peut transformer votre vie ») (2).
A certains moments, dans certaines circonstances, nous ressentons une irruption de beauté, un passage où nous sommes subjugués par un sentiment d’admiration et d’émerveillement, la manifestation d’une réalité qui nous dépasse. Dans la langue anglaise, il y a un terme qui désigne cette situation et l’émotion qui l’accompagne : « awe ». Certes, ce terme vient de loin et il véhicule des connotations différentes, mais, dans cette histoire, il s’est dégagé des ombres qui l’accompagnaient. Et aujourd’hui, cette « awe » attire l’attention des chercheurs en psychologie soucieux de contribuer au « Greater good », au meilleur bien. Il évoque aussi un ressenti de transcendance qui s’inscrit dans une histoire religieuse et qui, aujourd’hui, se manifeste dans un champ plus vaste jusqu’à une reconnaissance possible dans la quotidienneté. Dans ce contexte, vient de paraître un livre écrit par Dacher Keltner, professeur de psychologie à l’université de Berkeley (Californie), également directeur au « Greater Good Centre » (1) ; cet ouvrage nous rapporte une avancée de la recherche en ce domaine : « Awe. The new science of everyday wonder and how it can transform your life » (L’admiration. La nouvelle science du merveilleux au quotidien et comment elle peut transformer votre vie ») (2).
« Awe » : des significations en évolution
« Awe » est un terme apparu en vieil anglais au Moyen Age. A l’époque, il traduit un sentiment de crainte et même de peur, voire de terreur par rapport à une manifestation de puissance et d’étrangeté. On peut imaginer de telles réactions dans un contexte marqué par un climat de violence et un manque de savoir. A titre d’exemple, la foudre n’est plus perçue aujourd’hui comme hier. Comme l’a écrit le chercheur Rudolf Otto, l’expression du sacré peut être redoutée. Cependant, l’emploi du terme « awe » dans le vocabulaire chrétien a porté une signification différente, celle d’une admiration respectueuse vis à vis de la grandeur de Dieu, parfois décrite comme « une crainte révérencielle, manifestation de transcendance, un ressenti d’un dépassement ». Aussi, la traduction de « awe » en français manifeste toute une gamme de sens : admiration, émerveillement, ébahissement, extase, crainte révérencielle… Le phénomène varie en intensité. Il peut se manifester d’une manière bouleversante comme dans les « peak experiences » (les expériences de sommet ) décrites dès les années 1960 par Abraham Maslow, ou bien selon une autre terminologie par « un sentiment océanique ». Mais si ces expériences sont toujours remarquables, elles peuvent se manifester sur un mode beaucoup plus courant et familier comme le livre de Dacher Keltner vient nous le montrer abondamment.
L’évolution de la recherche en psychologie
Si la recherche concernant les expériences religieuses et spirituelles est marquée aux Etats-Unis par la personnalité du philosophe et psychologue américain Williams James au début du XXe siècle, et si elle a été poursuivie par des personnalités comme Alister Hardy (3) en Angleterre dans les années 1970, la recherche concernant le phénomène de la « awe » est beaucoup plus tardive et s’inscrit dans un autre contexte. Dacher Keltner nous en présente le développement.
Dans les années 1980, la psychologie était dominée par la « révolution cognitive ». Dans ce contexte, chaque expérience humaine, du jugement moral à la manifestation des préjugés, était abordée dans une manière où notre pensée, comme un programme d’ordinateur, traitait les unités d’information dans un processus dépourvu d’émotions. Les émotions n’étaient pas prises en compte dans la compréhension de la nature humaine. Longtemps, les émotions ont été perçues comme inférieures et venant troubler notre raison, la part élevée de notre nature, considérée comme la plus haute manifestation de notre humanité. Les émotions fugaces et subjectives ne pouvaient être observées en laboratoire. C’est alors qu’un article de l’anthropologue Paul Eckman a renversé la vapeur en mettant en évidence l’importance des émotions et la nécessité ainsi que la possibilité de les étudier. Il avait auparavant parcouru la planète et démontré qu’il existait des émotions universelles, six au total : la colère, la peur, le dégoût, la joie, la tristesse, la surprise. Elles sont reconnaissables par des mimiques caractéristiques. De jeunes chercheurs s’engagèrent sur cette piste et ils élargirent le champ des émotions étudiées, y ajoutant l’amusement, la gratitude, l’amour et l’orgueil. Dans son laboratoire, Dacher Keltner a lui-même travaillé sur le rire, la gratitude, l’amour, le désir et la sympathie. En réaction par rapport à la révolution cognitive, une révolution de l’émotion était en cours. On a ainsi mis en avant l’étude d’une intelligence émotionnelle.
Ici Dacher Keltner s’interroge. Pourquoi l’étude de la « awe » ne s’est-elle pas inscrite dans ce grand mouvement de recherche alors que l’« awe » est une émotion qui est à la source de tant de choses humaines : « musique, art, religion, science, politique et intuitions transformatrices au sujet de la vie ». Les raisons de cette omission sont pour une part méthodologiques. La « awe » ne se prête pas à la mesure. Comment l’étudier dan un laboratoire ? Il y avait aussi une barrière théorique. Quand la science des émotions s’est développée, c’était dans le contexte de l’esprit du temps qui envisageait les émotions comme tournées vers la protection de soi, réduisant les dangers et accroissant les gains compétitifs pour les individus. En contraste, la « awe » semble nous orienter vers un dévouement porté au delà de soi, vers un service et un sacrifice. C’est le sentiment que les frontières entre nos mois individuels et les autres peuvent se dissoudre facilement, que notre vraie nature est collective. Ces qualités ne correspondaient pas à la conception de la nature humaine hyper individualiste, matérialiste, qui dominait à l’époque. Et de plus, certains craignaient d’engager leur pratique scientifique dans un domaine où les expériences peuvent s’exprimer en termes religieux.
Développement de la recherche sur la « awe »
Lorsque la recherche sur les émotions a commencé à aborder le champ des émotions positives, en 2003, Dacher Keltner et un de ses collègues, Jonathan Haig ont commencé à travailler pour élaborer une définition de la « awe ». A l’époque, il y avait seulement quelques articles concernant ce sujet. Il manquait une définition. Dave Keltner rapporte comment ils ont étudié une vaste littérature, de mystiques à des anthropologues et à un sociologue comme Max Weber. Et il en est résulté la définition suivante : la « Awe » est le sentiment de la présence de quelque chose d’immense qui transcende votre compréhension habituelle du monde ». L’immensité (« vastness ») peut être perçue tant dans l’espace que dans le temps ou bien encore dans le monde des idées « lorsqu’une épiphanie intègre des croyances dispersées en une thèse cohérente ». L’immensité peut être déstabilisante. Elle entraine la recherche de nouvelles formes de compréhension. La « awe » porte sur les grands mystères de la vie. Il y a des variations innombrables. Comment change-t-elle d’une culture à une autre, ou d’une période de l’histoire à une autre, ou d’une personne à un autre ? Ou bien même d’un moment de votre vie à un autre ? Le sens change selon les contextes, et ces contextes sont extrêmement divers.
Lorsqu’au début du XXe siècle, le grand psychologue américain William James s’engagea dans une recherche pour comprendre la « awe » mystique, il ne procéda pas à des expérimentations ou à des mesures. Il rassembla des récits : des récits personnels, à la première personne, de rencontres avec le divin, des récits de conversions religieuses, d’épiphanies spirituelles… Et en découvrant des configurations dans ces récits, il mit en lumière « le cœur de la religion dans son rapport avec la « awe » mystique, une expérience émotionnelle ineffable d’être en relation avec ce que nous considérons divin ».
Dacher Keltner s’est donc engagé avec le professeur Yang Bai dans une grande enquête internationale à l’échelle mondiale en vue de rassembler des récits de personnes décrivant une expérience de « awe » selon la définition choisie : « Etre en présence de quelque chose de vaste et de mystérieux qui transcende votre compréhension habituelle du monde ». Les participant venaient de toutes les religions ou de sans-religions. Ils appartenaient à des cultures différentes avec une grande diversité de conditions sociales et de conditions d’éducation. 2600 récits ont été traduits à partir de vingt langues.
(Ce chapitre et le précédent sont écrits à partir des pages du livre 4 à 12).
Les huit merveilles de la vie
Qu’est-ce qui allait ressortir de cette moisson ? Dacher Keltner a été heureusement surpris de pouvoir classer ces récits en huit groupes aboutissant à une taxonomie en huit merveilles. De fait, le champ des expériences de « awe » est très vaste et ne se réduit pas à des situations privilégiées comme l’admiration de la nature. Qu’est ce qui amène le plus communément les gens à ressentir de l’admiration ? C’est la beauté morale qui s’exprime dans des actions où se marquent une pureté et une bonté de l’intention. Une attention particulière est accordée au courage.
Une seconde merveille de la vie est l’effervescence collective, un terme introduit par le sociologue français Emile Durkheim dans son analyse du cœur de la religion. Il y aurait une force de vie qui porterait les gens dans une conscience collective, un sens océanique du « nous ». Les récits portent sur des évènements familiaux, religieux, sportifs, politiques…
La troisième merveille de la vie, c’est la nature. Les phénomènes naturels impressionnent. « Les expériences dans les montagnes, la vue des canyons, la marche parmi des arbres majestueux, une course à travers des dunes de sable, une première rencontre avec l’océan suscitent de la « awe ». Ces expériences s’accompagnent fréquemment du sentiment que les plantes et les animaux sont conscients, une idée répandue dans les traditions indigènes.
La musique apparaît comme la quatrième merveille de la vie, car elle transporte les gens dans de nouvelles dimensions de signification symbolique à travers l’expérience de concerts, de l’écoute tranquille d’un morceau de musique, du chant dans des temps religieux ou tout simplement avec d’autres. On connait l’importance de la musique dans la culture actuelle.
Les réalisations visuelles (« visual design ») apparaissent comme la cinquième merveille de la vie. L’auteur cite des constructions, de grands barrages, de belles peintures.
Des récits de « awe » spirituelle et religieuse manifestent la sixième merveille de la vie. On y trouve bien sûr des récits de conversion.
L’auteur mentionne des récits de vie et de mort en y voyant une septième merveille de la vie. Le passage de la mort est évidemment un moment particulièrement crucial.
La huitième merveille de la vie se manifeste en terme d’épiphanies, c’est à dire de moments où nous comprenons soudainement des vérités essentielles sur la vie. A travers le monde, des gens ont été remplis d’« awe » par des intuitions philosophiques, des découvertes scientifiques, des idées métaphysiques, des équations mathématiques… Dans chaque cas, l’épiphanie unit des faits, des croyances, des intuitions et des images en un nouveau système de compréhension.
Toutes ces expériences de « awe » « interviennent dans un royaume différent du monde banal du matérialisme, de l’argent, de la cupidité, et de la recherche de statut, un royaume au delà du profane que beaucoup appellent le sacré » (p 19) (p 10-19).
La spécificité de l’émotion de « awe »
Dacher Keltner revient sur le parcours du terme : « awe » et nous montre que la signification correspondante est désormais tout à fait distincte des significations qui lui ont été associées au départ. En effet, le terme « awe » remonte à un mot anglais apparu il y a 800 ans et qui renvoyait à la peur, la crainte, la terreur. Le contexte de l’époque était menaçant. Depuis la signification a évolué, mais qu’en est-il d’un héritage de peur ? La recherche sur les émotions permet de répondre aujourd’hui à cette question. Parmi les autres émotions, l’émotion de « awe » est spécifique. Dacher Keltner peut s’appuyer sur une analyse mathématique d’une nouvelle approche quantitative d’un ensemble d’expériences émotionnelles. Dans cette étude, son auteur, Alan Cowen, a pris en compte 27 espèces d’émotion. Ici, l’émotion de « awe » apparaît comme très éloignée de la peur et de l’anxiété. Au contraire, elle est proche de l’admiration, de l’intérêt, de l’appréciation esthétique ou du sentiment de beauté. « L’émotion de « awe » paraît intrinsèquement bonne ». Cette émotion se distingue d’un sentiment classique de beauté qui ne comporte pas une impression d’immensité et de mystère. L’émotion de « awe » s’accompagne de réactions du corps spécifiques, par exemple de l’expression faciale. « Notre expérience de la « awe » prend place dans un espace spécifique très loin de la peur et distincte du sentiment plaisant et familier de la beauté » (p 23) (p 19-23).
L’émotion de « awe » au quotidien
A partir de ces constats, Dacher Keltner s’est interrogé sur la fréquence des émotions de « awe ». L’enquête internationale avait collecté des récits témoignant d’une grande intensité de « awe ». L’expérience de « awe » est-elle beaucoup plus répandue ? Apparaît-elle dans nos vies quotidiennes ? Des recherches nouvelles, à partir de l’analyse de journaux personnels tenus au quotidien, apportent une réponse positive. « Dans nos vies quotidiennes, nous ressentons fréquemment des émotions de « awe » dans nos rencontres avec la beauté morale, et en second, la nature, et dans des expériences avec la musique, l’art et le cinéma « (p 25). La culture influence ces ressentis. Ainsi, aux Etats-Unis, ils sont beaucoup plus fréquents dans des contextes individualistes. Certains éprouvent, quelque part chaque semaine, un ressenti de « awe », en « reconnaissant l’extraordinaire dans l’ordinaire », une générosité, la senteur d’une fleur, la lumière dans un arbre, un chant. « De grands penseurs de Walt Whitman à Rachel Carson… nous appellent à prendre conscience combien une bonne part de notre vie peut apporter une émotion de « awe » (p 26).
Les contours de la « awe » ?
Après ces différentes approches de recherche, une enquête internationale, une cartographie des émotions et l’expression des gens sur leur expérience quotidienne, Dave Keltner peut nous répondre à la question : « Qu’est-ce que la « awe » ? « La « awe » commence avec les huit merveilles de la vie. Cette expérience se déroule dans un espace spécifique et diffère des sentiments de peur et de beauté. Notre expérience quotidienne nous en offre de multiples occasions ».
L’auteur nous parle des émotions « qui nous transportent hors d’un état focalisé sur nous-même, centré sur la menace et soucieux du statu quo, vers un royaume où nous sommes connectés à quelque chose de plus grand que nous-même » (p 28). Parmi les émotions qui nous décentrent de nous-même, l’auteur cite la joie, l’extase (où nous nous sentons nous dissoudre complètement alors que dans la « awe » nous restons conscients de notre moi, bien que faiblement), l’amusement…
Cette « awe » nous tourne vers « quelque chose de plus grand que le soi » (« Something larger than the self » (p 31). Dacher Keltner relit le cours de l’histoire. Pendant des centaines d’années, la « awe » a inspiré la manière d’écrire sur la rencontre avec le divin. Avec Emerson et Thoreau, elle était au cœur d’une écriture sur la rencontre émerveillée de la nature. Elle a amené des chercheurs comme Herschel à la recherche astronomique. Albert Einstein a ainsi écrit : « la plus belle expérience que nous pouvions faire est celle du mystérieux. C’est l’émotion fondamentale qui se tient au berceau de l’art et de la science » (p 29). C’est aussi une émotion qui inspire la communion humaine. « Dans les moments de « awe », nous nous éloignons de l’impression que nous sommes seuls en charge de notre propre destin pour parvenir au sentiment de faire partie d’une communauté interdépendante et collaborante. Cette « awe » élargit ce que le philosophe Pete Singer appelle le cercle du soin (circle of care)… William James appelle les actions qui donnent naissance au cercle du soin ‘les saintes tendances de la « awe » mystique’… Cette « awe » éveille les meilleurs anges de notre nature » (p 40-41).
Comment la « awe » peut rendre la vie meilleure
Dave Keltner nous a montré que l’émotion de « awe » n’est pas un phénomène exceptionnel, mais que cette émotion peut apparaître à certains moments de la vie quotidienne avec des effets bénéfiques. Si il y a toujours un risque d’instrumentalisation, on peut donc imaginer des évènements et des processus favorisant cette émotion. C’est dans ce sens que travaille le centre du « Greater Good » à Berkeley. Le site correspondant publie de nombreux articles sur le thème de la « awe » et notamment cet article : « Huit raisons pour laquelle la « awe » rend la vie plus heureuse, en meilleure santé, plus humble et plus connectée aux gens autour de vous » (4).
« Un ensemble croissant de recherches suggère que faire l’expérience de la « awe » peut engendrer une vaste gamme de bienfaits, même davantage de générosité, d’humilité et d’esprit critique… Nous pouvons sous-estimer cette opportunité ». Une simple prescription peut avoir des effets transformateurs. Envisagez davantage d’expériences journalières de « awe », déclare Dacher Keltner.
Cet article énumère les bienfaits d’une expérience de « awe » en accompagnant d’exemples et de données chaque proposition :
° La « awe » peut améliorer votre humeur et vous rendre plus satisfait de votre vie.
° La « awe » peut être bonne pour votre santé.
° La « awe » peut vous aider à penser d’une manière plus critique.
° la « awe » peut réduire le matérialisme.
° La « awe » peut vous rendre plus petit et plus humble.
° La « awe » peut vous donner l’impression que vous avez plus de temps.
° La « awe » peut vous rendre plus généreux et plus coopératif.
° La « awe » peut vous rendre plus connecté aux autres gens et à l’humanité.
Cependant, précise cet article publié en 2018, la recherche sur ce thème n’est en fait qu’à son début et beaucoup de points restent à préciser ou à étudier. Paru en 2022, le livre de Dacher Keltner est un grand pas en avant.
Une vision nouvelle
A l’échelle internationale, des personnes ont donc été appelées à décrire une expérience de « awe » selon la définition : « Etre en présence de quelque chose de vaste et de mystérieux qui transcende notre compréhension habituelle du monde ». De fait, pour Dacher Keltner, la « awe » nous tourne vers quelque chose de plus grand que nous (something larger than the self). Et il relit ainsi le cours de l’histoire : « Pendant des centaines d’années, la « awe » a inspiré la manière d’écrire sur la rencontre avec le divin. Avec Emerson et Thoreau, elle était au cœur d’une écriture sur la rencontre émerveillée avec la nature ». Il reprend une citation d’Einstein : « La plus belle expérience que vous puissiez faire est celle du mystérieux. C’est l’émotion fondamentale qui se tient au berceau de l’art et de la science ».
Si il y a un lien entre « awe » et transcendance, il est significatif que le retard dans la recherche psychologique sur la « awe » puisse être attribuée pour une part à une conception de la nature humaine hyper individualiste et matérialiste qui dominait encore à la fin du XXe siècle et également à une crainte de compromission avec la religion. On notera que la psychologue américaine Lise Miller a dû également s’imposer dans sa recherche sur l’activité du cerveau et la spiritualité (5) comme dans celle sur la spiritualité de l’enfant (6). La reconnaissance nouvelle de ces recherches marque un tournant dans l’état d’esprit du milieu de la recherche. C’est un tournant significatif.
Le terme anglais : « awe » est polysémique et sa traduction en français est donc difficile. Dans notre texte, nous avons gardé le mot original. Une des significations correspondantes en français est l’émerveillement. Philosophe et théologien, Bertrand Vergely a montré en quoi l’émerveillement joue un rôle majeur dans notre vision du monde (7). « Qui s’émerveille n’est pas indifférent. Il est ouvert au monde, à l’humanité, à l’existence. Il rend possible un lien à ceux-ci ». Ce constat nous rappelle la manière dont la « awe » est perçue comme décentrement de soi pour une ouverture au monde et notamment aux autres humains. « Dans les moments de « awe », nous nous éloignons de l’impression que nous sommes seuls en charge de notre propre destin pour parvenir au sentiment de faire partie d’une communauté interdépendante et collaborante ».
Les résultats de l’enquête internationale manifestent, à travers leur diversité, des tendances communes, des expressions d’une spiritualité universelle. Cette universalité se constate également dans un tout autre domaine, celui des expériences de mort imminente (8). Quoiqu’il en soit, en regard, nous exposons ici des tendances universalisantes dans le monde chrétien. Ainsi, l’historienne et théologienne américaine, Diana Butler Bass, dans son livre : « Grounded. Finding God in the world. A spiritual revolution » (9), écrit : « Ce qui apparaît comme un déclin de la religion indique en réalité une transformation majeure dans la manière où les gens se représentent Dieu et en font l’expérience. Du Dieu distant de la religion conventionnelle, on passe à un sens plus intime du sacré qui emplit le monde. Ce mouvement, d’un Dieu vertical à un Dieu qui s’inscrit dans la nature et dans la communauté humaine, est au cœur de la révolution spirituelle qui nous environne… ». Si le glissement de sens dans le terme « awe » est plus ancien, il s’inscrit aussi dans ce contexte. Dans son livre : « Grounded », Diana Butler Bass nous révèle la manière dont les gens trouvent un nouvel environnement spirituel dans un Dieu qui réside avec nous dans le monde : dans le sol, l’eau, le ciel, dans nos maisons et nos voisinages et dans nos espaces communs.
Pour interpréter l’évolution en cours et esquisser une réponse chrétienne, nous trouvons un éclairage théologique dans la pensée de Jürgen Molmann (10). « Dieu, le créateur du ciel et de la terre est présent par son Esprit cosmique dans chacune de ses créature et dans leur communauté créée… Grâce aux forces et aux possibilités de l’Esprit, le créateur demeure auprès de ses créatures, les vivifie et les mène vers son royaume futur… Dieu est à la fois transcendant et immanent ». Dieu est communion.
Comme Jürgen Moltmann, Richard Rohr partage cette vision (11) « La révolution trinitaire, en cours, révèle Dieu avec nous dans toute notre vie… Elle redit la grâce inhérente à la création, et non comme un additif additionnel que quelques personnes méritent… Dieu est celui que nous avons nommé Trinité, le flux (flow) qui passe à travers toute chose… Toute chose est sainte pour ceux qui ont appris à la voir ainsi… Toute impulsion vitale, toute force orientée vers le futur, toute poussée d’amour, tout élan vers la beauté, tout ce qui tend vers la vérité, tout émerveillement devant une expression de bonté, tout bond d’élan vital… tout bout d’ambition pour l’humanité et la terre, est éternellement un flux de vie du Dieu trinitaire… ».
« Cet élan vers la beauté, cet émerveillement devant une expression de bonté » ne sont-ils pas souvent propices à une émotion de « awe » ? Et si la « awe » est « le sentiment de la présence de quelque chose d’immense qui transcende notre compréhension habituelle du monde », si ce sentiment peut se manifester et se manifeste dans des vécus extérieurs à toute empreinte religieuse, il peut également être éclairé par l’approche théologique que nous venons de proposer. Et cette approche éclaire notre regard chrétien sur ces réalités.
Dans la tourmente qui se manifeste aujourd’hui dans le déchainement d’une violence patriarcale, il serait bon que nous ne perdions pas de vue les signes d’évolution positive qui sont apparus dans les toutes dernières décennies. Et, parmi ce signes, la mise en valeur de la gratitude (12) et de la « awe » dans le champ psychologique. Cette mise en évidence apparaît à la fois comme un progrès dans la civilisation humaine et comme un fait spirituel.
J H
- Greater Good Center : https://greatergood.berkeley.edu
- Dacher Keltner. Awe. The new Science of everyday wonder and how it can transform your life. Penguin Press, 2023
- L’œuvre d’Alister Hardy, dans : Participation des expériences spirituelles à la conscience écologique : https://vivreetesperer.com/la-participation-des-experiences-spirituelles-a-la-conscience-ecologique/
- Eight reasons why awe makes your life better : https://greatergood.berkeley.edu/article/item/eight_reasons_why_awe_makes_your_life_better?fbclid=IwAR3PMEJYCYR4hNPBOxfJhd1aMLDE-gtAUVQ_dquAsu25VZxS8GeT4GCB-70
- Lisa Miller. The awakaned brain : https://vivreetesperer.com/the-awakened-brain/
- Lisa Miller. L’enfant spirituel : https://vivreetesperer.com/lenfant-un-etre-spirituel/
- Bertrand Vergely. Avant toute chose, la vie est bonne : https://vivreetesperer.com/avant-toute-chose-la-vie-est-bonne/
- Lytta Basset. Une révolution spirituelle. Une nouvelle approche d l’Au-delà : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/
- Diana Butler Bass. Une nouvelle manière de croire : https://vivreetesperer.com/une-nouvelle-maniere-de-croire/
- Deux approches convergentes : Diana Butler Bass et Jürgen Moltmann : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-dieu-present-dieu-avec-nous-dans-un-univers-interrelationnel-holistique-anime/
- Richard Rohr. La danse divine : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/
- La gratitude. Un mouvement de vie : https://vivreetesperer.com/la-gratitude-un-mouvement-de-vie/
Sortir de l’obsession de l’efficience pour entrer dans un nouveau rapport avec la nature.
 De l’âge mythique du progrès incarné par l’ère industrielle à un âge de la résilience.
De l’âge mythique du progrès incarné par l’ère industrielle à un âge de la résilience.
L’âge de la résilience selon Jérémie Rifkin
« Jérémie Rifkin est l’un des penseurs de la société les plus populaires de notre temps. Il est l’auteur d’une vingtaine de best-sellers ». On peut ajouter à cette présentation du livre de Jérémie Rifkin : « L’âge de la résilience» (1) que l’auteur n’est pas seulement un chercheur qui ouvre des voies nouvelles, mais un conseiller influent qui intervient auprès de nombreuses instances de décision. Ses livres nous font entrer dans de nouvelles manières de voir et de penser. Ainsi, sur ce blog, nous avons présenté « La troisième révolution industrielle » (2) et le « New Deal vert mondial » (3). Jérémie Rifkin est également l’auteur de grandes synthèses qui éclairent notre marche. Ainsi, sur le site de Témoins, nous avons présenté son livre sur l’empathie (4), une fresque historique très engageante. En général, comme dans ce livre ‘l’âge de la résilience’, Jérémie Rifkin développe son regard prospectif à partir d’une analyse et d’un bilan du passé. Il nous a habitué à une démarche dynamique. C’est avec d’autant plus d’attention que nous entendons ici son cri d’alarme sur l’héritage du passé et la menace du présent. Tout est à repenser. « Il ne s’agit plus de courir après l’efficacité, mais de faire grandir notre capacité de résilience. Nous devons tout repenser : notre vision du monde, notre compréhension de l’économie, nos formes de gouvernement, nos conception de l’espace et du temps, nos pulsions les plus fondamentales et, bien sûr, notre relation à la planète » (page de couverture).
Un chemin pour changer de vision et de paradigme
Dans l’introduction du livre, Jérémie Rifkin esquisse un chemin pour dépasser l’héritage du passé et nous engager dans une nouvelle manière de vivre.
L’auteur nous invite donc à revisiter notre histoire. Il commence par remettre en cause le mythe du progrès. Ainsi rappelle-t-il les propos du philosophe Condorcet guillotiné en 1794 : « La perfectibilité de l’homme est réellement indéfinie. Les progrès de cette perfectibilité, désormais indépendante de toutes puissances qui voudrait les arrêter, n’ont d’autres termes que la durée du globe où la nature nous a jeté » (p 10). « Aujourd’hui, sa conception du futur nous semble naïve. Pourtant le concept de progrès n’est que la dernière itération d’une vieille croyance : les humains seraient fondamentalement différents des autres êtres vivants avec qui ils se partagent la terre » (p 10). Aujourd’hui, l’humanité est assaillie de menaces et de peurs. En regard, un peu partout, le terme de résilience est évoqué. « L’âge du progrès cède la place à l’âge de la résilience ». « Ce grand basculement de l’âge du progrès à l’âge de la résilience requiert un vaste ajustement philosophique et psychologique dans la perception qu’a l’humanité du monde qui l’entoure. A la racine de la transition, il y a un changement total de notre rapport à l’espace et au temps » (p 11).
Jérémie Rifkin raconte comment la vie ordonnée des moines bénédictins au Moyen Age a suscité une nouvelle appréhension du temps ponctué par leurs activités. C’est la naissance de l’horloge mécanique qui s’est répandue ensuite dans la civilisation urbaine. Finalement, le temps va « être perçu comme une suite d’unités standard mesurables, fonctionnant dans un univers parallèle, qui ne doit plus rien aux rythmes de la terre » (p 84). Cette nouvelle temporalité va déboucher sur une recherche d’efficacité accrue dans le temps disponible. Cette temporalité a régi de bout en bout l’âge du progrès et sa conception de l’efficience. L’efficience a cherché à « optimiser l’expropriation, la consommation et la mise au rebut des ressources naturelles, et, ce faisant, à accroitre l’opulence matérielle de la société dans des temps toujours plus courts, mais au prix de l’épuisement de la nature. Notre temporalité personnelle et le pouls temporel de notre société obéissent à l’impératif de l’efficience » (p 12).
« Dans cet ouvrage, le terme « efficiency » employé dans l’édition originale, ne signifie pas « efficacité (capacité d’atteindre un objectif), mais « efficience » (capacité d’obtenir les résultats ou les profits maximaux avec le minimum de moyens et de frais dans le minimum de temps) » (p 12). « L’âge du progrès marchait au pas de l’efficience ». « Passer du temps de l’efficience à celui de l’adaptativité : tel est le visa de réadaptation qui permettra à l’espèce humaine de sortir d’un rapport de séparation et d’exploitation avec le monde naturel pour être rapatrié parmi la multitude des forces environnementales qui animent la Terre » (p 12)… Remplacer l’efficience par l’adaptativité implique des changements radicaux dans l’économie et dans la société : elles vont passer de la productivité à la régénérativité, de la croissance à l’épanouissement, de la propriété à l’accès, des marchés avec leurs vendeurs et leurs acheteurs aux réseaux avec leurs fournisseurs et leurs utilisateurs, des processus linéaires aux processus cybernétiques, des économies d’échelle de l’intégration verticale à celles de l’intégration latérale… des conglomérats capitalistes aux petites et moyennes coopératives opérant en blockchain sur des communs fluides… de la globalisation à la glocalisation, du consumérisme à l’intendance des écosystèmes, du produit national brut (PNB) aux indicateurs de qualité de vie… (p 12-13). Déjà expert de la « troisième révolution industrielle », Jérémie Rifkin voit là un mouvement en voie de « réinsérer l’humanité dans les infrastructures indigènes de la planète : l’hydrosphère, la lithosphére, l’atmosphère et la biosphère. La nouvelle infrastructure emporte l’humanité au delà de l’ère industrielle… » (p 13).
« Sans surprise, la nouvelle temporalité s’accompagne d’une réorientation fondamentale à l’égard de l’espace ». Notre appréhension de l’espace varie dans le temps, comme l’auteur nous le fait remarquer en mettant en lumière l’avènement de la perspective dans la peinture de la Renaissance italienne et ses incidences révolutionnaires (p 86-87). Bien sûr, dans l’âge qui vient, les ressources naturelles seront perçues et gérées autrement. Mais le changement de mentalité va plus loin encore. Nous prenons conscience d’appartenir à un ensemble vivant et nous ne nous regardons plus comme des êtres à part séparés de l’extérieur. L’auteur nous fait part de découvertes importantes qui nous situent en interaction avec le vivant. « Nous commençons à comprendre que notre vie et celle des autres êtres vivants est faite de processus, de modèles et de flux… Tous les êtres vivants sont des extensions des sphères terrestres. Les minéraux et les nutriments de la lithosphère, l’eau de l’hydrosphère, l’air de l’atmosphère nous parcourent continuellement sous forme d’atomes et de molécules, s’installent dans nos cellules… et y sont remplacées régulièrement, à différents intervalles, au cours de notre vie. La majorité des tissus et organes qui constituent notre corps se renouvellent sans cesse au fil de nos existences… ». Et, par ailleurs, « Notre corps n’est pas uniquement à nous. Nous le partageons avec de nombreuses autres formes de vie – des bactéries, des virus, des protéines, des archées et des champignons… Plus de la moitié des cellules de notre corps ne sont pas humaines… elles appartiennent aux autre êtres qui vivent dans chaque coin de notre anatomie (p 179-190)… Ainsi, nous sommes tous des écosytèmes… Et, de plus, nous sommes faits de multiples horloges biologiques qui adaptent continuellement nos rythmes corporels internes à ceux que marquent les rotations de la terre… rythmes circadien et lunaire, rythme des saisons, rythmes annuels… » (p 13-14).
Ainsi, « nous faisons partie de la terre, au plus profond de notre être… » L’auteur en déduit que « cela nous inspire des idées neuves sur la nature de la gouvernance et sur notre fonctionnement en tant qu’organisme social. A l’âge de la résilience, gouverner, c’est assurer l’intendance de écosystèmes régionaux. Et cette gouvernance biorégionale est beaucoup plus partagée, distribuée… » (p 15)
Cependant, on ne peut manquer de se poser une question fondamentale. Quel est le sens de ce parcours ? « Que cherche l’humanité ? Pas seulement sa simple subsistance. Quelque chose de plus profond, de plus tourmenté bouillonne en nous – un sentiment qu’aucun autre être vivant ne possède… Nous sommes en quête continuelle du sens de nos existences. » (p 16). C’est là que Jérémie Rifkin en revient à mettre en évidence la vertu qu’il a déjà appréciée dans l’humanité : son potentiel d’empathie (4). « Cet atout rare et précieux croit, décroit et ne cesse de réapparaitre ». « Ces dernières années, la nouvelle génération a commencé à étendre son empathie au delà de notre espèce pour y inclure les autres vivants qui font tous partie de notre famille évolutionnaire. C’est ce que les biologistes appellent la « conscience biophile ». Voilà un signe encourageant ».
L’approche de la résilience
Dans son livre, Jérémie Rifkin nous introduit dans une histoire, celle qui analyse le pesant héritage du passé pour baliser ensuite les voies d’un avenir viable, plus précisément d’un âge de la résilience. Ce parcours s’opère en quatre parties : « Efficience contre entropie. La dialectique de la modernité ; L’appropriation de la Terre et la paupérisation des travailleurs ; Comment nous en sommes arrivés là. Repenser l’évolution sur Terre ; L’âge de la résilience : la fin de l’ère industrielle ». Aujourd’hui, le regard scientifique est en train de changer, une nouvelle manière d’approcher les réalités en terme de « socio-écosystèmes adaptatifs complexes » (p 217).
Après avoir rappelé les principes de la science classique dans la foulée de Francis Bacon, l’auteur met en lumière une nouvelle approche, l’apport d’un écologue canadien : Crawford Stanley Holling. En 1973, dans un article intitulé : « Résilience et stabilité des systèmes écologiques », il a exposé une nouvelle théorie sur l’émergence et les modes de fonctionnement de l’environnement naturel. Holling a introduit les concepts de gestion « adaptative » et de « résilience » dans la théorie des systèmes écologiques ; avec d’autres pionniers, il a posé les bases d’une méthode scientifique radicalement neuve qui, en fusionnant l’écologique et le social, allait défier les principes directeurs, tant théoriques que pratiques de l’économie admise. Il s’agit de la théorie des « socio- écosystèmes adaptatifs complexes » (p 217).
Pour Holling, « le comportement des systèmes écologiques pourrait être défini par deux propriétés distinctes : la résilience et la stabilité »… La théorie de la résilience de Holling a ensuite été importée dans la quasi-totalité des disciplines : la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, l’anthropologie, la physique, la chimie, la biologie et les sciences de l’ingénieur. Différents secteurs économiques ont commencé à s’y intéresser… Mais le plus important est que l’épicentre de la nouvelle Grande Disruption se trouve à l’intersection de l’économie et de l’écologie. Holling précise : la résilience est la propriété du système et la persistance ou la probabilité d’extinction est le résultat. Une des principales stratégies retenues par la sélection n’a donc pas pour but de maximiser l’efficience ou un avantage particulier, mais de permettre la persistance en maintenant d’abord et avant tout la flexibilité » (p 217-218). En ce sens, la diversité est un atout. « Une méthode de gestion fondée sur la résilience… insistera sur la nécessité de garder une multiplicité d’options ouvertes, d’observer les évènements dans le contexte régional et non local et de privilégier l’hétérogénéité » (p 218). Et, dans la même perspective, il nous faut reconnaître notre ignorance et accepter l’imprévisibilité. « Dans les trente ans qui ont suivi, Holling a vu sa première esquisse de théorie de la résilience et de l’adaptation modifiée, améliorée et nuancée par d’autres et ces apports n’ont cessé d’affiner et d’enrichir sa thèse. En 2004, il a coécrit un nouvelle version de la résilience et des cycles adaptatifs ». Ici, on y exprime que « le système peut être incapable de se maintenir, ce qui l’oblige de se transformer en un nouveau système auto-organisé » (p 218-219).
L’auteur met l’accent sur les transformations qui adviennent ainsi. « Quand des forces interagissent dans la nature, la société et l’univers, elles ne reviennent jamais à leur point de départ, car leurs interactions, si minimes soient–elles, changent la dynamique (p 220). Et donc, « résilience n’a jamais voulu dire des restaurations parfaites du statu quo ante… On ne doit jamais considérer la résilience comme un état, une manière d’être dans le monde, mais comme une manière d’agir sur le monde » (p 221).
Et, si on envisage la résilience en terme de démarche thérapeutique, « elle n’est jamais un retour. On ne peut jamais revenir en arrière, mais seulement aller de l’avant vers un sens nouveau de sa capacité d’action » (p 221).
La science économique actuelle est remise en cause par la mutation en cours. « La rénovation imposera une réévaluation partielle de certains de ses fondements : la théorie de l’équilibre général, les analyses coûts-avantages, la définitions étroite des externalités et les concepts trompeurs de productivité et de PIB. Et d’abord, il faudra modérer et même remettre en cause l’obsession de l’efficience. Par dessus tout, les milieux d’affaires vont devoir renoncer complètement à leur conception du monde naturel et à leur rapport avec lui» (p 222). « Pour commencer à remodeler la théorie économique, le mieux n’est-il pas de suivre la démarche de l’âge de la résilience ? Celle qui est en train de sortir les autres discipline académiques du marasme de la recherche scientifique traditionnelle essentielle à l’âge du progrès ? ». L’auteur préconise donc l’approche des éco-systèmes adaptatifs complexes qui « conçoit la recherche de façon fondamentalement différente de la méthode scientifique traditionnelle. Premièrement, parce que cette dernière procède souvent en isolant un seul et unique phénomène… Deuxièmement, parce que la conception admise de la recherche scientifique est… en fait complètement biaisée… Le préjugé implicite, c’est d’examiner le monde comme s’il était fait d’un assortiment d’objets passifs et même inertes par nature, dont la capacité d’action est faible ou nulle. Troisièmement, la nature est souvent perçue comme un ensemble de « ressources » à exploiter au profit de la société » (p 223-224). A la différence de la recherche classique, dans la recherche sur les socio-systèmes adaptatifs, on passe : « des caractéristiques des parties aux propriétés systémiques ; de systèmes fermés aux systèmes ouverts ; de la mesure à la détection et à l’évaluation de la complexité ; de l’observation à l’intervention » (p 225). « Pour avancer, il faut que la visée de la recherche scientifique passe, du moins en partie, de la prédiction à l’adaptation » (p 227).
L’auteur évoque la pensée du philosophe américain : John Dewey, fondateur du pragmatisme. Il fut « l’un des premiers penseurs à attirer l’attention sur les mérites de l’adaptativité en tant que méthode de recherche scientifique et de résolution de problèmes… Pour Dewey, celui ou celle qui veut comprendre une situation commence toujours son enquête en y participant activement, en faisant expérience directe du problème qu’elle pose et en subissant personnellement ses effets » (p 227). « L’adaptativité acquit un certaine influence au début du XXe siècle, mais elle a ensuite été submergé par la croisade pour l’efficience » (p 228). Mais aujourd’hui, cette obsession de l’efficience est remise en cause. « Sur cette terre qui se réensauvage, il n’est plus question de profiter (opportunités infinies) mais de limiter les risques, et l’efficience commence à céder sa place à l’adaptativité » (p 228). L’auteur examine ensuite les manifestations de ce courant visant à l’adaptativité. C’est un nouvel état d’esprit. « La science économique traditionnelle et les mécanismes du capitalisme, en théorie comme en pratique, ne survivront pas sous leur forme actuelle à la transformation induite par le passage à la pensée des systèmes adaptatifs complexes… La pensée des systèmes adaptatifs complexes va également nécessiter une réforme du monde universitaire… Il n’existe qu’une seule façon de comprendre ce qui se passe : adopter une approche interdisciplinaire du savoir… » (p 231-232). L’esprit humain se prête à ce changement. C’est ici que l’auteur met en évidence une découverte récente des anthropologues : « De nouvelles séries de données environnementales indiquent qu’homo a évolué sur fond de longues périodes d’imprévisibilité de son habitat… ». Et ils précisent : « Les facteurs essentiels au succès et à l’expansion du genre homo ont eu pour fondement la flexibilité de son système alimentaire dans des environnements imprévisibles, car c’est elle, avec la reproduction alimentaire et la flexibilité du développement, qui a permis l’élargissement géographique et réduit les risques de mortalité ». Ainsi, un de ces chercheurs a pu écrire : « L’origine du genre humain se caractérise par des formes d’adaptabilité » (p 253-254). On peut parler « d’ingéniosité de l’espèce humaine ». Jérémie Rifkin voit là un encouragement. Comment faire face au réchauffement climatique ? « C’est la question fondamentale de notre époque. L’adaptabilité humaine aux changements brutaux du régime climatique est notre point fort. C’est ce qui a fait de nous une des espèces les plus résilientes de la planète. Au seuil de l’âge de la résilience, voilà peut-être la nouvelle la plus encourageante du moment » (p 235).
L’âge de la résilience : la fin de l’ère industrielle
Jérémie Rifkin consacre la quatrième partie du livre aux grands axes de changement qui forment la trame du nouvel âge : l’infrastructure de la révolution résiliente ; la montée en puissance de la gouvernance biorégionale ; une place croissante de la pairocratie distribuée dans la démocratie représentative ; l’essor de la conscience biophile. Ces chapitres, à nouveau, sont riches et denses en informations et idées. Chacun de nous a conscience de ces grands mouvements. C’est pourquoi nous nous bornerons ici à un bref aperçu en renvoyant à une lecture approfondie du livre.
Une nouvelle infrastructure. Un nouveau paradigme économique
Jérémie Rifkin nous a déjà entretenu dans un livre précédent ‘Le New Deal vert mondial’, des transformations structurelles en train de se préparer (3). Il met ici l’accent sur l’importance des infrastructures. Elles sont « bien plus qu’un simple échafaudage qui sert à réunir un grand nombre d’êtres humains au sein d’une vie collective ». Elles associent en effet trois facteurs majeurs : « de nouvelles formes de communication, de nouvelles sources d’énergie et de nouveaux moyens de transport et de logistique ». « Quand ces trois avancées techniques apparaissent et fusionnent en une seule et même dynamique, elles changent radicalement la façon dont on communique » (p 239). Et l’auteur ajoute qu’elles ont elles-mêmes une influence sur l’ensemble de la vie collective. « On assimile très justement ces structures à de vastes « organismes sociaux ». Ce sont des systèmes auto-organisés qui agissent comme une totalité unique ». « Les grandes révolutions infrastructurelles changent la nature de l’activité économique, la vie sociale, et les formes de gouvernement… » (p 240). Ainsi après les infrastructure du XIXe siècle (charbon, machine à vapeur, réseau ferré, télégraphe), puis du XXe siècle (réseau électrique centralisé, téléphone, radio et télévision, voitures, avions, réseaux routiers, aérodromes), « aujourd’hui, nous sommes au cœur d’une troisième révolution industrielle. L’Internet numérisé de communication haut débit converge avec un Internet numérisé continental de l’électricité, alimenté par les énergies solaire et éolienne ». Une énergie verte est revendue à l’internet continental. « Actuellement, ces deux internets numérisés convergent avec un troisième : l’Internet numérisé de la mobilité et de la logistique ». C’est la part des véhicules électriques. « Ces trois Internets vont progressivement partager un flux continu de données et d’analyses de ces données… A l’ère qui vient, on va rénover les immeubles à des fins d’énergie et de résilience climatique… ». Ce seront des « immeubles intelligents » (p 241-242).
« Les infrastructures des deux premières révolutions industrielles ont été conçues pour opérer en pyramide, de haut en bas, et pour fonctionner au mieux lorsqu’elles étaient enveloppées par plusieurs couches de droits de propriété matérielle et intellectuelle ». Les infrastructures des deux premières révolutions industrielles ont été propulsées, pour l’essentiel, par des énergies fossiles. Elles ont donné lieu à des engagements militaires. Au contraire, l’infrastructure de la nouvelle révolution industrielle est conçue pour être distribuée et non centralisée. Elle fonctionne mieux quand elle reste ouverte et transparente… ». « Elle est conçue pour s’étendre latéralement et non verticalement ». (p 244). L’auteur reconnait la présence actuelle d’oligopoles mondiaux dans ce champ. Cependant il estime que l’évolution à venir ne va pas dans le sens de la centralisation (p 245).
Des transformations majeures adviennent. « Bien qu’elle soit encore dans sa petite enfance, l’économie du partage distribuée et interconnectée par le numérique constitue un nouveau système économique. C’est le premier à entrer en scène depuis le capitalisme au XVIIIe siècle et le socialisme au XIXe siècle – encore un signe qui montre à quel point le nouvel ordre économique émergent se distingue de ce que nous avons connu sous le capitalisme industriel » (p 250). Le PIB, par exemple, perd de plus en plus son rôle d’indicateur de la performance économique. Le monde entier est concerné. « En 2020, des milliards d’êtres humains avaient un smartphone, et chacun de ses appareils possédait une puissance de calcul supérieure à celle qui avait envoyé des astronomes sur la Lune… L’humanité se connecte à un multitude de plateformes pour jouer, travailler, entretenir des relations » (p 251).
Dans ce chapitre, Jérémie Rifkin nous ouvre sans cesse de nouveaux horizons. Nous entrons dans un nouvel univers économique et social. « Quand nous dressons la liste de tous les changements induits par le passage à une infrastructure numérique intelligente de troisième révolution industrielle, l’énormité de ce qui se profile suggère une transformation radicale de notre idée de la vie économique. Elle va passer de la propriété à l’accès, des marchés « acheteurs-vendeurs » aux réseaux « fournisseurs-utilisateurs » ; des bureaucraties analogiques aux plateformes numériques… ; du capital financier au capital naturel ; de la productivité à la régénérativité ; de processus linéaires aux processus cybernétiques ; des externalités négatives à la circularité ; des économies d’échelle de l’intégration verticale à celles de l’intégration latérale ; des chaines de valeur centralisées aux chaines de valeurs distribuées ; du produit intérieur brut aux indicateurs de qualité de vie ; de la globalisation à la glocalisation ; des conglomérats de sociétés transnationales aux agiles PME opérant sur de simples réseaux blockchains glocaux et de la géopolitique à la politique de la biosphère ». Ces réalités nouvelles s’expriment souvent dans des termes techniques, un nouveau langage et une nouvelle réalité à découvrir dans ce chapitre.
Dans une conjoncture qui nous paraît si menaçante, Jérémy Rifkin introduit un nouveau regard : « Nous assistons à un saut extraordinaire dans un nouveau paradigme économique. Au début de la décennie 2040, il ne sera probablement plus perçu comme une troisième révolution industrielle fonctionnant sur un modèle économique strictement capitaliste. Notre société mondiale commence à sortir des deux cent cinquante années de révolution industrielle et à se tourner vers une ère nouvelle. Le mieux est de la nommer : « révolution résiliente » » (p 255).
Nouvelles formes de gouvernance
Les transformations nécessitées par la politique écologique requiert également de nouvelles formes de gouvernance. L’auteur envisage ainsi la montée en puissance d’une gouvernance biorégionale. Les accidents climatiques appellent des « mobilisations en terme de ‘gouvernance des communs’ où l’investissement personnel est bien plus fort » (p 267). Certes des fractures apparaissent actuellement dans les sociétés. Mais l’auteur développe une approche prospective.
Les régions rurales longtemps dévalorisées vont ré-émerger. Elles ont souvent des atouts en termes de potentiel solaire et éolien. Mais surtout, elles sont à même d’accueillir la nouvelle économie de partage distribuée et interconnectée par le numérique. « Les start up technologiques intelligentes peuvent opérer dans les bourgs et petites villes des zones rurales où les prix de l’immobilier et les frais généraux sont moins élevés, tout en restant compétitives sur les marchés « glocaux » (p 270). On observe par ailleurs une migration dans laquelle certains quittent les grandes villes pour s’installer dans les campagnes dans un mode de vie plus naturel ».
Récemment, « la communauté scientifique a posé le cadre d’une gouvernance biorégionale en appelant à « réensauvager » ou « reruraliser » la moitié de la terre » (p 276) en vue notamment de lutter contre la disparition des espèces et des écosytèmes. L’accent est mis sur l’importance des forêts naturelles dans le maintien de la biodiversité et la rétention et le stockage du carbone. L’auteur identifie des « bio régions » qu’on peut envisager « en termes sociaux, psychologiques et biologiques », avec l’idée de « vivre en un lieu » et en entendant par là : « une société vivant en équilibre avec la région qui la soutient à travers les liens entre les vies humaines, les autres êtres vivants et les processus de la planète – les saisons, le climat, les cycles de l’eau » (p 280). L’auteur en donne des exemples aux Etats-Unis et il met en lumière l’avènement d’une « gouvernance biorégionale » (p 176).
Participation et association
Nous observons aujourd’hui un « délitement de la cohésion sociale » (p 295). Le mécontentement monte et la méfiance s’accroît . Une enquête menée en 2020 dans 28 pays constate que 66% de citoyens n’ont pas confiance dans leur gouvernement actuel (p 295). Des remous, de grands changements mal interprétés suscitent l’inquiétude. La violence monte. Ces menaces appellent un renouvellement de la gouvernance à travers une participation accrue des citoyens. Ainsi un chapitre est intitulé : « La démocratie représentative fait une place à la pairocratie (le rôle des pairs) dans la démocratie représentative » (p 289). « Une jeune génération commence à tempérer la démocratie représentative avec ses succès, ses espoirs déçus et ses insuffisances en y mêlant une forme d’action politique horizontale, latérale, plus large, plus inclusive, qui insère les communautés locales au sein des écosystèmes… ». « Cette nouvelle identité politique émergente s’accompagne d’un engagement militant direct dans la gouvernance… Chaque citoyen devient partie intégrante du processus de gouvernement… Des assemblées citoyennes apparaissent. Leurs membres se réunissent entre égaux, entre pairs, travaillant parallèlement aux autorités en donnant des avis, conseils et recommandations… Ces assemblées de pairs horizontalisent la prise de décision en assurant l’engagement actif des citoyens dans la gouvernance. La démocratie représentative fait une place à une « pairocratie » distribuée comme la gouvernance locale fait une place à une gouvernance biorégionale en ces temps où les citoyens se regroupent pour réagir aux défis comme aux opportunités de sauvegarde de leur biorégion » (p 289-290). De nombreuses expériences apparaissent : budget participatif, contrôle local sur les écoles ou sur la police ».
Jérémie Rifkin inscrit son étude dans une réflexion historique sur la conception et la pratique de la liberté dans la période moderne en Occident et la vision de nouvelles générations pour lesquelles « la liberté est affaire d’accès et d’inclusivité et non d’autonomie et d’exclusivité. Ils mesurent leur liberté au degré auquel ils peuvent accéder et participer aux plateformes qui prolifèrent sur toute la planète. L’inclusivité qu’ils ont à l’esprit est latérale et très étendue : elle englobe souvent le genre, l’ethnie, l’orientation sexuelle et même le lien avec les autres êtres vivants sur une planète en vie » (p 292). L’auteur note « l’arrivée à maturité des organisations de la société civile… Ces organisations sont des mouvements sociaux, des entreprise économiques et aussi de nouvelles formes de proto-gouvernance qui font entrer les citoyens sur la scène politique » (p 300-301).
Conscience biophile
Selon Jérémy Rifkin, la grande dynamique à l’œuvre pour promouvoir l’âge de la résilience s’inscrit dans le développement d’une « conscience biophile ». Ce chapitre mériterait une analyse spécifique qui ne peut être engagée dans le cadre de cette présentation.
L’auteur commence par exposer les recherches de John Bowlby sur l’attachement. Privés de tendresse, de jeunes enfants dépérissent. Depuis l’intuition initiale de Bowlby sur le rôle que joue le comportement d’attachement, des chercheurs ont examiné de plus près notre constitution biologique en cherchant à comprendre les mécanismes de la pulsion empathique profondément intégrés à nos circuits neuronaux. Ils ont ainsi découvert qu’au cœur même de notre être – et c’est ce qui rend notre espèce si spéciale – un élan biologique inné nous pousse à avoir de l’empathie pour « l’autre » (p 322). Comme il l’a déjà étudié dans un livre précédent sur l’empathie (4), l’auteur revient ici sur ce thème. Dans une rétrospective historique, il inscrit l’empathie dans une dimension sociale. « L’élan empathique n’est pas seulement lié aux pratiques éducatives vécues par l’enfant,… l’empathie change aussi au cours de l’histoire, elle est étroitement mêlée à l’évolution de la société ». « L’infrastructure de chaque civilisation apporte un paradigme économique qui lui est propre, un nouvel ordre social. Elle s’accompagne aussi d’une vision du monde, d’un grand récit auquel la population peut prêter allégeance. Elle permet, à chaque fois, d’élargir la solidarité empathique, qui peut englober et unir émotionnellement les diverses populations… » (p 326). L’auteur évoque ainsi des civilisations successives. Il y voit des « expansions de l’empathie » sans méconnaitre « les reculs et les retours au passé, ce grand fléau de l’histoire de l’humanité » (p 331).
Il perçoit aujourd’hui l’apparition dans la jeune génération d’« une nouvelle famille biologique plus inclusive. La conscience biophile émerge à peine. Elle sera probablement le grand récit qui va définir l’Age de la résilience en un temps où débute l’entrée de l’humanité en empathie avec les autres vivants » (p 332). Aujourd’hui, l’humanité a besoin de se « réaffilier à la nature » (p 332). Les urbains ont besoin de se reconnecter avec le vivant de telle manière que Anne-Sophie Novel nous en indique le chemin (5). Et l’auteur décrit les initiatives pour permettre aux enfants de se familiariser avec le monde naturel, comme, par exemple, les classes de nature. Au total, nous sommes appelés à un changement de perspective ; « L’universalisation de la biophilie fait passer le récit humain d’une obsession de l’autonomie à un attachement au relationnel. La formule classique de René Descartes, « Je pense, donc je suis », est déjà du passé, car la jeune génération qui grandit dans des mondes virtuels… structurés par des couches d’interconnexion horizontale lui préfère une autre maxime : « Je participe, donc j’existe » (p 352). « L’interprétation interactive de la nature, comme de celle de la nature humaine, impose de repenser radicalement le discours philosophique et politique qui a fondé l’âge du progrès » (p 353). « Deux siècles avant que le concept de conscience biophile soit introduit par E O Wilson, le grand philosophe et savant allemand Johan Wolfgang von Goethe propose de faire de la conscience biophile un contre-récit opposable à l’univers mort, rationnel, mécanique que décrit la vision stérile de Newton. Goethe est persuadé que la personnalité de chacun, de chacune – et sa résilience – est un matériau composite, fait des relations qui la tissent ou le tissent à l’intérieur même de l’étoffe de la vie ». Il envisage la nature comme « toujours changeante, en flux continuel. » (p 355). « Goethe ressent et vit l’expérience empathique avant que ce sentiment reçoive un nom. « Me mettre dans la situation des autres, comprendre toute espèce d’individualité humaine et m’y intéresser, écrit-il, c’est affirmer l’unité de la vie. Être « dans l’ensemble » : pour Goethe, cet élan ne s’arrêtait pas aux limites de notre espèce, mais s’étendait à la totalité de la nature » (p 356).
Face aux menaces qui nous inquiètent et nous embrouillent, dans une réalité complexe qui rend difficile notre discernement, nous recherchons éclairages et chemins. La vision de Jérémie Rifkin nous apporte un éclairage auquel nous ajouterons pour notre part une dimension spirituelle telle que nous la découvrons dans le livre de Michel Maxime Egger : « Ecospiritualité » (6). Jérémie Rifkin nous propose aussi un chemin. La prise de conscience des méfaits de l’héritage de l’âge du progrès débouche sur la mise en œuvre de nouveaux atouts en terme de nouveaux savoirs, de nouvelles pratiques et de nouvelles valeurs. Dans ce livre comme dans ses précédents, Jérémy Rifkin nous ouvre une nouvelle manière de voir.
J H
- Jérémy Rifkin. L’âge de la résilience. La terre se réensauvage. Il faut nous réinventer. Les liens qui libèrent, 2022
- La Troisième révolution industrielle : https://vivreetesperer.com/face-a-la-crise-un-avenir-pour-l%e2%80%99economie/
- Le New Deal Vert : https://vivreetesperer.com/le-new-deal-vert/
- Vers une civilisation de l’empathie : https://www.temoins.com/vers-une-civilisation-de-lempathie-a-propos-du-livre-de-jeremie-rifkinapports-questionnements-et-enjeux/
- Comment nous reconnecter au vivant, à la nature ? : https://vivreetesperer.com/comment-nous-reconnecter-au-vivant-a-la-nature/
- Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/
Unis dans la continuité du temps
Selon Barbara Holmes
Du 30 octobre au 5 novembre 2022, sur le site du Center for action and contemplation, Richard Rohr a publié une séquence de méditations intitulée : « Garder la foi dans nos ancêtres » (« Keeping faith in our ancestors ») (1). Dans l’esprit du thème annuel : « Nothing stands alone » : « Rien n’est isolé ; tout se tient », cette séquence envisage la « communion des saints » : « A travers l’histoire, les humains ont souvent manifesté fortement leur appréciation d’une connexion avec leurs ancêtres », écrit Richard Rohr en poursuivant : « Je pense que cette notion collective de l’unité est ce que les chrétiens ont essayé de verbaliser lorsqu’ils ont ajouté tardivement à l’ancienne déclaration de foi des apôtres : « Je crois à la communion des saints ». Ils nous offrait l’idée que les morts en unité avec les vivants, qu’ils soient nos ancêtres directs, les saints en gloire ou même, ainsi appelées, les âmes du purgatoire » (« Partie d’un corps », mardi 1er novembre 2025). Sur ce blog, nous avons évoqué à de nombreuses reprises, la communion des vivants et des morts en évoquant notamment la théologie de Jürgen Moltmann (2). Nous abordons ce thème ici en rapportant la contribution de Barbara Holmes dans cette séquence : « The continuum of life » (La continuité de la vie » (3).
Barbara Holmes intervient à deux reprises dans cette séquence, l’une d’elle rapportant une expérience spirituelle vécue personnellement sur le registre du thème évoqué. Elle s’inscrit par ailleurs dans le réseau communautaire du « Center for action and contemplation ». C’est une personnalité qui a acquis une compétence dans de nombreux domaines : art, sociologie, sciences de l’éducation et, bien sur, théologie. A partir de son expérience spirituelle, elle a écrit plusieurs livres, et notamment : « « Une joie inexprimable. Pratiques contemplatives dans une Eglise noire », « Cosmos et libération ». Elle déclare : « Ma vie est engagée dans la lutte pour la justice, la guérison de l’esprit humain et l’art dans un mouvement de créativité radicale en recherche de pertinence ». Elle est décrite comme « une enseignante en spiritualité, une activiste et une chercheuse centrée sur la spiritualité afro-américaine, la mystique, la cosmologie et la culture » (4). C’est une théologienne et une écrivaine.
Barbara Holmes s’exprime ainsi : « Un monde sans ancêtres est solitaire. Je suis pleine de gratitude envers les anciens de ma famille qui m’ont introduit dans le continuum de la vie. Il est important de savoir comment nous comprenons notre séjour dans cette réalité. Si nous considérons nos vies comme des segments séparés par un trait qui englobe les dates de la naissance et de la mort, nous serons inconsolables quand un traumatisme tronquera nos réalités et retardera nos destinations. Mais si nous nous considérons nous-même comme une partie du continuum de la vie qui ne se termine pas à la mort, mais transite jusqu’à la vie après la vie, nos perspectives peuvent changer ».
Barbara Holmes porte ensuite son regard sur les relations entre le monde présent et l’au delà. « La communauté des ancêtres qui habite déjà la vie au delà de la vie se tient en contact constant avec nous. Ils envoient des messages et interviennent lorsque nécessaire. Ils prient avec nous et murmurent des avertissements. Que nous les appelions ancêtres ou anciens, seules ces femmes et ces hommes qui ont mené de bonnes vies dans leur vie physique, sont considérés comme étant des guides avisés dans le royaume spirituel. Dans certaines cultures africaines, ils sont appelés les ainés, les anciens. Chaque ancien représente l’entière autorité mystique et légale de la lignée. Pour moi, les ancêtres, les ainés vivants et morts, m’ont imposé le respect et ont toujours été présents, me soutenant et me guidant ».
Richard Rohr apporte ensuite un témoignage personnel. Après le décès de sa mère, il a fait l’expérience de la connexion ou d’un « pont » à la vie après la mort. « Je crois qu’un des évènements essentiels est l’expérience de la passion et de la mort, en relation avec quelqu’un que nous aimons, avec quelqu’un auquel nous sommes lié.
Quand ma mère est décédée, je n’ait pas douté qu’elle construisait un pont – je ne vois pas quel autre mot utiliser – qu’elle bâtissait un pont et prenait quelque chose de moi avec elle et qu’elle me renvoyait quelque chose d’elle. Je comprends maintenant à un niveau plus profond ce que Jésus voulait dire : « A moins que je m’en aille, l’Esprit ne viendra pas ». (Jean 16.7). Je pense que le cours normal de l’histoire est pour chaque génération de passer et de bâtir des ponts d’amour et de confiance pour la génération suivante… Tout ce que Jésus est venu nous enseigner et avait seulement besoin de nous enseigner, c’était comment avancer à travers le grand mystère, ne pas être confondu et d’avoir confiance que Dieu est de l’autre côté ».
Les formes de notre conscience des rapports entre les vivants et les morts sont certes en relation avec la culture dans laquelle nous vivons. Les accents peuvent varier, mais, avec Jürgen Moltmann, nous croyons en la communion entre les vivants et les morts.
« L’être humain est un être en relation ». Cette réalité se manifeste également dans la continuité des générations. « Les êtres humains participent à une continuité des générations même s’ils n’en ont pas toujours conscience ». Dans les sociétés modernes occidentales, l’individualisme fait obstacle à cette conscience collective. Cela réduit la conscience de la communion entre les vivants et les morts. A cet égard, les sociétés traditionnelles, en particulier celles d’Extrême Orient, ont quelque chose à nous rappeler, car elles vivent actuellement cette communion entre les vivants et les morts. Dans le monde occidental, nous avons besoin d’une culture nouvelle du souvenir, « de manière à ne pas vivre seulement comme individus pour nous-mêmes, mais en vue de regarder au delà de nous-mêmes ». C’est seulement si nous percevons notre durée de vie dans le cadre plus vaste de la succession des générations que nous pouvons entrer « dans la mémoire du passé et dans l’avenir en espérance de ce qui est à venir ». Pour réaliser cette communion entre les vivants et les morts, une transcendance de la vie et de la mort est requise… La foi chrétienne envisage la communion des vivants et des morts dans le Christ qui est mort dans une mort humaine et a été ressuscité dans une vie divine. En conséquence, la communauté chrétienne est une communauté non seulement des vivants, mais des morts. « Le Christ est ressuscité pour qu’il puisse être le Seigneur à la fois des morts et des vivants » ( Romains 14.9) (5).
J H
- Keeping faith in our ancestors : https://cac.org/themes/keeping-faith-with-our-ancestors/
- Sur la Terre comme au Ciel : https://vivreetesperer.com/sur-la-terre-comme-au-ciel/ Le Dieu vivant et la plénitude de vie : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/ Une révolution spirituelle. Une approche nouvelle de l’Au-delà : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/
- The continuum of life : https://cac.org/daily-meditations/the-continuum-of-life-2022-10-30/
- Barbara Holmes : https://www.drbarbaraholmes.com/bio
- Le Dieu vivant et la plénitude de vie : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/
Comment une démocratie multiethnique peut-elle se développer en surmontant les obstacles?
Selon Yascha Mounk
Nous vivons dans un régime démocratique, certes imparfait, mais qui nous assure des bénéfices inestimables, une participation à l’autorité politique, à la puissance publique à travers des élections libres, une garantie des droits fondamentaux tels qu’ils ont été proclamés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à travers un état de droit. Bref, si il y a des frustrations, il y aussi un espace où nous pouvons nous mouvoir pour susciter des changements et des améliorations. Nous vivons dans une république qui dépend de l’expression de chacun et est, en principe, l’affaire de tous. Mais avons-nous conscience de ce privilège ?
Cependant, la propagation d’une agitation à consonance autoritaire, se parant d’une référence au peuple, les divers populismes qui se sont répandus dans les dernières années sous des formes variées viennent nous interpeller et sonner l’alarme. En regard, il importe de comprendre le phénomène avec l’aide des sciences sociales. Ainsi, en 2018, un chercheur en sciences politiques Yascha Mounk a écrit un livre : « Le peuple contre la démocratie » (1).
Pourquoi des mouvements populistes en viennent-ils à mettre en cause le bon fonctionnement des institutions démocratiques ? On peut en distinguer quelques raisons comme la stagnation du niveau de vie depuis les années 1980, l’arrivée des migrants qui compromettent l’entre-soi national, ou bien l’emballement de la communication à travers les réseaux. Cependant, un des plus grands dangers est la montée d’un sentiment nationaliste et xénophobe dans une part de population qui se sent abandonnée, privée de son privilège national et sans espoir de promotion. Dans beaucoup de pays, en regard de la diversification de la population, on peut effectivement observer des phénomènes de rejet et une montée des tensions et des conflits. Le pouvoir politique devient alors un enjeu. Des forces contraires veulent se l’approprier pour neutraliser l’adversaire. Le débat politique, et tout ce qu’il implique et requiert : respect et compréhension, est alors compromis.
Or, effectivement, dans de nombreux pays occidentaux, de l’Angleterre à la Suède, de la France à l’Allemagne, une forte immigration est intervenue et la composition de la population a fortement changé. Aux Etats-Unis, si la diversité est constitutive, la diversification se poursuit autrement, avec une correction relative, mais positive des rapports de domination traditionnels. Comment les transformations démographiques en cours vont-elles modifier la vie politique ? L’enjeu est la réalisation d’une démocratie multiethnique. Chercheur en sciences politiques, d’origine allemande et aujourd’hui installé aux États-Unis, Yascha Mounk a intitulé son dernier livre : « la grande expérience » (2). Les démocraties occidentales vont-elles parvenir à un nouveau stade, celui d’une démocratie multiethnique ? Et comment ?
Yascha Mounk est bien qualifié pour aborder cette question. Car lui-même a grandi dans une famille polonaise, juive de confession, immigrée en Allemagne. Par expérience, il est sensible aux relations interculturelles. Yascha Mounk a fait ses études universitaires en Angleterre à Cambridge, puis il est devenu chercheur aux Etats-Unis. Il est maintenant professeur de politique internationale à l’Université John Hopkins. Il écrit dans de nombreuses revues et s’exprime dans de nombreuse conférences.
La transformation des sociétés et la question démocratique
Yascha Mounk part d’abord d’un constat. C’est la diversification considérable de la population des démocraties au cours des dernières décennies. « A la fin de la seconde guerre mondiale au Royaume-Uni, moins d’une personne sur vingt-cinq était née à l’étranger. Aujourd’hui, c’est une personne sur sept. Il y a quelques décennies de cela, la Suède était l’un des pays les plus homogènes du monde. Aujourd’hui, un habitant sur cinq a des origines étrangères » (p 16). La France et l’Allemagne vont dans le même sens. La différence des européens, le Canada et les Etats-Unis se sont pensés comme des nations d’immigrés dès leur conception. « Et pourtant, à leur manière, les deux grandes démocraties du Nouveau Monde ont été profondément excluantes durant la majeure partie de leur existence » (p 17). Aux Etats-Unis, la jeune république a composé avec l’esclavage et refusé aux noirs les droits les plus élémentaires. L’abolition de l’esclavage en 1865 a marqué un grand tournant, mais les discriminations affectant les afro-américains sont revenus ensuite. Elles s’effritent aujourd’hui.
Dans ces différents pays où s’opère la transformation démographique, des tensions sont apparues et affectent la vie démocratique.
Yascha Mounk s’interroge à partir de l’histoire. La démocratie multiethnique ne va pas de soi. Ainsi, dans le passé, « les citoyens des démocraties les plus respectées du monde ont porté leur pureté ethnique en étendard. D’Athènes à Rome, de Venise à Genève, les tentatives pré-modernes d’auto-gouvernance ont toutes été restreintes au groupe ethnique concerné » (p 14). A contrario, on a pu observer la réussite de sociétés multiethniques au sein d’empires où le pouvoir échappait à toute compétition entre des groupes. Ainsi, l’élargissement des démocraties rencontre des obstacles. Pour que la grande transformation s’effectue, « le récit qu’elles se font d’elles-mêmes, leur roman national, repose encore trop sur la fiction de leur homogénéité » (p 19). L’histoire d’une domination brutale exerce toujours son ombre dans telle société marquée par l’esclavage. Dans de nombreuses sociétés apparait un risque de fragmentation culturelle. « Certains groupes d’immigrés forment aujourd’hui une classe socio-économique défavorisée » (p 20). En regard des faits, Yascha Mounk observe une « ascension des pessimistes », mais son analyse porte réponse au « besoin d’optimisme » (p 22-34).
Avancer vers une démocratie multiethnique, c’est possible
Le terme de « démocratie multiethnique » peut donner lieu à des malentendus. En fait, l’ampleur est plus vaste. D’autres qualificatifs l’accompagnent : démocratie multiculturelle et multiconfessionnelle. (p 11). L’évolution vers cette nouvelle forme de démocratie est une traversée semée d’embuches, mais cette « grande expérience » n’est pas vouée à l’échec. Elle est possible et d’autant plus possible qu’on en perçoit les différents aspects et qu’on croit à sa réussite. « Si nous voulons que la ‘grande expérience’ réussisse, il nous faudra développer une vision optimiste » (p 27). Le livre aborde les différents aspects de la question en trois parties : Quand les sociétés multiethniques tournent mal ; de l’avenir souhaitable des démocraties multiethniques ; comment les démocraties multiethniques pourraient-elles s’épanouir ?
De fait, des recherches sur l’intégration en Europe montrent qu’à moyen terme, l’intégration en pays d’accueil se réalise. « L’intégration linguistique aussi bien que culturelle paraît plus lente en Europe qu’en Amérique du Nord, mais les tendances sont les mêmes. Il existe bien quelques exemples d’immigrés de deuxième ou même de troisième génération parlant mal la langue locale, mais, en général, les enfants nés en Italie, en France, en Suède ou en Grèce la parlent avec beaucoup plus de facilité que la langue de leurs ancêtres » (p 254).
Mais qu’en est-il du gouffre économique qui sépare encore la majorité historiquement dominante et les groupes minoritaires ? En fait, là aussi, il faut du temps selon les générations. « Ceux qui sont curieux de l’état actuel de nos démocraties multiethniques feraient bien de regarder les statistiques sur le parcours d’immigrés de très longue date afin de déterminer si leurs conditions de vie s’améliorent » (p 260). Et, dans l’ensemble, les conclusions sont positives. « Ainsi, aux Etats-Unis, les immigrés s’en sont très bien sortis, augmentant rapidement leurs revenus d’une génération à la suivante. Par ailleurs, la vitesse de cette progression dépend à peine de leur pays d’origine. Les enfants d’immigrés de presque tous les pays d’origine améliorent plus rapidement leurs conditions économiques que les enfants de parents nés aux États-Unis» (p 261).
Par ailleurs, à partir de différentes recherches, l’auteur tempère nos inquiétudes concernant une insécurité potentielle. « La plupart des immigrés partagent les valeurs de leur société d’accueil » (p 270). Si la menace terroriste est redoutable, elle n’a qu’une petite minorité pour origine.
« La démographie n’est pas un destin ». L’auteur prend en exemple les Etats-Unis. Une partie de la population blanche redoute de devenir une minorité brimée à l’avenir. Mais il y a de grandes différences dans l’évolution des groupes en croissance : les latinos, les asiatiques américains et les métis. L’auteur montre par exemple le caractère spécifique de la réussite intellectuelle des asiatiques américains. « Les asiatique américains ne représentent qu’un dixième de la population des Etats-Unis, mais un quart des élèves qui rentrent à l’Université Harvard. A l’Université Berkeley, presque la moitié des étudiants américains entrés en 2020 étaient des asiatiques américains ». La réussite économique va de pair (p 288). L’auteur montre également un développement rapide du groupe des métis. Il y a quelques décennies, le métissage rencontrait beaucoup d’hostilité. En 1980, seuls 3% des nouveau-nés étaient métis. A la fin des années 2010, un enfant sur sept était métis (p 284). Ainsi, les trajectoires de ces groupes sont différentes. Elles permettent une évolution des attitudes politiques. Elles vont à l’encontre d’une fatale confrontation entre « blancs » et « gens de couleur ».
Yascha Mounk estime que l’exemple américain est instructif et que les tendances qui y sont observées peuvent l’être également dans d’autres pays. « Des groupes qui nous semblent aujourd’hui soudés se fractureront sans prévenir. La démographie n’est pas un destin. Les habitants des démocraties multiethniques, dans leur grande diversité, sont embarqués sur le même bateau. Ceux d’entre nous qui pensons que la grande expérience peut réussir, devons remplir une tâche clé dans les décennies à venir : nous battre pour un avenir dans lequel le plus de personnes possibles se penseront non comme les membres de tribus mutuellement hostiles, mais comme citoyennes de démocraties multiethniques fières et optimistes » (p 304). Yascha Mounk , conscient des dangers du nationalisme, préconise en regard un patriotisme civique, inclusif et capable de rassembler les divers composantes de la population.
Dans quelle mesure les politiques publiques peuvent-elles aider à hâter cet avenir ?
Quelles politiques mettre en œuvre ?
Dans ce livre, Yascha Mounk ne se contente pas de proposer des analyses et des diagnostics ; en fin de parcours, il esquisse des orientations. « Quelles politiques publiques (aussi modestes soient-elles) pourraient contribuer à la réussite des démocraties multiethniques ? ».
Il importe d’abord d’identifier les obstacles majeurs.
« D’abord, de nombreuses personnes n’ont connu quasiment aucun progrès dans leurs conditions de vie ces dernières années. Elles s’inquiètent même d’une future dégradation. Comme l’a montré une étude sociologique, cela les rend beaucoup plus enclines à regarder avec peur ou dédain les membres des autres groupes démographiques.
Deuxièmement, certains groupes ethniques ou religieux subissent encore des conditions socio-économiques dégradées…
Troisièmement, les institutions des démocraties multiethniques peinent aujourd’hui à prendre des décisions efficaces. Elles sont insuffisamment réactives aux yeux de l’opinion ou elles excluent des minorités des processus de décision. En conséquence, les citoyens n’ont plus le sentiment d’être maitres de leur destin collectif, ce qui augmente le risque de tensions intergroupes.
Enfin, la polarisation croissant empêche les citoyens des démocraties multiethniques de considérer leurs opposants politiques avec bienveillance… » (p 307-308).
Dès lors, Yascha Mounk propose quelques orientations politiques majeures.
« Les démocraties doivent offrir à leurs citoyens une ‘prospérité garantie’ : encourager la croissance économique et s’assurer que ses gains finiront dans la poche des citoyens ordinaires. Elles doivent accentuer encore la ‘solidarité universelle’ : construire un État-providence généreux qui évitera la course à échalote entre groupes ethniques » (les avantages accordés à certains groupes peuvent susciter la jalousie et finalement s’avérer contre-productifs). Elles doivent bâtir des institutions efficaces et inclusives : donner à chaque citoyen le sentiment que ses préférences seront prises en compte. Enfin, elles doivent fonder une culture de respect mutuel… » (p 308).
Traduit de l’anglais, très fondé sociologiquement, comme en témoigne une annexe volumineuse de notes bibliographiques, ce livre se lit agréablement en couvrant une question majeure puisqu’il s’agit de l’avenir des démocraties multiethniques à l’échelle internationale. Et, en France, nous sommes directement concernés. Nous découvrons dans ce livre la pensée éclairante d’un chercheur engagé dans l’étude de problèmes politiques majeurs.
J H
- Yascha Mounk. Le peuple contre la démocratie. L’Observatoire, 2018
- Yascha Mounk. La grande expérience. La démocratie à l’épreuve de la diversité. L’Observatoire, 2022
Interview de l’auteur https://www.youtube.com/watch?v=3aLoeIWTTUk
Ecospiritualité
Une nouvelle approche spirituelle
Porteuse de grandes menaces, ponctuée par des épisodes alarmants, la crise écologique vient remettre en cause nos représentations et nos comportements, la manière dont nous envisageons le monde et notre mode de vie quotidien. L’ampleur du défi requiert un changement à grande échelle, une véritable révolution culturelle, économique, sociale. Nous voici engagé dans un changement de civilisation. Un tel bouleversement induit des craintes, des peurs. Il suscite des réactions de déni, des résistances, des fuites, des replis, des abandons. Alors, des questions essentielles apparaissent et viennent au devant de la scène. Quel est le sens de notre existence ? Comment nous situons- nous dans le monde qui nous entoure ? En quoi et comment entrons-nous dans un réseau de relations ? Qu’est-ce qui peut nous inspirer et nous encourager ? Ces questions essentielles appellent des réponses spirituelles. Aussi dans le changement en train d’advenir, ce passage vers une civilisation nouvelle, cette grande, transition, une nouvelle approche spirituelle est en train d’émerger. Parce qu’elle répond aux questions nouvelles engendrées par la prise de conscience écologique, on peut l’appeler une « écospiritualité ». « Ecospiritualité », c’est le titre d’un livre écrit par Michel Maxime Egger et publié en 2018 par les éditions Jouvence (1). L’auteur est bien connu et apprécié sur ce blog où nous avons fait déjà part de ses interventions et de ses publications (2). « Michel Maxime Egger est un sociologue, écothéologien et acteur engagé de la société civile. Il anime le réseau www.trilogies.org pour mettre en dialogue cheminements spirituels et engagements écocitoyens. Il est l’auteur d’essais sur l’écospiritualité et l’écopsychologie : « Ecopsychologie » (2017), « La Terre comme soi-même » (2012), « Soigner l’esprit, guérir la Terre » (2015)… » (p 125).
Quelles sont les intentions de l’auteur dans ce livre sur l’écospiritualité ? « Selon Michel Maxime Egger, une double dynamique est en cours où convergent quête spirituelle et aspiration à des relations plus harmonieuses avec la Terre. Ainsi, il nous invite à redécouvrir la sacralité de la nature, à transformer votre cosmos intérieur et à développer des vertus écologiques comme la sobriété, la gratitude ou encore l’espérance. Avec à la clé une nouvelle manière de s’engager : le méditant-militant » (page de couverture).
Le livre est ainsi présenté : « S’ouvrir à la conscience d’une dimension du mystère qui échappe à notre compréhension, qui habite la nature et qui nous unit à la Terre. Telle est la perspective défendue dans cet ouvrage pour construire un monde véritablement écologique, juste et résilient ». « L’écospiritualité affirme que l’écologie et la spiritualité forment un tout parce que sans une nouvelle conscience et un sens du sacré, il ne sera pas possible de faire la paix avec la Terre » (page de couverture).
Ce livre est original par son sujet. Il l’est également par son approche. Michel Maxime Egger, dans un esprit d’ouverture, couvre un champ très vaste dans une approche progressive, de la prise de conscience à l’engagement, comme l’indiquent les têtes de chapitre du livre :
1 Relier écologie, sciences et religions
2 Réenchanter la nature
3 Redécouvrir la sacralité de la terre
4 Etre un pont entre Terre et Ciel
5 Transformer son cosmos intérieur
6 Devenir un méditant militant
Ce livre, riche en contenu, est également très dense puisqu’il se développe en un petit nombre de pages (125p). Le pari est tenu parce que le talent pédagogique de l’auteur s’allie à l’intention de la collection : concept Jouvence. « Cette collection a pour ambition d’expliquer « des concepts » afin de donner des repères et d’aider à l’action dans le quotidien. Comprendre les concepts nous aide à retrouver du sens, à se poser la question du « pourquoi ? », tellement nous sommes submergés par le « comment ». La présentation du livre est commandée par une exigence d’accessibilité. Ainsi les termes importants sont expliqués dans des encadrés. L’intention pédagogique de la collection s’allie à la qualité d’exposition de l’auteur.
Relier écologie, sciences et religion
La prise de conscience écologique appelle une nouvelle conscience spirituelle, mais aussi un renouvellement des héritages religieux. Effectivement, « double dynamique est en cours où convergent quête spirituelle et aspirations à des relations plus harmonieuses avec la nature : un verdissement des religions et une spiritualisation de l’écologie » (p 22). Michel Maxime Egger fait le point sur la relation entre la prise de conscience écologique et les religions.
Ainsi, en ce qui concerne le christianisme, il rappelle le procès de l’historien Lynn White à son encontre dans un article célèbre de la revue Science paru en 1967 (p 25). « Il est important que les Eglises et leurs fidèles reconnaissent les faiblesses de leur tradition en matière écologique ». Cependant, « le problème vient surtout d’une interprétation particulière – cartésienne – de la Genèse. Une approche liée au fait que le christianisme occidental est devenu « a-cosmique » et a contribué au désenchantement du monde par la modernité » (p 26). Ce même christianisme occidental est appelé aujourd’hui à une transformation profonde de son approche théologique. Ainsi, dans un livre récent : « Spirit of hope », Jürgen Moltmann y décrit « un avenir écologique pour la théologie chrétienne ». Cet avenir écologique est lié à une transformation profonde des représentations de Dieu et de sa relation avec la terre. « La création est en Dieu et Dieu dans la création. Selon la doctrine chrétienne originale, l’acte de création est trinitaire ». Ce qui ressort d’une vision trinitaire, c’est l’importance du rôle de l’Esprit. « Dans la puissance de l’Esprit, Dieu est en toute chose et toute chose est en Dieu » (3). Dans son livre : « La Terre comme soi-même » (4), Michel Maxime Egger se réfère à l’approche de la théologie orthodoxe qui a échappé aux dérives engendrées par le changement de vision intervenu à l’époque moderne. Les lignes sont aujourd’hui en mouvement comme le montre le bon accueil de l’encyclique novatrice du pape François : Laudato si’ » (5).
Michel Maxime Egger fait également le point sur l’attitude des autres religions plus ou moins propices à l’écologie. Mais aujourd’hui, « malgré ses ambiguïtés, le rôle écologique des religions est souligné de manière croissante par une grande diversité d’acteurs qui collaborent avec elles » (p 27). L’auteur les appelle à « revisiter leurs traditions de manière critique et créative à la lumière des enjeux écologiques et des découvertes de la science contemporaine. On rejoint là une autre étymologie du mot religion (du latin religere : « relire »). Il s’agit de valoriser les ressources et les potentialités écologiques –souvent ignorées et difficiles d’accès – à travers une réflexion de fond, en faisant évoluer les doctrines, l’interprétation des textes et les rites » (p 28).
La montée des aspirations spirituelles s’affirme globalement. Ainsi l’auteur peut évoquer « la spiritualisation des écologies » (p 29-35). C’est un esprit d’ouverture. « Le préfixe « trans » est un mot latin qui signifie : par delà. Il sied bien à l’écospiritualité. Celle-ci est transcendante… transreligieuse… transdisciplinaire… transmoderne… Pour accomplir son potentiel de fécondité, cette vertu écologique de l’ouverture doit être sous-tendue par un enracinement… » (p 33). Cette spiritualisation de l’écologie se manifeste de différentes manières : reprise d’une tradition ancienne (Henri David Thoreau), sensibilisation d’organisations internationales, réinvestissement de la personne et de son intériorité comme foyer de transformation plus globale selon la formule célèbre de Gandhi : « Deviens le changement que tu veux voir advenir dans le monde ».
« Plusieurs recherches le montrent : nombre de militants ancrent leur engagement dans un travail intérieur, une expérience profonde, voire mystique de la nature et des ressources symboliques associées au spirituel… Certains lieux non religieux conjuguent écologie et spiritualité (6) » (p 31).
« L’écospiritualité se nourrit également des apports de la science postmoderne, vulgarisés par des figures comme Frank Capra et Rupert Sheldrake. Ce vaste chantier a été ouvert au XXè siècle par de nouvelles approches qui se sont développées au XXè siècle entre l’infiniment grand et l’infiniment petit » (p31).
Au total, « l’écospiritualité qui s’exprime dans ces espaces, est le plus souvent laïque et autonome par rapport au religieux institutionnalisé » (p 32).
Redécouvrir la sacralité de la Terre
Il y a donc aujourd’hui un grand mouvement pour « réenchanter la nature » (p 36-51). Ainsi la Création est envisagée comme « don », la Terre comme « mère », le cosmos comme « organisme vivant ». L’auteur nous engage à redécouvrir la sacralité de la nature. « Il convient de mettre un terme au divorce entre le sacré et la Terre, non pour diviniser la nature, mais pour lui redonner son mystère, source de respect » (p 52). Encore faut-il s’entendre sur la définition du sacré, notion complexe, lourde d’héritages divers ». Etymologiquement, il désigne ce qui est (mis) à part. Aujourd’hui, le sacré change de visage dans une nouvelle conscience. Il ne sépare plus, mais relie. Il vient moins de l’extérieur et par le haut (le Ciel) que de l’intérieur et par le bas (la Terre). Il n’existe plus en soi, mais à travers une relation. Il n’est plus réductible au religieux institué qui n’en est qu’une des expressions » (p 56). « Selon l’écothéologien Thomas Berry, le sacré évoque les profondeurs du merveilleux ».
Immanence et transcendance divine : les voies du pananthéisme.
Comme son étymologie l’indique, le panenthéisme est une doctrine du tout en Dieu et de Dieu en tout. C’est l’approche de Jürgen Moltmann en regard de la conception d’un Dieu lointain et dominant. Le panenthéisme est la voie des théologiens orthodoxes, mais aussi de nombreux théologiens très divers de Teilhard de Chardin à Leonardo Boff. Michel Maxime Egger envisage aussi le panenthéisme comme la voie de l’écospiritualité. « Ce dernier permet d’aller au delà de deux modèles qui enferment souvent la question écologique : le matérialisme et le panthéisme… Le panenthéisme unit le divin et la nature sans les confondre.
Dans la version faible du panenthéisme, la nature est le miroir du divin… Les hommes, les animaux, les oiseaux, les arbres, les fleurs sont des manifestations de Dieu, des signes de son amour, de sa sagesse, de sa bonté. Dans sa version forte, le panenthéisme n’est pas que le reflet du divin, mais le lieu de sa présence. « En toute créature, habite son Esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui, écrit le pape François » (p 58). Michel Maxime Egger décrit ensuite « trois modalités du panenthéisme fort qui résonnent à travers diverses traditions religieuses : Les empreintes du divin, les énergies divines et les esprits invisibles » (p58).
« Le premier mode de la présence de Dieu dans la nature est l’empreinte divine que chaque être humain et autre qu’humain, porte dans son être profond… ». L’auteur nous rapporte la tradition chrétienne à ce sujet. « Selon le Nouveau Testament, le Logos ou le Verbe divin est le « Principe » en qui, pour qui et par qui tout existe… Chaque créature porte en elle comme une information divine… C’est un ensemble de potentialités à réaliser en synergie avec la grâce de l’Esprit » (p 59).
« Le deuxième mode de présence de Dieu dans la nature se traduit par ses énergies qui rayonnent sur toute la terre » (p 64). Nous nous rencontrons ici à nouveau avec la pensée théologique de Jürgen Moltmann telle qu’elle se manifeste dans ses deux livres : « Dieu dans la création » et « L’Esprit qui donne la vie » (7).
« Une troisième modalité de la présence du divin dans la nature est constituée par les esprits qui peuplent le monde invisible « (p 64). Des théologiens pentecôtistes comme Amos Yong s’interrogent sur le discernement des esprits. Kirsteen Kim évoque ce sujet dans son œuvre sur l’Esprit saint dans le monde et particulièrement en Corée (8).
Au total, quelque soit la forme du panenthéisme, la nature est plus qu’une réalité matérielle obéissant à des lois physiques et chimiques. Elle est un mystère habité d’une conscience et d’une Présence » (p 67).
Quelle est la mission de l’homme ?
Si notre regard sur la nature en terme de sacralité se renouvelle, quel est maintenant le rôle de l’homme ? Les derniers chapitres balisent une voie . L’homme a pour mission d’être « un pont entre la terre et le ciel ». Il est appelé à transformer son « cosmos intérieur ». Et, à l’exemple de l’auteur, il devient un méditant-militant.
Cependant, tous ces chapitres sont denses. En voici seulement quelques aperçus. « Faire la paix avec la Terre demande de changer notre regard sur l’être humain pour lui redonner sa place dans la nature. L’enjeu est de sortir tant de l’anthropocentrisme que du biocentrisme pour élaborer une troisième voie fondée sur une relation dynamique et équilibrée entre l’humain, le cosmique et le divin. Trois réalités à unir sans les confondre et à les distinguer sans les séparer, le divin étant le centre caché de toutes choses » (p 70). Sortir d’un « anthropocentrisme dévié », selon l’expression du pape François, suppose « une série de passages : d’une approche hiérarchique à une vision holistique, de l’indépendance à l’interdépendance… » (p 74). « Pour opérer cette transformation, quatre postures ressortent des différentes traditions comme autant de pistes de réflexion » (p 74).
L’homme peut être considéré comme intendant ou jardinier de la Création, à l’inspiration du passage de la Genèse (2.15) où Dieu enjoint à l’être humain de garder et conserver le sol. Cependant, cette posture n’est pas sans risque. Elle peut induire une relation managériale, utilitariste et instrumentale avec la nature (p 75).
Une deuxième posture est celle de « citoyen de la communauté du vivant », « citoyen de l’univers et membre de la fratrie cosmique » (p 74). Ainsi que l’affirme un théologien, Thomas Berry, « la terre n’est pas une collection d’objets, mais une communauté de sujets ». « Selon les traditions, tous sont enfants du même père… ou de la même mère… Par cette origine partagée, tous les êtres vivants sont unis « par des liens invisibles » et « forment une sorte de famille universelle » (Laudato si’). (p 76).
« Une troisième posture respectueuse de la toile du vivant consiste à nous re-naturer (Jean-Marie Pelt) et à restaurer notre lien ontologique avec la nature. « Dans « humain », il y a « humus », la terre. La même racine se trouve dans « humilité… La terre n’est pas que notre milieu de vie, mais notre matrice originelle… » (p 78) ». Nous ne sommes pas seulement partie intégrante de la nature, mais celle-ci est inscrite au plus profond de notre corps et de notre psyché » (p 79). Avec Michel Maxime Egger, nous pouvons nous reconnaître comme un « microcosme interdépendant ».
Enfin, une quatrième posture nous est proposée, celle de médiateur entre la nature et le divin. « Selon la métaphore de Grégoire de Naziance, nous sommes des « êtres-frontières ». Nous appartenons à deux ordres de réalité entre lesquelles nous sommes appelés à être des médiateurs, le visible et l’invisible, le matériel et le spirituel… la Terre et les Cieux » (p 80). Certes, « ainsi que le montre une foule de travaux scientifiques, nous avons beaucoup en commun avec d’autres espèces… mais, en même temps, nous possédons des facultés en propre qui nous distinguent du reste de la nature » (p 81). « Microcosme, l’être humain est aussi un « microtheos », disent les Pères de l’Eglise. Créé corps, âme, esprit, cette troisième faculté, l’esprit, est ce qui rend l’être humain capable de transcender la matière, saisir les choses dans leur essence spirituelle, percevoir, au delà des apparences, la Présence qui habite la Création et qui en est la source » (p 81). « Elle définit une vocation particulière couplée à une grande responsabilité : participer à l’accomplissement spirituel de la Création » (p 82). Ici l’auteur nous parle de célébration.
Dans cet exposé, Michel Maxime Egger fait appel à une grande diversité de pensées, des Pères de l’Eglise à des philosophes comme Martin Buber ou Emmanuel Levinas, du pape François à des personnalités spirituelles de différentes traditions.
Dans un dernier chapitre : « Devenir un méditant- militant », l’auteur nous invite à ne pas nous perdre dans une spiritualité hors-sol, mais à nous engager dans la société au quotidien. « Ancrés dans l’être, l’engagement et les gestes écologiques ne relèvent plus d’une obligation morale (« il faut ») ou d’un idéal extérieur auquel se conformer, mais sont le fruit quasi-organique d’une nécessité intérieure liée à une reconnexion en profondeur avec la terre » (p 104). Cet engagement a besoin d’être enraciné, nourri. C’est une invitation à la cohérence. « L’horizon est l’alignement entre l’être et le faire, la parole et l’action, l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité » (p 112). « Une figure incarne ce nouveau mode d’engagement écocitoyen, joyeux et non sacrificiel : le méditant-militant » (p 112). L’auteur nous décrit en plusieurs points les caractéristiques de cette nouvelle forme d’engagement. C’est encore là un passage à lire et à méditer (p 112-113)
Une révolution silencieuse
Dans ce monde où les menaces abondent, il est important de voir qu’il y a bien au sein même de cette crise, des pistes positives. Aujourd’hui, Michel Maxime Egger nous montre une révolution silencieuse en cours. « Au sein même du chaos planétaire et des menaces d’effondrement, une nouvelle conscience est en train d’émerger. Ce qui se passe et qui nous échappe en bonne partie, ressemble à la genèse d’un papillon… Le spécialiste de l’intelligence collective Ivan Maltcheff voit dans ce processus une métaphore inspirante pour la situation actuelle. Aux quatre coins du globe, à différents niveaux de la société, des personnes et des groupes en transition se connectent à la nature et au divin pour cocréer le monde de demain, nourrir un devenir vers d’autres champs du possible, d’autres modes de vie compatibles avec les lois du vivant » (p 116).
L’écospiritualité est une bonne nouvelle !
J H
- Michel Maxime Egger. Ecospiritualité. Réenchanter notre relation avec la nature. Jouvence, 2018
- Un chemin spirituel vers un nouveau monde : https://vivreetesperer.com/un-chemin-spirituel-vers-un-nouveau-monde/ L’espérance en mouvement : https://vivreetesperer.com/lesperance-en-mouvement/
- Un avenir écologique pour la théologie moderne : https://vivreetesperer.com/un-avenir-ecologique-pour-la-theologie-moderne/
- Michel Maxime Egger : La Terre comme soi-même. Repères pour une écospiritualité. Labor et Fides, 2012
- Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François, Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
- Une approche spirituelle de l’écologie. Sur la Terre comme au Ciel : https://vivreetesperer.com/une-approche-spirituelle-de-lecologie/
- Voir le blog : L’Esprit qui donne la vie : https://lire-moltmann.com/
- Pour une vision holistique de l’Esprit : https://vivreetesperer.com/pour-une-vision-holistique-de-lesprit/
Jane Goodall : une recherche pionnière sur les chimpanzés, une ouverture spirituelle, un engagement écologique
Nous vivons aujourd’hui dans une période critique. La nature est en danger en raison de l’avidité humaine. Mais, en même temps, des transformations en profondeur s’opèrent. C’est, par exemple, la découverte de formes de conscience dans le monde animal. Et, plus généralement, l’humanité commence à accéder à une relation dimensionnelle qui la dépasse, un mouvement qui peut se décrire en terme d’écospiritualité. Une personne comme Jane Goodall s’inscrit dans ce paysage à travers son histoire de vie, une recherche pionnière sur les chimpanzés, une ouverture spirituelle, un engagement écologique.
Notre attention la concernant a été attirée par son obtention du prix Templeton en 2021. En effet, le prix Templeton (1) se veut l’équivalant en excellence au prix Nobel dans le domaine des réalisations ayant une portée spirituelle. Décerné pour la première fois en 1973, il a d’abord concerné « le progrès en religion ». Aujourd’hui, le prix Templeton est un prix « pour le progrès de la recherche et des découvertes concernant les réalités spirituelles ». Un intérêt tout particulier est porté aux personnes travaillant à « l’intersection de la science et de la religion ». « Comment exploiter le potentiel de la science pour explorer les questions les plus profondes concernant l’univers et, en celui-ci, la place et le but de l’humanité ?». En recevant le prix Templeton, Jane Goodall s’inscrit dans un ensemble de personnalités remarquables parmi lesquelles le Dalaï Lama et l’archevêque Desmond Tutu. Mais, plus précisément, dans le champ de la science, elle succède à Francis Collins, généticien américain connu pour son œuvre marquante dans la découverte de l’ADN et titulaire du prix Templeton en 2020.
A de nombreuses reprises, Jane Goodall a été amenée à s’exprimer sur son expérience de vie et ses convictions. Nous nous inspirons ici particulièrement de son livre : « Reason for hope. A spiritual journey » (2), initialement publié en 1999 et ensuite traduit en français. Ainsi, nous évoquons son histoire de vie, comment d’une enfance en Angleterre, dans la fraicheur d’une relation avec les animaux et l’encouragement de sa mère, elle est partie en Afrique, et, dans un contexte de recherche, a pu y découvrir une forme de conscience chez les chimpanzés. A l’époque, ce fut une découverte révolutionnaire. Dans son chemin qui fut difficile, elle a été portée par une foi chrétienne et une sensibilité spirituelle. Enfin, constatant les destructions en cours dans le monde vivant, elle s’est engagée dans une grande mission de conscientisation écologique.
Une histoire de vie
Si on peut accéder à de courtes biographies de Jane Goodall (3), le livre : « Reason for hope », relate de grandes étapes de sa vie. Comment une jeune anglaise est attirée par l’Afrique à une époque où cela n’allait pas de soi, comment elle fait l’apprentissage de la méthode scientifique et développe une approche originale dans l’observation des chimpanzés en devenant ainsi une personnalité scientifique reconnue, comment, à travers les aléas de la vie, elle est portée par une démarche de foi, une ouverture spirituelle qu’elle manifeste dans le titre de son ouvrage : « Reason for hope. A spiritual journey » (Raison d’espoir. Un voyage spirituel).
Jane Goodall est née en 1934 en Angleterre. Elle a vécu son enfance dans un pays en guerre, mais dans un lieu relativement privilégié, et dans un environnement familial où sa mère a joué un rôle marquant. Une des caractéristiques majeures de son enfance a été l’amour des animaux. Ainsi raconte-t-elle, dans son livre, des souvenirs précis, par exemple comment, à quatre ans, elle a découvert la manière dont une poule pondait un œuf. Elle nous décrit son attachement pour son chien et le plaisir de vivre dans un jardin.
Elles nous raconte également son éducation chrétienne, avec, dans l’adolescence à quinze ans, un poussée de ferveur au contact d’un pasteur dont elle apprécie l’enseignement. Ainsi évoque-t-elle la foi chrétienne vivante qu’elle a vécue à cet âge.
A 19 ans, elle s’oriente vers des études de secrétariat, un métier qui lui permet de travailler n’importe où. Et effectivement, elle nourrit un désir de se rendre en Afrique. Ce désir se réalise en 1957 lorsqu’elle peut se rendre au Kenya grâce à l’invitation d’une amie d’école.
Ainsi, de l’enfance à la jeunesse, on voit un fil conducteur dans la vie de Jane : « J’ai une mère qui n’a pas seulement toléré, mais encouragé ma passion pour la nature et les animaux, et qui, encore plus important, m’a appris à croire en moi. Tout a conduit, de la manière la plus naturelle, semble-t-il aujourd’hui, à l’invitation magique à me rendre en Afrique où je rencontrerai le docteur Louis Leakey (un paléontologue) qui me conduira sur le chemin de Gombé et des chimpanzés » (p 4).
A 23 ans, en 1957, Jane est donc partie en bateau pour l’Afrique. En faisant le point sur sa jeunesse, elle écrit : « Je pouvais entrer dans cette nouvelle vie sans peur, car j’étais équipée par ma famille et mon éducation, par de saines valeurs morales et par un esprit indépendant, pensant librement ». Au Kenya, elle est mise en relation avec le célèbre anthropologue, Louis Leakey qui lui offre un emploi comme sa secrétaire personnelle. Elle participe donc avec lui à ses campagnes de fouilles. Et c’est le docteur Leakey qui va l’inviter à s’engager dans une recherche de longue haleine sur les chimpanzés, car, bien que Jane ait été alors dépourvue de diplôme, il croyait en elle « un esprit ouvert avec la passion du savoir, avec l’amour des animaux et une grande patience » (p 55). A l’époque, on ne savait presque rien sur le comportement des chimpanzés dans un environnement naturel. Tout était à découvrir. Le docteur Leakey a trouvé un financement pour mener cette recherche. Jane s’est installée, en compagnie de sa mère, à Gombé, un espace de collines forestières en Tanzanie.
Et là, peu à peu, Jane a commencé à explorer les lieux. Tous les jours, de bonne heure, elle partait dans la forêt. Au départ, les chimpanzés fuyaient dès qu’ils la voyaient. Et puis, ils se sont habitués à elle et la découverte a commencé. Ainsi, elle a su mettre en évidence que les chimpanzés utilisaient des outils. « Ce fut une découverte majeure. A partir de là, on a commencé à redéfinir l’homme d’une façon plus complexe qu’auparavant ». Peu à peu, Jane est entrée « dans un monde magique qu’aucun humain n’avait exploré avant, le monde des chimpanzés sauvages » (p 71). Elle y découvre de mieux en mieux la personnalité des chimpanzés, mais elle entre aussi dans une harmonie. Animaux, arbres, étoiles « formaient un grand tout ». « Tout faisait partie d’un grand mystère et j’en faisais partie aussi ». « Un sentiment de paix descendait sur moi ».
Dans les années qui suivirent, Jane passa à l’Université de Cambridge et y obtint un doctorat. Si le séjour dans le centre de recherche qui s’était installé à Gombé connut des épisodes d’insécurité, la recherche sur les chimpanzés s’y est poursuivie. Le « noble singe » s’est révélé un mythe. La communauté des chimpanzés observée jusque là s’était séparée et ayant donné naissance à une autre communauté, un conflit entre les deux est apparu. « Notre monde paisible et idyllique, notre petit paradis a été bouleversé » (p 177). Des tueries ont été observées. « Soudain, nous avons trouvé que les chimpanzés pouvaient être brutaux » (p 177). Il a fallu en rendre compte scientifiquement, bien que dans ces années là, ce sujet se prêtait à des controverses idéologiques.
La recherche de Jane Goodall était désormais reconnue dans le monde scientifique. Elle publie un livre sur « les chimpanzés de Gombé ». C’est alors qu’elle fut invitée en 1986 à une grande conférence sur les chimpanzés. A cette occasion, elle prit conscience de la destruction du milieu naturel en Afrique. La vie des chimpanzés était menacée de toutes parts, notamment dans la maltraitance des expériences médicales en laboratoire. Face à tous ces dangers, Jane Goodhall s’est sentie appelée à s’engager pour la protection de la nature et pour l’éducation. Elle va parcourir le monde dans le cadre de la fondation qu’elle a créé : le « Jane Goodall Institute ». En 2002, elle est institué « ambassadrice de la paix » par le Secrétaire Général des Nations Unies.
Dans son livre, Jane Goodall nous fait part également de sa vie privée. Un premier mariage en 1964 avec un photographe et réalisateur. Après une décennie passée ensemble, le couple divorce. En 1975, Jane se remarie avec Derek Bryceson, un membre du parlement de Tanzanie et directeur des parcs nationaux du pays. Son mari est atteint d’un cancer et décède en 1980. Ce fut un événement très douloureux dans la vie de Jane.
Une recherche pionnière
En participant à la recherche de Louis Leakey, à ses fouilles paléontologiques, Jane a été initiée à la méthode scientifique. Et Louis Leakey était à l’avant-garde de la recherche sur les origines de l’homme. N’était-il pas nécessaire d’aller au delà de la reconstitution du passé et de s’interroger sur « les descendants vivants des créatures préhistoriques ? « Louis Leakey était intéressé par les grands singes, parce qu’ils sont les plus proches et parce qu’il était important pour lui de comprendre que leurs comportements dans un état sauvage pouvait l’aider à mieux envisager comment nos ancêtres se comportaient »(p 52). Ainsi Leakey projetait une recherche sur les chimpanzés. Cette étude de terrain n’avait pas de précédent. Elle était difficile. Au total, Leakey pensait que Jane était la meilleure personne qui pouvait entreprendre une telle tâche. Et il trouva un financement pour cette entreprise. Ainsi, Jane alla s’installer à Gombé, un coin de forêt tropicale au Tanganyka.
Au départ, les chimpanzés présents dans ce lieu la fuyaient. Et ce n’est que peu à peu qu’elle réussit à entrer en contact avec eux. Dans cette approche et cette attente, Jane aimait cette vie dans la forêt. Le temps passait et finalement, elle fit une grande découverte. C’était l’utilisation d’un outil par un chimpanzé. Et comme, à cette époque, l’homme était défini comme « le fabricant d’outil », les observations de Jane mettaient en question cette spécificité (p 67). Leakey obtint un crédit de la National Geographic Society pour poursuivre cette recherche. Ainsi, « Jane pouvait pénétrer, de plus en plus, dans un univers magique qu’aucun humain n’avait exploré avant elle : l’univers des chimpanzés sauvages » (p 71). Elle entra dans un dialogue familier avec les êtres vivants qui peuplaient la forêt. Et elle approcha de plus en plus des chimpanzés, reconnaissant en chacun une personnalité contrairement à une pensée scientifique « réductionniste et mécaniste » (p 74) dominante à l’époque. Elle put et elle sut entrevoir les émotions des chimpanzés. « Il était abondamment clair que ces animaux avaient une personnalité, pouvaient raisonner et résoudre des problèmes, avoir des émotions » (p 74). Peu à peu, elle apprit à reconnaître les liens affectifs et de soutien à long terme entre les membres d’une famille et les « proches amis » (p 76). Si, à l’époque, il était recommandé aux chercheurs d’éviter toute empathie, Jane ignorait cette recommandation. « Une grande partie de ma connaissance de ces êtres intelligents s’est construite justement parce que je nourrissais de l’empathie à leur égard « (p 77).
Un centre de recherche s’est installé à Gombé. L’étude a pu ainsi se poursuivre pendant des années. Un tournant est intervenu dans les années 70, car on a découvert alors une ombre dans la vie des chimpanzés. Le groupe central, bien connu de Jane, s’était séparé. Des conflits éclatèrent entre deux groupes devenus rivaux. On put observer des actes meurtriers, jusque dans la dévoration de jeunes chimpanzés par des congénères plus âgés. Ce fut un choc pour Jane et il ne fut pas facile d’en rendre compte dans la communauté scientifique, car des arguments furent opposés sur une possible instrumentalisation idéologique de ces résultats. Jane chercha à regarder la situation en face dans toute sa complexité.
Une ouverture spirituelle.
Dans son enfance et particulièrement dans son adolescence, Jane a vécu la foi chrétienne. Dans son livre, elle nous en décrit concrètement les expériences. Enfant, chez elle, le sentiment religieux s’étend à la nature comme il en sera de même par la suite. « Dieu était aussi réel pour moi que le vent qui passait à travers les arbres de notre jardin. D’une certaine manière, Dieu prenait soin d’un monde magique plein d’animaux fascinants et de gens qui, pour la plupart, étaient amicaux et bons. C’était pour moi un monde enchanté, plein de joie et de merveille et je me sentais beaucoup en faire partie » (p 10).
Dans son adolescence, la venue d’un nouveau pasteur dont l’enseignement était attirant, l’amena à fréquenter l’église congrégationnelle. « Le pasteur était hautement intelligent et les prédications étaient puissantes et suscitaient la réflexion » (p 21). « Soudainement, personne n’eut plus à m’encourager d’aller à l’église ». « Sans aucun doute, ce pasteur a eu une influence majeure sur ma vie. Comme j’écoutais ses prédications, la religion chrétienne devint vivante et, de nouveau, je permis aux idées de Dieu d’imprégner ma vie » (p 24). Jane nous raconte le contenu de sa foi et, entre autres, la manière dont elle lisait la Bible. Cette période a été marquante. « Clairement, à ce moment, je commençais à me sentir partie d’une grande puissance unificatrice ». Jane évoque l’émerveillement suscité par un magnifique coucher de soleil. Il y a des moments où « elle sentait profondément qu’elle se trouvait à l’intérieur d’une grande puissance spirituelle – Dieu ». « Comme j’ai évolué dans la vie, j’ai appris progressivement comment chercher de la force dans cette puissance, cette source de toute énergie pour fortifier mon esprit troublé et mon corps épuisé en cas de besoin » (p 30). Dans les épreuves qu’elle a connu, Jane a eu des passages de doute. Devant la souffrance de son mari en train de mourir, « ma foi en Dieu vacilla. Durant un moment, j’ai cru qu’elle s’était éteinte » (p 159). Mais elle a gardé le cap. Et son histoire de vie a été ponctuée par des expériences spirituelles.
A Gombé, dans la forêt tropicale, elle a ressenti un grand émerveillement. Elle nous en parle abondamment. « Plus je passais de temps dans la forêt, plus je devenais un avec ce monde magique qui était maintenant mon habitat (p 73). Elle vit à l’unisson des éléments, des arbres, des animaux. Plus tard, dans son parcours à Gombé, elle vivra un jour dans la forêt un temps d’extase, un profonde expérience spirituelle. Dans un autre cadre, à un moment précédent de sa vie, elle avait vécu un moment de transcendance. C’était en visitant la cathédrale Notre-Dame à Paris. A l’époque, elle avait déjà perçu un lien entre cette expérience, le vécu chrétien de son adolescence et l’émerveillement dans le monde de la forêt tropicale (p 94). Là, à nouveau dans la forêt de Gombé, « Perdue dans l’émerveillement face à beauté autour de moi, j’ai du glisser dans un état de conscience élevée. C’est difficile – impossible en réalité – de mettre en mots le moment de vérité qui descendit sur moi… En luttant ensuite pour me rappeler l’expérience, il m’a semblé que le moi tourné vers lui-même (self) s’était absenté. Les chimpanzés, la terre, les arbres, l’air et moi, nous semblions devenir un avec la puissance de l’esprit de vie lui-même… J’ai entendu de nouvelles fréquences dans la musique des oiseaux… Jamais je n’avais été aussi consciente de la forme et de la couleur des feuilles… Les senteurs elles aussi étaient présentes » (p 173-174). Par la suite, elle a continué à penser à cette expérience. « Il y a beaucoup de fenêtres à travers lesquelles, nous les humains, qui cherchons du sens, pouvons voir le monde autour de nous ». La science est une de ces fenêtres, mais il y en a d’autres. « Les fenêtres à travers les mystiques et les saints hommes de l’Orient et les fondateurs des grandes religions du monde… ont contemplé les vérités qu’ils voyaient non seulement avec leurs esprits, mais aussi avec leurs cœurs et avec leurs âmes. Pour moi, cette après-midi là dans la forêt, c’est comme si une main invisible avait tiré le rideau, et que, pendant un bref moment, j’avais pu voir à travers une telle fenêtre. Dans un flash de vision, j’avais connu une extase où le temps avait disparu et ressenti une vérité à laquelle la science n’ouvre qu’une petite partie. Je savais que cette vérité serait avec moi tout le reste de ma vie, mémorisée imparfaitement et cependant toujours là à l’intérieur. Une source de force dans laquelle je pourrais puiser quand la vie paraitrait dure, cruelle ou désespérée » (p 175). Jane Goodall refuse qu’on oppose science et religion. « Albert Einstein, indéniablement un des plus grands savants et penseurs de notre temps, proposait une approche mystique au sujet de la vie qui était, selon lui, constamment renouvelée par l’émerveillement et par l’humilité qui l’emplissait quand il contemplait les étoiles » (p 177).
La vision de Jane Goodall est unifiante. « La forêt et la puissance spirituelle qui est si grande en elle, m’a donné la paix qui dépasse toute intelligence » (p 181).
Un engagement au service du vivant
Parce qu’elle aime, parce qu’elle vit pleinement, Jane Goodall est aussi sensible. Elle ressent les souffrances de ses proches. Elle ressent les maux qui affectent le vivant sur toute la terre. Qu’est-ce qui importe aujourd’hui pour notre avenir ? « Allons-nous continuer à détruire la création de Dieu, nous battons-nous les uns contre les autres, et faisons-nous du mal aux autres créatures de cette planète ? Ou allons-nous trouver les moyens de vivre en plus grande harmonie les uns avec les autres et avec le monde naturel ? » (p 172). En 1986, Jane Goodall a été invitée à un congres scientifique venant à la suite de la publication de son livre : « Les chimpanzés à Gombé ». La participation à ce congrès a eu un effet inattendu. Elle y arrive comme une chercheuse scientifique. Elle en est ressortie comme une militante décidée à s’engager dans la protection de la nature et dans l’éducation. Ainsi parle-t-elle de cet événement comme son « chemin de Damas » (p 206). En effet au cours d’une session sur la protection de la nature, elle a pris conscience de la manière dont l’espèce des chimpanzés était menacée dans toute l’Afrique (p 106). Et elle a entendu combien les chimpanzés étaient souvent torturés dans les conditions éprouvantes de leur détention en vue d’expériences de laboratoire. « j’ai vu qu’un des grands défis du futur est de trouver des alternatives à l’usage des animaux de toutes espèces dans des expérimentations, avec le but d’y mettre fin » (p 221). Et puis, bien entendu, Jane Goodall participe à la prise de conscience écologique qui grandit actuellement. Elle met en évidence la disparition des forets et la disparition ou le recul des espèces menacées. Ainsi, dans le cadre de sa fondation, le « Jane Goodall Institute », elle s’adresse à un vaste public (4) et parcourt le monde pour étendre la prise de conscience écologique, notamment auprès de la jeunesse. « Encourager les jeunes et leur donner du pouvoir est ma contribution à leur avenir et donc à l’avenir de la planète » (p 243). Elle a récemment pris part au film : « Animal » de Cyril Dion (5). Elle porte un message : « Ensemble, nous devons rétablir nos connections avec le monde naturel et avec la Puissance Spirituelle qui est autour de nous… » (p 267).
Jane Goodall participe à une émergence de conscience, la montée de la conscience du vivant, la reconnaissance de la conscience animale (6). Et, en même temps apparait une ouverture au Divin (7).
Jane exprime tout cela parfaitement. C’est son histoire de vie et, en même temps, c’est un moment de l’histoire de l’humanité, un moment où nous sommes appelés à un changement majeur qui est aussi un tournant de la conscience. Et, comme quelques autres, Jane Goodall nous invite à y entrer dans l’espérance (8).
J H
(1) Le prix Templeton : https://www.templetonprize.org/
Sur Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Templeton_Prize
(2) Jane Goodall (with Phillip Berman). Reason for hope. A spiritual journey. Grand Central Publishing, 1999 (édition 2003). En français : Jane Goodall (avec Phillip Berman). Le cri de l’espoir. Stanké, 2001. Jane Goodall est également l’auteur de plusieurs livres parus en français. En octobre 2021, est paru un entretien avec Jane Goodhall qui témoigne de sa force de vie et de ses « raisons d’espérer » au cours d’une existence riche en découvertes, en expériences et en engagements : Jane Goodhall. Le livre de l’espoir. Pour un nouveau contrat social. Entretien avec Douglas Abrams. Flammarion, 2021.
(3) La vie de Jane Goodall : https://janegoodall.fr/biographie-jane-goodall/
(4) Actions de Jane Goodall : https://www.youtube.com/watch?v=ji5tdtz5AMg
(5) Le film : « Animal » est accompagné par le livre de Cyril Dion : « Animal » présenté sur ce blog. Dans les deux cas, Jane Goodhall est très présente : https://vivreetesperer.com/animal-de-cyril-dion/
(6) Jane Goodall a été pionnière dans la reconnaissance d’une conscience animale qui est l’objet aujourd’hui de nombreuses recherches. Dans la revue : Théologiques, en 2002, la sociologue Nicole Laurin a publié un excellent article : « Les animaux dans la conscience humaine. Questions d’aujourd’hui et de toujours ». Nicole Laurin cite, entre autres, le théologien Jean-François Roussel : « L’hominisation ne peut être définie sur le « mode différenciatoire, c’est à dire visant à désigner la différence humaine, mais plutôt sous « le mode inclusif et ouvert », car elle recouvre des processus repérables au delà de notre espèce… Cela signifie, pour la théologie, que l’histoire du salut doit devenir celle de la nature et non seulement de l’humanité, le salut de l’humanité participant d’un salut plus originel. La théologie doit s’efforcer de penser l’émergence de l’esprit dans l’animalité… ».
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2002-v10-n1-theologi714/008154ar/
(7) Dieu est toujours agissant et présent dans la création, comme l’œuvre du théologien Jürgen Moltmann le met en évidence : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/ La présence de Dieu dans la création est bien mise en valeur par Richard Rohr sur son site : Center for action and contemplation : plusieurs séquences récemment : « Contemplating creation » et « Francis and the animals » : https://cac.org/francis-and-the-animals-weekly-summary-2021-10-09/ et https://cac.org/themes/contemplating-creation/
(8) Nous rejoignons ici la théologie de l’espérance : « Jürgen Moltmann. Hope in these troubled times » qui prend en compte l’avenir écologique : https://vivreetesperer.com/un-avenir-ecologique-pour-la-theologie-moderne/
Contempler la création
Louez l’Eternel du bas de la terre, Monstres marins et vous tous abimes :
Feu et grêle, neiges et brouillards ;
Vents impétueux qui exécutez ses ordres ;
Montagnes et toutes les collines ;
Arbres fruitiers et tous les cèdres ;
Animaux et tout le bétail ;
Reptiles et oiseaux ailés ;
Qu’ils louent le nom de l’Eternel
Car son nom seul est élevé ;
Sa majesté est au dessus de la terre et des cieux
Psaume 148 7-10,13
Dans cette séquence (1), frère Richard Rohr partage sur la manière de « voir » et de percevoir Dieu dans les formes de la nature sur la base d’une spiritualité incarnée.
10 octobre 2021
Contempler la création
La spiritualité de la création a ses origines dans les Écrits hébraïques tels que les psaumes 104 et 148. C’est une spiritualité qui est enracinée, en premier, dans la nature, dans l’expérience, et dans le monde tel qu’il est. La riche spiritualité hébraïque a formé l’esprit et le cœur de Jésus ».
Richard Rohr fait remarquer alors combien nous sommes habitués à penser la religion en terme d’idées, de concepts et de formules trouvés dans des livres. « Ce n’est pas là où la religion commence. Ce n’est pas la spiritualité biblique. Celle-ci commence en observant ce qui est ».
Paul écrit : « Déjà depuis la création du monde, l’essence invisible de Dieu et sa puissance éternelle ont été vues clairement par la compréhension de l’esprit des choses créées » (Rom 1.20). Nous connaissons Dieu à travers les choses que Dieu a faites. La première fondation de toute vraie vision religieuse est tout à fait simplement d’apprendre à voir et à comprendre ce qui est ».
Or, selon Richard Rohr, « la contemplation, c’est rencontrer la réalité dans sa forme la plus simple et la plus directe, sans jugement, sans explication et sans contrôle ».
Richard Rohr nous appelle à voir dans le monde les « vestigia Dei », ce qui signifie les empreintes de Dieu. Apprendre à aimer pour voir. « Nous devons commencer avec une pierre. Puis nous passons de la pierre au monde végétal et nous apprenons à apprécier les choses qui grandissent et à voir Dieu en elles. Peut-être, une fois que nous pourrons voir Dieu dans les plantes et les animaux, nous pourrons voir Dieu dans nos prochains. Et puis, nous pourrons apprendre à aimer le monde. Et puis quand tout cet amour aura pris place, quand ce regard sera advenu, quand de telles personnes viendront à moi et me diront qu’elles aiment Jésus, j’y croirais. Elles sont capables d’aimer Jésus. Leur esprit est préparé. Leur esprit est libéré et il a appris à voir et à recevoir, comment rentrer en soi et en sortir. De telles personnes pourraient bien comprendre comment aimer Dieu ».
La dance de la vie
Richard Rohr voit en François d’Assise comme un premier exemple de quelqu’un qui a découvert en lui-même la connexion universelle de la création. Il nous fait part d’un apport de Sherri Mitchell sur la sagesse de s’accorder dans l’harmonie de la réalité.
« Chaque chose vivante a son propre chant de la création, son propre langage et sa propre histoire. En vue de vivre harmonieusement avec le reste de la création, nous devons vouloir écouter et respecter toutes les harmonies en mouvement autour de nous ». C’est faire appel à tous nos sens pour envisager le monde. « Quand nous vivons comme des êtres disposant de plusieurs sens, nous découvrons que nous sommes capables de comprendre le langage de chaque chose vivante. Nous entendons la voix des arbres et nous comprenons le bourdonnement des abeilles. Alors nous commençons à réaliser que c’est la substance inter-tissée de ces rythmes flottants qui nous tient dans un équilibre délicat avec toute vie. Alors notre vie et notre place dans la création commencent à faire sens d’une manière complètement nouvelle.
Sherri Mitchell nous raconte ensuite une expérience de cet ordre.
Dans une chaude journée d’été, dans un état méditatif, elle a remarqué le minuscule rampement d’une fourmi près d’un brin d’herbe.
« Comme j’observais la fourmi en train de bouger, son petit corps a commencé à s’illuminer. Puis le brin d’herbe sur lequel il marchait s’est lui aussi éclairé. Comme j’étais là et j’observais, tout l’endroit qui m’entourait a commencé à s’éclairer. J’étais assise, m’émerveillant tranquillement devant cette vue nouvelle, sans bouger de peur de la perdre. Pendant que j’étais assise là, respirant avec le monde autour de moi, les fermes lignes de mon être ont commencé à s’estomper. Je me suis sentie en expansion et en train de me fondre avec tout ce que j’observais. Soudain, il n’y avait plus de séparation entre moi, la fourmi, l’herbe, les arbres et les oiseaux. Nous respirions avec la même respiration. J’étais envahie par ce sens de parenté tellement beau et complet avec toute la création… ».
Sentir la nature
Richard Rohr nous convie à expérimenter une vie en pleine nature.
A l’exemple de François d’Assise, il a lui-même vécu quelques moments d’ermitage dans la nature. Il raconte comment il a découvert ce qui se passait chez les animaux et dans les arbres. Combien nous perdons lorsque nous sommes coupés de la nature… « Mes temps d’ermitage m’ont resitué dans l’univers de Dieu, dans la providence et dans le plan de Dieu. J’ai eu le sentiment d’être réaligné avec ce qui est. J’appartenais et donc j’étais sauvé… »
« Quand nous sommes en paix et que nous ne y opposons pas, quand nous ne sommes pas en train de fixer et de contrôler le monde, quand nous ne sommes pas remplis de colère, tout ce que nous pouvons faire est de commencer à aimer et pardonner. Rien d’autre ne fait sens lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Il n’y a rien qui vaille de retenir parce qu’il n’y a rien d’autre dont nous ayons besoin. Je pense que c’est dans cet espace de liberté que le réalignement advient. François vivait un tel alignement… ».
Les cercles sacrés
Richard Rohr voit la Trinité comme un « cercle de danse » d’amour et de communion mutuelle. « Ceux d’entre nous qui ont grandi avec la notion trinitaire de Dieu communément répandue, voient la réalité consciemment ou inconsciemment, comme un univers en forme de pyramide, avec Dieu au sommet d’un triangle et tout le reste en dessous. Mais c’est exactement ce que la Trinité n’est pas. Les premiers Pères de l’Eglise disaient que la métaphore la plus proche pour envisager Dieu, c’était un cercle de danse de communion. Ce n’était pas une situation hiérarchique, monarchique ou une pyramide.
Richard Rohr cite alors Randy Woodley, un théologien d’origine Cherokee (tribu indienne). « Notre modèle de la relation à toute chose est un simple symbole utilisé par les autochtones américains : le cercle. L’harmonie dans le genre de vie est souvent entendue en terme symbolique de cercle ou de cerceau ». Rassemblons-nous… faisons un cercle… Le cercle n’a ni début, ni fin et on peut y entrer n’importe où et n’importe quand. « Quand nous nous rassemblons dans un cercle, la prière a déjà commencé… Nous nous rassemblons l’un avec l’autre et avec le Grand Mystère même sans qu’un mot ait été dit ».
Randy Woodley nous introduit dans le symbolisme pour les peuples autochtones et pour la terre elle-même.
« Dans presque toutes les tribus autochtones d’Amérique du Nord, le cercle ou le cerceau est considéré comme un symbole de la vie. Ce symbole est une puissante représentation de la terre, de la vie, des saisons, des cycles de maturité etc… ».
Une prière centrée sur la création
« La nature spirituelle de la Création a toujours été là depuis le Big Bang… L’Esprit et la matière ont été un depuis que Dieu a décidé de se manifester ».
« Le Christ est partout. La planète entière est ointe et messianique. Tout porte le mystère du Christ… Quand nous apprenons cela, nous sommes en communion. ». Nous sommes en communion lorsque nous allons à l’église… Nous sommes en communion dans la pause de la salle de bain. Nous sommes en communion quand nous sommes dans la nature.
Richard Rohr convie une sœur franciscaine, José Hobday à s‘exprimer. Elle écrit comment elle a appris à « prier sans cesse » à partir de la spiritualité autochtone de sa mère qui honorait le sens d’être en communion, en harmonie constante, d’être avec Dieu en toutes choses. « Ma mère priait comme une américaine autochtone. Cela signifie qu’elle se voyait priant en vivant et vivant en priant. Elle essayait de prier sa vie. Elle exprimait, par exemple sa prière de gratitude dans la manière dont elle faisait les choses : Quand vous remuez les flacons d’avoine, faites le lentement de manière à ne pas oublier que les flacons d’avoine sont un don et qu’il ne faut pas les prendre pour acquis. Elle faisait les choses en priant. Elle priait même en marchant… Elle m’enseignait à marcher doucement sur la terre parce que la terre est notre mère. Quand nous marchons, disait-elle, nous devrions être prêts à entrer dans chaque mouvement de beauté que nous rencontrons ».
Qu’est-ce que Richard Rohr a appris de la spiritualité américaine autochtone ? « D’abord à faire que ma prière soit centrée sur la création. Les indiens prient comme étant en famille avec la création. Dans notre prière, nous pourrions penser aux créatures… et à leur relation avec la création. C’est ce que les américains autochtones ont fait. Cela ne les a pas seulement gardés en contact avec la création, mais aussi bien avec le Créateur.
Révérer la création et le Créateur
Pour Richard Rohr et la tradition franciscaine, l’incarnation est au cœur d’une spiritualité affirmant la création. Nous rencontrons Dieu dans la création parce que nous rencontrons Dieu partout. Au lieu d’être une barrière à la vie spirituelle, la création est une porte. Les gens qui vivent en relation profonde et harmonieuse avec la nature ont toujours su cela. Richard Rohr a trouvé, dans ses conversations avec des anciens autochtones, une perspective sur la nature de la réalité qui commence avec un éclairage sur la nature du Créateur. Et il cite à ce sujet, un verset de l’épitre aux romains (1. 19-20) : « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages… ». « L’Ecriture est cohérente avec la vision du monde indigène que la nature du Créateur est visible dans la création. Qu’est- ce que la création nous dit de la nature de Dieu ? Les peuples indigènes ont été accusés d’animisme, c’est à dire d’adorer la création plutôt que le Créateur. Mais, en réalité, le fondement de la spiritualité indigène, c’est la révérence… La révérence, c’est un profond respect. Le Créateur est évident dans la création qui nous entoure. Je puis voir cela et en faire l’expérience avec mes sens… L’humilité, c’est reconnaître que je ne suis pas séparé de la création. Je fais partie du tissu de la vie. J’ai appris que cette dépendance mutuelle est un don. La vie est un don ».
J H
- Center for action and contemplation. Contemplating creation : https://cac.org/contemplating-creation-2021-10-10/
Voir aussi sur ce blog:
L’homme, la nature et Dieu : https://vivreetesperer.com/lhomme-la-nature-et-dieu/
Enlever le voile: https://vivreetesperer.com/enlever-le-voile/
La grande connexion : https://vivreetesperer.com/la-grande-connexion/
Et la présentation du livre de Richard Rohr: The divine dance:
https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/
https://vivreetesperer.com/reconnaitre-et-vivre-la-presence-dun-dieu-relationnel/
Éducation et spiritualité
L’enfant spirituel
Par Lisa Miller
 Comment envisageons-nous la spiritualité ? Qu’est-ce qu’une démarche spirituelle ? Comment la spiritualité peut-elle inspirer l’éducation ? Comment les parents peuvent-ils reconnaître les aspirations spirituelles de leurs enfants et de leurs adolescents et leurs mouvements en ce sens ? En quoi la vie spirituelle des enfants et des adolescents contribue à leur permettre d’accéder à une vie plus pleine et plus saine ? Est-ce que la recherche scientifique nous apporte des données sur cette réalité ? Et, très concrètement, dans ce domaine complexe, quel éclairage peut-on apporter aux parents pour qu’ils puissent comprendre l’importance de cette dimension et encourager leurs enfants et leurs adolescents ?
Comment envisageons-nous la spiritualité ? Qu’est-ce qu’une démarche spirituelle ? Comment la spiritualité peut-elle inspirer l’éducation ? Comment les parents peuvent-ils reconnaître les aspirations spirituelles de leurs enfants et de leurs adolescents et leurs mouvements en ce sens ? En quoi la vie spirituelle des enfants et des adolescents contribue à leur permettre d’accéder à une vie plus pleine et plus saine ? Est-ce que la recherche scientifique nous apporte des données sur cette réalité ? Et, très concrètement, dans ce domaine complexe, quel éclairage peut-on apporter aux parents pour qu’ils puissent comprendre l’importance de cette dimension et encourager leurs enfants et leurs adolescents ?
La chercheuse américaine en psychologie, Lisa Miller vient de publier un livre sur le cerveau éveillé : « The awakened brain » qui nous montre le rôle important de la spiritualité dans la vie des adultes et le fonctionnement du cerveau. Nous avons présenté cet ouvrage (1). Mais quelques années auparavant, en 2105, Lisa Miller avait publié un autre livre sur l’enfant spirituel : « The spiritual child. The new science on parenting for health and lifelong striving » (2). Le sous-titre précise l’intention de l’ouvrage. Il n’expose pas seulement la nature spirituelle de l’enfant. Il apporte une vision nouvelle à même d’éclairer les parents en les conseillant dans leurs pratiques d’éducation. Nous présentons ici brièvement cet ouvrage dont la richesse exigerait une très longue description. Nous pourrons donc y revenir par la suite.
Qu’est ce que la spiritualité ?
Comme les manifestations de la spiritualité sont l’objet des recherches de Lisa Miller, celle-ci a été amenée à définir ce qu’elle entendait par spiritualité. « La recherche montre une claire différence entre la stricte adhésion à une religion particulière et une spiritualité personnelle. Cette spiritualité personnelle est entendue comme « un sens intérieur d’une relation vivante avec une puissance supérieure (Dieu, la nature, l’esprit, l’univers, ou , quelque soit le mot, une force de vie ultime, aimante, et guidante » (p 6-7). Dans une autre recherche menée en Angleterre et rapportée dans un livre : « Something there » (3), David Hay, accompagné par Rebecca Nye, était arrivé à la définition suivante : une « conscience relationnelle ». « Les analyses de conversations avec les enfants montraient comme ils se sentaient reliés à la nature, aux autres personnes, à eux-mêmes et à Dieu ».
Lisa Miller précise ainsi sa pensée : « Tandis que les religions organisées peuvent effectivement jouer un rôle dans le développement spirituel, le moteur premier qui suscite la spiritualité naturelle, est une faculté innée, biologique et en développement : d’abord une faculté innée pour une connection transcendante, puis un élan de développement pour rendre sienne cette connection, et, en conséquence, une relation personnelle profonde avec le transcendant à travers la nature, Dieu, ou la force universelle » (p 9).
Une recherche scientifique
Lisa Miller se présente comme psychologue clinique, directrice de la clinique de psychologie clinique de l’université Columbia. Dans son laboratoire, elle a conduit de multiples recherches et publié de nombreux articles validés scientifiquement sur le développement spirituel des enfants, des adolescents et des familles (p 1). Devenue une personnalité majeure dans le champ en pleine expansion du rapport entre psychologie, spiritualité et santé mentale, elle a joué un rôle pionnier dans ce domaine. En effet, il y a deux décennies, comme chercheuse centrée sur la spiritualité et la santé, elle rencontrait un énorme scepticisme et un véritable rejet. « Au début du XXIè siècle, dans les sciences sociales et médicales, il existait encore une forte opposition envers la recherche sur la spiritualité et la religion, de fait, des concepts distincts dans mon esprit » (p 2) . Cependant, des recherches ont ouvert la voie et ce fut une avancée décisive à travers « la compréhension de la science du cerveau et les découvertes de l’imagerie cérébrale, de longs entretiens avec des centaines d’enfants et de parents, des études de cas, et un riche matériel d’anecdotes » (p 2). Lisa Miller énonce les grandes idées nouvelles qui s’imposent aujourd’hui dans la psychologie : la psychologie positive, l’intelligence émotionnelle.. Et elle y ajoute la reconnaissance scientifique d’une faculté humaine : la spiritualité naturelle qui concerne tout particulièrement l’éducation familiale.
Reconnaître la spiritualité des enfants
Lisa Miller parcourt le pays à la rencontre des parents pour les entretenir de sa recherche. Elle nous raconte combien de nombreux parents lui parlent alors de leurs enfants : « des enfants qui prennent soin de leurs frères et sœurs plus petits ou de leurs grands-parents, qui parlent aux animaux ou chantent en prière ». « Les enfants sont si spirituels », me disent-ils (p 1). Souvent, dans des moments de crise familiale, des enfants font preuve de sagesse et de compréhension. Comme chercheuse scientifique, je sais que la spiritualité de l’enfance est une vérité puissante qui est irréfutable et cependant étrangement absente de la culture dominante ». « Que les enfants soient « si spirituels », n’est pas simplement une anecdote ou une opinion, que ce soit la mienne ou celle d’un autre. C’est un fait scientifique établi » (p 2).
La spiritualité, une faculté naturelle des enfants
« Biologiquement, nous sommes cablés pour une connection spirituelle. Le développement spirituel est pour notre espèce, un impératif biologique et psychologique depuis la naissance. L’harmonisation spirituelle innée des jeunes enfants, à la différence d’autres lignes de développement comme le langage et la cognition, commence entière et est mise en forme par la nature pour préparer l’enfance en vue des décennies à venir, y compris le passage critique de l’adolescence » (p 3). Lisa Miller décrit ensuite l’évolution du jeune enfant. « Dans la première décennie de sa vie, l’enfant avance à travers un processus d’intégration de sa « connaissance » spirituelle avec ses autres capacités en développement cognitif, physique, social, émotionnel, tous ces développements étant modelés à travers des interactions avec les parents, la famille, les pairs et la communauté » (p 3-4). Cependant, « si l’enfant manque de soutien et d’encouragement pour développer cette part de lui-même, son branchement spirituel s’érode et en vient à se désagréger sous la pression d’une culture strictement matérielle » (p 4).
Convergence avec la recherche de Rebecca Nye sur la spiritualité des enfants
En 2009, une chercheuse anglais, Rebecca Nye a publié un livre : « Children’s spirituality. What it is and why it matters » (4) rapportant les conclusions de ses recherches avec David Hay. Rebecca Nye décrit ainsi la spiritualité des enfants : « La spiritualité des enfants est une capacité initialement naturelle pour une conscience de ce qui est sacré dans les expériences de vie…. Dans l’enfance, la spiritualité porte particulièrement sur le fait d’être en relation, de répondre à un appel, de se relier à plus que moi seul, c’est à dire aux autres, à Dieu, à la création ou à un profond sens de l’être intérieur (inner sense of being). Cette rencontre avec la transcendance peut advenir dans des moments ou des expériences spécifiques aussi bien qu’à travers une activité imaginative ou réflexive ».
La recherche de Rebecca Nye converge avec celle de Lisa Miller : « la spiritualité des enfants est plus naturelle qu’apprise. Peut-être, le terrain le plus fertile pour la spiritualité se situe dans l’enfance. La spiritualité de l’enfance se répercute sur l’âge adulte. La spiritualité est profondément relationnelle… ».
La spiritualité, un guide pour l’adolescence
Un développement harmonieux de la spiritualité de l’enfant va lui permettre de mieux affronter les difficultés de l’adolescence. « La conscience du développement spirituel crée des opportunités pour préparer les jeunes à un important travail intérieur d’intériorisation qui est nécessaire pour une individualisation, le développement de l’identité, une résilience émotionnelle… et des relations saines. La spiritualité est un principe majeur d’organisation de la vie intérieure dans la seconde décennie de la vie, poussant les jeunes vers un âge adulte porteur de sens, de projet, de conscience, d’accomplissement » (p 3). En même temps que les changements physiques et émotionnels en cours dans l’adolescence, on y observe le surgissement d’un éveil spirituel. Quelles réponses les adultes apportent aux jeunes en ce domaine ? On sait par ailleurs les effets protecteurs d’une spiritualité harmonieuse par rapport à la dépression, aux conduites à risque et aux drogues.
Une vision nouvelle
Bien évidemment, cette présentation du livre de Lisa Miller n’est qu’une première esquisse . Dans ce livre de plus de 300 pages, Lisa Miller nous entraine dans la connaissance de ses découvertes révolutionnaires qui appellent un ajustement ou un changement de notre regard sur l’enfance et sur l’adolescence et, en conséquence, les exigences de celles-ci pour l’éducation parentale. En convergence avec les recherches engagées en Angleterre par David Hay et Rebecca Nye, Lisa Miller nous entraine dans la découverte de la spiritualité comme une faculté naturelle dont la prise en compte est particulièrement cruciale pour l’enfance et pour l’adolescence. C’est une vision nouvelle dont nous savons bien qu’elle doit encore se frayer un chemin, notamment en France. Cette vision nous concerne tous. « Nous pouvons laisser nos enfants nous toucher, nous changer en nous rappelant qui nous sommes réellement. En tant que société, nous pouvons développer notre spiritualité collective en sachant que c’est vraiment une réalité importante. En étant ouvert à ces idées, ces valeurs et en étant conscient de la manière dont nous les vivons, nous pouvons changer notre monde. Cela commence avec chaque enfant et son droit de naissance : l’enfant spirituel » (p 348). C’est « une culture de l’amour ». Ensemble, nous pouvons créer « une culture inspirée » (p 348).
J H
- Lisa Miller. The awakened brain. Random House, 2021 . Présentation : https://vivreetesperer.com/the-awakened-brain/
- Lisa Miller. The spiritual child. The new science on parenting for health and lifelong thriving. St Martin’s Press, 2015. 374p
- David Hay. Something there. The biology of the human spirit. Longman, Darton and Todd, 2006. Présentation : « La vie spirituelle comme une conscience relationnelle. Une recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui » : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
- Rebecca Nye. Children’s spirituality. What it is and why it matters. Church House publishing, 2009. Ce livre a été traduit et publié en français : Rebecca Nye. La spiritualité de l’enfant Empreinte, 2015. Présentation : L’enfant. Un être spirituel : https://vivreetesperer.com/lenfant-un-etre-spirituel/
Libérée d’une emprise religieuse
Avec Diana Butler Bass, auteure du livre : « Freing Jesus » (Libérer Jésus)
Peut-être avons nous vécu un moment, et, en tout cas, pouvons nous l’imaginer, un enfermement religieux ou idéologique ? Peut-être aujourd’hui même ressentons-nous une insatisfaction dans une situation où nous ne trouvons pas à l’aise, mais dont nous ne savons pas comment sortir parce que nous sommes attachés à des idées reçues ? Il est bon alors de pouvoir nous rendre compte qu’il y a d’autres situations d’enfermement, et, en regard, des processus de libération.
Bien sur, les contextes sociaux et culturels sont très différents. Ici, nous présentons un exemple issu du livre de Diana Butler Bass : « Freing Jésus » : Libérer Jésus (1). Dans le contexte américain, dans certains milieux, il y a, on le sait, des pulsions religieuses avec toutes leur conséquences psychologiques et théologiques. A travers son livre, Diana Butler Bass nous montre combien le visage et le message de Jésus peuvent être défigurés. Alors, regardant sa vie et son parcours, Diana partage « dans sa prose la plus intime et la plus incisive, comment son expérience de Jésus a changé à travers les années, en le voyant, à différents moments, comme ami, enseignant, sauveur, seigneur, voie (way) et présence » (page de couverture). C’est un guide pour embrasser tous « les prismes de la nature de Jésus et renouveler notre espérance en lui ».
Naturellement, l’expérience de Diana Butler Bass s’inscrit dans une culture différente de la notre, mais ce livre nous aide à mieux approcher la personne de Jésus à travers l’expérience et la théologie. Cependant, nous avons choisi ici un angle de vue particulier, car, principalement dans le chapitre : la voie, Diana Butler Bass nous raconte comment, dans sa jeunesse, elle a été soumise à une emprise religieuse mortifère et comment elle en est sortie.
Une enfance et une adolescence contrastée
Le livre de Diana Butler Bass prend appui sur son histoire de vie. Et celle-ci s’enracine dans une enfance et une adolescence contrastée. Ainsi elle raconte une enfance heureuse et pieuse dans un environnement méthodiste. Dans cette église, pas de fondamentalisme. Jésus est présenté comme un « enseignant modèle » (p 57). L’accent est mis sur « la règle d’or, le commandement de l’amour, les paraboles, le Nouveau Testament ».
Cependant, quand elle a treize ans, en 1972, sa famille déménage quittant le Maryland pour l’Arizona. C’est un grand dépaysement. Les églises sont très diverses. Les parents de Diana s’éloignent de la pratique religieuse. Elle éprouve un besoin de sécurité. Ainsi, peu à peu, elle rejoint une église évangélique. C’est une nouvelle mentalité qui s’impose. « Dans le cercle des jeunes évangéliques, Jésus n’était plus un tendre ami ou un enseignant moral, il était leur Sauveur et le Sauveur du monde, celui qui les récompenserait par le ciel et punirait tous ceux qui ne croient pas en lui. Il était mort sur la croix pour les purifier de leurs péchés, pour prendre leur place quand Dieu jugerait justement les pécheurs. Ils lui faisaient confiance. Ils croyaient en lui. Ils mettaient leur vie entre ses mains. Et ils seraient avec lui pour toujours dans le ciel, échappant au néant éternel » (p 49). Dans cette église, la clé de tout était le péché. « Cette église aimait parler du péché, s’inquiéter du péché, lutter contre le péché, confesser le péché et pardonner le péché » (p 80). Certes, Diana était réticente à confesser ses péchés, car elle n’en percevait pas l’importance. Ce qui était important pour elle, c’était son désarroi : « Disloquée, séparée de tout ce qu’elle connaissait et aimait, coupée de ses racines… » (p 75), Diana trouva dans ce nouvel entourage et ce nouveau message, la sécurité dont elle avait besoin. « Perdue, trouvée, sauvée, je passais d’une adolescence triste et solitaire, d’un foyer manquant, à une condition nouvelle : être une fille de Jésus (« A Jesus girl ») (p 78). A partir de ces années d’adolescence, Diana va ensuite s’engager dans des études supérieures, au collège d’abord, puis à l’université.
Inclusion ou exclusion
A la sortie du collège, Diana va s’engager dans des études théologiques. « Le but était d’obtenir un diplôme en théologie et en histoire et ensuite de chercher un poste d’enseignante dans une école chrétienne outre mer ». Elle est donc entrée au séminaire théologique de Gordon-Conwell au nord de Boston. Et « c’est là que j’ai commencé à me sentir perdue » (p 171). Dans son chapitre sur « la voie » (way), Diana nous décrit comment elle est tombée dans une ambiance mortifère, et puis comment elle est parvenue à échapper à cette emprise.
Elle commente d’abord le verset : « Je suis la voie, la vérité, la vie » (Jean 14.6) (2). A travers le Nouveau Testament, Jésus invite les gens à le suivre, à entreprendre un voyage (a journey) avec lui. Et là, il va plus loin puisqu’il se dit le chemin, la route vers la libération. Cependant, dans certains milieux, l’accent est déplacé sur le passage suivant : « Nul ne vient au Père que par moi ». Ce verset est interprété par certains comme une parole d’exclusion vis à vis de ceux qui n’adhérent pas au Christ aveuglément. Alors comme le dit Diana, « Le chemin n’est pas un chemin du tout. C’est un chemin dedans (in). L’autre chemin au dehors (out), c’est l’enfer » (p 106). Et ensuite, Diana nous explique comment éviter le piège de l’enfermement. Ce verset doit être entendu en termes relationnels et en aboutissement des quatre précédents chapitres de cet évangile où Jésus prépare ses amis à son départ. C’est l’expérience de la relation avec Jésus qui va les garder.
Ce début de chapitre nous introduit ainsi à la mentalité d’exclusion telle qu’elle va être décrite dans la suite du chapitre. Cette mentalité va être de plus en plus ressentie par Diana comme un enfermement au point que cela va se répercuter jusque dans sa santé.
Une emprise mortifère
Dans le séminaire fréquentée par Diana, il y avait deux groupes : le premier ouvert au changement dans la culture américaine et se posant des questions nouvelles, le second inquiet de cette menace de sécularisation et redoutant une compromission avec le péché. Tous étaient cultivés, mais, pour le second groupe, les véritables héros étaient des théologiens protestants du XIXè siècle et des penseurs du Sud qui, avant la guerre civile, défendaient l’esclavage » (p 173). Les deux groupes s’opposaient, mais finalement, les réformés calvinistes orthodoxes ont pris le dessus (p 173). Durant ces années, il y a plus généralement, un remontée conservatrice.
A l’époque, on pouvait s’y méprendre. Il pouvait y avoir « quelque chose d’exaltant à faire partie d’une nouvelle réforme pour faire revenir le christianisme occidental à son grand âge de foi et de vérité théologique » (p 174). « J’avais obtenu des résultats brillants au séminaire et je disparaissais dans l’ordre et dans l’orthodoxie en trouvant mon rôle comme une femme théologiquement conservatrice dans un monde d’autorités mâles ».
Diana nous décrit le climat dominant. « C’est l’enseignement d’une orthodoxie vigoureusement calviniste ». On ne nous enseignait « pas seulement la soumission et les hiérarchies, mais nous étions formatés en ce sens si nous désirions des emplois »… Finalement, la tonalité principale était une vision de plus en plus sombre de l’humanité. Les humains étaient considérés comme de misérables pécheurs. Il y avait désormais « un fossé entre la dépravation de l’humanité et la sainteté divine » (p 182). Le culte devenait un exercice « de réaffirmer le péché et d’implorer le pardon. J’entendais un sermon doctrinalement correct et on chantait des cantique à un Dieu tout puissant daignant vous sauver ». « Je m’effondrais dans l’obscurité, intellectuellement convaincue que l’humanité était mauvaise, tombée si bas qu’il ne restait plus rien de bien en nous, entièrement dépendant d’un Dieu qui pouvait, dans sa sagesse, choisir de sauver quelques uns parmi lesquels je priais ave ferveur de figurer » (p 181). Diana avait épousé un homme baignant dans cette orthodoxie presbytérienne (p 180). Mais au bout de quelques mois de mariage, elle s’est sentie misérable. Ce mariage ne dura pas plus de trois ans.
Un profond malaise
Diana étouffait. Une mémoire remontait à l’encontre de la théologie dominante. Elle se souvenait des derniers mots d’Anne Franck : « En dépit de tout, je crois que les gens sont bons au fond » (p 181). Et elle avait toujours envisagé la vie chrétienne comme un voyage. (« journey »). Ainsi elle se souvenait du livre de Louisa Mary Alcott : « Little women », un plaidoyer pour que les filles comprennent leur vie comme « un voyage vers la bonté et vers Dieu ». Elle avait lu ensuite de nombreux livres envisageant la vie comme un voyage spirituel.
Oui, mais aujourd’hui, « plus ma doctrine se resserrait, plus mon cœur se sentait contraint » (p 182). Diana était constamment déprimée. « La petite fille dans les bois, qui avait connu Jésus comme ami, avait été domestiquée par des dogmes et règles imposés de l’extérieur et renforcés par ses propres peurs « (p 186).
Un chemin de libération
Finalement dans ses études, Diana a opté pour l’histoire de l’église. Elle percevait les historiens comme plus sages et iréniques. C’était une voie plus sure. « Il ne m’était pas venu à l’esprit qu’étudier le passé pourrait bouleverser le présent ». En écoutant une historienne, elle a découvert l’extraordinaire diversité du christianisme dans l’empire romain. Cette diversité théologique lui enseignait un nouveau regard au delà de « vrai et de faux » (p 196). L’histoire lui apprenait comment les doctrines s’étaient formées et le rôle du pouvoir politique dans l’histoire de ces doctrines. Cet enseignement permettait à Diana de déconstruire une « certitude théologique ».
Diana a pu reconnaître alors que la voie de Jésus était l’amour. « Le christianisme n’est pas une série d’enseignement, mais un chemin de vie « a way of life ». L’amour de Dieu est toujours présent, toujours actif. Rentrant en Californie, après ses études universitaires, le mouvement de libération s’est poursuivi. Ayant un poste d’enseignement, Diana a accepté de donner un cours sur la théologie féministe dans un collège évangélique. Cela l’a amené à des nouvelles lectures. Cet enseignement a été comme un déclic. « Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté ». (Corinthiens 3.17).
Un vécu de crise et une vie nouvelle.
Ainsi, Diana a connu une crise sévère. « Elle se sentait si malheureuse, allant son chemin sans plus d’espoir. Elle ne pouvait plus manger. Elle avait perdu trente livres » (p 193). Elle s’était beaucoup interrogée. Comment en était-elle arrivée là ? Oui, en parlant avec un conseiller, elle s’était dit enfermée dans une prison, dans une cage (p 161). Et ce conseiller l’avait interpellé « Oui, peut être avez vous construit une case, mais qu’est-ce qui vous y retient ? Sortez en. La porte est ouverte » (p 164). Une prise de conscience s’était effectuée. « J’avais intériorisé une sombre histoire de l’humanité, me jugeant ainsi sans valeur et indigne d’être aimée » (p 204). Cette image négative de l’histoire du monde s’était associée à des évènements malheureux et à une dépréciation de la condition féminine.
Diana a été conduite par une recherche spirituelle. « Le péché comme échec de l’amour, cela faisait sens pour moi. Jésus est venu ouvrir une voie d’amour. Cela m’aidait à comprendre que je n’étais pas réellement sans valeur » (p 207). Diana raconte comment elle a peu à peu émergé. « Lentement, mois après mois, j’ai avancé, sauvée par les choses les plus inattendues ». Citant Norman Wirba : « Le désir de l’amour est toujours que toutes les créatures soient bien et atteignent la plénitude de leur être… C’est pourquoi quand les créatures sont blessées, l’amour s’active pour leur apporter la guérison » (p 211). En regard de ce qui est mort, quelque chose de nouveau arrive à l’existence. « La résurrection commença à être réelle » (p 211). « Si le grain de blé tombé en terre, ne meurt après qu’on l’y a jeté, il demeure seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits » (Jean 12.24). L’activité de Diana reprit. Elle se mit à écrire, trouva une église qui prenait au sérieux l’amour de Dieu pour guérir et renouveler le monde. Elle lut de nouveaux livres et trouva de nouveaux amis. « J’étais libre. Et plus, je sortais de la cage, plus je savais que Jésus était avec moi ». En février 1996, elle rencontra, en pleine affinité, un homme avec lequel elle s’est marié, onze mois plus tard. « Le chemin se fait en marchant ». « Quelque soit ce qui s’était conjugué pour créer ma cage, j’ai choisi différemment. J’ai perdu beaucoup. J’ai gagné davantage. Et Jésus était avec moi. Le chemin nous a amené ici » (p 214).
Cette histoire d’emprise, puis de libération, n’est qu’une facette du livre : « Freing Jesus ». L’image de Jésus est souvent déformée par des interprétations sociales et religieuses. « Libérer Jésus » est un service bienvenu. Certes, dans un contexte culturel particulier, elle allie une expérience personnelle, une inspiration spirituelle, un savoir théologique et historique et un talent d’écrivain.
Si nous avons choisi de n’en retenir qu’un aspect, la manière dont on peut être entrainé dans une emprise religieuse, puis en être libéré, c’est parce que ce récit nous aide à comprendre et ainsi aider ceux qui y sont confrontés. Ce phénomène d’emprise peut se manifester dans différents domaines de la religion et de la politique. Il prospère dans des situations d’insécurité (3) où telle idéologie apparaît comme un refuge. Il apparaît, bien sur, dans les « dérives sectaires ».
Ce récit montre comment des certitudes peuvent déboucher sur un univers mental qui vous sépare du monde extérieur et vous enferme. Pour faire face à l’emprise, si les émotions jouent un rôle majeur, il faut prendre en compte les idées auxquelles les gens adhèrent et répondre à leurs questionnements souvent inavoués et souterrains. C’est à travers une évolution des idées et des représentations qu’un chemin de libération peut s’ouvrir. Diana se sentait mal à l’aise. Elle disposait d’une ressource intérieure, celle de sa mémoire d’un autre vécu. Elle a trouvé une ouverture dans la réflexion historique. Elle a été aidée par des accompagnements.
Certaines croyances sont directement mortifères. On le voit dans ce récit. S’attacher à la perception du mal engendre le mal. Le remède, c’est l’amour comme Jésus nous y invite. L’amour libère des exclusions et des séparations. « Le chemin de Jésus est le chemin de l’amour », écrit Diana Butler Bass.
J H
- Diana Butler Bass. Freing Jesus. Rediscovering Jesus as Friend, Teacher, Saviour, Lord and Presence. Harper One, 2021
- Ce verset : « Je suis la voie, le vérité et la vie » porte une libération spirituelle. Comme le montre Monique Hébrard, il résonne chez beaucoup de nos contemporains : https://www.la-croix.com/Archives/1995-10-11/Je-suis-la-voie-la-verite-la-vie-_NP_-1995-10-11-398498
- L’insécurité abrite également le ressentiment qui se traduit par des enfermements et des emprises. Le livre De Cynthia Fleury : « Ci-git l’amer », nous éclaire à ce sujet : https://vivreetesperer.com/face-au-ressentiment-un-mal-individuel-et-collectif-aujourdhui-repandu/
Diana Butler Bass est l’auteur de plusieurs livres innovants et éclairants sur l’évolution du christianisme et la recherche spirituelle aujourd’hui.
Voir ici :
Une nouvelle manière de croire. Selon Diana Butler Bass dans son livre : Grounded : https://vivreetesperer.com/une-nouvelle-maniere-de-croire/
Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-dieu-present-dieu-avec-nous-dans-un-univers-interrelationnel-holistique-anime/
The Awakened Brain
Comment une pratique spirituelle fait barrage à la dépression, apparaît positivement dans l’activité du cerveau et engendre une vie pleine

Il arrive qu’un long cheminement personnel et intellectuel débouche sur la publication d’un livre qui ouvre un nouvel horizon. Ce livre résulte d’un nouveau regard. Il récapitule une recherche de longue haleine et il débouche sur des conclusions qui renouvellent notre entendement. Ainsi vient de paraître aux Etats-Unis un livre qui ouvre un nouvel horizon pour la psychothérapie et qui, en même temps nous appelle à une nouvelle manière de voir et de vivre. Il met en évidence l’importance de la spiritualité dans la reconnaissance de ses apports. C’est un livre qui se fonde sur une approche scientifique rigoureuse, en particulier des recherches portant sur le fonctionnement du cerveau. Le titre rend compte de l’ambition de la démarche : « The awakened brain. The new science of spirituality and our quest for an inspired life » (Le cerveau éveillé. La nouvelle science de la spiritualité et la quête d’une vie inspirée) (1).
« Le livre de Lisa Miller révèle que les humains sont universellement équipés d’une capacité pour la spiritualité et qu’en résultat, nos cerveaux deviennent plus robustes et plus résilients. Le « Awakened brain » combine une science en pointe (de « l’imagerie par résonance magnétique » à l’épidémiologie) à une application sur le terrain pour des gens de tous les âges et de tous les genres de vie, en éclairant la science surprenante de la spiritualité et comment mettre celle-ci en œuvre dans nos propres vies » (page de couverture).
Ce livre est le fruit d’un parcours scientifique de longue haleine. Lisa Miller est professeur de psychologie clinique à l’Université Columbia et travaille dans le département de psychiatrie de cette université.
Un parcours de vie. Un itinéraire professionnel
Dans ce livre, Lisa Miller nous entretient à la fois de son parcours de vie et de son itinéraire professionnel. Il y a là en effet un mouvement commun de prise de conscience de la dimension spirituelle.
Etudiante, Lisa a rencontré Phil en 1985. Ils se sont mariés et ils ont vécu dans leur milieu. En l’absence d’une naissance d’enfant, ils ont adopté un petit garçon en Russie. Et finalement, des naissances de deux petites filles sont advenues. Dans cet itinéraire, ils ont quitté le milieu urbain pour vivre à la campagne. Ce parcours témoigne de choix de vie qui ponctuent une évolution spirituelle.
Et, de même Lisa nous raconte son entrée au travail en 1994 et ses premières années de pratique professionnelle comme psychologue dans une clinique psychiatrique attachée à un hôpital new-yorkais. Cette clinique n’était pas retardataire et elle alliait médicaments et psychothérapie. « Notre modèle de traitement psychologique était essentiellement psychodynamique. Nous avions été entrainés à aider nos patients à fouiller dans leur passé pour une conscience et un éclairage permettant d’alléger leurs souffrances présentes… La voie pour sortir de la souffrance était d’y faire face en gagnant en compétence. C’était explorer les souvenirs pénibles et les expériences difficiles pour gagner en conscience » (p 13-14). Les limites de cette approche sont rapidement apparues à Lisa. De fait, les patients étaient amenés à se répéter et ils tournaient souvent en rond. Lisa a commencé à leur poser des questions nouvelles qui ne portaient pas seulement sur leur passé, mais sur leur présent. Et elle a perçu, chez certains, un besoin de reconnaissance. Souvent le psychologue garde une distance. « Le modèle thérapeutique peut aider à améliorer le contrôle des impulsions, mais il n’attire pas toujours, ni ne guide le meilleur et authentique soi-même du patient. Il m’est apparu que la guérison ne pouvait arriver à distance et que l’attention personnelle et la relation devaient faire partie du processus. Aussi, je différais avec un programme strictement psychanalytique » (p 17-18).
Un jour, dans une réunion, un patient demanda : « A-t-on prévu quelque chose pour célébrer le Yom Kippour ? ». Le Yom Kippour est la fête juive du pardon. On pouvait voir dans cette demande une recherche de sens. Dans ce quartier de New York, la clinique recevait de nombreuses personnes juives. Et il y en avait également dans le personnel. Lisa elle-même a une ascendance juive. Or la réponse fut négative comme si cela était hors de propos. En s’appuyant sur sa mémoire personnelle, Lisa prit alors l’initiative d’organiser une célébration avec quelques patients concernés. Et là elle constata chez eux de grands changements dans leurs comportements. « Les patients s’animèrent spectaculairement tandis que la célébration progressait, leurs yeux brillant comme ils lisaient et chantaient » (p 31). « Il y eut des expressions de foi. La salle paraissait fraiche et purifiée. Et ceux d’entre nous autour de la table, nous nous sentions plus connectés les uns aux autres et à quelque chose de plus grand » (p 32). Ces changements de comportement allaient-ils se poursuivre ? Or Lisa a constaté qu’il y avait bien une transformation profonde. « Non seulement ces patients paraissaient élevés (uplifted) par la cérémonie, mais chacun paraissait plus connecté et restauré à l’endroit même où ils étaient habituellement séparés ou enfermés » (p 33). Cette célébration avait été une initiative personnelle de Lisa. Elle chercha donc à mieux comprendre ce qui s’était exactement passé. Elle s’en entretint avec la collègue qui la supervisait. Celle-ci écouta et sa réponse fut décevante. « Le fond du problème, c’est que ces patients sont très malades. Nous sommes dans un hôpital ». « Son implication était claire. La spiritualité était extérieure à notre profession. J’avais dérogé à une règle non écrite et je m’étais discréditée en participant à un système de croyance qui n’était pas en lien avec la rigueur médicale. La conversation était terminée » (p 34).
Cependant, la question du sens habitait Lisa qui gardait mémoire d’une brève période de sa première jeunesse où elle avait frôlé la dépression. En travaillant par la suite dans une clinique destinée à des étudiants, elle s’interrogea à nouveau. Elle se rendait compte qu’une petite minorité seulement avait besoin d’un traitement psychiatrique. « Les autres étaient déprimés, mais leurs problèmes étaient davantage existentiels » (p 42). « Ce qu’ils éprouvaient, c’était plutôt de la tristesse et de la désorientation accompagnées de questions sur le sens et le but de la vie » (p 42). A 19 ans, Lisa s’était posé aussi ces questions. Elle se demandait si Dieu existait et quelle était sa raison de vivre. « Est-ce que l’amour est possible ? Est-ce que je retrouverai la joie ? » (p 42). Elle entreprit de suivre des consultations psychiatriques. Mais, à chaque fois, elle se sentait plus déprimée. Les psychologues lui posaient des questions sur ce qui avait pu l’affecter dans son enfance. « Mes questions n’étaient pas considérées comme des questions valides montrant une croissance authentique et un désir ardent de connaître la nature du monde » (p 43). Les psychologues « cherchaient des blessures d’enfance » et elle, recherchait un sens à la vie. On aurait pu lui poser la question : Est-ce qu’il y a une part de vous qui a ressenti profondément une réponse ? Est-ce qu’il y a un moment dans le passé où vous avez accéder à une connaissance intérieure ? Mais rien ne vint et elle perdit pied. Quand l’été vint et qu’elle rencontra Phil , son futur mari, elle revint à la vie.
Après ces premières années de pratique professionnelle, en 1995, elle reçut une bourse pour une recherche durant trois ans. Désormais, elle pouvait étudier sans contrainte. Dès lors, elle a pu prendre en compte le questionnement sur la question du sens dont on a vu comment elle s’était développée à la fois personnellement et professionnellement. Au contact avec les réalités de terrain, Lisa s’était de plus en plus interrogée sur les enfermements induits par certaines approches. Elle a pu exploiter les données d’une collègue pour y découvrir quelques configurations dans les facteurs en mesure d’atténuer la dépression. Ainsi elle va essayer d’établir des corrélations entre certaines variables. A cette occasion, elle a donc cherché quelles variables qu’elle pourrait prendre en compte pour envisager le rapport entre la dépression et l’expérience spirituelle. Elle a découvert deux questions qui pouvaient s’appliquer à cette étude. Ainsi « La religion ou la spiritualité sont-elles importantes pour vous personnellement ? ». Une rencontre incita Lisa à s’interroger sur la transmission intergénérationnelle de la spiritualité. Elle travailla donc en ce sens sur ces données et elle put mettre en évidence un lien important. « Il y a cinq fois moins de chance pour un enfant de tomber en dépression lorsqu’il partage une vie spirituelle avec sa mère » (p 52). Cet effet de protection était impressionnant. Lisa a donc publié un article relatant les résultats de sa recherche.
La réception par ses collègues psychologues fut mitigée. Mais, quelques mois plus tard en 1997, un autre article parut, lui aussi avançant dans la reconnaissance d’un lien entre santé mentale et spiritualité. Cet article du Docteur Kenneth Kendler, personnalité éminente en psychiatrie épidémiologie était intitulé : « Religion, psychopathologie et usage de drogue… ». L’auteur distinguait clairement spiritualité personnelle et stricte adhésion à une règle religieuse. Parfois, les deux allaient de pair, mais ce n’était pas le cas pour la majorité. « La recherche du docteur Kendler était la première étude empirique mettant en évidence cette importante distinction entre les gens qui peuvent être spirituels en étant ou pas religieux, et ceux religieux en étant ou pas spirituels » (p 56). Et par ailleurs, cette recherche montrait qu’un bas niveau de symptômes dépressifs était associé à un haut niveau de spiritualité. Au total, une religiosité personnelle jouait un rôle protecteur par rapport à différentes formes d’évènements stressants de la vie (p 57).
« Cette nouvelle recherche a ouvert la possibilité que juste comme nous sommes des êtres cognitifs, physiques, émotionnels, nous sommes des êtres spirituels… Cette recherche révolutionnaire a suggéré que la spiritualité n’est pas juste une croyance, mais quelque chose avec lequel chacun de nous est né avec la capacité d’en faire l’expérience » (p 58).
The awakened brain (Le cerveau éveillé) : une découverte révolutionnaire.
Au cours des années suivantes, la quête personnelle et professionnelle de Lisa Miller s’est poursuivie. Et une quinzaine d’années après sa première recherche, en 2012, un nouveau projet de recherche a abouti en apportant des conclusions spectaculaires.
Lisa Miller nous raconte cet épisode Au départ, elle nous rappelle le contexte. « Nous vivons à une époque d’anxiété mentale sans précédent » (p 4). Alors Lisa attendait beaucoup de cette recherche. « La spiritualité pouvait-elle jouer un rôle dans la prévention et la protection à l’encontre de la dépression ? » (p 3). Cependant, même autour d’elle, parmi ses proches collègues, le scepticisme l’emportait. Alors on attendait avec impatience les données provenant de l’imagerie à résonnance magnétique. La recherche portait sur des gens à haut ou bas risque génétique de dépression pour voir si il y avait une configuration particulière dans les structures du cerveau des participants déprimés ou non déprimés en vue d’envisager des traitements plus efficaces (p 6). Lisa avait ajouté une question controversée : « Nous avons demandé aux participants de répondre à la question : La religion ou la spiritualité sont-elles importantes pour vous ? ». « En plus de comparer les structures de cerveau de participants déprimés et non déprimés, nous désirions savoir comment la spiritualité était associée à la structure du cerveau et comment elle était corrélée avec le risque de dépression » (p 6).
C’était un grand enjeu, or les résultats qui sont apparus, étaient convaincants et sans appel. Il y avait un différence éclatante entre le cerveau associé à une faible spiritualité et le cerveau associée à une spiritualité élevée. « Le cerveau haute spiritualité était plus sain et plus robuste que le cerveau basse spiritualité. Et le cerveau haute spiritualité était plus fort et plus épais exactement dans les mêmes régions qui s’affaiblissaient dans le cerveau déprimé » (p 7).
Devant ces résultats inattendus, les collègues étaient stupéfaits. La quête persévérante de Lisa était récompensée.
The awakened brain : Le cerveau éveillé
C’est à partir de cette découverte que Lisa peut nous expliquer ce qu’est « le cerveau éveillé » (awakened brain) et comment
il se comporte. « Chacun de nous est doté d’une capacité naturelle de percevoir une réalité plus grande et de se connecter consciemment à la force de vie qui se meut à l’intérieur de nous, à travers nous et autour de nous »… » (p 8). Notre cerveau a une inclination naturelle pour accueillir une conscience spirituelle. Quand nous accueillons cette conscience spirituelle, nous nous sentons davantage en plénitude et à l’aise dans le monde. Nous entrons en relation et prenons des décisions à partir d’une vision plus large. « Nous passons de la solitude et de l’isolement à la connexion, de la compétition et de la division à la compassion et à l’altruisme, d’une focalisation sur nos blessures, nos problèmes et nos pertes à une grande attention pour notre voyage de vie » (p 8). D’un modèle d’identité en pièces et en morceaux, nous en venons à cultiver un genre de vie qui se fonde sur l’amour et la connexion.
Qu’est ce que la spiritualité ? Lisa Miller nous dit qu’elle ne s’est pas engagée dans cette recherche pour étudier la spiritualité, mais parce qu’elle y a été poussée par le désir de comprendre la résilience des humains et de les y aider. Peu à peu, à partir de ses expériences cliniques et de ses recherches, elle a découvert combien la spiritualité était une composante vitale de la guérison. Lisa Miller énonce des expériences qui évoquent la spiritualité : un moment de connexion profonde ave un autre être ou dans la nature, un sentiment d’émerveillement, de respect, de transcendance, une expérience de synchronicité, un moment où vous vous êtes senti inspiré ou sauvé par quelque chose de plus grand que vous (p 8).
Lisa Miller précise qu’elle est une scientifique et non pas une théologienne. C’est aussi une psychologue qui œuvre pour la santé mentale. « Quand nous faisons un plein usage de la manière dont nous sommes construits, nos cerveaux deviennent plus sains et plus connectés. et nous en tirons des bénéfices insurpassables… » (p 9). Mais, au delà de la santé mentale, le « cerveau éveillé » apporte un nouveau paradigme pour notre manière d’être, de nous diriger de nous relier, qui peut nous aider à agir avec une plus grande clarté et capacité face aux défis actuels auxquels l’humanité est confrontée.
Le cerveau éveillé est accessible à chacun d’entre nous, ici dans nos circuits neuronaux. Mais il nous revient de choisir de l’activer. On peut comparer cette situation à un muscle que nous pouvons fortifier ou bien le laisser s’atrophier (p 9). « Chacun d’entre nous a la capacité de développer pleinement son potentiel inné à travers une capacité d’amour, d’interconnexion et d’appréciation du déroulement de la vie. Au delà de la croyance, au delà du récit cognitif que nous nous disons à nous-même, le cerveau éveillé est la lunette intérieure à travers laquelle nous avons accès à la réalité la plus vraie, que notre vie est sacrée, que nous ne marchons jamais seul » . « Nos cerveaux sont branchés pour percevoir et recevoir ce qui élève, illumine et guérit » (p 10).
Etats d’être et fonctionnement du cerveau
Après cette découverte, Lisa Miller a engagé des recherches sur la manière dont les états d’être se manifestaient dans le fonctionnement du cerveau et comment ce fonctionnement pouvait avoir des conséquences à son tour. Ainsi a-t-on demandé à tous les participants d’exprimer oralement trois expériences personnelles, respectivement à un moment stressant, un moment relaxant et une expérience spirituelle tandis qu’ils étaient en même temps examinés au scanner (p 156). A partir de là, Lisa Mller expose les différents fonctionnements observés. A nouveau s’affirme l’originalité du fonctionnement en fonction de l’expérience spirituelle. « Les moments d’expérience spirituelle étaient biologiquement identiques qu’ils aient ou non un caractère explicitement religieux, qu’ils adviennent dans une maison de prière ou dans la cathédrale de la nature. Ils avaient le même niveau d’intensité ressentie et les mêmes chemins d’activation… Cela prouve que chacun d’entre nous a une part spirituelle du cerveau qui peut s’engager n’importe où et à n’importe quel moment » (p162).
Lisa Miller en arrive ainsi à distinguer deux processus différents d’activation de la conscience : « achieving awareness » (une conscience de réalisation) et « awakened awareness » (une conscience éveillée) (p 163-166). « Les études utilisant l’imagerie à résonance magnétique mettent en lumière que nous avons deux modes de conscience à notre disposition à tous moments : la conscience de réalisation et la conscience éveillée. C’est à nous de savoir dans laquelle nous voulons nous engager » (p 163).
La conscience de réalisation est la perception que nous avons d’organiser et de contrôler nos vies. Quand nous vivons à travers notre conscience de réalisation, le souci fondamental est : « Comment puis-je obtenir et garder ce que je désire » (p 163). Ce mode de conscience est utile et souvent nécessaire. Il nous donne une attention focalisée et souvent nécessaire pour atteindre des buts et nous permet de diriger notre attention et notre énergie sur une tâche particulière. Cependant quand la conscience de réalisation est sur-employée ou exclusivement employée, elle déborde et change la structure de nos cerveaux, entrainant des pathologies de dépression, d’anxiété et de stress.
D’autre part, « si nous poursuivons notre vie avec seulement la conscience de réalisation, nous sommes souvent frustrés et blessés lorsque les choses ne tournent pas aussi bien qu’elles sont planifiées et espérées » (p 164). Nous pouvons également ressentir de l’isolement et verser dans la rumination. Si nous vivons uniquement dans la conscience de réalisation, nous développons un sens excessif du contrôle. « Nous tombons dans une manière d’être solitaire et intrinsèquement vide ». La perception d’un vide nous amène à en vouloir plus.
Quand nous nous engageons dans la conscience éveillée, nous utilisons des parties différentes de notre cerveau et littéralement « nous voyons plus », intégrant de l’information de sources multiples.
La conscience éveillée nous permet de voir davantage de choses et d’opportunités. Nous ne nous agrippons pas à un but.
« Nous comprenons que la vie est une force dynamique avec laquelle nous pouvons nous harmoniser et interagir » « Ce n’est plus moi contre le monde, mais moi entendant ce que la vie a à me dire » (p 165). « Je m’appuie sur le flot de la vie, attentif aux portes qui s’ouvrent et qui se ferment ». « Je deviens attentif aux évènements significatifs. Nous inscrivant dans le courant de la vie, nous ressentons que nous ne sommes pas vraiment seuls ».
Cependant, nous avons également besoin de la conscience de réalisation pour la mise en œuvre de nos projets. Mais les décisions les plus importantes ne peuvent être prises à partir de la seule conscience de réalisation. Nous ne pouvons percevoir la réalité correctement que si nous allions les deux consciences. Ainsi, écrit Lise Miller, si la conscience éveillée nous est ainsi indispensable, elle nous est également accessible, car c’est un choix que nous pouvons faire. « La conscience éveillée est un choix que nous pouvons faire à chaque moment, un choix de la manière de percevoir le monde et nous-même ». (p 166). Au total, écrit Lisa Miller, l’intégration des deux modes de conscience est nécessaire. Et elle part ici de son exemple personnel : « Mes voyages pour trouver Isaiah, mon fils adoptif et la découverte du cerveau éveillé ont requis à la fois la conscience de réalisation et la conscience éveillée » (p 167). « Une interaction créative, dynamique entre la conscience de réalisation et la conscience éveillée ont changé mon chemin » (p 167).
Dans les derniers chapitres du livre, Lisa Muller nous décrit la manière dont le cerveau se manifeste dans « une attention éveillée », « une connexion éveillée » et « un cœur éveillé »… des textes riches en aperçus et en exemples.
Ce livre nous apporte une vision nouvelle. C’est une contribution essentielle. « Quand nous vivons avec un cerveau éveillé, en utilisant le mode de réalisation et le mode éveillé, en équilibre, nous utilisons la plénitude de ce que nous sommes et la manière dont nous sommes branchés pour percevoir. Le cerveau éveillé est fondateur dans la connaissance humaine et l’histoire. L’appel à la conscience éveillée se manifeste à travers les différentes religions et les traditions éthiques. à travers les arts et la musique, à travers les actions humanitaires et l’altruisme. Le cerveau éveillé est le siège de la perception de la transcendance et de l’immanence. Le cerveau éveillé ouvre notre sensibilité au ressenti d’une présence qui nous guide et à la sacralité dans la vie quotidienne » (p 242). Et, bien sûr, cette prise de conscience a un impact sur la société.
Une nouvelle perspective
Dans ce livre : « The awakened brain », Lisa Miller nous ouvre un nouvel horizon tant dans le domaine de la santé mentale que dans notre manière d’envisager la vie. Ce livre magistral est, en même temps, le récit d’une découverte scientifique révolutionnaire et un témoignage qui nous apporte un nouveau regard sur la vie. Nous accueillons cette vision innovante dans une approche théologique qui nous permet de reconnaître la présence de Dieu avec nous et en nous. « Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient » (2). C’est le titre d’un article exprimant les approches convergentes de Jürgen Moltmann et de Diana Butler Bass. « Dieu, le créateur du Ciel et de la Terre est présent par son Esprit cosmique dans chacune de ses créatures et dans leur communauté créée » écrit le théologien Jürgen Moltmann. Et Diana Butler Bass, historienne et théologienne américaine écrit : « Ce glissement d’un Dieu vertical vers un Dieu qui se trouve à travers la nature et la communauté humaine est le cœur de la révolution spirituelle qui nous environne ». La disposition spirituelle de Lisa Miller peut également être accueillie dans l’approche du théologien franciscain américain, fondateur et animateur d’un Centre pour l’action et la méditation, Richard Rohr. Dans son livre, « la Danse divine », Richard Rohr écrit : « Dieu est celui que nous avons nommé Trinité, le flux (« flow ») qui passe à travers toute chose sans exception et qui fait cela depuis le début… Toute implication vitale, toute force orientée vers le futur, toute pensée d’amour, tout élan vers la beauté, tout ce qui tend vers la vérité, tout émerveillement devant une expression de bonté, tout bond d’élan vital comme diraient les français, tout bout d’ambition pour l’humanité et la terre, est éternellement un flux du Dieu Trinitaire ». Voici une invitation à être « paisiblement joyeux et coopératif avec la générosité divine qui connecte tout à tout ».
« Le don de Dieu trinitaire et l’expérience pratique, ressentie, de recevoir ce don, nous offre une reconnexion bien fondée avec Dieu, nous même, les autres et le monde ».
Dans l’horizon ouvert par ces théologiens (4), nous aimons relire la conclusion de Lisa Miller : « Nous pouvons nous éveiller à la vraie trame du monde, une tapisserie en évolution que nous pouvons à la fois contempler et aider à la création, dans laquelle chaque fil importe et aucun brin n’est seul. Nous pouvons vivre dans l’isolement ou nous pouvons nous éveiller à une connaissance commune, à une communication avec tous les êtres vivants et à un alignement profond et ressenti avec la source de la conscience » (p 242).
J H
- Lisa Miller. The awakened brain. The science of spirituality and our quest for an inspired life. Random House, 2021 Lisa Miller est également l’auteur du livre: The spiritual child. A new science on parenting for health and lifelong thriving
- Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient : https://vivreetesperer.com/?s=dieu+vivant%2C+Dieu&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
- La Danse divine (The Divine dance) par Richard Rohr : https://vivreetesperer.com/?s=danse+divine&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
- En dehors des théologiens, voir aussi la contribution de chercheurs sur la spiritualité : Une vie pleine de sens, c’est une vie qui a du sens (Emily Esfahani Smith) https://vivreetesperer.com/une-vie-pleine-cest-une-vie-qui-a-du-sens/ La vie spirituelle comme une conscience relationnelle. Une recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
Tout se tient
 Relions-nous ! : un livre et un mouvement de pensée
Relions-nous ! : un livre et un mouvement de pensée
Les temps modernes se caractérisent par l’émancipation et l’autonomie de l’individu. Mais aujourd’hui, on ressent également les excès de l’individualisme. C’est ainsi qu’on appelle à plus de convivialité et plus de fraternité (1). Et de même, on prend conscience des méfaits de la domination de l’homme sur la nature à la suite de l’affirmation cartésienne. L’homme s’est extrait de la nature pour la dominer. Cette séparation produit aujourd’hui des fruits amers. Elle s’inscrit dans le développement d’une civilisation mécaniste. Mais aujourd’hui apparaît un mouvement en faveur d’un changement de paradigme. Face à une approche purement analytique qui débouche, en fin de compte sur un éclatement et un compartimentage des savoirs, une approche holistique se développe et on cherche actuellement une intégration dans la reconnaissance des interrelations. C’est l’avènement de l’écologie. Il y a aujourd’hui une nouvelle manière de connaître bien mise en évidence par de grands penseurs comme Michel Serres (2) et Edgar Morin (3). C’est la prise en compte de la complexité (3). Aujourd’hui, face au malaise engendré par la division, la séparation dans la vie sociale comme dans la vie intellectuelle, des mouvements se dessinent pour une nouvelle reliance. Ainsi un livre vient de paraître avec un titre significatif : « Relions nous ! » (4).
Ce livre se présente ainsi :
« Nous vivons une vraie crise de la représentation et donc une crise politique. Nous continuons à interpréter le monde selon des concepts dépassés… Aujourd’hui, le cœur des savoirs n’est plus la séparabilité, mais à l’inverse, les liens, les interdépendances, les cohabitations.
Cinquante des plus éminents philosophes, scientifiques, économistes, historiens, anthropologues, médecins, juristes, écrivains… chacun dans leur domaine, éclairent magistralement cette transition à l’œuvre et émettent des propositions pour mieux la conforter ou l’émanciper. Cette constitution dessine, à la lumière des liens, un nouveau paysage de la pensée et donc, d’une certaine manière, un nouveau corps politique… » (page de couverture).
En transition vers une nouvelle vision du monde
Cofondateurs des éditions : « Les liens qui libèrent », Henri Trubert et Sophie Marinopoulos, dans le prologue de cet ouvrage, nous disent comment ils envisagent le changement profond qui est en voie de transformer notre vision du monde et de susciter l’émergence d’un nouveau paradigme : « Nous continuons à penser le monde selon des conceptions dépassées issues des temps modernes. Aujourd’hui, le cœur des savoirs, son mouvement infus n’est plus la séparabilité et ses différents attributs : séparation homme/nature, homme considéré comme maitre et possesseur de lui-même ; les diverses notions de propriété, temps linéaire, objectivité, chosification, causalité locale, identité, déterminisme, verticalité… ainsi que leurs conséquences sociales et politiques, à savoir l’imaginaire du progrès infini, l’économisme, le réductionnisme, le rationalisme, l’individualisme, le productivisme… Ce serait plutôt l’interdépendance ou mieux la transdépendance (chaque domaine étant lui-même traversé par un dehors) (p7-8). En termes plus accessibles, les auteurs décrivent ainsi la transition : « Nous passons d’une société constituée d’objets distincts gouvernés par des forces extérieures à une société de relations, de compositions ou d’interactions » (p 8). Ce mouvement ne date pas d’hier. « Il est un long processus, mais qui n’a pas encore réellement infusé notre société… autant que nos manières d’éprouver et d’habiter le monde » (p 8).
Un milieu émergent
Comment le courant de pensée qui a pris conscience de la nécessité de cette transition se manifeste-t-il aujourd’hui ?
Ce recueil de textes s’accompagne d’une initiative de rencontre entre les participants. Les propositions des uns et des autres pour une nouvelle civilisation sont appelées à se présenter dans un « parlement » pour faire une « constitution des liens ». « La « constitution des liens »… a pour ambition de partager un nouveau paysage… » « Il s’agit d’ouvrir un nouvel horizon »… « Cette constitution est une matière vive à délibérer, amender ou enrichir… Il est urgent collectivement d’expérimenter, de faire vivre cette transition qui touche à la fois nos savoirs, mais également nos perceptions et nos émotions » (p 9). Il y a aussi un effort de diffusion vers le grand public. Début juin 2021, les participants ont été appelés à participer à une conversation au Centre Beaubourg.
Les auteurs de ce recueil sont cofondateurs des éditions : Les liens que libèrent. Ce mouvement s’inscrit dans l’orientation engagée de longue date par cette maison d’édition telle qu’elle se présente sur son site (5) : « La maison d’édition LLL, Les Liens qui Libèrent, créée en association avec Actes Sud, se propose d’interroger la question de la crise des liens dans les sociétés occidentales. Depuis la fin du XIXè siècle, les liens sont reconnus constitutifs de toute expression de la réalité. Toute entité ou système se construit, se développe, se diversifie par les interactions qu’il entretient avec son milieu… Que ce soit en biologie… en physique… en psychologie… en ethnologie, dans les domaines de l’économie, sociaux… ou bien entendu environnementaux. Or nos sociétés occidentales sont marquées du sceau de la déliaison… C’est cette véritable crise de la déliaison de nos sociétés que nous nous efforcerons de questionner… ». Si nous envisageons différemment les auteurs de catalogue des éditions LLB, nous apprécions particulièrement les livres de deux d’entre eux : Jérémy Rifkin (6) et Pablo Servigne (7).
Des intervenants nombreux et bienvenus
Ce livre aborde un champ très vaste puisqu’il traite de plus de trente domaines de savoir. On passe de l’agriculture à l’architecture, de l’art à la biologie, de la croissance et du bien être à la démocratie, de l’éducation à la langue et aux médias. Rien n’échappe à cette table des matières où apparaissent le monde végétal et le monde animal, les sciences du vivant, les neurosciences et la physique quantique, l’économie, la santé mais aussi la religion…
Parmi les intervenants, on découvre des personnalité reconnues comme Patrick Viveret, acteur pour le développement de la convivialité, Pablo Servigne, auteur d’un livre pionnier sur l’entraide (7), Philippe Meirieu, réputé pour son œuvre en éducation, Baptiste Morizot, inventeur d’une nouvelle manière de communiquer avec le monde animal, Delphine Horvilleur, une femme rabbin à la parole qui porte, Abdennour Bidar, connaisseur de l’Islam et artisan d’une spiritualité ouverte et relationnelle. Il y a au total 54 intervenants.
Les contributions sont courtes et denses et s’accompagnent de propositions. Pour certaines, elles s’expriment dans un vocabulaire spécialisé et requièrent un effort du lecteur. C’est une observation qui a été également formulée par un(e) des journalistes en discussion avec Abdennour Bidar dans un dialogue sur France Inter à propos d’un colloque organisé à Beaubourg sur ce livre (8). Au total, nous dit Abdennour Bidar, il y a là un effort pour mettre en dialogue les uns et les autres. Si les participants participent à une culture commune, il peut y avoir également des différends entre eux. Le but de la conversation est de « construire des désaccords » et de « trouver des terrains d’entente ». Comment développer une espérance commune ? Il nous faut « construire une manière commune de résister au risque de l’effondrement intérieur lorsqu’on ressent la menace d’un effondrement de civilisation ». Cet appel au dialogue est au cœur du chapitre écrit par Abdennour Bidar et Delphine Horvilleur sur la religion. Comment favoriser le dialogue entre athées, agnostiques, croyants ?
En regard de ce changement civilisationnel, une transformation spirituelle
Ce livre : « Relions-nous » témoigne d’une transformation profonde, intellectuelle et sociale. C’est un processus qui s’amplifie.
En regard, nous pouvons voir aussi une transformation spirituelle en cours aujourd’hui. Il y a dix ans déjà, dans son livre : « La guérison du monde » (2012) (9), Frédéric Lenoir évoquait une contestation de la vision « mécaniste » du monde, en faveur d’une vision « organique ». Et il observait une évolution dans les attitudes. « Si l’affirmation de l’individu est au cœur de la société moderne, il décrit trois phases successives dans la manifestation de l’autonomie : « L’individu émancipé, l’individu narcissique et l’individu global ». Dans cette troisième phase, un formidable besoin de sens se manifeste.
Cette montée de la spiritualité s’exprime en termes relationnels. Ainsi, au terme d’une remarquable enquête, dans son livre : « Something there » (10), David Hay définit la spiritualité, comme « une conscience relationnelle dans une relation avec soi-même, avec les autres , avec la nature et avec la présence divine ».
En regard, une théologie renouvelée
En regard de cette civilisation émergente, apparait une théologie émergente. La théologie pionnière de Jürgen Moltmann ouvre des horizons en phase avec cette civilisation émergente (11). Et justement, elle joue un rôle d’avant garde parce que elle relie les apports de traditions séparées et trop souvent étanches les unes aux autres. C’est le cas dans la théologie de l’espérance qui prend en compte la tradition juive du prophétisme ou la nouvelle théologie trinitaire et la théologie de la création qui accueille une dimension de la tradition orthodoxe (12). En affirmant sa veine écologique et l’œuvre de l’Esprit, Jürgen Moltmann associe sa voix à celles que nous venons d’entendre.
« La pensée moderne s’est développée en un processus d’objectivisation, d’analyse, de particularisation et de réduction. L’intérêt et les méthodes de cette pensée sont orientés vers la maitrise des objets et des états de chose. L’antique règle romaine de gouvernement : « Divide et impera » imprègne ainsi les méthodes modernes de domination de la nature… A l’opposé, certaines sciences modernes, notamment la physique nucléaire et la biologie, ont prouvé à présent que ces formes et méthodes de pensée ne rendent pas compte de la réalité et ne font plus guère progresser la connaissance. On comprend au contraire beaucoup mieux les objets et les états de chose quand on les perçoit dans leurs relations avec leur milieu et leur monde environnant… La perception intégrale est nécessairement moins précise que la connaissance fragmentaire, mais plus riche en relations… Si donc on veut comprendre le réel comme réel et le vivant comme vivant, on doit le connaître dans sa communauté originale et propre, dans ses relations, ses rapports, son entourage… Une pensée intégrante et totalisante s’oriente dans cette direction sociale vers la synthèse, d’abord multiple, puis enfin totale… » (13).
Cette approche relationnelle inspire la nouvelle théologie trinitaire. « Dans le passé, on pensait en terme de « substances » plutôt qu’en terme de relations. Dans le nouveau mode de pensée, la Trinité est envisagée en terme de relations et de mouvements… Le renouveau de la pensée trinitaire s’inscrit dans une inspiration profondément biblique et en continuité avec les premiers siècles de l’Eglise… Les personnes divines habitent l’une dans l’autre. Dans cette interrelation, Dieu invite les êtres humains à entrer dans une unité ouverte… Dieu n’est pas un « Dieu solitaire qui soumet ses sujets comme des despotes terrestres l’on fait en son nom ». C’est un Dieu vivant, relationnel dans son être même et dans son rapport avec les créatures » (14).
Et de même, Dieu n’est pas un Dieu lointain qui a créé le monde une fois pour toute et le considère de l’extérieur… « Dieu n’est pas seulement le créateur du monde, mais l’Esprit de l’univers. Grace aux forces et aux possibilités de l’Esprit, le Créateur demeure auprès de ses créatures, les vivifient, les maintient dans l’existence et les mènent dans son royaume futur »… « L’Esprit saint suscite une communauté de la création dans laquelle toutes les créatures communiquent chacune à sa manière entre elles et avec Dieu » (15).
La même approche relationnelle apparaît chez d’autres théologiens présents sur ce site. Ainsi Richard Rohr, franciscain américain, a écrit un livre inspirant : « la Danse Divine » (16) en évocation du Dieu trinitaire. Rappelant qu’Aristote mettait la « substance » » tout en haut de l’échelle et que cette conception a influencé la théologie occidentale, Richard Rohr écrit : « Maintenant nous voyons bien que Dieu n’a pas besoin d’être une « substance », Dieu lui-même est relation… Comme la Trinité, nous vivons intrinsèquement dans la relation. Nous appelons cela l’amour. En dehors de cela, nous mourrons rapidement ».
Bertrand Vergely, philosophe de culture orthodoxe, appelle à la conscience de la Vie dans tout ce qu’elle requiert et entraine. « Quand on vit, il n’y a pas que nous qui vivons. Il y a la Vie qui vit en nous et nous veut vivant. Il y a quelque chose à la base de l’existence… Quand nous rentrons en nous-même, nous découvrons un moi profond porté par la vie avec un grand V » (17).
Aujourd’hui, dans cette nouvelle conscience relationnelle, monte une nouvelle manière de croire.
C’est ce qu’exprime une historienne et théologienne américaine, Diana Butler Bass : « Ce qui apparaît comme un déclin de la religion organisée, indique en réalité une transformation majeure dans la manière dont les gens se représentent Dieu et en font l’expérience. Du Dieu distant de la religion conventionnelle, on passe à un sens plus intime du sacré qui emplit le monde. Ce mouvement d’un Dieu vertical à un Dieu qui s’inscrit dans la nature et dans la communauté humaine, est au cœur de la révolution spirituelle qui nous environne » (18). Nous voyons des convergences entre la pensée de Diana Butler Bass et de Jürgen Moltmann que nous exprimons dans le titre d’un article : « Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient » (19).
La prise de conscience écologique requiert et suscite une nouvelle approche théologique où la relation est première, une écothéologie. A cet égard, l’œuvre de Michel Maxime Egger nous paraît particulièrement éclairante. Depuis la publication d’un livre fondateur : « La Terre comme soi-même » (Labor et Fides, 2012), Michel Maxime Egger poursuit son engagement comme auteur et militant, comme sociologue, théologien et acteur spirituel (20).
Comment ce changement dans les représentations se manifeste-t-il dans le vécu quotidien ? A ce sujet, le témoignage écrit par Odile Hassenforder en 2008 nous paraît particulièrement significatif : « Assez curieusement, ma foi en notre Dieu qui est puissance de vie s’est développée à travers la découverte de nouvelles approches scientifiques qui transforment notre représentation du monde. Dans une nouvelle perspective, j’ai compris que tout se relie à tout et que chaque chose influence l’ensemble. Tout se tient. Tout se relie. Pour moi, l’action de Dieu s’exerce dans ces interrelations. Dans cette représentation, Dieu reste le même, toujours présent, agissant à travers le temps. Je fais partie de l’univers. Je me sens reliée à toute la création. Alors, dans un tel contexte, je conçois facilement que Jésus- Christ ressuscité relie l’humanité comme l’univers au Dieu Trinitaire… » (21).
Voici un parcours qui nous a mené de la prise de conscience par un milieu d’experts, de l’importance des relations dans tous les domaines de la pensée, des sciences à la philosophie et dans toutes les pratiques humaines, de l’agriculture à l’éducation et à la santé, à un mouvement spirituel et théologique. « Relions nous ! » Cependant le recueil, qui porte ce titre, aborde la religion sous un angle particulier : favoriser le dialogue entre différents interlocuteurs. Et pourtant, il y a bien plus à dire. La prise de conscience des interrelations est un mouvement qui nous concerne tous jusque dans l’essentiel de nos vies. C’est un mouvement qui monte et s’amplifie dans le registre spirituel et dans le champ religieux. « Tout se tient. Tout se relie ». Relions-nous…
J H
(1) Appel à la fraternité : https://vivreetesperer.com/appel-a-la-fraternite/ Pour des oasis de fraternité : https://vivreetesperer.com/pour-des-oasis-de-fraternite/
(2) Michel Serres. Petite Poucette : https://vivreetesperer.com/une-nouvelle-maniere-detre-et-de-connaitre-3-vers-un-nouvel-usage-et-un-nouveau-visage-du-savoir/
(3) Convergences écologiques : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
(4) Relions nous. La constitution des liens. L’an1. Les liens qui libèrent, 2021
(5) Les liens qui libèrent : http://www.editionslesliensquiliberent.fr/unepage-presentation-presentation-1-1-0-1.html
(6) Vers une civilisation de l’empathie (Jérémie Rifkin) : https://www.temoins.com/vers-une-civilisation-de-lempathie-a-propos-du-livre-de-jeremie-rifkinapports-questionnements-et-enjeux/
Un avenir pour l’économie : La troisième civilisation industrielle (Jérémie Rifkin) : https://vivreetesperer.com/face-a-la-crise-un-avenir-pour-l’economie/
Le New Deal Vert (Jérémie Rifkin) : https://vivreetesperer.com/face-a-la-crise-un-avenir-pour-l’economie/
(7) L’entraide. L’autre loi de la jungle. Pablo Servigne : https://vivreetesperer.com/?s=Entraide&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
(8) Comment recréer du lien. Un grand face à face sur France inter : https://www.youtube.com/watch?v=E7_eZ-5QMys
(9) Frédéric Lenoir . La guérison du monde : https://vivreetesperer.com/un-chemin-de-guerison-pour-lhumanite-la-fin-dun-monde-laube-dune-renaissance/
(10) David Hay . Something there. La vie spirituelle comme une « conscience relationnelle » : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
(11) Une théologie pour notre temps. L’autobiographie de Jürgen Moltmann : https://www.temoins.com/une-theologie-pour-notre-temps-lautobiographie-de-juergen-moltmann/
(12) L’évolution de la théologie de Moltmann. Une théologie qui relie : D Lyle Dabney : The turn to pneumatology in the theology of Moltmann https://place.asburyseminary.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.fr/&httpsredir=1&article=1474&context=asburyjournal
(13) Voir : Convergences écologiques : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
(14) Dieu, communion d’amour : https://lire-moltmann.com/dieu-communion-damour/
(15) Dieu dans la création : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
(16) Richard Rohr. La danse divine. https://vivreetesperer.com/?s=La+danse+divine&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
(17) Bertrand Vergely Prier. Un philosophie https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-rencontrer-une-presence/
(18) Une nouvelle manière de croire : https://vivreetesperer.com/une-nouvelle-maniere-de-croire/
(19) Dieu vivant. Dieu présent. Dieu avec nous dans un monde où tout se tient : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-dieu-present-dieu-avec-nous-dans-un-univers-interrelationnel-holistique-anime/
(20) L’espérance en mouvement : https://vivreetesperer.com/lesperance-en-mouvement/
Un chemin spirituel vers un nouveau monde : https://vivreetesperer.com/un-chemin-spirituel-vers-un-nouveau-monde/
(21) Odile Hassenforder. Dieu, puissance de vie : https://vivreetesperer.com/dieu-puissance-de-vie/
La couronne et les virus
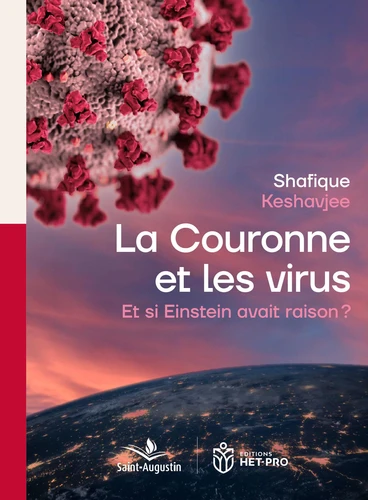 Un conte moderne à l’écoute des sagesses du monde
Un conte moderne à l’écoute des sagesses du monde
Ce livre interroge dès le départ par son titre : « La couronne et les virus » (1). Et puis on pressent que la couronne, c’est ce qui est précieux, ce qui est essentiel, ce qui est sacré face aux maux destructeurs engendrés par les virus. La signification se précise en cours de lecture, car l’auteur nous entraine dans le parcours d’une conversation entre des personnes certes fictives, mais qui nous apparaissent dans une consistance de vie. Cette conversation aborde de grandes questions que nous posons à propos de l’existence. Elles sont introduites par l’auteur au cours de cette conversation.
L’auteur de livre : « La couronne et les virus. Et si Einstein avait raison », Shafique Keshavjee a un parcours original. Originaire de l’Inde, il habite aujourd’hui en Suisse et a été professeur à l’Université de Genève. C’est un théologien chrétien, également spécialiste de l’histoire comparée des religions. Ses compétences se sont appliquées à l’écriture de ce livre. En effet, ce sont de grandes sagesses du monde qui sont appelées à répondre à des questions existentielles. Le fil conducteur de ce roman est le dialogue entre l’auteur et une jeune femme médecin chinoise habitant à Paris pendant l’épidémie, Li Ying et, au delà, par son intermédiaire, avec d’autres interlocuteurs représentatifs de courants religieux. Ainsi, sommes-nous introduits dans différentes visions spirituelles en écoutant ce qu’elles ont à nous dire. Cette conversation interculturelle et interreligieuse nous est présentée d’une manière attrayante avec une part de suspens et de rebonds, avec au cœur, une relation qui ne va pas de soi entre une belle jeune femme chinoise et un professeur avec l’expérience de l’âge.
Dans une interview vidéo (2), Shafique Keshavjee nous explique dans quel contexte il a écrit ce livre. Il était en recherche dans le souhait d’exprimer des réponses chrétiennes aux questions existentielles qui se posent aujourd’hui. La pandémie est arrivée. Quel sens cet événement peut-il avoir ? Shafique Kevhavjee a eu un rêve : « Une personne chinoise l’appelait : Et Dieu dans tout cela ? ». Déjà habitué à écrire en terme de fiction, l’imaginaire de Khavique s’est éveillé. A partir de la rencontre avec cette jeune et belle femme chinoise, d’autres personnages imaginaires sont apparus avec des apports substantiels. Dans ce contexte hors du commun, le langage se renouvelle. La Bible est le « Livre des Livres » et Jésus, le « Thérapeuthe des thérapeutes ». Dans la compréhension du langage hébraïque qui sous-tend l’écriture biblique, des clarifications et des éclairages apparaissent. Ainsi, ce livre sort des catégorisations habituelles, et, dans sa veine imaginative, il paraît heureusement accessible à des personnes en recherche. De par son style, de par sa forme, cet ouvrage ne se prête pas à l’écriture d’un compte-rendu linéaire Nous nous bornerons ici à en donner quelques aperçus.
La rencontre avec Li Ying
A la suite de son rêve où une personne chinoise l’appelait à l’aide : « Et Dieu dans tout cela ? », Shafique Keshavjee nous raconte une histoire, celle d’une correspondance par courriel qui s’ouvre entre lui et une jeune femme chinoise, Li Ying. Ce n’est pas sans méfiance que l’auteur réagit aux premiers courriels. Et puis le dialogue s’instaure. La jeune femme se présente comme issue d’une famille taoiste, mais ouverte à une recherche spirituelle plus vaste. « A coté du Tao-Te-King de Lao Tseu que je médite avec délectation, je m’intéresse à toutes les voies qu’elles soient spirituelles ou non. Depuis peu, et sur les conseils de mon cousin Wenliang donnés avant sa mort, je me suis mis à lire ce qu’il appelait le Livre des Livres… » (p 18). Dès lors, elle a commencé à recevoir des « intuitions fortes ». Une des plus centrales serait la suivante : « Seul le meilleur de l’Orient et de l’Occident guérira nos vies » (p 16). Le message que Li Ying adresse à l’auteur, que nous appellerons maintenant ici : le professeur, est surprenant :
« Appel du Vivant
Agapé, Beauté et Bonheur
Courage. Création en crise….
La couronne de Vie est pour les combattants des virus » (p 19).
Ces propos s’éclaireront par la suite.
Li Ying explique pourquoi son message commençait par une lettre hébraïque exprimant « le commencement du commencement » : l’Aleph. Li Ying voit dans l’Aleph « l’origine sans origine de Tout et de tous » (p 22). Son cousin Wenliang a été ébloui par la découverte suivante : « Le Tao, c’est l’Aleph et l’Aleph, c’est l’Agapé » (p 22). « Dans une de mes méditation, j’ai saisi que l’Agape peut être traduit par Affection. J’ai été saisie par cette réalité : « L’Agapé, c’est l’Affection dans l’Infection. C’est dans un monde infecté que l’Affection se rend visible… » (p 23).
Le professeur se dit quelque peu désabusé. En réponse, Li Ying évoque son expérience de l’Aleph : « Dans les traditions asiatiques, le point de départ de l’expérience, ce n’est pas d’abord les mots, ( même s’ils sont vraiment utiles), mais le corps personnel et social et le souffle ». Elle évoque une « chorégraphie intérieure » où le souffle est moteur et où elle décline successivement : amour, beauté et bonheur. « Cette méditation intérieure éveille tous mes sens et m’aide à repérer les petits éclats d’affection, de beauté et de bonheur tout autour de moi » (p 28). Pour li Ying, parmi les valeurs-réalités les plus fondamentales, « c’est la triade amour-beauté-bonheur qui est la plus essentielle » (p 29).
Le professeur apprécie, mais se dit attristé et fatigué. En réponse, on notera un éclaircissement apporté par Li Ying dans une référence à l’hébreu. « Un des mots pour beauté en hébreu est tov lequel peut être aussi traduit par bonté. La beauté est bonne et la bonté est belle. Encore faut-il les voir. Le Livre des Livres affirme que l’Aleph est à l’origine de la lumière. Et tout aussi important, il dit que la lumière est tov » (p 34). « Le regard bienveillant d’autrui nous permet peu à peu de croire et de voir le tov (beauté–bonté) en soi. Le monde irait tellement mieux si, en tous lieux, nous portions un regard bienveillant les uns sur les autres. Pour ceux qui acceptent la voie de la méditation ou de la prière, c’est le regard bienveillant d’Aleph sur soi qui permet de mettre en lumière, sans peur, nos propres laideurs. Il permet surtout de mettre en lumière nos propres beautés » (p 36-38).
Après plusieurs échanges fondateurs, la conversation s’est poursuivie en introduisant d’autres personnages.
Gamzou, une spiritualité juive
Li Ying introduit dans l conversation la présence de son voisin de palier, Gamzou. C’est l’époque où des personnes confinées commencent à se manifester en solidarité avec ceux qui luttent contre la pandémie. Certains s’expriment à partir de leurs balcons. « Un soir », écrit Li Ying, j’ai entendu quelqu’un qui écoutait de la musique. C’était une version orchestrale et rythmée de John Lennon : « Imagine » J’ai vu un homme qui dansait et qui riait. C’est ainsi que nous avons fait connaissance… » (p 45). Cet homme âgé était inspiré par une spiritualité juive, celle des Hassidim. « Les Hassidim sont mus par la mélodie de tout être dans la création de Dieu. Si cela les fait passer pour des fous pour ceux qui ont des oreilles moins sensibles, devraient-ils pour autant cesser de danser ? » (p 47). Le vieil homme a invité Li Ying à danser et ils ont dansé, chacun sur leur balcon. Gamzou lui a dit finalement : « N’oubliez pas la bonne humeur, Mademoiselle, quelque soient les terreurs ». Et il rajouta : « Tout a un sens » (p 48). Le professeur accueillit ce message, mais gravement objecta : « Ayant perdu un enfant, je n’ai plus envie de rire ». Gamzou, sollicité, répondit : « Lorsque je danse, ce n’est pas parce que je suis toujours heureux dans l’univers présent, mais parce que je me projette vers la joyeuse délivrance qui vient » (p 51).
En regard, comme le professeur, le lecteur, ressent l’abomination de la Schoah. Gamzou en éprouve la souffrance bien sur, mais il continue à penser : « Tout a un sens ». « Dans ce temps de chaos et de peur, le Créateur nous appelle et nous dit : partout où il y a une grande obscurité, il y a une opportunité pour une plus grande lumière » (p 58).
Et si Einstein avait raison ?
Gamzou est aussi en conversation avec Ruben, son fils qui habite Jérusalem. Celui-ci vient de découvrir « Yeshua comme Messie ». Cette nouvelle au départ a suscité un grand choc chez son père. Cependant, Li Ying est entré en contact avec Ruben. Ruben lui fit connaître la pensée d’Einstein, ce grand savant, de culture juive, mais qui ne croyait pas à un Dieu personnel. « L’argent pollue toute chose » a affirmé Einstein. Il n’a fait que répéter les enseignements de la Bible » (p 91). Et voici un autre écrit d’Einstein : « Si l’on sépare le judaïsme des prophètes et le christianisme tel qu’il fut enseigné par Jésus de tous les ajouts ultérieurs, en particulier ceux des prêtres, il subsiste une doctrine capable de guérir l’humanité de toutes les maladies sociales » (p 91). Cette découverte a ébloui Ruben. « Le meilleur du judaïsme et du christianisme , selon Einstein, serait capable de « guérir l’humanité de toutes les maladies sociales ». « Et si Einstein avait raison » C’est le sous titre donné au livre…
Alors, « Moi le juif, je me suis mis à l’école de Jeshua de Nazareth. Après un long cheminement, je suis arrivé à reconnaître que le Messie, c’est bien Jeshua » (p 92). Dans les remèdes à la crise, Ruben évoque l’humilité et la sanctification du sabbat, et sur un autre registre, une saine gestion des impôts.
Zineb : Une recherche de justesse et de liberté dans une culture musulmane
Li Ying introduit une de ses amies :Zineb dans le cercle de ses conversations avec le professeur.
Zineb, élevée dans une famille non pratiquante de culture musulmane, et passée par une étape de ferveur religieuse, mais elle a finalement découvert des failles doctrinales qui sont à l’origine de grandes violences . Certes, comme l’écrit Li Ying, « Zineb ne voit plus que le pôle Babylone sans percevoir le pôle Jérusalem. Or le Vivant fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et, dans toutes les cultures, des traces de sa présence peuvent être trouvées ». et Li Ying pose une question embarrassante : « Selon Djamila (nom original de Zineb), ce ne sont pas seulement des musulmans malades de haine qui seraient transmetteurs du « virus », alors que le texte sacré du Coran serait sain. Mais dans le Coran même, il y aurait des virus de haine. Et alors que des musulmans sains et lumineux y résisteraient, d’autres y succomberaient et les transmettraient autour d’eux. Comme tu connais bien les religions, voici ma question : Si il y a des Coranovirus, est-ce qu’il y a des Bibliovirus et des Talmudovirus » ? (p 125-126).
Zhen : Une manifestation du mal
Un jour, le professeur reçut un mail inhabituel de Li Ying. Ce mail l’invitait à une relation érotique ave son amie chinoise. Surpris, le professeur répondit négativement. La rupture fut évitée de justesse. Par un autre mail, Li Ying expliqua au professeur comment son frère Zhen, fauteur de zizanie, avait manipulé son ordinateur en son absence . Le professeur parvint à « douter de ses doutes » sur ce qui était arrivé. La conversation reprit et se poursuivit heureusement. Ainsi reçut-il de Li Ying un mail où elle reprenait l’enseignement de la Kabbale qui lui avait été transmis par son ami juif. « La Kabbale enseigne que quatre mondes sont imbriqués les uns dans les autres : le monde naturel, le monde humain, le monde angélique et le monde divin. A l’interface de ces quatre mondes, il y a des « états d’esprit ». Les « états d’esprit » sont façonnés à la fois par des « pulsions humaines » et par des impulsions spirituelles inspirées par des intelligences supra-naturelles vivifiantes ou mortifères. Cependant toutes ces intelligences surnaturelles restent soumises au monde du divin. Le monde du divin s’exprime diversement. La première manifestation du divin est Kether. La couronne, Kether est la volonté divine originale, source de tout délice et de tout plaisir » (p 140). Le professeur reçut cette vision avec enthousiasme. « Par Gamzou et Ruben, je saisis avec émerveillement que, selon la Kabbale, la première manifestation de l’Ultime réalité se nomme Kether : la Couronne. Et cette Couronne originelle est avant tout volonté de désir et de plaisir ». (p146-147).
Une multiplicité de virus
Tout au long de ce livre, la pandémie est constamment présente. Li Ying elle-même n’était-elle pas une femme médecin engagée contre la maladie dans un hôpital. Mais, à partir de là, voici que le débat s’élargit. La définition des virus est étendue à ce qui fait du mal à l’humanité. Li Ying ouvre cet horizon : « Cette vision d’une humanité infectée de nombreux virus ne m’a plus quitté. Mais quels sont-ils ? Il y a bien sûr le coronavirus. Mais quels sont les autres ? C’est alors que j’ai eu cette conviction. Pour soigner l’humanité, nous devons connaître tous les virus qui l’empoisonnent… Une voix intérieure me dit alors : « Le monde a beaucoup d’immunologues du corps, mais pas assez de l’âme et surtout de l’esprit » (p 69). Li Ying poursuit sa réflexion : « Virus vient du latin : « uirus » qui signifie poison. Un virus est un poison parasitaire. Si l’on accepte que l’être humain a trois dimensions distinctes et interdépendantes à savoir le corps, l’âme et l’esprit, il devient vital de s’intéresser non seulement aux virus qui détruisent le corps (la vie physiologique), mais à ceux qui détruisent l’âme (la vie psychologique) et l’esprit (la vie spirituelle) ». Cette approche recueillit l’assentiment du professeur. Ainsi il désigna en quelques mots les poisons qui lui paraissaient les plus courants : peur, convoitise, violence, suffisance. Et il écrit : « je me suis souvenu que le thérapeuthe des thérapeuthes (pour parler comme le cousin de Li Ying) avait enseigné que le cœur humain est le lieu principal des infections… C’est ce lieu qui doit être guéri en priorité » (p 76). A nouveau, dans la conversation, Li Ying rapporta un entretien avec Gamzou à propos d’un tir à l’arc. Ce n’est pas évident d’atteindre la cible. « Savez-vous quel est le virus le plus dangereux de l’humanité ? C’est ce que notre livre sacré nomme : « khattat » ce qui signifie : manquer la cible. En latin, il a été traduit par « peccatum », ce qui a donné en français : péché ». Le professeur se réjouit de ce message : « Gamzou et Li Ying n’avaient pas eu peur de dire que le virus le plus mortel pour l’humanité, c’est le « péché ». Mais leur compréhension était loin de celle si culpabilisante -et irrecevable- que les églises avaient transmises pendant des siècles » (p 83).
Mais qui est Li Ying ?
Dialogue au plus profond
Comme Li Ying se dit en contact avec beaucoup de personnalités dans le monde, le professeur s’interroge sur sa vraie nature. En réponse aux questions qu’il lui pose sur son identité véritable, Li Ying lui adresse une réponse surprenante : « Je suis la face la plus lumineuse de l’âme humaine » (p 172). Cela n’allait pas de soi. Serait-elle un aspect de l’âme du professeur ? Li Ying précisa : « Je suis la face la plus belle de l’âme humaine. Et pour ceux qui savent s’écouter, l’âme parle à l’âme » (p 173). Il y a ainsi des dialogue intérieurs dans la parole biblique : « Retourne mon âme à ton repos, car le Vivant t’a fait du bien ». « Tu étais fatigué et j’ai voulu te réchauffer . Quand dans nos vies tout est gris, il devient vital de distinguer la lumière de la nuit » (p 173). Ce roman s’achève par une parole que Li Ying adresse au professeur : « Je ne suis pas la lumière, mais la face lumineuse de l’âme qui appelle chacun à se tourner vers Celui qui dit : « Je suis la lumière du monde » » (p 182).
Un livre suggestif
Voici un roman qui se lit sans aucune lassitude dans le mouvement et la succession de mouvements et de moments très divers et une suite de suspens et de rebondissements. C’est une lecture où on prend son temps, car il y a de beaux éclairages qui appellent la réflexion et la méditation. Il y a là comme une promenade dans des paysages culturels différents. Certes, on est plus ou moins sensible et on n’adhère pas nécessairement. Mais l’auteur met en scène des réponses par rapport à des questions existentielles. Dans ce parcours interreligieux, on reçoit des éclairages nouveaux. Et si les personnages sont fictifs, ils paraissent tout à fait naturels. Cet ouvrage met en valeur le bon et le beau dont il nous est dit qu’il s’exprime dans le même mot hébraïque : tov. Alors il est réconfortant. A certains moments, on pourra apprécier cette parole de Li Ying : « Quand dans nos vies, tout est gris, il est vital de distinguer la lumière de la nuit » (p 173).
- Shafique Kevhavjee. La couronne et les virus. Et si Einstein avait raison. Saint-Augustin, éditions Het-Pro, 2021
- Interview vidéo de Shafique Kevhavjee sur son livre : La couronne et les virus : https://www.youtube.com/watch?v=wwgSdizDDC4
Une espérance fondatrice
 Comment envisager la vie dans une dynamique de l’espérance ?
Comment envisager la vie dans une dynamique de l’espérance ?
Dans une séquence sur la foi dans le monde d’aujourd’hui, Richard Rohr nous parle de l’espérance fondatrice. : « Fondational hope » (1). Elle s’inscrit dans l’amour de Dieu pour nous. « Le savant jésuite Teilhard de Chardin écrit que « l’amour est la structure physique de l’univers » . Notre manière de dire la même chose théologiquement est de rappeler que Dieu nous a fait à son image : « Let us create in our image » (Genèse 1 .26), dans l’image du Dieu triun, qui est amour, une source dynamique et renouvelée d’un flux infini et d’un accueil infini.
Nous pouvons également percevoir un sens. « Si Dieu est à la fois incarné et implanté, à la fois Christ et Esprit Saint, alors un dynamisme intérieur se déployant dans toute la création n’est pas seulement certain, mais il se meut dans une direction positive. Un objectif divin est toujours devant nous, attendant d’être dévoilé. Les forts souhaits de mort , les tueries de masse, les suicides et le montant élevé de conflit émotionnel que nous expérimentons aujourd’hui dans notre monde est surement pour une part, un résultat de notre échec majeur à apporter à notre civilisation occidentale une compréhension positive et pleine d’espérance de notre propre « bonne nouvelle ». Et la bonne nouvelle doit être sociale et cosmique, et pas seulement à mon sujet, à propos de « moi ».
En quoi avons- nous besoin d’espérance ? « Une espérance fondatrice demande une croyance fondatrice dans un monde qui se déploie encore et toujours vers quelque chose de meilleur. C’est la vertu de l’espérance. Personnellement j’ai trouvé qu’il était presque impossible de guérir des individus dans le long terme si l’arc cosmique entier n’était pas aussi une trajectoire vers le bien »
Il n’est pas toujours facile d’espérer. « Évidemment quelquefois, les souffrances et les injustice de notre époque rendent difficile de croire dans l’arc de l’amour. Steven Charleston, ancien de la tribu Chotaw et évêque de l’église épiscopale décrit en des termes pratiques comment cet amour et cette espérance fondatrice nous entoure sans cesse :
« Les signes sont tout autour de nous. Nous pouvons les voir surgir comme les fleurs sauvages après la pluie dans la prairie Les gens qui se sont endormis se réveillent. Les gens qui ont été heureux d’observer désirent participer. Les gens qui ne disaient jamais un mot, se mettent à parler. Le point de bascule de la foi est le seuil de l’énergie spirituelle où ce que nous croyons devient ce que nous faisons. Quand la puissance est libérée, rien ne peut l’arrêter, car l’amour est une force que rien ne peut contenir. Regardez et voyez les milliers de nouveaux visages qui se rassemblent, venant de toutes les directions. C’est le signe d’espérance que vous attendiez ».
Apprenons à vivre l’espérance. « L’espérance nous fait voir littéralement la présence et l’action de ce qui est saint dans nos vies quotidiennes. Ce n’est pas un désir imaginaire à travers des lunettes en rose. C’est une évidence solide de la puissance de l’amour qui se rend visible dans l’abondance ».
Ecoutons nouveau Steven Charleston : « Quelquefois, dans ce monde troublé qui est le notre, nous oublions que l’amour est partout autour de nous. Nous imaginons le pire en pensant aux autres gens et nous nous retirons dans nos coquilles. Mais essayons ce simple test : Tenez-vous tranquille dans un lieu fréquenté et observez les gens autour de vous. En peu de temps, vous commencerez à voir l’amour et vous le verrez à nouveau et à nouveau. Une jeune mère parlant à son enfant, un couple riant ensemble en marchant cote à cote, un homme âgé ouvrant la porte à un étranger – les petits signes d’amour sont partout. Plus vous regardez, plus vous verrez. L’amour est littéralement partout. Nous sommes environné par l’amour ».
Apprenons à contempler. « Il y a là un appel puissant à un regard de contemplation pour voir le monde autour de nous. Les signes d’amour abondent, nous rappelant la nature essentielle de Dieu.
J H
- Richard Rohr. A foundational hope 31 may 2021: https://cac.org/foundational-hope-2021-05-31/
Pourquoi et comment donner priorité au sens dans notre vie quotidienne ?
 Victor Frankl, survivant de l’holocauste et psychiatre bien connu, nous suggère que la recherche de sens est une motivation première chez les êtres humains. « C’est une part essentielle de nos existences, des jeunes enfants qui posent la question du pourquoi aux adultes qui réclament davantage de sens au travail ou dans une crise du milieu de la vie ». A travers l’histoire, chercheurs, philosophes, théologiens, poètes, ont abordé cet enjeu primordial du sens. Sur ce site, nous avons présenté un livre d’Emily Esfahani Smith : « There is more to life than being happy » : « Une vie pleine, c’est une vie qui a du sens » (1).
Victor Frankl, survivant de l’holocauste et psychiatre bien connu, nous suggère que la recherche de sens est une motivation première chez les êtres humains. « C’est une part essentielle de nos existences, des jeunes enfants qui posent la question du pourquoi aux adultes qui réclament davantage de sens au travail ou dans une crise du milieu de la vie ». A travers l’histoire, chercheurs, philosophes, théologiens, poètes, ont abordé cet enjeu primordial du sens. Sur ce site, nous avons présenté un livre d’Emily Esfahani Smith : « There is more to life than being happy » : « Une vie pleine, c’est une vie qui a du sens » (1).
Il existe, aux Etats-Unis, un Centre de recherche qui explore les activités et pratiques de vie en rapport avec la question du sens. Un site : « Greater good magazine . Science-based insights for a meaningful life » (2) nous présente des recherches sur ces attitudes et pratiques de vie que sont l’émerveillement, la compassion, l’empathie, le pardon, la gratitude, le bonheur, la conscience, la connexion sociale.
Ces attitudes et ces pratiques ont également des effets positifs pour nous-mêmes. Ce sont des clefs pour notre bien-être (« Keys for our well-being »). « Aujourd’hui, de plus en plus de recherches montrent qu’éprouver du sens peut nous aider à améliorer notre bien être et nous aider à mieux vivre ». Les transformations actuelles de notre société rendent ces questions existentielles d’autant plus pressantes.
Une recherche : Est-ce que de simples activités quotidiennes peuvent rendre la vie plus signifiante ?
Prinit Russo-Meyer publie sur ce site un article sur notre rapport avec le sens dans notre vie quotidienne (3).
« Frankl n’a-t-il pas écrit : « Ce qui importe, ce n’est pas le sens de la vie en général, mais plutôt le sens spécifique vécu par une personne dans un moment donné de sa vie » . En d’autres mots, le sens se manifeste dans ce que nous choisissons de faire activement et consciemment dans nos vies ». « Eprouver du sens dans la vie est une question concrète qui a tout à voir avec nos priorités, avec la manière dont nous passons le temps dans le travail ou dans les loisirs, seul ou avec d’autres ».
Prinit Russo-Meyer a donc entrepris une recherche pour répondre à la question. « Pouvons-nous développer davantage de sens et de bien-être à travers une simple action quotidienne ? ». Elle a conduit une enquête pour savoir comment des personnes recherchent des expressions pleines de sens dans leur vie quotidienne, ce qu’elle a appelé : « mettre le sens en priorité » (« prioritizing meaning ».
Sa recherche, publiée dans le « Journal of happiness studies », montrent que « les gens qui mettent du sens en priorité dans leurs actions, tendent à développer une plus grande conscience du sens dans leur vie, et ensuite à éprouver moins d’émotions négatives et plus d’expressions positives : gratitude, cohérence (optimisme et contrôle), bonheur et satisfaction dans leur vie » .
« Ce qui veut dire que lorsque nous désirons une vie plus signifiante sans développer des activités en ce sens, nous n’irons probablement pas très loin ». Prinit Russo Ritzer s’est inspirée d’une autre recherche auprès des gens donnant priorité à la positivité. Dans la stratégie correspondante, on essaie d’agir sur les actions plutôt que sur les sentiments. Cette stratégie est une approche qui se révèle plus efficace. Comment privilégier le sens dans notre vécu ? Prinit observe que nous ne traduisons pas toujours nos priorités données au sens, en activités concrètes. Par exemple, si nous valorisons la famille, mais nous n’accordons pas plus de temps aux enfants, cette valeur peut ne pas se révéler bénéfique. Combler le fossé (the gap) est vital. Chaque journée nouvelle est une opportunité pour faire des chose qui comptent vraiment pour nous dans notre désir de vivre une vie signifiante et qui mérite d’être vécue ». Nous pouvons donc nous demander quelles activités signifiantes nous devons privilégier dans la journée qui s’annonce et quelles activités nous devons supprimer ou modifier. Nous pouvons également nous interroger sur la manière dont nous avons utiliser le temps passé récemment. « Comme nous passons nos journées, nous passons également notre vie ». Albert Camus a écrit un jour : « La vie est la somme de tous nos choix ».
J H
- Une vie pleine, c’est une vie qui a du sens » : https://vivreetesperer.com/une-vie-pleine-cest-une-vie-qui-a-du-sens/
- Greater Good Magazine. Science-based insights for a meaningful life : https://greatergood.berkeley.edu
- Why you should prioritize meaning in your everyday life . Can simple, everyday actions make life more meaningful ? https://greatergood.berkeley.edu/article/item/why_you_should_prioritize_meaning_in_your_everyday_life?fbclid=IwAR3BNe71vZrAPDgA3ISkT-VXoiARYe8cXJsoTZqf7ma2vIc0fxYmV45azHQ
Une révolution culturelle, selon Jean Viard
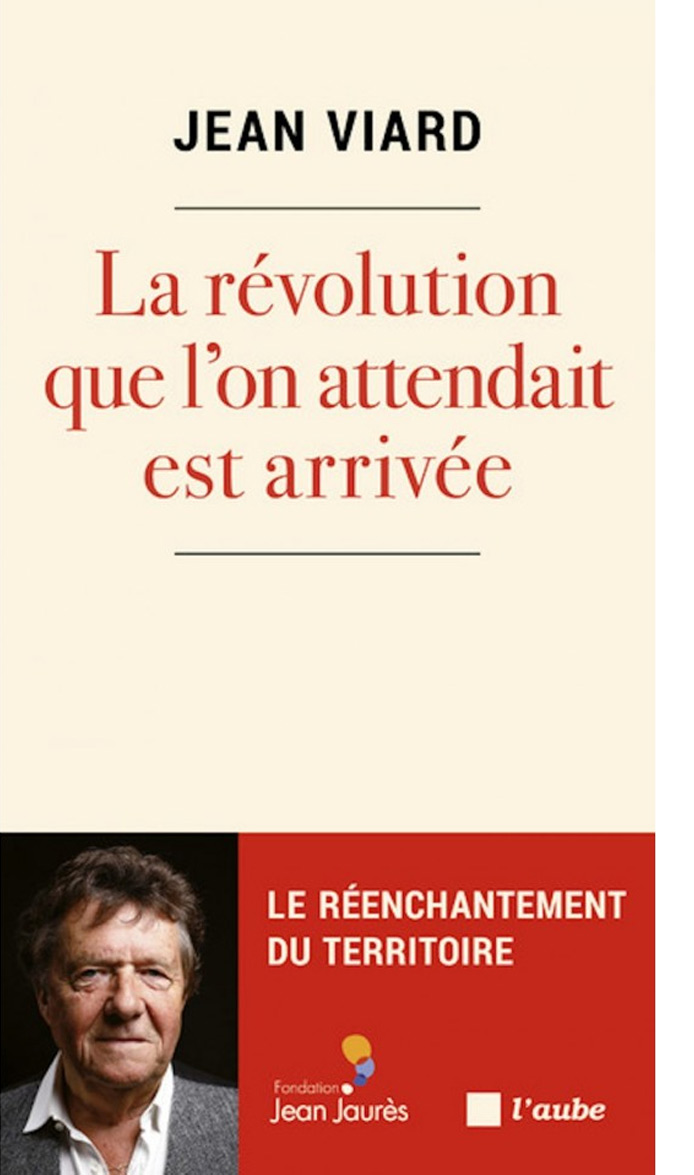 Si la pression de la pandémie se relâche actuellement, elle nous a profondément marqué et nous gardons une saine vigilance. Dans la menace omniprésente et les bouleversements nécessaires de nos habitudes sociales pour y faire face, nous avons vécu un véritable cauchemar. Et si , aujourd’hui, nous commençons à nous réveiller, notre regard a changé. Nous voyons le monde différemment, mais en quoi au juste ? D’où venons nous ? Où en sommes nous ? Où allons nous ? Voilà des questions auxquelles Jean Viard nous aide à répondre dans un livre récent : « La révolution que l’on attendait est arrivée » (1).
Si la pression de la pandémie se relâche actuellement, elle nous a profondément marqué et nous gardons une saine vigilance. Dans la menace omniprésente et les bouleversements nécessaires de nos habitudes sociales pour y faire face, nous avons vécu un véritable cauchemar. Et si , aujourd’hui, nous commençons à nous réveiller, notre regard a changé. Nous voyons le monde différemment, mais en quoi au juste ? D’où venons nous ? Où en sommes nous ? Où allons nous ? Voilà des questions auxquelles Jean Viard nous aide à répondre dans un livre récent : « La révolution que l’on attendait est arrivée » (1).
Nous avons déjà rencontré Jean Viard sur ce blog (2). C’est un sociologue qui allie hauteur de vue et regard concret nourri par l’observation de la vie quotidienne. Lui même est enraciné dans un pays, en Provence et, en même temps, comme sociologue, comme éditeur, il est constamment en phase avec l’évolution de notre société. Il sait donner une signification aux données chiffrées et aborder les réalités sociales dans leurs proportions. Jean Viard a également le grand mérite de ne pas se contenter de décrire la réalité, mais de dégager également des voies d’avenir. Cette sociologie s’allie à une dynamique de l’espoir.
Alors, dans le contexte actuel, encore hésitant, ce livre vient à point. Il est particulièrement éclairant comme les précédents livres de Jean Viard. Il foisonne en réflexions originales. Aussi, nous nous bornerons à n’en présenter que quelques points forts, des visions qui éclairent nos manières de voir. Ce livre se lit de bout en bout. Et comme aujourd’hui nous avons besoin d’y voir plus clair, c’est un livre qui appelle la lecture de tous, une lecture citoyenne parce qu’elle encourage et éclaire le vivre ensemble.
Comment le désastre a-t-il pu être limité ?
Chacun a pu frémir en voyant la menace se manifester en des milliers et des milliers de morts. Cependant, est-ce qu’au total nous n’avons pas échappé au pire ? Est-ce que le désastre n’a pas été contenu ? Jean Viard nous aide à voir le positif dans le négatif.
Face à cette épidémie, il y a eu un choix qui témoigne d’une priorité accordée à la vie humaine. Ce choix a été politique : accepter de « casser l’économie pour « sauver les vieux » pourtant improductifs » (p 26).
Cette solidarité s’est manifestée également sur le plan social : « Télescopage des générations et immenses phénomènes de solidarité. Des jeunes ont été fantastiques. Ils se sont hyperprotégés pour préserver les plus âgés. Ils ont remplacé au pied levé les retraités qui agissaient dans des associations de solidarité. C’est une force. Dans les milieux populaires, ça s’est relativement bien passé, car ce sont les familles qui gardent le plus leurs anciens à la maison… » (p 33).
Cette solidarité s’est manifestée à tous les niveaux. « L’expérience fut tragique et extraordinaire : familiale, locale, nationale, continentale et planétaire. Des humains unis dans un même combat, une même incertitude. La France fit corps, l’Europe fit corps. Le monde fit corps. Les familles firent corps autour de leurs anciens » (p 14). Jean Viard discerne ainsi du positif dans une réaction disparate. Nous ne reviendrons pas ici sur les erreurs et les fautes des dispositifs sanitaires. L’auteur pointe les lourdeurs de l’organisation administratives.
Sur un autre registre, Jean Viard met l’accent sur les progrès de la science. « La science a fait des pas de géant. Deux cent soixante laboratoires ont travaillé en parallèle. Des centaines de milliards ont été engagés. La science a repris sa place historique de porteuse de progrès et de soin » (p 14).
Au total, le désastre a été limité. En regard, la grippe espagnole a été beaucoup plus dévastatrice. Elle a pris « de cinquante à cent millions de vies dans une humanité deux fois moins nombreuse et beaucoup moins mobile. Réjouissons-nous que la vie humaine ne soit plus une variable d’ajustement, mais soit devenue pour le monde entier, une valeur cardinale » (p 16). Aujourd’hui, il y a eu « des millions de morts et de malades », mais « le combat sauva sans doute de cinquante à cent millions de vies » (p 26).
Une transformation profonde
Cette épreuve a engendré une réflexion profonde, une remise en cause. Les mentalités et les comportements ont changé. Et si nous entrons dans une rétrospective historique, nous pouvons découvrir que notre société a changé de cap. Jean Viard met en évidence cette transformation. « Nous avons changé de monde » (p 11). « Le fond de l’air n’est plus le même. La hiérarchie de l’importance des choses et des métiers a été comme bousculée » (p 14). En voici un indice : « 10% des français disent vouloir changer de vie. Ils ne le feront pas tous, mais ils le désirent. C’est un mouvement puissant » (p 34).
Jean Viard nous décrit quelques lignes de force de la transformation actuelle. « Le retour d’un commun – cette fois-ci planétaire et simultanément – ouvre une nouvelle époque, comme la révolution industrielle l’avait fait au XIXè siècle. Mais alors seulement pour une part de l’humanité. Aujourd’hui, nous sommes tous acteurs dans le même temps planétaire » (p 28). Une nouvelle civilisation s’annonce : écologique et numérique. « Nous sommes en train de nous décrocher des sociétés industrielles et post-industrielles pour basculer dans des sociétés numériques et écologiques.
La vie, y compris celle de la nature, a repris le pas sur la matière transformée et l’objet… » (p 22). La pandémie actuelle nous rappelle que nous appartenons au monde du vivant. Elle nous apprend que nous sommes capables de faire face au réchauffement climatique à travers un changement de nos priorités et de nos comportements. « Cette pandémie va servir pendant des décennies de justification à la lutte contre le dérèglement climatique. De cette tragédie, peut, et doit, naître un nouvel impératif existentiel au nom de ceux qui ont souffert et qui sont morts » (p 94).
La crise sanitaire a pu être affrontée grâce à la présence du numérique. « Sans internet, le confinement aurait été invivable » (p 56). Aujourd’hui, le numérique est partout disponible. « Ce n’est que depuis 1945 que la société du pétrole dirige nos déplacements et nos rencontres. La Grande Pandémie marque une rupture de même nature. Le numérique a pris la main. On ne va évidemment pas supprimer le lien physique. Il faudra toujours se voir, mais dorénavant, la première question qu’on se posera, sera : Peut-on le faire par Zoom, Skype ou autre… Bien sûr, les deux modes de rencontre vont se compléter » (p 45-46). Aujourd’hui, le télétravail est devenu une réalité majeure. Ainsi partout, le numérique est en train de s’imposer. « Même au sein de la famille, on se verra par zoom. Amazon écrasera alors les très grandes surfaces. Le télétravail – du moins à temps partiel- deviendra la règle pour ceux qui le peuvent. Les enseignants eux-mêmes utiliseront plus souvent les outils numériques… » (p 46).
Et, en même temps, il y a aujourd’hui un grand désir d’un nouveau genre de vie : donner un sens à sa vie, vivre en relation, se trouver à proximité de la nature, rechercher le beau. Dès lors, on veut repenser nos lieux de vie. Jean Viard évoque les laideurs de la modernisation de l’après-guerre. « Demain, peu à peu, la priorité va être donné à la mise en scène du patrimoine, du beau, de l’art, des forêts, des bocages. C’est ce que j’appelle l’esprit des lieux » (p 62).
« Aujourd’hui, nous changeons de récit commun. La modernité, c’est à dire l’éloignement progressif du passé et de son principe d’autorité laisse la place à une nouvelle alliance entre passé et révolution numérique et technologique… C’est pour cela que l’esprit des lieux devient primordial, car si le premier lien est numérique, il se passe en grande partie à partir ou autour de là où j’habite. Le numérique, comme la télévision hier, renforce la place du domicile comme caverne centrale. Mais une caverne faite pour la vie, l’amour, la culture, le travail, la famille, le lien avec la nature par le jardinage et l’animal domestique » (p 62).
C’est aussi la promotion du local. « Soutenue par une quête de vie locale, de ville du quart d’heure, du marché du soir et du week-end, de vente directe, le bio a gagné 15% de nouveaux consommateurs pendant la pandémie en particulier chez les jeunes et dans les milieux populaires- mais hors grandes surfaces. Du lien donc avec l’autre et avec le sol » (p 70).
Une nouvelle géographie sociale
Après avoir rappelé la géographie sociale de l’après-guerre et notamment les bastions communistes, Jean Viard nous décrit un nouveau paysage. Là aussi, la crise est à l’œuvre et joue parfois un rôle d’accélérateur.
Le peuple ouvrier a changé. Au cours des dernières décennies, « la France des ouvriers s’est rapprochée des petites villes, des lotissements et des paysans du vaste périurbain » (p 114). « La France ouvrière existe toujours, pour partie dans le monde des ouvriers d’entretien, pour partie dans l’industrie qui pèse encore 13% du PIB » (p 115). « La pandémie a contribué à redonner des lettres de noblesse à l’industrie et a montré l’absurdité de certaines localisations lointaines » (p 115).
Jean Viard distingue un second groupe : Les travailleurs du care et des services. Les travailleurs du care habitent les banlieues et ceux des services, la grande périphérie, le périurbain, parmi ces derniers, certains d’entre eux ayant participé aux manifestations des gilets jaunes. Notons deux suggestions en leur faveur : une politique de logement social pour les premiers, une politique du foncier pour les seconds.
Et puis, Il y a un troisième groupe, « celui dont le monde professionnel est numérisé : 30% à 40% des emplois, certaines études disent 60%, au moins pour une partie du temps ». C’est un monde en expansion. « Si il est socialement homogène, il ne l’est pas géographiquement. Il s’agit ainsi d’abord du monde des métropoles, mais plus uniquement, car certains d’entre eux, avant même la pandémie avaient commencé à réinvestir les villes moyennes, les petites villes et la campagne. Des néo-ruraux qui s’éloignent de la ville, non par nécessité, mais par choix » (p 123). « Ainsi on note une congruence entre le monde des résidences secondaires et celui du télétravail qui se chevauchent » (p 124). La pandémie a accru ce mouvement. « 20% des parisiens au moins ont quitté la ville au début du premier confinement, soit 450 000 personnes » (p 127).
Il y a enfin le monde des fermes ancré dans les terre arables.
Jean Viard nous décrit les rapports entre les différents milieux en mouvement. « Car il y a un désir massif des populations de travailler dans les grandes métropoles ou en lien avec elle, mais de ne pas y habiter toujours » (p 129).
Cette analyse a une portée internationale. « Aux Etats-Unis, une partie de la société rurale ou en partie périurbaine se vit comme « scotchée» et une autre partie, métropolitaine et péri métropolitaine, se vit comme emportée par un flux » (p 132). « Ce décalage stock flux se retrouve dans toutes nos grandes démocraties » (p 133).
Le réenchantement du territoire
Le réenchantement du territoire, c’est le sous-titre du livre de Jean Viard. L’auteur y met l’accent sur « l’esprit des lieux ». C’est le renouveau du local dans la mise en valeur de sa culture et de son patrimoine. « Comment réinvestir les lieux patrimoniaux qui donnent du sens à l’aventure d’y vivre avec nos modes de vie et nos usages contemporains. La pandémie va accentuer cette double demande de mémoire et d’art de vivre. Le patrimoine, les fermes, la nature sont devenus la toile de fond d’une vie mobile où les logements grandissent et s’ouvrent sur l’extérieur » (p 150). Jean Viard nous montre comment nous sommes passé de la France paysanne, incarnée dans la IIIè République à la nouvelle géographie d’aujourd’hui en passant par « l’épopée des trente glorieuses » et son maillage territorial : « Quartiers rouges, quartiers bourgeois, campagne et rural profond » (p 106). Jean Viard évoque le désarroi récent de la société française : « Le récit national ne rassemble plus, les appartenances de classe sur lesquelles reposaient le champ politique n’intéressent plus. La société est devenue mobile, et la figure de l’arrivant devient notre angoisse » (p 109). « Peu à peu, l’école, les maires, les petites et moyennes entreprises, à égalité avec la justice et la police, paraissent aux citoyens les plus protecteurs des valeurs républicaines » (p 109).
Cet équilibre était précaire et menacé par une économie mondialisée galopante. « Or la civilisation écologique et numérique où nous entrons, me paraît permettre de reterritorialiser les liens sociaux. Ce mouvement était déjà en cours. Le local était une préoccupation de plus en plus forte. Paris se dépeuplait. Les villes pensaient forêts et fermes urbaines, vélo, marche à pied… Puis la grande pandémie a fonctionné comme une loupe grossissant tous les traits, parfois peu visibles, de notre société (p 110-111). On a vu émerger une nouvelle classification du social, une nouvelle spatialisation sociale renforcée par la numérisation des liens » (p 111).
Ce livre éclaire nos situations de vie. Nous nous y reconnaissons. Il ouvre des pistes et fourmille de propositions innovantes (chapitre 4). Il est inspiré par une vision positive et une dynamique d’espoir, par exemple « lorsqu’il parle de l’intime conviction que si l’humanité a pu dérégler le climat, cela veut dire que la puissance humaine est aussi apte à le reréguler » (p 66). Bien sûr, rien n’est gagné d’avance. La pandémie n’est pas terminée. « Nul ne sait la date où nous sortirons de la pandémie, ni si il faut déjà annoncer les suivantes » (p 87). De même, la menace d’un totalitarisme politique peut resurgir. A nous d’y faire face. Ce livre a, entre autres, une vertu. Il nous montre qu’à travers cette épidémie nous avons beaucoup appris. Nous pouvons également tirer des leçons de nos échecs. Ce livre nous apporte une remarquable analyse, mais il nous offre aussi le dynamisme d’une vision :
« Il faut replanter la vieille république paysanne dans une société de jardins, de parcs, mais aussi de terres arables, de forets, de rivages. Toujours. La replanter dans cette nature dont nous sommes membres, qui nous environne et qui est en nous. Prendre soin de la Terre et de l’humanité. Avec la puissance du numérique et de la science. De la Révolution mentale, écologique et culturelle que nous venons de vivre. Mai 68 puissance cent » (p 220).
Voici une lecture indispensable, une lecture citoyenne.
J H
(1) Jean Viard. La révolution que l’on attendait est arrivée. Le réenchantement du territoire. Edition de l’Aube, Fondation Jean Jaures, 2021 Une interview vidéo de Jean Viard sur ce livre : https://www.youtube.com/watch?v=WvgeXWpURJQ
(2) Articles sur Vivre et espérer concernant des livres de Jean Viard : Une société si vivante (2018) : https://vivreetesperer.com/une-societe-si-vivante/
Penser à l’avenir (2016) : https://vivreetesperer.com/penser-a-lavenir-selon-jean-viard/
Emergence en France de la « société des modes de vie » : initiative, autonomie, mobilité (2012) : https://vivreetesperer.com/emergence-en-france-de-la-societe-des-modes-de-vie-autonomie-initiative-mobilite/
Coach pour une vie en rebondissement : L’hypnose comme un outil thérapeutique
Interview de Béatrice Ginguay
Béatrice, depuis plusieurs années, tu t’es engagée professionnellement vers un accompagnement en tant que coach. Peux-tu nous rappeler ton passage de cadre infirmier à la profession de coach (1) ?
Après avoir exercé 30 ans, dont 20 en tant que cadre Infirmier, dans le secteur sanitaire (hospitalier, extra-hospitalier) et médico-social, j’ai éprouvé le besoin d’établir des relations plus proches et plus personnalisées avec les personnes accueillies.
En effet, l’évolution de la situation dans les institutions de Santé et notamment du contexte hospitalier, ne correspondait plus à ce que je souhaitais vivre au niveau humain et ne me permettait plus un exercice professionnel en accord avec mes valeurs de respect, de qualité, d’écoute, d’accompagnement…
J’ai donc suivi une formation afin de me réorienter vers le Coaching. Puis j’ai pris la difficile décision de « lâcher » la sécurité « salariée » pour une réorientation professionnelle : m’établir en libéral et mettre à profit mes expériences personnelles et professionnelles.
Mon cœur de métier et mon parcours professionnel me permettent d’accompagner les personnes confrontées à des accidents de la vie : situations de Handicap, graves maladies, maladie d’Alzheimer, burn out…
De plus, ayant expérimenté personnellement les bienfaits des contacts avec l’animal, et ayant suivi une double formation de thérapie par le biais du cheval et du chien, c’est donc tout naturellement que je propose pour ceux qui le désirent que les séances de coaching puissent se dérouler avec Médiation Animale (2).
En fonction de tes compétences, tu as choisi d’orienter ta fonction de coach vers un accompagnement aux personnes en difficulté, en recherche d’un second souffle, d’un rebondissement. Peux-tu décrire ton expérience ?
En effet, parfois le tourbillon des événements nous blesse profondément et nous entraîne, malgré nous, au fond du trou. Il est alors difficile de se ressaisir, de relever la tête. Nous avons alors souvent besoin d’une main tendue, d’un coup de pouce.
Ma certitude absolue est que nous avons TOUS, au fond de nous, une pulsion de vie qui parfois baisse en intensité, mais qui jamais ne s’éteint.
En tant que professionnelle, il m’appartient de créer ce lien, de redonner confiance à la personne, et de l’accompagner pour retrouver foi en Sa propre Force.
Le nom de REBONDIR m’est venu en voyant des enfants jouer et sauter sur un trampoline. S’ils restent statiques, aucun mouvement ne se produit. En revanche, une chute engendre un système de réaction physique qui le fait, à un moment donné, rebondir.
Et si vraiment la personne reste allongée sur le trampoline sans pouvoir se relever, le mouvement, impulsé par une tierce personne à côté d’elle, suffit à remettre en mouvement ce mécanisme physique de rebond, dont va pouvoir bénéficier la personne qui jusque-là était « inerte » par épuisement.
Cette observation illustre pour moi le mouvement interne à chaque individu, ainsi que l’aide potentielle apportée par le professionnel.
Une fois « remise sur pied », la personne a, comme face à toute difficulté, un choix à faire :
- l’abandon – la capitulation,
- ou bien la résistance et l’engagement par l’action.
La première option peut sembler la voie la plus facile. Néanmoins, elle conduit souvent, à plus ou moins long terme, à une sorte de Mort.
La deuxième option, si elle est plus difficile à court terme, ouvre vers la Vie.
L’impasse dans laquelle nous avons parfois l’impression de nous trouver, vient en partie de notre propre perception.
Un regard extérieur, un accompagnement permet alors de sortir la tête de l’eau, et de percevoir cet entrefilet de lumière, qui pourtant existait bien, mais qu’on ne voyait plus, empêchés par nos larmes de honte, de désespoir, de rage… ., ou notre état de sidération.
Alors, n’hésitons plus ! Il nous faut demander de l’aide.
Que le problème soit matériel, organisationnel, affectif, relatif à la santé…., nos émotions prennent parfois le dessus, nous rendant aveugle à toute issue potentielle, nous laissant penser que plus rien n’est possible.
En réalité, mes différentes formations me permettent de proposer trois approches possibles pour pouvoir REBONDIR :
- par un accompagnement en Coaching, en revisitant votre passé, en trouvant vos forces profondes qui vous permettront de poser des objectifs et de vous projeter dans le futur, et d’avancer, un pas après l’autre,
- grâce à la Médiation Animale, en vous remplissant « d’Ici et Maintenant », en reprenant confiance en vous grâce à l’acceptation inconditionnelle de mes chiens, à leur témoignage débordant de sympathie. Il est parfois, en fonction de notre passé, plus facile de mettre sa confiance, dans un premier temps, dans les animaux que dans les humains.
- en découvrant, grâce à l’Hypnothérapie, la source profonde des freins et des blocages qui nous poursuivent.
C’est alors que ce filet, de manière certaine, va aller en grandissant, au fur et à mesure que nous avançons.
Justement, tu as suivi récemment une formation en hypnose devenir hypno-thérapeute. Pourquoi as-tu choisi cet outil parmi les autres disponibles aujourd’hui ?
Mon expérience de coach m’a permis de constater que lorsque nous sommes accompagnés en coaching, ou même lorsque suivons une thérapie, le matériel avec lequel et sur lequel nous travaillons, ce que nous apportons, « se limite » à ce dont nous avons conscience.
Il s’agit de nos souvenirs, notre expérience professionnelle, personnelle, nos difficultés ou richesses actuelles… Tout ceci est très riche. Néanmoins, cela ne constitue qu’une partie de nous-même.
Notre psychisme est constitué de notre conscient (ce dont nous avons conscience), et de notre inconscient.
Je vais me permettre une comparaison avec un ordinateur :
- notre conscient, c’est l’ensemble des dossiers qui sont sur le bureau, c’est-à-dire, ce qui est à portée de main de façon immédiate, à portée de vue et de mémoire.
- notre inconscient, correspond au disque dur de l’ordinateur. Aucune de nos manipulations effectuées sur l’ordinateur, aucune recherche internet … rien ne lui échappe. Le disque dur de l’ordinateur garde une trace de tout, absolument tout ! C’est ce que fait notre inconscient : il garde une trace de chaque événement de notre vie, de nos émotions, y compris de notre vécu in utéro.
J’ai donc éprouvé le besoin de me former à un outil que je pourrais proposer, outil qui permette à la personne d’accéder à cette partie d’elle-même qui renferme tant d’informations, dont certaines sont les origines et sources profondes de nos malaises, blocages….à savoir notre inconscient.
L’hypnose n’est pas uniquement un outil de remémoration, de prise de conscience. L’hypnose permet également de guérir, de réparer.
Sur le marché des soins, nous disposons de nombreux outils pour accompagner les patients/clients dans le besoin. Certains professionnels optent pour se former en sophrologie, kinésiologie, shiatsu, EMDR, etc …. L’éventail disponible en est large.
Chaque outil peut être plus spécifiquement indiqué pour telle ou telle situation.
Certaines de ces méthodes proposent préférentiellement une approche corporelle, psychocorporelle, psycho neurobiologique, etc …
En tant que professionnels, il nous faut faire un choix, ou en tous les cas, prioriser nos choix de formations, car elles ont un coût, au niveau financier et temporel.
J’ai donc opté pour l’hypno-thérapie. Outre l’outil en lui-même, qui permet d’accéder à notre inconscient, de revivre des situations enfouies…, j’ai été convaincue par la qualité des formateurs, leur exigence éthique, et l’orientation spécifique dans la prise en charge des psycho-traumatismes.
Je ne prétends pas que l’hypnose soit le seul outil possible, valable, efficace. Il est celui que je peux offrir aujourd’hui, et avec lequel je suis en parfait accord.
Il est, à mon sens, fondamental que le thérapeute se sente en cohérence avec l’outil qu’il propose à ses patients/clients, qu’il soit à l’aise avec la méthode utilisée et qu’elle ne s’entrechoque pas avec ses valeurs. Faute de quoi, le thérapeute ne pourra pas se l’approprier parfaitement, et risque de vivre une discordance qui nuira au patient/client.
Peux-tu nous expliquer ce qu’est l’hypnose ? Quelle pratique en as-tu choisi ?
La terminologie exacte lorsqu’on parle d’hypnose, c’est de parler « d’état de transe ». Il s’agit du terme technique exact. Pour ma part, je préfère utiliser le terme d’« état hypnotique ».
En effet, la notion de transe, dans certains milieux culturels, peut être connotée : transe convulsive, chamanique, de possession …… Or l’état dans lequel nous nous trouvons en hypnose, lorsqu’elle est menée par un professionnel qualifié, n’est en rien semblable avec cela.
Avant toute chose, il est important de préciser que « l’état hypnotique » est un phénomène « naturel ». Nous passons tous, à certains moments, par de tels états sans en avoir conscience. Simplement, cela se produit de manière plus superficielle, et sur une durée plus courte.
Dans notre cas d’hypno-thérapie, il s’agit d’aider la personne à être dans un état hypnotique plus profond et sur une durée plus longue.
Le but est de permettre un état de dissociation qui donne, à la personne, accès à son inconscient. Si je veux prendre une image, c’est un petit peu comme une poupée russe. La poupée extérieure représente notre conscient. L’état hypnotique permet de faire coulisser le chapeau/ couvercle de la poupée extérieure, et ainsi d’avoir accès à la poupée plus interne qui représenterait notre inconscient.
Pour ma part, professionnelle de santé, je me suis formée à l’hypnose éricksonienne.
Le client/patient peut choisir de se laisser conduire par son inconscient, sans but précis.
Cependant la plupart des cas, le client /patient consulte par rapport à un objectif très précis. Nous travaillons donc à cet objectif, avant de démarrer l’hypnose à proprement parlé.
Les objectifs peuvent être très variés : vouloir « arrêter de fumer », « perdre du poids », « lever des freins, des peurs », « se sentir mieux », « réparer un dommage corporel » ….
L’objectif peut-être d’ordre physique, psychique, émotionnel…
Ma formation me permet également de traiter les psycho-traumatismes. Dans certains cas, le client/patient n’en a même plus le souvenir. Et pourtant, c’est bien ce trauma enfoui qui est la cause de bon nombre des difficultés de sa vie actuelle. Il le découvrira au fur et à mesure des séances.
L’état hypnotique permet des phénomènes de régression, nous retrouver enfant, bébé. Nous pouvons revivre des situations « in utéro ».
Il est important de se rappeler que l’inconscient est toujours BIENVEILLANT. L’absence de souvenir d’un événement que notre entourage peut nous relater comme ayant été traumatisant, est l’œuvre « bienveillante » de notre inconscient qui a voulu nous protéger au moment « t » de cet événement. La réminiscence en travail d’hypnose se fera au fur et à mesure de nos capacités émotionnelles à gérer cela.
Comme Paul l’écrit dans l’une de ses lettres (l’épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13), « Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. », notre inconscient ne fera pas remonter au niveau de notre conscience un événement, une situation… si nous ne sommes pas à même de les supporter ou de les gérer. Il agira de manière fragmentée, jusqu’à la reconstitution du puzzle.
Dans le contexte d’un « état de conscience modifié », l’hypno-thérapie ne présente-t-il pas un danger d’assujettissement ou celui de l’intrusion de pensées négatives ? ou de résurgence de pensées négatives ? Quelle est l’éthique apportée dans ta formation en hypnose ?
Pour ma part, j’ai été formée par des hypno-thérapeutes, professionnels de santé (médecin généraliste et psychomotricienne), enseignants en université (faculté de médecine).
Les participants à cette formation ont été sélectionnés : nous étions tous des professionnels de santé.
Tout ceci constituait un « cadre » qui était pour moi un gage de sérieux et une garantie que cette formation s’inscrivait dans une perspective éthique, de grand respect du patient accompagné.
L’accompagnement par le thérapeute se fait de manière respectueuse, au rythme du patient. Cet accompagnement se déroule dans un climat bienveillant, soutenant, inconditionnellement positif.
En situation ordinaire, nous avons le sentiment de penser par nous-même, d’analyser, de faire des choix et agir suite à nos réflexions, à notre conscience. En réalité, notre inconscient a un impact certain sur notre vie, nos pensées, nos actions…. sans que nous n’en ayons pleinement conscience.
C’est la raison pour laquelle, il me semblait important de pouvoir proposer à mes clients/patients cet accompagnement, afin de trouver l’origine de leurs freins, de leurs peurs…
En « état hypnotique, de par la dissociation entre notre conscient et notre inconscient (explicitée précédemment), notre inconscient devient plus accessible, et fait « remonter à la surface », au niveau de notre conscience, des souvenirs, des émotions, des sensations oubliées et enfouies, parfois très loin. Rappelons que notre inconscient avait agi comme cela pour nous protéger.
Lorsque je parle de mon activité professionnelle, j’entends beaucoup de crainte, de questions à propos de l’hypnose. Je vais en évoquer quelques-unes, des plus fréquentes.
1 : « Moi je ne peux pas rentrer en hypnose…. ». « et si je n’arrivais pas à rentrer dans cet état ? ». Et bien, on ne peut pas le savoir sans avoir essayé. Et si cet outil qu’est l’hypnose ne vous convient pas, dans ce cas, vous pourrez toujours vous orienter vers une autre approche de soin.
2 : « Je ne suis plus tout à fait moi-même, donc on risque de me faire faire des choses que je ne voudrais pas…. ».
Cette crainte est légitime. Elle prend racine dans une représentation répandue par « l’hypnose spectacle ». Dans ces situations en effet, la personne est « soumise » à l’hypnotiseur, elle est sous son emprise, faisant des choses sous les ordres de « l’hypnotiseur », choses qu’elle ne ferait pas d’elle-même. Il s’agit d’une forme de manipulation
Et ce qui est en cause dans cette situation-là, ce n’est pas l’hypnose, mais la personne qui l’utilise. Ne nous trompons pas d’adversaire.
Moi je parle de SOIN, non de spectacle. L’hypnose que je pratique est un outil thérapeutique, utilisé à des fins thérapeutiques, donc pour améliorer une situation dont le client/patient est acteur, dont il souffre, et pour lequel il désire un changement.
Nous travaillons à partir d’un objectif précis, défini par le client/patient, par lui-même, pour lui-même. C’est lui qui va mettre cela au travail.
L’hypno-thérapie n’a donc rien à voir avec cette « hypnose spectacle », même si elle utilise le même outil. Pour prendre une image, l’outil seringue peut servir à soigner, à se droguer ou à tuer. Faut-il pour autant bannir les seringues ?
L’hypno-thérapie s’inscrit dans un objectif de THERAPIE. Il est donc effectivement fondamental de s’assurer de l’éthique de la personne que nous consultons.
3 : « et si je découvrais des choses épouvantables » : si nous avons une douleur abdominale qui ne cède pas à un traitement médicamenteux, nous pouvons craindre les résultats révélés des examens complémentaires (radio, scanner …).Et pourtant, ils sont nécessaires pour investiguer et aller sur le chemin de la guérison.
Il en est de même en hypnose. Notre mal-être, nos problématiques… peuvent nous handicaper, rendre notre vie terriblement difficile. Si nous n’allons pas à la source, là où tout est inscrit, nous laissons alors passer une chance d’amélioration, voire de guérison.
Si certains événements ont été « enfouis » bien malgré nous au niveau de notre inconscient, il s’agit d’un mécanisme de PROTECTION induit par notre inconscient : certaines choses sont trop douloureuses pour rester au niveau de notre conscience. Il faut alors les mettre sous le tapis. Mais arrive un moment, où elles parasitent bon nombre de nos pensées et actions. Et il faut y travailler.
Une des autres caractéristiques de l’inconscient, c’est qu’il est toujours BIENVEILLANT :
il ne fera remonter au niveau de notre conscience que ce que nous sommes en état de gérer et de supporter. Par exemple, un traumatisme grave ne « resurgira » pas comme cela, comme si on ouvrait une boite renfermant un petit diablotin monté sur ressort.
Notre inconscient le fera alors, petit à petit, en fonction de notre capacité à gérer les souvenirs enfouis. Cela peut se faire en plusieurs séances, sur plusieurs semaines.
De plus, il ne suffit pas d’avoir ramené à notre conscience certains épisodes plus ou moins douloureux. Cela serait inutile, voire difficilement supportable s’il n’y avait pas de possibilité de traitement, de guérison.
Or par l’hypnose, nous pouvons guérir ces événements, ces relations, ces traumatismes.
4 : « j’ai peur de ne plus être moi-même après une séance, que le thérapeute ait changé des choses en moi … ». En hypnose thérapeutique éricksonnienne, c’est le client/patient qui travaille. En tant que thérapeute, je l’accompagne dans son travail personnel. C’est son inconscient qui travaille. Ce n’est pas moi, thérapeute, qui impulse mes idées, mes pensées. Mon rôle est un rôle d’accompagnateur soutenant. L’évolution du client/patient viendra de ses profondeurs à lui, pour un mieux. C’est sa véritable identité qui se révèlera.
5 : « je refuse de consulter un thérapeute car je ne veux pas étaler ma vie, mes problèmes… Je n’ose pas / je ne sais pas parler de moi…. Je suis coincé dans mon corps …. Je ne veux pas qu’on me touche …». Alors l’hypno-thérapie est une bonne orientation. Il s’agit d’une thérapie « non corporelle », « non verbale ». Personne ne vous touchera. Vous ne serez pas tenu de « vous raconter », de parler, de vous dévoiler…. ni pendant, ni à la fin de la séance. C’est un travail entre vous et vous. Pendant la séance, vous vivrez votre présent, votre passé. Et en fin de séance, libre à vous de parler de ce que vous venez de vivre, … ou pas… . Vous pourrez l’évoquer lors de la séance suivante … ou pas.
Vous préserverez totalement votre intimité corporelle, émotionnelle, psychique.
6 : Je souhaiterais enfin à cette occasion, évoquer une question difficile : celle de la Foi. Il s’agit de questions fréquentes et récurrentes dans certains milieux : « je suis chrétien, puis-je utiliser l’hypnose pour me soigner ? ». « Puis-je pratiquer l’hypnose en tant que thérapeute chrétien ? ».
A cela, en tant que chrétienne, je réponds, « OUI ».
Oui, mais pas dans n’importe quelles conditions, et pas avec n’importe qui.
L’hypnose est un outil. Comme tout outil, il ne faut pas le mettre entre les mains de n’importe quelle personne, et il ne faut pas s’y soumettre dans n’importe quelles conditions.
- j’ai évoqué précédemment la nécessité absolue de se former, l’importance des formateurs et de leur éthique, et notre éthique personnelle.
- pour franchir le cap et se laisser aller à rentrer dans cet état d’hypnose, la confiance dans le thérapeute est fondamentale. Celle-ci est la conséquence d’un bon lien qui s’est établi entre les deux personnes. Ceci est valable pour toute relation de soin. Encore plus dans le domaine de l’hypnose, compte tenu de l’état dans lequel nous nous trouvons.
- Le Créateur sait de quoi nous sommes faits. Il connait parfaitement ce qui s’est inscrit sur « notre disque dur », comme évoqué plus haut. Ce qu’Il souhaite, c’est notre bonheur, notre paix intérieure. Les chemins pour y arriver sont multiples. Les professionnels de santé (que ce soit dans le domaine physique, psychologique, médecine parallèle…) peuvent être utilisés par le Seigneur pour participer à notre guérison. En fonction de ce que nous sommes, de notre problématique, de notre personnalité, de nos blocages…. l’outil « Hypnose » et le thérapeute sont, dans ce cas, au service de la foi, pour aboutir à une amélioration de leur état, voire à leur guérison. Parler du fait que je sois chrétienne
Peux-tu nous donner quelques exemples de pratiques ayant entrainé des changements positifs d’attitudes et de comportement ?
1-Une personne est venue me voir suite à des menaces de mort proférées à son encontre dans le cadre d’un conflit. Cela engendrait des peurs, perturbations de son sommeil … En état d’hypnose, elle a revécu une situation de grande détresse alors qu’elle était enfant : elle avait fait une réaction allergique très forte à la suite d’une anesthésie. Dans ce contexte, elle avait frôlé la mort et s’était sentie partir. Je l’ai accompagnée en hypnose pour réparer ce traumatisme d’enfant. Cette démarche l’a aidé à surmonter cette nouvelle angoisse liée à la menace de mort récente.
2-Une personne souffrait de douleur d’épaule. L’hypnose l’a fortement soulagée et elle a recouvré une aisance fonctionnelle.
3-Une personne souffrait d’un mal-être récurrent engendrant des difficultés relationnelles. En état d’hypnose, elle a réussi à revivre des situations in utéro (lorsqu’elle était encore dans le ventre de sa maman). Elle a ressenti, revécu l’angoisse de sa maman qu’elle avait « absorbée » à l’époque en tant que fœtus, bébé en formation. L’accompagnement en hypnose lui a permis de faire le tri et de se détacher de l’angoisse de sa maman lors de sa grossesse, pour devenir plus sereine dans sa vie actuelle.
4-Une dame s’est fracturée plusieurs vertèbres suite à une chute de cheval. L’hypno-thérapie a réduit de moitié le temps de consolidation.
5-Une personne a trouvé grâce à l’hypnose l’origine de son état de mal-être, de ne pas être à sa place, sentiment permanent de vide, de manque: elle a découvert qu’elle avait eu un jumeau décédé prématurément in utéro
6-Une personne a revécu des traumatismes d’enfance (maltraitance et abus) enfouis profondément. La réparation en hypnose lui a permis d’être plus épanouie dans sa vie d’adulte. Elle a retrouvé confiance, et ce travail l’a libérée.
Conclusion
Les différentes parties de notre être (physique, psychique, émotionnel, spirituel …) constituent un tout en interaction. Plusieurs entrées sont donc possibles.
Mon parcours m’a fait rencontrer tellement d’humains en souffrance. Et je sais combien un état intérieur blessé peut constituer un véritable handicap dans la vie quotidienne.
Mon activité professionnelle actuelle me permet d’offrir un accompagnement individualisé, dans le respect de ce que mes clients sont personnellement. J’ai vraiment à cœur de pouvoir les aider en profondeur.
La Thérapie par l’Hypnose répondant à ces objectifs, je suis vraiment heureuse de pouvoir leur proposer et utiliser cet outil qui couvre une multitude de champs d’application,
Béatrice GINGUAY
Hypnothérapeute
- De cadre infirmier à coach de vie : https://vivreetesperer.com/de-cadre-infirmier-a-coach-de-vie/
- Médiation animale : https://vivreetesperer.com/mediation-animale/
Le courage de la nuance
 Une juste expression
Une juste expression
Selon Jean Birnbaum
Lorsque l’insécurité prévaut, lorsque l’angoisse qui en résulte suscite une agressivité généralisée, lorsque cette agressivité s’exprime dans une polarisation idéologique et l’affrontement de camps opposés, alors l’expression libre de la pensée est menacée par les pressions sociales, et le débat public est lui-même handicapé. Dans ce contexte, il importe de résister. C’est l’appel lancé par Jean Birnbaum dans un essai : « Le courage de la nuance » (1). « Tout commence par un sentiment d’oppression. Si j’ai écrit ce livre, ce n’est pas pour satisfaire un intérêt théorique, mais parce que j’en ai éprouvé la nécessité interne. Il fallait nommer cette évidence. Dans les controverses politiques comme dans les discussions entre amis, chacun est désormais sommé de rejoindre tel ou tel camp, des arguments sont de plus en plus manichéens, la polarisation idéologique annule d’emblée la possibilité même d’une position nuancée ». « Nous étouffons parmi les gens qui pensent avoir absolument raison » disait naguère Albert Camus et nous sommes nombreux à ressentir la même chose aujourd’hui » (p 11).
Jean Birnbaum est en situation d’émettre un jugement sur la conjoncture du débat intellectuel. En effet, depuis 2011, il dirige le Monde des Livres et, lui-même, il a écrit deux essais : « Un silence religieux. La gauche face au djihadistes » (2), « La religion des faibles. Ce que le djihadisme dit de nous » dans lesquels il pointe des manques dans la culture actuelle face à un élan religieux extérieur. Et nous dit-il, à deux ans d’intervalle (2016 et 2018), participant, à ce sujet, à de nombreuses rencontres publiques, avoir observé un changement de climat : « Dans la même ville, parfois avec les mêmes personnes, l’atmosphère était beaucoup moins ouverte. On pouvait observer une suspicion latente « avec une accusation qui effectue actuellement un grand retour et qui tient en quatre mots : « faire le jeu de » (p 14). « Vieille antienne. A l’époque du stalinisme déjà, le écrivains qui dénonçaient le goulag étaient accusés de faire le jeu du fascisme ».
En écrivant ce livre, Jean Birnbaum se propose donc de nous offrir « Un bref manuel de survie par temps de vitrification idéologique, pour faire pièce à la suspicion. Non seulement parce qu’il célèbre la nuance comme liberté critique, comme hardiesse ordinaire, mais aussi parce qu’il est nourri par cette conviction que le livre, l’ancienne et fragile tradition du livre constitue pour la nuance le plus sûr des refuges » (p 15). Et il écrit un essai, car c’est un genre de livre où la puissance de la nuance peut s’épanouir au mieux à « la charnière de la littérature et de la pensée » (p 16). Dans cette approche, Jean Birnbaum a eu l’idée de nous montrer combien on peut s’appuyer sur l’exemple « d’intellectuels et d’écrivains qui illustrent un héroïsme de la mesure ». Il fait appel à « des figures aimées auxquelles il revient souvent et dont il est convaincu qu’en ce temps périlleux, elles peuvent nous aider à tenir bon, à nous tenir bien » (p 17). Ce sont des personnes courageuses : Albert Camus, Georges Orwell, Hannah Arendt, Raymond Aron, Georges Bernanos, Germaine Tillon ou encore Roland Barthes. Si ces noms nous sont pour la plupart connus, leur parcours ne l’est pas toujours et, avec Jean Birnbaum, il est bon de revisiter leur histoire et d’en apprécier le sens et la portée.
Cet essai n’est pas volumineux, mais il est riche et dense. Il appelle une lecture attentive et même enthousiaste. Dans notre présentation, nous nous bornerons à situer ces auteurs dans l’histoire et, avec Jean Birnbaum, évoquer quelques traits de leurs personnalités.
Le courage de la nuance face aux pressions totalitaires
Si il y a bien aujourd’hui une menace croissante de polarisation idéologique, la situation aujourd’hui ne nous paraît pas aussi tendue et aussi dangereuse qu’elle a pu l’être, durant quelques décennies au XXè siècle, à l’époque où des régimes totalitaires s’étaient installés en Europe et y exerçaient leur pression : Le fascisme, l’hitlérisme et le stalinisme. Les auteurs mis en valeur dans ce livre ont vécu durant cette période.
Georges Bernanos
La menace fasciste s’est révélée durant la guerre d’Espagne dans le putsch de l’armée contre la République espagnole et la guerre civile qui s’en est suivie. C’est là qu’on voit réagir Georges Bernanos dans son livre : « Les grands cimetières sous la lune » : « un témoignage sur la guerre d’Espagne rédigé à chaud par le romancier connus pour engagements royalistes et chrétiens qui n’en proclame pas moins son dégout pour les crimes du Général Franco et ses complices en soutane » (p 36). L’événement est d’autant plus significatif que Georges Bernanos a longtemps été un militant d’extrême-droite. Or, il refuse de ne pas voir les atrocités en cours et il intervient pour les dénoncer. « Naguère dévoué au puissant mouvement monarchiste, Bernanos vient donc briser le consensus chez ses anciens compagnons et plus généralement chez les soutiens français de Franco » (p 31).
A quoi tient cet engagement ? Georges Bernanos se dit « un homme de foi ». Il refuse le déni du mal et voit dans la médiocrité une réalité spirituelle « qui mêle désinvolture morale, contentement de soi et furieuse cécité… Il en résulte un parti-pris de ne pas voir ce qui crève les yeux » (p 41). Georges Bernanos voit dans l’enfance « une grâce à préserver, un élan qui se met à travers de l’imposture et du fanatisme… Nulle naïveté ici… Sous la lumière de Bernanos, la nuance est un aveuglement surmonté » (p 44-45).
Georges Orwell
La guerre d’Espagne a également mis en évidence le courage d’un autre écrivain : Georges Orwell. Dans les deux camps, la guerre d’Espagne apparaît à beaucoup comme « un combat contre le mal, une lutte finale ». Et dès lors, « la priorité est de serrer les rangs, et dire la vérité devient inopportun, voire criminel si la proclamation de cette vérité sert « objectivement les intérêts de la partie adverse » (p 82). C’est contre ce mécanisme que Georges Orwell s’est élevé en affirmant la primauté de l’humain et de ce qu’il appelle « la décence ordinaire ». (p 86). « Ce qui fonde toute émancipation, c’est la justesse des idées, mais surtout la vérité des sentiments » (p 87). On comprend pourquoi son grand roman antitotalitaire « 1984 » a pour héros un amoureux des mots que le régime prive bientôt de la possibilité non seulement d’écrire, mais de ressentir » (p 87). Et, de même qu’Orwell sait manifester de la sympathie, il aime la franchise. « Chez lui, ce franc parler se conjugue au doute ; Dire son fait à autrui, certes, mais aussi assumer ses propres failles… se montrer « fair play ». La meilleure façon d’être honnête, c’est de renoncer à une illusoire « objectivité »… Si « Hommage à la Catalogne » est un récit bouleversant, c’est parce que l’esprit critique et l’ironie y annulent d’avance toute velléité dogmatique » (p 90). « Refusant de céder au chantage idéologique…, Orwell nous lègue sa conception de la nuance comme franchise obstinée. Avec, pour corollaire ce principe si précieux : jamais une vérité ne devrait être occultée sous prétexte qu’en nommant les choses on risquerait de se mettre à dos telle personne importante ou de « faire le jeu » de telle idéologie funeste » (p 95).
Hannah Arendt
La guerre d’Espagne fut un prélude à l’expansion de l’Allemagne nazie. La philosophe Hannah Arendt a fui cette domination pour se réfugier aux États-Unis en 1941. Elle a éprouvé les effets de la « bêtise », ce qu’elle désigne par : « un certain rapport à soi, une manière de coller à ses propres préjugés jusqu’à devenir sourd aux vues d’autrui » (p 58). « Pas de pensée sans dialogue avec les autres et pour commencer avec soi. Avoir une conscience aux aguets, se sentir capable d’entrer dans une dissidence intérieure, voilà le contraire du mal dans sa banalité ; pour Arendt, la pensée a moins à voir avec l’intelligence qu’avec le courage. C’est un héroïsme ordinaire. D’où son insistance sur « le manque d’imagination » d’Eichman, l’impossibilité qui était la sienne de se mettre à la place des autres. Aussi « cet héroïsme de la pensée se confond-il largement avec le génie de l’amitié. C’est seulement parce que je peux parler avec les autres que je peux parler avec moi-même, c’est à dire penser » (p 59).
Raymond Aron
Le sociologue et philosophe Raymond Aron, lui aussi, a été confronté avec le nazisme. En 1933, nommé à un poste d’assistant de philosophie en Allemagne, il découvre la montée hitlérienne. C’est une épreuve où il va apprendre le caractère précieux de la démocratie. Et dans cette tourmente, il forge un idéal de lucidité. La lucidité est la « première loi de l’esprit », écrit-il dès 1933 dans sa « lettre ouverte d’un jeune français à l’Allemagne » (p 73). Et sa ligne de conduite repose sur le « pluralisme culturel ». Face aux emportements, le choix de Raymond Aron est « une éthique intraitable du doute. « En ce sens, si l’on mentionne souvent Kant et Tocqueville comme les principales sources de sa pensée, on peut dire qu’Aron fut d’abord un disciple d’Aristote, ce grand philosophe de la prudence » (p 76). Ainsi célèbre-t-il « le suprême courage de la mesure ». C’est dans cet esprit que Raymond Aron a fait face aux totalitarismes, du fascisme au stalinisme.
Germaine Tillon
Au cours des années qui précèdent la guerre 1939-1945, Germaine Tillon est ethnologue, en recherche en Algérie chez les berbères Chaouis (p 105). En 1940, elle choisit la résistance et « crée, avec d’autres, le célèbre Réseau du Musée de l’Homme, un des premiers réseaux de résistance en territoire occupé » (p 106). Elle est déportée à Ravensbruck en 1943. A sa libération, elle poursuit son œuvre de recherche où elle tient ensemble « enquête serrée et expérience sensible» (p 108). Elle va écrire surtout des « essais », « autrement dit des livres qui avancent à tâtons en assumant leurs propres fragilité » (p 104). Durant la guerre d’Algérie, Germaine Tillon se bat, côté français pour que cessent les exécutions capitales, et, en même temps, elle dialogue avec un des meneurs algériens de la lutte armé » (p 111). « Femme de conviction, elle préservait cependant comme un trésor fragile la nécessité de ne jamais leur sacrifier la vérité et la possibilité de nouer des liens authentiques avec des gens aux idées différentes, voire opposées » (p 111).
Albert Camus
Albert Camus est lui aussi interpellé par la guerre d’Algérie puisqu’il est originaire de ce pays. « Né en Algérie au sein d’une famille modeste, très tôt orphelin de père, élevé par une grand-mère pénible et une mère illettrée, l’auteur de « La Peste » a été atteint par la tuberculose alors qu’il n’avait que 17 ans » (p 24). C’est une dure épreuve. Ce fut une expérience subie, mais « sa patience n’en demeura pas moins active ». Contre les rigidités « d’un rationalisme sans nuance, elle nourrit des engagements ancrés dans la vie sensible. Ainsi, on ne comprend rien aux positions de Camus sur la guerre d’Algérie si on n’a pas en tête le lien si charnel qui a uni ce fils de pied noirs aux êtres et aux paysages de ce pays. Au moment de la guerre d’Algérie, il formule l’impossible rêve d’une formule « fédérale », qui aurait permis à la fois la fin du système colonial et l’invention d’un nouveau « vivre ensemble », mais cela ne l’a pas empêché de défendre très tôt les nationalistes algériens et leur lutte contre la puissance française, ses lois d’exception et ses « codes inhumains » (p 25). Inscrit au parti communiste dans sa première jeunesse, Camus en a été banni. Il formule à son égard deux griefs qu’il « relancera plus tard au fil des années, en direction des intellectuels « progressistes » : d’une part, la prétention à faire entre la réalité sociale dans un carcan théorique, d’autre part, le refus d’admettre qu’un adversaire politique peut avoir raison » (p 26)… « Manichéisme politique et mensonge existentiel sont inséparables. La langue de bois est secrétée par un cœur en toc » (p 26).
Albert Camus a suivi un sentier étroit, mais juste. « Comment concilier indignation et lucidité ? Un être humain peut-il donner libre cours à son « goût pour la justice » et, en même temps, « tenir les yeux ouverts ? » (p 26). « Il y a un courage des limites, une radicalité de la mesure » (p 27).
Roland Barthes
Jean Birnbaum adjoint à cet ensemble de portraits, Roland Barthes, philosophe, critique littéraire et sémiologue.
« Barthes s’est fixé cette tâche impossible, non seulement prendre soin des mots, mais encore ne jamais laisser le langage se figer, toujours le maintenir dans cet état de révolution permanente qu’on appelle littérature » (p 118). Roland Barthes distingue une « parole ouverte » en terme de souffle et une « parole fermée », hermétique, comme un bloc de clichés, ce qu’il appelle la « brique » (p 119). Lors d’un voyage dans la Chine Maoïste, Roland Barthes saisit « la tyrannie des stéréotypes » (p 121) et il étouffe. A partir des années 1970, « le sémiologue fait de la nuance un souci constant et une méthode active. Je veux vivre selon la nuance », proclame-t-il » (p 122). Ainsi, « maitresse des nuances, la littérature est une permanente remise en question, une parade face aux dogmatismes » (p 122). Roland Barthes s’établit dans le « refus du surplomb », le « refus de l’arrogance ».
Des attitudes communes
Si le contexte d’une même époque est un dénominateur commun entre les personnalités évoquées dans ce livre, Jean Birnbaum voit chez eux des attitudes voisines. Et il évoque cette perception dans de courts chapitres intermédiaires, des « interludes ». Les titres en sont parlants : « Des mots libres pour des hommes libres » ; « Il faut parler franc » ; « La blague est quelque chose d’essentiel » ; « Vous avez dit : « faire le jeu de » ; « L’inconnu, c’est encore et toujours notre âme » ; « La littérature, maitresse des nuances ». On reconnaitra là les remarques de l’auteur à propos des personnalités évoquées dans ce livre. Jean Birnbaum les a choisis dans une communauté d’attitudes et de démarches : « Les hommes et les femmes que j’ai voulu réunir dans ce livre, ne savaient pas où se mettre. Ils étaient trop nuancés pour s’aligner sur des slogans. Trop libres pour supporter la discipline d’un parti. Trop sincères pour renoncer à la franchise. Trop mobiles pour obéir à une politique de frontières… » (p 129). Ces diverses figures « s’inscrivent dans une même constellation de sensibilité et de vigilance », ce que Hannah Arendt nommait « une tradition cachée » (p 130). Alors, nous dit Jean Birnbaum, « J’ai voulu… entendre cette petite troupe d’esprits hardis, délivrés de tout fanatisme, qui ont accepté de vivre dans la contradiction, et préféré réfléchir que haïr » (p 137).
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » affirme la déclaration universelle des droits de l’homme dans son article 18 et l’article 19 ajoute : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression » (3). Malheureusement, il y a encore certains états où ces libertés sont bafouées. Il y faut du courage pour penser, c’est à dire penser librement. Cependant la menace vis à vis de l’exercice de la pensée ne vient pas seulement des pouvoirs politiques dictatoriaux. D’une façon plus subtile, elle peut aussi s’exercer à partir de pressions sociales et idéologiques dans une imitation servile. Des modèles s’imposent en terme d’oppositions simplistes, d’une pensée en blanc et noir. Ici, le courage de penser, c’est aussi le « courage de la nuance » pour reprendre le beau titre du livre de Jean Birnbaum. Les exemples vivants qu’il nous apporte en ce sens viennent nous accompagner et nous encourager.
J H
- Jean Birnbaum. Le courage de la nuance. Seuil, 2021 Interview vidéo de l’auteur : https://www.youtube.com/watch?v=o5fu8S1irZY
- Un silence religieux : https://vivreetesperer.com/un-silence-religieux/
- Liberté de penser. Liberté d’expression : http://www.francas40.fr/var/francas/storage/original/application/93286c030c46cedd732730e0917a7c13
La grande connexion
 Vivre au ciel maintenant
Vivre au ciel maintenant
Selon Richard Rohr
Les représentations du Ciel qui nous sont traditionnellement proposées nous renvoient au lointain et au futur, et son accès au conditionnel. Cependant, ce paysage est en voie d’évolution.
Dans une séquence sur « la communion des saints », Richard Rohr nous ouvre une vision évangélique en se fondant sur les paroles de Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples. Ici des interrelations s’affirment. Des barrières tombent : « Jésus leur dit toutes ces choses, et levant les yeux au ciel, il dit « Père, je ne demande pas pour ceux là seulement, mais aussi pour ceux qui croient en moi à travers leur parole : qu’ils puissent tous être un, de même que toi Père, tu es en moi et moi en toi, qu’ils puissent aussi être en nous de manière à ce que le monde puisse croire que tu m’as envoyé » (Jean 17. 1, 20-23).
« On peut voir dans cette prière le plus haut niveau de l’enseignement mystique du Nouveau Testament », écrit Richard Rohr. « Ici Jésus se connecte à tout. Il est dans le Père, le Père en vous, vous en Dieu, Dieu en lui, Dieu dans le monde et vous dans le monde. Tout cela est un ».
Pour Richard Rohr, c’est là le fond des choses. La relation est première. Nous ne vivons pas seuls, mais en relation. « Les saints voient les choses dans leur connexion et leur globalité ; ils ne voient pas les choses séparées. C’es tout un et cependant, comme la Trinité, c’est aussi différent. Ce que vous faites à l’autre, vous vous le faites à vous-même. Comme vous vous aimez vous-même, c’est aussi comme vous aimez votre prochain. Comme vous aimez Dieu, c’est comme vous vous aimez vous même. Comme vous vous aimez vous même, c’est comme vous aimez Dieu. Comme vous faites une chose, c’est comme vous faites toutes les choses ». Nous pouvons nous interroger dans cette perspective sur notre manière de vivre.
De même, cette approche nous appelle à discerner, à voir la réalité en profondeur. « La foi, ce n’est pas simplement voir les choses en surface, mais à reconnaître leur signification profonde. Etre une personne de foi signifie que nous voyons les choses – les gens, les animaux, les plantes, la terre – comme intrinsèquement connectés à Dieu, connectés à nous-mêmes et donc absolument dignes d’amour et de dignité. C’est pour cela que Jésus a prié : Pour que nous voyons les choses dans leur unité, dans leur connexion ».
Où en sommes nous dans ce regard ? Notre maturité spirituelle est fonction de notre degré d’évolution dans la manière de percevoir notre connexion, nos interrelations. C’est ce que nous dit Richard Rohr : « Plus nous pouvons nous connecter, plus il y a de la sainteté en nous. Moins nous pouvons nous connecter, moins nous sommes transformés. Si nous ne pouvons pas nous connecter avec des gens d’autres religions, d’autres classes, d’autres races, avec nos « ennemis » ou avec ceux qui sont en souffrance, nous ne sommes pas très convertis. Les gens vraiment transformés sont capables d’une reconnaissance universelle… »
Notre manière de voir a des conséquences quant à notre manière de voir le « ciel ». « Nous n’allons pas au ciel, nous apprenons à vivre dans le ciel maintenant », écrit Richard Rohr. « Et personne ne vit seul au ciel. Ou nous apprenons à vivre en communion avec d’autres gens et avec tout ce que Dieu a créé, ou bien, très simplement, nous ne sommes pas prêts pour le ciel… »
Ainsi quel est le chemin ? « Nous avons été invités, même maintenant, même aujourd’hui, même en ce moment, à vivre consciemment dans la communion des saints, dans la Présence, dans le Corps, dans la Vie du Christ éternellement Ressuscité ».
J H
- Une méditation de Richard Rohr dans son site : Center for action and meditation : Living in Heaven now Vendredi 12 mars 2021 https://cac.org/living-in-heaven-now-2021-03-12/
Voir aussi ces autres méditations de Richard Rohr
Enlever le voile : https://vivreetesperer.com/enlever-le-voile/
L’homme, la nature et Dieu : https://vivreetesperer.com/lhomme-la-nature-et-dieu/
Créativité et sagesse
 Le parcours d’Angélique Kidjo du Bénin à une vie internationale
Le parcours d’Angélique Kidjo du Bénin à une vie internationale
Un petit livre vient de paraître dans une nouvelle collection : « Je chemine avec Angélique Kidjo » (1). Ainsi, à travers des entretiens avec Sophie Lhullier, nous découvrons le parcours et le témoignage d’une chanteuse réputée internationalement. La collection elle-même mérite attention. Elle est destinée aux jeunes. « Comment trouve-t-on sa voie ? Quand nous demande-t-on ce qui nous anime, ce qui nous donnerait envie de nous lever le matin ? D’ou l’idée de partager l’exemple de possibles, de récits de vie de personnalités très différentes, mais toutes libres et passionnées ». En fait, le public s’étend bien au delà des jeunes, à tous ceux qui se veulent à l’écoute, en mouvement.
Nous avons découvert la personnalité d’Angélique Kidjo à travers le message d’une amie sur facebook . Effectivement, ce livre nous présente un récit de vie particulièrement instructif à double titre : il nous présente un témoignage où nous voyons un fil conducteur ; sagesse et éthique, et, en même temps, il nous permet de mieux comprendre comment un nouveau monde est en train de se construire, un monde en transformation où chacun d’entre nous compte et est appelé à jouer un rôle constructif. Il y a là une lecture, tonique, encourageante, à partager.
Un parcours international
Le parcours d’Angélique Kidjo nous est présenté dans une introduction (p 8-9) : Elle nait au Bénin en 1960, deux semaines avant l’indépendance. « Elle y vit une enfance entourée de parents ouverts et d’une fratrie de musiciens ». Toute petite fille, elle commence à chanter. Dans une ambiance favorable, elle apparaît très vite sur scène. Et « elle devient une star au Bénin à 19 ans ». « En 1983, ne pouvant plus s’exprimer en tant qu’artiste en raison de la dictature, Angélique Kidjo décide de fuir en France pour continuer à chanter librement. Elle repart à zéro, s’inscrit dans une école de jazz où elle rencontre son futur mari, Jean Hebrail. Depuis, ils n’ont cessé de travailler ensemble. En 1991, elle sort son premier album français : « Logozo » dont le succès est immédiat et international. ». En 1998, Angélique et son mari s’installent aux Etats-Unis où ils vivent depuis lors. La créativité musicale d’Angélique Kidjo s’y déploie brillamment. Elle réalise de nombreux albums « intimement liés à l’histoire de l’Afrique et aux droits humains ». « Elle associe, avec brio, la beauté des musiques traditionnelles d’Afrique à l’énergie et à la vivacité des musiques contemporaines. Par le chant, elle cherche à rassembler les peuples et les cultures, à pacifier les relations… ». Angélique Kidjo est également engagée socialement. « Elle est ambassadrice de bonne volonté de l’Unicef depuis 2002. Pour elle, tant que l’éducation ne sera pas devenus la priorité de tous les adultes, le justice et la paix ne pourront pas régner dans le monde. C’est pourquoi, elle a créé en 2006 sa fondation Batonga qui oeuvre en faveur de l’éducation secondaire des jeunes filles africaines.
Une source inspirante.
L’éducation d’Angélique dans une famille pionnière.
Au cours de cet entretien, on découvre combien la famille d’Angélique joué un rôle majeur dans sa formation et son orientation.
Non seulement cette famille l’a encouragé dans le développement de ses dons et ses talents, mais elle a participé à l’adoption de valeurs fondatrices. Il y a là un fait original, car cette famille était particulièrement ouverte. Ainsi a-t-elle reçu une éducation « atypique », orientée vers la bienveillance, l’accueil et le respect de la femme. Son père croyait hautement à l’importance de l’éducation scolaire, envoyant à l’école ses nombreux enfants, les filles comme les garçons. Il appelait sa fille à réfléchir par elle-même, mais aussi à tenir compte des autres et à savoir se remettre en cause. « J’ai été éduquée dans cette logique d’associer la tête et le cœur à toute réflexion » (p 12). Et aussi, son père manifestait une attitude de bienveillance et de compréhension. Un jour qu’Angélique s’était violemment emportée en découvrant la réalité de l’apartheid, son père lui a dit : Tu as le droit d’être en colère et de ne pas comprendre pourquoi il y a l’apartheid en Afrique du sud, mais jamais je ne te laisserai aller vers la haine et la violence… Que veux-tu ? Comment vois-tu la vie ? Tu veux un monde de guerre perpétuelle ou tu veux que l’on arrive un jour à comprendre que nos différences sont nos forces et pas nos faiblesses… » (p 31). Angélique a réfléchi et a réécrit la chanson qui faisait problème. Son père respectait la vocation de sa femme à la tête d’une compagnie de théâtre. Angélique a intégré celle-ci à l’âge de six ans. « La personne que je suis a commencé à se construire là » (p 13). Son père et sa mère étaient féministes. « Sa mère a élevé ses garçons de la même manière que les filles (p 12).
Angélique s’est interrogée sur la personnalité « atypique » de ses deux parents. Elle y voit l’influence des ses deux grands-mères, veuves très jeunes et qui sont devenues des « femmes fortes » engagées dans une activité marchande.
Un autre élément est intervenu dans la formation d’Angélique : la présence d’une nombreuse fratrie. Ses frères jouaient tous d’un instrument et ils étaient très engagés dans la musique. Angélique a chanté depuis la petite enfance et elle a grandi en écoutant beaucoup de musique depuis la musique traditionnelle jusqu’à pratiquement toutes les musiques du monde » (p 13). Ainsi, ce livre nous éclaire sur le contexte dans laquelle la personnalité d’Angélique s’est forgée. Et, de plus, dans la sympathie éveillée par cette lecture, nous apprenons beaucoup sur la civilisation africaine et sur son évolution.
Toute créativité
Un parcours musical exceptionnel
A 23 ans, Angélique arrive en France. Elle réussit une adaptation difficile en s’engageant dans une formation musicale et c’est dans une école de jazz qu’elle rencontre Jean Hebrail, bassiste, compositeur qui devient son mari. De rencontre en rencontre, elle trouve une reconnaissance et une aide pour s’exprimer. Angélique nous décrit cet univers et rend hommage à ceux qui ont choisi de travailler avec elle. Ses albums rencontrent de grand succès. Ce fut le cas de « Logozo » en 1991. Des concerts en résultent jusqu’en Australie. Dea tournées s’organisent autour de ces succès comme « Agolo » (terre nourricière). En 1998, Angélique et son mari s’installent aux Etats-Unis où ils vont résider jusqu’à aujourd’hui. Elle y réalise une trilogie musicale sur l’esclavage (p 66). Aujourd’hui, la réputation d’Angélique Kidjo est internationale. Ainsi, on lui a demandé de chanter devant un parterre de chefs d’état lors du centenaire de l’armistice du 11 novembre 2018 (2).
Cette carrière musicale témoigne d’un dynamisme considérable. En effet, il n’y a pas seulement une grande créativité artistique, mais il y a aussi une intense activité relationnelle. Celle-ci se manifeste notamment dans le travail quotidien avec de nombreux collaborateurs. « Choisir le bon manager et le bon producteur, c’est capital dans la profession ». Et pour ses albums, il y a chaque fois un choix de partenaires, de musiciens. « On ne se fait pas tout seul, jamais. Beaucoup de soutiens m’ont ouvert les voies. J’essaie de ne jamais l’oublier. C’est pour cela que je fais le maximum pour aider autour de moi » (p 65). Sur la scène, il y a également une relation intense avec le public. « On n’est jamais artiste seul. Sans public, il n’y a pas d’artiste. Tu crées à partir de ce qui est au fond de toi, de ce que tu as vécu, mais aussi ce que d’autres ont vécu et de ce que tu as vécu à travers eux » (p 102).
Au total, il y a un fil conducteur, c’est l’inspiration. « Quand on écrit, comme dit Philip Glass, c’est du domaine de l’inconnu. Ce n’est pas toi qui décide du moment où les mots ou la musique doivent sortir. Et quand ça vient, il faut essayer de préserver tel quel ce qui arrive » (p 102).
L’Afrique au cœur
Angélique vient d’une famille africaine avancée dans l’affirmation du respect des autres, du respect des femmes. Son témoignage nous fait part de l’exemple donné par son père et par sa mère dans l’héritage d’une lignée de grand-mères, « femmes puissantes ». C’est un rappel de l’influence de choix personnels bien au delà du présent immédiat, car Angélique a porté ensuite ces valeurs de respect, ce refus de la haine et de la violence. Et de même, la vocation musicale d’Angélique s’enracine dans sa famille. Elle s’inscrit également dans le contexte de la culture africaine. C’est au Bénin qu’elle a appris la musique. Et, dans sa réussite de chanteuse, elle a repris l’héritage des rythmes africains et elle a écrit ses chansons dans des langues africaines. Elle nous dit parler quatre langues du Bénin : le fon, le yoruba, le goun et le mina (p 83). L’œuvre d’Angélique Kodjo a porté haut la culture musicale africaine qu’elle retrouve également dans la diaspora et, particulièrement, dans la descendance de l’esclavage présente en Amérique des Etats-Unis au Brésil en passant par les Antilles. Dans ce mouvement, Angélique Kodjo a réalisé une trilogie musicale sur l’esclavage.
Dans cet entretien, elle nous rappelle maintes fois cette histoire douloureuse dont nous méconnaissons trop souvent la charge et l’importance. « la violence de nos sociétés est un héritage de l’esclavage… On commence seulement à se poser la question de savoir pourquoi l’Afrique, un continent riche (en matières premières, en forces vitales), compte le plus de pauvreté. L’exploitation des richesses de l’Afrique par les pays occidentaux perpétue ce système inégalitaire auquel il faut mettre fin. Et si on commence à examiner l’histoire économique mondiale, on se rend compte que c’est le travail des esclaves qui a financé la richesse des pays occidentaux et a fondé un capitalisme inhumain. Aux Etats-Unis, les esclaves ont travaillé quatre cent ans sans être payés… Tant que cette réalité historique ne sera pas reconnue, nous ne pourrons pas progresser parce que le poison de l’humiliation et de la déshumanisation des africains restera au cœur des sociétés » (p 127-128). « Il faut également se souvenir que jusqu’à la Renaissance, on trouvait en Afrique, des sociétés, des royaumes, de l’architecture d’un niveau comparable à l’Europe. Tout un pan africain de l’histoire de l’humanité a été occulté pendant longtemps (p 128-129).
Angélique Kidjo porte l’Afrique dans son cœur. Déjà décrite, c’est la présence de l’Afrique dans ses chants et sa musique. Ainsi, dans un album comme « Djin Djin », elle a voulu partager sa culture béninoise avec des musiciens béninois actuels. (p 76). Et puis, elle est également engagée socialement au service de l’Afrique à l’Unicef et dans la fondation Batonga qui œuvre pour l’éducation secondaire des jeunes filles en Afrique.
Une sagesse. Une éthique
Des valeurs vécues au quotidien
Au tout début de l’interview, Angélique Kidjo proclame une vision universaliste de l’être humain : « Avant d’être femme, avant d’être noire, je suis un être humain » (p 12). Et elle rappelle ensuite son vécu familial où elle a appris le respect des autre qui est aussi le respect de la femme et qui se manifeste par une hospitalité ouverte. Elle y a appris également à rejeter la haine et à refuser la violence.
Le respect des autre, c’est aussi le respect de soi-même, et par là même, une hygiène de vie. Cette hygiène de vie lui paraît indispensable dans son métier de chanteuse. « Les cordes vocales sont comme les muscles » (p 95). Il y a donc des règles de vie importantes : bien dormir, avoir une alimentation saine, ne pas fumer ou boire de l’alcool. Depuis une dizaine d’années, Angélique pratique la méditation. « Tous les voyages que j’ai fait, m’auraient tué sans la méditation » (p 97).
La sagesse, c’est aussi ne pas s’enorgueuillir : « Savoir rester humble….Tu es au service de ton inspiration. Laisse ta chanson se faire. Cette vulnérabilité te permet de saisir clairement ce dont tu as envie…. Quand l’inspiration se présente, le moment est tellement fugace que si tu n’adoptes pas une posture d’humilité, tu risques de passer à côté » (p 103-104).
Angélique Kidjo trouve des joies intenses dans son métier de chanteuse. C’est le plaisir de chanter, le bonheur d’être en scène (p 104), mais c’est aussi le travail d’équipe. Angélique est très sensible à l’accueil du public. Il y a des personnes qui se mettent en mouvement parce qu’elles trouvent une énergie, une espérance dans les chansons d’Angélique.
Il y a une dynamique de vie dans ses chansons. Angélique déplore l’individualisme qui règne en France, une attitude très différente de celle qui prévaut en Afrique. « Quand je rencontre quelqu’un chez moi dans ma ville à Cotonou, on se dit bonjour, on se répond… Quand je suis arrivée en France, quand je rencontrais les voisins de l’immeuble dans les escaliers et que je leur disais bonjour, ils se collaient au mur comme si j’allais les agresser.. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre, c’est souvent ça pour moi, les pays riches » (p 108-109).
Angélique Kidjo a toujours eu un sens aigu de la justice, mais très jeune, elle a découvert le danger de la violence (p 25). Et elle a adopté le même refus de la haine que celui de ses parents. « Chanter est ma responsabilité. Il ne faut pas la prendre à la légère. Il ne faut pas chanter la haine » (p 117). « Que demande l’amour ? Déjà que l’on s’aime soi-même avec ses défauts et ses qualités, que l’on soit prêt à être vulnérable et rejeté dans cet amour, pour ensuite retrouver la force dans ce rejet. La haine ne demande rien. La haine se nourrit de la haine . La colère, même à toute petite dose, se transforme rapidement en un problème insurmontable. Puis tu commences à haïr et le temps que tu alimente cette haine, tu ne sais même plus pourquoi elle est apparue. Tu entres dans le vortex de la haine qui va te broyer parce qu’elle n’apporte que violence et destruction. La haine nait de la peur. De quoi avons nous peur ? (p 131-132).
Angélique et Jean ont une fille, Naima, grande maintenant. Naima a reçu une éducation internationale incluant ses origines béninoises. La manière dont Angélique parle de l’éducation de sa fille témoigne de ses valeurs. « Ce que j’espère lui avoir transmis, c’est cette valeur fondamentale : « Aime-toi, respecte-toi et respecte les autres. Et ne fais jamais subir à autrui ce que tu ne voudrais pas subir toi-même » (p 142).
« Je chemine avec Angélique Kidjo » : La conversation qui se déroule à travers l’interview est très agréable à suivre. Elle suscite de la sympathie et elle est aussi très instructive.
Certes nos goûts musicaux sont différents les uns des autres. On ne se reconnaît pas nécessairement dans telle musique. Mais n’y a-t-il pas là aussi à apprendre du nouveau ?
Voici un livre qui élargit notre vision.
Nous y apprenons la vitalité créative de l’Afrique, la richesse de la civilisation africaine.
Cette richesse s’exprime notamment dans la musique et nous en y voyons ici la dimension internationale.
Ce livre nous rappelle également l’ampleur des méfaits de l’esclavage. C’est une réalité que nous avons trop tendance à oublier.
Voici également un message tonique. C’est l’importance des choix et des attitudes personnelles. Parce qu’un père et une mère ont choisi le respect des autres et, à une échelle plus vaste, le respect de la femme, un sain féminisme, leur fille Angélique, a pu trouver là une inspiration et se déployer dans une vie ouverte et créative. Au delà de son pays d’origine, elle nous apporte un message de paix dans une convivialité internationale.
Si il y a aujourd’hui beaucoup d’ombre dans ce monde, il y a aussi de la lumière. Angélique Kidjo nous apporte une dynamique de vie qui vient nous éclairer. Oui, le titre du livre est bien choisi : « Je chemine avec Angélique Kidjo ». Angélique nous accompagne.
J H
- Angélique Kidjo. Je chemine avec Angélique Kidjo. Entretiens menés avec Sophie Lhuillier. Seuil, 2021
- Angélique Kidjo a écrit précédemment des mémoires : « La voix est le miroir de l’âme » (2017) Elle est interviewée à ce sujet : https://www.youtube.com/watch?v=DDKEr1FLfFs
- « Pour le 11 novembre, Angélique Kidjo a ému les spectateurs ave la chanson de « Blewu » : https://www.youtube.com/watch?v=j5jk4sr6Upg
Paul : sa vie et son œuvre, selon NT Wright
 Une nouvelle vision du monde, une nouvelle manière de croire à la suite de Jésus, mort et ressuscité
Une nouvelle vision du monde, une nouvelle manière de croire à la suite de Jésus, mort et ressuscité
Les grands penseurs du passé nous inspirent encore aujourd’hui. Paul, au départ Saul de Tarse, puis souvent appelé saint Paul ou l’apôtre Paul fait partie de ces penseurs, bien qu’il ait été aussi un homme d’action, pionnier des premières communautés chrétiennes dans le monde gréco-romain.
Mais pourquoi nous intéresser à Paul aujourd’hui ? Dans un contexte ou le christianisme institutionnel décline, non sans rapport avec un ordre patriarcal et hiérarchique, on regarde de plus en plus aujourd’hui vers la dynamique du christianisme dans les deux premiers siècles, la période de l’« invention du christianisme » selon le titre d’un ouvrage collectif consacré à ce thème (1). On y remarque que la référence à Jésus apparaît très tôt après son départ, dès le début des années 50 dans les épitres de Paul, bien avant la rédaction des évangiles. Paul ne crée pas seulement des églises dans le monde gréco-romain, il se fonde sur la mort et la résurrection de Jésus et l’interprète comme un événement déterminant dans l’histoire du monde. Quelle signification pour nous aujourd’hui ? Or, un grand exégète britannique et par ailleurs, auteur de nombreux livres, N T Wright vient d’écrire une biographie de Paul (2) qui répond à nos questions.
Un nouveau monde en gestation
Au départ N T Wright dissipe un malentendu. Dans le passé et jusque dans la jeunesse de l’auteur, beaucoup de chrétiens percevaient le christianisme dans une perspective de salut individuel : « aller au ciel au moment de la mort » ; être « sauvé » et être « glorifié », pour reprendre les termes de Paul, signifiait « aller au ciel ». C’était une attente en rapport avec des « questions médiévales ». « Le cadre de la terre et du ciel a été une construction du haut Moyen Age ». Or, « Les chrétiens du premier siècle n’attendaient pas que leurs âmes quittent le monde présent matériel ». Ce qui était premier pour Paul et les nouveaux chrétiens, c’était « la venue conjuguée du ciel et de la terre dans un grand acte de renouveau cosmique dans lequel les corps humains seraient renouvelés pour prendre leur place dans ce nouveau monde » (p 8). Paul a une vision nouvelle de l’histoire. Il parlait de l’histoire comme ce qui arrive dans le monde réel : le monde de l’espace, du temps et de la matière. Il était un juif qui croyait dans la bonté de la création originelle et à l’intention du Créateur de renouveler ce monde. Son évangile de salut portait sur le Messie d’Israël comme cela avait été promis dans les psaumes. Ce que Dieu avait fait en Jésus et à travers lui c’était un mouvement « ciel et terre » et non d’offrir un espace extra-terrestre.
Le message de Paul
N T Wright nous rapporte la vie de Paul dans un univers multiculturel. Mais le message de Paul n’est pas une synthèse philosophique. Il se fonde sur un événement, la mort et la résurrection de Jésus, et il s’enracine dans la culture juive, dans une histoire. Cette histoire est « l’histoire d’Israël comme enfants d’Abraham, Israël choisi par Dieu, choisi dans le monde, mais également Israël choisi pour le monde, Israël, le peuple de la Pâques sauvé de l’esclavage, le peuple avec lequel Dieu a fait alliance, le peuple à travers lequel toutes les nations seront bénies » (p 18). A l’époque, des signes donnent à penser que pour beaucoup de juifs, la Bible n’était pas d’abord un ensemble de règles et de prescriptions, mais un grand récit ancré dans la création et dans l’alliance et avançant dans l’ombre de l’inconnu (p 18). Et cette histoire n’était pas terminée. Elle était accompagnée de promesses et débouchait sur une espérance : un nouvel exode, une nouvelle restauration (p 19). Dans la révélation de Jésus, mort et ressuscité, Paul envisage cette histoire dans une perspective universaliste. Ainsi va-t-il appeler les juifs comme les non-juifs à entrer dans le mouvement de Jésus. Ainsi les épitres nous proposent un message à la dimension du monde entier. N T Wright évoque plusieurs textes de la Bible qui inspirent cette approche. Ainsi le psaume 2 : « Tu es mon fils. Aujourd’hui je t’ai engendré. Demande-moi et je te donne les nations en héritage, pour domaine, la terre toute entière ». Paul croit qu’à travers Jésus, sa mort et sa résurrection, le Dieu Un a vaincu toutes les puissances néfastes exerçant une emprise sur le monde. Et le pardon est accordé à tous. Cela signifie que tous les hommes, et pas seulement les juifs, sont libres pour adorer le Dieu Un. « Il n’y a plus de barrières entre juifs et non juifs » (p 79) ;
Des communautés nouvelles. Un nouveau genre de vie
Les nouvelles communautés qui apparaissent rassemblent des juifs et des non-juifs dans un nouveau genre de vie. Elles dépassent et traversent les frontières de « la culture, du genre, de l’ethnie, du milieu social », elles sont contre-culturelles, une réalisation unique à l’époque. (p 91). Ce mouvement est « profondément dépendant de « la présence et de l’inspiration puissante du Saint Esprit », dans le déploiement d’une grande énergie (p 93). Le nouveau genre de vie, qui apparaît ici, sera, dans le long terme, le point de départ d’un changement des mentalités et d’une révolution sociale politique, telle que nous la décrit l’historien britannique, Tom Holland, dans son livre : « les chrétiens. Comment ils ont changé le monde » (4). « La vision de Paul était celle d’une société dans laquelle chacun travaille pour tous et tous pour chacun » (p 427).
Genèse d’une théologie
Cependant l’apport principal de ce livre ne nous parait pas là. Ce livre n’étudie pas seulement la vie de Paul dans les différente étapes de sa vie, la fondation des communautés et la rédaction des lettres qu’il leur adresse : les épitres, mais il analyse l’inspiration de ces épitres dans leur apport retentissant. Ce qu’il nous dit, c’est que la pensée de Paul se fonde sur l’événement de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, qu’elle s’appuie sur le récit biblique en proclamant l’accomplissement du plan divin à long terme (p 119). « Le Créateur du monde a réalisé en Jésus la chose qu’il avait promise, accomplissant le récit ancien qui remonte à Abraham et à David… Les échecs sont maintenant surmontés. La mort du Messie a vaincu les puissances qui asservissaient à la fois les juifs et les gentils et sa résurrection a lancé un nouvel ordre du monde « sur terre comme au ciel ». Il y a maintenant un seul peuple, le peuple du Messie (p 130).
Si ce message a été écrit dans un lointain passé, il nous paraît qu’il demeure actuel aujourd’hui. Il peut être entendu par ceux qui gardent une mémoire malheureuse d’une religion qui se détournerait du monde et trierait les personnes dans leur destinée. Il peut être entendu par nous tous en quête de boussole dans un monde incertain. A partir de la mort de la résurrection de Jésus, c’est une dynamique de vie qui s’exprime là. La théologie de l’espérance que nous apporte par ailleurs Jürgen Moltmann (4) s’appuie sur cette dynamique. Elle s’inscrit dans cette perspective « eschatologique ». Elle met en valeur la « nouvelle création » qui est en route en Christ. Et comme l’exprime Jürgen Moltmann, c’est une religion tournée vers l’avenir. On retrouve ici la vision de Paul : une dynamique de vie.
J H
- Sous la direction de Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim. Après Jésus. L’invention du christianisme. Albin Michel, 2020
- N T Wright. Paul. A biography. Harper One, 2018
- Comment l’esprit de l’Evangile a imprégné les mentalités occidentales et quoiqu’on dise, reste actif aujourd’hui : https://vivreetesperer.com/comment-lesprit-de-levangile-a-impregne-les-mentalites-occidentales-et-quoiquon-dise-reste-actif-aujourdhui/
- Jürgen Moltmann est très présent sur ce blog. Un blog : Vivre par l’Esprit, est spécialement dédié à son œuvre théologique : https://lire-moltmann.com
Une émotion à surmonter : la peur
Une approche psycho-spirituelle de Thomas d’Ansembourg
Si on compte sept émotions de base parmi lesquelles la peur, la colère, la tristesse, la joie, la peur est l’une de celles qui est la plus difficile à gérer. Dans une série de courtes vidéos interview chez les « dominicains de Belgique », Thomas d’Ansembourg dont on sait sur ce blog combien son apport (1) est innovant et encourageant, parle de plusieurs émotions et ici de la peur (2). Son enseignement est précieux.
La peur, un indicateur à prendre en compte
« La peur est une des émotions les plus récurrentes. Elle indique bien sûr un besoin de sécurité. Lorsque nous avons peur, c’est que nous ne nous sentons pas en sécurité. Le besoin de sécurité est fondamental pour tout être vivant et, bien sur, particulièrement pour nous, êtres humains qui sommes assez fragiles et donc, nous avons besoin de savoir comment prendre soin de notre besoin de sécurité qui peut se vivre sur différents plans. Ce peut-être un besoin de sécurité physique, un besoin de sécurité matérielle ou un besoin de sécurité affective et relationnelle ».
Thomas d’Ansembourg envisage la peur comme un clignotant (un clignotant sur un tableau de bord), « un clignotant par rapport à un besoin qui n’est pas satisfait, le besoin de sécurité ». « Pour pouvoir dépasser la peur, cela nous demande de pouvoir l’écouter ». Thomas nous invite à visualiser cette attitude d’écoute par le geste de rapprocher une chaise, « pouvoir nous asseoir à coté de notre peur » et dialoguer avec elle. « Viens ici ma peur. Qu’est ce que tu as à me dire ? C’est quoi ton message ? ». « Et la plupart du temps, si j’écoute, je vais recevoir son message : j’aurais besoin de faire confiance dans la vie, de faire confiance dans les gens, de faire confiance à mon ‘enfant’, de faire confiance à moi ». Elargir notre champ de. discernement… « Assez souvent, la peur renseigne sur un besoin d’estime de soi. L’estime de soi, ce n’est pas un petit besoin. 90% de la population éprouve un besoin d’estime de soi. C’est un besoin que j’ai eu moi-même à travailler en entrant en thérapie : trouver une juste estime de moi. Pour ce qui est d’avoir peur de la pression sociale des jugements, des critiques et d’arriver à trouver sa façon, son autonomie, nous avons besoin d’apprendre ».
La peur peut être apprivoisée à travers des dialogues réguliers. « La peur est comme un chien de garde dans une maison. Elle nous avertit d’un danger. Peut-être que tu vas trop vite, peut-être trop lentement. Fais attention à ceci. Fais attention à cela. On va écouter le message du chien de garde. Cela, c’est le dialogue intérieur. Et ensuite, j’ai compris le message et alors je renvoie la peur parce que j’ai compris.
Ce qui est précieux, ce n’est pas de ne pas avoir peur. C’est ne pas avoir peur d’avoir peur. Nous pouvons acquérir une plus grande capacité de cohabiter avec cette émotion, à la dépasser. Le risque, c’est que le chien de garde prenne toute la place. Beaucoup de gens sont terrorisés par la peur. Ecouter le message, ajuster le comportement, reconnaître la peur pour sa fonction, cela ne tombe pas du ciel. Ce sont des apprentissages à faire petit à petit ».
Une confiance à développer
Thomas d’Ansembourg nous propose une vision positive : « Dans mon expérience d’accompagnement des personnes… je réalise que l’enjeu est de taille : Nous avons à faire confiance dans la beauté et la bonté de la Vie. La maman qui a peur de tout, qui a peur que tout arrive, qui interdit aux enfants de sortir, est bien intentionnée, mais elle est tellement terrorisée qu’elle n’a pas confiance dans la vie. Elle pourrait étouffer ses enfants et casser leur confiance en soi. Elle a donc besoin, pour encourager leur confiance en soi, de retrouver elle-même la confiance en elle. J’ai besoin d’apprendre à faire confiance dans la Vie. La Vie ne veut pas du mal. La Vie veut du bien. Et donc, il y a une dimension spirituelle de la peur. Plus nous entrerons dans une connaissance profonde de nous-même, la dimension du souffle qui nous habite, la dimension d’appartenance à ce projet magnifique qui va bien au delà de nous et qu’on appelle la Vie, plus nous fréquenterons les régions qu’on appelle Dieu, mais qu’on peut appeler l’Infini ou le Tout, plus nous sentirons que tout cela est soutenant, aimant et nous veut du bien. Inversement, en pensant à ma pratique, quand on n’a pas conscience de cela, quand nous nous sentons seuls, coupés, sans appartenance, alors nous commençons à avoir peur de tout. Il y a donc une dimension d’ouverture psycho-spirituelle qui nous permet… de tabler profondément de tout son être sur le fait que la vie nous veut du bien et d’entrer dans une voie d’expansion de nous-même ».
Des chemins différents
L’interviewer pose alors une question à Thomas d’Ansembourg : « Certains d’entre nous ont plus peur que d’autres . Comment peut-on expliquer cela ? C’est notre histoire personnelle ? Ce sont nos blessures ? ». « Il y a tout un cocktail d’éléments dans ce genre de choses : notre histoire personnelle, la manière dont on a grandi. Il y a les modèles qu’ont donné les parents (plutôt inquiets ou plutôt confiants…). Cela est très impressionnant, cela fait impression ». Les parents peuvent se demander « quels modèles ils donnent à leurs enfants : modèles de peur ou modèles de confiance, d’expansion, d’ouverture »…
« Arrivons-nous complètement indemnes ?… Je trouve intéressant d’ouvrir cette possibilité. Peut-être que je peux observer cela pour le démanteler petit à petit. Nous avons un libre examen. Et si nous prenons conscience de nos peurs, nous pouvons les démanteler » . L’interviewer évoque la psychologie transgénérationnelle. « Effectivement, nous pouvons reproduire des scénarios qui ont été vécu par nos grands-parents, nos arrière grands-parents et même des grands oncles. Donc c’est intéressant de ne pas subir l’avenir, de ne pas dire : je suis comme cela, je ne changerai pas. Non, nous avons un pouvoir de transformation considérable si nous portons les choses à la conscience et c’est cela l’enjeu… »
Un message de confiance
« L’idée que je porte chèrement dans mon cœur, c’est que nous avons la capacité de traverser les défis qui nous gênent. J’en suis convaincu. L’image de l’oiseau sur la branche peut nous aider. L’oiseau sur la branche n’a pas tellement confiance dans la branche parce qu’elle pourrait casser à tout moment, car fragile, un peu pourrie… L’oiseau a surtout confiance dans sa capacité de reprendre son envol si jamais la branche tombe. C’est à cela que j’invite les personnes : prendre conscience dans notre capacité à reprendre notre envol, à rouvrir nos ailes à dépasser les risques, si jamais risque il y avait.
Là, il y a vraiment la capacité d’un citoyen beaucoup plus inspiré et donc inspirant, un citoyen beaucoup plus pacifié et donc pacifiant parce qu’il a acquis cette confiance en soi, qu’il n’est plus dans le stress, l’agitation qui génèrent tellement de confusion aujourd’hui. »
La peur s’exprime parfois collectivement. Ainsi l’interviewer évoque le racisme. N’est-ce pas la peur de l’altérité, de la différence ? « Oui, bien sur, c’est une forme de peur : racisme, intégrisme, radicalisme, retour à la lettre du texte, aux traditions du passé… Tout cela c’est la peur de l’ouverture, du cheminement, de l’éveil, de la transformation… C’est une difficulté à accepter la nouveauté, le changement, la vie telle qu’elle et non pas telle qu’on voudrait qu’elle soit, accepter le cours des choses, être joyeux de ce qui est plutôt que de ce qui n’est pas… Donc on voit bien qu’il y a un travail psycho-spirituel de connaissance de soi, d’élargissement du discernement, d’ancrage dans nos valeurs, d’ouverture à la vie spirituelle qui peut nous aider à dépasser la peur sans la nier, mais à la dépasser, pour mieux vivre, une vie plus valide, plus généreuse… ».
Cette interview de Thomas d’Ansembourg est une ressource qui vient nous aider à affronter nos ressentis de peur. Elle est accessible et ouverte à tous. Le message chrétien nous invite également à ne pas craindre et à faire confiance. « Ne crains pas » est un des appels les plus répandus dans la parole biblique. Il est très présent dans l’Évangile. Ainsi parle Jésus : « Ne crains pas. Crois seulement » (Marc 5.36)(3). Ici, le remède à la peur, c’est la confiance, cette dernière étant présente dans l’étymologie du mot croire (4). Sur ce blog, on trouvera un témoignage d’Odile Hassenforder qui raconte, combien, dans une épreuve de santé, elle a été encouragée par quelqu’un qui ne disait pas aux autres : « bon courage », mais « confiance », « Dame confiance »… (5). L’élan de vie dont parle Thomas d’Ansembourg rejoint cette inspiration. Cette interview sur la peur comme émotion nous entraine dans une démarche psycho-spirituelle.
J H
- Thomas d’Ansembourg, sur le blog : Vivre et espérer : « Face à la violence, apprendre la paix » (avec des liens aux autres interviews de Thomas d’Ansembourg sur ce blog) : https://vivreetesperer.com/face-a-la-violence-apprendre-la-paix/
- Interview de Thomas d’Ansembourg sur la peur chez les dominicains de Belgique : https://www.youtube.com/watch?v=ujFSylfXkJA
- « Ne crains pas. Crois seulement » Un commentaire : https://passlemot.topchretien.com/ne-crains-pas-crois-seulement-mc-536-la-foi-nechou/
- A propos du verbe croire : https://www.rabbin-daniel-farhi.com/ambiguite-du-verbe-croire/1021
- « Dame confiance » sur : Vivre et espérer : https://vivreetesperer.com/dame-confiance/ Un écho à cet article : « Un message qui passe à travers les rencontres » : https://vivreetesperer.com/odile-hassenforder-sa-presence-dans-ma-vie-un-temoignage-vivant/
Une pratique de la joie
Selon Thomas d’Ansembourg
Thomas d’Ansembourg, que nous rencontrons fréquemment sur ce blog (1), nous parle des émotions dans plusieurs interviews vidéos chez « les dominicains de Belgique ». Parmi les émotions, il y a la peur (2), la tristesse, la colère, mais il y a aussi la joie (3). Nous pouvons bien rejoindre Thomas d’Ansembourg lorsqu’il déclare qu’il y a « une énergie magnifique dans la joie », mais alors comment la cultiver ?
La joie, est-ce possible ?
A partir de son expérience d’accompagnement de nombreuses personnes, Thomas d’Ansembourg peut estimer que « nous sommes joyeux par nature ». Les enfants ne sont-ils pas naturellement joyeux ? « Pourquoi les adultes ont-ils souvent déserté cette joie là ? ».
Il y a certes des explications en rapport avec la culture. « Les difficultés d’accès à la joie, à la joie durable que l’on peut reproduire et que l’on peut utiliser pour orienter sa vie, cette difficulté d’accès à la joie tient à ce que j’appelle la culture du malheur ». Nous avons grandi dans « une culture ambiante qui est plutôt basée sur les rapports de force » et qui hérite d’une mémoire collective rappelant des guerres, des épidémies, la mortalité infantile… « Tout cela s’est encodé dans notre inconscient ». Thomas d’Ansembourg en voit l’expression dans une inquiétude latente qui implique un repli : « On n’est pas là pour rigoler ». Cela joue comme un « vaccin anti-bonheur ». « On a envie d’être joyeux, mais on n’y accède pas ». Si on est joyeux, ce n’est pas pour longtemps. Car « on a peur d’un retour de manivelle ». « On espère le bonheur, mais on n’y accède pas. On ne s’y autorise pas ». Comme nous avons peur que la joie nous échappe, instinctivement, c’est nous-même qui nous la retirons. Comme cela, nous avons l’impression d’avoir du pouvoir sur notre propre vie. C’est ce qu’on appelle un mécanisme d’auto-sabotage. C’est peu connu. Seulement, si nous savions cela, nous pourrions observer un mécanisme de désamorçage et le réamorcer avant qu’il ne s’enclenche.
J’en parle en connaissance de cause m’étant moi-même retrouvé dans des mécanismes d’auto-sabotage que je n’imaginais pas du tout. Vous m’auriez demandé : « Qu’est-ce que vous cherchez à vivre », j’aurais répondu : j’ai envie d’être joyeux. J’ai envie d’être heureux. Mais je n’avais pas vu que c’était moi qui était en cause. J’attribuais mon problème aux autres, à mon travail, à ma compagne… J’avais du mal à identifier tout ce qui m’empêchait d’être joyeux ».
Apprendre à vivre davantage dans la joie.
Comment apprendre à être dans un état de joie de plus en plus régulier, ce qui n’empêche pas la traversée des difficultés, car nous ne vivons pas dans un monde idéal et nous devons faire face aux contrariétés. « Cependant, je crois que notre intention, notre sentiment profond, c’est de goûter de la joie malgré ces passages difficiles, de conserver de la joue à l’intérieur de soi. Comment apprendre cela ? Thomas d’Ansembourg reprend ici un petit exercice de dialogue avec un sentiment symbolisé par un fauteuil à côté de lui. « Apprendre à côtoyer la joie, à lui faire de la place. Je la goûte, je la savoure, je conjure la culture du malheur… ».
Thomas nous invite à observer les moments de la journée ou nous ressentons de la joie. « Si je suis heureux parce qu’il y a du soleil le matin, parce que le temps est beau, cela veut dire que j’aime la beauté, j’aime la douceur, j’aime la chaleur. Ce ne sont pas là des valeurs négligeables : beauté, douceur, chaleur. Qu’est-ce que je vais faire dans la journée pour reproduire et restaurer cela ?…. »
« Si j’ai partagé un repas avec quelques amis, je vais observer ce qui m’a rendu joyeux : l’amitié, la fidélité, la connivence, la rencontre authentique, la vulnérabilité que chacun accueille chez l’un, chez l’autre… Et j’aime cela. C’est comme cela que je veux vivre. Et donc dans mes rapports, je vais instaurer ou réinstaurer authenticité, intériorité, acceptation de la vulnérabilité, franchise… Je recrée parce que la joie me dit que c’est par là que je veux aller. Je l’instaure. »
Et si, pendant le week-end, j’ai promené les enfants dans la forêt et que je me suis enchanté, je vais décoder ce que me dit ma joie : nature, beauté, silence, présence des enfants… J’ai besoin de garder cela même quand je prends les transports en commun. J’ai besoin de garder le goût de l’émerveillement : regarder les gens, m’intéresser à leur vie… J’ai besoin de goûter le vivant partout où je suis et pas seulement dans une belle forêt, mais aussi dans le métro. Goûter le fait que je suis dans une communauté humaine qui est en marche, qui est en route… ». Ainsi, il est bon de décoder les moments de joie parce qu’ils nous indiquent notre fil rouge, comme une courbe croissante de cette joie que nous voudrions vivre.
« Accompagnant des personnes depuis vingt cinq ans, c’est ma conviction que nous cherchons à vivre cet état de joie profonde que j’appelle toujours un état de paix intérieure, de plus en plus stable, de plus en plus transportable dans les péripéties de la vie, un état de paix intérieure qui se révèle contagieux, généreux. Je pense que c’est notre véritable humanité d’apprendre à trouver cet état de paix intérieure qui permet d’être rayonnant, d’être contagieux dans notre état d’être. Cela ne nie pas les difficultés. Cela ne nie pas les tensions, les moments de désarroi. Mais plus je sais bien traiter ma colère, ma tristesse, ma peur, des parties de moi, pas tout moi, plus je sais écouter ces parties de moi, moins elles m’encombrent. Et plus mon espace qui est la joie prend de la place, s’installe, s’instaure, se stabilise. Pour moi, notre vraie nature, c’est d’être dans un état de plus en plus fréquent de joie intérieure. Et j’observe, dans mes lectures, que la plupart des traditions disent la même chose : être joyeux dans un monde vivant et être contagieux de notre joie ». A ce stade, l’interviewer rappelle la parole de Jésus : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ».
Pourquoi un univers médiatique si peu propice à une expression de joie ?
Constatant une avalanche de mauvaises nouvelles dans les médias, une situation peu propice à une expression de joie, l’interviewer questionne Thomas d’Ansembourg sur cet état de chose. « On se plaint de cette offre de mauvaises nouvelles, mais je pense qu’il n’y aurait pas d’offre si il n’y avait pas de demande. Qu’est-ce qui fait qu’on demande cela ? Une des manières de l’expliquer, à partir de mon travail d’accompagnement, si la vie me paraît plate, ennuyeuse, si je ne fais pas les choses que j’aime, si je sens pas le tressaillement de la vie, si tout me paraît morose, quand je rentre le soir et que j’allume mon petit écran, il y a des catastrophes, il y a des éboulements, il y a des guerres, je me sens vivant parce que je ne suis pas mort. Il y a un effet de comparaison. Je ne me sens pas vivant par l’intérieur, mais par différence avec la mort, avec la tragédie. Nous avons besoin de nous rééduquer par rapport à ce phénomène d’être fasciné par l’horreur et d’attendre cela. Il y a ce phénomène de la culture du malheur. Nous savons ce qui ne va pas. Nous savons nous plaindre, nous lamenter, mais nous ne savons pas bien nous réjouir et nous réjouir durablement. C’est un système de pensée ». Thomas nous invite à imaginer des médias qui diffuseraient autant de bonnes nouvelles que de mauvaises, et cela, bien sûr, en rapport avec la réalité. Mais pour un avion qui s’écrase, des milliers et des milliers arrivent normalement à bon port… « Il y a des prodiges de technologie et de savoir faire humain et cela mériterait notre émerveillement, notre admiration » « Si les gens des médias réinstauraient un peu plus d’équité entre bonnes et mauvaises nouvelles, je pense que cela changerait significativement l’énergie du monde ». Et d’ailleurs, nous savons bien que lorsque nous entendons des bonnes nouvelles qui nous concernent, cela nous dynamise. Thomas rappelle les bienfaits de la gratitude (3). Il y a un rapport entre savoir vivre des moments de gratitude et une meilleure santé. « C’est citoyen que d’apprendre à se réjouir profondément pour pouvoir transformer les choses ».
Dans cet entretien, Thomas d’Ansembourg vient nous rejoindre dans les émotions qui abondent dans notre vie quotidienne. Et il y en a une, la joie qui est un tremplin pour une vie heureuse, tournée vers le bon et vers le beau. Cependant , dans le monde où nous vivons, les circonstances auxquelles nous devons faire face, la joie est souvent étouffée par d’autre émotions. Elle est également empêchée par une culture héritée d’un passé douloureux : une « culture du malheur » comme une culture du deuil et du sacrifice. Thomas d’Ansembourg vient nous aider à y voir clair, à lever les obstacles qui font opposition à la joie et à reconnaître celle-ci en désir d’émergence dans notre vie. Comme cet entretien fait référence à l’apport de traditions religieuses en faveur de la joie, rappelons l’appel de Jésus : « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et votre joie soit complète » (Jean 15.11). Et, en 2013, le pape François publie un texte sur « la joie de l’Evangile » (4). Si l’on pense que l’être humain est fondamentalement un être en relation, avec lui même, avec les autres humains, avec la nature et avec Dieu, alors on imagine que la joie résulte de la qualité et de l’harmonie de ces relations. Dans les chemins où la joie se découvre, il y a cette levée des obstacles à laquelle nous invite Thomas d’Ansembourg.
- Face à la violence, apprendre la paix (avec des liens à d’autres articles rapportant sur ce blog la pensée de Thomas d’Ansembourg) : https://vivreetesperer.com/face-a-la-violence-apprendre-la-paix/
- Une émotion à surmonter : la peur
- Thomas d’Ansembourg : la joie : https://www.youtube.com/watch?v=B5vyHlEDU04
- Evangelii Gaudium : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
Pour une vision holistique de l’Esprit
Avec Jürgen Moltmann et Kirsteen Kim
 Selon les chemins que nous avons parcouru, le mot Esprit peut évoquer une résonance différente. Ce peut être l’évocation d’un groupe de prière où l’Esprit porte le désir de vivre en harmonie avec Jésus, avec Dieu et d’entrer dans un mouvement de louange. Pour d’autres, c’est ce qui est dit du Saint Esprit dans la vie d’une église. Et puis, pour ceux qui se disent « spirituels et pas religieux », ce peut être reconnaitre une présence au delà de la surface des choses, une expérience de vie. Quoiqu’il en soit, dans une perspective chrétienne, il y aujourd’hui une attention croissante portée à l’Esprit Saint. Et on sort des sentiers battus. L’Esprit Saint n’est plus seulement observé dans l’Eglise. On le voit à l’œuvre dans l’humanité, dans la nature, dans toute la création.
Selon les chemins que nous avons parcouru, le mot Esprit peut évoquer une résonance différente. Ce peut être l’évocation d’un groupe de prière où l’Esprit porte le désir de vivre en harmonie avec Jésus, avec Dieu et d’entrer dans un mouvement de louange. Pour d’autres, c’est ce qui est dit du Saint Esprit dans la vie d’une église. Et puis, pour ceux qui se disent « spirituels et pas religieux », ce peut être reconnaitre une présence au delà de la surface des choses, une expérience de vie. Quoiqu’il en soit, dans une perspective chrétienne, il y aujourd’hui une attention croissante portée à l’Esprit Saint. Et on sort des sentiers battus. L’Esprit Saint n’est plus seulement observé dans l’Eglise. On le voit à l’œuvre dans l’humanité, dans la nature, dans toute la création.
Partager le mouvement actuel de la théologie qui dépasse les cloisonnements et les barrières et met en évidence l’œuvre de l’Esprit, c’est nous aider à reconnaître la présence divine dans le monde, dans l’univers, porteuse d’amour, de vie, de libération. Cette prise de conscience d’une présence active de l’Esprit, bien au delà des frontières des églises est relativement récente. Dans cette transformation du regard, un rôle majeur a été exercé par le théologien, Jürgen Moltmann, à travers la publication de son livre : « L’Esprit qui donne la vie » (1). Sa pensée est présente sur ce blog (2). Pourquoi donc revenir ici sur ce thème ? De fait, Moltmann ayant ouvert la porte d’une théologie de l’Esprit (3). Celle-ci se développe aujourd’hui à l’échelle mondiale. Un livre vient à nous informer à ce sujet en mettant en valeur des mouvements significatifs. Là aussi, c’est un dépassement des frontières. Ce livre : « Holy Spirit in the world. Global conversation » (4) est écrit par Kirsteen Kim ; une théologienne dont l’itinéraire est lui-même international puisqu’elle-même, anglaise, s’est mariée à un coréen, a enseigné en Corée et en Inde, et, de retour en Angleterre, a été invitée à enseigner à la faculté Fuller aux Etats-Unis.
Le livre de Moltmann sur l’Esprit est paru d’abord en allemand en 1991 : « Das Geist des lebens. Eine Ganzheiliche pneumatologie », puis en anglais : « Spirit of life. An universal affirmation » (1992), enfin en 1999 en français : « L’Esprit qui donne la vie. Une pneumatologie intégrale » (1). Le terme : pneumatologie, bizarre à priori pour le non spécialiste, est issu de « pneuma », en grec, esprit. Les différents titres, dans leur spécificité linguistique rendent compte du contenu de l’ouvrage. Nous retenons ici le terme : « ganzheitlich » qui peut être traduit en terme de : « holistique », une approche globale, unifiante. Cette démarche est mise en valeur par Kirsteen Kim lorsqu’elle écrit : « Moltmann élargit la théologie de l’Esprit lorsqu’il associe l’Esprit avec la vie, non pas « la vie contre le corps », mais « la vie qui apporte la libération et la transfiguration du corps » et en considérant le rôle de l’Esprit dans toutes ses dimensions de salut : libération, justification, renaissance, sanctification, puissance charismatique, expérience mystique et fraternité. En reliant tout ceci au politique aussi bien qu’au personnel, au matériel aussi bien qu’au spirituel, il essaie de montrer le caractère holistique de la théologie de l’Esprit, un point qui est mis en valeur par le sous-titre de l’édition allemande originale » (p 61).
L’Esprit qui donne la vie
 De fait, cette dimension holistique est également exprimée dans le descriptif du livre : « L’Esprit qui donne la vie ». La pensée de Moltmann est une pensée qui relie. « Se plaçant dans une perspective oecuménique, Moltmann intègre les apports de la théologie orthodoxe, mais également les expériences « pentecostales » des jeunes églises. Il entend honorer l’expérience du sujet et de son expérience à l’époque moderne ainsi que les préoccupations écologiques d’aujourd’hui… L’auteur cherche à élaborer une théologie de l’Esprit Saint susceptible de dépasser la fausse alternative souvent réitérée dans les Eglises, entre la Révélation divine qu’elles ont pour mission de sauvegarder et les expériences humaines de l’Esprit. Il entend mettre ainsi en valeur les dimensions cosmiques et corporelles de l’Esprit « créateur et recréateur » qui transgresse toutes les frontières préétablies ».
De fait, cette dimension holistique est également exprimée dans le descriptif du livre : « L’Esprit qui donne la vie ». La pensée de Moltmann est une pensée qui relie. « Se plaçant dans une perspective oecuménique, Moltmann intègre les apports de la théologie orthodoxe, mais également les expériences « pentecostales » des jeunes églises. Il entend honorer l’expérience du sujet et de son expérience à l’époque moderne ainsi que les préoccupations écologiques d’aujourd’hui… L’auteur cherche à élaborer une théologie de l’Esprit Saint susceptible de dépasser la fausse alternative souvent réitérée dans les Eglises, entre la Révélation divine qu’elles ont pour mission de sauvegarder et les expériences humaines de l’Esprit. Il entend mettre ainsi en valeur les dimensions cosmiques et corporelles de l’Esprit « créateur et recréateur » qui transgresse toutes les frontières préétablies ».
Déjà dans la « Théologie de l’espérance », Moltmann avait réalisé une œuvre pionnière en mettant en phase plusieurs courants de pensée. A nouveau, dans « L’Esprit qui donne la vie », il abaisse des frontières et permet de nouvelles synthèses. Ce mouvement est décrit et mis en valeur par D. Lyle Dabney dans un remarquable article : « L’avènement de l’Esprit. Le tournant vers la théologie de l’Esprit dans la Théologie de Jürgen Moltmann » (3). Lyle Dabney nous permet de comprendre le chemin de libération suivi par Moltmann. Jürgen Moltmann a pris progressivement conscience que la théologie occidentale, catholique et protestante, était dans une impasse historique par la méconnaissance de la personnalité propre de l’Esprit. Celui-ci était envisagé en situation de subordination par rapport au Père et au Fils. Dans son livre sur la Trinité et le Royaume (paru en 1980 dans sa version anglophone), Moltmann fait mouvement pour sortir de cette subordination. « Nous voyons une théologie qui s’éloigne de la subordination illégitime de la pneumatologie à la christologie qui a marqué la tradition occidentale » et il en résulte que, pour la première fois, la théologie peut sérieusement considérer l’Esprit comme « un sujet de l’activité divine à coté du Père et du Fils ce qui permet une compréhension nouvelle ». « L’histoire de Jésus est aussi incompréhensible sans l’action de l’Esprit qu’elle ne le serait sans le Dieu qu’il appelle mon Père ». On entre ainsi dans une vraie théologie trinitaire. Cinq ans plus tard dans « La théologie de la création », Moltmann parle de l’Esprit de Dieu présent dans toute la création. Il sort d’une théologie qui met en contradiction Dieu et le monde et oppose la rédemption et la création. « L’Esprit de Dieu n’est pas actif seulement dans la rédemption, mais dans la création ». « Si l’Esprit cosmique est l’Esprit de Dieu, alors l’univers ne peut être conçu comme un système fermé. Il doit être considéré comme un système ouvert, ouvert à Dieu et à son futur ». Dans son livre suivant, « Le chemin de Jésus-Christ », Moltmann met en évidence combien la vie de Jésus-Christ est interconnectée au Père et à l’Esprit. Finalement Moltmann écrit « L’Esprit qui donne la vie », consacrant ainsi un livre entier à la théologie de l’Esprit. C’est une exploration qui récapitule également tous les acquis de l’évolution antérieure.
Le Saint Esprit dans le monde
Si Moltmann a ainsi ouvert la voie à la fin du XXe siècle, le livre de Kirsteen Kim : « The Holy Spirit in the world » (4) paru au début du XXIe témoigne d’une expansion rapide de la théologie de l’Esprit à travers une « conversation » internationale comme le suggère le sous-titre : « A global conversation ». Mais à quoi tient donc l’engagement de Kirsteen Kim ? Elle nous le dit dans sa préface. L’inspiration initiale provient de son expérience du renouveau charismatique dans sa jeunesse : « La première chose que j’ai compris de la théologie de l’Esprit a été celle-ci : quand Dieu nous appelle à suivre Jésus, il n’est pas seulement attendu de nous que nous reproduisions la conduite d’une figure historique lointaine en « étant bon », mais il nous est donné le pouvoir de devenir comme Jésus. L’Esprit me semblait une énergie invisible et un genre de moyen surnaturel qui me connectait à Dieu et à mes amis chrétiens » (p V). Cependant, son entourage a généralement été réfractaire à cette vision. Plus tard, Kirsteen a entendu différentes interprétations de l’Esprit. Puis elle s’est mariée à un coréen, et en Corée dans son église, elle a découvert une grande confiance dans la puissance de l’Esprit. Au cours de son séjour en Inde, elle a rencontré un grand intérêt pour la spiritualité et a pu se référer à des théologiens indiens dont la pensée sur l’Esprit est en phase avec la culture indienne. Puis, de retour en Angleterre, elle a constaté une ouverture nouvelle aux expériences spirituelles de tous genres. Mais, dans l’université, le monde semblait se réduire à la matière et à l’humain. « Ce livre est donc une conséquence de mon effort pour faire apparaître le sens de ces expériences variées de l’Esprit et la signification du concept correspondant. C’est aussi l’expression du désir que, dans l’Occident actuel, nous puissions être capables de porter le message de l’Evangile d’une façon plus significative en nous appuyant sur l’Esprit… N’est-ce pas le rôle de l’Esprit de préparer le monde pour recevoir Christ ?» (p VI).
Ce livre nous entraine donc dans une présentation de la théologie de l’Esprit et de son développement durant la précédente quinzaine d’années. Il expose les fondements exégétiques, la pensée des théologiens, la conversation sur l’Esprit dans le mouvement œcuménique, la manière d’envisager l’Esprit dans la Mission, la théologie de l’Esprit telle qu’elle s’est développée dans deux pays d’Asie, l’Inde et la Corée, en phase avec leur culture. Kirsteen Kim nous invite à une réflexion théologique internationale. A cet égard, la contribution de l’Inde et de la Corée est particulièrement instructive.
La théologie de l’Esprit en Corée : diversité et ouverture
Lorsqu’on apprend à connaitre la théologie en Corée, on en perçoit une grande originalité. Elle apporte des réponses aux questions que nous pouvons nous poser sur la manière dont nous envisageons de rôle du Saint Esprit. Nous avons découvert la théologie coréenne à travers des publications de Kirsteen Kim accessibles sur internet, telle que : « Le passé, le présent, le futur de la théologie coréenne. Perspectives pneumatologiques » (5). Nous nous sommes ensuite reporté à son livre sur « le Saint Esprit dans le monde » et au chapitre correspondant sur la Corée. Ces textes très informés et très denses ne peuvent être résumés ici. Nous chercherons simplement à répondre aux questions suivantes : Quel est le contexte de cette théologie ? Quelle en est l’originalité ? En quoi, nous pouvons y trouver des enseignements fondamentaux ?
Le christianisme a commencé à prendre son essor en Corée au début du XXe siècle. Cependant, le paysage religieux coréen est marqué par des influences historiques. En arrière plan, il y a le chamanisme et sa relation avec les esprits. Venues à travers la Chine, il y a deux grandes civilisations religieuses : le bouddhisme et le confucianisme. On peut reconnaître des influences culturelles de ces pratiques religieuses dans des courants du christianisme coréen. Ainsi on pourra dire que tel courant a un mode paternel parce qu’il se meut socialement et culturellement dans une dimension patriarcale issue du confucianisme et que telle autre a un aspect maternel et féminin en y percevant un héritage du chamanisme. La théologie reflète également ces influences.
Le christianisme coréen s’inscrit dans l’histoire politique et économique de la Corée. Pendant les premières décennies du XXe siècle, la Corée a subi la tutelle dominatrice du Japon. Les chrétiens coréens ont participé activement à la lutte pour l’indépendance nationale. Ce fut le cas lors du « réveil », du mouvement dans l’Esprit en 1907. Aujourd’hui le grand problème est celui de la division entre les deux Corées, la Corée du Nord étant sous une domination communiste totalitaire. Les chrétiens coréens participent activement aux tentatives de dialogue et de réconciliation. Aujourd’hui, la Corée du sud est un des pays du monde les plus développés technologiquement et économiquement. Ce remarquable essor est intervenu dans la seconde moitié du XXe siècle. Tout au long de ce dernier siècle, l’image des chrétiens a été associée à la modernisation.
Il y a eu également une participation importante des chrétiens dans les luttes pour le progrès social, ce dont témoigne la théologie Minjung.
En 2005, 30% de la population coréenne est chrétienne, dans une version protestante ou catholique, la version protestante étant quelque peu majoritaire. Au début du XXe siècle, les chrétiens étaient très peu nombreux. Cet essor rapide du christianisme, exceptionnel en Asie, est donc remarquable. Dans la première moitié du siècle, il s’est opéré à travers de grands mouvements dans l’Esprit, des « réveils ». L’histoire du christianisme coréen est marquée par l’inspiration de l’Esprit et une dimension pentecôtisante. Aujourd’hui, une des plus grandes églises en Corée se réclame directement du pentecôtisme : l’Église Yoido Full Gospel, dont la figure réputée est celle de David Yonggi Cho, une megachurch avec plusieurs centaines de milliers de membres. Mais ce n’est là qu’une des manifestations, dans une expression spécifique, du dynamisme suscité en Corée par l’inspiration de l’Esprit.
Dans ce contexte, la théologie témoigne d’une réflexion riche et diverse qui s’est développée tout au long du XXe siècle. En fonction du rôle joué par l’inspiration de l’Esprit dans la vie des églises en Corée, « la ‘ pneumatologie ’ est centrale dans la théologie coréenne ». C’est ce que nous décrit Kirsteen Kim : « C’est parce que le réveil coréen de 1907, qui est généralement considéré comme le point où le protestantisme est devenu une religion coréenne, est presque toujours interprété comme l’œuvre du Saint Esprit qui a été déversé sur la Corée, une Pentecôte coréenne. Le réveil a doté le protestantisme coréen d’un sens profond du mouvement dynamique de l’Esprit dans l’histoire et le monde matériel qui constitue une matrice pour la réflexion théologique en Corée. Bien plus, les théologiens coréens ont, dans beaucoup de cas, réfléchi au delà des restrictions portant sur l’œuvre de l’Esprit chez leurs homologues occidentaux. Ils ont vu l’importance du développement de la théologie de l’Esprit dans le contexte de la reconnaissance des nombreux esprits des différentes religions et de l’expérience de vivre dans le troisième âge de l’Esprit. Ils apprécient l’importance du discernement de l’Esprit et la pertinence de la pneumatologie dans la vie politique, la subsistance, la culture et le genre » (5) (p 9-10).
Kirsteen Kim nous expose les courants actuels de la théologie en Corée dans une description qui en montre la richesse et la profondeur ; Nous rapportons ici son exposé introductif. «A partir des années 1960, la théologie coréenne a commencé à s’épanouir comme une fleur de lotus et s’est développée en plusieurs courants. Cela incluait une aile conservatrice qui peut être considérée comme la continuation d’un évangélisme « mainstream ». Les nouveaux mouvements ont été une théologie progressiste mettant l’accent sur la libération politique et centrée sur les problèmes socio-historiques qui s’est fait connaître sous l’appellation de la théologie Minjung ; un courant pentecôtiste connu comme le mouvement du plein Évangile ; un courant libéral qui pense chercher à inculturer l’Évangile en Corée en dialogue avec les autres traditions religieuses de la nation ; et une combinaison radicale de théologie féministe et d’éco-théologie ». Kirsteen Kim nous montre comment ces différentes théologies sont fondamentalement pneumatologiques. Chacune d’elles s’appuient sur les différentes significations bibliques de l’Esprit dans la tradition coréenne. Suh a dans l’esprit « Ki », la force de vie (Genèse 1.2) ; Cho est centré sur « shin », Dieu, le Grand Esprit (Actes 2 ; Mathieu 12.28) ; Ryu pense à « ol », l’âme primordiale du peuple (Genèse 2.7) et Chung traite avec le monde de « kuishin », les esprits (Romains 8.19-23)(5) (p 12).
En regardant vers l’avenir, Kirsteen Kim s’interroge sur les apports potentiels de la théologie coréenne à la conversation théologique internationale. Elle identifie quatre domaines dans lesquels la contribution des théologiens coréens serait importante : « la réconciliation, la cyberthéologie, la théologie de la puissance et la théologie du pluralisme » (p 15). On se reportera à ses analyses. A partir de ce qu’on sait maintenant de l’œuvre de l’Esprit en Corée, on imagine combien l’expérience chrétienne coréenne dans une société plurielle et les tensions qu’elle comporte peut nous éclairer dans les voies de la réconciliation. Différents approches se manifestent : humanisation, guérison, harmonisation… C’est un esprit de paix qui se manifeste aussi dans le discernement des esprits, une reconnaissance de ceux-ci qui ne débouche pas sur les confrontations brutales qui sont, un moment, apparues en Occident, dans les proclamations de Peter Wagner et John Wimber. Ici le discernement s’allie à un esprit de paix et à une approche thérapeutique (5) (p 19-20).
Grace à la recherche et à la réflexion de Jürgen Moltmann dans « L’Esprit qui donne la vie », et de Kirsteen Kim dans ses nombreuses publications et particulièrement celles sur la Corée, nous avons maintenant accès à une théologie de l’Esprit. Cette théologie a le grand mérite de nous prémunir contre les tendances sectaires, les enfermements dans un individualisme spirituel, les idéologies fondamentalistes que l’on peut observer dans certains milieux. Mais, plus encore, elle nous ouvre un horizon non seulement par la confiance nourrie en nous par la présence active de l’Esprit, mais aussi par une vision holistique en phase avec une théologie de l’espérance.
J H
- Jürgen Moltmann. L’Esprit qui donne la vie. Seuil, 1999
- « Un Esprit sans frontières » : https://vivreetesperer.com/un-esprit-sans-frontieres/
- « D Lyle Dabney. The advent of the Spirit. The turn to pneumatology in the theology of Jürgen Moltmann (The Ashbury theological journal. Spring 1993) : https://place.asburyseminary.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.fr/&httpsredir=1&article=1474&context=asburyjournal
- Kirsteen Kim. The Holy Spirit in the world. A global conversation. SPCK, 2007. Kirsteen Kim est également l’auteure avec son mari, Sebastian Kim du livre : « Christianity as a world religion. Bloomsbury, 2016 (2e éd).
- Kitsteen Kim. The Past, Present and Future of Korean Theology. Pneumatological perspectives. 2010 (Kirsten Kim a été coordinatrice de la recherche à la conférence d’Edinbourg, en centième anniversaire de la première conférence mondiale missionnaire en 1910) : http://www.pcts.ac.kr/pctsrss/js_rss/zupload/학술발표3-커스틴김(영어).pdf
Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin
Au lever du jour
Au lever du jour, de l’aube à l’aurore, au petit matin, un commencement, ou plutôt un recommencement se manifeste. En contraste avec l’obscurité de la nuit, la lumière apparaît. La vie reprend. En ces moments, bien souvent, la beauté du ciel appelle l’émerveillement. Alors ce premier épisode de la journée revêt une forte signification. Il est perçu en termes symboliques comme l’annonce d’un jour nouveau. La force de la Vie s ‘y exprime. Ainsi y monte également un désir profond. On trouve dans les Psaumes un appel à la prière matinale. « Je veux te chanter et te célébrer de tout mon cœur. Levez-vous mon luth et ma harpe. Je me lèverai dès l’aurore » (Psaume 208.3). Emerveillement…. Pour évoquer le lever du jour, nous présentons ici des photos issues des sites flickr que nous fréquentons.
J H
« Aurore flamboyante »
Gérard et Françoise
Lever du soleil en montagne
Michèle Carbone
« Le jour se lève »
(Aravis Alpes)
Didier Héroux
« Early Light »
Première lumière dans une campagne anglaise
Pete Quinn
«Misty sunrise »
Lever de soleil dans la brume
Anthony White
« Mine is the sunrise »
Un lever de soleil pour moi
Rita Eberle-Wessner
« Dawn’s rosie fingers »
Les doigts roses de l’aube
Julie Falk (Michigan)
« Automn sunrise »
Lever de soleil sur une plage en automne
Tony Armstrong-Sly
« Winterton sunrise »
Lever de soleil sur la plage de Winterton
Lee Acaster
« Even the darkest night will end and the sun will rise »
Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lévera
Pixelmama
Canto al amenacer
Chant à l’aube
Gloria Castro (Espagne)
Voir aussi :
Comme la beauté nous accompagne en hiver
https://vivreetesperer.com/comme-la-beaute-nous-accompagne-en-hiver/
Un regard lumineux dans un pays lumineux
https://vivreetesperer.com/comme-la-beaute-nous-accompagne-en-hiver/
J H
Face au ressentiment, un mal individuel et collectif aujourd’hui répandu
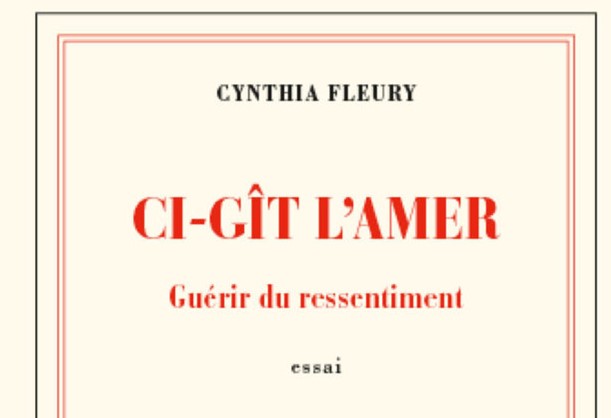 « Ci-git l’amer. Guérir du ressentiment » de Cynthia Fleury
« Ci-git l’amer. Guérir du ressentiment » de Cynthia Fleury
Il nous arrive, il nous est arrivé de rencontrer des gens qui manifestent un profond ressentiment. Nous avons pu nous-même éprouver du ressentiment envers quelqu’un ou à notre égard. Nous savons combien il est précieux de pouvoir sortir de cette situation. Et, plus généralement dans la vie sociale, et tout particulièrement si nous fréquentons certains réseaux sociaux et parcourons certains commentaires sur internet, nous y percevons parfois des bouffées de haine, des violences verbales dont nous percevons le rapport avec un profond ressentiment. Le ressentiment est donc une réalité assez répandue qui ne nous est pas inconnue et que nous avons besoin de comprendre pour y faire face, car c’est une réalité pernicieuse.
Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, vient d’écrire à ce sujet un livre intitulé : « Ci-git l’amer » avec pour sous-titre : « Guérir du ressentiment ». C’est un ouvrage conséquent de plus de 300 pages qui, en 54 chapitres, étudie le problème du ressentiment dans ses dimensions personnelles et collectives, à partir d’une culture psychanalytique, philosophique et littéraire qui mobilise de nombreuses références, ainsi, parmi d’autres : Scheler, Nietzche, Winnicott, Mallarmé, Montaigne, Fanon… La culture de Cynthia Fleury est très vaste et se manifeste sur de nombreux registres. Lorsqu’on ne dispose pas des mêmes outils de compréhension, on peut donc hésiter à entrer dans cette lecture et encore plus à s’engager dans la présentation du livre. Il nous paraît que ce serait fort dommage de se passer d’un tel apport, car l’écriture de Cynthia Fleury est claire, compréhensible et elle sait mettre les mots appropriés sur les différents aspects du ressentiment. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». Cette qualité d’écriture nous paraît remarquable. Elle nous aide dans la compréhension du phénomène.
La pensée de Cynthia Fleury se déploie dans une grille d’analyse d’inspiration psychanalytique. « D’où vient l’amertume ? De la souffrance et de l’enfance disparue, dira-t-on d’emblée. Dès l’enfance, il se passe quelque chose avec l’amer et ce Réel qui explose dans un monde serein. Ci-git la mère. Ci-git la mer. Chacun fera son chemin, mais tous connaissent le lien entre la sublimation possible (la mer), la séparation parentale (la mère) et la douleur (l’amer), cette mélancolie qui ne relève pas d’elle-même… L’amer, la mère, la mer, tout se noue » (p 13). Et comment traiter avec l’amer ? Cynthia Fleury évoque son travail de psychanalyste et les ressources de la « rêverie océanique ». La mer n’est pas une affaire de navigation, mais de grand large existentiel, de la sublimation de la finitude et de la lassitude » (p 14). « Universelle amertume », tel est le titre du premier chapitre. Le livre s’intitule : « Ci-git l’amer ». Notre propos n’est pas de commenter la vision de la vie qui est celle de l’auteur, mais de nous instruire de son analyse du ressentiment. Nous voici donc à la découverte du ressentiment d’abord dans sa version individuelle, puis dans sa vision collective.
Le ressentiment
Cynthia Fleury nous fait part de la définition du ressentiment telle que nous la communique Max Scheler dans un essai publié à ce sujet en 2012 : « L’expérience et la rumination d’une certaine réaction affective dirigée contre un autre qui donnent à ce sentiment de gagner en profondeur et de pénétrer, peu à peu, au cœur de la personne, tout en abandonnant le terrain de l’expression et de l’activité ». Cynthia Fleury commente en ces termes : « Le terme clé pour comprendre la dynamique du ressentiment est la rumination… Il s’agit de revivre une ré-action émotionnelle qui, au départ, pouvait être adressée à quelqu’un de particulier. Mais le ressentiment allant, l’indétermination de l’adresse va prendre de l’ampleur. La détestation se fera moins personnelle, plus globale… » (p 19). Il y a là un processus destructeur.
« Cela gronde, comme l’écrit Max Scheler à travers le mot allemand : groll. « Groll, c’est la rancœur, le fait d’ « en vouloir à » ; et l’on voit comment ce « en vouloir à » prend la place de la volonté, comment une énergie mauvaise se substitue à l’énergie vitale joyeuse… Le ressentiment allant, l’indétermination se fait plus grande… Tout est contaminé. Tout fait boomerang pour raviver le ressentiment ». L’effet est dévastateur. « Scheler évoque l’auto-empoisonnement pour décrire les « malfaits » du ressentiment »… « Le sens du jugement est vicié de l’intérieur. La pourriture est là » (p 22). Ainsi, le sens du jugement, « instrument possible de libération » est détourné vers « le maintien dans la servitude devant une pulsion mortifère ».
Si le ressentiment a un visage personnel, il débouche également sur une pulsion collective. Aujourd’hui, celle-ci s’exprime particulièrement sur les réseaux sociaux.
Guérir du ressentiment
Confronté au ressentiment, Cynthia Fleury perçoit la difficulté d’en sortir pour ceux qui s’y emprisonnent. « Seule aptitude du ressentiment à laquelle il excelle : aigrir, aigrir la personnalité, aigrir la situation, aigrir le regard sur. Le ressentiment empêche l’ouverture. Il ferme, il forclôt, pas de sortie possible ; le sujet est peut-être hors de soi, mais en soi, rongeant le soi, et, dès lors, rongeant la seule médiation possible vers le monde » (p 24). D’autant que le ressentiment peut se radicaliser : « Je puis tout te pardonner sauf d’être ce que tu es, sauf que je ne suis pas toi. Cette envie porte sur l’existence même de l’autre » (p 25). Dès lors, dans la relation clinique, « l’extraction hors de cette emprise sera extrêmement compliquée. Il faut poser comme idée régulatrice que la guérison est possible, mais que la clinique est sans doute insuffisante dans son soin. Il est impossible de dépasser le ressentiment sans que la volonté du sujet entre en action. C’est précisément cette volonté qui est manquante, enterrée chaque jour par le sujet lui-même » (p 25).
Cependant, quel est le chemin de guérison proposée par Cynthia Fleury ? « L’homme qui échappe au ressentiment n’y échappe pas d’emblée . C’est toujours le fruit d’un travail… la sublimation des instincts… Celle-ci est « un talent » de faire avec les pulsions autre chose que du pulsionnel régressif, de les tourner vers un au delà d’elles-mêmes, d’utiliser à bon escient l’énergie créatrice qui les parcourt » (p 65). C’est apprendre à bien utiliser son énergie. « La grande santé, c’est choisir l’avenir, choisir le numineux » (p 71). Cynthia Fleury prône l’accès à la création. « Choisir l’œuvre, c’est toujours choisir l’ouvert ». « L’œuvre crée l’air, l’ouverture, la fenêtre. Elle crée l’échappée » (p 73).
Le ressentiment collectif
Les ressentiments individuels peuvent s’exprimer collectivement, par exemple en empruntant la voie d’internet. En quelque sorte, ils s’agglutinent dans un déchainement de violence verbale. Cependant, le phénomène n’est pas nouveau parce que, dans l’histoire, on a pu observer des comportements analogues, par exemple dans un lien entre la passion de l’égalité et le ressentiment collectif. « La structure du ressentiment est égalitaire. Celui-ci surgit au moment où le sujet se ressent certes inégal, mais surtout lésé parce qu’égal… La frustration se développe sur un terreau de droit à… Je me crois lésé parce que je crois à mon dû ou à mon droit » (p 28). Il y a là un processus dangereux. « Dénigrer les autres ne suffit pas au ressentiment. Il faut un pas de plus : la mise en accusation. Celle-ci étant toutefois sans objet réel, elle vire à la délation, à la désinformation… Dorénavant, l’autre sera coupable. Une forme de dépréciation universelle s’enclenche » (p 29). Cette fureur engendre évidemment la fin du discernement : « Ne plus faire le point des choses, viser la « tabula rasa » sans autre projet »… « Il se produit un « éthos renversé », une « disposition générale » à produire de l’hostilité comme d’autres produisent de l’accueil au monde » (p 30). C’est bien ce que l’on observe dans une violence répétitive qui marque certains commentaires politiques apparaissant sur internet.
Cynthia Fleury nous décrit « l’homme ressentimiste » qui se manifeste ainsi. « L’une des manifestations les plus explicites et audibles du ressentiment demeure l’utilisation ordurière du langage. L’homme du ressentiment… se lâche et vomit, par son langage, sa rancœur (p274-275). L’homme ressentimiste choisit délibérément de n’user du langage que pour dégrader l’autre, le monde, les rapports qu’il entretient avec lui ». C’est une manifestation de haine. « Cette haine dresse un cadre de vie et de pensée assez nauséeux, car du ressentiment au délire conspirationniste, il n’y a qu’un pas. Telle est la version collective du désir de persécution. (p 284). On assiste à une logique implacable où les valeurs s’inversent. « Si vous êtes riche et bien portant dans cet univers inique, c’est que vous êtes complice de cet univers inique. Le ressentiment est une idéologie, un rapport de force qui cherche à s’établir et à promouvoir les intérêts d’un nouveau groupe qui se trouve spolié » (p 286). Il y a donc un renversement de la mentalité. « La notion de « mundus inversus » est très importante pour comprendre le lien manifeste entre ressentiment et pensée conspirationniste. Elle correspond à une sorte de solution magique ayant réponse à tout, pouvant expliquer toutes les vexations narcissiques de l’individu ressentimiste et permet par ailleurs une merveilleuse dissolution de ses responsabilités… Le raisonnement conspirationniste est bien connu dans la psychiatrie, car il est l’apanage des structures paranoïaques » (p 288).
Réduire le ressentiment collectif
Cependant, si ces processus de pensée sont malheureusement répandus, on peut s’interroger sur les conditions qui peuvent en favoriser le développement. Ainsi combien il est important de respecter les singularités, l’originalité de chacun. La question a été posée au niveau des institutions de soin, des asiles. « Il est intéressant de voir que cette analyse peut être élargie de nos jours au fonctionnement plus global de la société. Que faire de l’attention au petit, à l’infime, aux détails du singulier ? y a-t-il une place pour cela dans la politique ? » (p 262). C’est prendre garde à la « réification », à la chosification, à la normalisation qui s’opèrent dans les institutions publiques comme « si elles prenaient plaisir à détruire les positions de l’individu pour le mettre sous tutelle et enlever tout goût d’individuation » (p 261). Cynthia Fleury met en évidence des facteurs favorisant des dysfonctionnements individuels et des dysfonctionnements collectifs. « Il s’agit de comprendre que la santé psychique des individus produit un impact tout à fait indéniable sur le fonctionnement de la société… Dans « Les irremplaçables », j’avais cherché à démontrer ce lien à l’égard d’un individu réifié, se sentant remplaçable, interchangeable, non respecté par un environnement notamment institutionnel et professionnel, donc public au sens large. Comment cet individu, petit à petit, se clivait pour résister à cette maltraitance psychique » (p 271). « Nos institutions doivent produire assez de soin pour ne pas renforcer les vulnérabilités inhérentes à la condition humaine, à savoir ses conflits pulsionnels… et prendre garde à ne pas produire de la réification qui après s’être retournée contre les individus, les avoir rendu malades, se retourne contre la démocratie elle-même en développant la traduction politique de ces troubles et notamment dudit ressentiment » (p 273).
Plus généralement, le ressentiment collectif se nourrit d’une angoisse sociale en lien avec un manque de relations humanisantes. Cynthia Fleury cite Michel Angenot dans une analyse qui s’inspire de Max Weber. « Les idéologies du ressentiment sont intimement liées aux vagues d’angoisse face à la modernité, à la rationalisation, à la déterritorialisation. La mentalité de la « gemeinshaft », homogène, chaude et stagnante a tendance à tourner à l’aigre dans les sociétés ouverts et froides, rationnelles et techniques. Le ressentiment qui recrée une solidarité entre pairs rancuniers et victimisés… apparaît comme un moyen de réactiver, à peu de frais, de la chaleur, de la communauté dans l’irrationnel chaleureux » (p 290). Ainsi, pour Cynthia Fleury, prévenir le ressentiment collectif autant que faire se peut, c’est veiller à ne pas renforcer les processus extrêmes de rationalisation et de déterritorialisation qui provoquent immanquablement un sentiment de réification et donc, par réaction, une résistance qui, très vite, préfère se soumettre à une passion victimaire » (p 291).
Cette présentation du livre de Cynthia Fleury nous fait comprendre l’importance du ressentiment et en éclaire les ressorts. Mais il est très loin de rendre compte de la richesse de cet ouvrage. Ainsi, l’auteure traite également des incidences de la colonisation et des processus du fascisme. Et aussi, on découvre des réflexions sur des sujets de grande importance comme le discernement (p 30-31) ou la pratique d’écriture en thérapie (p 257-258). Dans ce livre, Cynthia Fleury entre en dialogue avec ses pairs, analystes et psychologues. Si notre culture est différente, il reste que Cynthia Fleury ouvre au lecteur non expert des fenêtres de compréhension. Dans cette tâche, elle est servie par une écriture riche et précise autant que par sa vaste culture. A une époque où nous sommes confrontés au ressentiment, au moins dans sa forme collective, il serait dommage d’ignorer l’apport de ce livre.
Cynthia Fleury aborde la question à partir de sa culture et de sa pratique d’analyste. D’autres points de vue sont envisageables. Ainsi peut-on envisager la prévention du ressentiment à partir d’une culture spirituelle qui met en avant l’amour, la miséricorde, le pardon, d’une culture relationnelle de la fraternité et de la communauté. C’est l’enseignement de Jésus qui, dans la dynamique de l’Esprit, nous appelle à un amour universel et à un pardon inépuisable. Nous voici, aujourd’hui interpellé par les manifestations de ressentiment. Cynthia Fleury nous permet d’envisager les dimensions de ce phénomène, d’en comprendre les ressorts et de participer ainsi à la « guérison du ressentiment ». Voila un précieux éclairage.
J H
- Cynthia Fleury. Ci-git l’amer. Guérir du ressentiment. Gallimard, 2020. Cynthia Fleury est interviewée sur son livre dans plusieurs vidéos : France culture. Dépasser le ressentiment pour sauver la démocratie : https://www.youtube.com/watch?v=ElNNOOXQEv4
- Cap sciences échos Ci git l’amer : https://www.youtube.com/watch?v=P1un1KYWwc
- De la cure au politique. Le ressentiment ( cours) https://www.youtube.com/watch?v=c9qoF9qHHT8
Voir aussi :
De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin
https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/
Terre promise
 L’aventure et la mission de Barack Obama
L’aventure et la mission de Barack Obama
Barack Obama vient de publier le premier volume de ses mémoires : « Une Terre Promise » (1). La présentation qui en est donnée en page de couverture, mérite d’être rappelée ici : « Dans le premier volume de ses mémoires présidentielles, Barack Obama raconte l’histoire passionnante de son incroyable odyssée, celle d’un jeune homme en quête d’identité devenu dirigeant du monde libre, retraçant de manière personnelle son éducation politique et les moments emblématiques du premier mandat de sa présidence. Obama nous invite à le suivre dans son incroyable voyage et ses premiers pas sur la scène politique à sa victoire décisive aux primaires de l’Iowa qui démontre le pouvoir de l’engagement citoyen, et jusqu’à la soirée historique du 4 novembre 2008 lorsqu’il fut élu quarante quatrième président des Etats-Unis devenant ainsi le premier afro-américain à accéder à la fonction suprême. En revenant sur les grandes heures de sa présidence, Barack Obama nous offre un point de vue unique sur l’exercice du pouvoir présidentiel, son amplitude phénoménale, mais aussi ses limites, ainsi qu’un témoignage singulier sur les ressorts de la politique intérieure et de la diplomatie internationale ».
La première campagne présidentielle de Barack Obama a suscité des échos dans le monde entier. Il y avait là une promesse de transformation en profondeur de la société politique américaine dans un mouvement de justice sociale et de respect des groupes jusque là discriminés. Et un grand élan participatif était apparu dans la confiance et l’espérance. « Yes, we can » (Oui, nous pouvons). Ainsi, l’élection de Barack Obama nous est apparue non seulement comme un tournant de l’histoire américaine, mais comme un tournant de l’histoire du monde, un véritable signe des temps (2).
A l’époque, Dominique Moisi, chercheur à l’IFRI, venait de publier un livre : « Géopolitique de l’émotion » (3). La scène internationale n’est pas soumise uniquement aux couleurs politiques. Les émotions collectives jouent un rôle moteur, ainsi l’humiliation, la peur et l’espoir. Il n’y a pas de fatalité. C’est bien sous le signe de l’espoir que s’est placée l’action d’Obama et son ouvrage : « une Terre Promise ». Dans un livre précédent, il avait parlé » de « l’audace de l’espoir » : « Audacy of hope ». Cet espoir requiert une considération pour l’homme et son potentiel. Il s’accompagne de la confiance. C’est bien l’esprit que l’on trouve dans la biographie de Barack Obama. Dans un monde inquiet, cette biographie éveille la sympathie et rencontre une audience internationale. Nous en sommes témoins par une réaction que ce livre a suscité autour de nous. Si des amis ont manifesté de l’enthousiasme lors de la publication de ce livre, nous avons pu constater, lors d’une hospitalisation, que cet ouvrage éveillait de l’intérêt chez certaines aides-soignantes d’origine africaine.
Genèse d’une personnalité
Cette biographie nous permet de suivre le premier mandat de la présidence de Barack Obama dans ses réflexions personnelles face aux grands enjeux de l’époque, dans le contexte des disputes et des conflits de l’époque. Mais ce qui nous intéresse ici en premier, c’est comment cette personnalité a émergé et comment elle s’est engagée et a gagné la campagne présidentielle. Le témoignage de Barack Obama nous apporte une réponse.
Il nous éclaire sur son entourage familial, sa mère, ses grands-parents maternels et la manière dont il a grandi à Hawaï. Et puis, advient ensuite un long périple sur le continent américain, des études universitaires, un travail social de développement communautaire à Chicago et puis des études de droit dans la prestigieuse université d’Harvard. C’est tout un cheminement à partir d’un idéalisme studieux. Barack nous décrit sa rencontre avec Michèle et leur mariage, un tournant majeur dans sa vie. Ainsi il a fallu des années à Barack Obama pour qu’il parvienne à un niveau de maturité à partir duquel il s’est ensuite engagé dans la vie politique. Ce parcours nous apprend combien nos évolutions requièrent du temps.
Mais c’est durant cette période que l’idéal d’Obama s’est forgé.
C’était le rêve américain. « L’idée de l’Amérique, la promesse de l’Amérique, ça je m’y suis accroché avec une obstination qui me surprenait moi-même. « Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes que les hommes sont créés égaux ». Voilà l’Amérique telle que je la concevais. L’Amérique de la Déclaration d’indépendance, de Tocqueville, le pays de Whitman et de Thoreau, où nul ne m’était inférieur ou supérieur, l’Amérique des pionniers qui étaient partis vers l’Ouest en quête d’une vie meilleure ou des immigrés qui avaient débarqué à Ellis Island poussés par la soif de la liberté… C’était l’Amérique de Lincoln à Gettysburg, du Centre des œuvres sociales de la militante du droit des femmes, Jane Addams à Chicago, des GI épuisés sur les plages de Normandie et de Martin Luther King appelant la nation toute entière, et lui le premier, à s’armer de courage.
C’était la Constitution et le Bill of Rights rédigés par des penseurs brillants, même s’ils n’étaient pas sans défauts, qui avaient su fonder sur la raison un système à la fois solide et souple, ouvert aux changements « (p 32-33).
De père kenyan, Barack Obama est métis. Il s’inscrit ainsi dans la communauté afro-américaine en lutte pour son émancipation après l’asservissement de l’esclavage et portant haut le message de Martin Luther King (4). Le titre même de cette biographie, « une terre promise » renvoie à l’inspiration judéo-chrétienne, celle de l’exode du pays d’Egypte vers la terre promise.
Très concrètement, lorsque après ses études universitaires, en 1983, Barack prend un emploi à Chicago dans une association d’églises qui s’étaient regroupées pour maintenir à flot des populations ravagées à la suite de la fermeture des aciéries. « Cette expérience lui a permis de reprendre pied dans le monde réel ». « Il me fallait désormais être à l’écoute des problèmes des gens au lieu de broder des théories. Je devais demander à des inconnus de se joindre à moi et de collaborer sur des projets concrets : réhabiliter un parc, désamianter des logements sociaux ou monter un programme de cours du soir. J’ai connu des échecs où j’ai appris à me retrousser les manches… Autrement dit, j’ai grandi » (p 34). Cette expérience a été une occasion de développer son aptitude à la relation et le goût de celle-ci qui vont être une caractéristique marquante de sa vie politique ». Barack écrit ainsi : « J’ai fini par m’attacher aux hommes et aux femmes avec qui je travaillais… Les épreuves que toutes ces personnes avaient traversées et leurs modestes triomphes ne cessaient de me conforter dans l’idée que les gens étaient foncièrement bons et honnêtes. Grâce à eux, j’ai vu à quelles transformations on pouvait aboutir quand les citoyens demandent à leurs dirigeant et aux institutions de leur rendre compte, même sur les questions les plus triviales » (p 34). Ici, Barack nous dit avoir beaucoup appris : « Grâce à eux, j’ai pu répondre aux questions qui me taraudaient sur ma propre identité raciale. Car je me suis rendu compte qu’il n’existait pas une seule et unique façon d’être noir. Essayer d’être un type bien était déjà suffisant… Grâce à eux, j’ai découvert une communauté de croyances…Et comme j’entendais dans les salles en sous-sol des églises… exalter ces mêmes valeurs : l’honnêteté, le travail, la compassion, que m’avaient inculquées ma mère et mes grands-parents, j’en suis venu à croire en la force du lien commun qui unissait les gens » (p 34-35).
Si l’engagement d’Obama s’opère progressivement sur la scène intérieure, tout d’abord dans l’Illinois, puis au sénat des Etats-Unis, enfin dans la campagne présidentielle jusqu’à l’accession à la présidence, il a, dés le départ, une conscience internationale. Cela tient à ses origines. Né d’un père kenyan et d’une mère américaine, il passe sa première jeunesse dans le Pacifique, notamment à Hawaï. Si il croit en la vertu de l’idéal américain, il a bien conscience des méfaits de l’impérialisme et il votera par ailleurs contre la guerre en Irak. Il sait que les Etats-Unis sont la première puissance dont les habitants viennent des quatre coins de la terre. Lorsque vient le moment de sa candidature à la présidence aux Etats-Unis, dans une conversation avec Michèle, la motivation internationale, transethnique de Barack Obama, s’exprime du fond du cœur : « Je sais une chose. Je sais que le jour où je lèverai la main pour prêter serment à la présidence des Etats-Unis, le monde commencera à porter un regard différent sur les Etats-Unis. Je sais que tous les gamins de ce pays, les gamins noirs, les gamins latinos, tous les gamins qui ont l’impression de ne pas être à leur place ici, porteront eux aussi un regard différent sur eux-mêmes, leur horizon soudain dégagé, le champ des possibles soudain ouvert devant eux » (p 112). Obama porte un espoir en faveur de la diversité des origines.
Barack Obama : le primat de la relation
Le premier pas d’Obama dans la campagne présidentielle fut la victoire d’Obama à la désignation des représentants démocrates de l’Iowa. Ce fut le résultat d’une intense activité auprès des électeurs. Barack Obama a montré là une grande capacité de relation avec des gens différents de sa propre condition. L’Iowa est un état rural. Sa victoire est la résultante d’une volonté délibérée : rassembler : « J’avais compris que pour faire vraiment bouger les choses, je devais pouvoir parler au plus grand nombre » (p 68). Son activité politique dans l’Illinois, un état aux populations très diversifiées, avait été un bon apprentissage en ce sens.
Ce livre révèle l’intensité des campagnes électorales américaines. Là où il s’est engagé, Barack Obama a su rassembler et mobiliser de fervents soutiens et un grand nombre de bénévoles. C’est un effet de ses convictions, mais aussi de sa chaleur humaine.
Cette attention relationnelle est bien mise en évidence par le livre. Et bien sur, cette qualité apparait en premier dans sa vie familiale : l’amour respectueux porté à Michelle, une relation attentive et joyeuse avec ses deux filles, Malia et Sasha. A de nombreuses reprises, il exprime l’importance des relations familiales et la nécessité de ne pas les négliger au profit d’une ambition de carrière. Cette attention relationnelle est également constante dans son activité politique. Ainsi, non seulement dans ce livre, il évoque un grand nombre de personnes, mais encore, il en décrit souvent la personnalité en quelques lignes. Cette approche est présente à la fois dans la manière dont il rapporte ses campagnes électorales et lorsqu’il décrit le milieu politique auquel il a affaire durant sa présidence. Ses descriptions sont parfois empreintes d’humour, mais toujours de respect, y compris pour ses adversaires. Cette aptitude relationnelle va également lui permettre de gouverner en écoutant ses conseillers. C’est la voie d’une meilleure prise de décision. Et Barack Obama a su également garder le contact avec ses électeurs, avec les citoyens américains à travers un service de correspondance où il a répondu personnellement chaque jour à quelques lettres (5).
Pour une bonne part, ce livre traite du premier mandat présidentiel. Et bien sur, si Obama progresse dans son projet, il rencontre aussi beaucoup d’oppositions, beaucoup d’empêchements. Nous y apprenons la complexité de la vie politique. Certainement, Barack Obama n’a pas atteint la « Terre promise », mais celle-ci est l’aboutissement d’un chemin qui se manifeste à travers un état d’esprit. Dans sa symbolique chrétienne, si magnifiquement exprimée par Martin Luther King, la Terre Promise se manifeste à travers une société nouvelle et régénérée. A travers la biographie de Barack Obama, nous percevons un mouvement persévérant pour aller dans ce sens. Ne s’ouvre-t-elle pas par une citation en extrait d’un spiritual afro-américain :
« O vole et jamais ne fatigue
Vole et jamais ne fatigue …
Un grand rassemblement se trouve en Terre Promise »
J H
- Barack Obama. Une Terre Promise. Fayard, 2020
- Le phénomène Obama. Un signe des temps : https://www.temoins.com/jean-hassenforder-le-phenomene-obama-un-signe-des-temps/
- Dominique Moisi. Géopolitique de l’émotion. Flammarion , 2008
- De Martin Luther King à Obama : https://vivreetesperer.com/de-martin-luther-king-a-obama/
- Récits de vie et gouvernance participative : https://vivreetesperer.com/recits-de-vie-et-gouvernance-participative/
Autres textes
La prière dans la vie de Barack Obama : https://vivreetesperer.com/la-priere-dans-la-vie-de-barack-obama/
Barack Obama au Kirchentag : https://vivreetesperer.com/notre-responsabilite-pour-le-monde/
La rencontre entre le Président Obama et le pape François : https://vivreetesperer.com/la-rencontre-entre-le-president-obama-et-le-pape-francois/
Vivre et espérer : Une opportunité de dialogue
Un ami, Sylvain, apprécie Vivre et espérer.
Ainsi a-t-il écrit quelques commentaires sur certaines livraisons de Vivre et espérer.
En voici un concernant la livraison de février 2012(1) C’est un dialogue qui s’ouvre ainsi à travers le temps.
Merci Sylvain !
 Cet article qui a abordé la peinture comme un mode de communication (parler de Dieu, parler à Dieu) me plait beaucoup, car comme tu le sais j’apprends la peinture, mais aussi les corrélations avec des états qui rapproche l’artiste, dans son exécution, d’états modifiés, de transe, plus connu sous le nom de flow.
Cet article qui a abordé la peinture comme un mode de communication (parler de Dieu, parler à Dieu) me plait beaucoup, car comme tu le sais j’apprends la peinture, mais aussi les corrélations avec des états qui rapproche l’artiste, dans son exécution, d’états modifiés, de transe, plus connu sous le nom de flow.
La peinture comme moyen de se lier à la vie, à la spiritualité, est une nouvelle perspective pour moi, qui m’enchante.
Je trouve que c’est une belle démarche qui pourra apporter de la profondeur à mes œuvres.
Un moyen de me dépasser, de communiquer aux hommes et pourquoi pas avec Dieu ?
Quel présence Dieu a-t-il dans ma vie ? Je ne le dis pas encore clairement.
Odile était très claire avec cela, tout comme toi. Pas d’hésitation, de demie mesure. Une confiance totale, le dévouement, l’amour. La foi, une force qui permet de voir la vie autrement et d’en donner un véritable sens.
D’accepter, ou plutôt de comprendre que la vie est telle qu’elle est, et qu’il ne faut pas se focaliser sur les résultats sans prendre de recul, mais belle et, bien sûr, ce que les expériences positives ou négatives peuvent réellement nous apporter.
Cela parle du bien qu’il y a en toute chose a partir du moment où l’on se donne les moyens de le voir.
Pour apprécier la vie, il faut l’aimer.
La chanson de Jacques Brel est un hymne à la vie, au partage.
Cette article parle aussi de cette valeur incommensurable qu’est le don de soi.
Lorsque l’on arrive à casser toutes ses barrières mentales et que l’on se donne pleinement sans se soucier de ce que pensent les autres, mais plutôt de ce que l’on peut offrir à l’autre, alors le message que l’on peut véhiculer devient intemporel, et touche tout le monde.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on devient pur amour.
Et dans les situations plus compliquées de l’existence quand on a que l’amour devient alors cette force qui nous raccroche à la vie, qui nous lie a ce qu’il y a de plus beau en nous grâce au regard de l’autre, et qui nous fait comprendre que notre existence a un sens,
Il est difficile de penser que malgré qu’il y ait une existence après la mort, qu’un fossé nous sépare de ce que nous sommes actuellement.
De savoir qu’il y a un lien entre la vie et la mort, beaucoup plus simple a appréhender que tout ce qui est proposé, me parait plus apaisant.
Il suffit de penser en toute simplicité à l’autre pour se connecter. Cela veut dire que l’autre peut aussi se connecter à nous. Ce qui veut dire que quoi qu’il advienne, nous ne sommes jamais seul.
Toutes ces manières de penser et d’appréhender l’existence sont tellement riches et variées. Cela peut donner le tournis et peut parfois prendre des allures compliquées. C’est avec les personnes qui ont une pensée claire que l’on trouve le plus de simplicité. Et c’est dans la simplicité que l’on touche à la compréhension de l’autre, que l’on retrouve des vérités, justes, belles, réconfortantes et apaisantes.
Il faut évoluer avec son temps et profiter de toutes ces ressources que l’on a la chance d’avoir autour de soi pour apprendre et mieux comprendre ce qu’est la vie, afin de pouvoir mieux communiquer avec son prochain et le soutenir.
Rester rigide dans des idées, dans des principes, n’a aucun sens car la vie montre que c’est dans la capacité l’adaptation que survit le plus sage.
Un esprit dicté par des principes figés évoluera dans la contrainte, alors que l’esprit ouvert, saura s’adapter, rester fidèle à lui-même et donner le meilleur à tout ce qui l’entoure.
Sylvain
- Livraison 2012 Peindre, c’est aussi parler, Horizon de vie, Quand on a que l’amour, Sur la Terre comme au Ciel, Une vie qui ne disparaît pas , Vivre et espérer février 2012 : https://vivreetesperer.com/2012/02/
Enlever le voile
« Unveiling » selon Richard Rohr
Et si, face à une conjoncture catastrophique, nous apprenions à voir plus profond, plus vrai, plus loin.
Nous vivons dans une conjoncture anxiogène, pressés par les menaces de la pandémie et du réchauffement climatique. Nos habitudes, nos certitudes sont bousculées. C’est l’occasion d’une prise de conscience, d’un regard nouveau sur la réalité. Nous voici appelés à « enlever le voile » (unveiling) comme nous l’explique Richard Rohr, fondateur et animateur du « Center for action and contemplation » à Albuquerque dans l’état du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis(1). Richard Rohr est un moine franciscain, un penseur œcuménique qui témoigne de la sagesse de la mystique chrétienne et œuvre pour une intégration de l’action et de la contemplation. En réponse aux aspirations spirituelles de notre temps, il a écrit de nombreux livres, notamment « The divine dance » présenté sur ce blog (2). Chaque jour, sur le site du Centre pour l’action et la méditation, Richard Rohr partage avec nous une réflexion dans un parcours annuel dont le thème sera cette année : « A time of unveiling » (un temps de dévoilement) (3) : « En dépit de l’incertitude et du désordre, le moment présent est une grande opportunité pour nous éveiller à une transformation profonde dans l’amour et dans l’espérance… La réalité nous invite à entrer en profondeur pour découvrir ce qui dure et ce qui compte ».
Une conjoncture apocalyptique
Aujourd’hui, les menaces abondent. Nous vivons cette situation comme catastrophique. Un terme remonte à notre esprit pour la qualifier : apocalyptique, mais il est très souvent entendu à mauvais escient. « Ce mot est utilisé pour faire peur aux gens et les entrainer dans des conduites de peur, d’exclusion, de réaction dans la perspective d’une fin des temps ». Richard Rohr nous apporte le sens véritable du mot : apocalyptique. Il vient du grec : « apokalupsis » qui en réalité veut dire simplement : dévoilement. Il y a ainsi des textes apocalyptiques dans le Nouveau Testament : Mathieu 24, Luc 21, Marc 13, et le livre entier de l’Apocalypse. Mais quelle est l’intention de cette littérature ? Ce n’est pas d’effrayer, mais de dévoiler. Nous sommes bousculés dans notre conception du normal pour pouvoir le redéfinir. Ainsi, « il y a un langage et des images hyperboliques tels que les étoiles tombant du ciel et la lune se changeant en sang pour nous aider à reconnaître que nous ne sommes pas dans un état normal. Cela ne veut pas dire que nous sommes à la fin du monde, mais cela nous aide à imaginer la fin de « notre monde ».
Un nouveau regard
Dans ce tohu bohu, rien n’est plus « normal ». Les mauvais systèmes paraissent à la fois de plus en plus éffrontés et banals. Et pourtant, écrit Richard Rohr, dans tout cela, « Dieu nous invite à une transformation plus profonde ». « Quand les choses sont dévoilées, nous cessons de les tenir pour acquises. C’est ce que des évènements majeurs comme la pandémie produisent. Ils recadrent la réalité d’une manière radicale et nous invitent à une plus grande profondeur ». Richard Rohr inscrit cette relecture dans la compréhension de l’œuvre de Dieu. « La création est en cours de transformation et nous allons vers le bon et le nouveau ». C’est la réalité de l’évolution. La fin est le point de départ d’un nouveau commencement. Comme chrétiens, nous pensons que l’univers a un sens. L’expression biblique : « l’alpha et l’omega » marque les deux extrémités du temps cosmique. « Dans la trajectoire du monde, la conscience se déploie . « Toute la création gémit dans un grand acte d’enfantement (Romains 8.22) ». Nous sommes trop impatients. Les humains comme l’histoire grandissent lentement.
Une voie pour le discernement : la prière contemplative
« Nos problèmes commencent quand nous nous opposons à la réalité, la repoussons ou déclarons que la manière dont nous « voyons » la réalité, de notre perspective limitée, est la seule réalité valide ». « Toute pratique contemplative qui cherche à accueillir la réalité telle qu’elle est, nous changera ». « La prière contemplative est une forme de dévoilement, car elle révèle ce qui se passe en dessous de la surface de notre mental. Quand nous arrivons à être assez tranquille, la contemplation peut advenir en nous dans des moments d’ouverture, juste ici, juste maintenant ». A travers la contemplation, nous plongerons positivement dans la réalité dévoilée, et même désagréable, en disant « Viens mon Dieu et enseigne moi tes bonnes leçons ». Nous avons besoin d’une telle pratique pour abaisser notre résistance au changement et notre agrippement aux choses. Cherchons à prier en ce sens aussi longtemps qu’il nous faudra pour dire pleinement oui à la réalité . C’est alors seulement que nous pourrons en voir les leçons ». Ainsi, dans la situation troublée qui est la nôtre aujourd’hui, Richard Rohr nous propose un chemin.
J H
- Center for action and contemplation : https://cac.org
- La danse divine : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/ et : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-et-vivre-la-presence-dun-dieu-relationnel/
- A time of unveiling Semaine du 3 au 9 janvier 2021 https://cac.org/a-time-of-unveiling-weekly-summary-2021-01-09/ Ce texte est écrit à partir des méditations du 3 et du 8 janvier (Pulling back the veil. When things are unveiling), et aussi du lundi 4 janvier 2021 (The prayer of unveiling)
A travers les méandres de l’histoire, une humanité meilleure qu’il n’y paraît
 Une approche « optimiste » pour une action positive
Une approche « optimiste » pour une action positive
Selon Rutger Bregman
Lorsqu’on remonte le cours de l’histoire, notre attention est attirée par les massacres qui la jalonnent, autant de malheurs engendrés par les ambitions, les égoïsmes, les fureurs collectives. Dans son livre sur la ,
philosophie de l’histoire, « Darwin, Bonaparte et le Samaritain », Michel Serres nous parle d’un âge dur symbolisé par la figure guerrière de Bonaparte (1). Il y a donc là la matière d’une dépréciation de l’homme. Dans une généralisation abusive, il peut nous apparaître comme violent et égoïste. Ce regard engendre la méfiance et cette méfiance alimente les tensions. Ainsi l’homme est perçu comme dangereux. Alors ses instincts présumés néfastes doivent être réprimés et il doit être encadré par un pouvoir fort, autoritaire et hiérarchique. En Occident, cette vision sombre de l’homme a été religieusement cautionnée par la théologie du péché originel (2), mais on la retrouve également chez ses penseurs matérialistes comme Freud (3). Cette vision négative de l’homme n’est pas sans conséquences. Loin de faire barrage, elle amplifie le mal. Elle ouvre la voie au fatalisme et à la résignation. Elle influe sur nos comportements. Ce problème a été abordé en France par un pionnier de la psychologie positive Jacques Lecomte (4). En psychologie aussi, si nous nous attardons uniquement sur nos dysfonctionnements, cette orientation fera barrage à une dynamique positive. Nous avons déjà présenté sur ce blog le beau livre de Jacques Lecomte : « La bonté humaine ». L’homme n’est pas monolithique. Il y a en lui des inclinations différentes.
Dans son récent livre : « Humanité. Une histoire optimiste » (5), le chercheur néerlandais, Rutger Bregman, s’engage dans la même voie à partir d’une recherche approfondie qui prend souvent la forme d’enquêtes. Il démonte le mythe que les gens sont « égoïstes » et « agressifs » et il ouvre la voie à une autre perception : « Les gens sont des gens bien » (p 21). On connaît de mieux en mieux les effets positifs de l’effet placebo. Notre imagination transforme les situations en bien, mais ce peut être aussi en mal, ce qu’on qualifie aujourd’hui d’ « effet Nocebo ». Voici la raison d’être du livre de Rutger Bregman : « Une vision négative de l’humanité n’a-t-elle pas aussi un effet nocebo ? Si nous croyons que la plupart des gens sont mauvais, c’est ainsi que nous allons nous traiter mutuellement. Du coup, nous allons flatter chez chacun et chacune les plus vils instincts. Après tout, peu d’idées ont autant d’influence sur le monde que notre vision de l’humanité. Ce que l’on présuppose chez l’autre, c’est ce que l’on suscite. Quand il s’agit des plus grands défis de notre époque, du réchauffement climatique au déclin de la confiance que l’on porte au prochain, je pense que la réponse commence par une autre perception du genre humain. Je ne compte pas prétendre dans ce livre que l’homme est naturellement bon. Nous ne sommes pas des anges. Nous avons tous une bonne et une mauvaise jambe. La question, c’est de savoir laquelle nous exerçons. Je souhaite simplement montrer que nous avons tous et toutes naturellement depuis l’enfance -que ce soit sur une ile inhabitée, lorsqu’une guerre éclate ou que les digues se rompent- une forte préférence pour notre bonne jambe. Ce livre rassemble un grand nombre d’éléments scientifiques. Il en ressort qu’il est réaliste d’avoir une vision plus positive de l’être humain. D’ailleurs, je pense que cela peut devenir encore plus réaliste si nous nous mettons à y croire » (p 28-29).
Tout au long de ce livre, Rutger Bregman relate des faits historiques ou des histoires. Il analyse les interprétations, et bien souvent, pour en diminuer les biais, il effectue des enquêtes en remontant le temps. Comme un détective, il découvre les dessous des faits étudiés. Rutger Bregman allie ainsi la démarche d’un auteur de roman policier et celle d’un historien et d’un sociologue. Il met sa grande culture au service d’une cause : la mise en évidence d’une nouvelle vision de l’humanité.
Un nouveau regard à propos de situations sociales en tension
Pour démonter les préjugés et introduire un nouveau regard, ce livre nous entraine dans un parcours. Et, tout d’abord, à partir d’exemples saisissants, il contredit des représentations négatives de situations sociales et nous apporte en regard une vision positive. Comme l’affirme Gustave Thibon dans « la psychologie des foules », est-il vrai que, dans des situations d’urgence, « l’homme descend de plusieurs degrés sur l’échelle de la civilisation » ? (p 11). L’expérience dément cette prédiction. Lorsqu’en septembre 1940, les bombardiers allemands s’attaquèrent à la ville de Londres et commencèrent leur œuvre de destruction, la population, loin de s’effondrer sous le choc, résista. « Gustave Le Bon, le fameux psychologie des masses, n’aurait pas pu être plus éloigné de la vérité. La situation d’urgence ne convoquait pas le pire chez les êtres humains. Le peuple britannique s’était précisément élevé de quelques degrés sur l’échelle de la civilisation » (p 14). Etait-ce là un phénomène spécifiquement britannique ? Pas vraiment puisque lorsque par la suite des bombardements écrasèrent les villes allemandes, la population résista.
Rutger Bregman apporte d’autres exemples. Ainsi lorsque l’ouragan Katrina dévasta La Nouvelle Orléans aux Etats-Unis, il n’en résulta pas une sauvage anarchie comme cela fut rapporté par certains medias , mais au contraire un mouvement de solidarité et d’amour du prochain, un démenti au commentaire d’un historien britannique : « Retirez les éléments de base de la vie organisée et civilisée et nous retournerons en quelques heures à un état de nature hobbesien (à l’image de la théorie d Hobbes), celui d’une guerre de tous contre tous » (p 23). D’autres chercheurs montrent au contraire que, dans les situations d’urgence, c’est ce que les gens ont de meilleur qui revient à la surface (p 26). Le pessimisme dominant sur la nature humaine apparait dans un roman de William Golding : « Sa majesté de mouches » (Lord of the flies). C’est la désintégration d’un groupe d’écoliers britanniques ayant échoué dans une ile déserte. Cette histoire est une pure invention. Elle témoigne du parti pris de l’auteur : « L’homme produit le mal comme l’abeille produit le miel ». Ce livre a connu un grand succès. « Il a été traduit en plus de trente langues et est devenu un des plus grands classiques du XXè siècle » (p 42). En fait, il a rejoint et conforté un pessimisme ambiant . Rutger Bregman nous raconte combien ce livre l’avait attristé. Aussi lorsque le temps de sa recherche est arrivé, il a découvert un auteur « assez torturé » (p 43) et surtout, à sa manière de détective, il s’est mis à chercher si, en vrai, on avait des récits d’enfants naufragés et comment ils avaient réagi. Et, à partir d’internet, cette enquête a finalement abouti. Dans le Pacifique, six enfants avaient échoué sur une ile déserte. Ils s’étaient bien entendu et finalement ils avaient pu être libérés (p 41-57). Au total, Rutger Bregman nous rapporte les effets négatifs des récits cyniques sur notre vision du monde.
La nature humaine à travers l’histoire
Mais d’où vient l’humanité ? Quel est notre héritage ? Comment notre vie en société a-t-elle évolué jusqu’à aujourd’hui ? L’auteur s’engage dans une recherche anthropologique. Son chapitre sur l’état de nature commence par une évocation de la vision opposée de Hobbes et de Rousseau. « Hobbes, le pessimiste croyait que l’homme était naturellement mauvais. Seule la civilisation, pensait-il, pouvait nous sauver de nos instincts bestiaux. En face, Rousseau était convaincu que nous étions profondément bons. Mais il pensait que la civilisation nous avait abimé » (p 61) . L’auteur envisage l’évolution de l’humanité de l’homme de Néanderthal à l’Homo Sapiens. Si on a pu soupçonner l’Homo Sapiens d’avoir éliminé ses prédécesseurs, Rutger Bregman répond à cette accusation en mettant en valeur la spécificité positive de notre espèce : la sociabilité. Et, pour cela, il nous rapporte une expérience entreprise en Sibérie montrant la possibilité d’évolution de renards argentés d’une redoutable agressivité à une sensibilité extrême et à toutes les qualités attenantes. Cette extraordinaire expérience nous aide à percevoir les caractéristiques positives de l’Homo Sapiens : « Les êtres humains sont des machines à apprendre hypersensibles. Nous sommes nés pour apprendre, pour nouer des liens et pour jouer » (p 87).
Et cependant, la violence meurtrière est un fait historique. L’auteur n’élude pas le problème. Il y répond d’abord par un chapitre qui montre que, même dans l’armée, les soldats ne sont pas prédisposés à tirer pour tirer. Et de plus il semble que le phénomène de la guerre ait eu un commencement. « La guerre ne remonte pas à des temps immémoriaux. Selon l’éminent archéologue, Brian Ferguson, elle a eu un début ». « Disposons-nous de preuves archéologiques pour étayer l’existence de formes de guerre primitives antérieures à la domestication du cheval, à l’invention de l’agriculture et aux premières colonies de peuplement ? Quelles sont les preuves que nous sommes d’une nature belliqueuses ? Réponse : il n’y en a pratiquement pas… » (p 111).
Nous voici donc engagé dans une recherche historique. Selon Rutger Bregman, la guerre n’a guère prospéré chez les chasseurs cueilleurs, des sociétés portées au partage.
Cependant, le climat se réchauffant après la dernière période glaciaire, il y a environ 15000 ans, la lutte commune contre le froid a cessé. Les populations se sont installées. « Plus important encore, les gens ont commencé à accumuler des biens » (p 120). Le patrimoine s’est accru. Des pouvoirs autoritaires se sont mis en place. « Ce qui est fascinant, c’est que c’est justement à cette époque après la fin de la période glaciaire qu’ont eu lieu les premières guerres » (p 121). Il y a une corrélation entre le développement des états et des empires et l’expansion de la guerre. « Notre vision de l’histoire a été déformée. La civilisation est devenue synonyme de paix et de progrès tandis que la vie sauvage équivalait à la guerre et au déclin. En réalité, pendant la majeure partie de notre histoire, cela a été plutôt le contraire (p 131). De fait, « le véritable progrès est en fait très récent ». « Il ne s’agit donc pas d’être fataliste face à la civilisation. Nous pouvons choisir de réorganiser nos villes et nos Etats dans l’intérêt de chacun et de chacune… » (p 133).
Au nom de préjugés pessimistes, comment des expérience en psychologie sociale ont été dévoyées.
Dans les années 1950 et 1960, la psychologie sociale a grandi. C’est alors que dans l’humeur dominante de l’époque, de jeunes psychologues ont réalisé des expérimentations qui partaient de postulats négatifs sur la nature de l’homme. Certaines d’entre elles ont exercé une grande influence, par exemple une expérience menée par Stanley Milgram à l’université Yale. Des moniteurs étaient chargés d’envoyer des électrochocs (en réalité factices) à des cobayes donnant de mauvaises réponses. De fait, la majorité des moniteurs suivirent les consignes de l’expérimentateur jusqu’à de grandes décharges. Ces résultats furent abondamment diffusés. « Pour Milgram, tout tournait autour de l’autorité. Il décrit l’humain comme un être qui suivait des ordres sans broncher » (p 183). Un écho aux atrocités nazies… Comme pour d’autres expérimentations mettant en valeur le côté sombre de la nature humaine, Rutger Brugman a enquêté, remontant dans les archives et dans la mémoire humaine. Et, à partir de là, il met en évidence les biais de ces expériences. Ici, il montre les résistances larvées des participants. « Si vous pensez qu’une telle résistance ne sert à rien, lisez donc l’histoire du Danemark pendant la seconde guerre mondiale. C’est l’histoire de gens ordinaires témoignant d’un courage extraordinaire. Une histoire qui montre que cela a toujours un sens de résister même dans les circonstances les plus sombres » (p 196).
La violence meurtrière est un fait. Comment en comprendre les ressorts ?
Pendant la seconde guerre mondiale, on a pu constater les performances de l’armée allemande. Une contre propagande a été organisée. Les effets ont été limités. La recherche a montré quelles raisons bien plus simples permettaient d’expliquer les performances presque surhumaines de l’armée allemande. Kameradschaft : l’amitié… En fin de compte, les soldats ne se battaient pas pour un Reich millénaire, pour « le sang et le sol ». Ils se battaient pour leurs camarades qu’il ne fallait pas laisser tomber. « En fait, nos ennemis souvent nous ressemblent » (p 228). Même pour les terroristes, les liens sociaux comptent beaucoup. « Cela n’excuse pas leurs crimes, mais cela les explique » (p 230).
Ensuite, l’auteur rappelle les études qui montrent la répugnance de beaucoup de soldats à tirer sur leurs ennemis. « Il y a une aversion atavique des êtres humains pour la violence » (p 241). « La plupart du temps, on ne tire pas de près, mais de loin » (p 241). « Les guerres, de mémoire d’homme, se gagnent donc en employant le plus de gens possible pour tirer à distance » (p 241). « Enfin, il y a un groupe pour lequel il est aisé de garder une distance avec l’ennemi, c’est le groupe qui se trouve au sommet » (p 243). Alors comment se fait-il que les égoïstes, « les bandits, les personnalités narcissiques, les sociopathes pervers parviennent si souvent à se hisser au sommet de la hiérarchie ? » (p 204). Rutger Bregman s’interroge donc sur le pouvoir et, à cet égard, il rappelle les écrits de Machiavel : « la théorie selon laquelle il vaut mieux mentir et tricher si l’on veut parvenir à quelque chose » (p 216). L’auteur se montre très critique vis à à vis du pouvoir, de ses effets et de ses conséquences. Il rappelle le mot célèbre de lord Acton : « Tout pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument » (p 254). Par ailleurs le pouvoir va de pair avec le développement ou le maintien des inégalités. « Certaines sociétés ont donc monté quelque chose pour mieux distribuer le pouvoir. Nous appelons cela la démocratie ». Mais il y a des limites.
L’héritage des lumières
Le siècle des lumières : une étape majeure dans l’histoire occidentale. Rutger Bregman nous en montre les apports décisifs. Les lumières ont posé les fondements du monde moderne de la démocratie à l’état de droit, de l’éducation à la science » (p 265). Cependant certains philosophes des lumières comme Hobbes posaient sur l’homme un regard très pessimiste. « Face à la corruption de l’homme, ils s’appuyaient sur la raison ». « Ils se sont persuadés que nous pouvions développer des institutions intelligentes qui tiendraient compte de notre égoïsme inné » (p 266). L’économie a été envisagée comme la mise en œuvre des intérêts. Dans la première démocratie occidentale, les Etats-Unis, la constitution posait des contrôles et des contre-pouvoirs. « On doit faire jouer l’ambition contre l’ambition » (p 267).
Lorsqu’on dresse l’héritage des lumières, on y voit de grands bienfaits. Mais aussi, il y a une part d’ombre. Et, dès lors, on peut s’interroger pourquoi les institutions héritières des lumières (démocratie, état de droit, vie économique) se fondaient-elles sur une conception aussi pessimiste de la nature humaine. Pourquoi s’attachaient-elles à une vision si négatives de l’humanité ? Ces négations n’ont-elles pas nuit à une bonne marche des institutions ? « Pourrions-nous miser sur la raison et utiliser notre entendement pour créer de nouvelles institutions qui s’appuieraient sur une toute autre conception de l’humanité ? » (p 271). La recherche de Rutger Brugman va s’orienter dans ce sens.
L’influence des représentations sur les attitudes et les comportements. Les effets placebo et nocebo
Si, dans sa recherche de la vérité, l’auteur en était venu à se méfier des croyances, à un moment, il a commencé à douter du doute lui-même. C’est ici qu’il nous rapporte les célèbres recherches de Bob Rosenthal. « Les rats, dont les étudiants pensent, en fonction des informations qui leur ont été données, qu’ils sont plus intelligents et plus vifs, réussissent effectivement mieux » (p 277). Rosenthal découvre que « la façon dont les étudiants manipulaient les rats « intelligents »- plus chaleureuse, plus douce et plus chargée d’attentes- changeait la façon dont les rats se comportaient » (p 278). Et cette influence d’une image positive sur les réalisations de ceux à qui elle est affectée s’est confirmée brillamment dans une école. Les élèves dont il était cru qu’ils étaient plus doués que les autres, réussissaient beaucoup mieux. Rosenthal appelle sa découverte l’effet Pygmalion. L’effet Pygmalion rappelle l’effet placebo. Seulement, « il ne s’agit pas ici d’une attente d’un effet sur nous-même. Cette fois, c’est une attente qui produit un effet sur les autres » (p 279). Contrairement à d’autres, cette découverte a été validée maintes fois. Mais en a-t-on tiré tous les enseignements ? « Si nos attentes peuvent devenir réalité, c’est aussi le cas de nos hantises. Le jumeau maléfique de l’effet Pygmalion est appelé « l’effet Golem » (p 279). « Notre monde est tissé d’effets Pygmalion et d’effets Golem… L’homme est une antenne qui s’ajuste à la fréquence des autres » (p 280-281). C’est dire l’influence de nos représentations collectives et notamment du regard que nous portons sur la condition humaine d’autant qu’il y a des effets induits. On adopte ce que les autres adoptent. Les gens se laissent souvent entrainer par ce qui leur apparaît l’opinion dominante. Dès lors, Rutger Bregman s’interroge. « Notre conception négative de l’humanité relève-t-elle aussi de l’ignorance collective. Craignons-nous que la plupart des gens soient égoïste parce que nous pensons que c’est ce que pensent les autres ? Et nous conformons-nous à ce cynisme alors que nous aspirons en réalité à une vie plus riche en gentillesse et en fraternité » (p 283). Ne nous laissons pas enfermer dans des spirales négatives. « La haine n’est pas la seule à être contagieuse. La confiance l’est aussi » (p 283).
Puissance de la motivation intrinsèque
La conviction d’un homme peut susciter la confiance et des réalisations à contre-courant qui sortent de l’ordinaire. L’auteur nous donne l’exemple de Jos de Blok, fondateur de la Fondation Boutsorg, une organisation néerlandaise de soins à domicile ou prévaut l’entraide en dehors d’une tutelle hiérarchique (p 285). A cette occasion, Rutger Bregman met en valeur « une motivation intrinsèque ». « Pendant longtemps, on a cru que le monde du travail dépendait du « bâton et de la carotte ». Ainsi Frédéric Taylor, dans son « organisation scientifique du travail » assure que « ce que les employés attendent par dessus tout de leurs employeurs, c’est un bon salaire » (p 282). Cependant, en 1969, un jeune psychologue, Edward Deci rompt avec la psychologie behaviouriste où les être sont considérés comme passifs en montrant que l’effort n’est pas toujours proportionné à une récompense matérielle. Une prise de conscience de la motivation intrinsèque émerge. Mais elle tarde à se répandre dans les organisations. Cependant, il y a aujourd’hui beaucoup d’innovations qui vont dans ce sens. L’auteur nous en décrit plusieurs. Il y a bien une motivation intrinsèque. « Edward Deci, le psychologue américain grâce auquel notre façon d’envisager la motivation a été transformée de fond en comble, estime que la question n’est plus de savoir comment nous motiver les uns les autres. La vraie question est plutôt de savoir comment créer une société dans laquelle les gens se motivent eux-mêmes » (p 299-230). Rutger Bregman poursuit : « Et si nous fondions la société toute entière sur la confiance ? ». Ainsi évoque-t-il un mouvement de transformation sociale qui s’exprime dans des expériences éducatives et politiques. Il y a bien une évolution des mentalités. Ainsi prend-on conscience aujourd’hui de tout ce dont nous disposons en commun. C’est le terme anglais : « commons ». Pendant longtemps, tout ce qu’il y avait au monde faisait partie des « commons ». Cependant au cours des dix mille dernières années, la propriété s’est développée. Mais aujourd’hui, il y a de nombreuses situations où les « commons » prospèrent et il y a là un horizon nouveau.
Face à la violence
Dans la dernière partie du livre, Rutger Brugman envisage différentes stratégies pour diminuer la violence et résoudre les conflits. Le titre est significatif : « L’autre joue », en référence à une parole de Jésus. Et il commence en rapportant une anecdote. Agressé par un jeune qui s’empare de son porte-monnaie, un travailleur social lui propose de manger avec lui. Une relation s’établit. Rutger Bregman ne cache pas sa stupéfaction en entendant cette histoire. Elle lui fait penser aux clichés qu’enfant il entendait à l’église. Et il réfléchit. « Ce dont je me rend compte maintenant, c’est qu’en fait Jésus décrivait un principe très rationnel. Les psychologues modernes parlent ainsi de « comportement non complémentaire »… Il est facile de faire le bien autour de soi lorsqu’on est soi-même bien traité. Ou comme le disait Jésus : « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? ». La question est de savoir si on peut aller un cran plus loin. Et si nous partions du principe que non seulement nos enfants, nos collègues et nos concitoyens, mais aussi nos ennemis ont un bon fond. Le mahatma Gandhi et Martin Luther King, les plus grands héros du XXè siècle brillaient par leurs comportements non complémentaires, mais c’étaient des figures presque surhumaines. D’où la question : en sommes-nous capables ? Et cela fonctionne-t-il aussi à grande échelle dans les prisons et les commissariats de police, après les attentats et en temps de guerre ? ». Dans ce livre, le lecteur découvrira quelques exemples. Ainsi l’auteur décrit des prisons norvégiennes ou l’engrenage de la violence est rompu par un climat de confiance. Et puis, il analyse des situations où un renouveau de compréhension résulte d’une réduction de l’isolement social et d’un abaissement des barrières entre les groupes. Il y a là un autre apport original de ce livre qui mérite une lecture approfondie.
Un nouveau regard
La richesse de cet ouvrage nous a incité à écrire un long compte-rendu pour en partager l’apport et inviter à la lecture d’un livre qui, de bout en bout se lit passionnément. En effet, non seulement il nous invite à un regard neuf, mais il nous entraine dans un chemin d’exploration. Bien sur, nous ne suivons pas nécessairement l’auteur dans certaines de ses affirmations, il y a d’autres approches dans l’histoire qui mériteraient d’être mentionnées (6), mais il nous offre un livre facilement accessible qui nous permet d’accéder à un ensemble de recherches et d’innovations. C’est un livre qui ouvre notre regard. Ce n’est pas rien d’entendre un historien israélien renommé Yuval Noah Harari affirmer : « L’ouvrage de Rutger Brugman m’a fait voir l’humanité sous un nouveau jour ». Et, ce livre nous invite aussi à changer dans nos comportements comme il énonce « dix préceptes » en conclusion. « Le monde serait meilleur si nous portions sur l’autre un regard bienveillant et si nous cherchions à le comprendre. Le bien est contagieux » (p 420). Le sous-titre : « Une histoire optimiste » nous avait au départ déconcerté et amené à vérifier le sérieux du livre en nous renseignant sur l’auteur à travers un moteur de recherche. Le titre en anglais nous paraît plus approprié : « A hopeful history » (une histoire qui incite à l’espoir). Oui, la période actuelle est particulièrement difficile. Cependant, il y a aussi des courants, parfois encore peu visibles, qui se développent pour affronter les menaces et construire d’autres possibles. Pour y participer, cette lecture nous paraît très utile.
J H
- Une philosophie de l’histoire, par Michel Serres https://vivreetesperer.com/une-philosophie-de-lhistoire-par-michel-serres/
- Bienveillance humaine. Bienveillance divine. Une harmonie qui se répand https://vivreetesperer.com/bienveillance-humaine-bienveillance-divine-une-harmonie-qui-se-repand/
- Vers une civilisation de l’empathie https://www.temoins.com/?s=empathie&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
- La bonté humaine https://vivreetesperer.com/la-bonte-humaine/ Voir aussi : Vers un nouveau climat de travail dans des entreprises humanistes et conviviales https://vivreetesperer.com/vers-un-nouveau-climat-de-travail-dans-des-entreprises-humanistes-et-conviviales-un-parcours-de-recherche-avec-jacques-lecomte/
- Rutger Bregman. Humanité. Une histoire optimiste. Seuil, 2020 Rutger Bregman est également l’auteur du livre (best seller) : Utopies réalistes. Seuil, 2017
- Comment l’Esprit de l’Evangile a imprégné les sociétés occidentales, et, quoiqu’on en dise, reste actif aujourd’hui https://vivreetesperer.com/comment-lesprit-de-levangile-a-impregne-les-mentalites-occidentales-et-quoiquon-dise-reste-actif-aujourdhui/
Facebook en question
S’il vous plait, un peu de communication dans une ambiance respirable lorsque les médias se font répétitifs et amplifient l’écho des mauvaises nouvelles. Alors si parfois les contenus de facebook peut me paraître un peu superficiels, et si ma fréquentation, dans un moment d’isolement où le besoin de relation et d’information se fait sentir, peut comporter un danger d’addiction, au total, c’est finalement une ressource bénéfique puisqu’au fil du temps, un réseau assez divers a pu se développer. Et d’abord, l’à priori positif qui est privilégié à travers le rôle donné aux «like» éduque mon regard et suscite une démarche d’appréciation et de participation. Et puis, si les nouvelles importantes apparaissent immédiatement, elles sont en quelque sorte filtrées par une réception humaine . Alors, si « la pêche » sur facebook me paraît maigre assez souvent, il y des moments aussi où j’y trouve un texte, une vidéo, une photo à partager et à répandre. Et parfois, c’est une piste, une ressource signifiante. Et puis, ne l’oublions pas, si je n’ai pas rencontré physiquement la grande majorité de mes « amis » de facebook, une fréquentation régulière de leurs messages me permet d’entrevoir leur vie et leur personnalité. C’est donc un regard amical que je porte. J’ai conscience que ce qu’ils communiquent peut être interprété comme un cadeau de leur part. Ils me font part de ce qui leur tient à cœur.
Je suis venu à facebook individuellement, il y a une décennie. A l’époque, je créais les blogs : « Vivre et espérer » et « L’Esprit qui donne la Vie ». Je ressentais un besoin de partage et de relation. J’y suis arrivé seul et, peu à peu, j’y ai retrouvé certains amis (C P) (1), certaines connaissances (D P), certains collègues (L S C). Rencontres bienvenues, mais je ne suis pas arrivé là comme d’autres dans une situation de partage semi familial avec des amis qui forment « tribu ». C’est une différence avec d’autres. J’ai pu lire un point de vue sociologique qui distingue des réseaux où on s’attache essentiellement à un objet partagé et d’autres où on partage non seulement des informations, mais les ressentis de la vie quotidienne, randonnées, vacances, questionnements et jusqu’à l’évocation d’un bon repas. Ainsi à flickr.com, on partage et on commente des photos. A facebook, c’est toute la vie sociale qui s’exprime. Mais on peut aussi garder une certaine discrétion. C’est mon cas. Ainsi, l’engagement dans facebook prend des formes diverses avec des ressentis et des retours différents. Cependant, quelque soit notre degré d’expression, il y a des convictions fondamentales qui transparaissent. Sur ce blog, j’ai déjà déjà présenté ma participation à facebook dans ses différentes dimensions (2). Dans cet article, je m’interroge sur ma fréquentation de facebook, aujourd’hui, au quotidien.
Un peu plus de 300 « amis » se sont enregistrés. Dans les quelques derniers jours, une cinquantaine d’entre eux se sont manifesté. Il s’y est ajouté l’apport substantiel de nombreux organismes qui diffusent leurs messages sur facebook. Les thèmes sont différents : écologique : Mondialisation, Reporterre, Colibris,
Brut, Forum économique mondial….politique : Loopsider, Guardian, le Monde, Présidence de la République….artistique : Aux amidonniers, RestaurArs et différentes galeries…. Ces contributions et celles des « amis » qui les relayent sont riches en contenus méritant d’être partagés.
Comment est-ce que je perçois les différents aspects de ma fréquentation ?
Une vie sociale
Il y a l’expression de la vie de certains. Ils nous associent aux manifestations et aux ressentis de leur vie quotidienne. Si mon attitude personnelle à cet égard est la discrétion, j’apprécie ce partage comme une expression de confiance. Si des soucis et des deuils peuvent être exprimés, c’est le plus souvent un bonheur partagé. Une personnalité s’exprime en nous faisant part de sa vie familiale et personnelle. Et souvent, en même temps, de ses convictions et de sa motivation profonde.
Ainsi L R nous rapporte les évènements marquant de sa vie de couple et de sa vie de jeune maman. Dans les joies et les difficultés, elle manifeste une inspiration qui nous encourage dans l’amour et la persévérance.
D S réside en Provence. Il nous partage sa vie familiale dans ses vacances et ses déplacements. C’est tout particulièrement la vie de sa petite fille O, musicienne et amoureuse de la nature. A plusieurs reprises, D S s’est fortement engagé pour la défense des droits humains et la promotion démocratique.
J C G ne nous entretient pas seulement avec ouverture et compétence de la culture actuelle. Pasteur, il est engagé dans une expression de foi et dans la promotion des médias protestants. Mais il n’hésite pas à partager des échos de la saveur de sa vie personnelle.
M F R partage avec nous son amour de la nature dans la campagne française, sa pratique écologique et une expression discrète de sa recherche du bon et du beau. De quoi éveiller des affinités…
Il y a aussi des amis qui expriment leur existence dans une dimension internationale : V B partageant son année entre la France et l’Australie, P O et A O sur la côte Pacifique des Etats- Unis avec deux enfants lumineux et un engagement chrétien.
Un écho à l’actualité
Facebook renvoie également à l’actualité en faisant immédiatement écho aux événements à travers des voix nombreuses et diverses. J’ai pu y suivre la campagne présidentielle. Aujourd’hui, je lis des commentaires ( B G D S). Comme mon public est divers, certaines réactions peuvent me déplaire, ainsi parfois des colères qui se polarisent. Mais il est bon de pouvoir entendre des voix différentes à condition que l’agressivité ne prenne pas le pas. Emettre frontalement des avis contraires n’est souvent pas bien accepté dans ce contexte. Certains réussissent à permettre un dialogue grâce à une gestion éclairée ( D P).
Le courant écologique est très présent (F R) et nous pouvons y apprécier et y partager des ressources éclairantes.
La dimension spirituelle
Parmi les intervenants récents sur mon fil facebook, beaucoup ont une activité identifiable dans le champ chrétien. (Une vingtaine sur 50). Cela est sans doute une réponse à ma propre recherche spirituelle. A cet égard, à coté des expressions protestantes, je suis également le courant réformateur en milieu catholique (C P A S
C O M M J). J’évite les manifestations du fondamentalisme et du traditionalisme. Je n’entre pas dans les polémiques suscitées par certaines interventions (H L). Je recherche avant tout une expression d’amour, de foi et de bienveillance ce qui n’exclue pas un examen critique.
Depuis longtemps, j’ apprécie le blog d’une religieuse qui sait nous parler de l’amour de Dieu (Au bonheur de Dieu), très présente sur facebook (M J). Et aujourd’hui une pasteure suisse (A C) s’exprime sur facebook dans une dynamique de vie et d’amour. Du Québec, nous vient une contribution marquante. C’est le réseau Transcendarts animé par P L. J’y trouve du sens et du bon sens, un message chrétien qui éclaire mon esprit. Il y a là une connexion à laquelle participe également un ami rencontré sur facebook, J C. Et puis est apparu également un réseau au titre expressif : « En dehors de la boite religieuse » animé par D F. C’est une heureuse critique du fondamentalisme, une critique intelligente et pertinente qui en montre les travers, les abus et les maux qui en résultent. Mais c’est aussi un trésor d’expressions spirituelles et théologiques. Pour la France, rappelons la page de Témoins sur Facebook, carrefour d’une approche chrétienne interconfessionnelle. Une autre page exprime le mouvement de vie et d’espérance présent dans Vivre et espérer.
Notre fil facebook manifeste également une expression spirituelle qui s’exprime abondamment à travers de courtes expressions : parfois brèves expressions personnelles, mais surtout beaucoup de citations, et pour certains, des versets bibliques (C P). Certains expriment régulièrement leur approche spirituelle (I I A). Ces affirmations portent les plus souvent une vérité expérientielle. A certains moments, abondance et redondance de brèves affirmations peuvent lasser.
Sur un plan plus psychologique où psychologie s’allie à spiritualité, notons l’apport du réseau géré par un remarquable psychothérapeute T A : « La paix, ça s’apprend ».
Dans ce vaste champ d’expression sur facebook émerge de temps à autre un élément fondamental qui nous est rapporté par tel ou tel et que nous diffusons à notre tour.
Généreuse beauté
On ne se lasse pas de la beauté. Elle est très présente sur mon fil facebook , soit à travers des contributions personnelles, soit à travers des apports dédiés. Ce sont des paysages. Et je recours à Flickr pour y participer. Il y a de belles photos personnelles qui traduisent l’amour de la nature (M F R V H P S..). Il y a aussi l’intervention d’offices de tourisme. La France est si belle de la Provence à la Bretagne… Et puis des « amis » nous font part également d’œuvres artistiques (A S V B J E…). De nombreuses galeries nous offrent des reproductions de peintures (Aux amidonniers etc..). Toute cette beauté : photos de nature ou expressions artistiques, vient nous enchanter. C’est une contribution majeure de ma participation à facebook.
Voici donc ma pratique de facebook, une pratique parmi d’autres. Je reçois, mais j’ai à cœur également de contribuer en partageant certains apports ou, en expression de mes convictions, des textes de « Vivre et espérer », de « L’Esprit qui donne la vie » ou de « Témoins » Je fais part aussi de superbes photos que je choisis sur Flick en pensant également à leur apport symbolique.
Je vois sur facebook des interrelations dans le respect et dans la discrétion. Dans mon cheminement, ce qui me revient à ce sujet, c’est la parole de Paul : « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation … soit l’objet de vos pensées » (Epitre aux Philippiens 4.8). C’est rechercher le bon, le bien et le beau. Le rechercher ensemble donne une force plus grande à ce mouvement.
Chacun d’entre nous ressent le besoin d’être reconnu. J’y pense en étant généreux dans mon attribution de « like » en poussant parfois, dans les bonnes occasions, jusqu’à l’élan positif du petit cœur rouge.
Au total, il y a dans le partage de l’expression sur Facebook une incitation à la gratitude et à la louange. D’une certaine manière, facebook peut être une école de bienveillance. Puis-je y apprendre à manifester davantage attention, compassion, prière. Si, pour moi, facebook est d’abord un espace de « bon voisinage » , il oriente mon regard au delà. C’est un chemin.
J H
- Nous mentionnons certains participants Facebook par leurs initiales
- Mon expérience de facebook : https://vivreetesperer.com/mon-experience-de-facebook/
Le temps des consciences
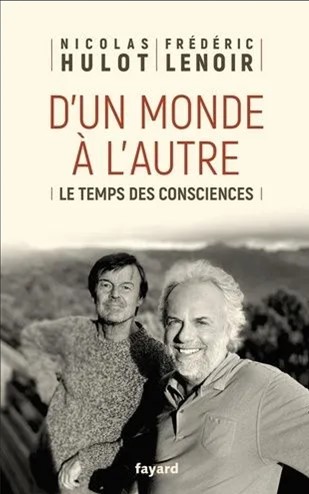 Une rencontre entre Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir
Une rencontre entre Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir
La crise actuelle multiforme et menaçante nous interpelle. Quelles en sont les origines et comment y faire face ? Ces questions sont partout posées . Parmi les réponses, on peut retenir un livre rapportant une rencontre entre Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir : « D’un monde à l’autre. Le temps des consciences » (1).
Ces deux personnalités ont un parcours original et leur rencontre est donc prometteuse. « Nicolas Hulot a passé une partie de sa vie à voyager dans les parties les plus reculées du monde au fil de son émission de télévision : Ushaïa. Engagé depuis trente ans dans la protection de l’environnement , il fut ministre de la transition écologique et solidaire de mai 2017 à août 2018. Auteur de nombreux ouvrages, il a créé la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme ». « Frédéric Lenoir est philosophe et sociologue, auteur de nombreux essais et romans traduits dans une vingtaine de langues. Il est notamment l’auteur des best sellers : « Du Bonheur », « Un voyage philosophique », « La puissance de la joie » ou « Le miracle Spinoza ». Il est cofondateur de la fondation Seve (Savoir Être et Vivre Ensemble) qui propose des ateliers de philosophie avec des enfants » (page de couverture). Le parcours de Frédéric Lenoir est diversifié à la fois quant à ses fonctions et quant à ses intérêts (2). En effet, si ses nombreux livres témoignent de son évolution spirituelle (3), il est connu aussi pour avoir été directeur du Monde des religions. Nous avons ici présenté son remarquable livre : « La guérison du monde » paru en 2012. Dans ce livre, Frédéric Lenoir envisage la crise qui affecte nos sociétés et il en présente les menaces et les opportunités : « Un chemin de guérison pour l’humanité. La fin d’un monde. Le début d’une renaissance » (4). On retrouve l’approche de Frédéric Lenoir dans ce livre : « Le temps des consciences » et on y trouve aussi l’authenticité et l’originalité de la démarche de Nicolas Hulot. De la crise du progrès à la recherche de sens, le livre se déroule en abordant de grandes questions de société comme « le règne de l’argent » ou « les limitations de la politique » ou un examen de nos attitudes : « Tout est question de désir », « Du toujours plus au mieux-être ». Les auteurs nous font part de leur réflexion, mais aussi de leur expérience. Ainsi, dans le chapitre : « Les limites de la politiques», Nicolas Hulot nous fait part des démêlés qui l’ont affecté dans son passage au gouvernement.
La crise du progrès
« En s’interrogeant sur ce qui appartient au progrès ou ce qui n’en est qu’une illusion, nous touchons d’emblée au cœur de la réflexion que nous devons engager en ce début de siècle. Sous bien des aspects, le projet s’est vidé de sens et est devenu une machine incontrôlable » (p 13), nous dit Nicolas Hulot. Mais il rappelle aussi les avancées majeures que sont l’augmentation de l’espérance de vie, les acquis sociaux et les libertés individuelles. Il y a un siècle, 80% de la population mondiale vivait dans l’extrême pauvreté contre 10% aujourd’hui en 2020. Mais, on doit « redéfinir ce que nous estimons relever du progrès afin de distinguer ce qui est une addition de performances technologiques de ce qui participe de notre raison d’être et à l’amélioration durable de la condition humaine » (p 12).
Frédéric Lenoir met en évidence les origines de cette crise. Déjà, dans son livre « La guérison du monde », il déplore le passage d’une conception « organique » du monde à une approche mécanique. C’est le philosophe René Descartes qui induit ce passage : « Au XVIIè siècle, le philosophe René Descartes considère que la nature n’est que de la matière qu’on peut utiliser pour ses ressources. L’être humain devient, selon son mot célèbre, « maitre et possesseur de toutes choses ». Cette pensée réductionniste et utilitariste ouvre le champ de la science expérimentale, mais elle s’allie aussi au capitalisme naissant. La nature est totalement désenchantée. Elle abandonne ses dimensions sacrées pour devenir une chose… L’être humain n’est plus relié au cosmos ce qui pose une question fondamentale : comment vivre en étant déraciné du monde naturel ? » (p 25-26).
Nicolas Hulot dénonce aussi l’exploitation de la nature comme une marchandise. Comme le rappelle Frédéric Lenoir, la prise de conscience actuelle n’est pas sans précédent. Déjà les romantiques, au tournant du XVIIè et du XIXè siècle « offrent une vision du réel plus profonde que celle proposée par la vision cartésienne et reprise par l’idéologie capitaliste ». Pour eux, le monde « n’est pas fait de matière inerte, mais il est un organisme vivant. Ils invitent l’être humain à s’épanouir non pas en regardant la matière désenchantée, mais en contemplant l’âme du monde » (p 244-245), cette âme que le philosophe Platon avait mis en valeur. Frédéric Lenoir fait aussi référence au mouvement transcendentaliste américain : Henry David Thoreau et Ralph Wado Emerson qui tentent de reconnecter l’être humain à ses racines naturelles, et un siècle plus tard à la « Beat generation » (p 246-247).
Face aux déviances du monde actuel, Nicola Hulot partage avec nous la vision puissante et prémonitoire de Victor Hugo : « La grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, je dis même de courber l’esprit des hommes vers la recherche du bien-être matériel. Il faut relever l’esprit de l’Homme vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C’est là et seulement là que vous trouverez la paix de l’Homme avec lui-même et par conséquent avec la société » (p 246).
Appel à la recherche de sens
« Actuellement, face à la crise actuelle, nous subissons comme des esclaves, alors que nous devrions prendre des décisions et faire des choix. La révolution qui se présente actuellement à nous n’est pas technologique. Elle est celle de l’esprit. Et nous devons l’accueillir ensemble… » (p 35) « L’homme doit faire fonctionner son esprit pour sortir du désarroi tragique de ne plus être relié à rien. » « Aujourd’hui, pense Nicolas Hulot, nous devons effectuer un nouveau saut, celui du sens » (p 37). Frédéric Lenoir évoque de même les besoins humains décrits dans la « pyramide d’Abraham Maslow » : « On peut cependant contester le fait que l’être humain passe à une aspiration supérieure lorsqu’un besoin plus fondamental a été satisfait… Ce n’est pas ce que l’expérience de la vie m’a montré. J’ai rencontré à travers de nombreux voyages des gens qui avaient parfois de la peine à survivre et dont la dimension spirituelle les aidait fortement à vivre et à être joyeux… C’est la réaction de notre esprit face aux événements que nous ne pouvons pas maitriser qui fait de nous des êtres joyeux ou tristes. C’est aussi la réflexion intellectuelle et morale qui nous permet de grandir en humanité et de vivre en harmonie avec les autres humains et espèces sensibles. Alors, je te rejoins complètement : La grande aventure du siècle doit être celle de du sens » (p 36-37).
Le livre se termine donc par un chapitre : « donner du sens » avec une citation de Friedrich Hegel en ouverture : « Ce qui s’agite dans l’âme humaine, c’est la quête de sens ». Or, trop souvent, cette quête est méconnue, nous dit Nicolas Hulot : « Boutée hors des débats publics, cantonnée à la sphère privée, voire réduite au non-dit, la question du sens est la grande absente des médias. C’est pourtant elle qui nous permettra de retrouver la pureté de ce qui se dissimule derrière le mot ‘progrès’ trop souvent confondu avec une addition de puissance et une augmentation de l’efficacité. La dimension spirituelle a été engloutie par la société technologique, matérialiste et consumériste » (p 290).
Ce chapitre, riche et diversifié, nous apporte des pistes de réflexion. Ainsi Frédéric Lenoir nous appelle à reconnaitre « la vibration spirituelle qui rassemble tous les humains ». « J’ai constaté cela en rencontrant des gens très éloignés de moi, notamment lors de voyages à l’étranger. Il est possible de vibrer sur la même « longueur d’onde » grâce à un simple sourire, un échange de regard ou quelques gestes… Comme l’ensemble du monde animé, l’être humain a une intériorité qui donne du sens à son corps, l’anime ou l’oriente de telle ou telle manière (p 292-293). « C’est un peu cela que j’appelle le sacré, cette vibration qui relie tous les individus entre eux et qui nous relie tous au monde », commente Nicolas Hulot. Frédéric Lenoir évoque la dimension anthropologique du sacré (5), développée notamment par Rodolf Otto et William James, dans un univers qui nous dépasse, face auquel nous ressentons crainte, émerveillement et qui nous bouleverse. C’est cette expérience profonde qu’on peut qualifier de sacrée ainsi que le lien mystérieux qui nous rassemble au-delà de toutes nos différences. « L’expérience la plus profonde et la plus belle que peut faire l’homme est celle du mystère », a dit Albert Einstein » (p 293). Frédéric Lenoir poursuit sa réflexion dans une rétrospective historique. « Les grands courants de spiritualité et de sagesse du monde sont nés au sein ou en marge des religions en réaction contre leur politisation, leur ritualisation et leur formalisme excessifs » (p 297).
Aujourd’hui, comment vivre ensemble harmonieusement ? « Puisque nous partageons une même communauté de destins, il s’agit de redéfinir des valeurs universelles communes. Ces valeurs nous permettent de déterminer ce qui est essentiel dans notre vie et ce qui ne l’est pas. Elles sont l’objectif ou l’horizon vers lequel l’être humain tend pour croitre de manière harmonieuse : solidarité, fraternité, liberté, beauté, respect, justice » (p 299). En réponse, on découvre un Nicolas Hulot particulièrement sensible à la beauté : « L’un de mes premiers guides a été la beauté, car j’ai eu la chance d’en être le témoin privilégié tout au long de ma vie. Source d’humilité sur le mystère du monde, elle fait prendre conscience de la sacralité de la nature. Je suis intimement convaincu que c’est la beauté qui relie tous les êtres humains. Elle est un langage universel… La beauté de la nature nous enseigne l’harmonie, l’équilibre, la juste mesure qui font défaut dans les comportements humains. Du monde fractal à l’espace, il y a un ordre. La beauté se loge partout jusqu’au fond des abysses… La beauté est ce qui nous guide peut-être jusqu’à ce que certains appellent Dieu et nous ramène au premier matin du monde. Elle est une force d’émerveillement pour celui qui sait orienter son regard, ses sensations, ses champs émotionnels et de conscience Je dois tout mon chemin à cette rencontre avec la beauté qui m’a mené vers le respect, le juste, le vrai et le nécessaire (p 299). En communion avec Frédéric, cet éloge de la beauté se poursuit. « Il n’y a pas que la beauté des paysages, mais aussi la beauté des esprits, des gestes, des pensées, des regards, des corps, des mots. Elle se niche partout pour nous donner des joies durables… La beauté est universelle ». (p 303-304). On reconnaît là une capacité d’émerveillement et tout sur ce quoi elle débouche (6). Ces propos rejoignent ceux de Jean-Claude Guillebaud dans son livre : « Sauver la beauté du monde » (7).
La conversation se poursuit à propos d’autres valeurs fondamentales comme la solidarité, la fraternité, la liberté. Les deux intervenants évoquent les personnalités qui les inspirent dans leurs parcours : Nelson Mandela pour Nicolas Hulot et le Dalaï Lama pour Frédéric Lenoir, et en remontant dans le passé, Victor Hugo pour N. Hulot et Baruch Spinoza pour F. Lenoir, et, en fin de chapitre, on en revient à la recherche d’une vision collective : « Je me demande si ce n’est pas la catastrophe écologique doublée par des crises sanitaires, qui lui sont corrélées, qui pourrait susciter un idéal collectif. Il s’agit de redécouvrir des valeurs universelles qui permettent de vivre une meilleure harmonie ensemble et avec notre environnement : La beauté, la justice, la solidarité, la liberté tant politique qu’intérieure » (p 339-340). Et, comme l’écrit Nicolas Hulot, « Cette crise économique et sanitaire a la vertu de nous rappeler que nous vivons en équilibre sur un fil de soie et que nous faisons partie d’un miracle… N’oublions jamais que, dans le domaine du vivant, l’homme est une possibilité parmi des milliards d’autres qui a eu la chance de tomber sur la combinaison gagnante… S’il fait partie d’un tout, l’homme ne peut se substituer au tout… Nous devons être les jardiniers. Il faut les faire jaillir en chacun d’entre nous pour échapper au sable mouvant de la profusion des moyens, accéder au bonheur, et décider de la direction à prendre ensemble… Le sens doit être un opérateur de conscience permettant de faire le tri. » (p 341).
Face à la crise actuelle, nous cherchons quelles en sont les origines et comment y faire face. Nous comprenons mieux aujourd’hui comment un changement de mentalité et des représentations correspondantes a entrainé la crise actuelle. Ce livre nous aide à mieux percevoir les conséquences d’une affirmation de la toute puissance de l’homme : « L’homme, maitre et possesseur de toutes choses », selon Descartes. En regard, à travers la recherche de Frédéric Lenoir et l’expérience de Nicolas Hulot, cet ouvrage nous appelle à reconnaître que l’homme n’est pas détaché de la nature, qu’il s’inscrit dans une dimension spirituelle dans la rencontre avec le sacré et le mystère du monde. Si nous sommes tous aujourd’hui à la recherche de sens, est-ce seulement en raison d’une déviation matérialiste ? Est-ce que cela ne tient pas aussi aux manquements d’une religion occidentale trop centrée sur la destinée individuelle de l’homme ? A cet égard, la parution de l’encyclique : « Laudato Si » (8) apparaît comme un tournant révolutionnaire. Et le dernier demi-siècle a été marqué par l’apparition d’une théologie nouvelle, la théologie de Jürgen Moltmann, une théologie de l’espérance dans la perspective d’une seconde création à l’œuvre en Christ ressuscité (9). Ainsi, pour comprendre et agir, nous pouvons accéder aujourd’hui à différentes ressources. Ce livre est significatif par la qualité et la complémentarité de ses auteurs.
J H
- Nicolas Hulot Frédéric Lenoir. D’un monde à l’autre. Le temps des consciences. Propos recueillis par Julie Klotz. Fayard, 2020. Voir à ce sujet sur France Culture : « Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir, pour un monde en quête de sens » : https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement-du-mardi-08-septembre-2020
- Parcours de Frédéric Lenoir : https://www.fredericlenoir.com/bio-longue/
- Mieux comprendre l’évolution spirituelle de Frédéric Lenoir à travers une vidéo rapportant une interview conjointe de Carolina Costa, pasteure et Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue
- https://www.rts.ch/play/tv/pardonnez-moi/video/carolina-costa–frederic-lenoir?urn=urn:rts:video:8266285
- « Un chemin de Guérison pour l’humanité. La fin d’un monde. L’aube d’une renaisssance » : https://vivreetesperer.com/un-chemin-de-guerison-pour-lhumanite-la-fin-dun-monde-laube-dune-renaissance/
- Voir : Hans Jonas. Les pouvoirs du sacré. Une alternative au récit du désenchantement. Seuil, 2020
- Autour du livre de Bertrand Vergely : Retour à l’émerveillement : « Avant toutes choses, la vie est bonne » : https://vivreetesperer.com/avant-toute-chose-la-vie-est-bonne/
- « Sauver la beauté du monde » : https://vivreetesperer.com/sauver-la-beaute-du-monde/
- Autour de Laudato Si : « Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François et Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
- Un blog dédié à l’œuvre de Jürgen Moltmann : https://lire-moltmann.com Voir aussi : « Une vision d’espérance dans un monde en danger » : https://www.temoins.com/une-vision-desperance-dans-un-monde-en-danger/
Une voix différente
Pour une société du care
Un regard nouveau
Nous voici déstabilisés par le pandémie. Nous savons la part de souffrance qu’elle a suscité et suscite encore. Nous entendons l’expression de cette souffrance, l’expression de la peur. C’est alors que nous prenons conscience du rôle salvateur de tous ceux qui ont fait ou font face à cette épidémie et en particulier les soignants dans toute leur diversité. Bref, il y a des mots qui portent aujourd’hui : soin et sollicitude. C’est le moment où une pratique nouvelle et le concept qui l’accompagne : le « care », le prendre soin peuvent apparaître au grand jour après un parcours marqué par des obstacles de mentalité.
Désormais, le « Care » n’est plus seulement la prise de conscience ouverte par le livre de Carol Gilligan : « In a different voice », « Une voix différente » (1) qui met en évidence une approche relationnelle de la morale majoritaire en milieu féminin, méconnue jusque là, et dans le même mouvement, une approche de sollicitude envers tous les êtres vulnérables. A partir de là, va naitre une « éthique du care » exposée notamment par Fabienne Brugère (2). Ouverte à l’actualité, celle-ci a donc pu écrire récemment dans la revue « Etudes », un article : « Pour une société du care » (3) : « La pandémie fait valoir un fait anthropologique majeur oublié, au moins dans les pays les plus riches : nous sommes vulnérables… les vies viables sont des vies pourtant vulnérables. Chaque vie déploie un monde qu’il s’agit de maintenir, de développer et de réparer. L’individu est relationnel et non pas isolé » (p 63). En regard, construire éthiquement et politiquement le « prendre soin » demande une volonté. Le soin est une construction éthique, politique et sociale » (p 67). Ainsi la prise de conscience ouverte par Carol Gilligan, la mise en évidence d’une autre manière de penser et d’agir, débouche sur un mouvement social et la vision d’une autre société. C’est un regard nouveau. Comme tous les regards nouveaux, il induit un changement de mentalité et, par la suite, un changement des pratiques sociales. On peut revisiter l’histoire dans ce sens en évoquant les regards nouveaux qui ont changé l’état du monde. Et aujourd’hui encore, face aux tourments que nous rencontrons, de nouvelles visions sont porteuses d’espérance. Le « care » compte parmi ces visions. Reconnaître « une voix différente » requiert écoute et respect. C’est une ouverture spirituelle. C’est geste démocratique.
« Une voix différente »
C’est bien l’écoute qui a permis à Carol Gilligan de découvrir une réalité méconnue : « Voici dix ans que je suis à l’écoute des gens. Je les écoute parler de la morale et d’eux-mêmes. Il y cinq ans, j’ai commencé à percevoir des différences entre toutes les voix, à discerner deux façons de parler de morale et de décrire les rapports entre l’autre et soi… » (1) (p 7). A partir de cette écoute, au travers de ses enquêtes, Carol Gilligan découvre que les voix des femmes ne correspondent pas aux descriptions psychologiques de l’identité du développement qu’elle même avait lues et enseignées pendant des années. « A partir de cet instant, les difficultés récurrentes soulevées par l’interprétation du développement féminin attirèrent mon attention. Je commençais à établir un rapport entre ces problèmes et l’exclusion systématique des femmes des travaux permettant de construire les théories cruciales de la recherche en psychologie. Ce livre décrit les différentes manières de concevoir les relations avec autrui et leurs liens avec la tonalité des voix masculines et féminines… On peut envisager une hypothèse : Les difficultés qu’éprouvent les femmes à se conformer aux modèles établis de développement humain indique peut-être qu’il existe un problème de représentation, une conception incomplète de la condition humaine, un oubli de certaines vérités concernant la vie » (1) (p 7-8).
Carol Gilligan ne débouche pas sur une catégorisation absolue. « la voix différente que je décris, n’est pas caractérisée par son genre, mais par son thème. Les voix masculines et les voix féminines ont été mises en contraste ici afin de souligner les distinctions qui existent entre deux modes de pensée et d’élucider un problème d’interprétation. Je ne cherche pas à établir une généralisation quelconque sur l’un ou l’autre sexe ». Ce qui m’intéresse, c’est l’influence réciproque de l’expérience et de la pensée, les différences entre les voix et le dialogue qu’elles engendrent, la manière dont nous nous écoutons et dont nous écoutons autrui et ce que nous racontons sur nos propres vies » (1) (p 1-4).
La traduction française du livre de Carol Gilligan est précédée par des présentations de chercheurs français qui en montrent toute la portée. Ainsi, dans un entretien préliminaire, Fabienne Bruguère nous en montre l’originalité. Carol Gilligan interpelle la théorie dominante du développement humain et les catégories d’interprétation morale de Kohlberg : « La morale a un genre : une morale masculine qui se veut rationnelle, imprégnée de lois et de principes étouffe une morale relationnelle nourrie par le contexte social et l’attachement aux autres » (p III). Mais, bien plus encore, elle promeut une nouvelle éthique « qui est un résultat de la clinique, un équilibre nouveau entre souci de soi et souci des autres. L’éthique est alors une manière de se constituer un point de vue » (p II). Et, dans le même mouvement, sans figer des oppositions, elle exprime un nouveau féminisme : « Gilligan ne préconise pas un féminisme de la guerre des femmes contre les hommes, mais de la relation, laquelle est aussi la relation entre sphère publique et sphère privée, raison et affects, éthique et politique, amour de soi et amour des autres. Ce sera le féminisme du XXIè siècle. L’émancipation des femmes ne se fera pas sans celle des hommes, sans l’égalité des voix, sans la démocratie comme modèle de vie désirable ou encore sans une reconnaissance de l’importance du « care » (p VI).
Une éthique du care
Dans l’inspiration de Carol Gilligan, Fabienne Brugère publie un livre : « L’éthique du care ». La « voix différente » de Carol Gilligan, nous dit-elle, « inaugure un problème, à la fois philosophique, psychologique, sociologique et politique, celui du « care »… Il existe une « caring attitude », une façon de renouveler le problème du lien social par l’attention aux autres, le « prendre soin », le « soin mutuel », la sollicitude et le souci des autres. Ces comportements adossés à des politiques, à des collectifs ou à des institutions s’inscrivent dans une nouvelle anthropologie qui combine la vulnérabilité et la relationalité, cette dernière devant être comprise avec son double versant de la dépendance et de l’interdépendance » (2) (p 3).
Ce mouvement est accompagné par l’apparition et le développement d’une éthique nouvelle. « L’éthique du care surgit comme la découverte d’une nouvelle morale dont il faut reconnaître la voix dans le monde qui ne dispose pas du langage adéquat pour exprimer et faire reconnaître tout ce qui relève du travail de « prendre soin » (2) (p 7).
L’éthique du care s’affirme en opposition à une démarche individualiste. « Les tâches du care sont un sérieux antidote à une psychologie qui ne prend en compte que l’intérêt personnel des individus à agir ou à la construction du moi autonome refermé sur lui-même. La théorie du care est d’abord élaboré comme une éthique relationnelle structurée par l’attention aux autres (2) (p7). L’éthique du care s’affirme dans le concret de la vie et non à travers des principes moraux abstraits. Alors que pour Kohlberg, il existe une morale supérieur ancrée dans le raisonnement logique généralement produit par les hommes, Gilligan affirme que les femmes construisent le problème moral différemment en centrant le développement moral sur la compréhension des responsabilités partagées et des rapports humains (2) (p 19). Plus que simplement une morale différente, l’approche du care induit une éthique. « Utiliser l’arsenal théorique du care revient à mettre entre parenthèses le raisonnement moral au profit de ce qui particularise les conduites au nom des besoins des autres et de la force sociale des situations » (2) (p 32). « Alors que la morale est « prescriptive, corrective et autoritaire », l’éthique est « du coté de l’enquête empirique qui propose une détermination des normes à partir des situations vécues » (2) (p 35). Carol Gilligan décrit les cheminements de la pensée qui induisent des décisions. « Il s’agit de cheminer vers une décision qui se révèle possible à même le contexte de toutes les interdépendances en jeu… la résolution a à faire avec une humanité vulnérable, avec des situations de grande fragilité à certains moments de la vie où il faut prendre des décisions… L’éthique est associée au souci, souci de soi et souci des autres… » (2) (p 38).
Pour une société du care
La pandémie du Covid 19 a suscité une prise de conscience de notre vulnérabilité individuelle et collective. Elle a suscité un besoin d’aide et de soin. Dès lors, le care peut accéder à la conscience sociale. C’est bien le moment d’évoquer une société s’inspirant de l’éthique du care. C’est le thème d’un article de Fabienne Brugère dans la revue : Etudes (3). « Ce qui semble fonctionner dans cette crise sanitaire relève d’une logique d’entraide très proche de ce que préconise Joan Tronto dans : « Caring democracy » où l’accent est porté sur un élément essentiel des politiques de soin : « l’être avec », c’est à dire les relations de solidarité et de mise en commun (3) (p 66). Cependant, au delà de la conjoncture, c’est une nouvelle vision de la société et de sa gouvernance qui apparaît. « Le présupposé individualiste conçoit les être humains à travers une injonction à l’autonomie comme si les êtres humains étaient à tout moment de leur vie maîtres et possesseurs d’eux-mêmes. Insister sur l’interdépendance généralisée des vies revient à promouvoir une autre conception du vivre ensemble à travers la primauté d’un lien démocratique soucieux de ne pas exclure celles et ceux qui sont confrontés à des situations de vulnérabilité » (2) (p 84). Dans le contexte actuel, nous comprenons mieux les enjeux. « L’éthique du care nous met en garde contre les dérives conjointement marchandes et bureaucratique de nos sociétés. En reconnaissant collectivement la nécessité de mettre en œuvre plus de justice sociale, elle vaut comme une alternative à un néolibéralisme mondialisé et homogène qui laisse de plus en plus de monde sur la route… Déployer une éthique du care, c’est rappeler qu’un projet de société ne saurait se rapporter qu’à celles et ceux qui rêvent de performance individuelle, d’argent et de pouvoir. Il doit également faire face avec des destins individuels différents qui expriment le désir d’autres formes de réussite de la vie. Il a à rendre possible le soutien des individus au nom d’un bien-être à la fois collectif et individuel… L’éthique du care mène à une politique du care… » (2) (p 123-124).
Le mouvement du care s’inscrit dans les transformations actuelle des mentalités et l’apparition conjuguée d’idées nouvelles. Le livre de Fabienne Brugère relève la complexité de cette situation dans laquelle nous ne sommes pas entré ici. En faisant apparaître et reconnaitre la diversité des points de vue, Carol Gilligan inaugure un féminisme nouveau qui porte un mouvement social, le mouvement du care. Il est bon de rappeler ici combien le féminisme peut engendrer des prises de conscience par rapport aux pratiques d’un monde encore patriarcal. A l’époque, la même exigence apparaît dans la théologie féministe. On en trouve un aspect dans le dialogue entre Elisabeth Moltmann–Wendel et son mari, tous deux théologiens, en 1981, dans une rencontre organisée par le Conseil mondial des Eglises (4) : « Nous voulons une vie pleine qui joigne le corps, l’âme et l’esprit, une vie qui ne soit plus divisée entre la sphère publique et la sphère privée et qui nous remplisse de confiance et d’espoir par delà la mort biologique », interpelle Elisabeth.
Nous voyons bien aujourd’hui les tempêtes et qui agitent le monde et les menaces qui nous environnent. Mais il apparait aussi des mouvements porteurs d’espoir qu’il faut reconnaître et soutenir comme le care, la communication non violente et le mouvement écologique . Essayons de prendre du recul. Dans son livre : « Darwin, Bonaparte et le samaritain » (5), Michel Serres perçoit une inflexion dans le cours de l’histoire, au sortir de massacres séculaires, un âge plus doux. A l’encontre de la violence meurtrière, la figure du samaritain est emblématique de la compassion et du soin. Ne peut-on pas envisager le mouvement du care comme une étape dans ce parcours ? Dans une rétrospective de long cours, on doit rappeler combien l’inspiration de l’Evangile a été anticipatrice 6). Qu’on se rappelle non seulement la parabole du bon samaritain, l’épisode évangélique du lavement de pieds, la répudiation des puissants. « Ceux que l’on regarde comme chefs des nations, les commandent en maitre. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi… » (Marc 10. 42-44). Dans tout cela, ce qui est en cause au cours de l’histoire, n’est-ce pas la volonté de puissances et ses conséquences ? En regard, on perçoit tout l’apport du « care ».
J H
- Carol Gilligan. Une voix différente. La morale a-t-elle un sexe ? présentation de Sandra Laugier et Patricia Paperman. Précédé d’un entretien avec Fabienne Brugère. Champs essais, 2019
- Fabienne Brugère. L’éthique du care 3è éd Presses universitaires de France, 2020 (Que sais-je ?). L’éthique du care présentée par Fabienne Bruguère sur Youtube (2016) : https://www.youtube.com/watch?v=hBBSb-ujdXI
- Fabienne Bruguère. Pour une société du care. Etudes, juillet-aout 2020, p 61-72
- Une philosophie de l’histoire par Michel Serres : https://vivreetesperer.com/une-philosophie-de-lhistoire-par-michel-serres/
- Hommes et femmes en coresponsabilité dans l’Eglise. Dialogue théologique entre Elisabeth Moltmann-Wendel et Jürgen Moltmann : https://www.temoins.com/femmes-et-hommes-en-coresponsabilite-dans-leglise/
- Comment l’Esprit de l’Evangile a imprégné les mentalités et, quoiqu’on dise, reste actif aujourd’hui (Tom Holland) : https://vivreetesperer.com/comment-lesprit-de-levangile-a-impregne-les-mentalites-occidentales-et-quoiquon-dise-reste-actif-aujourdhui/
Réinventer les aurores (1)
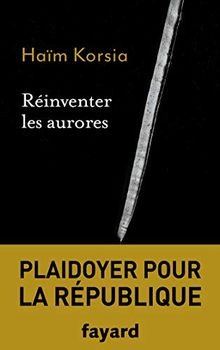 Selon Haïm Korsia
Selon Haïm Korsia
« C’est par la faille que jaillit la lumière ». Cette phrase fut prononcée par, Haïm Korsia, grand rabbin de France, au cours d’une émission de grande écoute, qui énumérait les innombrables épreuves que la France traverse en cette période de pandémie. L’incurie de nos gouvernants était fortement évoquée.
Sa parole lumineuse et forte fait écho à toute une tradition judéo-chrétienne qui porte en elle cette certitude multiséculaire : la crise que nous traversons révèle notre faiblesse mais c’est peut-être là que se trouve la source d’une eau vive et d’une croissance intérieure inattendue. Pour Albert Camus aussi, la souffrance est un trou et la lumière vient de ce trou.
C’est aussi ce que dit, en chantant, le grand Leonard Cohen : « There is a crack in everything. That’s how the light gets in » De même, c’est ce qu’exprime Pierre Soulages avec l’outrenoir, ses grands tableaux couverts d’aplats de noirs qui jouent avec la lumière. À 100 ans, il offre la couverture de ce livre à son ami Haïm.
Il suffit parfois d’un angle de vue pour changer de monde et le monde. C’est à cela que nous invite Haïm Korsia. Il s’agit, nous dit-il, de reconstituer, maille après maille, le tissu de la société menacée par tout ce qui la délite, de la peur à la haine. Il nous invite à faire appel aux forces de l’imaginaire alliées à celles de la raison pour réinventer une société plus juste, réinventer les aurores. Il y a là, comme un manifeste contre l’indifférence, un plaidoyer pour la fraternité. En des termes simples et forts, il nous aide à penser une politique de la jubilation et du bonheur retrouvé.
Son projet politique pour aujourd’hui, est bien celui du retour à l’espérance. Nous y avons notre place : l’État ne peut pas tout. Il ne peut que ce que les citoyens sont prêts à faire. Le rêve d’une société heureuse implique des efforts collectifs et individuels.
Réinventer les aurores de la République. C’est bien de cela qu’il s’agit dans cet ouvrage qu’on a plaisir à lire. La langue est belle, simple et lumineuse. Ses propos reposent sur une connaissance fine, précise et lucide de la France d’aujourd’hui, celle qui souffre de la pandémie et du confinement, celle des Gilets jaunes et autres événements qui marquent notre quotidien aujourd’hui. Car, on se doit de « penser ce moment pour ce qu’il dit. Il y a là, un immense questionnement sur notre société, sur notre modèle, sur notre rapport à l’étranger, au pauvre, au réfugié, sur la violence des impératifs de performance et de rentabilité qui s’exercent sur nous et sur les autres au quotidien, sur le sens de notre existence. »
Si l’on refuse la passivité, au cœur de la nuit, il y a une espérance, une ouverture. C’est alors que des personnes différentes, d’horizons et de cultures différents, se sentent invitées à participer à une intelligence collective, enrichie de toutes ses pépites uniques et ainsi de refaire société. Il s’agit, en effet, d’échanger pour retrouver notre capacité à inventer de nouveaux possibles.
Son idée de la République est éclairée par son judaïsme profondément ouvert aux autres formes de spiritualité et de cultures. « Ce n’est pas le livre d’un Juif pour les Juifs, dit-il, mais la réflexion que peut offrir un homme porteur de la part juive de la France, s’adressant à l’ensemble de ses concitoyens. » Il nous donne, ainsi, sa vision de textes fondamentaux qui ouvrent sur une espérance active pour aujourd’hui. Grâce à lui, l’Exode, les Hébreux dans le désert, Moïse, prennent vie et nous éclairent.
Le rêve est au cœur du judaïsme, nous dit-il. Juif ou non juif, nous nous retrouvons tous à écouter sa parole, parce qu’elle repose sur un regard lucide, exigeant sur notre actualité. Son espérance nous incite à partir à sa suite, pour retrouver notre capacité à inventer de nouveaux possibles, notre rêve commun, un socle et un idéal, grâce auxquels, chacun accepte de rogner un tout petit peu sur ses propres privilèges – les farouches critiques de l’État diraient sur les libertés – au profit du bien commun.
L’erreur souvent est de ne voir que notre passé. « Il y a là, comme un vieillissement de l’âme, un manque de confiance d’une société dans son avenir. Ouvrons-nous aux nouvelles idées, aux nouveaux possibles. Car, il s’agit bien de trouver le souffle des premiers matins de la République. L’essentiel se joue dans la définition de notre désir commun de faire société. »
Le seul combat qui vaille est celui qui vise à un monde plus juste, plus ouvert sur l’altérité, en faisant appel aux forces de l’imaginaire alliées à celles de la raison pour réinventer une telle société. Il faut pour cela, « rassembler les étincelles de lumière de tous les peuples. » Il s’agit de permettre à des personnes différentes, d’horizons et de cultures différents de participer. Il est vital de multiplier les opinions, d’encourager une pensée divergente qui tourne le dos au nivellement par le bas de l’opinion publique.
Il faut oser imaginer un autre monde que celui qui nous est imposé. Le véritable enjeu de notre présent, c’est la réappropriation, par chacun, de son pouvoir. « Tout ce qui descend du haut vers le bas, sans consentement ni participation, sans explication ni tendresse, apparaît inacceptable. » Haïm Korsia encourage alors des pensées divergentes, militantes, comme celles de ce merveilleux film documentaire « Demain » de Cyril Dion et Mélanie qui présente de nombreuses initiatives dans le monde, répondant aux grandes questions sociales et écologiques du moment. « C’est local dans sa mondialité, optimiste, vivant, jouissif, parce que porteur d’espoir et de bonheur. »
Geneviève Patte
- Haïm Korsia. Réinventer les aurores. Fayard, 2020
Voir aussi :
« Le film demain » : https://vivreetesperer.com/le-film-demain/
« Pour des oasis de fraternité : https://vivreetesperer.com/pour-des-oasis-de-fraternite/
« Appel à la fraternité » :
https://vivreetesperer.com/appel-a-la-fraternite/
« Penser à l’avenir, selon Jean Viard »
https://vivreetesperer.com/penser-a-lavenir-selon-jean-viard/
Récits de vie et gouvernance participative
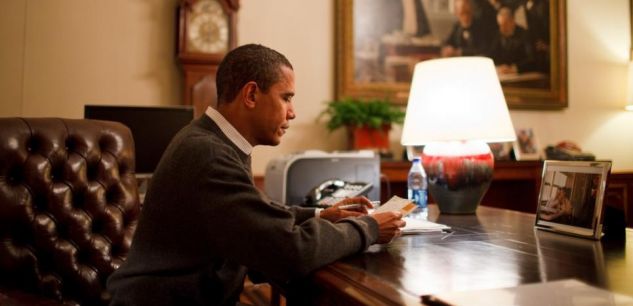 A travers un service du courrier, Obama, président, dialogue avec les citoyens américains.
A travers un service du courrier, Obama, président, dialogue avec les citoyens américains.
pour répondre aux besoins, encore faut-il écouter leur expression. Cette écoute est nécessaire pour identifier les besoins dans toute la complexité humaine dans laquelle elle se manifeste. C’est bien là la tache essentielle des élus et évidemment du premier d’entre eux, le président. Certes, il y a différentes manières d’identifier et d’analyser les besoins, par exemple une enquête, une expression des média, mais rien ne remplace une écoute directe des gens. Et plus généralement, la participation appelle le dialogue. Cette expression des citoyens peut prendre différentes formes. Un livre récent (1) vient aujourd’hui nous présenter une expérience : le service du courrier qui recevait des milliers de lettres adressées au président Obama par des citoyens américains.
Le service du courrier
Tout au long de l’histoire américaine, il y a toujours eu des citoyens qui ont écrit au président . Mais cette correspondance s’est considérablement amplifiée au cours du temps. Et le service a pris un importance majeure avec l’arrivée d’Obama à la présidence . Ce développement s’inscrit dans la vague militante qui a porté et accompagné l’élection. Ainsi, la participation à cette entreprise témoigne d’une forte mobilisation, d’un engagement comme celui de Fiona devenue responsable de ce service.
« Au total, le service de la correspondance présidentielle ou OPC comme tout le monde l’appelait, requérait l’action coordonnée de 50 employés, de 36 stagiaires et d’une armée de 300 volontaires se relayant pour faire face à la dizaine de millier de lettres et de messages quotidiens. Il appartenait à Fiona en tant que directrice de l’opération de faire tourner la boutique » (p 86). Ces lettres parlent des réalités de la vie qui interpellent le président. Ces messages sont lus attentivement et cotés selon le sujet choisi en vue d’y apporter une réponse. Cependant la grande affaire, c’est de choisir chaque jour dix lettres auxquelles le président répondra.
Si la création du service a été précédée par une lente évolution, si elle est advenue dans un grand moment politique, elle est d’abord la résultante d’une volonté personnelle, celle du président Barack Obama. Le service a été organisé par des hommes qui l’ont accompagné dans sa démarche politique. Et sa décision de lire chaque jour dix lettres et d’y répondre, a été emblématique.
Barack Obama
Barack Obama a surgi dans l’histoire américaine comme la réponse à une espérance que puissent hommes et femmes être respectés dans leur originalité personnelle et leur existence sociale et politique. Dans son accession à la présidence, Barack Obama a apporté une réponse : « Yes, we can ». Oui , nous pouvons. Son élection nous est apparue comme un tournant dans l’histoire des Etats-Unis (2), une ouverture pour le monde. Aussi, à plusieurs reprises, avons-nous évoqué, sur ce blog, les activités et les expressions de ce président (3). L’attention qu’Obama a porté au courrier lors de sa présidence est une manifestation de son empathie et de son engagement au service de l’humain. C’est une faculté d’écoute permettant une meilleure identification des besoins et, donc, une capacité d’y répondre. Ainsi, nous dit-il, « Ce serait un exercice intéressant d’identifier le nombre d’initiatives… dont la plupart étaient de portée limitée…. qui aboutirent à une modification ou qui provoquèrent au moins une discussion sur la manière dont nous fonctionnons. Un nombre non négligeable , je pense » (p 196). Certaines lettres ont suscité des réactions visibles. « Je me rappelle une rencontre. Une merveilleuse famille. Un père et une mère relativement jeunes avec deux enfants, et, au moment où je suis arrivé, la mère a fondu en larmes. Elle m’a serré dans ses bras et dit : « Si on est ici, c’est grâce à vous ». J’ai répondu : « Comment ça ? ». « Mon mari ici présent a servi dans l’armée et souffrait d’un syndrome post-traumatique assez grave et je craignais qu’il n’en sorte pas, mais vous avez demandé à l’administration des vétérans de nous appeler directement et c’est ce qui l’a conduit à se faire soigner ». C’est le genre d’occasions qui nous rappelle que cette fonction a quelque chose de spécial » (p 196). « Quand les gens reçoivent une réponse, ils ont le sentiment que leurs vies et leurs préoccupations ont de l’importance. Et ça, ça peut changer dans une faible mesure, et parfois plus largement, le regard qu’ils portent sur la vie » (p 196). Parce qu’Obama portent un profond respect aux gens, les gens le ressentent, et lui expriment une considération qui va jusqu’à lui faire part de leur évolution personnelle. « Parfois les gens me font part d’une forme de transformation qu’ils ont vécu. Il y a plusieurs lettres de personnes me confiant avoir grandi dans des familles se méfiant des personnes d’une origine différente, d’un autre milieu. Les lettres me relatent l’évolution que leurs auteurs ou leurs proches ont connue après avoir constaté que l’image d’eux qu’on leur renvoyait n’était pas celle qu’ils imaginaient » (p197).
Parce qu’Obama respecte profondément les gens et que ceux-ci peuvent lui manifester du respect en retour, il peut se créer une forme de communauté en retour. Ainsi écrit Obama : « Les lettres qui me tiennent à cœur sont, je crois, celles qui opèrent des liens, qui parlent de la vie des gens, de leurs valeurs, de ce qui leur importe » (p 197). Cette attention témoigne d’une confiance et d’une bienveillance dont fait preuve le président : « Ces lettres disent que les gens sont pleins de bonté et de sagesse. Il suffit d’y faire attention. Ce qui est parfois difficile de faire quand on est à l’intérieur d’une bulle, mais cette petite porte me l’aura rappelé chaque jour » (p 207).
Les lettres : une expression de la vie américaine dans toute sa diversité
Ce livre publie ainsi un grand nombre de lettres par périodes chronologiques. Si elles comportent telle interprétation ou telle louange, elles s’appuient généralement sur une expression de la vie de ceux qui écrivent. C’est un recueil de récits de vie qui témoignent de la diversité des situations. Certes, il y a des inflexions dans les contenus. Lorsque Obama accède à la présidence, il doit faire face à une grave récession. Il y a du chômage. Beaucoup de gens souffrent dans leurs conditions de vie. Et comme le redressement ne peut être immédiat, on entend une plainte et parfois une déception.
Cependant, il y a aussi ds demandes plus classiques. « Il y a des lettres récurrents comme celles des anciens combattants demandant de l’aide, celles des jeunes accablés par des dettes récurrentes essayant de savoir s’ils sont éligibles à une aide ou une autre, des militaires ou des familles de militaires aux prises avec une décision du département de la défense… » (p 195). « La loi sur la protection de patients et des soins abordables » surnommée « Obamacare », a suscité un courrier abondant. Des vies ont été sauvées.
Bien souvent, ces lettres témoignent d’une expérience de vie originale. Elles expriment des prises de conscience auxquelles le président est associé parce qu’elles soutiennent des causes qu’il soutient ou des pistes qu’il ouvre . Ces lettres couvrent un champ très vaste. Des valeurs s’y expriment, le meilleur de l’idéal américain tel que Barack Obama en témoigne. En voici quelques exemples.
Des récits de vie
Ces lettres en grand nombre portent toutes un message. Et, pour chacune d’elle, l’auteure nous permet de la situer dans son contexte et de percevoir le dialogue qui s’établit entre les personnes et le président. Ce livre nous apporte un ensemble de récits de vie qui nous rapportent les problèmes, économiques, sociaux er culturels vécus par des américains et les idéaux qui les animent.
Marnie Hazelton
Marnie Hazelton, mère célibataire, quinquagénaire, a derrière elle une tradition familiale qui l’engage dans « une vie de service », des parents et des grands-parents afro-américains, « Elle était la dernière représentante d’une histoire marquée par le courage et la lutte » (p 165). Puis, elle devient enseignante dans des écoles défavorisées à New-York. C’est un idéal qui la pousse. En 2011, elle écoute attentivement le dernier discours d’Obama sur l’état de l’Union : « Ce qui aura le plus d’impact sur la réussite d’un enfant, c’est l’homme ou la femme qui se tient devant lui dans la salle de classe. A l’attention de tous les jeunes gens qui écoutent ce soir et qui hésitent pour leur carrière professionnelle, si vous voulez influer sur la vie d’un enfant, devenez enseignant. Votre pays a besoin de vous » (p 164). « Une bâtisseuse de nation, une patriote, voilà ce qu’elle était » (p 164). Hélas la récession avait frappé les Etats-Unis et il fallait du temps pour que la politique d’Obama porte tous ses fruits. A l’échelon local, il y a encore des coupes budgétaires. Elle perd son emploi et entre alors dans une période difficile .
C’est alors qu’elle décide d’écrire au Président Obama.
« Cher monsieur le Président
Mes parents représentent le meilleur de l’Amérique .
Mon père a servi. Ma mère a répondu à l’appel de John F Kennedy à servir ». Plusieurs des mes aïeux ont combattu pour les Etats-Unis. « J’ai marché dans les pas de ma mère et suis devenu enseignante. « Une bâtisseuse de nation ».
Monsieur le Président, vous devez recevoir des milliers de lettres narrant les malheurs des chômeurs et il n’y a pas grand chose que vous puissiez faire à l’échelle individuelle. J’ai perdu mon emploi parce que les fonds de relance attribués aux écoles sont épuisés.
J’aimerais que vous me disiez ce que je dois faire maintenant pour subvenir aux besoins de ma famille alors que le marché de l’emploi dans l’éducation est inondé de milliers d’enseignants licenciés à cause des coupes budgétaires et que j’ai consacré les onze dernières années de ma vie à bâtir la nation et à éduquer les enfants de l’Amérique » (p 167). Elle fut très surprise de recevoir une réponse personnelle du président : « Merci de votre dévouement à l’éducation. Je sais que la situation actuelle peut paraître décourageante, mais la demande pour des enseignantes et des personnes avec vos compétences grandira au fur et à mesure que la conjoncture et le financement des états rebondiront. En attendant, je suis de tout cœur avec vous » (p 170).
Cette phrase : « je suis de tout cœur avec vous » alla droit au coeur de Marnie. La lettre du président lui redonna courage et l’accompagna dans les épisodes qui ont suivi jusqu’à la présenter dans un jeu télévisé. Treize mois après avoir été congédiée, elle reçut la demande d’un district scolaire dans lequel elle avait déjà travaillé. « Revigorée, réinventée, quand elle revint dans la salle de classe, elle montra à ses élèves le mot du président Obama. C’était une occasion de leur apprendre quelque chose. Elle dit aux enfants : « Je suis de tout coeur avec vous ». Et elle l’a répété à tout le monde autour d’elle. Finalement, elle devint directrice du district qui l’avait autrefois mise à pied.
Marjorie McKinney
Marié à un géologue de l’Université de Caroline du Nord, Marjorie avait aidé son mari pendant toute sa carrière. Cette association avait toujours reposé sur un consentement mutuel.
« Ce jour, elle s’était rendu à Albany pour collecter des images de fossile à la demande de Ken ». Pour regagner sa voiture, elle commença à s’engager dans une immense place devant le musée. « Il y avait une personne au loin qui se dirigea vers elle. Il avait l’air jeune. Il était noir. Il portait un sweat à capuche . D’un geste brusque, il rabattit la capuche masquant son visage ». Marjorie eut très peur avec une immense envie de fuir » . En arrivant en même temps à la cage d’escalier, il la regarda. « Désagréable le vent, hein ! » dit-il, avant d’ajouter qu’il y avait un passage souterrain pour piétons qui reliait le musée au parking au cas où elle ne le saurait pas. La prochaine fois qu’il ferait froid, elle gagnerait peut-être à le prendre, suggéra-t-il. C’était tout. Il était parti. Un truc qui pouvait sembler anodin. Un truc banal ». Mais pour Marjorie, cela marqua une rupture dans sa représentation d’elle-même. « Pourquoi avais-je eu peur de ce charmant jeune homme ? ». Tout simplement parce qu’il était noir . Je n’avais aucune raison d’avoir peur de lui. J’étais atterrée. Ce n’était pas quelque chose que j’aurais cru ressentir un jour. Ce fut un tournant dans ma vie parce que je me suis rendu compte que j’étais raciste. Et il fallait que je trouve le moyen de m’en débarrasser » (p 209).
Une bonne partie du problème pour Marjorie, c’est qu’elle pensait s’en être débarrassée (p 210). Et elle avait déjà parcouru un chemin en ce sens. En effet, elle avait vécu son enfance dans le sud profond, Birmingham à une époque où le monde était divisé en deux : blanc ou noir. Cela paraissait naturel. Elle prit conscience de l’injustice en rencontrant à l’université un ami, un étudiant allemand beaucoup plus âgé qu’elle. Elle venait d’une ville où régnait une ségrégation très dure. Son ami allemand lui expliqua le racisme, l’intolérance, la haine, lui parla de son pays, de sa vie, des jeunesses hitlériennes… « Elle le remercia pour tout ce qu’il lui avait expliqué à la cantine ce jour-là et pour avoir donné une nouvelle orientation à sa vie. « Tu en avais besoin » lui dit-il » (p 218). Dès lors, « Marjorie s’engagea dans le mouvement des droits civiques. Toute sa vie, elle chercha à voir au delà de la race. Et, parmi ses enfants adoptés, deux d’entre eux étaient métis (p 212). « Imaginez un peu. Avec tout ce bagage, tout ce chemin parcouru avec Ken et les enfants. Et puis, elle est à Albany. Il fait froid. Et elle a découvert ce puits de laideur installé en en elle, tel un vers qui s’éveille à la vie ». à la suite d’un fait divers mettant en évidence la persistance des sentiments racistes et d’un discours très digne d’Obama à ce sujet. Elle décida de lui écrire. Elle lui raconta son parcours et l’incident qu’elle avait vécu.
Monsieur le Président. J’espère que d’autres personnes qui auront entendu vos paroles auront davantage conscience de la peur qui se tapit chez beaucoup d’entre nous. Elle est irrationnelle, mais elle est là. J’espère que j’aurais oublié cette course à Albany et le jeune homme rencontré par cette froide journée. Vos franches paroles de la semaine dernière comptent beaucoup pour moi. Merci » (p 215).
La réponse d’Obama vint en ces termes : « Merci pour cette lettre murement réfléchie. Votre histoire illustre ce qui me rend optimiste pour le pays ».
Yolanda
Aider les gens en détresse à revenir dans une vie vivable et sociable, tel peut être un objectif bienfaisant de l’action politique. Et il peut en résulter une expression de gratitude. Yolanda fait partie de ceux qui ont lutté pour vivre et savent reconnaître l’aide qu’ils ont reçue .
Yolanda « avait déjà écrit il y a quelques années pour parler au président de sa situation d’ancienne combattante handicapée du fait qu’elle vivait dans sa voiture et qu’elle faisait constamment des cauchemars liés aux traumatismes sexuels subis pendant qu’elle était dans la marine. « Monsieur le président, vous et votre cabinet avez fait une déclaration nationale pour que les états travaillent à mettre fin au problème des sans-abris. Je vous avais fait part de ma prière silencieuse de vouloir devenir un membre productif de notre société, d’être capable de vivre, d’y payer un loyer, bref d’y prendre part » (p 236). Or ce désir a été exaucé. « C’est avec des larmes de reconnaissance que je peux vous dire que j’ai signé aujourd’hui un bail au Veteran’s village pour deux pièces….Aujourd’hui j’ai pleuré des larmes de joie. J’étais si fière de pouvoir leur donner le mandat postal pour le loyer… Tout ça, c’est grâce à vous et à votre administration. Je ne suis pas un numéro. Je ne suis pas une saleté sur laquelle des gens crachent. Je ne suis pas oubliée…. J’ai maintenant un endroit où vivre, un chez moi. Je vais me montrer à la hauteur de ce don gracieux qui m’a été fait. Merci ! » (p 236). Une expression de dignité dans la gratitude et la confiance.
« Barack Obama et les citoyens américains en toutes lettres » (1), ce livre de Jeanne Marie Laskas, nous permet de partager à travers la publication de cette vaste correspondance, des centaines de lettres, une expression constructive et encourageante.
Si Obama rencontre des oppositions, il est en général respecté. Ces lettres manifestent un grand respect . Ainsi s’établit une confiance réciproque . Courage, dignité et confiance se manifestent dans ces récits de vie. Cette lecture n’est pas seulement agréable. Elle communique la bienveillance qui s’y exprime.
J H
- Jeanne Marie Laskas. Monsieur le Président. Barack Obama er les citoyens américains en toutes lettres. Trad. Tilman Chazal. Fayard, 2020
- Le phénomène Obama. Un signe des temps : https://www.temoins.com/jean-hassenforder-le-phenomene-obama-un-signe-des-temps/
- Notre responsabilité pour le monde : https://vivreetesperer.com/notre-responsabilite-pour-le-monde/ De Martin Luther King à Barack Obama : https://vivreetesperer.com/de-martin-luther-king-a-obama/ La rencontre entre Barack Obama et le pape François : https://vivreetesperer.com/la-rencontre-entre-le-president-obama-et-le-pape-francois/ La prière dans la vie de Barack Obama : https://vivreetesperer.com/la-priere-dans-la-vie-de-barack-obama/
De l’esclavage à la lumière
Du Bénin à la région parisienne, une histoire de vie
 Philo a vécu enfant au Bénin jusqu’à l’âge de onze ans. Elle vivait avec ses parents, avec ses frères et sœurs. « Nous étions une famille très chrétienne, une famille très unie. Un papa maçon. Une maman très commerçante. Nous habitions à Porto Nove au Bénin. Je suis allée à l’école là bas. J’étais une élève très assidue. J’aimais l’école. J’aimais être avec mes ami(e)s à l’école. Après l’école, je jouais avec mes frères et sœurs. J’ai appris tôt à cuisiner et on lavait le linge à la main (Il n’y avait pas de machine à laver !). Pour les devoirs de l’école, je les faisais ensemble avec mes frères et sœurs. Je lisais aussi des livres, par exemple « Finagnon ».
Philo a vécu enfant au Bénin jusqu’à l’âge de onze ans. Elle vivait avec ses parents, avec ses frères et sœurs. « Nous étions une famille très chrétienne, une famille très unie. Un papa maçon. Une maman très commerçante. Nous habitions à Porto Nove au Bénin. Je suis allée à l’école là bas. J’étais une élève très assidue. J’aimais l’école. J’aimais être avec mes ami(e)s à l’école. Après l’école, je jouais avec mes frères et sœurs. J’ai appris tôt à cuisiner et on lavait le linge à la main (Il n’y avait pas de machine à laver !). Pour les devoirs de l’école, je les faisais ensemble avec mes frères et sœurs. Je lisais aussi des livres, par exemple « Finagnon ».
Emmenée en France comme domestique
Je vivais ainsi avec mes parents lorsqu’une famille française est venue au Bénin pendant les vacances. Ils étaient venus rendre visite à des gens à côté de chez nous. Quand ils m’ont vu, ils ont proposé à mes parents de m’emmener avec eux en France pour un avenir meilleur à l’école. Sans hésiter, mes parents ont accepté. On se disait que j’aurais une vie meilleure en France et que je pourrais plus tard les aider. J’ai donc quitté le Bénin à 11 ans. J’étais contente de prendre l’avion sans imaginer ce qui allait m’arriver ensuite.
Une fois arrivée en France, la promesse que ces gens avaient fait à mes parents de m’envoyer à l’école n’a pas été tenue. Je me suis retrouvée ensuite dans une maison où il y avait deux enfants entre 5 et 8 ans. Je les déposais à l’école le matin. J’allais les rechercher à midi pour manger à la maison et j’allais les chercher à 4h ½ . Entre temps, je faisais le ménage, le repassage et la cuisine pour les enfants. J’ai vécu ainsi pendant des années. Au début, je ne comprenais pas du tout pourquoi, je vivais ainsi. Ce n’est pas ce qui avait été dit à mes parents. Je n’avais pas de nouvelles d’eux. J’ai vécu ainsi pendant 9 ans de 11 à 20 ans.
On me disait de manger ce qu’il restait après que tout le monde ait mangé. Et je n’avais pas le droit de toucher aux affaires des enfants. En cachette, je me débrouillais pour trouver des choses à manger avant leur retour. Et, en l’absence de la famille, je regardais les livres des enfants. Lorsqu’ils sortaient, je restais à la maison. Je n’avais pas le droit de sortir. Je regardais les passants par la fenêtre.
J’avais 16 ans lorsqu’ils sont partis au Bénin sans moi. Les parents n’avaient pas de nouvelles de moi. Ils s’inquiétaient. Quand ils ont vu ces gens, ils ont demandé de mes nouvelles. On leur a répondu que j’allais très bien et on leur a proposé de me téléphoner. Ils ont appelé et ils m’ont passé mes parents. C’est là que j’ai parlé à mes parents pour la première fois. J’étais contente de les entendre. Je n’ai pas eu l’à propos, ni le temps de leur décrire la situation dans laquelle j’étais. Je leur ai dit : « Tout va bien, mais priez pour moi ». Sans doute, ma mère a du se rendre compte que cela n’allait pas, mais elle n’a rien pu faire. C’est à partir de ce moment là que j’ai commencé à réagir. J’ai cherché à prendre contact avec l’extérieur.
Ces gens qui m’exploitaient m’avaient dit de me méfier des personnes que je rencontrais à l’extérieur quand je menais les enfants à l’école. Je me tenais souvent à la fenêtre pour voir les gens. Une voisine m’a remarquée et m’a demandé un jour pourquoi je regardais toujours par la fenêtre. J’ai parlé un peu avec elle. Je lui ai dit que je n’avais pas le droit de parler avec quelqu’un. Du coup, elle a compris. Un autre jour, je l’ai rencontré par hasard au bas de l’immeuble. J’avais déjà 16 ans. Nous avons parlé. Elle m’a écouté. Ensuite, elle m’a dit de ne pas parler de notre conversation à la famille en attendant qu’on trouve une solution. Un autre jour, on s’est croisé et elle m’a donné des informations écrites sur un papier : des adresses d’associations et de services sociaux. Ensuite, elle m’a dit : « Essaie de voir comment tu peux faire pour appeler tel numéro. Si ce n’est pas possible, je le ferais avec toi. Tu monteras chez moi et nous téléphonerons ». Je suis monté chez elle. On a téléphoné à une assistante sociale. Elle m’a donné rendez-vous. J’y suis allé. Elle m’a demandé de lui raconter comment j’étais arrivé en France. Je lui ai expliqué sans trop entrer dans les détails. Ensuite, elle m’a dit : « Moi, je suis là pour vous aider. Allez porter plainte ». La dame qui m’aidait m’a accompagné, mais, une fois arrivé là bas, ils nous ont dit que le délai était passé et qu’on ne pouvait plus porter plainte contre X. Après, on est rentré. La dame m’a réconforté. Elle a proposé de m’accompagner dans d’autres démarches pour avoir un titre de séjour.
Je suis resté dans la famille qui m’enfermait sans rien dire de ma rencontre avec cette dame et de mes contacts extérieurs. Quand la famille rentrait, je ne pouvais plus faire aucune démarche. La dame, de son côté, avait promis de faire des recherches auprès des associations qui aident les sans papiers. Elle a trouvé une association qui lui a demandé quel lien elle avait avec moi. « C’est une jeune fille que j’ai rencontré et que je veux aider ». On lui a demandé la présence de l’intéressée. La dame m’a accompagné à l’association. L’association m’accueilli et je leur ai expliqué ce qui m’était arrivé. Ils m’ont demandé où j’étais allé à l’école depuis que j’étais arrivé. J’ai dit que je n’y étais pas allé. On m’a dit que ce n’était pas normal puisque la solidarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. Ils m’ont établi un dossier pour la préfecture à partir des documents de la dame qui m’aidait comme si elle m’hébergeait. A partir de là, l’association a pu monter un dossier pour demander un titre de séjour. Après six mois, il y a eu la réponse de la préfecture. On m’a interrogé et j’ai expliqué le cas. C’est grâce à la dame de l’association que j’ai fait cette démarche. J’en aurais été absolument incapable seule. Ils m’ont donné un récépissé du titre de séjour qui m’autorisait à travailler et à faire une formation. J’ai été orienté vers une mission locale. La mission locale m’a pris en charge. Après un an et demi d’attente, j’ai fini par obtenir un studio pour jeunes travailleurs, ce qui me permettait de suivre un enseignement de remise à jour.
A ce moment là, la voisine qui m’aidait m’a dit : « Il est temps de dire à la famille que j’allais partir de chez eux. J’avais les papiers pour cela ». A l’instant où j’ai commencé à parler de mon départ de chez eux, ils n’ont pas voulu m’écouter et ils m’ont dit d’une manière très agressive. « Voilà, on t’a sorti de la pauvreté et c’est comme cela que tu nous remercie ». Je me suis mise à pleurer en pensant à tout ce que j’avais enduré. Au moment où je pleurais, ils ont commencé de sortir mes affaires et ils m’ont dit de partir. C’est comme cela que j’ai été libérée. J’avais vingt ans.
J’ai été orientée vers la mission locale qui s’occupe des jeunes en difficulté. On m’a proposé de suivre une formation d’auxiliaire de vie étant donné que je n’avais pas de diplômes préalables. Cette formation a duré un an et elle m’a permis d’obtenir ensuite un emploi d’aide à domicile. J’y ai appris à accompagner des personnes âgées et les compétences et les capacités correspondantes comme l’écoute, la patience… Tout en cherchant cet emploi d’aide à domicile, j’ai exercé de petits boulots comme caissière à Intermarché. Finalement, j’ai trouvé un emploi d’aide à domicile dans un organisme spécialisé. Cet emploi d’aide à domicile m’a aidé à trouver mon autonomie dans la vie active, dans le monde du travail. J’ai pu développer ainsi une vie personnelle qui est aussi aujourd’hui une vie familiale. J’ai pu sortir d’un esclavage domestique et aujourd’hui je suis heureuse d’avoir accompli quelque chose de positif.
Philo
Un chemin spirituel vers un nouveau monde
« S’élancer vers une nouvelle terre. Une approche contemporaine pour s’éveiller à demain et traverser les changements ».
A la sortie de la pandémie, le monde va-t-il reprendre ses habitudes, se réinstaller dans un système économique et social dont on voit bien qu’il va à sa perte. La crise du coronavirus va-t-elle permettre une accélération de « la transition vers des sociétés post-carbone respectueuses des limites de la biosphère, de la justice globale et des droits des générations futures ? » (1). Cependant, cette mutation globale requiert une profonde transformation des mentalités. Cette transformation appelle un cheminement spirituel qui induise une évolution des comportements et la mise en pratique de valeurs nouvelles. C’est aussi, comme l’écrit Michel Maxime Egger dans un article du « Temps » (2), « le besoin d’un nouvel imaginaire qui puisse entrainer une mobilisation collective ».
Michel Maxime Egger est un sociologue et un théologien (chrétien orthodoxe) qui anime aujourd’hui le « Laboratoire de transition intérieure » de l’association suisse : « Pain pour le prochain ». Depuis plus de vingt ans, il milite pour le développement durable et des relations Nord Sud plus équitables. En 2004, il a fondé le réseau « Trilogies » (3) qu’il anime depuis « pour mettre en dialogue : traditions spirituelles, quête de sens, écologie et grands enjeux socio-économiques ». C’est une approche qui associe « le cosmique, l‘humain et le divin ». Dans cette perspective, Michel Maxime Egger a écrit plusieurs livres :
A partir de la spiritualité chrétienne, « La Terre comme soi-même. Repères pour une écospiritualité » (2015).
A partir de la profondeur de la psychè humaine : « Soigner l’esprit. Guérir la terre. Introduction à l’échopsychologie » (2015).
A partir de la spiritualité dans une approche interreligieuse : « Ecospiritualité. Réenchanter notre relation à la nature » (2018).
Michel Maxime Egger a préfacé récemment un livre de la grande militante écologiste américaine : Joanna Macy : « L’espérance en mouvement » Nous avons présenté cette œuvre sur « Vivre et espérer » (4).
Michel Maxime Egger intervient dans de nombreuses rencontres. Et ainsi, en mai-juin 2020, il a répondu à une interview rapportée dans une vidéo qui introduit un cycle de méditation : « meditatio écologie » « organisée par la « Communauté mondiale pour la méditation chrétienne ». L’horizon ouvert nous est annoncé par le titre de cette vidéo : « S’élancer vers une nouvelle terre. Une approche contemporaine pour s’éveiller à demain et traverser les changements » (1). Nous accompagnons ici cette interview en évoquant quelques unes de ses expressions. Mais la vidéo s’entend avec tant de clarté et avec tant de sympathie qu’elle se suffit à elle-même.
La première question porte sur la réaction personnelle : « Pouvez-vous nous dire dans un registre personnel comment vous voyez ce qui se passe aujourd’hui ? En quoi vous êtes touché de manière sensible et comment y faites vous face ? » Chacun réagit selon les conditions d’habitat et de travail, mais aussi selon les circonstances familiales. Ici Michel Maxime Egger profite du confinement pour être présent à sa maman dans son départ au Ciel et accompagner son papa dans sa nouvelle solitude, une école de compassion. Et naturellement les nouvelles limitations sont une invitation à « aller vers le dedans, revenir vers soi, descendre à l’intérieur de soi » : prière, méditation, contact avec la nature…
La seconde question est plus générale. « Qu’est-ce que cette crise du Covid 19 nous dit de notre manière de vivre aujourd’hui ? Quel lien avec la crise écologique ? Comment met-elle le doigt sur une fragilité et questionne-t-elle nos vies spirituelles ? »
Si on entend par apocalypse révélation et dévoilement, cette crise a une « dimension apocalyptique ». Nous sommes conviés à écouter, à entendre. A travers ses symptômes, le coronavirus est un puissant révélateur . « Il donne le fièvre et tue par suffocation. Le symbole d’un système qui réchauffe et asphyxie la planète par son obsession de la croissance, sa démesure consumériste et sa quête du produit sans fin. Ensuite par son origine : le Covid 19 vient d’animaux abominablement maltraités , et son développement est indissociable des perturbations climatiques et écosystémiques…. Enfin par sa diffusion et ses impacts : impressionnant d’observer comment un virus microscopique peut mettre le monde à l’arrêt et l’économie à terre. L’expression de la vulnérabilité d’un système globalisé dont l’interconnexion est à la fois la force et la faiblesse » (2)
Cependant, Michel Maxime Egger nous appelle également à redécouvrir des éléments essentiels. Et tout d’abord, « Nous sommes un avec le Vivant. Le Vivant est un ». Nous sommes ensemble dans une situation de profonde interdépendance Or « par notre domination, par notre arrogance, nous avons brisé cette unité ». C’est un appel à la réconciliation avec la Terre, avec le Vivant.
Cette crise nous rappelle que « nous ne sommes pas les maitres et possesseurs de la nature. La nature n’est pas qu’un stock de ressources, mais elle est au contraire la source de la vie, une source qui nous appelle au respect, à un respect profond » .
Un troisième élément que cette crise du coronavirus nous rappelle, c’est que « nous ne sommes pas tout puissants, mais profondément fragiles, profondément vulnérables. C’est un appel à redécouvrir l’humilité ».
Et puis, parce que nous avons été amenés à réduire notre consommation, « nous avons appris que le bonheur ne réside pas dans des biens en quantité, mais dans des biens de qualité. Et, bien que physiquement, nous ayons du garder nos distances, nous avons redécouvert l’importance des relations humaines, des relations d’entraide pour la coopération. Ainsi ce virus nous apprend à retrouver, d’une part, la solidarité, et, d’autre part, par la réduction de la consommation, la sobriété ».
« A quels changements, attitudes et actions sommes-nous appelés, individuellement et collectivement, en lien avec un chemin spirituel tel que celui de la méditation ? »
« J’entend dans cette crise un triple appel : un appel à un choix radical, un appel à une métanoïa, un appel à un engagement, ces trois dimensions étant profondément interreliées »
« Choix radical : Je vis depuis longtemps avec cette idée que l’humanité est arrivée à une croisée des chemins, à une forme de carrefour. Nous avons en fait le choix, selon l’expression du sociologue Edgar Morin, entre le coté de l’abime et la métamorphose. Pour moi, cette crise du coronavirus a confirmé cette vision d’un carrefour de l’humanité ». « La grande question aujourd’hui : Est-ce que l’après sera un simple retour à l’avant ou au contraire aurons nous su, pu profiter de ce temps de ralentissement, de retour sur soi-même pour pouvoir faire des pas vers cette transition écologique et sociale qui est absolument nécessaire ». « J’ai souvent médité sur la phrase du Deutéronome (Deutéronome 30) dans le Premier Testament : « Je te propose vie et bonheur, mort et malheur. Choisis la vie pour que toi et ta postérité (les générations futures), vous viviez ». Mais de quelle vie parle-t-on ? D’une Vie avec un grand V, d’une vie connectée avec ce qui est vivant, d’une vie ralliée avec ce qui est Vivant, mais aussi à la source du Vivant, à ce Souffle, cet Esprit qui est à la source de toute chose, qui anime toute chose, qui anime la Création, qui est le mystère du Divin quelque soit le nom qu’on veuille lui donner. Evidemment, pour entrer dans cette connection là, la méditation est un espace, un chemin privilégié. S’ouvrir à ce Souffle, à cet Esprit, à cette dimension, attire une métamorphose, une métanoia, un retournement. Se métamorphoser, c’est en quelque sorte mourir pour renaitre. Mourir à ce qui conduit à la mort… pour pouvoir renaitre…renaitre au nouveau et donc à la vie, une vie plus forte que la mort, une vie animée par le souffle de l’Esprit et dont la résurrection du Christ a été une des manifestations et un des symboles et qui nous ouvre à une dimension d’inconnu. Ce choix de la vie, cette métanoia sont les fondements d’un engagement, à la fois personnel et collectif, pour la transition écologique et sociale, au sens fort du mot transition : trans ire : aller au delà, parce qu’il ne s’agit pas simplement de corriger un système ou de l’améliorer, mais bien de changer le système, changer le paradigme pour opérer, ce que le pape François, dans son encyclique, Laudato Si, appelle une révolution culturelle courageuse.
Quel encouragement, quelle perspective pourriez-vous nous donner pour s’élancer vers une nouvelle terre ?
Cette tâche est gigantesque, mais il est important de ne pas se décourager devant l’ampleur de la tâche ! Michel Maxime Egger nous propose plusieurs pistes.
Ne pas rejeter les émotions que nous pouvons avoir comme la peur, la tristesse, le découragement, le sentiment d’impuissance, mais simplement les accueillir … Elles sont . Elles appartiennent à notre humanité. Mais ce qui est extrêmement important, c’est de ne pas nous laisser enfermer, dominer, submerger par ces émotions, et, pour cela, créer des espaces où ces émotions puissent s’exprimer, se partager pour pouvoir ensuite être transformées….
Deuxième piste : « le mot confiance ou le mot foi ». Et à coté de toutes ses failles, « il y a en l’être humain créé à l’image de
Dieu… un être capable d’amour, capable de relations harmonieuses avec les autres. Ce sont des qualités, des dimensions à reconnaître, à cultiver et ce à l’intérieur de chaque être humain.
Troisième piste : entrer dans la conscience que chacun de nous tient le fil d’un autre possible. Un fil parfois ténu, mais qui est bien là. Mais pour pouvoir tisser ce fil, c’est extrêmement important d’aller à la source de ce fil, se connecter à ce qui est le plus vivant, le plus vibrant en nous, c’est à dire en fait se connecter à notre désir. Cela prendra des formes différentes…il ne pourra y avoir d’écologie intégrale durable si c’est une écologie du défaut. Ce doit être une écologie du désir.
Quatrième piste : commencer là où nous sommes, par de petits pas … L’important, c’est de se mettre en mouvement….
Cinquième élément : croire que c’est possible. Et pour cela se rappeler que l’histoire est pleine de causes qui apparaissaient au départ impossibles et sans espoir et qui se sont réalisées. Pensons à l’abolition de l’esclavage, à la chute du mur, à la fin de l’apartheid. … Il y a eu des basculements systémiques et structurels…
Sixième piste : construire des appuis et des alliances. On a besoin des autres. On ne peut pas réaliser la transition tout seul. Et pour cela, pour construire ces alliances, on a besoin de dialogue. On a besoin de s’écouter, on a besoin de coopérer. Passer du pouvoir sur au pouvoir de… c’est à dire on se met au service de quelque chose avec d’autres…
Septième piste. Comme l’a dit Joanna Macy, opérer le changement de cap en gardant le cap de la joie profonde. C’est à dire cultiver des énergies comme l’amour, comme la joie, comme l’enthousiasme. Ces énergies ne sont pas seulement des énergies renouvelables. Ce sont, bel et bien, des énergies inépuisables.
Huitième piste. Pour tout cela, il est nécessaire de créer à l’intérieur de nous un espace où va pouvoir agir à travers nous une force, un esprit, une énergie ( c’est tout le rôle de la méditation), qui n’est pas celle de notre égo, ce moi volontariste qui est aux commandes, une force qui va pouvoir agir en nous, nous traverser, agir à travers nous, une autre force, une autre énergie , un souffle qui est aussi un souffle de la terre, un souffle du vivant, mais aussi un souffle du Vivant avec un grand V, un souffle de l’Esprit, le souffle du Mystère au delà de tout nom. Et quand on laisse ce Souffle agir, dans cette ouverture, c’est aussi une ouverture à l’avenir, a ce qui va advenir, dans la confiance, dans une ouverture au fait que cette terre, cette terre nouvelle vers laquelle on s’élance, on ne sait pas la forme qu’elle va prendre. Il y a là une dimension d’inconnu, une dimension d’inouï, une dimension d’improgrammable à respecter. Oui, cette terre nouvelle, on ne peut pas la programmer, mais elle va émerger de quelque chose qu’on ne connait pas encore.
Voici une pensée unifiante, tournée vers l’avenir, qui en rejoint d’autres, présentes sur ce blog, telle que celle de Jürgen Moltmann. Cette méditation s’inscrit dans la réflexion que le vision écologique induit également sur ce blog . « Nous sommes un avec le Vivant. Le Vivant est un », nous dit Michel Maxime Egger.
J H
- Dans cette interview en vidéo, Michel Maxime Egger introduit Meditatio Ecologie sur le thème : « S’élancer vers une nouvelle terre. Une approche contemplative pour s’éveiller à demain et traverser les changement » : https://www.youtube.com/watch?v=CxrfhAgi_0s&feature=share&fbclid=IwAR1ynwSqVhbTPyTDqv8QudnoR6vkT8fNr7VSexdHr25Xv83SSwH2B407jPQ
- Michel Maxime Egger. Après le coronavirus, besoin d’un nouvel imaginaire. Le Temps, 6 mai 2020 : https://www.letemps.ch/opinions/apres-coronavirus-besoin-dun-nouvel-imaginaire?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=article&fbclid=IwAR0PcSdvtfQ1UN62KbGft6FFgTSpeKSIKpKI2WppO69zGTEkqv672oGM7kA
- Le site de Michel Maxime Egger : Trilogies. Entre le cosmique, l’humain et le divin : https://trilogies.org/auteurs/michel-maxime-egger
- L’espérance en mouvement. Vivre et espérer : https://vivreetesperer.com/lesperance-en-mouvement/
Voir aussi :
En route pour l’autonomie alimentaire : https://vivreetesperer.com/en-route-pour-lautonomie-alimentaire/
Vers une économie symbiotique : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
L’homme, la nature et Dieu : https://vivreetesperer.com/lhomme-la-nature-et-dieu/
Comment entendre les principes de la vie cosmique pour entrer en harmonie : https://vivreetesperer.com/comment-entendre-les-principes-de-la-vie-cosmique-pour-entrer-en-harmonie/
Une approche spirituelle de l’écologie (Sur la Terre comme au Ciel) : https://vivreetesperer.com/une-approche-spirituelle-de-lecologie/
Un avenir écologique pour la théologie moderne
https://vivreetesperer.com/un-avenir-ecologique-pour-la-theologie-moderne/
Comment dimension écologique et égalité hommes-femmes vont de pair et appellent une nouvelle vision écologique : https://vivreetesperer.com/comment-dimension-ecologique-et-egalite-hommes-femmes-vont-de-pair-et-appellent-une-nouvelle-vision-theologique/
Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François, Edgar Morin : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
…En route pour l’autonomie alimentaire
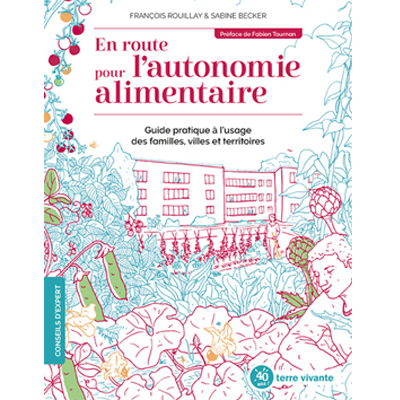 Une nouvelle manière de vivre en harmonie avec le vivant
Une nouvelle manière de vivre en harmonie avec le vivant
« En route pour l’autonomie alimentaire » (1), tel est le titre d’un livre récent de François Rouillay et de Sabine Becker. Prendre ce chemin, c’est répondre au déséquilibre d’une existence humaine où le contact s’est rompu entre la terre nourricière et l’assiette de nos repas et où la continuité de notre alimentation est soumise à la menace d’une rupture dans nos chaines d’approvisionnement éclatées dans la distance géographique et soumises aux aléas de la spéculation.
Cependant, ce livre nous dit bien plus. Car emprunter le chemin de l’autonomie alimentaire, c’est également s’engager dans un nouveau genre de vie , une vie en phase avec la nature nourricière. Et tout ceci implique une nouvelle éthique qui fonde une approche collaborative : « prendre soin de soi, de l’autre et de la terre ». (p 62)
Ainsi ce livre : « En route pour l’autonomie alimentaire » est ambitieux, mais il est aussi réaliste. Le sous-titre nous en informe : « Guide pratique à l’usage des familles, villes et territoires » . En effet, nous n’avançons pas dans l’inconnu. Le chemin est déjà reconnu et balisé par de nombreuses initiatives collaboratives. Et ceux qui sont déjà impliqués dans ces initiatives où la présence du vivant engendre du bonheur peuvent accéder à une joie que les auteurs mettent en lumière : « Lorsque nous sommes connectés par le partage, cette énergie, ce carburant, cette essence qui résident en nous nous permet d’avancer, d ‘évoluer, de faire tomber nos barrières, nos zones d’ombre. La joie est une immense force qui nous conduit vers l’amour libéré de nos peurs et autres pollutions psychiques, vers l’amour semblable à celui de l’enfant…. » (p 195).
Ce livre nous permet d’entrer dans une recherche où la vie se reconstruit différemment : un volet participatif, un volet éducatif, un volet coopératif et un volet régénératif. A chaque fois, nous découvrons de belles expériences dans une grande variété d’approches du « permis de végétaliser la ville en paysage nourricier », aux « poulaillers participatifs », aux « ateliers de cuisine » et aux « zones d’activité nourricière ». C’est une collaboration inventive.
Les auteurs : une approche pionnière
Auteur du livre avec Sabine Becker , François Rouillay a été un pionnier de cette approche au cours de la dernière décennie. Il raconte comment, à un moment propice, où, consultant en politiques publiques, il s’interrogeait à leur sujet, il a découvert une approche innovante qui débute dans une petite ville anglaise. Effectivement, elle est née à Todmorden quand deux mères de famille, subissant le déclin économique et social du nord de l’Angleterre, ont décidé de réagir et de créer un mouvement pour planter légumes et fruits dans la ville en vue d’offrir une nourriture à partager . François Rouillay s’est engagé pour développer cette expérience en France en suscitant un mouvement : « Les incroyables comestibles » . « Il s’agissait de fabriquer des bacs de nourriture à partager sur un domaine privé ouvert au public ou visible depuis la rue qui enverrait un signal très fort d’offrande de nourriture que l’on aurait soi-même mise en terre » (p 19). Pendant trois ans, François Rouillay a été l’animateur de ce mouvement , travaillant « dans la foi absolue que celui-ci aurait un effet transformateur dans les quartiers et dans les villes. Et ce fut le cas » (p 19). Le mouvement s’est alors répandu à vive allure. En trois ans, il s’est propagé en France et à l’international dans plus de 800 villes et 30 pays. A l’époque, nous avons rapporté sur Vivre et espérer une interview de François Rouillay en pleine action :
https://vivreetesperer.com/incroyable-mais-vrai-comment-les-incroyables-comestibles-se-sont-developpes-en-france/ Ce fut une véritable épopée. François Rouillay a ainsi « accompagné des centaines et des centaines de groupes ». Malheureusement, cette activité s’est révélée épuisante et a porté atteinte à la vie privée de François. En mars 2015, « il décide de passer la main après trois années de bénévolat ». Une nouvelle étape commence pour François Rouillay. Il rencontre Sabine Becker. La perspective s’élargit. En conjuguant la compétence de chacun, ils induisent le développement d’un mouvement pour l’autonomie alimentaire.
Sabine Becker a exercé, pendant trente-deux ans, la profession d’ingénieure urbaniste dans différentes collectivités publiques. Au vu des obstacles rencontrés, elle a pris conscience que son activité professionnelle « n’était pas juste » et « elle a cherché à comprendre pourquoi ». « Une grande quête s’en est suivie qui m’a conduite à étudier le fonctionnement de l’être humain dans les différentes dimensions qui le composent. Je me suis également formée à la connaissance des énergies dans le monde vivant des humains, mais aussi des règnes végétal, animal et minéral » (p 23). « Ma vision est devenue holistique et mon regard est appliqué au travail sur soi, au travail collectif et aux territoires » (p 24).
François Rouillay et Sabine Becker se sont ainsi rejoints, « lui dans le domaine de la participation citoyenne au service de l’autonomie alimentaire et donc de la restauration de la santé des personnes, des sols et de la biodiversité, et, elle, dans le domaine holistique du fonctionnement humain en matière comportemental sur les plans émotionnel et mental (p 24). Ensemble, à la suite des expériences passées, ils ont dégagé une vision du retour à l’autonomie alimentaire et élaboré des stratégies pour sa mise en œuvre. « Il s’agissait pour nous de diffuser la connaissance à partir de méthodes pédagogiques accessibles au plus grand nombre, d’expérimenter des techniques de fabrication de sol nourricier en milieu urbain et périurbain et d’animer des réseaux de personnes volontaires engagées dans l’agriculture urbaine et la transition alimentaire sur les territoires » (p 24).
C’est dans ce but que François Rouillay et Sabine Becker ont créé « L’Université francophone de l’autonomie alimentaire » et le site francophone qui en est l’expression : http://www.autonomiealimentaire.info
Et c’est ainsi qu’ils en sont venus à publier ce livre : « En route vers l’autonomie alimentaire ». Cet ouvrage présente la feuille de route de 21 actions résultant de nombreuses expériences et réflexions et permettant le retour à l’autonomie alimentaire de manière individuelle et collective.
Pour des paysages nourriciers
Développer l’autonomie alimentaire, c’est non seulement faire face à des déséquilibres insécurisant, c’est établir une relation bienfaisante avec la nature pourvoyeuse de nourriture . Comment envisager cette autonomie ? C’est « la capacité d’un territoire urbain à produire une nourriture saine permettant de répondre aux besoins quotidiens primordiaux des habitants …. Il s’agit d’obtenir, à travers une production locale constituée de fruits, de légumes, de légumineuses, de noix, de diverses céréales, d’œufs et de viandes, si nous sommes loin de la mer, de poissons d’élevage en eau douce, ainsi que de produits laitiers et d’huiles végétales ; le tout étant récolté, voire transformé sur ce territoire, ou situé dans une proche périphérie (moins d’une heure de trajet), élevé et cultivé selon des méthodes respectueuse de la santé et de l’environnement » (p 37).
Or, une telle politique requiert un nouvel aménagement de l’espace. Et cet aménagement dépend lui-même de notre niveau de conscience. Les auteurs mettent en évidence les déviations qui sont intervenues au cours des dernières décennies. « Comment se fait-il qu’au cours des cinquante dernières années nous soyons passés des espaces nourriciers aux espaces verts d’ornement ? » . Et, par ailleurs, « les entrées de nos villes forment des espaces périurbains voués invariablement aux zones commerciales avec leurs parkings et leurs ronds points » (p 47). En regard, le développement de l’autonomie alimentaire requiert une conscience collective. « Et l’un des moyens pour y contribuer est tout simplement de rendre les paysages nourriciers….. ». « A plus grande échelle que celle des bacs de nourriture, cela permettrait de mettre en évidence le lien entre le sol et l’assiette et nous en redonnerait le goût » (p 68). Tout au long de ce livre, nous voyons comment des paysages nourriciers peuvent apparaître et se développer. Et, par exemple, une des premières actions recommandées, c’est d’obtenir l’autorisation de planter légumes et fruitiers dans la ville auprès des collectivités publiques. C’est « le permis de végétaliser la ville en espace nourricier » (p 17). « Le permis de végétaliser est une pratique récente que le mouvement international : « Incredible edible » (Incroyables comestibles ) a grandement contribué à généraliser. Il exprime avant tout une volonté politique d’ouvrir l’espace public à la participation citoyenne pour l’agriculture urbaine. Pour des questions de sécurité et de responsabilité, il a progressivement été accompagné de protocoles (conventions simplifiées entre des citoyens désireux de jardiner la ville et les services techniques de la collectivité) et d’une procédure administrative (p 67) . En France, de nombreuses villes ont maintenant officialisé leur permis de végétaliser .
Une dynamique associative
Ce livre nous indique un chemin : en route vers l’autonomie alimentaire. Mais le mouvement en ce sens est déjà bien engagé. Et il manifeste une dynamique associative. Celle-ci s’est déjà révélée dans la rapide expansion du mouvement des « Incroyables comestibles » qui a gagné ville après ville. La même force anime les nombreuses et diverses initiatives qui apparaissent dans ce livre. C’est le commun dénominateur des volets « participatif, éducatif, coopératif, régénératif » de la feuille de route (p 6-7). Et ainsi les maîtres-mots sont bien : collaboration, coopération, participation, partage. Ainsi parle-t-on de « vergers et de jardins partagés », de « pépinières citoyennes participatives » et même de « poulaillers participatifs ». Ainsi cette collaboration s’exerce en divers domaines et à des échelles différentes. François Rouillay nous rapporte le fonctionnement d’un poulailler participatif au Québec. « Sept familles s’y impliquent en intervenant à tour de rôle pendant une semaine pour préparer la moulée, donner à manger, nettoyer et « cueillir » les œufs. Le service revient toutes les sept semaines » ( p 110).
Tout ce mouvement, si divers dans ses expressions, s’inscrit dans « une vision commune partagée » : « Nous ne sommes absolument pas dans une démarche autarcique d’individualités en repli… La logique cosmique des choses nous indique que nous sommes interdépendants les uns des autres …. Nous avons besoin les uns des autres pour rendre possible l’expression d’une intelligence collective autour d’une vision commune partagée » (p 193).
Ce livre témoigne d’une vision. Elle s’exprime notamment dans l’épilogue : « Voir les choses dans leur ensemble ; les fondements : eau, sol, semences, arbres ; l’homme est le gardien des équilibres ; l’univers est un lieu de création et d’abondance » (p 197-199). Ce sont des pensées directrices qui orientent notre marche vers une société nouvelle, un nouveau genre de vie, une éthique.
En même temps, à travers ce livre, on reconnaît le levain dans la pâte d’aujourd’hui comme l’écrit le préfacier, Fabien Tournan : « Le fil conducteur de ce guide porte sur l’émersion de ce qui existe déjà, qui est là partout dans le monde, expérimenté, enseigné, mais masqué par le vacarme du modèle marchand qui domine…. Il nous conduit à nous reconnecter à la terre, à celle qui nous nourrit, que nous devons préserver, entretenir, celle dont nous devons prendre soin. C’est un livre qui nous invite ainsi à rencontrer la paix » (p 10) . Avec François Rouillay et Sabine Becker, entrons dans ce beau voyage.
(1) François Rouillay et Sabine Becker . En route pour l’autonomie alimentaire. Guide pratique à l’usage des familles, villes et territoires Terre vivante, 2020
Aujourd’hui, le 12 juin 2020, François Rouillay fait le point dans une vidéo : « Autonomie alimentaire. Comment s’impliquer ? » :
J H
Voir aussi :
« Vers une économie symbiotique » : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
La maladie – Les coulisses d’un sauvetage
Il courait dans les médias un bruit de mort, la menace grandissait, le coronavirus se répandait, les deuils se multipliaient…
Plus fragile à mon âge, 89 ans déjà, le prudence était à l’ordre du jour. Je reportais une visite médicale à Paris ; ce fut un choix strict dans les rencontres de la semaine. Cependant un dimanche après-midi une poussée de fièvre se déclara.
La réponse du 15 fut prudente et le médecin me confirma dans cette prudence. Cependant le mal persistait et la fatigue gagnait. De Londres, où il résidait, mon fils, sensible à l’étrangeté de la situation, demanda à mon médecin de passer me voir, ce qui ouvrit un premier traitement. Mais la fatigue s’amplifia ; une forme de langueur s’installa.
Je descendais la pente sans en avoir bien conscience ; une voisine, amie de longue date, fut attentive, eut le courage d’intervenir et tira l’alarme. Le médecin arriva et déclencha une hospitalisation d’urgence.
Le choc
Et donc, en ce début d’après-midi des ambulanciers m’emmenèrent ; je me retrouvai dans une ambulance dont on ferma le capot. Destination : l’hôpital d’Antony.
Nous attendîmes à l’entrée ; le froid était glacial. J’ai souvenir de m’être ensuite retrouvé au chaud dans un lieu accueillant. Un masque à oxygène fut ouvert ; il distribua à forte dose le fluide de vie (18 litres). Nouvellement alité j’entrai dans une douce tranquillité. Une nuit passa. Le lendemain mon fils ayant pris la décision de me rejoindre dans la situation périeuse où je me trouvais, arriva de Londres.
Ma vie était en danger ; le pronostic vital était engagé. Les médecins ne cachèrent pas à mon fils la gravité de la situation. Cependant le vent tourna du bon côté ; quelques jours après je fus transféré dans une clinique/hôpital Les Tournelles à la Hay les Roses où le traitement fut allégé.
L’hôpital
Le traitement s’est poursuivi dans cet hôpital. De longues journées émaillées d’interventions ponctuelles : soins, médicaments, repas. L’organisation est régie par la division du travail ; à chacun sa tâche. Les relations sont limitées ; parfois elles s’élargissent grâce à une personne bienveillante, une « bonne personne ». La doctoresse apporte une dynamique d’encouragement. Finalement j’ai appris ma guérison. Libération !
Au terme de ce parcours, suite aux effets de la maladie, les forces physiques manquent. Le passage par une maison de repos s’impose ; la lutte se poursuit. Merci à ceux qui m’y accompagnent.
Sauvetage dans les coulisses
Si aujourd’hui la lutte pour regagner la vie normale se poursuit, ce récit n’en témoigne pas moins d’une échappée à une menace de mort très présente pendant quelques jours.
Quand mon fils arriva précipitamment à Antony et accéda à l’hôpital, les médecins lui parlèrent d’une situation désespérée. Mon fils dit à son papa, lui-même inconscient du danger, des paroles mobilisatrices. Pour me parler dans un contexte d’interdiction, il avait quasiment forcé le passage. Ensuite, durant la longue poursuite du traitement, sa présence a été une condition sine qua non dans la persévérance de l’effort de vie. Dans ce scenario, une autre personne a joué un rôle capital ; c’est une voisine amie de longue date et donc au courant de mon évolution, qui me voyant m’enfoncer dans une grande faiblesse, a eu le courage d’appeler le médecin à mon sujet. Celui-ci m’a hospitalisé d’urgence. Il était déjà très tard, le pronostic vital était engagé ; le vent a bien tourné.
D’une manière assez surprenante, la nouvelle de mon hospitalisation s’est très vite répandue. Quelques personnes en relation fréquente avec moi avaient remarqué mon affaiblissement dans les derniers jours ; elles s’alarmèrent lorsque le téléphone ne répondit plus. Elle prirent contact avec des amis pour avoir de mes nouvelles. L’une d’entre elles eut même l’initiative de rechercher sur l’annuaire l’adresse des médecins proches et eut ainsi la chance de pouvoir téléphoner à mon médecin traitant. J’ai su ensuite également les prières qui se sont exprimées à mon intention. Toutes ces interactions psychiques qui m’étaient favorables, ont certainement joué un rôle positif dans l’épreuve que je traversais.
Mon fils a même organisé un réseau d’information sur WathsApp, Dad’s army (l’armée de Papa), riche en expressions d’amitié et de souvenirs communs.
Cette épreuve a été une longue marche. Si tant d’amis ont participé de près ou de loin à cette effervescence salvatrice, je veux mentionner également ceux qui tout particulièrement ont joué un grand rôle dans le maintien de ma persévérance ; ce sont les amis qui m’ont accompagné au téléphone dans l’écoute, un partage de vie et de motivation, un temps de prière ; grâce à eux j’ai pu maintenir le cap. Ajoutons notre reconnaissance vis à vis des personnels hospitaliers qui ont permis cette guérison.
Dieu a été là ; il s’est engagé à travers toutes ces initiatives. Si cela peut prendre des formes et des expressions différentes, « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Sauvetage dans les coulisses, c’est un enseignement sur la puissance de l’entraide et sur notre responsabilité commune.
JH
Vivre de la présence divine
« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu » (Romains. 8/39).
La guérison est beaucoup plus que le rétablissement de la santé.
En moi, je ressens en profondeur cette certitude : que quoiqu’il m’arrive,
Dieu, en Jésus Christ, attesté par l’Esprit
Demeure en moi.
Sa présence est intégrée à ma personne. Je sais, je le vis.
Tout en moi est imprégné de divinité.
Tout ce qui est terrestre est une couche superficielle de mon être comme l’aspect visible de l’arbre, de la vigne.
La sève, invisible, circule dans toutes les ramifications, apporte la vie.
L’arbre qui est coupé, paraît mort. Mais, du tronc, racines, la sève fait resurgir des pousses. Un deuxième arbre apparaît.
La vie divinisée en moi est éternelle.
Nous sommes étrangers sur cette terre dans la mesure où n’y sommes pas établis pour l’éternité.
La Terre est une étape dans notre Vie. La mort, un passage vers un autre état comme la naissance. Du fœtus au bébé, nous naissons à un état spirituel.
En moi, aujourd’hui :
Une joie profonde de la présence de Dieu
Qui donne :
Confiance au présent
Force et énergie
Espérance du futur
Illumination du passé.
Odile Hassenforder
Ecrits personnels
4 décembre 2006
Textes en regard.
Que Dieu qui est l’auteur de l’espérance
vous comble
de toute joie
et de sa paix par votre confiance en Lui.
Ainsi, votre cœur débordera d’espérance
par la puissance du Saint Esprit.
(Romains 15/13)
Dans son grand amour
Dieu nous fait naître à une vie nouvelle… Voilà qui fait notre joie
Même si vous êtes attristés par diverses épreuves
actuellement … qui servent à éprouver votre foi.
… Joie glorieuse qu’aucune parole ne peut exprimer…
(I Pierre 3,6)
Romains 8
Verset 2 C’est la loi de l’Esprit qui nous donne la Vie dans l’union avec Jésus Christ…
Sa présence dans ma vie
« Sa présence dans ma vie », tel est le titre du livre d’Odile Hassenforder. Ce livre porte un témoignage vivant qui nous parle à travers le temps : https://vivreetesperer.com/odile-hassenforder-sa-presence-dans-ma-vie-un-temoignage-vivant/
Ce témoignage s’exprime à travers ce blog . Ce texte : « Vivre de la présence divine » rapporte un vécu qui s’adresse à chacun de nous . C’est un désir que nous ressentons. Chez Odile, la réalité de la présence divine est aussi en phase avec le mouvement de ce désir :
« Ce désir au fond de moi d’être imprégné de la vie divine est suscité par l’Esprit. Donc, j’ai à accueillir son oeuvre en moi, et ensuite à donner mon accord pour qu’il me rende capable de vouloir, puis de faire vis à vis des actes qui lui plaisent . C’est très différent de me forcer, de rassembler ma volonté pour agir ».
« Accueillir la vie » : https://vivreetesperer.com/accueilir-la-vie/
Dieu vivant : rencontrer une présence
Ce témoignage apporte un exemple concret à l’appui de la vision théologique que nous apportent Bertrand Vergely, Jürgen Moltmann, Diana Butler Bass et Richard Rohr dans ce blog. Ces apports convergent dans l’article : « Dieu vivant : rencontrer une présence » au sujet du livre de Bertrand Vergely : « Prier : une philosophie » : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-rencontrer-une-presence/
« La Vie. La Vie avec un grand V. Ce n’est pas un terme grandiloquent. Il y a en nous une présence faisant écho à ce que nous avons de plus sensible, d’où la justesse de parler de divine présence », nous dit Bertrand Vergely. Richard Rohr lui fait écho : « Dieu n’est pas un être parmi d’autres, mais plutôt l’Etre lui-même qui se révèle… Le Dieu dont Jésus parle et s’y inclut, est présenté comme un dialogue sans entrave, un flux inclusif et totalement positif, la roue d’un moulin à eau qui répand un amour que rien ne peut arrêter ». Jürgen Moltmann, dans la foulée de la théologie renouvelée d’un Dieu Trinitaire, écrit : « Nous vivons en communion ave Jésus, le Fils de Dieu, et avec Dieu, le Père de Jésus-Christ et avec Dieu, l’Esprit de vie. Ainsi, nous ne croyons pas seulement en Dieu . Nous vivons avec Dieu, c’est à dire dans son histoire trinitaire avec nous ».
C’est dans cette compréhension qu’Odile témoigne : « Ce désir au fond de moi d’être imprégné de la vie divine … Tout en moi est imprégné de divinité ».
J H
Comme la beauté nous accompagne en hiver
Ici, en partage, quelques photos des sites Flickr que nous fréquentons et qui nous apportent des moments d’émerveillement.
Des couleurs en trace d’automne
Avec Paula W Angleterre 30 décembre 2019
Temps de neige
Avec Sandra Bartocha Allemagne 8 janvier 2020
Rêve de blancheur
Avec Sandra Bartocha Allemagne 22 décembre 2019
Une harmonie qui se révèle
Avec Didier Héroux Savoie 26 janvier 2020
Neige en montagne
Avec Didier Héroux Savoie 26 janvier 2020
Ciel, lac et montagne tout en bleu
Avec Gérard et Françoise Léman 5 février 2020
Un chemin dans la brume
Avec Tony Armstrong-Sly Angleterre 7 février 2020-02-15
Gestation, un matin, dans la brume
Avec Vanille France 10 janvier 2020
Crocus : annonce de printemps
Avec Dhina A 31 janvier 2020
Amandier en fleurs
Avec Gloria Castro Province de Valencia Espagne 28 janvier 2020
En toute saison, un ciel qui émerveille
Avec Gloria Castro Province de Valencia Espagne 11 février 2020
« Le monde est très matériel et pourtant il est très spirituel. Une montagne, l’hiver, a beau être un tas de cailloux avec de la neige comme le dit un matérialiste ordinaire, ce n’est pas un tas de cailloux avec de la neige, c’est de la beauté. On fait un avec le monde quand on vit cette beauté. On expérimente le réel comme le Tout vivant. On se sent vivre et l’on s’émerveille de vivre … » Bertrand Vergely Retour à l’émerveillement (p10)
https://vivreetesperer.com/emerveillement-un-regard-nouveau/
J H
Une mobilisation démocratique face à la violence des pays inégaux
 Un chemin vers la sécurité dans les pays mortifères
Un chemin vers la sécurité dans les pays mortifères
Selon Rachel Kleinfeld
Il y a dans le monde une violence meurtrière. Nous prenons part à la souffrance des peuples déchirés par la guerre : Syrie, Afghanistan, Irak. Les médias nous en parlent abondamment. Mais il y a aussi dans le monde d’autres pays où sévit une violence meurtrière. Les dégâts sont considérables, mais le fait est beaucoup moins connu. C’est pourquoi une intervention de Rachel Kleinfeld au sommet Ted 2019 (1) nous paraît particulièrement importante. Rachel Kleinfeld travaille dans un think tank international : le Fond Carnégie pour la paix internationale (Carnegie Endowment for international peace). Elle a pour mission de conseiller les gouvernements pour les aider à remédier à la violence. Et là, elle a découvert qu’une bonne partie de la violence meurtrière qui sévit dans le monde passe inaperçue. De fait, il y a dans le monde des pays inégalitaires qui sont marqués par une extrême violence. Mais cette situation n’est pas irrémédiable. Rachel Kleinfeld nous montre comment, en certains lieux, une mobilisation démocratique a rompu la spirale de la violence. Il y a « un chemin vers la sécurité dans les pays les plus mortifères (« A path to security for the world deadliest countries).
Les pays les plus dangereux
« Le Brésil est aujourd’hui le pays le plus violent au monde. Dans les trois dernières années, il ya plus de gens qui y sont décédés de mort violente qu’en Syrie. Et, au Mexique, il y a plus de gens qui y sont morts ainsi qu’en Irak ou en Afghanistan . Et, à la Nouvelle –Orléans, il y a plus de morts violents par habitant que dans un pays déchiré par la guerre comme la Somalie…. De fait, 18% seulement des morts violentes dans le monde sont causées par la guerre. Aujourd’hui, les probabilités de mourir de mort violente est plus grande si vous vivez dans une démocratie à niveau de vie moyen avec une grande inégalité de revenu et une forte polarisation politique. Sait-on qu’il y a aux Etats-Unis quatre des cinquante villes les plus violentes du monde ? ». Rachel Kleinfeld nous amène ainsi à une prise de conscience. Nous découvrons une nouvelle forme de violence. C’est un défi, mais ce n’est pas une fatalité. Un petit nombre de gens peuvent faire beaucoup pour mettre fin à la violence dans nos démocraties. Et si le vote fait partie du problème, c’est aussi la clef de la solution.
Lorsque la violence meurtrière devient ordinaire.
Le méfait des privilèges
En comparant des statistiques, Rachel Kleifeld a découvert qu’il y a des journalistes assassinés dans des pays qui ne sont pas dépourvus économiquement. Mais ces pays sont marqués par une grande inégalité sociale et les privilèges d’une petite minorité qui tient le pouvoir en s’appuyant sur des groupes mafieux.
A partir de l’exemple du Vénézuéla où le nombre de morts violents par habitant est aujourd’hui le plus élevé du monde, Rachel Kleinfeld analyse un processus dans lequel le pouvoir politique se maintient au pouvoir à travers des groupes qui finissent par l’emporter sur les autorités légitimes : justice et police. Dans ce processus, dans certains pays d’Amérique latine, en regard les pauvres cherchent à s’organiser, mais ce processus dégénère à son tour.
Rachel Kleinfeld pointe un autre aspect du problème. Généralement la violence est concentrée dans des quartiers démunis. « Elle affecte les gens du mauvais côté de la ville, les gens qui sont pauvres, marginaux, souvent colorés. Les classes moyennes habitent dans un meilleur environnement. Elles peuvent regarder de loin le phénomène de la perturbation sociale. « Nous nous disons que la plupart des gens qui sont tués sont eux-mêmes des gens probablement impliqués dans le crime ». On se rassure et on se désintéresse.
La violence meurtrière aujourd’hui n’est plus majoritairement le résultat d’une guerre. C’est la conséquence d’une politique pourrie dans certaines démocraties. Et là, les citoyens qui votent peuvent être la force la plus efficace pour le changement.
Lorsqu’une mobilisation démocratique renverse la violence.
Ici, Rachel Kleinfeld nous fait part d’un exemple remarquable de mobilisation démocratique.
En 1994, la corruption et le pouvoir de la drogue régnait en Colombie. Mais, à l’élection municipale de Bogota, une mobilisation démocratique se réalisa et un candidat indépendant fut élu à la mairie par 2/3 des électeurs.
Le nouveau maire Mockus reprit en main la police qui ne réagissait plus à la violence : « Ce sont juste des criminels qui tuent d’autres criminels ». Une police honnête finit par réémerger. Le maire développa également une politique de solidarité, demandant aux plus riches de verser volontairement 10% d’impôt de plus..
A la fin de la décennie, après deux mandats, l’homicide à Bogota avait diminué de 70%.
Comment renverser la violence ?
Que ce soit en Colombie ou aux Etats-Unis dans les endroits où règne la violence, les responsables peuvent agir et faire la différence.
« Ce que nous pouvons faire de plus important, c’est d’abandonner l’idée qu’il y a des vies qui sont moins importantes que les autres, que certains peuvent être tués ou assassinés parce qu’après tout ils sont coupables de quelque chose… Cette dévaluation de la vie humaine, une dévaluation que nous osons à peine nous avouer à nous même, est ce qui permet à la chute vers la violence de commencer ». Partout, les victimes de la violence sont des gens qui sont du mauvais côté de la ville au mauvais moment.
Ensuite, nous devons reconnaître que l’inégalité dans nos pays est aujourd’hui une cause de violence plus grande que la guerre. Entre autres, l’inégalité entraine une séparation entre les quartiers. « Nous devons payer des impôts et demander que nos gouvernants mettent de bons enseignants et une police bien entrainée dans les quartiers menacés. Nous savons aujourd’hui beaucoup de choses sur la manière de réduire la violence, par exemple mettre davantage de police qualifiée là où il y a le plus de violence. C’est la tâche des hommes politiques responsables.
Les régimes les plus violents tendent à être nourris et entretenus par la drogue Comprendre que le système a une dimension internationale. Des régimes financiers à rendre plus transparents.
Cette violence n’est pas une fatalité. L’homicide a baissé au cours des siècles. Des victoires ont été remportées de la Colombie à New-York où l’homicide a baissé de 85% depuis 1990. Rachel Kleinfeld nous adresse un message d’action et et d’espoir. La violence a baissé pendant des siècles et elle pourrait baisser encore plus rapidement.
Certes, les situations varient. La dimension idéologique est une autre variable qui induit des formes différentes (2), mais il y a là une inspiration qui en rejoint d’autres et vaut dans différents contextes (3).
J H
- Rachel Kleinfeld TEDSummit 2019 A path to security for the world’s deadliest countries https://www.ted.com/talks/rachel_kleinfeld_a_path_to_security_for_the_world_s_deadliest_countries/transcript?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2020-01-17
- « Un silence religieux » : https://vivreetesperer.com/un-silence-religieux/
- « Un environnement pour la vie. Comment la toxicomanie est liée à l’isolement social et peut trouver un remède dans un environnement positif » : https://vivreetesperer.com/un-environnement-pour-la-vie/ « Le secret d’une résistance non- violente efficace » : https://vivreetesperer.com/le-secret-dune-resistance-non-violente-efficace/
Comment l’esprit de l’Evangile a imprégné les mentalités occidentales et, quoiqu’on dise, reste actif aujourd’hui
« The making of the western mind » de Tom Holland
« Dominion : The making of the western mind » (la formation de la mentalité occidentale », c’est le titre du livre d’un historien britannique, Tom Holland, traduit en français sous un titre plus explicite : « Les chrétiens. Comment ils ont changé le monde » (1). Qu’est-ce à dire ? A une époque où la pratique chrétienne recule dans les pays occidentaux et particulièrement en Europe, le christianisme continue-t-il à inspirer nos sociétés ? C’est la question que s’est posé cet historien. Il y répond dans un volume de plus de 600 pages qui déroule la fil de l’histoire du christianisme à travers vingt siècles comme une véritable épopée, alternant récit épique et analyse historique dans une vingtaine de grands moments répartis entre l’antiquité, la chrétienté et la modernité.
« Le fracas des armes, le choc des ego, les guerres civiles qui scandent l’histoire des religions monothéistes nous le rappellent : la plus grande histoire du monde, l’avènement du christianisme, de l’antiquité jusqu’aux crises migratoires, est une épopée. Une histoire pleine de bruits et de fureurs opposant athées et croyants, islam et chrétienté. Face à la montée du matérialisme, du divorce entre l’Eglise et le message évangélique à la crise de foi et aux nouvelles guerres de religion, la chrétienté maintiendra-t-elle sa suprématie ? Ou, confrontée au recul du sacré, fait-elle partie du monde d’hier ? » (page de couverture).
Sans doute, dans cette affaire, l’usage du mot chrétienté porte à question. Ce que nous dit l’auteur, c’est qu’au long de cette histoire, le message de l’Evangile a été un levain et qu’il a été et reste la matrice des grandes valeurs qui inspirent le monde occidental. Tom Holland nous dit comment personnellement il a été amené à se poser ces questions à partir de son expérience de l’antiquité en prenant conscience de la violence insupportable qui y régnait. Il nous montre en quoi le christianisme a été un choc culturel par rapport à la civilisation romaine, et l’inspiration évangélique, une force transformatrice au cours des siècles, dans le sillage du Christ crucifié, prenant le parti des pauvres face aux riches et aux puissants. Cependant, le christianisme a souvent été desservi et trahi par les institutions. Le reflux du « christianisme organisé » témoigne d’un porte-à-faux. Cette histoire est donc complexe. Cependant, Tom Holland nous montre qu’aujourd’hui encore, l’imprégnation évangélique est toujours active jusque dans des milieux séculiers et éloignés de la religion . Ce sont des valeurs chrétiennes qui inspirent les mouvements contemporains au service du respect de l’humanité et des droits humains quelle qu’en soit la forme.
Comment Tom Holland a pris conscience de l’originalité de l’inspiration chrétienne
Tom Holland s’est d’abord orienté vers l’étude de l’antiquité . Ses premiers ouvrages d’historien ont porté sur les invasions perses de la Grèce et les ultimes décennies de la civilisation romaine. Au départ, il était fasciné par la civilisation gréco-romaine et ses personnages emblématiques. Et puis, progressivement, il a pris conscience de la barbarie que cette civilisation véhiculait. Et elle lui est apparue comme de plus en plus étrangère : « Les valeurs de Léonidas, dont le peuple avait pratiqué une forme particulièrement atroce d’eugénisme en entrainant les jeunes à assassiner de nuit les « untermenschen », les sous-hommes, n’étaient pas les miennes, ni celles de César qui aurait tué un million de gaulois et réduit en esclavage un million d’autres … Ce n’était pas seulement leur violence extrême qui me troublait, mais leur absence totale de considération pour les pauvres et pour les faibles » (p 27).
Tom Holland, après une enfance pieuse, s’était éloigné de la foi chrétienne, même « s’il continuait vaguement de croire en Dieu ». « Le Dieu biblique lui apparaissait comme l’ennemi de la liberté et du plaisir » ( p 26). Alors, dans cette prise de conscience, il a compris combien les valeurs chrétiennes étaient précieuses. « L’effacement de ma foi chrétienne au cours de l’adolescence ne signifiait pas que j’eus cessé d’être chrétien. Les postulats avec lesquels j’ai grandi sur la meilleure manière de gouverner une société et sur les principes qui devraient être les siens, ne proviennent pas de l’antiquité classique, encore moins d’une quelconque « nature humaine », mais très clairement de son passé chrétien. L’impact du christianisme sur le développement de l’Occident est un fait si profond qu’il en est venu à ne plus être perçu … Ce livre explique ce qui a rendu le christianisme si subversif et perturbateur, comment il a fini par imprégner la mentalité de la chrétienté latine et pourquoi, dans un Occident souvent incrédule à l’égard des prétentions de la religion, nos attitudes restent, pour le meilleur et pour le pire, profondément chrétiennes » ( p 28).
Face à la domination et à la violence, l’élan de la révélation chrétienne
Notre image de l’antiquité gréco-romaine nous renvoie généralement au prestige de grandes œuvres intellectuelles ou monumentales. Nous recevons ainsi un héritage. Mais il s’agit de la meilleure part, car, comme Tom Holland en a pris progressivement conscience, il y a à l’arrière-plan des mœurs barbares où la violence des puissants se déploie au dépens des faibles dans une omniprésence de l’esclavage.
Le châtiment de la crucifixion est emblématique de la puissance romaine. Tom Holland nous décrit cette horreur répandue au cœur de Rome et dans tout l’empire . Ce livre commence par une effroyable description d’un quartier de Rome longtemps réservé à une crucifixion de masse. « Aucune mort ne semblait égaler la crucifixion dans l’ignominie. Cela en faisait le châtiment tout désigné pour les esclaves…. Pour se montrer dissuasif, celui-ci devait s’exécuter en public. Et, rien n’évoquait avec plus d’éloquence l’échec d’une révolte que la vue des centaines et des centaines de corps suspendus à des croix alignées le long d’une voie ou amassées au pied d’une cité rebelle ou encore de collines alentour dépouillées de leurs arbres » ( p 12). Si la cruauté de ce châtiment n’échappait pas à certains esprits, « l’effet salutaire des crucifixions sur ceux qui menaçaient l’ordre républicain ne faisait guère de doute aux yeux des romains » (p 11).
Ainsi, la croix était l’instrument d’un système glorifiant la puissance des hommes de pouvoir et des dieux au détriment des opprimés. En mourant sur une croix, Jésus a bouleversé l’ordre dominant. Et cette subversion s’est répandue dans l’histoire. « Que le fils de Dieu, né d’une femme et condamné à la mort d’un esclave, ait péri sans être reconnu par ses juges était propice à faire réfléchir même le plus arrogant des monarques » Il y avait là la source « d’un soupçon capital que Dieu était plus proche des faibles que des puissants, des pauvres que des riches » ( p 20).
Par ailleurs, à tous égards, en la personne de Paul, la prédication chrétienne s’est avérée révolutionnaire. Dans un chapitre : « Mission », il nous est montré toute la portée de ce message. « Les juifs, tels des enfants soumis à la protection d’un tuteur, avaient reçu la grâce de se faire le gardien de la loi divine. Mais la venue du Christ avait rendu cette mission caduque…. Le caractère exclusif de cette alliance était abrogée. Les anciennes distinctions entre eux et les autres, dont la circoncision masculine constituait le symbole, se voyaient transcendée. Juifs et grecs, galates et scythes, tous égaux dans la foi en Jésus-Christ, formaient désormais le peuple saint de Dieu » ( p 102). « Et la loi du Dieu d’Israël pouvait être lue et inscrite dans le cœur humain par son Esprit » ( p 113). L’universalité de ce message était et est encore révolutionnaire. C’était et c’est encore un message d’amour et de respect. Dans un monde où la domination masculine s’imposait, c’était également proclamer la dignité de la femme. Dans le monde de Néron, un monde où la débauche sexuelle était à son paroxysme, comme l’auteur nous en décrit la réalité suffocante, Paul proclame le respect du corps, « temple du Saint Esprit » ( p 119). Là aussi c’est un message révolutionnaire. Pendant des siècles, ce message a transformé les consciences et il a transformé l’Occident. Si cet idéal a bien souvent été bafoué, il a néanmoins changé les mentalités en profondeur.
Tout au long de ce livre, Tom Holland nous montre comment ce message s’inscrit encore aujourd’hui dans les esprits, chez ceux qui vivent la foi chrétienne, mais aussi dans ceux qui l’ont délaissée et ont quitté les institutions religieuses. « Comment se fait-il qu’un culte inspiré par l’exécution d’un obscur criminel dans un empire disparu ait pu imprimer une marque si profonde et durable dans le monde ? » ; C’est la question à laquelle Tom Holland répond dans ce livre. « Il suit les courants de l’empire chrétien qui se sont répandu le plus largement et ont survécu jusqu’à nous » (p 23). « Aujourd’hui, alors que nous sommes les témoins d’un réalignement géopolitique sismique, que nos principes se révèlent moins universels que certains d’entre nous ne l’auraient imaginé, le besoin de reconnaître à quel point ceux-ci sont culturellement contingents, est plus puissant que jamais. Etre citoyen d’un pays occidental revient à vivre dans une société toujours saturée de convictions et de supputations chrétiennes » (p 23).
De manière visible ou invisible, l’inspiration de l’Evangile active au fil des siècles et toujours aujourd’hui.
En rapportant l’histoire de la civilisation chrétienne, Tom Holland a cherché à en montrer les accomplissements et les crimes, mais, comme il nous le dit, son jugement a été lui-même conditionné par les valeurs chrétiennes. Ce sont ces valeurs qui, de fait, ont engendré la proclamation des droits humains, même si cette origine, fut dès l’époque plus ou moins passée sous silence. « Des deux côtés de l’Atlantique, les révolutionnaires considéraient que les droits de l’homme existaient naturellement depuis toujours et qu’ils transcendaient le temps et l’espace » Pour l’auteur, c’est là « une croyance fantastique ». « Le concept des droits de l’homme avait été à ce point médiatisé, depuis la Réforme, par les juristes et les philosophes protestants qu’il en était venu à masquer ses véritables origines. Il ne provenait pas de la Grèce antique, ou de Rome…C’était un héritage de jurisconsultes du Moyen-Age…. ».
Tom Holland nous montre la prégnance des valeurs chrétiennes jusque dans les mouvements qui sont sortis des cadres sociaux du christianisme. Les adversaires du christianisme s’y opposent bien souvent en fonction même de l’esprit de l’Evangile. « Alors même que Voltaire présente le christianisme comme hargneux, provincial, meurtrier, son rêve de fraternité ne faisait que trahir ses origines chrétiennes. De même que Paul avait proclamé qu’il n’y avait ni juif, ni grec dans le Christ Jésus, un avenir baigné dans d’authentiques Lumières ne comporterait ni juif, ni chrétien, ni musulman. Toutes leurs différences seraient dissoutes. L’humanité ne ferait qu’un « ( p 434). Le souci des humbles et des souffrants, qui mobilise aujourd’hui tant d’hommes et de femmes pour de grandes causes, est, lui aussi, directement issu du christianisme. Des adversaires extrêmes du christianisme le montrent bien puisqu’ils rejettent à la fois le vécu chrétien et les idéaux de compassion et d’égalité. Ce fut le cas de Nietzsche ( p 513-514).
Et, aujourd’hui, dans les débats sur les questions de société, des positions adverses s’inspirent de valeurs chrétiennes reprises différemment. « L’idée que la guerre de religion en Amérique se livre entre les chrétiens d’un côté et ceux qui se sont émancipés du christianisme de l’autre, est une exagération que les deux parties ont intérêt à promouvoir.. En réalité, évangéliques comme progressistes sont issus de la même matrice. Si les adversaires de l’avortement héritent de Macine qui avait parcouru les décharges de la Cappadoce à la recherche d’enfants abandonnés à sauver, ceux qui les combattent s’appuient sur la supposition non moins chrétienne que le corps de la femme devrait être respecté comme tel par tout hommes. Les partisans du mariage homosexuel se montrent pour leur part tout autant inspirés par l’enthousiasme de l’Eglise pour la fidélité monogame que ses opposants par les condamnations bibliques des hommes qui couchent avec des hommes » ( p 586).
Si dans l’histoire du christianisme, il y a bien des épisodes qui sont marqués par la violence et la domination, « les normes selon lesquelles ils furent condamnés pour cela restèrent chrétiennes ».
Et, aujourd’hui encore, ces normes, bien souvent non identifiées comme telles, restent vigoureuses. « Même si les Eglises devaient continuer à se vider dans tout l’Occident, il semble peu probable que ces normes changeraient rapidement. « Dieu a choisi les éléments faibles du monde pour confondre les forts ». Tel est le mythe auquel nous persistons à nous accrocher. En ce sens, la chrétienté reste la chrétienté » ( p 592).
Passé, présent et avenir
Les lectures de l’histoire du christianisme différent selon les regards qui lui sont portés. L’approche d’un historien dépend de son contexte personnel qui, lui-même induit tel ou tel questionnement.
Ainsi Jean Delumeau a exploré le climat de peur engendré par une image de Dieu et un système répressif.. Son oeuvre historique milite en faveur d’un christianisme ouvert à la modernité. Conscient de l’écart entre les propositions du christianisme institutionnel et la culture actuelle, souvent désignée comme ultra-moderne, nous avons cherché un éclairage dans des lectures historiques montrant comment l’élan du premier christianisme s’était figé et emprisonné dans une système hérité de la conjonction entre l’empire romain et l’Eglise et ayant perduré pendant des siècles avant de soulever des vagues de protestation. Quant à lui, Tom Holland s’attache à mettre en évidence le caractère révolutionnaire du message chrétien à son apparition dans le monde antique et la puissance de la matrice chrétienne à travers les siècles jusqu’à aujourd’hui. Il retient notamment son engagement en faveur des pauvres et des faibles et son caractère universaliste . Dans cette entreprise, il accorde une place majeure à la croix alors qu’on pourrait mettre également en évidence la résurrection du Christ, l’œuvre de l’Esprit et l’espérance qui est ainsi déployée. N’est-ce pas cette espérance qui a animé certains mouvements contemporains comme la campagne pour les droits civiques engagée par Martin Luther King contre la discrimination raciale ou la théologie de la libération. C’est la théologie de l’espérance exprimée par Jürgen Moltmann (2)
Ainsi, il y a bien un lien entre passé, présent et avenir
L’importance de ce livre nous paraît résider dans le fil conducteur qui met en valeur l’influence majeure de la matrice chrétienne dans la civilisation occidentale, et, tout particulièrement dans la manière dont cette influence continue à s’exercer dans une société sécularisée, apparemment déchristianisée. Ainsi parle-t-on aujourd’hui d’une « sortie de la religion », mais tout dépend de ce qu’on entend par ce terme. Tom Holland nous dit qu’en réalité le message évangélique est toujours présent et actif dans la profondeur des mentalités. Et, à bien y réfléchir, on mesure les gains accomplis au cours des siècles par rapport aux mœurs barbares qui prédominaient dans l’antiquité. C’est comme si le message chrétien avait agi comme un levain. Si le monde aujourd’hui est en danger, il y a aussi des atouts dans la créativité scientifique et technologique et les prises de conscience qui se multiplient : conscience écologique, mais aussi conscience de la montée d’une nouvelle donne relationnelle : promotion des femmes, respect des minorités, nouveau regard où prend place l’empathie, la bienveillance, le « care »… Voici un horizon où on peut lire une présence du levain évangélique quel que soit soit le déphasage des institutions. Et, dans une attention et une écoute croyante, ne peut-on y voir l’oeuvre de l’Esprit et regarder ainsi en avant ?
J H
- Tom Holland. Les Chrétiens. Comment ils ont changé le monde. Editions Saint Simon, 2019 . Ce livre a été présenté sur France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/ce-que-lesprit-occidental-doit-au-christianisme Tom Holland a été interviewé en France sur la portée et la pertinence de ce livre : https://www.youtube.com/watch?v=LMRwkqcl3Lw&feature=emb_logo
- Un accès à la pensée théologique de Jürgen Moltmann sur le blog : « l’Esprit qui donne la vie » : https://lire-moltmann.com
Hymne de tendresse pour des personnes en chemin,
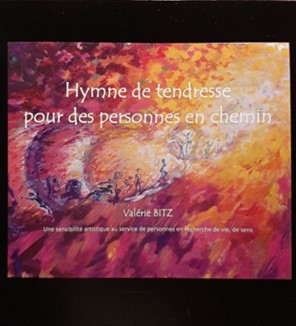 Un recueil d’œuvres peintes par Valérie Bitz
Un recueil d’œuvres peintes par Valérie Bitz
Valérie nous partage son expérience.
« Un désir est à la source de ce recueil : Rendre hommage à notre humanité chercheuse de chemins de vie !
Rejoindre les personnes qui se reconnaissent dans cette pâte humaine…. désireuses d’avancer !
Toucher notre sensibilité profonde, là même où elle conduit vers le cœur de soi, cet intime foyer vivant en chacun, où il pourra puiser!
A la genèse de ces œuvres, une fulgurance qui vous traverse, vous éblouit et en un instant, vous ouvre un chemin devant vous. Là, c’était le déclic suivant : Je suis de cette humanité qui marche, peine, erre, se relève,
en même temps que j’ai beaucoup reçu, de bien des personnes, de groupes et de milieux !
Je réalise alors que quelque chose en moi coule, se donne, déborde, pour d’autres! Vais-je retenir ou laisser circuler?
Ainsi est née la première peinture: «Je suis dans une chaine d’humanité».
D’autres suivront : plusieurs hommes, un à un, grandeur nature presque, par besoin de leur rendre leur dignité.
Qui voudra passer le relais ?
Hymne de tendresse pour des personnes en chemin
Il y a des textes, des poèmes, comme une proposition de voix et de vécus multiples.
Les peintures sont en craies de cire et acrylique, 100×50 cm
recueil disponible : 10€ + 2e si envoi postal
Valérie est peintre et accompagnatrice de vie.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter directement : Valerie Bitz, 06 89 06 77 10 – valerie.bitz.art@orange.fr
Articles de Valérie sur ce blog
Exprimer ce qu’il y a de plus profond en moi
https://vivreetesperer.com/exprimer-ce-qu’il-y-a-de-plus-profond-en-moi/
Des expériences de transcendance, cela peut s’explorer
https://vivreetesperer.com/des-experience-de-transcendance-cela-peut-sexplorer/
Apprendre à écouter son monde intérieur et à le déchiffrer. Pourquoi ? Pour qui ? https://vivreetesperer.com/apprendre-a-ecouter-son-monde-interieur-et-a-le-dechiffrer-pour-quoi-pour-qui/
Au cœur de nous, il y a un espace
https://vivreetesperer.com/au-coeur-de-nous-il-y-a-un-espace/
Le cadeau d’une intuition
https://vivreetesperer.com/le-cadeau-dune-intuition/
Un avenir écologique pour la théologie moderne
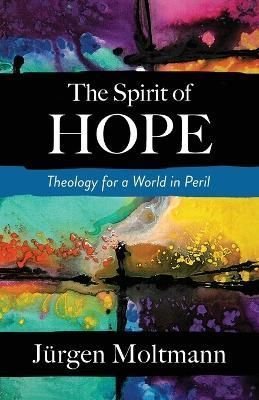 Une espérance pour des temps troublés Selon Jürgen Moltmann
Une espérance pour des temps troublés Selon Jürgen Moltmann
Un nouveau livre de Jürgen Moltmann vient de paraître en anglais à la fin de cette année 2019. Il est publié conjointement en Europe et aux Etats-Unis avec des titres analogue : « Hope in these troubled times » et « The Spirit of hope. Theology for a world in peril » (1). En cette période de l’histoire, nous ressentons effectivement de nombreuses menaces depuis le danger du dérèglement climatique jusqu’aux reflexes politiques de repli autoritaire. Venant d’un théologien qui a pris en compte les problèmes du monde au cours de ces dernières décennies, ce livre est bienvenu. La profondeur de cette pensée éclaire nos problèmes. Et si elle reprend et approfondit des éclairages antérieurs, elle ouvre aussi des pistes toutes nouvelles, comme une réflexion sur l’interpellation des grandes religions du monde par une sensibilité religieuse nouvelle autour de la dimension écologique de la terre. L’écothéologie de Moltmann se déploie dans deux chapitres successifs : L’espérance de la terre : l’avenir écologique de la théologie moderne » ; « Une religion terrestre commune : les religions mondiales dans une perspective écologique ».
L’espérance de la terre : l’avenir écologique de la théologie moderne »
Une approche historique montre qu’à partir du XVIè siècle, une volonté de puissance sur la nature s’est imposée à travers la conjonction d’une approche scientifique et d’une interprétation biblique. L’humanité est devenue « le centre du monde ». Seul l’être humain a été reconnu comme ayant été créé à l’image de Dieu et supposé soumettre la terre et toutes les autres créatures. Il devient le « Seigneur de la terre » et, dans ce mouvement, il se réalise comme le maitre de lui-même.
Aujourd’hui, cette dérive apparaît clairement. Les humains sont des êtres créés au sein de la grande communauté de la vie et ils font partie de la nature. Selon les traditions bibliques, Dieu n’a pas infusé l’Esprit divin seulement dans l’être humain, mais dans toutes les créatures de Dieu. « Les êtres humains sont si étroitement connectés avec la nature qu’ils en partage la même détresse et la même espérance de rédemption « (p 19). Les humains font partie de la nature. Pour survivre, ils doivent s’y intégrer. C’est un changement de représentation : « le passage du centre du monde à une intégration cosmique, de l’arrogance de la domination sur le monde à une humilité cosmique » (p 16).
La visée dominatrice de l’humanité a été également la conséquence d’une représentation de Dieu. Au bout du compte, suite à une interprétation juive d’un monde dé-divinisé et à une certaine approche scientifique, « Dieu a été pensé comme sans le monde, de la façon à ce que le monde étant sans Dieu puisse être dominé et que les humains puissent vivre sans Dieu » (p 21). Et le monde étant compris comme une machine, l’humain est menacé aujourd’hui d’être considéré également comme une machine.
Mais aujourd’hui, une compréhension écologique de la création est à l’œuvre. « Le Créateur est lié à la création non seulement extérieurement, mais intérieurement. La création est en Dieu et Dieu est dans la création. Selon la doctrine chrétienne originelle, l’acte de création est trinitaire… Le monde est une réalité non divine, mais il est interpénétré par Dieu. Si toutes les choses sont crées par Dieu le père, à travers Dieu le fils et en Dieu le Saint Esprit, alors elles sont aussi de Dieu, à travers Dieu et en Dieu « (p 22). Ce qui ressort d’une vision trinitaire, c’est l’importance et le rôle de l’Esprit. « Dans la puissance de l’Esprit, Dieu est en toute chose et toute chose est en Dieu ». C’est la vision d’Hildegarde de Bingen dans le monde médiéval (2). A la Réforme, Calvin affirme le rôle majeur de l’Esprit. Moltmann rapporte la doctrine juive de la Shekinah dans l’Ancien Testament. « Dieu désire habiter au milieu du peuple d’Israël. Il habitera pour toujours dans la nouvelle création où toutes les choses seront remplies de la gloire de Dieu (Esaïe 6.3) (p 23). Cette même pensée se retrouve chez Paul et Jean dans le Nouveau Testament. Vraiment, il y a aujourd’hui un changement de paradigme : « D’un monde sans Dieu à un monde en Dieu et à Dieu dans le monde » (p 20).
Dans la conception mécaniste du monde, celui-ci était achevé, terminé. Aujourd’hui, un monde inachevé est ouvert au futur. Et, on prend conscience que la terre, formant un système complexe et interactif a la capacité d’amener la vie. C’est la théorie, abondamment discutée, de Gaia. « Cette théorie ne signifie pas la déification de la terre, mais la terre est envisagée comme un organisme vivant qui suscite la vie » (p 24). Les êtres humains sont eux-mêmes des êtres terrestres. « Dans notre dignité humaine, nous faisons partie de la terre et nous sommes membres de la communauté terrestre de la création » (p 25). Moltmann rappelle que dans le premier récit biblique de la création, la terre est une grande entité qui engendre les êtres vivants. Et dans l’alliance de Dieu avec Noé, il y a une place pour la relation de Dieu avec la terre.
Au total, « L’Esprit divin est la puissance créatrice de la vie ». « Le Christ ressuscité est le Christ cosmique et le Christ cosmique est « le secret du monde ». Il est présent en toute chose » (p 26) . « Dans la tradition chrétienne, on a envisagé un double apport : la « théologie naturelle » qui résulte d’une connaissance de Dieu à travers le livre de la nature et une connaissance surnaturelle de Dieu, issue du « livre des livres », de la Bible. La révélation biblique n’évacue pas et ne remplace pas la théologie naturelle, mais elle la corrige et la complète (p 28). Dans la promesse d’une Nouvelle Alliance, telle qu’elle est formulée en Jérémie (31. 33-34), tous les hommes connaitront Dieu, du plus petit jusqu’au plus grand (p 28). Alors, la connaissance de Dieu sera toute naturelle. La théologie naturelle peut être ainsi envisagée comme une préfiguration. Mais, aujourd’hui, elle doit envisager la réalité dans un état où l’on y perçoit les « soupirs et les gémissements de le création ». Nous sommes en chemin. « Tous les êtres créés sont avec nous en chemin dans la souffrance et l’espérance. L’harmonie de la nature et de la culture humaine nous accompagne sur ce chemin ». « La théologie naturelle ainsi décrite est une théologie de l’Esprit Saint et de la sagesse de Dieu. Aujourd’hui, l’essentiel est de percevoir en toutes choses et dans la complexité et les interactions de la vie, les forces motrices de l’Esprit de Dieu et de ressentir dans nos cœurs l’aspiration de l’Esprit vers la vie éternelle du monde futur » (p 29).
La spiritualité parle au cœur. C’est le lieu où nous faisons l’expérience de L’Esprit de Dieu. Longtemps, dans la tradition d’Augustin, la spiritualité a été tournée uniquement vers l’intérieur ; C’était une spiritualité de l’âme et de l’intériorité. Mais les sens de l’homme : la vue, l’ouïe, le toucher peuvent également porter la spiritualité. La présence du Saint Esprit peut être perçue à travers la nature comme ce fut le cas pour Hildegarde de Bingen et François d’Assise. Jürgen Moltmann appelle à vivre une spiritualité en phase avec la création. Il évoque une nouvelle « mystique de la vie ». « Ceux qui commencent à aimer la vie – la vie que nous partageons – résisterons au meurtre des hommes et à l’exploitation de la terre et lutterons pour un avenir partagé ». (p 31).
Une approche religieuse de la terre.
Les religions du monde dans une perspectives écologique
Comment les grandes religions mondiales abordent la montée de la conscience écologique ? En quoi sont-elles interpellées par cette transformation profonde de la vision du monde ? Jürgen Moltmann entre ici dans un champ nouveau. C’est une approche originale.
Les grandes religions ont dépassé aujourd’hui leurs aires initiales . Elles sont entrées dans la mondialisation, le « village global ». Elles participent ainsi à une évolution qui nous appelle à passer des particularismes nationaux à une politique mondiale inspirée par la requête écologique. L’économie aussi est interpellée. Les ressources de la terre sont limitées. Il nous faut passer d’une économie quantitative à une économie qualitative, à une « économie de la terre ».
Les religions du monde existent depuis bien avant la globalisation. Elles ont accompagné la vie domestique dans « la célébration religieuse des évènements de la vie ». Mais, pour certaines, elle se sont considérablement engagées dans le champ politique. Des religions politiques ont accompagné la fondation des états. « Ces religions sont invariablement monothéistes : un Dieu, un Gouvernant, un Empire, avec un gouvernant qui se présente également comme « le grand prêtre du Ciel » (p 37). Les exemples sont multiples : Rome, la Perse, la Chine, le Japon. A l’époque moderne, les empires ont eu également une connotation religieuse. En regard , le bouddhisme est probablement la plus ancienne religion du monde indépendante des états. Les religions abrahamiques se sont référées à une conception exclusive du Dieu d’Israël. Dans l’histoire, christianisme et islam ont eu tendance à appuyer la formation d’empires à travers une religion politique. « La christianisation de l’empire romain a donné naissance aux empires d’Europe qui se sont entredéchirés et effondrés durant la première guerre mondiale (p 38).
Le monde prémoderne était caractérisé par une culture agraire vivant en symbiose avec la nature. La religion prémoderne est une religion cosmique. L’unité sociale était le village. Aujourd’hui, on est passé du village à la ville. Le monde urbanisé, globalisé donne aux religions un caractère mondial si certaines conditions sont remplies comme la séparation de la religion et de la politique et la garantie de la liberté de conscience. Ce monde urbanisé, globalisé abrite ainsi une société multireligieuse. On trouve des chamans en Californie et des bouddhistes tibétains en Allemagne.
Dans ce nouveau paysage humain, Moltmann introduit la terre comme une interlocutrice majeure à travers laquelle la nature et l’humanité se rejoignent et il revient sur la théorie de Gaia déjà évoquée. La terre est certes le sol sur lequel et à partir duquel nous vivons. Mais aujourd’hui, dans la nouvelle configuration qui résulte de la découverte de l’espace et de l’exploration spatiale (3), la terre apparaît comme un système complexe et unique qui peut être perçu comme un organisme vivant. « La théorie de Gaia n’est pas un essai pour déifier la terre, mais une compréhension de la planète terre come un organisme qui engendre la vie et suscite les environnements correspondants » (p 40). Ainsi la terre peut apparaître comme un organisme vivant avec une sensibilité propre. Et comme, nous autres humains, nous sommes des créatures terrestres, pour comprendre notre humanité, nous devons comprendre la terre. C’est « la fin de l’anthropocentrisme du monde moderne ». « La race humaine s’inscrit dans la vie du système terrestre » (p 41). Moltmann reprend en ce sens des éclairages bibliques déjà évoqués. En Genèse 1.24, c’est la terre qui engendre les êtres vivants. Et l’alliance de Dieu avec Noé n’envisage pas seulement l’humanité, mais aussi la terre.
Ce regard nouveau interpelle les grandes religions du monde, car jusqu’ici, elles se sont intéressées uniquement au monde humain. Mais, si le monde humain est inscrit dans la nature de la terre et ne peut survivre sans elle, alors l’attention des religions doit se porter également sur la terre. « Les religions mondiales ne peuvent l’être que si elles deviennent des religions de la terre et envisagent l’humanité comme humanité comme un élément intégré dans la planète terre. Si les religions missionnaires de l’histoire veulent atteindre les extrémités de la terre, elles doivent se transformer elles-mêmes en religions universelles de la terre. Pour cela, elles doivent redécouvrir la sagesse écologique aujourd’hui oubliée et la révérence naturelle des religions locales de la nature » (p 43). Beaucoup d’adhérents des religions historiques ont rabaissé les religions de la nature, les considérant comme primitives. Il y a là une erreur à corriger. « On doit chercher à réinterpréter la sagesse pré-industrielle pour notre âge post-industriel. « Car si les religions mondiales ne peuvent pas y parvenir, qui le pourrait ? » (p 43).
« Les religions mondiales se tournaient invariablement vers un monde au delà. Le nirvana des religions bouddhistes et le Dieu des religions monothéistes se tournaient vers un au delà de ce monde. Les religions politiques impériales envisageaient l’empereur dans la position d’un fils du Ciel. Ces religions percevaient le monde comme « mondain, pénible, mortel, futile et temporaire » (p 43). L’âme était destinée à échapper à ce monde. « Les religions ont offert un soulagement par rapport à l’étrangeté de ce monde, mais elles ont aussi rendu ce monde étranger ». « Si les religions du monde veulent atteindre les extrémités de la terre, elle doivent se retourner vers la terre et y apprécier les beautés et les vertus qu’elles projetaient dans le monde au-delà » (p 44). Ainsi les religions du monde doivent s’engager sérieusement dans la perspective écologique et commencer par s’appliquer à elles-mêmes les requêtes correspondantes ».
La religion hébraïque nous offre une religion de la terre dans la forme de l’année sabbatique. Tous les sept ans, la terre doit se reposer. Le repos sabbatique de la terre est béni par Dieu. Cette disposition permet à la terre de porter à nouveau du fruit » (p 44).
En terme d’image, Jürgen Moltmann rapporte qu’en Chine, les peintures comportent toujours une chute d’eau, une eau vive qui descend du ciel sur la terre. C’est un symbole fort. Puissent un jour les religions du monde couler comme une eau vive de l’au-delà dans notre monde apportant la joie du ciel pour faire le bonheur de la terre et apportant l’eau vive de l’éternité dans notre temps. « J’aspire à la venue du royaume de Dieu sur la terre comme au Ciel » (p 44)
Ce livre apporte ainsi , entre autres, un éclairage fondamental sur le rapport entre écologie et religion. « Il argumente que la foi chrétienne – et aussi les autres religions du monde – doivent s’orienter vers la plénitude de la famille humaine et l’environnement physique nécessaire à cette orientation » (page de couverture). Cet éclairage s’inscrit dans une première section du livre portant sur les défis que le monde actuel porte à l’espérance tandis que la seconde section présente des ressources en provenance de la première Eglise, de la Réforme et de la conversation théologique contemporaine. Moltmann rappelle que la foi chrétienne a beaucoup à dire en réponse à un monde qui va en se désespérant. Dans « le oui éternel du Dieu vivant », nous affirmons la valeur et le projet en cours de notre fragile humanité. De même, l’amour de Dieu nous donne force pour aimer la vie et résister à la culture de mort » (page de couverture).
Aujourd’hui, la recherche montre l’intensité des nouvelles aspirations spirituelles qui se retrouvent mal dans la religion organisée. Ce décalage existe également dans le rapport entre écologie et religion. Jürgen Moltmann décrit ce décalage et nous indique des pistes nouvelles. La voie écologique est, aujourd’hui, un chemin obligé. C’est une contribution bienvenue à un moment où des initiatives conséquentes commencent à apparaître dans le champ chrétien aussi bien dans le champ de la pensée (4) que de l’action (5).
J H
- Jürgen Moltmann. Hope in these troubled times. World Council of Churches, 2019 et, version américaine : Jürgen Moltmann. The Spirit of hope. Theology for a world in peril. Wesminster John Knox Press, 2019. Pour des raisons d’opportunité, nous avons travaillé sur cette seconde version.
- Hildegarde de Bingen. « L’homme, la nature et Dieu » : https://vivreetesperer.com/lhomme-la-nature-et-dieu/
- « Pour une conscience planétaire. Blueturn : la terre vue du ciel » : https://vivreetesperer.com/pour-une-conscience-planetaire/
- « Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, Pape François et Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/ « Comment entendre les principes de la vie cosmique pour entrer en harmonie » : https://vivreetesperer.com/comment-entendre-les-principes-de-la-vie-cosmique-pour-entrer-en-harmonie/
- « Une approche spirituelle de l’écologie : « Sur la Terre comme au Ciel » : https://vivreetesperer.com/une-approche-spirituelle-de-lecologie/
« L’espérance en mouvement » : affronter la menace environnementale et climatique pour une nouvelle civilisation écologique » : https://vivreetesperer.com/lesperance-en-mouvement/
Voir aussi : « Comment dimension écologique et égalité hommes-femmes vont de pair et appellent une nouvelle vision théologique » : https://vivreetesperer.com/comment-dimension-ecologique-et-egalite-hommes-femmes-vont-de-pair-et-appellent-une-nouvelle-vision-theologique/
L’espérance en mouvement
 Affronter la menace environnementale et climatique pour une nouvelle civilisation écologique
Affronter la menace environnementale et climatique pour une nouvelle civilisation écologique
Joanna Macy Chris Johnstone Michel Maxime Egger
Les éditions Labor et Fides nous offre une collection dédiée à la question écologique. « Les études des scientifiques convergent. La civilisation industrielle basée sur la consommation industrielle des ressources entame désormais une confrontation ultime avec les limites du système terre dont elle dépend. Les dérèglements et dégradations en cours provoquent des dommages et catastrophes naturelles de plus en plus graves et des souffrances intolérables à un nombre croissant d’êtres humains. La collection « Fondations écologiques » dirigée par Philippe Roch et Michel Maxime Egger, propose des ouvrages cherchant à dégager les concepts, les valeurs et les moyens propres à fonder une civilisation respectueuse des limites écologiques d’un côté, et de la diversité des aptitudes et des aspirations humaines de l’autre » ( p 4).
En 2018, est paru dans cette collection, un livre de deux personnalités écologiques anglophones : Joanna Macy et Chris Johnstone : « L’Espérance en mouvement. Comment faire face au triste état de notre monde sans devenir fou » (1). Ce livre est préfacé par Michel Maxime Egger, un pionnier francophone de l’écospiritualité et de l’écopsychologie (2). En suivant cette préface (au thème repris dans une vidéo) (3), nous entrerons dans la perspective de la transition écologique et nous apprécierons l’appel de ce livre dans toute son originalité.
Vers un nouveau paradigme : écologie extérieure et écologie intérieure.
« Il ne s’agit pas seulement de protéger le milieu naturel, mais de transformer le paradigme culturel, psychologique et spirituel qui sous-tend le modèle productiviste et consumériste qui détruit la planète…Pour cela, l’économie extérieure ne suffit pas… Cette écologie doit être complétée par une écologie intérieure et verticale… Cette nouvelle approche de l’écologie centrée sur l’approche de relations réharmonisées avec la terre et tous les être qui l’habitent, a pris de plus en plus d’ampleur ces vingt dernières années … Elle se décline selon deux axes : l’écopsychologie qui explore les relations profondes entre la psyché humaine et la terre… et l’écospiritualité qui ouvre explicitement à une dimension de mystère et d’invisible, de transcendance et de sacré, non réductible aux noms et aux formes multiples –doctrinales symboliques et rituelles – que leur donnent les traditions religieuses instituées » ( p 9-10).
Une visionnaire : Joanna Macy
Joanna Macy, l’auteure du livre : « L’Espérance en mouvement », est « l’une des grandes figures de la « révolution tranquille » qui apparait aujourd’hui. Elle est l’une des rares à participer à la fois aux deux courants de l’écopsychologie et de l’écospiritualité ». Michel Maxime Egger nous présente les grandes étapes de sa vie, les « cercles expansifs » de son parcours.
Le premier cercle recouvre ses racines judéo-chrétiennes. « Si elle a vécu Dieu comme « une présence chaude et enveloppante » pendant son enfance, la théologie universitaire va transformer cette présence en vide et la foi chrétienne en injonctions morales ». Elle s’éloigne ( p 12).
Le deuxième cercle est sa formation universitaire. « Joanna a fait une formation en théorie générale des systèmes. Cela lui a donné des outils conceptuels forts pour une compréhension holistique et organique des problèmes de la planète ». Elle a vu dans cette approche « la plus importante révélation cognitive de notre temps, de la physique à la psychologie ». « Elle montre que nous tissons notre monde en une toile vivante qui forme notre demeure qu’il ne tient qu’à nous de perpétuer » ( p 13).
« Le troisième cercle est la découverte du bouddhisme à travers la rencontre avec des maitres tibétains ». Dans les années 60, elle participe à des actions humanitaires dans des régions bouddhistes. « Le bouddhisme lui a appris la nécessité de regarder la souffrance en face. Plus encore, il lui a permis de développer les ressources intérieures pour assumer cette dernière, vivre avec elle et la transformer en force de vie. Il l’a également ouverte à l’expérience de la compassion comme réponse organique à l’interdépendance de toutes choses qui constitue la loi de la toile de la vie ». Cette inspiration spirituelle va l’accompagner dans son engagement écologique.
Cet engagement se poursuit sans l’approche de l’écologie profonde, une identification avec les réalités naturelles. « Une manière de rompre avec une posture anthropocentrique et de prendre conscience de l’unité ontologique de l’être humain avec la terre et les êtres qui la peuplent » ( p 14).
Enfin, on peut percevoir un cinquième cercle dans son engagement pour la surveillance des déchets nucléaires. « L’énergie atomique constitue le symbole par excellence de la nature brisée et de la séparation de l’être humain avec la Terre ».
« Pour Joanna Macy, les cinq cercles n’en font qu’un. Elle voit entre eux de fortes convergences : la pensée et la pratique bouddhiste entrent en interaction avec les valeurs du mouvement vert et les principes gandhiens, la psychologie humaniste avec l’écoféminisme, l’économie durable avec la théorie des systèmes, l’écologie profonde et la nouvelle science paradigmatique » ( p 15).
Le Travail qui relie
« C’est riche des apports de tous ces cercles que Joanna Macy va, à partir du milieu des années 80, développer « le Travail qui relie », une méthodologie puissante de transformation personnelle et collective pour contribuer au changement de cap » ( p 16).
Car c’est bien à un changement de cap que Joanna Macy nous appelle à l’encontre de deux autres scénarios : « On fait comme d’habitude » et : on se prépare à subir « la grande désintégration ». Tout ce livre a pour but de renforcer « notre contribution au changement de cap en faisant tout notre possible » ( p 29-30).
Michel Maxime Egger porte son regard d’analyste, d’interprète et de témoin sur l’approche du « Travail qui relie ». « le but essentiel du travail qui relie est d’amener les gens à découvrir et à faire l’expérience de leurs connexions naturelles avec les êtres qui les entourent ainsi qu’avec la puissance systémique et autorégénératrice de la grande toile de la vie, cela afin qu’ils puissent trouver l’énergie et la motivation de jouer leur rôle dans la création d’une civilisation durable » (Joanna Macy) ( p 12). L’objectif est d’aider les personnes à éveiller et développer leurs ressources – intérieures et sociales – pour passer du déni à la réalité, de l’apathie au désir d’agir, de l’impuissance à l’empowerment, de la compétition à la coopération, du désespoir à la résilience, du moi ego-centré au soi relié »…
Cette série de passages est le cœur de ce que Joanna Macy appelle « l’espérance en mouvement » qui constitue le titre de cet ouvrage… « L’espérance vient de l’intérieur. Ele jaillit du cœur profond, telle une aspiration à accomplir le non encore advenu de l’histoire. L’espérance est en cela intrinsèquement liée au processus de la personne qui grandit en humanité et réalise son potentiel cosmique, humain et divin » ( p 17).
Le « Travail qui relie » se présente comme une spirale qui se déploie organiquement selon quatre temps :
S’enraciner dans la gratitude
Honorer sa souffrance pour le monde
Changer de vision
Aller de l’avant
C’est cette approche que présente Joanna Macy dans ce livre.
A travers la gratitude, « reconnaître les dons de la vie donne des forces ». A travers cette analyse, l’auteure rejoint la recherche psychologique dans ses découvertes récentes (4).
Honorer notre souffrance pour le monde, c’est accepter nos émotions face aux malheurs du monde, ne pas les refouler. C’est accepter de voir la réalité en face et ne pas nous réfugier dans le déni. C’est accepter d’entrer en relation avec les victimes dans une attitude d’empathie et de compassion. L’auteure nous appelle à reconnaitre et à accepter notre souffrance pour le monde. « Quand nous entendons les pleurs de la terre en nous, non seulement nous nous libérons des résistances, mais nous permettons la circulation des flux de reliance qui nous connectent avec le monde. Ces canaux agissent comme un système racinaire qui nous donne accès à une force et à une reliance qui perdurent aussi anciennes que la vie elle-même » (p 112). Dans cette pratique d’acceptation de la souffrance du monde, Joanna Macy fait largement appel aux ressources de la tradition bouddhiste. On pourrait de même se reporter à la compassion divine telle qu’elle se manifeste dans l’inspiration chrétienne.
En nous invitant ensuite à porter un nouveau regard, Joanna Macy élargit notre conscience comme l’indiquent les titres des différents chapitres : une conscience de soi élargie ; un pouvoir d’un autre genre ; une expérience plus riche de la communauté ; une vision élargie du temps.
Et puis, nous pouvons ensuite aller de l’avant : Joanna Macy nous parle d’inspiration, d’imagination, d’intelligence collective, de confiance, de reliance. « Nous vivons à un moment où le corps vivant de notre terre est attaqué. Cependant, l’agresseur n’est pas une force étrangère, mais notre propre société de croissance industrielle. Dans le même temps, un processus de récupération extraordinaire est en cours, une réponse créative vitale que nous appelons le changement de cap. En relevant le défi de jouer le meilleur rôle possible, nous découvrons ce trésor qui enrichit nos vies et participe à la guérison du monde. Une huitre en réponse au traumatisme fait pousser une perle. Et nous, nous faisons pousser pour l’offrir ainsi, notre don de l’espérance en mouvement » (p 290).
Le mouvement de l’espérance
Dans son œuvre militante pour une nouvelle civilisation écologique, Michel Maxime Egger a écrit de nombreux livres. Et, aux éditions Jouvence, il a publié un livre accessible à tous : « Ecospiritualité. Réenchanter notre relation à la nature » (5). Voici ce qu’il écrit à propos de l’espérance : « L’espérance vient de l’intérieur. Elle jaillit du cœur profond, telle une aspiration pour faire advenir le non encore advenu de l’histoire… C’est là qu’intervient la foi. Non pas comme une adhésion à un système de croyances, mais comme le fruit de l’expérience intime du divin. Ma foi est la connaissance que « la vie va vers la vie » et que « la mort n’est pas la fin de tout »… « Elle donne du sens, le courage de vivre et de s’engager, une confiance fondamentale en la vie, en l’Esprit, en la capacité de l’humain à changer » (p 115)
Si l’espérance monte ainsi du cœur profond, nous y voyons un mouvement général de l’Esprit qui fait lever cette espérance, une dynamique qui nous porte ensemble vers l’avenir. En termes chrétiens, la théologie de l’espérance développée par Jürgen Moltm
ann nous permet d’entrer dans cette dynamique et d’y reconnaître l’œuvre de Dieu. « La promesse de Dieu ouvre le futur et donne ainsi le courage d’aller vers l’avant ». « La promesse que l’avenir de Dieu s’ouvre à nous donne naissance à une mission dans l’histoire, de telle sorte que cet avenir puisse être anticipé dans le contexte des possibilités que nous découvrons » (6) « Le Dieu qui a ressuscité Jésus est le créateur d’une existence nouvelle de tout ce qui est créé ». « La résurrection est le premier acte de la nouvelle création de ce monde transitoire en une forme nouvelle vraie et durable ». Dieu renouvelle la terre. Si aujourd’hui le monde est encore exposé aux forces de mort – et combien ne le voit-on pas aujourd’hui ! – il est appelé à devenir la maison de Dieu ( 7). La pensée de Jürgen Moltmann et du pape François dans l’encyclique Laudato si’ se rencontrent (8).
Une perspective analogue est exprimée par Michel Maxime Egger : « L’Esprit est toujours à l’œuvre agissant à l’intérieur de la Création. Le récit allégorique de l’Apocalypse, qui clôt la Bible, raconte l’histoire – invisible, souterraine, spirituelle – qui se joue sous la surface de l’histoire apparente, pleine de bruits et de fureurs. Cette histoire visible – avec ses nœuds, ses fils coupés, brisée et enchevêtrés qui symbolisent les souffrances, violences, et désordres de la Création – représente l’envers de la toile de la vie que le divin continue de tisser –silencieusement et amoureusement – avec nos vies et celles de toutes les créatures. Cela, dans l’attente que les êtres humains opèrent la mutation de conscience, le retournement intérieur nécessaire pour permettre au motif harmonieux de l’endroit de se manifester ».
« L’écospiritualité invite chacun et chacune à s’ouvrir à une telle vision d’espérance et à effectuer cette transformation. Elle souhaite ainsi nourrir le désir de nous engager pour la transition vers une société écologique, juste et résiliente ». ( p 117).
Ainsi, le livre de Joanna Macy et Chris Johnstone : « L’espérance en mouvement » est bien nommé. Cette espérance est en marche aujourd’hui à travers des voies à la fois diverses et convergentes (9).
J H
- Joanna Macy, Chris Johnstone. L’espérance en mouvement. Comment faire face au triste état de notre monde sans devenir fou. Préface de Michel Maxime Egger. Labor et Fides, 2018
- Michel Maxime Egger est sociologue, écothéologien et acteur engagé de la société civile en Suisse. Il est l’auteur de plusieurs livres. Il a fondé le réseau : Trilogies « pour mettre en dialogue traditions spirituelles, quêtes de sens, écologie et grands enjeux socio-économiques de notre temps ». Il chemine dans la spiritualité chrétienne orthodoxe. http://trilogies.org/auteurs/michel-maxime-egger
- Vidéo de Michel Maxime Egger présentant le travail qui relie https://www.youtube.com/watch?v=CRk5dpvoUDQ
- « La gratitude : un mouvement de vie » : https://vivreetesperer.com/la-gratitude-un-mouvement-de-vie/
- Michel Maxime Egger. Ecospiritualité. Réenchanter notre relation avec la nature. Jouvence, 2018
- « Une théologie pour notre temps… Chapitre : une théologie de l’espérance : https://lire-moltmann.com/une-theologie-pour-notre-temps/
- « Dieu dans la création » : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
- « Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, Pape François et Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
- Entre autres, chemins écologiques sur ce blog : « Vers une économie symbiotique » : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/ « L’homme, la nature et Dieu » : https://vivreetesperer.com/lhomme-la-nature-et-dieu/ « Comment entendre les principes de la vie cosmique pour entrer en harmonie : https://vivreetesperer.com/comment-entendre-les-principes-de-la-vie-cosmique-pour-entrer-en-harmonie/ « Une approche spirituelle de l’écologie (Sur la Terre comme au Ciel) : https://vivreetesperer.com/une-approche-spirituelle-de-lecologie/
Aspects politiques et économiques de l’écologie :
« La course pour la terre » : https://vivreetesperer.com/la-course-pour-la-terre/
« Le New Deal Vert » : https://vivreetesperer.com/le-new-deal-vert/
The way of life: un film sur la vie et l’œuvre de Jürgen Moltmann
 Un hymne à l’amour et une vision d’espérance
Un hymne à l’amour et une vision d’espérance
Jürgen Moltmann, un des plus grands théologiens de notre époque, a aujourd’hui une audience universelle. Ainsi, l’équipe chinoise qui a réalisé une délicate et émouvante vidéo à l’occasion de son anniversaire à 93 ans (1), vient de réaliser un film sur son parcours de vie et de recherche (2). Ce film nous présente à la fois la vie personnelle de Jürgen Moltmann dans son contexte familial et son parcours de recherche et d’enseignement, la vision nouvelle d’une théologie en phase avec les aspirations de nos contemporains. (3) Ainsi apparait le témoignage d’un homme qui porte amour et foi dans le même mouvement. Et ce témoignage s’allie à une vision théologique nouvelle qui change notre regard et nous ouvre un horizon.
L’amour unit. Il rassemble. Il libère. Nous voyons là un fil conducteur dans le déroulement et l’inspiration de ce film. Celui-ci ne s’ouvre-t-il pas sur le thème de l’amour entre Jürgen et son épouse Elisabeth, décédée il y a trois ans, mais toujours là dans une « seconde présence » (4), un amour qui s’exprime dans une famille unie et ouverte. Et il s’achève sur le thème de l’amitié, une amitié qui a inspiré Jürgen Moltmann dans ses relations, professionnelles entre autres (5).
La théologie de Molmann est étroitement liée à la vie de celui-ci, au départ vécue dans le bombardement de Hambourg, dans la guerre et dans un camp de prisonniers, puis ensuite dans sa participation à un mouvement social et intellectuel, qui se manifeste à l’échelle internationale pour plus de liberté et de dignité humaine (6). De la souffrance ressentie dans les épreuves de son adolescence et de sa jeunesse et de l’engagement dans la foi qui s’en est suivi, procède l’inspiration des ses trois premiers livres : Théologie de l’espérance ; Dieu crucifié ; L’Eglise dans la puissance de l’Esprit.
L’amour ne se résout pas à ce qui opprime les hommes. La pensée de Moltmann elle-même met en évidence ce qui unit et ce qui construit. Elle emprunte le vrai, là où il se trouve. Elle rejette la domination et se plait dans la conversation. C’est ce qui apparaît à travers de nombreuses interviews au sujet de la vie et de la théologie de Moltmann. Les paroles de celui-ci ponctuent le déroulement du film. Elles sont éclairées à leur tour par des interviews. Une vision commune émerge dans une pluralité d’expressions. Et cette vision est reçue universellement comme en témoignent les auteurs de ce film dans un moment consacré à la réception de la théologie de Moltmann en Chine.
Le film est intitulé : « The way of life ». Il y a bien dans ce film l’expression d’une manière de vivre. Mais il y aussi une réponse théologique aux questionnements sur nos raisons de vive, notre raison d’être. Les premiers chrétiens, rapporte-t-on, se présentaient comme « The people of the way » (7), le peuple de la voie, une voie d’amour et de paix à la suite de Jésus. « The way of life », c’est bien la voie de la Vie. Le livre le plus récent de Moltmann s’intitule « The living God and the fullness of life » (8).
Ce film éveille l’émotion. Jürgen respire la bonté. Il parle vrai. Il s’exprime avec son cœur. On ressent son empathie. Et d’autre part, ce film a été réalisé avec une remarquable délicatesse. On y ressent une affection respectueuse pour l’homme et pour le théologien, une reconnaissance pour la vision qu’il communique, une vision de foi et d’espérance en un Dieu, communion d’amour et puissance de vie. Alors les paroles portent et suscitent l’émotion. Elles répondent à nos questions et éveillent notre intelligence. Un théologien, Miroslav Volf rapporte un fait significatif. Il y a quelques années, Jürgen Moltmann intervenait à Pékin devant un public de 3000 personnes, la plupart n’étant ni théologien, ni chrétien. Et, à la fin, tous se levèrent dans une « standing ovation ».
Ce film est beau dans son déroulé et dans ses images. Il va profond en associant le témoignage et l’enseignement. Nous y voyons comme un petit chef d’œuvre.
Le film se déroule autour de cinq séquences successives intitulée : amour, souffrance, théologie, Chine, amitié. Nous essaierons d’apporter ici un aperçu de chaque séquence à partir de quelques interventions marquantes.
Amour
Ce film sur Jürgen Moltmann commence par une évocation de sa vie personnelle aujourd’hui. Il a cette vertu de ne pas hésiter à entrer dans l’intimité de Jürgen avec une grande délicatesse.
D’entrée, Jürgen évoque Elisabeth, son épouse, décédée de maladie en 2016, il y a trois ans. C’est un amour profond qui s’exprime là. « Elle est toute ma vie ». Au sortir d’années difficiles, la rencontre avec Elisabeth a été fondatrice. « Quand j’ai rencontré mon épouse et que j’en suis tombé amoureux, la joie de vivre est venue à moi et ne m’a jamais quitté ». Dès le départ, ce fut un compagnonnage intellectuel et théologique. « Je suis reconnaissant à Elisabeth mon épouse pour le développement de sa théologie féministe ». Effectivement, Elisabeth Moltmann Wendel a joué un rôle pionnier dans ce domaine et leurs deux pensées se sont enrichies mutuellement (9). A travers l’interview de Jürgen, on perçoit la peine qui demeure à la suite de son départ. « La peine accompagne l’amour. La nuit, la peine me submerge, mais Elisabeth s’approche de moi ». Ainsi regarde-t-il vers l’avenir en terme de retrouvailles avec Elisabeth dans la vie éternelle, mais, dès maintenant, Elisabeth est encore là, autrement. « Mon épouse Elisabeth est décédée en 2016 et je ressens encore la joie de sa présence. Je suis convaincu qu’elle est ressuscitée dans la vie éternelle. Elle est présente dans une seconde manière de présence ». Et ses proches l’accompagnent dans cette conviction.
Jürgen Moltmann avait déjà exprimé sa conviction d’une seconde présence de ceux qui nous ont quitté lors d’un récit à propos de la mort de son père dans son autobiographie (4). Voici un message précieux pour ceux qui vivent une expérience analogue.
Dans cette séquence, la vie intime de Jürgen se déroule dans une ambiance familiale et amicale imprégnée par un amour mutuel. On le voit dans le climat chaleureux de la célébration de son anniversaire et, très généreusement, dans les témoignages de ses quatre filles et de ses amis. Michael Weker, professeur de théologie qui fut son assistant, nous rapporte dans cet esprit la motivation actuelle de Moltmann. « Je pense que j’ai découvert votre secret. Chaque jour, vous avez à écrire. Et chaque mois, vous voyagez dans un pays différent ». Et Jürgen a confirmé.
Ainsi, dans cette séquence, tout parle d’amour : l’amour de Jürgen et d’Elisabeth, mais aussi cette chaleureuse ambiance familiale et amicale. Ce n’est pas hors sujet par rapport à la théologie de Moltmann. Cette théologie est étroitement liée à l’expérience humaine et elle est inspirée par la bonté et par la bienveillance. Dieu est amour. Tout est relié en Lui.
Souffrance
Pourquoi suis-je en vie ?
La seconde séquence du film rappelle la souffrance endurée par Jürgen Moltmann lors de la seconde guerre mondiale, une souffrance qui a bouleversé sa vie et qui a trouvé une réponse dans la consolation de Jésus. Cette séquence est donc intitulée : « Souffrance. Pourquoi suis-je encore vivant ? » C’est une question existentielle qui va éveiller la recherche de Jürgen Moltmann. Cette séquence commence par la désolation et elle s’achève par le bonheur familial qui a précédé le malheur.
A travers le témoignage de sa sœur et de son frère, nous découvrons une vie de famille unie, retranchée sur elle-même face à l’emprise nazie. Autour d’une mère optimiste et d’un père rigoureux, une vie enfantine heureuse nous est rappelée. Né en 1926, Jürgen Moltmann manifeste déjà une orientation intellectuelle. « Mon idéal était la physique atomique. Einstein et Heisenberg étaient mes héros ». C’est dans ce contexte que le malheur de la guerre a fait irruption.
A 16 ans, la classe d’âge de Jürgen est mobilisée dans la défense anti-aérienne. « Nous étudions le jour. La nuit, nous montions la garde auprès des canons, attendant la venue de la Royal Air Force. Ils ne venaient pas. Et puis ils vinrent. Hambourg fut bombardé pendant une semaine. Ce fut une tempête de feu. J’étais dedans, mais j’ai survécu tandis que beaucoup de mes amis et de mes camarades sont morts. Depuis ce temps là, je me pose la question : Pourquoi ne suis-je pas mort comme eux ? Pourquoi suis-je vivant ? »
Mobilisé ensuite dans la Wehrmacht, il parvient à se rendre. Pendant trois ans et demi, il vit enfermé dans des camps de prisonniers, en Belgique, en Ecosse, en Angleterre. « Dans ces années de désespoir, j’ai trouvé la foi dans une communauté chrétienne et l’espérance qui dépasse tout. Je suis devenu chrétien, essayant de comprendre le mystère de ma survie, de ma vie et je suis devenu théologien ». « Lorsque je fus relâché du camp de prisonnier, ce fut une libération et j’étais dans la joie ». Ainsi, c’est à partir des questions posées par la souffrance et le mystère de la vie que Jürgen Moltmann a commencé sa recherche théologique.
Théologie
La troisième séquence porte sur l’oeuvre théologique de Jürgen Moltmann. Elle s’appuie sur de bons connaisseurs, entre autres : Miroslav Volf (Universty of Yale), Richard Bauckam (University of St Andrews) et Michael Welker (Heidelberg University). Elle est ponctuée par des paroles de Moltmann. Elle commence par une mise en perspective des œuvres fondatrices : Théologie de l’espérance, Dieu crucifié, L’Eglise dans la puissance de l’Esprit. C’est toute l’originalité de l’œuvre de Moltmann qui apparaît.
Les premières œuvres
Jûrgen Moltmann : « After Auschwitz, the word of God is different from before. Theology is related to the life and death expérience of people » : « Aprés Auschwitz, la parole de Dieu n’est plus comme auparavant. La théologie est reliée avec l’expérience de la vie et de la mort des gens ».
Miroslav Volf : « Il parle de son engagement personnel dans la foi et a été capable d’articuler la foi avec la vie, personnelle et structurelle, économique et politique ».
Richard Bauckam : « Ce qui a touché Moltmann chez les chrétiens écossais qu’il a rencontré lors de sa captivité, a été leur sens du pardon. Il a été profondément influencé par la manière dont ils se sont comportés envers lui. Et les deux thèmes qu’il identifie comme venant de cette expérience, le premier d’entre eux : la souffrance naturellement, et aussi l’espoir dans la souffrance, l’ont mené à son premier grand livre : « la théologie de l’espérance ».
Moltmann enchaine en nous disant le contexte dynamique dans lequel ce livre a été écrit : Martin Luther King, John Kennedy, le socialisme à visage humain, le Concile Vatican II (6).
Moltmann : « A cette époque, nous nous sommes tournés vers l’autre facette pour montrer comment le Royaume de Dieu, dans la nouvelle création, pouvait nous influencer ici-même ».
Miroslav Volf : « Je pense que la vision de la promesse a été fondamentale dans la théologie de l’espérance. La théologie de l’espérance est fondée sur une conviction fondamentale, celle que le futur vient vers nous, non pas parce que le passé et le présent engendrent le futur, mais plutôt parce qu’il y a une possibilité de quelque chose de nouveau qui ne peut pas être simplement extrapolé de la condition dans laquelle nous sommes maintenant. C’est une idée très importante qui provient de la résurrection de Christ.
Autant que je puisse le comprendre, la théologie de l’espérance a été initiée par une conversation avec Ernst Bloch.
Moltmann : « Ernst Bloch et Franz Rosenschweig, le penseur juif qui a écrit « l’Etoile de la rédemption », nous apportent un trésor de bonnes idées théologiques. Ernst Bloch m’a encouragé dans la théologie de l’espérance ».
Richard Bauckam : « Le livre de Moltmann nous entraine vers une orientation eschatologique de la théologie. La première théologie de Moltmann a exercé une influence majeure sur le monde théologique et au delà sur le monde chrétien. Cela a été son orientation vers une espérance tournée vers le futur.
L’autre côté de la pièce, l’autre versant de son expérience l’ont mené vers son deuxième livre majeur : « Dieu crucifié ». La manière dont il a ressenti le compagnonnage de Jésus dans sa souffrance durant sa captivité, l’a conduit vers le Dieu crucifié, voyant Jésus comme le Dieu crucifié en solidarité avec tous ceux qui souffrent. Tels ont été les deux thèmes majeurs de sa théologie originelle. On ne peut envisager sa théologie en dehors de ces deux thèmes ».
Miroslav Volf : « Ce que j’ai appris du Dieu crucifié, c’est sa considération pour les victimes. La théologie générale a toujours envisagé la croix en quelque sorte comme une consolation (« solace ») par rapport aux diverses afflictions dont nous faisons l’expérience, Moltmann a élevé cette tonalité à un plus haut niveau lorsqu’il parle d’un Dieu souffrant. Ainsi la souffrance de l’histoire est portée dans l’esprit même de Dieu. Je pense que c’est une conséquence de la conception trinitaire de Dieu et de l’amour radical de Dieu tel qu’il s’engage dans le monde ».
Moltmann : « J’ai envisagé la croix de Luther en parlant de Dieu comme une victime du pouvoir, de la violence et de l’injustice. Nous voyons dans la crucifixion du Christ le pouvoir du mal dans le monde. En Dieu crucifié, nous voyons l’amour, la patience et l’endurance de Dieu ».
Miroslav Volf : « Moltmann a suivi les évènements centraux de la dernière semaine de la vie du Christ et du commencement de l’Eglise. Ainsi la théologie de l’espérance est connectée avec la résurrection et a été suivie par ce qui a précédé la résurrection, c’est-à- dire : Dieu crucifié et ensuite par la Pentecôte : l’Eglise dans la puissance du Saint Esprit. Ainsi il y a une étroite cohérence entre les trois livres ».
Moltmann : « Le Saint Esprit dans la création et le Saint Esprit dans la vie et la voie de Jésus, le Saint Esprit est l’Esprit de vie. Le Saint Esprit pousse chaque chose à la perfection dans la nouvelle création ».
Une nouvelle approche théologique
Cet entretien sur les premières œuvres de Moltmann est suivi par diverses interventions qui mettent en évidence l’originalité de la nouvelle approche théologique de Moltmann.
Prof Ulrich Herrman : Les théologiens académiques sont souvent des savants de la religion. Jürgen Moltmann est un théologien qui parle de Dieu. C’est quelque chose de particulier, même dans la théologie protestante. C’est pourquoi il occupe une position spéciale.
Prof Hong Tsin Lin (Graduate school of theology Taïwan). Hong Tsin Lin remarque combien Moltmann ne s’en tient pas à la lecture de ses cours. Il improvise. Suivre son enseignement, ce n’est pas seulement apprendre à connaître Dieu, mais aussi à connaître tout ce que Dieu a créé, connaître les gens, connaître les origines du monde.
Miroslav Volf : La théologie est l’intelligence de la foi. La foi n’est pas un catalogue de croyances auxquelles nous adhérons contre toute évidence. En fait, la foi est un acte existentiel engageant l’existence entière à vivre dans la lumière de qui est Dieu et avec la présence de Dieu dans nos vies. La vie des théologiens accompagne ce que les théologiens expriment.
Prof Xu Zhang (University of China). Dans la seconde moitié du XXè siècle, la théologie de Moltmann a inspiré la théologie de la libération, la théologie Minjung, la théologie coréenne, la théologie du Sud Est et de Taïwan
Michael Welker : Il est l’un des plus grands théologiens du XXè siècle parmi les grands noms de Karl Barth, Bonhoeffer et Tillich. Il a développé une théologie tournée vers le fond et non pas seulement sur la méthode. Et il a une merveilleuse intuition pour voir quels sont les contenus théologiques les plus utiles pour nos contemporains.
Prof Xu Hong Song (Minzu University of China) : Parmi les idées des années 1982, il a manifesté une vitalité et une créativité extraordinaire. Il a porté attention à de nombreux problèmes du monde occidental et au delà de l’humanité : problèmes de l’économie, de l’écologie, de l’oppression de la femme. Il a abordé ces problèmes en théologien avec sa sagesse pour monter la pertinence de la réflexion théologique.
Miroslav Volf : Moltmann a compris l’importance des émotions et la prend en compte dans sa théologie.
Prof Bin Yu (Minzu University of China) : Dans sa vision, il embrasse le progrès de l’humanité.
Prof Xu Hong Xong : la beauté du langage et des formes de sa théologie… seulement ceux qui ont une grande passion peuvent écrire ainsi.
Moltmann : « Le royaume de Dieu est si fascinant lorsqu’on considère le futur de l’histoire humaine et de l’histoire naturelle. Autrement nous voyons une catastrophe apocalyptique. Le Royaume de Dieu est un oui à ce monde et à la vie de ce monde.
Miroslav Volf : Moltmann proclame une théologie de solidarité avec les victimes, mais aussi une bonne nouvelle de guérison pour ceux qui persécutent. C’est l’amour inconditionnel de Dieu.
En cette fin de séquence, le professeur Klaus Dietz évoque l’audience internationale de Moltmann. A travers le monde, il y a 450 thèses de doctorat portant sur son œuvre.
Moltmann : La vie doit être aimée et vécue en dépit du danger et des catastrophes. En regardant le futur, nous devons dire oui à la vie.
Chine
La théologie de Moltmann a eu et a un retentissement mondial. Son accueil en Chine témoigne de cette dimension universelle. Et ce sont des théologiens chinois qui nous font le cadeau de ce film sur la vie et l’œuvre de Moltmann. La quatrième séquence est consacrée à la réception de Moltmann en Chine.
Miroslav Volf rapporte un événement particulièrement significatif. Il a participé avec Jürgen Moltmann à un grand forum à Pékin en 2010. Moltmann était un des principaux orateurs et c’est lui qui était appelé à délivrer la conférence plénière. Il y avait près de 3000 personnes. La plupart d’entre elles n’était ni des théologiens, ni des chrétiens. Moltmann a fait un exposé où on pouvait reconnaître tous les aspects importants de sa théologie chrétienne. Quand il eut fini, tout le monde se leva et il y eut une « standing ovation ». « Les gens étaient excités et j’ai trouvé cela absolument stupéfiant ».
Dans cette séquence, plusieurs théologiens chinois marquent leur vif intérêt pour la théologie de Moltmann.
Ainsi le professeur Huilin Yang (University of China) nous montre en quoi et comment la théologie de Moltmann est importante en Chine. C’est une théologie décentrée, ouverte. Jürgen Moltmann développe une théologie écologique. Il y a une idée originale dans la théologie écologique de Moltmann. C’est aussi une théologie politique. Il s’agit de traiter justement les gens. Et cette attitude vaut dans la relation avec l’humain et la nature. Moltmann est un si grand penseur qu’il peut nous encourager à espérer dans l’avenir. Pour réfléchir ensemble, il est bon d’avoir un background en commun, une expérience commune. Ce peut être un événement traumatique. Pour Moltmann, c’est la guerre 1939-1945. Pour la génération de Huilin Yang, c’est la révolution culturelle. Ce traumatisme a engendré en retour le développement d’une pensée indépendante. Il y a des cadres imposés. Huilin Yang cite le philosophe français Alain Badiou. « Nous sommes obligés de penser ».
Dans ce paysage, il y a une longue relation de collaboration entre Moltmann et l’« Institute of sino-christian studies » . Avant même que l’Institut soit créé, cette collaboration était en route. Le premier livre traduit fut « Dieu crucifié » en 1994. La « théologie de l’espérance » fut célèbre à Hong Kong dans les années 1980. Un théologien, Milton Wan Wai-Yiu, nous rapporte comment ayant étudié la philosophie allemande en Grande-Bretagne, il a pu introduire la théologie de Moltmann à Hong Kong à travers des publications et des enseignements.
David Yeung Hee Nam, directeur de l’Institut des études sino-chrétiennes nous rapporte une longue et fructueuse collaboration avec Moltmann : il a étudié le Tao Te Ching (10), le livre de Lao Tseu, durant ces dernières années en essayant de prendre en compte les ressources du Tao Te Ching dans sa réflexion pédagogiques.
Jürgen Moltmann s’exprime à ce sujet en parlant du voisinage entre le Tao Te ching et la Bible : « J’ai donné une conférence à Taïwan. J’ai supervisé des recherches en ce domaine. Avec la compréhension du Tao Te Ching et la compréhension biblique de la création, je vois que les dirigeants doivent servir. Compassion et patience sont des vertus majeures ». La collaboration entre Moltmann et l’Institut des études sino-chrétiennes date de plus de vingt ans. « Il a beaucoup soutenu notre mouvement ». De nouveaux talents apparaissent.
Amitié
Ce film s’achève par une séquence sur l’amitié. Jürgen Moltmann a écrit de très belles pages sur l’amitié (5). Et on voit dans cette séquence combien l’amitié a été une trame de sa vie inspirant ses relations en tous domaines, et notamment dans sa vie professionnelle. Ce film commence par le thème de l’amour et s’achève par le thème de l’amitié.
Jürgen Moltmann : « Je crois à l’amitié entre les hommes et les femmes dans le mariage, entre les professeurs et les étudiants, entre les peuples du monde ».
Michael Welker rapporte sa relation d’amitié avec Jürgen Moltmann. Il a commencé ses études à Heidelberg, et puis admirant la « théologie de l’espérance » de Moltmann, il l’a rejoint comme jeune assistant. Il raconte comment Jürgen Moltmann a eu immédiatement avec lui une relation de dialogue et de partage, se fiant à lui, par exemple, pour la relecture de ses livres : « Nos relations ont été très libres sans aucune volonté de supériorité de la part de Moltmann. Cela a été une relation d’encouragement mutuel et d’amitié mutuelle ». Ainsi Michael Welker est bien placé pour nous parler de Jürgen Moltmann aujourd’hui : « Il est jeune de cœur, jeune d’esprit. C’est un brillant théologien, mais c’est aussi un être humain merveilleux ».
Très présent dans ce film, Miroslav Volf a aussi une relation profonde d’amitié avec Moltmann : « Jürgen Moltmann est le plus important partenaire en conversation que j’ai eu en développant ma propre théologie. Son œuvre sur la Trinité a été particulièrement importante pour moi, notamment dans son rapport avec le Dieu crucifié. Il m’a influencé, mais je pense que son influence a été très, très, significative au niveau de sa manière de faire de la théologie. Il est toujours concret, mais il recherche aussi les enjeux qui touchent les gens aujourd’hui et qui concernent des problèmes contemporains. Et il apporte la lumière de l’Evangile. Jürgen a été pour moi un père intellectuel… »
D’autres témoignages apparaissent comme celle de sa secrétaire encouragée dans son potentiel. Et on est ému par le témoignage de ses quatre filles.
Alors, on peut entendre, en conclusion, cette déclaration de Jürgen Moltmann comme l’expression d’une forte conviction : « Commencer une nouvelle vie, c’est selon Hannah Arendt, avoir la liberté de la commencer, de réaliser la possibilité de quelque chose de nouveau : Apporter la paix dans la guerre, la justice dans la violence, l’amour dans la haine.
Voilà ce qui est essentiel. Il y a un potentiel de créativité en chaque être humain et je désire éveiller cette créativité en toute personne ».
Une expression vivante en devenir
Ce film nous parle de la vie et de l’œuvre de Jürgen Moltmann. Nous y voyons la réception de cette oeuvre à travers les interviews de plusieurs théologiens. L’accent est mis sur les livres qui ont interpellé l’univers théologique dans les années 1960 et 1970 : « Théologie de l’espérance » et « Dieu crucifié ». Pour nous, nous sommes également particulièrement sensibles à ce que nous percevons comme un élargissement de la vision de Moltmann dans les années 1980 et 1990, et notamment les livres : « L’Esprit qui donne la vie » et « Dieu dans la création ». Nous y découvrons l’œuvre de Dieu dans le monde et dans l’humanité. Moltmann est un pionnier de la théologie écologique.
L’œuvre de Moltmann nous paraît immense, un véritable continent. Alors, elle peut être reçue différemment selon les parcours et les sensibilités de chacun. Elle ouvre des pistes nouvelles et diverses. Ainsi peut-on entendre la tonalité de l’écoute chinoise et la participation de Moltmann aux études sino-chrétiennes et son appréciation du Tao Te Ching. Ce film met en évidence l’audience mondiale de la théologie de Moltmann.
Les paroles de Jürgen Moltmann égrenées ici témoignent d’une pensée en marche ouverte à l’avenir. Ainsi, nous ne voyons pas seulement dans ce film une célébration. Nous voulons y voir aussi une expression vivante en devenir.
Ce film nous parle de la vie de Jürgen Moltmann. Sa théologie est étroitement liée à l’expérience, à son expérience et à celle des autres. Ainsi peut-elle faire écho auprès de tous.
Nous voyons dans ce film une expression de bonté, de bienveillance, de respect. C’est l’attitude de Jürgen Moltmann et c’est, d’un bout à l’autre, la manière dont on s’exprime à son sujet. Le film s’ouvre sur le thème de l’amour et s’achève sur le thème de l’amitié. Ainsi, osons nous dire que nous ressentons ce film comme un hymne à l’amour.
Ici, c’est le témoignage d’un théologien dont l’œuvre exprime l’amour de Dieu et la présence de l’Esprit.
Ici, c’est le témoignage d’une communauté vivante qui se reconnaît dans cette inspiration.
Ici, c’est le témoignage d’une équipe chinoise qui a réalisé un film d’une grande délicatesse et d’une grande beauté.
J H
- « Vivre la découverte théologique à l’échelle du monde. L’anniversaire de Jürgen Moltmann célébré en Chine » » : https://vivreetesperer.com/vivre-la-decouverte-theologique-a-lechelle-du-monde/
- « The way of Christ. A documentary of Jürgen Moltmann » https://www.youtube.com/watch?v=23vndWJavAY&fbclid=IwAR1M9j2vUtC9SMveWgNUpVJZyl9RV9KXIjMwF6Wo9zFB7Rn_Pmo0bCi6oQo
- Pour mieux connaître et comprendre la vie et l’œuvre de Jürgen Moltmann, on se reportera à son autobiographie : Jürgen Moltmann. A broad place. An autobiography. SCM Press, 2007 : « Une théologie pour notre temps. L’autobiographie de JürgenMoltmann » https://www.temoins.com/une-theologie-pour-notre-temps-lautobiographie-de-juergen-moltmann/ On pourra voir aussi le blog : « L’Esprit qui donne la vie. Réfléchir et méditer avec Jürgen Moltmann » : https://lire-moltmann.com
- « Par delà la séparation » https://vivreetesperer.com/par-dela-la-separation/
- Un très beau texte sur l’amitié, p 343-348, dans : Jürgen Moltmann. L’Esprit qui donne la vie. Cerf, 1999. Ici : https://vivreetesperer.com/amitie-ouverte/
- « Genèse de la pensée de Jürgen Moltmann » https://vivreetesperer.com/quelle-vision-de-dieu-du-monde-de-lhumanite-en-phase-avec-les-aspirations-et-les-questionnements-de-notre-epoque/
- « Le peuple de la voie », dans : Harvey Cox. The future of faith https://www.temoins.com/quel-horizon-pour-la-foi-chretienne-l-the-future-of-faith-r-par-harvey-cox/
- Jürgen Moltmann. The living God and the fullness of life. World Council of churches, 2016. « Le Dieu vivant et la plénitude de vie » https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/
- « Femmes et hommes en coresponsabilité dans l’Eglise. Dialogue théologique entre Elisabeth Moltmann-Wendel et Jürgen Moltmann » https://www.temoins.com/femmes-et-hommes-en-coresponsabilite-dans-leglise/
- Tao Te Ching sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dao_de_jing
Méditer avec Moltmann

Une vision d’espérance mise à la disposition de tous.
Au fil des années, nous avons pu constater combien la théologie de Jürgen Moltmann répondait aux aspirations et aux questionnements d’un vaste public. Ce recueil : Méditer avec Moltmann (1) s’inscrit dans cette approche. Par son accessibilité, il met la théologie de Moltmann à la portée de tous. Et pour quoi donc? L’avertissement en quatrième de couverture nous le dit :
« Dans l’histoire dont nous faisons l’expérience, il nous est plus facile de désigner le négatif dont nous voulons nous libérer que d’exprimer le positif en vue duquel nous espérons devenir libre. Mais c’est l’expérience d’un avenir plus grand qui nous mène vers des expériences toujours nouvelles ».
Le secret de la force mobilisatrice de la pensée de Moltmann se trouve dans la profondeur des réflexions existentielles qu’il nous propose. Mais, pour que cette force nous rejoigne et nous transforme à notre tour, elle doit être méditée, digérée, expérimentée, confrontée aux joie et aux peines de notre existence. L’incarnation de l’espérance s’inscrira alors dans notre parcours de vie ».
Les textes rassemblés ici (2) proviennent du blog : « L’Esprit qui donne la vie », créé en 2011, pour communiquer la pensée de Moltmann à tous ceux qui sont à la recherche d’un Dieu, communion d’amour et puissance de vie. Il n’est pas anodin que l’éditeur ait, de lui-même choisi comme titre : « Le sourire de Dieu ».
Ce livre nous ouvre à une nouveauté de vie. Dans son adresse aux étudiants de Prétoria, qui introduit le recueil, Jürgen Moltmann déclare : « Celui qui croit au « Dieu vivant », voit le monde non seulement selon la réalité… mais aussi selon les possibilités. « Tout est possible à celui qui croit », parce que « tout est possible avec Dieu » . Toute la réalité est une possibilité réalisée. La possibilité vient en premier, la réalité vient après » (p 13). Ce livre regarde à la promesse de Dieu et nous ouvre un avenir. Dans le témoignage sur lequel s’achève ce recueil, homme de foi et d’action engagé dans de grandes causes humanitaire, Guy Aurenche nous confie une notation personnelle : « En refermant provisoirement ce livre de méditation, me vient l’appétit d’un commencement caché » ( p 156).
Au fil des années, nous avons pu constater combien la théologie de Jürgen Moltmann était libératrice, féconde et éveillait des échos chez des amis de formations et de cultures très différentes. La théologie de Moltmann est un continent. Chacun vient y chercher une réponse à ses questionnements. C’est un dialogue à partager.
J H
- Jean Hassenforder. Méditer avec Moltmann. Le sourire de Dieu. Préface : Discours de Jürgen Moltmann aux étudiants de Pretoria, traduit par David Gonzalez. Postface par Guy Aurenche. Empreinte Temps présent. 2019 (Collection : l’art de méditer dirigé par David Gonzalez).
- Issus du blog : « L’Esprit qui donne la vie », les textes sont entrés ensuite dans un processus d’édition, dans lequel, à notre regret, le référencement initial n’a pas été retranscrit. A ce sujet, on se reportera donc au blog originel : https://lire-moltmann.com
Le New Deal Vert
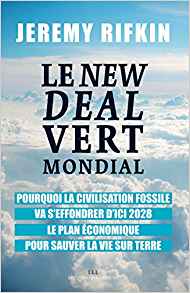 « Un plan économique pour sauver la vie sur terre »
« Un plan économique pour sauver la vie sur terre »
Selon Jeremy Rifkin
La menace du dérèglement climatique est aujourd’hui de plus en plus fortement ressentie. Elle engendre un grand désarroi. En effet, le danger paraît de plus en plus pressant. Alors la crainte commence à grandir. L’horizon se ferme. On envisage le pire. C’est le thème de l’effondrement. Sans aller jusqu’à cette extrémité, l’avenir paraît bien sombre. Cependant, l’alerte est donnée et les forces politiques, économiques et sociales se mobilisent. Quel enjeu ! Le temps presse !.
C’est un problème complexe. Pour l’aborder, il faut envisager l’évolution de notre économie dans son ensemble. C’est ainsi que procède l’approche de Jeremy Rifkin dans son nouveau livre : « Le New Deal Vert mondial » (1). Nous y voyons apparaitre une issue, un chemin.
Jeremy Rifkin n’est pas un inconnu (2). C’est un économiste américain engagé dans la prospective depuis trente ans. Ainsi est-il devenu un conseiller écouté auprès d’autorités politiques ouvertes au changement. Il milite aux Etats-Unis. Il est entendu en Chine. Il est très présent en Europe.
La troisième révolution industrielle.
En 2012, il publie un livre intitulé : « La Troisième Révolution Industrielle » (3). A l’époque, on commence à sortir de la crise économique qui a éclaté aux Etats-Unis et a bouleversé l’économie mondiale. Ce choc a entrainé un grand désarroi. Or, dans ce livre, Jeremy Rifkinnous apporte une vision d’ensemble qui éclaire le phénomène et ouvre un horizon. En nous y reportant, nous y voyons déjà une anticipation de la crise écologique actuelle et le début d’une réponse. En effet, Jeremy Rifkin analyse le phénomène en terme de révolution industrielle. Succédant à la grande émergence du XIXè siècle, une seconde révolution industrielle apparaît au XXè siècle.
Dans la seconde moitié de ce siècle, « la conjonction de l’électricité centralisée, de l’ère du pétrole, de l’automobile et des banlieues pavillonnaires a d’abord suscité un grand essor économique qui a pris fin dans les années 80 ». Cet essor s’est ralenti. On s’est appuyé alors sur l’épargne accumulée dans les décennies prospères et sur des pratiques de crédit facile. Cette ressource s’est épuisée et la crise a éclaté. Cette crise est issue de la décélération de la deuxième révolution industrielle. Poussé à l’excès, le mariage du pétrole abondant et de l’automobile a entrainé une hausse du prix du pétrole qui a provoqué un effondrement financier.
A ce stade, Jeremy Rifkin peut ajouter : « La facture entropique des première et deuxième révolutions industrielles arrive à échéance. Les conséquences de la quantité de dioxyde de carbone envoyée dans l’atmosphère terrestre se fait maintenant sentir et il en résulte une grave menace de changement climatique ». Ainsi, dès le début de cette décennie, l’auteur prévoit la crise climatique qui s’accélère aujourd’hui. Et, ayant posé le diagnostic, il commence à dessiner un avenir nouveau. « Au cours de mes investigations, j’ai fini par comprendre que les grandes évolutions économiques de l’histoire se produisent quand de nouvelles technologies de communication convergent avec de nouveaux systèmes d’énergie ». Or cette conjonction est en cours aujourd’hui. « Les technologies d’internet et les énergies renouvelables sont en voie de fusionner pour créer une puissante infrastructure nouvelle, celle de la troisième révolution industrielle qui va changer le monde ». Ainsi aujourd’hui, le nouveau livre de Jeremy Rifkin n’apparait pas soudainement. Il prend la relève d’une orientation déjà esquissée en accentuant la composante écologique.
Emergence d’une nouvelle économie : une économie verte numérique
« Les grandes transformations économiques de l’histoire ont un dénominateur commun. Elles reposent sur trois éléments dont chacun interagit avec l’autre pour que le système fonctionne comme un tout : un medium de communication, une source d’énergie, un mécanisme de transport » (p 23). Il se forme ainsi une infrastructure commune. La nouvelle économie du XXIè siècle est en train d’émerger. C’est « une économie verte numérique ». Aujourd’hui, « la communication internet numérique converge avec l’énergie internet numérique renouvelable alimentée par une électricité d’origine solaire et éolienne et l’internet de mobilité et de logistique numérique composé de véhicules autonomes électriques équipés d’une pile à combustible, alimentée par une énergie verte, outre une plateforme IdO ( internet des objets) présente dans le parc immobilier, commercial, résidentiel et industriel, le tout étant destiné à métamorphoser l’économie et la société du XXIè siècle » (p 24).
Toutes les composantes se relient les unes avec les autres. Il en résulte d’énormes avantages économiques. En appelant : « coût marginal de production », le coût de production d’une unité supplémentaire de biens ou de services, une fois que les frais fixes ont été absorbés (p 25), on va observer une baisse considérable de ces coûts. « Dans cette économie verte numérique, le coût marginal de certains biens et services sera proche de zéro ce qui obligera à un changement radical du système capitaliste ». L’auteur nous apporte de nombreux exemples. « la propriété cède le pas à l’accès… Les marges de certains biens et de certains services sont tellement « proches de zéro » que les profits ne sont plus viables… Partout dans le monde, de plus en plus de gens produisent leur propre électricité d’origine solaire et éolienne pour un usage hors réseau et/ou pour la vendre au réseau pour un coût marginal proche de zéro » (p 27).
De même que les deux premières révolutions industrielles ont requis la mise en place de grandes infrastructures, il en va de même pour la nouvelle économie. Et cela vaut dans tous les secteurs : communication, énergie, transports. Dans le court terme, les deux ou trois prochaines décennies, le travail va être considérable. Le développement de ces infrastructures requiert un engagement des pouvoirs publics. « La mise en place de l’IdO – internet de la communication, internet de l’énergie, internet de la logistique – va donner naissance à une dernière vague de travail qui durera une trentaine d’années » (p 31). Par la suite, à moyen et long termes, une quantité croissante de jobs vont migrer du secteur du marché à l’économie sociale et à l’économie de partage (p 31). Le secteur non lucratif est déjà en forte croissance.
Victoire des énergies renouvelables et reflux du CO2
Dans un contexte où la menace climatique se fait de plus en plus pressante, la question n’est pas seulement l’orientation suivie, mais la vitesse du processus. Or, sur ce point, Jeremy Rifkin nous apporte une bonne nouvelle, une nouvelle décisive. Les énergies solaires et éoliennes sont désormais « meilleur marché que les raffineries à gaz, les centrales à charbon et les réacteurs nucléaires les plus efficaces » (p 162). Et cet avantage compétitif va s’accroitre rapidement. « La production d’énergie solaire et éolienne suit une courbe de coût exponentielle nettement descendante, pas loin de la courbe exponentielle qu’a récemment connu l’industrie informatique… En 1977, le coût fixe par watt des cellules photovoltaïques par silicone utilisées pour les panneaux solaires étaient à 76 dollars. Aujourd’hui, il a chuté à moins de 50 centimes de dollar… L’impact des ces énergies vertes est impressionnant » (p 69-70). Plus les énergies renouvelables seront moins couteuses, plus les investissements financiers vont se détourner des énergies fossiles. Et les installations correspondant aux énergies traditionnelles vont se dévaloriser. En perdant de leur valeur, elles deviennent des « actifs bloqués ». L’énergie nucléaire est elle aussi dépassée (p 84).
« La rampe de sortie qui mène d’un système fondé sur les combustibles fossiles à un réseau fondé sur le solaire et l’éolien se manifeste quand ces derniers franchissent un cap de 14 à 16% de pénétration. Le cap a été franchi par l’Union européenne en 2017 » (p 130). Nous approchons ainsi d’un mouvement de bascule. Et tout indique que ce mouvement va intervenir dans les prochaines années. Ce sera un facteur majeur de réduction de CO2. Des analyses financières récentes montrent que l’effondrement de la révolution industrielle fondée sur les combustibles fossiles est imminente. Il pourrait se produire entre 2023 et 2030 puisque ce sont des secteurs essentiels qui se séparent de ces combustibles et qui reposent de plus en plus sur des énergies moins onéreuses, solaires, éoliennes et autres énergies renouvelables et sur les technologies zéro carbone qui les accompagnent (p 17).
Dans la confrontation avec la dérégulation climatique, nous vivons une course contre la montre. Alors la vision du processus en cours nous encourage vivement. « Les forces du marché sont en train de venir à bout de la civilisation des énergies fossiles… Les principales filières de l’économie – TIC/télécommunications, internet, électricité, transports, bâtiment – abandonnent ces combustibles pour investir dans les énergies renouvelables et ouvrent la voie à l’émergence de la troisième révolution industrielle. Certaines études ont fixé la date du point de bascule à 2023, d’autres à 2035. Si l’on compare les différents scénarios et les différentes projections, l’inflexion devrait avoir lieu à mi-chemin et l’effondrement de la civilisation des combustibles fossiles devrait se produire autour de 2028… En l’état, les forces du marché sont plus puissantes que les manœuvre des lobbies… J’ai toujours été critique vis à vis de certains aspects du capitalisme de marché. Sauf que, pour une fois, la disruption est elle que le marché fait figure d’ange gardien de l’humanité » (p 251). Mais cela ne suffira pas. « Construire une civilisation écologique à partir des cendres de la nôtre est une entreprise collective qui implique de mobiliser le capital public, le capital de marché et le capital social à tous les niveaux de gouvernance Elle implique aussi la participation de tout le corps politique » (p 251).
Les forces agissantes pour une économie verte décarbonée
Non seulement Jérémy Rifkin nous montre un processus qui nous amène à une réduction drastique de l’émission de CO2, mais il nous décrit les forces actuellement à l’œuvre pour l’avènement d’une nouvelle économie. Si les autorités politiques commencent à se mobiliser face à l’urgence de la menace climatique, on peut s’inquiéter de la lenteur de cette mobilisation, et pire du déni de certains dirigeants comme le président actuel des Etats-Unis. Expert souvent consulté à l’échelle mondiale, Jeremy Rifkin peut nous apporter un état de la situation. Globalement, celle-ci nous paraît meilleure qu’escomptée. L’Europe est en marche. La Chine réagit avec puissance. Les Etats-Unis sont en retard, handicapés par un président désastreux, mais en action vigoureuse dans certains états et dans certaines villes. « Je sais, pour avoir conseillé des dirigeants de l’Union européenne et de la Chine, que ces deux gouvernements ont adopté des politiques comparables pour réagir au changement climatique. Ils savent qu’ils ont mission de séparer chaque filière et chaque industrie de l’infrastructure de la dernière révolution industrielle pour la rattacher à celle de la troisième révolution industrielle » (p 240). « L’Union européenne est passée d’une longue liste de projets isolés à la volonté explicite d’une transformation économique et sociétale » (p 236). Et aujourd’hui, « la notion de civilisation écologique est au cœur de la politique intérieure de la Chine » (p 242). « La Chine est désormais le premier producteur de technologies solaires et éoliennes efficaces et peu coûteuses qu’elle a commencé à exporter dans le monde entier » (p 137).
Aux Etats-Unis, si le gouvernement fédéral est actuellement immobile, il y a des états et des villes très dynamiques dans ce domaine. 29 états ont adopté une législation nommée RPS (Renewable porfolio standards) qui veut qu’un certain pourcentage d’électricité soit issu d’énergies renouvelables. Certains gouverneurs sont en train de s’organiser pour que 100%de l’électricité soit issue de sources sans carbone (p 263). L’idée d’un New Deal vert gagne du terrain sur le plan politique.
Une nouvelle organisation politique
Jéremy Rifkin met l’accent sur le rôle décisif du marché dans la chute des énergies fossiles et la montée des énergies renouvelables. Mais ensuite il y a nécessité de réaliser de nouvelles infrastructures dans tous les domaines, par exemple dans la circulation de l’énergie. Et, là, les pouvoirs publics ont un rôle majeur et spécifique à jouer. De même que les énergies renouvelables se développent et sont exploitées au niveau local, de même, selon Jeremy Rifkin, la nouvelle économie est en phase avec une gestion décentralisée dans les régions. En Europe, Jeremy Rifkin conseille des expériences régionales, par exemple dans les Hauts-de-France. Ainsi, on n’attend plus des pouvoirs publics une intervention centralisée, mais la mise en place d’infrastructures permettant le développement coordonné de réalisations locales. Le New deal vert « sera centré sur des énergies renouvelables exploitées localement et gérées par des infrastructures régionales connectées entre elles au delà des frontières » (p 261). Ce sera une gestion participatives impliquant des « assemblées de pairs » constituées localement (p 266-267).
Pour une civilisation écologique
Dans ce livre, Jeremy Rifkin témoigne d’un immense savoir économique, sociologique, politique, à l’échelle internationale. Mais, c’est aussi, nous le savons par ailleurs, un homme de conviction qui affirme des valeurs. Ses convictions écologiques datent de loin (4), bien avant que cette question passe au devant de la scène. C’est un homme qui croit en la communauté humaine. Ainsi a-t-il écrit un livre remarquable sur l’empathie (5).
Ainsi, si cet ouvrage sur le New Deal Vert entre dans la technicité des rouages de l’économie, Jeremy Rifkin ne se réduit pas à une froide rationalité. Il participe à notre sensibilité écologique ; ainsi prend-il une distance critique par rapport à une apologie du progrès par Condorcet dans son « Esquisse des progrès de l’esprit humain ». « La vision de Condorcet est devenue emblématique dans ce qu’on appellera l’ère du progrès. Hélas aujourd’hui, nous savons ce qu’elle implique… vu les ravages provoqués par la civilisation des énergies fossiles. Rares sont ceux qui osent parler tout haut d’« ère du progrès » ou de perfectibilité de l’homme. Nous vivons à l’ère de la résilience et l’infrastructure du New Deal vert est conçue pour cette ère… Cette infrastructure implique une subversion de la conscience autant qu’une subversion de l’infrastructure » (p 117).
Le changement requiert une éthique personnelle et une éthique sociale. Ainsi, Jeremy Rifkin lance un « appel en faveur d’une politique des pairs et d’une gouvernance des communaux qui donneront le pouvoir à des communautés prenant en charge leur avenir alors que nous traversons une période très sombre de l’histoire de la terre. » (p 272).
« Nous avons cru que nous étions maitres de notre destin et que la terre était à notre disposition. Nous n’avions pas compris que la facture de l’entropie se paye par tout ce qui attente à la planète. Nous entrons dans une nouvelle ère, un nouveau paysage. L’âge de la résilience nous attend. L’acclimatation à cette nouvelle réalité planétaire est déterminante pour notre futur en tant qu’espèce. Il est temps de prendre conscience de la biosphère. Espérons que nous y arriverons à temps. Voilà le New Deal Vert auquel le crois » (p 272).
Une proposition majeure
La lecture de ce livre nous parait indispensable. C’est un livre majeur, indispensable pour nous situer dans le monde d’aujourd’hui à un moment où la question écologique est devenue centrale. Nous y apprenons à nous situer dans une histoire, à comprendre les processus en cours, et, conscient du péril, à découvrir un nouveau chemin. C’est dire combien ce livre est, à nous tous, nécessaire. Face à la peur, à la violence que celle-ci engendre, aux enfermements idéologiques qu’elle suscite, ce livre ouvre des pistes constructives. Il écarte le fatalisme, le catastrophisme aussi bien que le déni et l’immobilisme. On voit aussi combien l’intelligence permet d’éviter les étroitesses de vue et leurs conséquences. Parce qu’il ouvre l’espoir, ce livre permet et engendre la mobilisation. Aussi, à ce titre, évoquons-nous une parole d’espérance citée par Jürgen Moltmann à la fin d’un chapitre sur les catastrophes (6). C’est l’expression d’un poète allemand Friedrich Holderlin : « Au milieu du danger se développe le salut ».
J H
- Jeremy Rifkin. Le New Deal Vert Mondial. Pourquoi la civilisation fossile va s’effondrer d’ici 2028. Le plan économique pour sauver la vie sur terre. Les liens qui libèrent, 2019 Interview vidéo sur son livre : https://www.youtube.com/watch?v=d49ZHoClJf4
- Parcours de Jeremy Rifkin : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Rifkin
- Jeremy Rifkin. La Troisième Révolution Industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie et le monde. Les Liens qui libèrent, 2012
- Mise en perspective : « Face à la crise : un avenir pour l’économie » : https://vivreetesperer.com/face-a-la-crise-un-avenir-pour-l’economie/
- Dès 1988, Jeremy Rifkin fait se rencontrer des scientifiques du climat et des militants écologistes de 35 pays à Washington pour une première réunion du Réseau mondial sur l’effet de serre (Wikipedia)
- Jeremy Rifkin. Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Vers une civilisation de l’empathie. Les liens qui libèrent. 2010 A propos du livre de Jeremy Rikfin : https://www.temoins.com/vers-une-civilisation-de-lempathie-a-propos-du-livre-de-jeremie-rifkinapports-questionnements-et-enjeux/
- Jürgen Molttmann. De commencements en recommencements. Empreinte Temps présent, 2012 (p 69)
Plusieurs livres à lire parallèlement à ce livre :
Isabelle Delannoy. L’économie symbiotique. Régénérer la planète, l’économie et la société. Préface de Dominique Bourg. Actes Sud, 2017 Un livre essentiel qui, dans son originalité mettant l’accent sur les éco-systèmes du vivant, peut être lu en convergence avec celui-ci. Mise en perspective : « Vers une économie symbiotique » : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
Jean Staune. Les clés du futur. Réinventer ensemble l’économie, la société et la science. Préface de Jacques Attali. Plon, 2015
Mise en perspective : « Comprendre la mutation actuelle de notre société requiert une vision nouvelle du monde » : https://vivreetesperer.com/comprendre-la-mutation-actuelle-de-notre-societe-requiert-une-vision-nouvelle-du-monde/
Thomas L Friedman. Thank you for being late. An optimist’s guide to thriving in the age of accelerations. Penguin Random House, 2015. Mise en perspective : « Un monde en changement accéléré » : https://vivreetesperer.com/un-monde-en-changement-accelere/
Sauver la beauté du monde
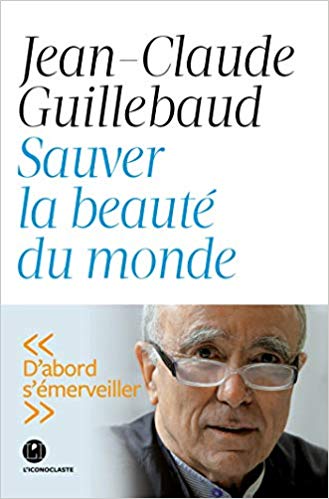 Enthousiasme de la beauté. Enthousiasme de la vie
Enthousiasme de la beauté. Enthousiasme de la vie
Un nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud
« Sauver la bonté du monde » (1), c’est le titre d’un nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud. Nous savons aujourd’hui combien la nature et l’humanité sont conjointement menacées par les désordres engendrés par les excès humains. Le milieu urbain s’est éloigné de la nature. Les équilibres naturels sont déréglés. La pollution défigure les paysages. Allons-nous perdre de vue la beauté de la nature ? Nous les humains, nous participons au monde vivant. Si nous nous reconnaissons dans le mouvement de la création, nous percevons l’harmonie du monde, nous sommes mus et transportés par sa beauté. Alors, oui, si quelque part, cette beauté là est menacée, notre premier devoir, c’est de proclamer combien elle nous est précieuse, indispensable. Ensuite nous pourrons la défendre. C’est dans cet esprit que nous entendons l’appel de Jean-Claude Guillebaud : Sauver la beauté du monde.
Certes, pour sauver la planète du désastre, conjurer la fin du monde, « une énorme machinerie diplomatique et scientifique est au travail » (p 15). Et, on le sait, il est nécessaire d’accélérer le mouvement. Une grande mobilisation est en train de se mettre en route. Cependant, si la peur vient nous avertir, elle n’est pas à même de nous entrainer positivement. Alors, Jean-Claude Guillebaud est à même de nous le rappeler : « Si l’on veut mobiliser les terriens, il faut partir de l’émerveillement. Serait-ce naïf ? Bien sur que non. C’est un Eveil » (p 17). L’émerveillement, ce n’est pas un concept. C’est une expérience. L’auteur sait nous en parler dans un mouvement d’enthousiasme. « Chaque émerveillement me remet debout sur mes jambes, heureux d’être vivant. La beauté fait lever en nous tous une exaltation ravie qui ressemble au bonheur. Et, qu’on ne s’y trompe pas. Beaucoup de savants, parmi les plus grands, ont parlé de ces moments radieux. Oui d’abord s’émerveiller. C’est sur cet émerveillement continuel qu’il fait tabler si l’on veut sauver la beauté du monde… » (p 18-19).
Jean-Claude Guillebaud est bien la personne adéquate pour nous adresser cet appel (2). Dans ses missions de journaliste, correspondant de guerre pour de grands journaux, il connait la face sombre de l’humanité et le poids de la souffrance et de la mort. Résidant, dans sa vie quotidienne au plus près de la nature, dans un village de Charente à Bunzac, il sait se nourrir de la beauté qui transparait de la présence du vivant. Et enfin, éditeur, familier de grands chercheurs, c’est un homme de savoir et il sait traduire cet émerveillement dans les termes d’une pensée construite. A partir de 1995, à travers une série d’essais, face au désarroi contemporain, il a su faire le point en alliant les savoirs issus des sciences humaines et une réflexion humaniste. Effectivement, pour ce faire, il a pu puiser à de très bonnes sources : « Plus j’avance en âge, mieux je comprend ce que je dois à de grandes figures de l’histoire de la pensée : Jacques Ellul, René Girard, Edgar Morin, Cornelius Castoriadis et Maurice Bellet » (p 227). Chez Jean-Claude Guillebaud, la dimension humaniste se joint à une dimension spirituelle. En 2007, il en décrit un mouvement : « Comment je suis redevenu chrétien ».
Dans ce contexte, ce livre de J C Guillebaud nous apparaît comme un témoignage personnel dans une grande diversité de registre. L’auteur rend hommage à la nature, mais pas seulement. Sauver la beauté du monde, c’est aussi reconnaître les grandes œuvres de l’humanité, la puissance de la créativité qui s’y manifeste. Ainsi dans cette dizaine de chapitres, Jean-Claude Guillebaud nous parle des nouveaux moyens de communication au service de la découverte du monde (« Un monde « augmenté »), du mystère de l’art préhistorique (« La beauté inaugurale », du « grand secret des cathédrales ». D’autres chapitres explorent les visages de l’humain.
Les belles personnes
Son expérience de la vie l’amène à consacrer un chapitre sur « les belles personnes ». « C’est un être humain qui irradie je ne sais quelle douceur pacifiée, une trêve dans la grande bagarre de la vie » (p 207). « C’est une disposition de l’âme énigmatique comme la beauté elle-même » (p 208). L’auteur nous en trace des portraits très divers. Face aux cyniques, au déni des autres et de soi-même, Jean-Claude Guillebaud milite pour la reconnaissance des qualités humaines. Et il peut s’appuyer sur une littérature scientifique toute nouvelle. « Plaisir de donner, préférence pour l’aide bénévole, choix productif de la confiance, dispositions empathiques du cerveau, stratégies altruistes et réciprocités coopératives : on découvre dans l’être humain des paramètres qui remettent en cause la vision noire de l’être humain… » (p 217). Il y a là un nouveau paradigme qui nous inspire et que nous mettons en évidence sur ce blog (3).
Les passions humaines
L’auteur se risque à parler des passions humaines. « Un homme sans passions est un roi sans sujets (Vauvenargues). Mais c’est là un sujet ambigu. Il y a bien des passions mauvaises. Le titre du chapitre reconnaît cette disparité : « la dangereuse beauté des passions humaines ». Mais il y a aussi dans la passion une force motrice qui porte de grandes causes pour le plus grand bien. Jean-Claude Guillebaud envisage les passions comme des « écrins » (p 253). Face au calcul et à une excessive prudence, il met en évidence des passions pour le bien. « On ne cite presque jamais certains élans alors qu’ils sont en tous points admirables » (p 254). « La générosité et le souci de l’autre conjugués avec le courage du partage, de toute évidence, composent la plus irremplaçable des passions humaines » (p 239).
Un hymne à la nature.
Cependant, le parcours de ce livre a bien commencé par un hymne à la nature. Et cet hymne peut être entonné parce qu’il est la résultante d’un choix de vie. Au chapitre 2 : « Heureux comme à Bunzac », Jean-Claude Guillebaud nous raconte comment, depuis plusieurs décennies, il a choisi, avec son épouse Catherine, de partager sa vie, chaque semaine, entre Paris (deux jours) et un village de Charente (cinq jours), Bunzac où il s’est installé dans une grande maison familiale. Et il sait nous parler avec enthousiasme de la vie des champs et des bois, des multiples rencontres avec des animaux sauvages sur les petites routes de cette campagne. « Un essayiste assure que tous ces animaux, petits ou grands, représentent la part sauvage de nous-même. L’expression est belle… C’est cette part sauvage que depuis des années, j’essaie de mettre à l’abri, autour de ce que nous appelons avec Catherine, ma femme, la grande Maison devant la forêt » (p 30). C’est le choix d’un genre de vie, où le temps a une autre épaisseur et où l’année est ponctuée par le rythme des saisons. « Mon idée de bonheur est liée à un instant très fugitif du mois d’avril où les lilas s’épanouissent et se fanent en deux semaines. Ce qui m’émeut, c’est l’agencement rigoureux des dates, des floraisons… ».
Sauver la beauté du monde
Sauver la beauté du monde : c’est qu’aujourd’hui elle est menacée. L’avant dernier chapitre intitulé : « Quand la Terre pleure » est introduit par une citation de Thich Nhat Han : « Ce dont nous avons le plus besoin, c’est d’écouter en nous les échos de la Terre qui pleure » (p 261). Les menaces abondent. Parmi elles, Jean-Claude Guillebaud cite l’enlaidissement. Lecteur engagé d’Albert Camus, il raconte comment celui-ci « venu du grand soleil d’Algérie, a découvert avec effroi la laideur des banlieues d’Europe ». Revenu meurtri d’Europe, Albert Camus raconte son retour à Tipisa, un site sur le rivage de la Méditerranée… (p 267). Jean-Claude Guillebaud évoque à ce sujet quelques lignes d’Albert Camus dans « l’Eté » : « Je redécouvrais à Tipisa qu’il fallait garder intactes en soi une fraicheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l’injustice, et retourner au combat avec cette lumière conquise… J’avais toujours su que les ruines de Tipisa étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. Ce recours dernier était aussi le nôtre… Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invincible » (p 268). Visitant ce lieu, Jean-Claude Guillebaud en est impressionné. « Grâce à Camus, j’avais l’impression d’être tenu debout par la beauté du monde. Ou ce qu’il en reste » (p 269).
Face à un « enlaidissement du monde qui s’accélère » (p 270), le chapitre se poursuit par un questionnement de l’auteur sur la manière de remédier aux méfaits du capitalisme. Cependant le problème n’est pas seulement économique, politique et social, il est aussi culturel et spirituel, l’auteur explore cette question éminemment complexe.
Changer de regard
Au terme de ce voyage dans l’espace et dans le temps, Jean-Claude Guillebaud s’emploie à répondre à son questionnement initial. Et si il nous fallait changer de regard et « avoir d’autres yeux ».
« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux » (Marcel Proust) (p 293). « Cette citation », nous dit l’auteur, « m’émeut toujours… Elle signifie, au bout du compte, que la beauté est – aussi – une grâce humaine. C’est elle qui enchante, désenchante et réenchante le monde. Un des proches conseillers de Nicolas Hulot, le philosophe Dominique Bourg, rejoignait Proust quand il affirmait que le seul choix qui nous reste, était de repenser notre manière de voir le monde, c’est à dire d’être au monde » (p 296).
Et « changer notre manière d’être au monde, d’avoir d’autres yeux, implique une révolution intérieure… » (p 296). Appel à une mystique (Pape François), à un nouveau récit personnel (Cyril Dion ). « Yann Arthus Bertrand a cent fois raison quand il dit que la révolution écologique sera spirituelle » (p 297). « Avec le monde en danger, nous devons accéder à une véritable conscience amoureuse », nous dit Jean-Claude Guillebaud, rappelant qu’il avait intitulé le premier chapitre de ce livre : « Une déclaration d’amour à la terre » (p 297). Et ceci implique et induit des changements de comportements face à un consumérisme à tout-va.
En fin de compte, sauver la beauté du monde, c’est aussi la reconnaître, et donc vivre l’émerveillement. C’est un enthousiasme. « Le marquis de Vauvenargue est l’auteur d’un aphorisme : « C’est un grand signe de médiocrité que de louer toujours modérément ». Cette maxime a du faire son chemin au plus profond de moi au point de me constituer. S’émerveiller– du monde, de la vie, des humains – me semble aujourd’hui la moindre des choses » (p 305).
Une dynamique de vie
Le monde est en crise. Devant la menace climatique, le péril est déclaré. C’est dans ce contexte que Jean-Claude Guillebaud écrit ce livre : « Sauver la beauté du monde ». Il y participe aux alarmes et aux interrogations concernant l’avenir de l’humanité. Le trouble est sensible aujourd’hui. Sans boussole, le voyageur se perd. Nous avons besoin de comprendre et d’espérer. Il y a donc lieu de rappeler qu’en 2012, Jean-Claude Guillebaud a écrit un livre intitulé : « Une autre vie est possible. Comment retrouver l’espérance ? » (4). Si le péril nous semble plus grand aujourd’hui qu’hier, il reste que cet ouvrage nous paraît toujours d’actualité. Et, déjà à l’époque, il y avait en France une propension au négatif. « Depuis longtemps, l’optimisme n’est pas tendance. On lui préfère le catastrophisme déclamatoire ou la dérision ». Ce livre nous aide à mesurer « la mutation anthropologique » dans laquelle nous sommes engagés sur plusieurs registres à la fois. Mais, en même temps, des chemins nouveaux commencent à apparaître : « Partant de nous, autour de nous, un monde germe. Un autre monde respire déjà ».
Nous nous retrouvons sur ce blog dans le même esprit. Aujourd’hui, une civilisation écologique commence à germer. Ce sera nécessairement, une civilisation relationnelle. C’est dans ce sens que nous sommes appelés à avancer. Comme l’écrit Jürgen Moltmann, « Sil y a une éthique de crainte pour nous avertir, il y a une éthique d’espérance pour nous libérer » (5). Nous voici en mouvement. « Les sociétés fermées s’enrichissent aux dépens des sociétés à venir. Les sociétés ouvertes sont participatives et elles anticipent. Elles voient leur futur, dans le futur de Dieu, le futur de la vie, le futur de la création éternelle » (6)
Il y a dans ce monde des voix qui anticipent et nous ouvrent un chemin. Parmi elles, on compte Joanne Macy, militante écologiste américaine engagée depuis plus de cinquante ans pour la paix, la justice et la protection de la terre et chercheuse associant plusieurs approches et inspirations. Labor et Fides vient de publier un de ses livres : « L’espérance en mouvement » (7), coécrit avec Chris Johnstone et préfacé par Michel Maxime Egger. Il y a là une démarche qui contribue à baliser le chemin. « L’humanité se trouve à un moment crucial où elle doit faire le choix entre trois manières de donner du sens à l’évolution du monde : le « on fait comme d’habitude », la grande désintégration, ou le « changement de cap ». Cette dernière histoire est « la transition d’une société qui détruit la vie vers une société qui la soutient à travers des relations plus harmonieuses avec tous les êtres, humains et autres qu’humains ». Engagée dans une approche de partage et de formation, Joanne Macy ouvre le champ de vision à travers la gratitude, l’acceptation de la souffrance pour le monde, la reliance… Sur ce blog, on retrouve cette dimension d’ouverture et de mise en relation dans la vision théologique de Jürgen Moltmann (6) et de Richard Rohr (8).
Une intelligence éclairée, multidimensionnelle vient également à notre secours. C’est la démarche de Jérémy Rifkin dans son livre : « Le New Deal Vert mondial » (9) qui nous montre comment l’expansion des énergies renouvelables va réduire la pression du CO2 et contribuer à l’avènement d’une civilisation écologique.
Comme l’a écrit Jean-Claude Guillebaud, « Changer notre manière d’être au monde implique une révolution intérieure », il y a bien un profond mouvement en ce sens. Ainsi, Bertrand Vergely a écrit un livre sur l’émerveillement (10) : « C’est beau de s’émerveiller… Qui s’émerveille n’est pas indifférent. Il est ouvert au monde, à l’humanité, à l’existence. Il rend possible un lien entre eux… Tout part de la beauté. Le monde est beau, l’humanité qui fait effort pour vivre avec courage et dignité est belle, le fond de l’existence qui nous habite est beau… Quand on vit cette beauté, on fait un avec le monde. On expérimente le réel comme tout vivant. On se sent vivre et on s’émerveille de vivre… Beauté du monde, mais aussi beauté des êtres humains, autre émerveillement… Beauté des être humains témoignant d’une beauté autre. Quelque chose nous tient en vie. Une force de vie, la force de la vie. Une force venue d’un désir de vie originel. Personne ne vivrait si cette force n’existait pas. Cela donne du sens à Dieu, source ineffable de vie… » (p 9-11). Le livre de Jean-Claude Guillebaud nous dit comment on peut vivre cet émerveillement dans la vie d’aujourd’hui. C’est un hymne à la beauté. Il ya chez lui, un enthousiasme, enthousiasme de la beauté, enthousiasme de la vie. Et, par là, comme l’écrit Bertrand Vergely, il y a une force qui s’exprime. Dans un contexte anxiogène, Jean-Claude Guillebaud nous permet de respirer. Il ouvre un espace où nous engager avec lui, dans une dynamique de vie et d’espérance.
J H
- Jean-Claude Guillebaud. Sauver la beauté du monde. L’Iconoclaste, 2019-10-13
- Biographie et bibliographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Guillebaud
- « Empathie et bienveillance : révolution ou effet de mode ? » : https://vivreetesperer.com/empathie-et-bienveillance-revolution-ou-effet-de-mode/
- Jean-Claude Guillebaud. Une autre vie est possible. Choisir l’espérance. L’Iconoclaste, 2012 « Quel avenir pour le monde et pour la France ? » : https://vivreetesperer.com/2012/10/
- « Agir et espérer. Espérer et agir » : https://vivreetesperer.com/agir-et-esperer-esperer-et-agir/
- « Le Dieu vivant et la plénitude de vie. Eclairages apportés par la pensée de Jürgen Moltmann » : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie/
- Joanna Macy et Chris Johnstone. Préface de Michel Maxime Egger. L’espérance en mouvement. Labor et Fides, 2018Une vidéo de Michel Maxime Egger présente la formation mise en œuvre par Joanna Macy : le travail qui relie : https://www.youtube.com/watch?v=CRk5dpvoUDQ
- Reconnaître et vivre la présence d’un Dieu relationnel. Extraits du livre de Richard Rohr : « The divine dance » : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-et-vivre-la-presence-dun-dieu-relationnel/
- Jeremie Rifkin. « Le New Deal Vert mondial ». Pourquoi la civilisation fossile va s’effondrer d’ici 2028. Le plan économique pour sauver la vie sur la terre. Les liens qui libèrent, 2019
- Bertrand Vergely. Retour à l’émerveillement. Albin Michel, 2010 (Format de poche : 2017). « Le miracle de l’existence » : https://vivreetesperer.com/le-miracle-de-lexistence/
Une grande manifestation pour le climat à Montréal
 Tous mes enfants et petits-enfants ont participé à la marche pour le climat le vendredi 27 septembre, la majorité d’entre nous à Montréal, mais aussi à Sherbrooke, en Estrie. J’y étais avec ma femme, Alice. Malgré la solennité que provoque le sujet du climat, l’esprit qui régnait en était un de bonne humeur, de fraternité et de solidarité sous un soleil radieux. Voici quelques-unes de mes premières réflexions.
Tous mes enfants et petits-enfants ont participé à la marche pour le climat le vendredi 27 septembre, la majorité d’entre nous à Montréal, mais aussi à Sherbrooke, en Estrie. J’y étais avec ma femme, Alice. Malgré la solennité que provoque le sujet du climat, l’esprit qui régnait en était un de bonne humeur, de fraternité et de solidarité sous un soleil radieux. Voici quelques-unes de mes premières réflexions.
En tout premier lieu, il s’agit vraisemblablement de la plus grande manifestation dans l’histoire du Québec, et peut-être même du Canada. La foule étant estimée à 500 000, le huitième des citoyens du Grand Montréal y aurait participé ! La majorité des marcheurs étaient jeunes, mais il y eut aussi de nombreuses familles ainsi que des grands-parents soucieux de l’avenir laissez en héritage à leur descendance. C’est ici la source de l’espérance que ce mouvement international semble susciter, ici comme ailleurs dans le monde. Ce sont des jeunes qui, à l’instar de Greta Thunberg qui était présente avec nous, prennent conscience de la réalité troublante et précaire du monde et qui, sans attendre, cherchent à prendre en main et à se porter responsable pour la santé de la terre. Non seulement revendiquent-ils des changements auprès des gouvernements et des grandes entreprises, mais plusieurs assument de nouvelles disciplines personnelles en ce qui concerne leurs propres habitudes de consommation (notre plus jeune et sa petite famille ne remplisse qu’un pot en verre de déchets aux deux mois). Le plein potentiel de la créativité humaine n’est qu’à ses débuts pour ce qui est de la recherche scientifique et économique et de la mise en application par la volonté politique et entrepreneuriale de cette nouvelle génération.
En termes théologiques, l’image de Dieu au cœur de l’humanité se concrétise dans sa relation à la terre que Dieu a soumise à la gouvernance, l’intendance et l’administration des êtres humains (Gn 1,28). Les responsabilités transmises à l’Adam sont celles de cultiver et de garder le jardin (Gn 2,15), et de nommer les animaux qui y habite (Gn 2,20). Il lui est aussi défendu d’en abuser (Gn 2,17). La rédemption holistique (qui comprend toutes les relations possibles aux êtres humains : avec Dieu, avec soi, avec son prochain et avec la nature) et cosmique (la réconciliation universelle des cieux et de la terre) promue par Paul a aussi trait à la relation des hommes régénérés, les « fils de Dieu », avec la terre (Rm 8,19-23), sans parler de la vision apocalyptique de Jean qui se termine avec la promesse d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre (Ap 21-22). L’Église qui émerge aujourd’hui ne peut outrepasser la dimension écologique de son message. Elle doit chercher et trouver sa place et sa voix au sein de ce mouvement qui est aujourd’hui irréversible.
Le combat pour la planète est pourtant loin d’être gagné. Changer les mentalités et les comportements de la majorité de l’humanité est une énorme et presque irréalisable tâche. Sans la participation de la masse critique nécessaire d’êtres humains, de gouvernements et d’entreprises engagés dans une volonté commune de transformation du monde, nous courrons tous vers notre perte. Cette transformation se veut spirituelle, morale et pragmatique. Comme point de départ, je propose que nous renoncions tous à voir la vie comme une possession, mais plutôt comme ce qu’elle est vraiment, un don, autant par sa beauté que par sa bonté, qui nous a été légué. « Ce pourrait être le début d’une nouvelle façon de gouverner, d’une toute nouvelle économie, fondée sur la reconnaissance, le contentement, le partage et, encore mieux, le don de soi. Il est encore temps d’espérer. »
Pierre LeBel
Qui est Pierre LeBel ? Une interview de Pierre LeBel sur le site de Témoins (2012)
Libérer le potentiel du jeune enfant dans un environnement relationnel
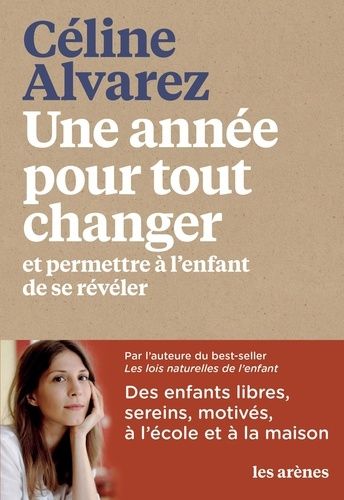 Une année pour changer l’école
Une année pour changer l’école
Avec Céline Alvarez
« Après une expérience pilote dans une zone d’éducation prioritaire en France, Céline Alvarez a été invitée par la ministre belge de l’Enseignement à accompagner 750 enseignants pendant une année scolaire. Ils ont réaménagé leur classe, trié les activités et individualisé la transmission, et ce, sans moyens supplémentaires. En quelques semaines, les enfants sont devenus autonomes, confiants et sereins. Dès la maternelle, ils sont entrés spontanément dans la lecture ». Cette notice, en quatrième de couverture, décrit brièvement l’expérience relatée dans un livre, au titre énigmatique au premier abord : « Une année pour tout changer et permettre à l’enfant de se révéler » (1). Et la notice se poursuit en ouvrant l’horizon : « Ce livre montre que nous pouvons susciter un changement à grande échelle, basculer de l’ennui à la motivation, de l’indiscipline au calme, du manque de persévérance à la créativité ». Ainsi la confiance peut s’affirmer : « Permettre à l’enfant de se révéler, c’est possible. Une année peut tout changer ».
En initiant et en accompagnant cette expérience à grande échelle, Céline Alvarez est effectivement en mesure, à partir d’observations, de dialogues et de témoignages de nous montrer très concrètement les changements qui sont intervenus dans les attitudes et les pratiques, le processus de changement jusque dans le moindre de ses aspects.
Cette expérience n’est pas advenue par hasard. Elle est l’aboutissement d’un parcours de recherche, d’un engagement. Céline Alvarez, munie d’un master de sciences du langage, s’est formée ensuite à la méthode Montessori. En 2009, elle passe le concours de professeur de écoles. Ayant obtenu l’accord du Ministère de l’Education Nationale, de 2011 à 2014, elle réalise une expérimentation pédagogique auprès d’enfants issus d’une zone d’éducation prioritaire dans une école maternelle à Gennevilliers. Elle se fonde sur les travaux scientifiques des docteurs Seguin et Montessori enrichis par l’apport des neurosciences grâce à l’équipe de Stanislas Dehaene. Cette expérience s’avère une grande réussite. Les enfants sont plus autonomes, font preuve de remarquables aptitudes sociales, savent mieux lire. Cependant, après ces trois années d’expérimentation, l’Education Nationale ne renouvelle pas le contrat. Céline Alvarez démissionne et va tirer tous les enseignements de cette expérience en développant des formations et les outils correspondants et en publiant un livre : « Les lois naturelles de l’enfant » (2). Ce livre va répondre aux aspirations et aux questions d’un grand nombre puisqu’il s’est vendu à 220 000 exemplaires. Nous en avons présenté une mise en perspective sur ce blog (3). On lira ce nouvel ouvrage : « Une année pour changer » à l’éclairage du précédent, car il est entièrement centré sur l’expérience qu’il relate, cette fois une expérimentation à grande échelle.
« Dans le cadre de la lutte menée contre le redoublement et l’échec scolaire, Madame Martine Schyns, ministre de l’enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles, m’a sollicitée pour accompagner 750 enseignants volontaires, désireux de transformer leurs pratiques. En Belgique, 4 enfants sur 5 n’ont pas les compétences minimales en lecture à la sortie du CM2. L’accompagnement a pris la forme de 8 journées de rassemblement à Namur. L’objectif était de créer des environnements adaptés au fonctionnement et aux besoins de l’enfant en faisant davantage place aux grands invariants de l’apprentissage tels que l’autonomie, le sens, le challenge, la rencontre et la joie. De cette manière, nous avons pu soutenir le développement de ce que l’on appelle les fonctions exécutives, identifiées par la recherche comme centrales pour l’épanouissement humain » (p 13).
Les fondations de l’intelligence
Ce que des chercheurs, amis de l’enfance, comme Maria Montessori, avaient découvert, il y a un siècle, des recherches en neurosciences le confirment aujourd’hui : l’extraordinaire potentiel du tout petit. Ici, Céline Alvarez s’appuie sur les travaux du « Center on the developing child » de l’Université Harvard. La question éducative se pose en ces termes : ne pas contrarier, ne pas freiner le développement et les apprentissages du tout petit, mais, au contraire, les faciliter et les encourager. « Lorsque l’enfant nait, tout est possible. Il est dépositaire de tous les potentiels humains. Ses circuits sont déjà là, préesquissés. Il est prédisposé à être et à faire tout ce que nous cherchons à lui inculquer : développer un langage élaboré, penser de manière complexe, agir de façon contrôlée, créer, etc, mais il n’est pas déterminé à le faire. Il nait avec ces potentiels, mais ce qui détermine leur développement ou non, c’est nous : notre capacité individuelle, familiale, sociale, institutionnelle , à fournir à l’enfant des environnements appropriés, pensés dans le rapport et le soutien de ses lois universelles de développement » (p 9).
De fait, au départ, il nous faut permettre à l’enfant, de réaliser, par lui-même, les activités de la vie quotidienne qui se présentent à lui. « Si le jeune enfant, dès sa première année de vie, peut s’engager dans des tâches qui mettent son intelligence au défi, le niveau de maitrise de ses compétences exécutives augmentera rapidement entre 3 et 5 ans. L’enfant sera de plus en plus capable de se contrôler, de différer une envie et d’attendre pour parler… il saura prendre du recul, analyser la situation avant d’agir. Il grandira en prenant confiance en lui, en ses capacités » (p 26).
Céline Alvarez met ainsi l’accent sur le développement des « fonctions exécutives » de l’enfant. « Les fonctions exécutives sont des compétences cognitives qui nous permettent d’agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs. Elles regroupent trois compétences : la mémoire de travail (capacité de garder une information en mémoire sur un temps court), le contrôle inhibiteur (capacité à se contrôler, à se concentrer et à inhiber les distractions), la flexibilité cognitive (capacité à détecter ses erreurs, à les corriger, à persévérer et à se montrer créatif) (p 23). Ces compétences exécutives sont « les fondations biologiques » des apprentissages scolaires. « Sans ces comportements, les enfants ne peuvent apprendre ».
Alors, le développement des compétences exécutives a été au cœur de la transformation des pratiques pédagogiques engagée en Belgique. « Lors de l’accompagnement, les enseignants ont été invités à focaliser toute leur réflexion et leurs pratiques sur l’exercice des fonctions exécutives en renforçant les éléments favorables… et, en veillant dans la mesure du possible, à réduire les éléments entravant. Le fonctionnement des classes s’est ainsi peu à peu transformé : les enfants ont été accompagnés individuellement à devenir autonomes au quotidien, et, dans les classes, à choisir eux-mêmes des activités qui les motivent, parmi une sélection ambitieuse et pleine de sens soigneusement réalisée par l’adulte. Les enfants étaient aidés à les mener à leur terme seul ou en tout petit groupe de deux ou trois enfants, à patienter, à s’entraider, à s’exprimer clairement etc » (p 45).
Une année pour tout changer
Si l’accompagnement mis en ouvre par Céline Alvarez a été collectif, elle a également suivi l’évolution sur le terrain dans une relation privilégiée avec 3 enseignantes : Marie, dans une classe de CP ; Vania et Vanessa en deuxième année de maternelle. « Tout au long de l’année, Marie, Vania et Vanessa m’ont accueilli plusieurs journées dans leur classe. J’ai pu ainsi filmer leurs avancées et les retransmettre aux enseignants qui participaient à l’accompagnement au cours des huit journées de partage et de formation. Les séquences filmées dans les classes de Maria, Vania et Vanessa ont alors été au cœur des échanges (p 50). De même, dans le livre, en analysant les différentes étapes du processus, Céline Alvarez s’appuie sur la relation constante qu’elle a entretenue avec Marie, Vania et Vanessa. Elle se réfère à une expérience quotidienne au sein des classes en rapportant les faits significatifs et les expressions des participants. Ce suivi est illustré par de nombreuses photos. Très concrètement, nous sommes introduits au cœur de l’expérimentation.
Et nous voici engagés dans les étapes successives du processus où des priorités s’affichent : Relever le niveau des activités proposées parce que les enfants ont besoin d’aller plus loin ; optimiser l’espace parce que l’espace de la classe habituelle est insuffisant et mal organisé pour répondre au besoin de mobilité ; trier les activités en développant celles qui suscitent la joie des enfants…
Et, au fil des mois, il y a une tâche essentielle : « installer l’autonomie ». Tant individuelle que collective, l’autonomie requiert un apprentissage, mais celui-ci répond aux besoins profonds de l’enfant. Avec empathie et une grande compréhension de l’évolution de l’enfant, Céline Alvarez sait induire cette éducation. Celle-ci a des effets positifs plus généraux encore : « En s’efforçant à faire seuls et à respecter les règles de la classe (y compris l’ordre), continuellement toute la journée, les enfants Le processus traverse des phases différentes. Ainsi Céline Alvarez nous parle de la grâce des premiers jours. C’est la joie des enfants. « Un système rigide, étouffant venait d’être ôté. Ils pouvaient respirer, circuler, bouger, échanger, choisir eux-mêmes leurs activités, et créer un tout autre lien avec leurs enseignants totalement disponibles aux échanges individuels avec chacun d’entre eux « (p 123). Et les parents eux-mêmes constatent que leurs enfants aiment désormais aller à l’école.
Et puis, on s’est rendu compte qu’il fallait traiter en profondeur les vraies problématiques. « Après une première bouffée d’oxygène, l’atmosphère studieuse et apaisée laisse souvent la place au désordre » (p 131). Céline Alvarez nous parle du « désordre fécond des jours suivants ». Alors l’environnement doit se réajuster. Le vrai travail commence : apprendre aux enfants à être autonomes, à patienter, à persévérer, à tenir une conversation…
Dans ce contexte, l’entrée dans la lecture se fait naturellement dès la maternelle : reconnaissance des lettres et des digrammes (ch, ou, etc), association des sons correspondants, composition et reconnaissance des mots, écriture. « Lorsque les enfants lisent avec plus de fluidité, ils s’emparent spontanément des petits albums adaptés à leur âge » (p 226). Et, au CP, nous dit Marie, « j’ai vu des progrès phénoménaux chez la plupart de mes élèves. Ils lisaient des histoires dès le mois de décembre. Dans notre école, ce n’est pas du tout courant ».
Un changement en profondeur
En conclusion, Céline Alvarez rappelle les acquis de l’expérience réalisée à l’école maternelle de Gennevilliers en 2011-2014. « Le passage de l’état de « désordre » à une personnalité sereine, enthousiaste, épanouie, empathique, confiante, mature, semblait être une conséquence, inattendue mais directe, de l’exercice soutenue de la fonction cognitive… Je ne doutais pas que nous puissions, en Belgique, aider les enfants à entrer plus facilement dans les apprentissages scolaires, mais le développement de cette personnalité rayonnante était-il reproductible ? Ce fut la grande surprise de cet accompagnement. Il y a eu chez les enfants une vraie transformation. Ils étaient plus motivés, plus souriants, plus confiants et plus sereins » (p 225). Les témoignages l’expriment abondamment. Celui-ci, en provenance d’une directrice d’école communale est représentatif : « Dans les classes, il y a désormais une place de choix pour tous, que chaque enfant s’est autorisé à prendre sans craindre le regard de l’adulte ou de ses pairs. L’humain a repris sa place. Cette priorité acquise, le champ était libre pour l’épanouissement et des apprentissages de haut vol. Le témoignage des parents est venu confirmer notre ressenti tout au long de l’année. Ils voyaient, eux aussi, à travers ce grand chamboulement, des enfants s’apaiser, être fiers d’eux, devenir autonomes et avoir une soif insatiable d’apprendre » (p 236).
Ainsi, oui, un changement en profondeur est possible. Et, par rapport à nos attentes, c’est une vraie révolution. Cécile Alvarez ouvre un chemin : « Rassemblons nos forces et allons y. Il nous faudra alors changer radicalement de posture, déposer l’habit de l’enseignant et revêtir celui de « soignant », de « réparateur de l’esprit ». Nous ne visons plus en premier l’assimilation de concepts culturels. Nous visons d’abord la réhabilitation des fonctions cognitives supérieures, autrement appelées fonctions exécutives. Nous visons d’abord la créativité, la persévérance, la confiance et l’entraide. Nous visons, avant toute chose, l’épanouissement de la personne, de sa pleine singularité, de sa dignité. Le reste suivra » (p 239).
C’est une nouvelle vision où nous retrouvons des accents montessoriens. « L’âme humaine a ceci de remarquable qu’elle cherche le perfectionnement ardemment. Elle s’épuise, se fane dans la stagnation, le manque de sens, la médiocrité. Elle doit s’élever. Les enfants ressentent instantanément les adultes qui Alors une joie s’éveille. « Quand les enfants se réveillent jusqu’à ce qu’ils reviennent à eux-mêmes, alors la classe devient une symphonie aux tonalités différentes, puissantes, inspirantes. Les changements nous remplissent d’une joie et d’une satisfaction que l’on ne peut imaginer. Je peux essayer de vous la décrire. Je peux essayer de vous en parler. Mais, comme le dit un proverbe chinois : « J’entends et j’oublie. Je vois et je retiens. Je fais et je comprends. « Faites. Vivez-le. Jamais plus vous ne reviendrez en arrière » (p 340).
Un livre important
Ce livre est important. Il montre que l’échec scolaire peut être efficacement combattu. Ce n’est pas un vœu pieux. Ici, c’est une démonstration par l’expérience. La réussite est là. Certes, on entend aujourd’hui des critiques malveillantes (4). Il y en eut déjà à propos de l’expérience de Gennevilliers. La personnalité enthousiaste de Céline Alvarez dérange. Son entreprise s’appuie sur des fondements scientifiques affirmés et des valeurs qui vont de pair. C’est aussi une pédagogie exigeante. Il y a donc des mentalités rétives. Les valeurs portées par cette expériences peuvent susciter des réserves. D’après des données sociologiques, on sait, par exemple, que la confiance interpersonnelle (5) est minoritaire dans la population adulte française. Rien n’est acquis. Mais cette expérience prouve que la réussite est possible là où la vision est active et la motivation présente. Quand on voit le courant de sympathie qui porte la transformation pédagogique engagée par Céline Alvarez, le grand succès de son livre : « Les lois naturelles de l’enfant », on peut se dire que cette transformation répond à une puissante aspiration. Il y a là un terrain favorable pour le développement de cette nouvelle approche éducative. Et nous avons tous à en apprendre…
Ce livre est important également sur un registre plus vaste. Ce livre, comme le précédent du même auteur, est un jalon dans le mouvement historique pour la reconnaissance de la personne enfantine. On sait, que la lumière reconnue par Jésus, chez le jeune enfant (6), a été longtemps méconnue par la suite. Au siècle dernier, des éducateurs se sont levés pour promouvoir le potentiel de l’enfant. Ainsi, dans ce livre, comme dans le précédent, on reconnaît l’état d’esprit qui a animé Maria Montessori qui voyait en l’enfant « un embryon spirituel » (7). C’est le même élan vital qui est reconnu ici.
Les neurosciences confirment aujourd’hui l’immense potentiel du petit enfant. Sur un autre registre, des recherches ont mis en évidence la dimension spirituelle du jeune enfant en terme d’une dynamique relationnelle (8). Dans un livre comme celui-ci, nous voyons se dessiner une conjonction entre science et spiritualité.
En conclusion, nous pouvons reprendre ici l’approche de Céline Alvarez dans son livre précédent : « les lois naturelles de l’enfant ». Céline Alvarez attache une grande importance à la « reliance », l’acte de relier ou de se relier, ou le résultat de cet acte. Lorsqu’une attitude généreuse, chaleureuse, empathique, se manifeste, elle a partout des effets bénéfiques. Et, notamment, elle permet l’expression des tendances empathiques et altruistes des enfants. « Le jeune enfant est un être d’amour… Les enfants sont fondamentalement mus par des élans altruistes, généreux » (p 396). Alors Céline Alvarez ose affirmer : « Le secret, c’est l’amour ». « L’amour n’est pas le premier mot qui vient à l’esprit lorsqu’on aborde le sujet de l’apprentissage et il s’agit là d’une erreur fondamentale. L’amour est le levier de l’âme humaine. Nous sommes câblés pour la rencontre chaleureuse et empathique avec l’autre, et, lorsque nous obéissons à cette grande loi dictée par notre intelligence, alors tout devient possible » (p 392).
Cet état d’esprit, vécu par Céline Alvarez, a participé à la mise en œuvre de l’approche pédagogique qui a entrainé un changement profond dans les écoles belges. Ainsi, comme elle nous le dit : « Le changement radical est possible, il est réel, à portée de la main. Mais il ne se fera pas sans effort. Une véritable révolution intérieure nous est nécessaire » (p 239).
Dans les ombres de notre temps, il y a aussi des évènements lumineux. En voici un.
J H
- Céline Alvarez. Une année pour tout changer et permettre à l’enfant de se révéler. Les Arènes, 2019. A l’occasion de cette parution, Céline a été interviewée plusieurs fois à propos de son livre . Ainsi : https://www.youtube.com/watch?v=bKLsOW4E274
https://www.youtube.com/watch?v=kIZcHEFYUG8
- Céline Alvarez. Les lois naturelles de l’enfant. Les Arènes, 2016
- « Présentation du livre de Céline Alvarez : « Les lois naturelles de l’enfant ». Pour une éducation nouvelle, vague après vague » : https://vivreetesperer.com/pour-une-education-nouvelle-vague-apres-vague/
- En réponse à un article malveillant paru dans Libération, 335 enseignants belges ont immédiatement répondu pour soutenir Céline Alvarez : https://medium.com/@vniacaao/et-si-lon-écoutait-les-enseignants-qui-ont-travaillé-avec-céline-alvarez-334aeb4c0d65
- Des données sur l’état de la confiance interpersonnelle en France (p 53-62) dans :Yann Algan, Elisabeth Beasley, Daniel Cohen, Martial Foucault. Les origines du populisme. Seuil, 2019 Et : « Promouvoir la confiance dans une société de défiance » : https://vivreetesperer.com/promouvoir-la-confiance-dans-une-societe-de-defiance/
- « Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent », déclare Jésus en parlant des jeunes enfants (Marc 10. 13-16)
- Dans son livre : «L’enfant », publié en 1935 et constamment réédité depuis lors, Maria Montessori nous communique sa vision du jeune enfant et de l’éducation qui en découle. A propos de Montessori https://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
- « La vie spirituelle comme une conscience relationnelle : une recherche de David Hay » : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/ « L’enfant, un être spirituel » (D’après le livre de Rebecca Nye. Children’spirituality. What it is and why it matters ? 2009) : https://vivreetesperer.com/lenfant-un-etre-spirituel/
Voir aussi
« Et si nous éduquions nos enfants à la joie ? Pour un printemps de l’éducation ! » : https://vivreetesperer.com/et-si-nous-eduquions-nos-enfants-a-la-joie-pour-un-printemps-de-leducation/
L’écologie nous appelle à regarder vers l’avenir
 L’écologie nous appelle à regarder vers l’avenir
L’écologie nous appelle à regarder vers l’avenir
France vit depuis des années dans une vallée alpine, attentive à la beauté de la création et aux menaces du dérèglement climatique. Elle est consciente des enjeux de notre civilisation. Et si aujourd’hui un souffle nouveau s’élevait ? Quelques paroles ainsi recueillies…
Voici que l’écologie vient réparer les failles humaines du temps et diverses situations et irresponsabilités.
L’avenir occupe à nouveau le temps présent, délivré des instantanéités, sans passé, ni avenir…
En contact avec des jeunes, j’ai constaté que certains étaient focalisés sur le temps présent, sans intérêt pour le passé et sans grand souci de l’avenir. Or la grande question du dérèglement climatique les invite à repenser leur avenir. Seule l’écologie peut leur répondre. La mobilisation actuelle signe leur engagement.
Une civilisation est en marche, retrouvée symboliquement, soit l’écologie soucieuse de l’être : humain, animal, nature…
Une utopie à réaliser qui concerne le Ciel et la Terre, l’Humain et la Création (Le Créateur pour certains)
Autrement dit, prendre le soin de l’Etre (Philon d’Alexandrie)
France
La course pour la terre
Le réchauffement climatique induit aujourd’hui une conscience de l’urgence de la réduction du CO2, dans l’atmosphère c’est à dire une transformation de tout ce qui engendre cette émission, un changement technique, économique et social. De fait, nous prenons conscience que l’écosystème de la vie, notre « planète bleue », sont en en danger. Les données scientifiques se pressent pour nous dire ce danger. Des mobilisations citoyennes se mettent en route.
Cependant, nous savons en même temps que le problème est mondial. Nous sommes tous concernés. L’aveuglement d’un président induit un retard qui nous affecte tous. C’est le cas du président actuel des Etats-Unis. C’est pourquoi nous rapportons ici un article de Thomas Friedman paru dans le New York Times (1). Journaliste dans ce quotidien , Thomas Friedman, au fil des années, est devenu un expert des questions techniques, économiques et sociales à l’échelle du monde. Ses livres successifs nous ont permis de comprendre la transformation accéléré du monde actuel. Nous avons rapporté sur ce blog les analyses et les conclusions de son dernier livre : « Thank you for being late. An optimist’s guide to thriving in the age of accelérations » (2).
Chroniqueur au New York Times (3), Thomas Friedman écrit chaque semaine un article de fond sur la politique internationale (3). Conscient de l’enjeu écologique, il vient d’alerter l’opinion américaine dans un article où il place cet enjeu au cœur de la prochaine élection présidentielle américaine. Ce sujet ne nous paraît pas anecdotique. C’est pourquoi nous croyons bon de rapporter ici son analyse.
Dans une campagne électorale, il y, bien sûr, une diversité dans les questions abordées. Face à l’inconscience du président actuel, Thomas Friedman appelle le pari démocrate à mettre l’enjeu écologique au centre du débat. Il montre combien les décisions qui ont été prises par ce président sont dangereuses et contreproductives au point que cela peut apparaître clairement aux yeux des électeurs ; « Dans les années 1960, John F Kennedy dynamisa le pays dans une « course pour l’espace ». Les démocrates doivent faire campagne contre Donald Trump dans une « course pour la terre » (Earth race)
Le président actuel « a aboli plus de 80 règles et normes protégeant l’air pur, l’eau, le climat, les parcs nationaux.. ». Qui pourrait l’approuver ? « Notre mère terre s’impose dans ce débat ». la mobilisation en cours dans le monde entier commence à s’étendre aux Etats-Unis. La course pour la terre apparaît désormais comme un enjeu central, car il y a là « une opportunité économique, un impératif de la sécurité nationale, un besoin majeur de la santé, une urgence environnementale et une obligation morale ».
« Trump nous parle de rendre sa grandeur à l’Amérique… C’est ridicule puisqu’il ne prête aucune attention à l’industrie automobile et à ses filières d’approvisionnement. Il essaie de forcer la Californie et d’autres états à affaiblir les règles concernant la consommation kilométrique et la pollution si bien que nos entreprises – qui ne réclament même pas ces mesures – pourront fabriquer des gouffres d’essence et ne plus produire de voitures qui réduisent la consommation d’essence aussi bien que ce qui se fait au Japon et aussi en Chine à travers le développement de voitures électriques … La dernière fois où notre industrie s’est laissé aller vers le bas dans le domaine des normes de consommation et de pollution, cela a été catastrophique… Aujourd’hui, il y a 42 grandes entreprises chinoises qui fabriquent et vendent des voitures électriques . En Chine, à Shenzhen, une grande ville de 12 millions d’habitants, 18000 bus électriques circulent aujourd’hui. 99% des taxis fonctionnent avec des batteries électriques »
« Donald Trump nous dit qu’il est probusiness. C’est ridicule parce qu’il essaie de développer l’usage d’un charbon polluant alors que, en beaucoup de lieux, l’énergie éolienne et l’énergie solaire sont maintenant meilleur marché. Le Los Angeles Time rapporte que le prix de l’énergie éolienne a baissé de 50% et celui de l’énergie solaire de 85% depuis 2010. Selon l’agence de recherche Bloomberg NEF, dans les 2/3 du monde, ces énergies sont maintenant meilleur marché que celles issues des nouvelles centrales à charbon ou à gaz ».
Malgré l’aveuglement présidentiel, les Etats-Unis sont cependant déjà en marche. C’est une bonne nouvelle ! Une nouvelle politique ne requiert donc pas un effort démesuré. Elle demande d’encourager et de généraliser ce qui est déjà en route. En effet, il y a déjà 24 états, de la Californie au Nouveau Mexique, qui ont déjà mis en place, à des degrés divers, des normes concernant les voitures, les maisons et les immeubles, des normes en train de progresser. On en mesure déjà l’impact. « A cause de normes comme celles-là, l’usage global des ressources est maintenant en train de diminuer alors que notre économie continue à grandir ». « Il suffirait donc d’inviter l’ensemble des états, les 50 états à imposer des normes dans ce vaste domaine. Alors l’économie de marché produirait des solutions innovantes . Ce serait une explosion d’innovations qui créeraient des milliers de produits nouveaux disponibles aussi pour l’exportation… »
Ce serait une victoire dans la lutte contre le réchauffement climatique à l’échelle mondiale. Thomas Friedman a également écrit, il y a quelques années, un livre de fond sur la question écologique : « Hot, flat and crowded » (4). En regard, notre analyse ne porte ici que sur un article ponctuel. Alors pourquoi lui accorder cette attention ? Dans ses limites, ce texte nous apporte deux informations importantes. Conjoncturellement, une nouvelle politique peut l’emporter. Mais il y a déjà une évolution en cours qui s’avère favorable au changement. Le monde entier commence à bouger. Les Etats-Unis participe à ce processus
J H.
- Thomas l Friedman. It’s the Environment, Stupid ! https://www.nytimes.com/2019/09/24/opinion/democrats-climate-change.html
- Thomas Fridman. Thank you for bring late. An optimist’s guide to thriving in the age of accelerations. Penguin, Allen Lane, 2016 sur ce blog : « Un monde en changement accéléré » : https://vivreetesperer.com/un-monde-en-changement-accelere/
- New York Times. Thomas Frieman « Foreign affairs, globalisation and technology » : https://www.nytimes.com/column/thomas-l-friedman
- Thomas Friedman. Hot, flat and crowded. Why we need a green revolution. And how it can renew America. 2008. https://www.thriftbooks.com/w/hot-flat-and-crowded-why-we-need-a-green-revolution–and-how-it-can-renew-america_thomas-l-friedman/248030/#isbn=0312428928&idiq=3916620
Comment dimension écologique et égalité hommes-femmes vont de pair et appellent une nouvelle vision théologique
 Une approche de Jürgen Moltmann
Une approche de Jürgen Moltmann
La crise actuelle va de pair avec une crise sociale et écologique. De fait, on prend conscience qu’elle révèle l’inadéquation croissante d’un ordre établi de longue date. C’est un changement de civilisation qui s’annonce et se dessine. L’ordre patriarcal ancien est en train de s’affaisser. Or, au cours des derniers siècles, cet ordre avait privilégié un modèle mécanique autour de la fabrication des biens. Aujourd’hui, on prend conscience que ce monde allait de pair avec la conception d’un Dieu éminemment transcendant et dominant. Très tôt, dans les années 1980, Jürgen Moltmann, à travers un livre : « Dieu dans la création » (1), a su analyser cette situation et proposer un traité écologique de la création » . Nous reprenons brièvement ici un aspect éclairant de la prise de conscience qui nous est proposée (2) avec les conséquences libératrices qui en découlent.
La manière de se représenter le monde.
« Le monde , nous dit Jürgen Moltmann, a été perçu à travers un certain nombre de symboles. La pensée biblique, la pensée théologique sont entrées en dialogue avec ces symboles en intégrant certains éléments. Jürgen Moltmann énumère ainsi différents symboles advenus au cours du temps : la mère du monde ; la terre mère ; les symboles de la fête, de la danse, du théâtre, de la musique et du jeu ; le symbole du monde comme ouvrage et comme machine.
Lorsque le monde est conçu comme ouvrage et comme machine, Dieu est envisagé comme un maitre d’ouvrage. « L’imaginaire de ce symbole comprend le monde de l’action, du travail et des œuvres. C’est, avant tout, le monde de l’homme au sens masculin ». « Un enfant surgit dans le ventre de sa mère et est enfanté par elle. Mais l’homme travaille sur quelque chose qui est extérieur et crée une œuvre qui subsiste en dehors de lui. Il connaît la distance qui le sépare de « l’œuvre de ses mains »…Le « monde comme ouvrage divin » reflète, malgré toute la différence, la vision du monde de l’homme travailleur. Là où cette vision s’impose… elle repousse les mythes humains de la mère du monde, de la terre mère et de la fête du ciel et de la terre » (p 387-398). A partir du symbole du monde comme ouvrage divin, se sont développés à l’époque des Lumières, les symboles modernes du monde : le monde comme machine, le monde comme atelier, le monde comme expérience » ( p 398).
Les impasses d’une théologie fondée sur une représentation du monde comme ouvrage et comme machine
A partir d’une analyse historique, Jürgen Moltmann peut mettre en évidence l’impasse où nous a entrainé un monothéisme étroit, une pensée théologique fondée sur une vision du monde comme ouvrage et comme machine. « Au terme d’une longue histoire de la culture et de l’esprit, la vision du monde comme « entente secrète », la métaphysique des puissances vitales, de leurs accords et de leurs désaccords, a été détruite, et cela, d’une part, par le monothéisme, et, d’autre part, par le mécanisme scientifico-technique, par lequel, d’ailleurs, le monothéisme a conquis la place, en désacralisant et en désenchantant la nature. Dieu et la machine ont survécu au monde archaïque et se rencontrent maintenant seuls » (A Gehlen). Si ceci devait être le but du développement, ce serait aussi, en raison de la destruction de la nature, la fin de l’homme » ( p 401). En regard, Moltmann nous propose une autre vision théologique. « La foi chrétienne de la création est la foi messianique en la création. La foi messianique en la création est une connaissance du monde et de l’homme dans la lumière messianique de leur avenir de salut » (p 402). Nous sommes engagés dans « une histoire cosmique inachevée » (p 254).
Les différents symboles du monde énumérés par Moltmann peuvent nous permettre d’y percevoir la présence d’un Dieu immanent. Seul, le symbole du monde comme ouvrage et comme machine, débouche sur une transcendance de Dieu sans partage. « Le monothéisme du Dieu transcendant et la mécanisation du monde suppriment toutes les représentations d’une immanence divine. Avec ce développement , a commencé le démembrement du divin du monde de l’homme. Le déisme a fait de Dieu un Dieu lointain. L’athéisme devait suivre, car il faut que cette machine du monde fonctionne aussi par elle-même sans Dieu » (p 403)
Le déclin du patriarcat
« Une seconde comparaison s’attache aux intérêts et aux expériences humaines qui sont liés à ces symboles du monde. C’est pourquoi on peut reconnaître dans leur histoire le passage du matriarcat des civilisations primitives au patriarcat des civilisations historiques. A l’apparition des symboles patriarcaux du monde est liée la prise de pouvoir et de possession par les hommes » (p 404).
En regard de la domination patriarcale, « est né le messianisme, c’est à dire le messianisme de l’enfant .« En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l’état d’enfant, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux » (Matthieu 18.3). Les visions messianiques de l’avenir surmontent la puissance des symboles archaïque et rendent les hommes libres » (p 405). « Le don messianique de l’Esprit, qui surmontent la primauté religieuse de l’homme ou de la femme, est symbolisé, en christianisme, par le baptême des hommes et des femmes, qui remplacent la circoncision purement masculine d’Israël ». ( p 406).
Vers une civilisation nouvelle : écologie et égalité des genres
Nous assistons aujourd’hui à une transformation profonde de la société qui peut être interprétée en terme d’un mouvement vers une civilisation écologique. La pression des évènements va dans ce sens et les mentalités évoluent en profondeur. Or, au même moment, d’autres changements interviennent. Ainsi se manifeste un mouvement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. On pourrait se demander en quoi ce mouvement a-t-il un lien avec la mobilisation écologique. L’analyse de Moltmann nous apporte une réponse.
« Il paraît raisonnable de chercher à remplacer la vision mécaniste du monde, car c’est image marquée d’une façon unilatérale par le patriarcat. Le passage à une vision écologique du monde fait davantage justice, non seulement aux environnements naturels du monde humain, mais au caractère naturel de ce monde humain lui-même – hommes et femmes. C’est pourquoi il implique de nouvelles formes égalitaires de communauté, dans laquelle la domination patriarcale est abolie et une communauté fraternelle est construite. Les centralisations de la conception mécaniste du monde cèdent le pas à des ententes dans le réseau des relations réciproques… » (p 409).
Une nouvelle expression chrétienne
Un changement de civilisation induit de nouvelles exigences, de nouvelles attentes, de nouvelles aspirations. Il appelle en regard une nouvelle dimension spirituelle. Ici, la reconnaissance du Vivant évoque respect, émerveillement, dépassement. Nous voici en demande d’un renouvellement des pratiques et des représentations religieuses.
Les églises qui s’attarderont dans un style patriarcal, en subiront les conséquences. Cependant, l’enjeu majeur, c’est bien une transformation de la vision théologique. Dès les années 1980, Jürgen Moltmann a esquissé une réponse : une théologie écologique. Son livre : « Dieu dans la création » est présenté en ces termes : « Dans ce traité écologique de la création, Jürgen Moltmann formule, de façon nouvelle, la foi chrétienne en la création de telle sorte que celle-ci ne continue pas à être elle-même un facteur de la crise, mais devienne un facteur de paix avec la nature. Il s’agit d’une doctrine chrétienne de la création, c’est à dire qu’elle prend au sérieux le temps messianique qui a commencé avec Jésus et qui tend vers la libération des hommes, la pacification de la nature et la délivrance de notre environnement à l’égard des puissances du négatif et de la mort. Il s’agit d’une doctrine trinitaire de la création (un Dieu communion). L’insistance sur la création dans l’Esprit et pas seulement par la parole, nous invite à dépasser une conception typiquement moderne de la subjectivité et de la domination mécanique du monde. Ecologie signifie le monde de la « maison » (oikos). Une telle doctrine de la création est une théologie de l’inhabitation de Dieu par son Esprit dans l’ensemble de la création ». Si la récente encyclique du pape François : « Laudato si’ » converge (3), il reste du chemin à faire : reconnaitre et accompagner l’œuvre de l’Esprit dans cette sortie de la civilisation patriarcale, l’entrée dans la dimension écologique, la confrontation avec les menaces assorties au changement, le chemin vers une nouveauté de vie .
J H
- Jürgen Moltmann. Dieu dans la création. Traité écologique de la création . Traduit de l’allemand par Morand Kleiber. Cerf, 1988 (édition originale en 1985). Voir aussi sur le blog : « L’Esprit qui donne la vie » : « Dieu dans la création » : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/ Sur ce blog, la pensée de Jürgen Moltmann est très présente : https://vivreetesperer.com/?s=Moltmann+&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
- L’analyse de la succession des symboles du monde n’est qu’un aspect de l’évolution générale de la manière de concevoir les rapports entre l’homme et la nature dans le contexte de la relation entre science et théologie. Jürgen Moltmann met en évidence l’évolution de la représentation de Dieu depuis la Renaissance : « L’omnipotence est devenu un attribut prééminent de la Divinité… Comme image de Dieu sur terre, l’être humain a été amené à se voir lui-même en correspondance comme maître et seigneur et à s’élever au dessus du monde et à le subjuguer ». https://vivreetesperer.com/vivre-en-harmonie-avec-la-nature/ La remise en cause de cette domination se poursuit aujourd’hui. Ainsi, au « Center for action and contemplation », Richard Rohr rapporte qu’au Moyen Age, l’univers était perçu comme centré autour de l’homme et de la terre. C’était une conception anthropocentrique. Dieu comme le monde était envisagé dans un ordre stable et hiérarchique. Evidemment, notre représentation de l’univers a complètement changé. « Nous ne sommes plus au centre de rien . Nous avons besoin d’une cosmologie et d’une vision du monde entièrement nouvelle » ( 26 août 2019) https://cac.org/a-new-cosmology-2019-08-26/
- « Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François et Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
Voir aussi
« Comment entendre les principes de la vie cosmique pour entrer en harmonie »
https://vivreetesperer.com/comment-entendre-les-principes-de-la-vie-cosmique-pour-entrer-en-harmonie/
« Vers une économie symbiotique »
https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
Une approche spirituelle de l’écologie
Selon Christine Kristof-Lardet

Aujourd’hui, à partir même des changements en cours, nous commençons à comprendre que tout se tient et à voir le vivant et le monde dans leurs interrelations, dans une approche globale, dans une perspective holistique. L’ampleur du changement requis requiert un dépassement. On rencontre ici une approche spirituelle si tant est qu’on puisse la définir, avec David Hay (1), comme « une conscience relationnelle » dans une relation avec les autres et avec soi-même, avec la nature, avec la présence divine… Et, de plus, en se référant à un chercheur anglais, Alister Hardy, le même David Hay perçoit le potentiel spirituel de l’homme comme une faculté qui s’inscrit dans l’évolution des êtres vivants. Si, la transition écologique nous achemine vers une civilisation nouvelle, ce processus requiert une vision spirituelle qui puisse éclairer les acteurs. Cette vision est déjà en cours. Elle est exprimée par des théologiens et par des sages (2). Elle inspire des pratiques nouvelles. On assiste à des émergences et à des convergences. Nous avons besoin de reconnaître ce mouvement et d’en percevoir toutes les dimensions. Comment mobilise-t-il déjà de nombreuses ressources en terme d’initiatives et de communautés ? A ce stade, le récent livre de Christine Kristof-Lardet : « Sur la Terre comme au Ciel » (3), est une contribution particulièrement importante puisqu’elle nous fait connaître « les lieux spirituels engagés en écologie ». « Nombre de communautés spirituelles intègrent aujourd’hui la dimension écologique dans leur mode de vie et leurs structures, puisant à la source de leur sagesse les raisons de leur engagement pour la terre et le vivant. En même temps, elles sont des laboratoires où s’inventent et s’expriment des « possibles » qui peuvent nourrir notre société en quête de sens, de valeurs et de repères. Cette ouverture favorise l’émergence d’une approche spirituelle de l’écologie au sein de laquelle les postures du « méditant » et du « militant » se fécondent mutuellement » (page de couverture).
Approche spirituelle de l’écologie
Christinde Kristof-Lardet nous présente ainsi « une approche spirituelle de l’écologie ». C’est la poursuite d’un cheminement que Christine accomplit depuis une vingtaine d’années. « Ecojournaliste, écrivain, voyageur, militante écologiste à les heures, j’ai vu, pleuré et défendu la beauté de la Terre. Je me suis parfois posée dans des monastères retirés du monde et me suis laissé questionner. Comment, devant tant de splendeur, ne pas avoir le cœur chaviré ? Comment trouver la paix intérieure au sein du chaos que mes reportages me donnaient à voir ? Comment concilier ma quête écologique et ma quête spirituelle ? c’est lors d’une grande rencontre organisée au centre bouddhiste Karma Ling en Savoie que la jonction s’est opérée et que j’ai compris qu’écologie et spiritualité n’étaient en fait qu’une seule et même réalité. Cette prise de conscience a signé le début de mon exploration » (p 9). Dans une inspiration chrétienne et dans une dimension interreligieuse, Christine Kristof Lardet a donc suivi cette voie, la voie d’une convergence entre écologie et spiritualité. Journaliste, spécialiste des questions écologiques, elle est aujourd’hui rédactrice en chef de la revue Présence (4). Dans la continuité d’un travail jadis engagé par le WWF en direction des spiritualités, elle a poursuivi cette tâche en créant avec d’autres personnes de diverses traditions, un « Réseau des écosites sacrés ». « La vocation de ce réseau est de mettre en lumière les initiations écologiques inspirantes au sein des centres spirituels et de favoriser le dialogue entre ces lieux ».
Il s’agit bien de mettre en évidence la montée d’une approche spirituelle de l’écologie. « S’interroger sur les causes profondes de la destruction de la nature et de la crise écologique conduit à comprendre que celles-ci s’enracinent en grande partie dans notre cœur, notre culture et notre façon de « penser le monde ». C’est donc là, dans notre esprit et notre cœur que nous devons aussi chercher les solutions. La perspective de l’effondrement ne relèvent pas de la crise à résoudre ; elle nous appelle à une transformation intérieure qui seule permettra une véritable mutation de notre société… Il nous faut accomplir « un saut quantique » de la conscience. Pour cela, il convient de sortir de la séparation – perçue ou vécue comme telle – entre le monde de l’écologie et celui de la spiritualité. Développer une approche spirituelle de l’écologie, au sein de laquelle la posture du « méditant » vient nourrir celle du « militant » – et inversement – ouvre des perspectives de réconciliation et d’espérance » (p 11).
Un réseau d’écosites sacrés
Nous découvrons à travers ce livre de nombreuses communautés qui s’inscrivent dans des cheminements religieux différents, du christianisme, aux religions orientales et aussi à des spiritualités émergentes et qui, chacune, s’ouvrent à la conscience écologique. On pourrait dire que, d’une certaine manière, leurs pratiques spirituelles les prédisposent à un éveil écologique, mais que c’est justement cet éveil qui engendre une dynamique commune. « L’écologie se pose de façon transversale au cœur des traditions spirituelles et inspire chacun de nous, « habitants de la maison commune », croyants et non croyants confondus : « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous », écrit le pape François dans l’encyclique « Laudato si’ » consacrée à l’écologie. Découvrir quelles sont les visions et les ressources cultivées au sein des centres spirituels, les mettre en lumière et montrer leur pertinence est un des buts de cet ouvrage » (p 11-12). Quelque soient les manques et les dysfonctionnements éventuels, ces communautés participent à une évolution générale. Elles innovent. « Toutes ces communautés, aussi imparfaites soient-elles, peuvent être également vues comme des laboratoires ou s’expérimente en miniature et de manière concentrée tout ce que notre humanité traverse à une plus grande échelle. Ce qui se joue dans notre société, notamment la transition écologique, se joue également en microcosme au sein des centres spirituels. Dans ce sens, il n’est peut-être pas vain d’imaginer que tous les trésors d’amour, de courage et de perspicacité mis en œuvre par ces communautés puissent être profitables au plus grand nombre » (p 12-13).
Ainsi, l’auteure nous introduit ici dans la vie d’une trentaine de communautés à travers « des reportages, réalisés en plusieurs années et actualisés en permanence, pensés dans une perspective de découverte et de partage et témoignages vécus »… Notre posture de base s’inscrit dans une neutralité bienveillante et lucide ». Le lecteur que nous sommes, trouve que cet objectif a été bien rempli. Chaque communauté est l’objet d’une monographie qui nous permet de la situer dans son histoire et d’en découvrir la vie quotidienne dans ses différents aspects. En 200 pages, il y a là un ensemble d’études de cas particulièrement éclairantes.
Nous voici en voyage : Des communautés chrétiennes anciennes ou nouvelles, des communautés de tradition orientale, des « communautés spirituelles intentionnelles »…
Quelques exemples en empruntant un tout petit bout de descriptif :
Le Centre Amma de Pontgoin
« Le Centre Amma de Pontgoin, teinté d’Orient et d’Occident, est tout d’abord un lieu pour vivre les enseignements d’Amma… la sainte indienne qui serre les foules dans ses bras. Il s’inscrit dans la lignée des ashrams indiens par sa philosophie, les rituels et la discipline qui y est pratiquée. En même temps, cet ashram est un écosite qui expérimente et promeut un vivre-ensemble écologique en harmonie avec la nature… Au Centre Amma où l’on s’exerce aussi bien à la méditation, qu’à la permaculture, à la gouvernance partagée ou à l’art du compostage, la pratique spirituelle et l’engagement écologique se nourrissent mutuellement » ( p 21).
L’Arche de Saint-Antoine
« Dans cette ancienne abbaye, lovée au pied du Vercors, s’expérimente, depuis une trentaine d’années, une vie profonde de fraternité et de partage dans l’esprit de Lanza del Vasto, un disciple chrétien de Gandhi, à mi-chemin entre la vie monastique et la vie laïque. Cette communauté se compose aujourd’hui d’une cinquantaine de personnes qui expérimentent un mode de vie simple fondé sur la non-violence et la spiritualité, et sous-tendu par la recherche d’une harmonie avec soi, les autres et la nature. Ces valeurs constituent la trame d’une écologie intégrale qui se décline dans tous les aspects de la vie » (p 39).
Le Village des Pruniers
Fondé au cœur de la Dordogne par le vénérable moine, Thich Nhat Han en 1982, ce centre spirituel incarne le rêve de son fondateur de développer, dans un lieu de nature préservé et nourrissant, une communauté conjuguant la pratique de la pleine conscience et le vivre-ensemble fraternel… Puisant aux fondements de la tradition bouddhiste zen, cette communauté internationale propose aux multiples retraitants d’expérimenter la pratique de la méditation dans ses différentes formes et de vivre un chemin de réconciliation avec soi, avec les autres et avec la Terre » (p 59).
L’écohameau de La Chaux en Côte d’or
« Loin du tout-conformisme comme du tout-confort, Marie et Alexande Sokolovtch posent leur sac en juin 2009 à la ferme de La Chaux en Bourgogne après des années de nomadisme alternatif au service de jeunes démunis. Leur désir : prendre le temps, à la suite de Jésus, de vivre une simplicité volontaire et évangélique dans la cohérence entre engagement social, écologique et spirituel… Les Evangiles, c’est notre base et notre nourriture… Aujourd’hui, trois familles sont installées à La Chaux et forment avec sept enfants et un célibataire, une communauté d’une quinzaine d’habitants fixes. Inspirée des communautés de l’Arche de Lanza del Vasto, le ferme de La Chaux est aujourd’hui un bastion de la sobriété et de la débrouille, mais aussi un lieu où s’expérimente de façon atypique, le partage, l’accueil inconditionnel du prochain et la relation à la terre. Par son mode de vie et sa pratique, la ferme de La Chaux explore les différentes dimensions de l’écologie : la sobriété, l’usage du troc, la relation à la terre avec la réalisation de zones de maraichages ouvertes à tous et des cultures de variétés anciennes de blé en agroforesterie… , le partage et le don » (p 139-140)
Le monastère de Taulignan
« Onze sœurs vivent aujourd’hui dans ce monastère perdu au milieu de la Drome provençale. Elles cultivent des plantes aromatiques servant à créer des huiles essentielles ou des hydrolats dans la distillerie qu’elles ont fait construire en 2014. Cette activité est née de la nécessité de trouver une activité pouvant assurer leur subsistance en accord avec la vie monastique. C’est un parcours écologique qui a été encouragé par le paysan philosophe Pierre Rabbi. Au cœur de leur vie communautaire et de prière, ces pionnières cherchent à explorer entre Terre et Ciel la ligne de crête entre foi et écologie » (p 105).
Le monastère Orthodoxe de Solan dans le Gard
« Le monastère de Solan abrite aujourd’hui 17 moniales de tradition orthodoxe qui vivent principalement de la production de vin et des produits de leurs récoltes au potager ou au verger » . « La rencontre avec l’agroécologiste Pierre Rabbi dans les années 1990 a été décisive ». Elles ont accompli un beau parcours écologique. « Aujourd’hui, elles mettent en pratique ces principes écologiques d’autant plus naturellement qu’elles les vivent aussi de l’intérieur par la prière… la liturgie… une ascèse et l’eucharistie partagée dans une conscience ouverte au cosmos ». « Dans notre tradition, nous n’avons pas la dichotomie habituelle entre le spirituel et le matériel, le Créateur et la Création, entre l’homme et la nature… Nous nous sentons vraiment faire partie de la Création… » (p 136-131)
L’écovillage de Findhorn en Ecosse
« Le rôle de Findhorn depuis sa création a été de démontrer l’expérience pratique de la communion et de la coopération avec la nature fondée sur une vision de la vie et de l’intelligence organisée qui lui est inhérente » ( David Spangler). Au départ, en 1962 ,dans le nord de l’Ecosse, « c’est un groupe de trois adultes et six enfants, poussés par le « destin », qui s’installe sur un terrain de caravaning et qui développe une vie en harmonie avec le divin et la nature. Aujourd’hui, c’est une communauté composée d’environ 600 personnes qui propose un modèle de vie cohérente fondée sur trois principes : la spiritualité (par l’écoute intérieure), le service à autrui (par l’amour en action), et l’écologie globale (par l’intelligence au cœur de la nature) »… « La communauté de Findhorn s’illustre pas sa longévité et son développement exceptionnel… Elle a su conjuguer la spiritualité, la relation à la nature et le service au monde. Ces bases solides ont permis l’émergence de nouveaux paradigmes et de chemins jusque là inexplorés, en particulier la coopération avec l’intelligence de la nature… Dans ce creuset, s’est développée non seulement une conscience forte de l’unité de toutes choses, mais aussi la nécessité d’inscrire notre humanité dans le cercle beaucoup plus vaste de la communauté du vivant, avec laquelle nous partageons une fraternité ontologique » (p 177 et 198).
A travers ces quelques exemples, une grande émergence apparait et des convergences sensibles se manifestent.
A partir de cette recherche, Christine Kristof-Lardet met en évidence un dynamique spirituelle, communautaire, écologique. « Dépositaires de sagesse, ces communautés peuvent contribuer à soutenir et à nourrir l’évolution du monde, sa conversion vers un authentique respect de la planète et de tous les êtres qui l’habitent. Ce n’est que dans une approche globale, écosystémique, transdisciplinaire que nous pouvons répondre aux défis de notre temps » (p 235-236).
Ce livre bien écrit, bien construit rend compte au plus près de la démarche des communautés où la spiritualité et l’écologie s’allient. Il tient bien l’objectif annoncé : être « une ressource qui peut inspirer chacun dans sa quête d’harmonie et ouvrir des perspectives pertinentes pour notre monde en transition » .Comme l’écrit Sabish Kumar : « La transition nous appelle à passer à une vision holistique du monde, où physique et métaphysique, engagement et spiritualité dansent ensemble comme les deux faces d’une même médaille : Transition extérieure et transition intérieure vont de pair » (p 9)
J H
- David Hay. La vie spirituelle comme une conscience relationnelle. La recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui (« Something there. The biology of the human spirit ») : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
- Une vision exprimée par des théologiens et des sages. Ce livre comprend une bibliographie étendue (p 267-273) ; L’auteure note l’influence des spiritualités bouddhiste, hindouistes et plus largement orientales . « Ces spiritualités qui, pour la plupart s’ancrent dans une approche écosystémique et holistique, ont permis d’élargir les perspectives de nos cultures souvent cartésiennes, réductionnistes et largement anthropocentriques… Les résonnances étonnantes entre les textes récents du dalaï-lama autour de la responsabilité universelle par exemple et ceux du pape François dans l’encyclique « Laudato si’» sur l’écologie intégrale, révèlent une complémentarité de points de vue » (p 81), Dans le champ de la théologie chrétienne, Jürgen Moltmann a accompli un travail pionnier puisque son livre : « Dieu dans la création » et avec pour sous-titre : « Traité écologique de la création » est paru au Cerf en 1988. Courte présentation : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/ La pensée théologique de Jürgen Moltmann est très présente sur ce blog : « Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François, Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/ Nous mettons également en évidence le courant écologique outre-Atlantique inspiré par le théologien : Thomas Berry : « Comment entendre les principes de la vie cosmique pour entrer en harmonie » : https://vivreetesperer.com/comment-entendre-les-principes-de-la-vie-cosmique-pour-entrer-en-harmonie/ Dans son « Center for action and contemplation », Richard Rohr développe également une spiritualité écologique. Nous avons rapporté certains de ses thèmes : « L’homme, la nature et Dieu » : https://vivreetesperer.com/lhomme-la-nature-et-dieu/
- Christine Kristof-Lardet. Sur la Terre comme au Ciel. Lieux spirituels engagés en écologie. Labor et Fides, 2019
- Présence. La revue des chercheurs de sens : https://revuepresence-leblog.com
Animer une émission de radio
« Paroles d’écriture » de Michel Bernard
Michel Bernard, anime une émission culturelle dans une radio locale: « Paroles d’écriture » sur la radio: « Agora Cote d’azur »
Nous lui avons posé quelques questions.
- En quoi consiste cette émission: « Paroles d’écriture »? Quelle est en est la finalité?
Cette émission, que j’ai conçue en 2011, et qui a été acceptée immédiatement par Agora Côte d’Azur, est centrée sur les livres et leur auteur. Je dirai, pour être précis, d’abord sur l’auteur, et ensuite sur le livre. La finalité est de donner le désir de lire et de découvrir des auteurs. Je pense qu’au delà le livre, il y a un être humain qui, mieux connu, provoquera le désir de lire ce qu’il écrit.
- Tu as créé cette émission en 2011. Dans quel contexte as-tu rencontré cette radio?
Alors, je prends conscience de l’importance de vulgariser, au sens le plus noble du terme, de sensibiliser, le plus de gens possible à la lecture et à l’écriture. Ma référence, qui reste toujours inscrite dans tous les documents, reste la suivante : c’est une phrase de Louis Lavelle (1883-1951) : « La corruption de la parole et de l’écriture est la marque de toutes les autres corruptions. »
Face à cette citation, je réponds : « La renaissance de la parole et de l’écriture est le témoignage de toutes les autres renaissances «
Dans cet esprit, une émission radio est un média de qualité. Dont l’influence est beaucoup plus grande que nous le pensons. Ainsi, outre les auditeurs régionaux de l’émission, elle est ensuite mise sur mon site, et entendue dans le monde entier par environ 60 000 personnes.
- Quel a été ton parcours de vie? Dans quelle mesure ce parcours t’a préparé à réaliser cette émission?
Un parcours de vie, unique certes, comme chaque parcours de vie. Après l’école primaire, mon père refusant la poursuite de mes études, j’entre en pharmacie et passe mon CAP et mon Brevet Professionnel de préparateur en Pharmacie (équivalent à un B.T.S). Puis après plus de 10 ans de travail, je reprends mes études par correspondance, grâce au C.N.T.E (Centre National de Télé-Enseignement, devenu le C.N.E.D, Centre National d’Enseignement à Distance), pour préparer l’examen d’entrée à l’université. Je réussis. Alors tout en travaillant, je fais des études universitaires dans plusieurs disciplines, puis le doctorat troisième cycle, et le doctorat d’état. Je travaille successivement, comme chargé d’études, puis conseillé professionnel au ministère du travail. Puis directeur adjoint à l’ANPE ( Association Nationale pour l’Emploi), qui se créait alors. Et Bertrand SCHWARTZ me demande de travailler avec lui sur un projet que tout le monde semble avoir oublié : les A.U.R.E.F.A : Association Universitaire Régionale d’Education et de Formation d’Adultes. Mais après 68, ce projet est annulé. Alors j’entre comme maître de conférence associé à l’IUT de Nantes pour créer un département. Ensuite, je deviens professeur et créais 5 DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées). Le dernier, sur la distance, sera créé à Paris II, où je suis affecté. Si alors, j’avais accepté de résider à Paris, ma carrière aurait encore évolué. Mais les évènements de la vie me conduisent vers d’autres décisions. Ce passage par une activité professionnelle avant de devenir universitaire, ainsi que la culture de l’artisan, transmise par mon père, m’ont profondément marqué.
Alors, plus que l’université, j’envisageais l’aménagement du territoire ou le journalisme. Ainsi je peux dire que la conception et la réalisation de cette émission ont mis en valeur des compétences et des valeurs en sommeil.
Comment se réalise le choix des sujets et des personnes interviewées?
Je dispose d’une totale liberté pour le choix des auteurs et des livres. Ainsi, par exemple, j’accueille Edgar Morin, Boris Cyrulnik, Bertrand Vergely, ou des auteurs moins connus, mais de grande qualité, selon moi. A cela j’ajouterai que depuis 2018/2019, je prends un thème annuel. En 2018-2019 : Ce monde où va-t-il? En 2019-2020 : Explorer notre quotidien.
Au fil des années, quelles lignes de force émergent de ce travail?
Je retiendrai plus précisément les trois lignes force suivantes:
1 – La qualité et la disponibilité des personnes que je sollicite. Il en résulte des liens étroits.
2 – De la part des auditeurs, découverte, surprise et encouragement.
3 – Pour moi, un nouvel apprentissage et au sens concret du terme : Vivre le Nouvel Esprit Educatif (titre de l’un de mes livres).
Peux-tu rapporter quelques rencontres qui ont été marquantes pour toi?
Chaque rencontre est singulière et marquante. Mais je retiendrai peut être, outre les auteurs par ailleurs très connus : Geneviève Callerot (centenaire), Danièle Baudot-Laksine, la plus grande écrivaine du pays de Grasse et morte prématurément, Stéphane Udovitch , pianiste remarquable, Zarina Khan, une femme au parcours international, ou encore l’entretien avec ma fille Ana Paola.
Comment cette ressource est-elle mise en valeur? Quel est le rôle du site dédié: « Arts Culture, Education tout au long de la vie »?
Cette émission est mise en valeur par une radio locale de grande qualité, Agora Côte d’Azur, puis sur mon site www.artscultureseducation.fr A cela s’ajoute maintenant, directement sur mon site, quatre autres séries d’émissions. Un projet devrait voir le jour à la rentrée : 9 penseurs oubliés du 20ème siècle à connaître pour le 21ème siècle. J’étudie aussi actuellement la possibilité de contribuer à une banque d’émissions radio pour l’Afrique.
Enfin, mon site ne comporte pas que ces émissions, il comporte également plusieurs rubriques, dont une récente : « Les Nouveaux Colibris ». Il s’agit de brèves notes de lecture, intégrant parfois, une émission radio. Il y aura 50 notes à la fin 2019 et 100 à la fin 2020.
Comment l’audience a-t-elle évolué? Quelles relations?
L’audience évolue surtout de bouche-à-oreille car aucune autre publicité n’est faite par ailleurs. Et j’essaie le plus possible, par l’intermédiaire d’un mail, d’entrer en contact avec les auditeurs.
Michel, je te remercie de cet entretien et de ces réponses spontanées, as-tu quelque chose à rajouter?
Oui Jean, Je veux d’abord rendre hommage, à tout ce que tu fais, à ton site, « vivre et espérer », à la qualité de tes notes de lecture. Toi comme moi, continuons d’agir en retrait de notre profession antérieure, mais avec le soucis constant de donner, d’offrir, de créer, jusqu’à notre dernier souffle.
C’est dans cette perspective que j’ai créé en septembre 2018 le collège international de sénior. Harmattan (site : cis-h.org).
Merci Michel. C’est une amitié réciproque. Ton nouveau site est véritablement un centre de ressources à l’oral bien sûr à travers le lien avec les émissions, et aussi à l’écrit. C’est une belle ouverture culturelle. Nous nous rejoignons dans un désir de compréhension et de partage
J H
Les roses de la paix
Les roses de la paix
En parcourant les sites dans le réseau Flickr, on peut rassembler des photos qui répondent à notre goût de la beauté. Et, on en vient à apprécier particulièrement certains sites. Nous en avons présenté sur ce blog (1). Chaque site a son originalité. Le site de Chantal Giraudeau (2) nous présente la diversité des fleurs de son jardin dans une abondante production. Et, parmi ces photos, il y en a des roses magnifiques.
L’inventeur de cette rose, un français, Francis Meilland a réalisé en 1935, un nouveau croisement. Il fait connaître cette nouvelle variété de rose à ses correspondants internationaux. En 1942, il publie la variété au catalogue Meilland sous le nom de sa mère décédée : Madame Antoine Meilland. La guerre bat son plein. En France, c’est l’occupation. Et voici que la guerre terminée, il apprend que cette rose a été appelée : « peace », le 29 avril 1945 par son introducteur aux Etats-Unis, Robert Pyle, de la société : Conard et Jones Company. C’était le jour même de la chute de Berlin, considérée comme marquant la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.
L’American Rose Society offrit cette « peace rose », cette « rose de la paix » à chaque délégué de la future organisation des Nations Unies mors de la première réunion à San Francisco avec le message : « Nous espérons que cette rose de la paix influencera les hommes pour la paix dans le monde » (3)
C’est une belle histoire, n’est-ce pas ? Et donc, aujourd’hui encore, ces roses continuent à évoquer la paix et à nous y inviter. Si belles que, par ailleurs, dans les pays germanophones, on les appelle : « Gloria Dei » (Gloire de Dieu)… Merci à Chantal Giraudeau qui nous a autorisé à utiliser ses photos pour illustrer ce récit qu’elle-même appelle « une fabuleuse histoire »
J H
- Un regard lumineux dans un pays lumineux. Le site de Gloria Castro : https://vivreetesperer.com/un-regard-lumineux-dans-un-pays-lumineux/ Le jardin de Paula : https://vivreetesperer.com/le-jardin-de-paula/ Effets de lumière dans une campagne bocagère : https://vivreetesperer.com/effets-de-lumiere-dans-une-campagne-bocagere/
- Le site de Chantal Giraudeau : https://www.flickr.com/photos/57660560@N08/
- Madame Antoine Meilland. Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_Antoine_Meilland
BLEU, BLEU, BLEU !
 Bleu du ciel
Bleu du ciel
Bleu de la mer
Bleu de l’eau…..
Vacances ! Vacances ! Vacances !
Vraiment !?
…. Est-ce le cadre idyllique pour des vacances ? ….
ou encore, ces vacances seraient-elles des espaces pour vivre les nuances vibrantes de notre être ?
des inspirations larges et amples du souffle de vie ?
des circulations multiples et colorées dans nos relations ?
Variété de ces bleus tout en nuances !
Je vous souhaite quiétude, en vos découvertes intérieures, relationnelles et géographiques.
Je vous souhaite de chercher et de trouver de l’eau vive pour étancher vos soifs profondes !
Et si vous désirez partager ce que cette peinture vous inspire, c’est avec joie que je vous lirai !
Valérie BITZ
Formatrice agréée PRH
Vous pouvez utiliser le support de l’expression créative pour explorer votre monde intérieur en ses richesses :
- avec le stage LA VIE EN MOI ET SES ENTRAVES : http://www.prh-france.fr/canvas/PRHStage.aspx?ID=145585
- ou avec le stage AVANCER EN COHERENCE DANS MON QUOTIDIEN : http://www.prh-france.fr/canvas/PRHStage.aspx?ID=144424
Sur ce blog, voir aussi :
Au cœur de nous, il y a un espace : https://vivreetesperer.com/au-coeur-de-nous-il-y-a-un-espace/
L’intelligence collective
 Une inspiration motrice pour l’avènement d’une société post- capitaliste.
Une inspiration motrice pour l’avènement d’une société post- capitaliste.
Un processus en développement selon Jean Staune
Avec le changement des modes de communication suscités par le développement d’internet, nous entrons dans une mutation de la société et de l’économie. Les conséquences se manifestent dans tous les domaines. Ainsi, à travers internet, les intelligences humaines sont en situation de pouvoir converger. Au début de ce nouveau siècle, dans son livre : « World philosophie » (1), Pierre Lévy voit là le départ d’une intelligence collective. Quelques années plus tard, en 2004, aux Etats-Unis, paraît un livre de James Surowieki : « The wisdom of crowds » (2), traduit par la suite sous le titre : «La sagesse des foules » (3). Si les foules peuvent s’égarer, il y a aussi une avancée possible dans une prise en compte avisée du collectif. Bien gérée, une expression d’avis multiples peut se révéler beaucoup plus pertinente dans l’observation et la prévision que des expertises isolées. Un groupe d’individus multiples, variés est en mesure de prendre de meilleures décisions et de faire de meilleures prédictions que des individus isolés et même des experts. Certaines conditions doivent être réunies comme la diversité des participants, l’indépendance dans leur expression et un mode efficient d’agrégation des opinions.
La recherche sur l’intelligence collective se poursuit, notamment au MIT (Massachusetts Institute of technology) et elle a mis en évidence des résultats spectaculaires. Dans un livre récent, Emile Servan-Schreiber nous montre « la nouvelle puissance de nos intelligences » en terme marqué : « Supercollectif » (4). Il y a bien « Une force de l’intelligence collective » (5). Et nous en découvrons aujourd’hui toute l’originalité.
Ainsi, « l’intelligence d’un groupe n’est pas d’abord déterminé par le degré d’intelligence de ses membres, mais par la sensibilité aux autres (communication non verbale) et par l’équité du temps de parole qui tient un rôle capital. Les femmes enregistrent dans ce domaine, un score supérieur aux hommes. C’est dans les groupes où le nombre de femmes est le plus représenté que les scores sont les meilleurs » (6). Il y a là une leçon plus générale puisqu’elle met en valeur l’importance de la qualité des relations.
Emile Servan-Scheiber rappelle les fondamentaux du processus de l’intelligence collective. « Il y faut beaucoup de diversité ». Les biais individuels de chacun vont s’annuler à travers la confrontation en permettant ainsi au meilleur d’émerger. « Il faut beaucoup d’indépendance d’esprit ». « Il faut récolter beaucoup d’information. Il faut agréger tout cela de façon objective… ». L’intelligence collective peut ainsi amener des transformations importantes. Ainsi, « il est établi que les entreprises les plus innovantes sont celles qui impliquent le plus d’employés dans l’effort d’idéation pour trouver de nouvelles idées ».
Dans son nouveau livre : « L’intelligence collective, clé du monde de demain » (7), Jean Staune rapporte comment, dans une approche d’intelligence collective, de nouvelles entreprises sont en train d’apparaître et de grandir, prémices d’une économie et d’une société post-capitaliste. Jean Staune est un pionnier et un découvreur (8). A travers la création de l’Université interdisciplinaire de Paris et la publication de plusieurs livres, il a ouvert une relation féconde entre sciences, religions et spiritualités. Mais enseignant et expert dans le domaine du management, et aussi penseur interdisciplinaire, il développe également une pensée prospective dans le champ de la vie économique et sociale. Ainsi, en 2015, son livre : « les clés du futur » (9) nous a permis d’entrer dans la compréhension de la mutation de la vie économique et sociale. Ce nouveau livre sur la mise en œuvre de l’intelligence collective dans des entreprises innovantes, se focalise dans un champ plus précis, le terrain où une nouvelle approche économique est en train de voir le jour et d’induire l’apparition d’une économie « post-capitaliste ». Au travers d’un livre de Jacques Lecomte (10), nous savions déjà comment des entreprises humanistes et conviviales se développent aujourd’hui et témoignent d’un état d’esprit nouveau. Ce livre de Jean Staune nous montre également qu’une nouvelle économie est en train de naître à travers des entreprises innovantes.
« Libérées », « conscientes », « apprenantes », inclusives », « hybrides », de nouvelles entreprises voient le jour, qui permettent de se réaliser en favorisant la créativité et en développant l’intelligence collective. Elles tiennent compte de toutes les parties prenantes concernées par leurs activités, et non des seuls actionnaires, et créent une triple valeur ajoutée : humaine, économique et environnementale… Une autre forme de capitalisme, d’organisation du travail, d’économie de marché est donc plausible » (couverture).
Face à un monde incertain, un monde « VUCA »
Jean Staune évoque d’abord le contexte dans lequel ces entreprises apparaissent. C’est une société en pleine mutation qui se caractérise par une complexité croissante. Grâce à sa culture scientifique, Jean Staune nous apporte des connaissances qui nous permettent d’analyser les situations auxquelles les entreprises et nous-mêmes, sommes aujourd’hui confrontés, ce qui, face à une complexité croissante, requiert d’autant plus une intelligence collective.
Jean Staune nous parle ainsi d’un « monde VUCA » (p 62) . « VUCA est un acronyme pour volatility (« volatilité »), uncertain (« incertitude »), complexity (« complexité ») et ambiguity (« ambiguité »). Ce terme rend compte d’un ensemble de caractéristiques du monde d’aujourd’hui qui peuvent être envisagés à partir de concepts appartenant à la nouvelle vision scientifique, celle qui s’est substituée à une approche déterministe, envisageant l’univers « comme une grande mécanique réglée par des lois immuables où n’existait aucun espace de liberté » (p 49).
° « Volatilité : notre monde est beaucoup plus sensible que le monde d’hier aux effets papillon, aux disruptions, aux ruptures brutales que constituent les bifurcations.
° Incertitude : la physique quantique nous montre qu’il existe une incertitude irrémédiable à la base de notre compréhension du réel. Le théorème de Gödel introduit une forme d’incertitude dans la logique mathématique en montrant son incomplétude. Cela nous permet de mieux comprendre et percevoir l’incertitude du monde que si nous avions gardé nos « lunettes » classiques.
° Complexité : nous avons montré comment la complexité du monde s’était fortement accrue, comment se multiplient autour de nous les boucles de rétroaction et les phénomènes d’auto-organisation qui rendent certains processus de décision purement et simplement impossibles à décrire.
° Ambiguïté : la physique quantique nous montre que quelque chose peut occuper deux états contradictoires en même temps. Elle met fin aux catégories classiques où les états de chose étaient bien séparés… Cette ambiguïté est partout… » (p 62-63).
« La complexité du monde actuel accroit l’incertitude. Nous participons à une mutation mondiale au moins équivalente à celle du passage du monde agraire au monde industriel, mais qui se déroule sur un rythme beaucoup plus rapide. Bien entendu, cette situation ne peut manquer d’engendrer de la crainte et du stress… Mais il faut bien comprendre qu’il n’y a jamais eu autant d’opportunités dans l’histoire humaine, car les bifurcations et les effets papillon peuvent se produire à la hausse comme à la baisse… » (p 64).
L’entreprise, un levier pour la transformation du système économique.
Si l’économie capitaliste a remporté un certain nombre de succès, on en perçoit aujourd’hui les limites et les travers. Dans la mutation actuelle, des dangers redoutables apparaissent tant sur le plan social que sur le plan écologique. « Une véritable refonte du système économique » est indispensable. Ne peut-elle pas advenir à partir même d’une transformation des unités qui assurent la production, des entreprises ? Jean Staune prône la mise en place d’une nouvelle forme de capitalisme « qui intègre l’intérêt de toutes les parties prenantes (stakeholders) et non seulement l’intérêt des actionnaires, des salariés, des clients et des fournisseurs de la firme » (p 27). « Hier, l’entreprise devait faire des profits pour ses actionnaires tout en fabricant de bons produits pour satisfaire ses clients. Demain, on ne demandera pas seulement à l’entreprise de respecter l’intérêt des différents parties prenantes concernées par son activité et de respecter l’environnement, mais aussi d’avoir une contribution sociale positive » (p 27).
« Ces exigences sont fortes, mais face à la pression du changement, c’est l’entreprise qui est la plus capable de réagir » (p 27). Aujourd’hui, l’horizon s’étend. C’est bien le cas à travers la Révolution numérique qui relie des centaines de millions, aujourd’hui des milliards d’internautes. Aujourd’hui, 3,5 milliards de requêtes sont adressées quotidiennement au navigateur Google. 4 milliards de vidéos sont consultées chaque jour sur You Tube » (p 16). Ainsi, les barrières s’abaissent, les cloisonnements s’effacent. On prend conscience de la globalité. C’est bien en ce sens qu’apparaît l’intelligence collective. Et, dans le même mouvement, les systèmes pyramidaux s’effondrent. « Il faut donc mettre en place la subsidiarité, c’est à dire permettre aux salariés à tous les niveaux hiérarchiques de prendre eux-mêmes des décisions sur un certain nombre de questions les concernant directement. Le rôle du dirigeant devient celui d’un chef d’orchestre » (p 30). « L’entreprise de demain se doit de développer son intelligence collective en interne pour augmenter son agilité, sa réactivité, son adaptabilité à un monde de plus en plus mouvant tout en développant en externe un véritable écosystème, qui, par son existence même, soutiendra le développement harmonieux de l’entreprise et assurera la fidélité, voire, osons le mot, l’amour de tous les acteurs du système envers elle » (p 20). Dans cet ouvrage, Jean Staune se focalise donc sur un domaine précis : « celui de la réforme de l’économie de marché et du capitalisme grâce à l’action et au développement d’un nouveau type d’entreprise » (p 34). Et, pour cela, il nous montre que des démarches crédibles existent déjà partout autour de nous et qu’elles peuvent apporter des résultats parfois extraordinaires ».
Les pionniers d’une nouvelle économie
Tout au long de son livre, Jean Staune égraine des portraits d’entrepreneur qui ont inventé de nouvelles manières de faire entreprise. En vendant des glaces, l’entreprise Ben and Jerry’s innove dans les approvisionnements et les relations humaines. « Ben and Jerry’s a ainsi posé les bases concrètes de la fameuse « théorie des parties prenantes » selon laquelle l’entreprise doit prendre en compte son impact global sur la société et essayer de le positiver au maximum pour toutes les parties prenantes et pas seulement ses clients, ses salariés, ses actionnaires » (p 69). De même, un militant écologiste, John MacKay, en créant les magasins bio : « Whole Foods Market » va aider l’agriculture biologique à se développer, et, contrairement à la gestion décentralisée généralement adoptée, il donne à ses équipes une grande autonomie tant pour les achats que pour les ventes (p 69-71).
On peut développer un capitalisme qui cherche autre chose que le profit. Jean Staune cite l’exemple du commerce équitable. Il met en évidence l’approche de Mohammed Yunus, prix Nobel de la paix, promoteur du microcrédit pour les pauvres et aussi du « social business ». En France, voici la manière dont Bertrand Martin redresse l’entreprise Sulzer Diésel France en permettant au personnel d’entrer dans une approche commune de réflexion et de proposition. La mise en œuvre de cette intelligence collective a non seulement sauvé l’entreprise, mais lui a donné une grande impulsion (p 78-80). Dans une autre entreprise, une fonderie du nom de Favi, le nouveau directeur, François Zabrist, a libéré les travailleurs d’une tutelle tatillonne. « Le coût du contrôle est supérieur au coût du non contrôle » Il a donné aux équipe une autonomie leur permettant de répondre rapidement aux besoins des clients dans un secteur, celui de la sous-traitance automobile où le « juste à temps » est une exigence des constructeurs (p 81-84).
Dans toutes ces entreprises, il y a un esprit commun que Jean Staune rapporte en ces termes : « Ainsi se dessine le profil de l’entreprise capable d’être anti-fragile et de surfer sur la complexité. Une telle entreprise tient compte de toutes les parties prenantes impactées par son activité. Elle développe à tous les niveaux l’intelligence collective et la subsidiarité. Elle met en place des logiques d’économie circulaire, d’économie de la fonctionnalité, d’écologie positive. Elle ne se contente pas de polluer moins, mais veut restaurer son environnement tout en fonctionnant. Elle est toujours en mouvement, capable d’être là où personne ne l’attend, capable de se réinventer » (p 209).
Une transformation qui se répand jusque dans une grande entreprise traditionnelle : l’Office Chérifien des Phosphates
Ainsi, on peut entrevoir une transformation en train de s’opérer dans certaines entreprises. C’est un changement d’état d’esprit et ce changement commence à se répandre. Il gagne parfois des lieux où l’on ne l’y attendrait pas. Et c’est ainsi que Jean Staune nous fait connaître le changement en train de se réaliser dans une grande entreprise d’état marocaine : l’Office chérifien des phosphates.
Le phosphate est un des composants les plus importants des engrais. C’est donc une ressource majeure et le Maroc possède les plus grandes ressources mondiales prouvées de phosphates.
C’est dire la place considérable que l’Office Chérifien des phosphates a pris dans la vie du Maroc. Or, l’Office Chérifien des Phosphates était une structure hiérarchique, « une organisation quasi militaire » (p 115). « L’entreprise souffrait d’un double manque de communication, à la fois transversale et verticale… Focalisée sur les ventes et non sur les marges, l’entreprise était en bien mauvaise situation financière » (p116-117). C’est alors, en 2006, qu’un entrepreneur novateur, Mostafa Terrab est arrivé et a engagé un processus de transformation globale de l’entreprise. Dans ce livre, Jean Staune consacre plus de cent pages à une étude de cas de cette innovation.
Qu’est-ce qui rend ce cas si intéressant ? Tout d’abord, l’ampleur de la transition qui se déroule au sein de cette entreprise. Il y a seulement une dizaine d’années, son organisation et son management en étaient à un stade pré-moderne, et elle a du effectuer une transition (qui est toujours en cours) vers le monde moderne, tout en se lançant d’une façon particulièrement intense dans une transition vers le monde post-moderne… Ensuite, parce que cette entreprise, qui est le premier exportateur du Maroc, joue un rôle social important. Mais la façon dont s’effectue cette redistribution est en train de changer radicalement. Selon la fameuse formule, elle évolue de « donner du poisson à quelqu’un » à « lui apprendre à pécher ». Enfin, ces deux grandes branches d’activité : l’extraction des minerais d’un côté, la production industrielle d’engrais de l’autre, ont un impact très important sur l’environnement. Or l’entreprise vise désormais, malgré le caractère chimique d’une grande partie de ses activités, à être exemplaire dans ce domaine. Ainsi, l’entreprise « coche toutes les cases » que nous avons mentionnées comme étant les caractéristiques de l’entreprise de demain : prendre en compte toutes les parties prenantes, libérer l’intelligence collective, développer le « bonheur au travail » en interne, intégrer les questions environnementales et l’économie circulaire » (p 112)
Jean Staune va donc nous raconter les multiples facettes de cette transformation, les innovations qui s’y succèdent, la libération de l’intelligence collective à travers un nouvel espace où les énergies peuvent se déployer : « le Mouvement » apparu en 2016 (p 121). Les intentions : « être de plus en plus une entreprise apprenante (ou plus exactement une entreprise d’apprenants), être une entreprise digitale, enfin être une entreprise mondiale. Les deux premières intentions poussent clairement à une très forte transformation culturelle de l’entreprise ». L’entité de base du mouvement s’appelle « la Situation ». « La Situation est un groupe d’étude et de proposition qui se saisit lui-même d’un sujet pour faire une proposition concrète, et ce, dans n’importe quel domaine qui concerne l’entreprise » (p 122-123). Les groupes élaborent des propositions –
A travers cette étude de cas, qui occupe une place majeure dans ce livre, Jean Staune nous entraine dans la compréhension d’un processus riche en inventions, en transformations. Pour notre compréhension, il y ajoute des outils d’analyse. Ainsi, il nous apprend à voir dans cette grosse entreprise, l’existence de différents niveaux de réalité qui se côtoient :
« ° Le niveau de l’entreprise pré-moderne et bureaucratique
° Le niveau de l’entreprise moderne et la recherche de l’information, du big data et du contrôle en temps réel
° L’entreprise post-moderne basée sur la créativité : le Mouvement, l’autre organisation…
° L’université qui se situe dans une dimension totalement différente de l’entreprise, tout en interagissant en permanence avec elle, comme les différents niveaux de la réalité (par exemple : quantique, mécanique et virtuel) interagissent entre eux
° Les fondations et associations comme l’école 1337 ou encore un Think Tank comme le « Policy Center » (p 208-209)
Le potentiel de l’intelligence collective
Face aux enjeux des mutations économiques, politiques et sociales en cours, Jean Staune met en valeur le potentiel de l’intelligence collective. Il intervient ici dans une conjoncture marquée par l’actualité, notamment par les revendications des gilets jaunes concernant le référendum d’initiative citoyenne et le débat entre philosophes sur l’évolution de la société. Toute conjoncture comporte des aspects immédiats et passagers qui peuvent susciter des humeurs.
Nous nous bornerons ici à mettre en valeur les grandes orientations qui se dégagent de ce livre.
En abordant la question de l’intelligence collective, Jean Staune en rappelle les conditions permettant d’éviter les dérives possibles à partir d’un livre de Patrick Scharnitzky : « Comment rendre le collectif (vraiment) intelligent » (p 237). On peut y ajouter que le bon fonctionnement de l’intelligence collective dans certaines entreprises est lié au climat qui règne dans celles-ci. Alors que dans un contexte social plus global, les passions sont beaucoup plus vives et dérégulantes. Des dispositions particulières sont nécessaires.
Dans ce chapitre, Jean Staune présente trois études de cas d’entreprises françaises où les performances en matière d’intelligence collective sont remarquables : le groupe Innov on et la société Chronoflex dirigés par Alexandre Gérard, Clinitex dirigé par Thierry Pick, et la Camif dirigé par Emery Jacquillat (p 242-267).
La société Chronoflex intervient dans un marché de niche : la réparation de flexibles hydrauliques sur des chantiers. En 2009, à la suite de la crise, l’entreprise se retrouve dans une situation difficile. Son directeur, Alexandre Gérard, s’interroge, entend parler des entreprises libérées, et s’engage dans un processus de consultation qui débouche sur une réorganisation de l’entreprise : autonomie des équipes, conception nouvelle des responsables vers une approche d’animation, multiplication et diversification des responsables, processus de décision collective dans la conduite de l’entreprise et la définition des stratégies. Un tel changement passe aussi par une transformation du dirigeant de l’entreprise : Alexandre Gérard (11)
A Clinitex, Thierry Pick a développé son entreprise en se fondant à la fois sur une relation de proximité avec le client et un grand respect pour la personne humaine. Les collaborateurs participent à une procédure d’autoévaluation partagée et interviennent dans le recrutement. Les agences ont une grande autonomie. La rémunération n’est pas basée sur les résultats, mais sur la responsabilité. L’écart maximum de salaire est de 1 à 12 entre le « balayeur de base » et le dirigeant. Clinitex démontre qu’on peut être une entreprise à taille humaine avec plusieurs milliers de personnes.
En 2009, Emery Jacquillat « s’est lancé dans un pari énorme : reprendre la CAMIF, l’ancienne centrale d’achat de la mutuelle des instituteurs qui venait de faire une faillite retentissante ». « Il s’agissait d’une grosse structure bureaucratique à l’ancienne . Emery Jacquillat n’avait aucune légitimité particulière à agir dans ce milieu. Il savait qu’il ne pouvait réussir sans l’existence d’un microsystème autour de l’entreprise. Il met en place un blog pour expliquer qui était la nouvelle équipe et surtout demander : « Qu’est-ce que les clients et le fournisseurs veulent que soit cette entreprise ? » C’est comme ça qu’a émergé, à une époque où elle était encore beaucoup moins à la une des médias, l’idée du « made in France ». Aujourd’hui, 73% du chiffre d’affaires provient des produits fabriqués en France, un chiffre absolument unique dans un secteur comme celui de l’ameublement, de la literie et des fournitures de maison » (p 259-266). Pour réussir, la CAMIF a mis en place graduellement toute une série de mécanismes pour co-construire ses produits. A tous les niveaux, on cherche à « créer du lien entre les hommes » Les collaborateurs comme les clients sont engagés dans une démarche participative. Et, par exemple en 2015, l’entreprise a décidé que le budget 2016 serait établi par un groupe de salariés bénévoles. L’exercice a réussi et suscité une grande motivation.
L’intelligence collective n’est pas un rêve. Ce n’est pas une idéologie. « Les extraordinaires aventures économiques et humaines que représentent Innov on, Clinitex, La CAMIF, les propos d’Alexandre Gérard, de Thierry Pick et Emery Jacquillat nous fournissent les réponses principales aux critiques des démarches d’entreprises libérées et d’intelligence collective. L’intelligence collective, ça marche ».
Vers une société nouvelle
Ce livre nous montre comment le système économique peut changer de l’intérieur. Il y a une évolution des mentalités. L’angle de la vision s’élargit. Les barrières s’affaissent. De plus en plus, on pense globalement. Des lors, peuvent apparaitre des entreprises « inclusives ». Ces entreprises ouvrent la voie à une société post-capitaliste. Si les expérimentations sont encore peu nombreuses, elles sont concluantes et participent à un mouvement qui s’amplifie.
Alors, dans un monde inquiet, menacé par le dérèglement climatique, traversé par des crispations et des tumultes politiques, Jean Staune nous ouvre une piste : l’émergence d’une intelligence collective dans une société participative.
A l’heure ou certains envisagent l’effondrement de nos sociétés, Jean Staune trace une voie. « Pourquoi je ne suis pas collapsologue ? Ce n’est pas par un optimisme béat. Tout ce que nous avons vu au cours de ce livre soutient avec force cette affirmation. Oui, il y a une énergie incroyable au fond de nous, l’énergie de l’intelligence collective qui a été, pour l’instant, si peu employée dans l’histoire humaine que nous pouvons justement être certain qu’elle recèle un potentiel incroyable… Tous les exemples que nous avons développés dans ce livre le montrent : il est possible d’effectuer des progrès inimaginables aux yeux des experts quand de simples personnes sans formation, mais avec une bonne connaissance de terrain, mettent leur intelligence en commun » (p 298).
Dans une nouvelle étape, on peut envisager que les réseaux sociaux démultiplient l’exercice de cette intelligence collective. « Les réseaux permettent de créer des outils fondamentaux pour le monde de demain, comme le montre déjà l’exemple de Wikipedia… Comme le dit Vincent Lenhardt, grâce à nos réseaux sociaux, cette capacité d’intelligence collective est en train de réaliser « un véritable saut quantique ». Cette « Noosphère » envisagée par Teilhard de Chardin, cette « éruption » d’intelligence et de créativité, rendue possible par la connexion de tous les esprits de la planète, est aujourd’hui « à la portée de la main » (p 399). Oui, dans les remous actuels, Jean Staune sait voir ce qui est en train de se construire. « Face à toute cette montée du populisme, de toutes ces démonstrations de bêtise collective, à ces rumeurs qui se répandent », il voit « ces fragiles petites flammes qui s’élèvent ici et là et qui sont constituées de toutes les expériences que nous avons décrites ici » (p 301). C’est un commencement.
Emergence
Au fil de son œuvre intellectuelle et militante, Jean Staune nous apparaît comme un pionnier, un défricheur, un visionnaire. Dans son livre précédent : « les clés du futur (9), il réalisait une grande synthèse à partir de laquelle il mettait en évidence une voie de transformation économique et sociale. Ce nouveau livre sur l’intelligence collective a été écrit plus rapidement dans une période où l’actualité était agitée par les manifestations des gilets jaunes. L’auteur commente cette actualité. Il prend part au débat. On peut ne pas le suivre dans telle ou telle opinion. Mais, toujours, on se réjouit de voir qu’il apporte un fil conducteur pour voir plus grand, plus loin.
L’intelligence collective, c’est aussi une voie nouvelle à explorer dans le domaine politique. Et, justement, nous venons d’apprendre qu’une grande innovation est en train de se mettre en place aujourd’hui en ce domaine : la création d’une « assemblée citoyenne pour le climat » fondée sur une mise en œuvre d’intelligence collective (12). C’est un évènement majeur. Cependant, nous avons centré notre analyse de ce livre sur la transformation du système économique.
Au terme de son livre, Jean Staune évoque Teilhard de Chardin dans sa vision annonciatrice de la « noosphère ». Comment ne pas y associer aujourd’hui la pensée théologique de Jürgen Moltmann dans sa vision d’un Esprit créateur partout à l’œuvre (13). C’est un éclairage qui nous parait en phase avec les dimensions nouvelles qui apparaissent aujourd’hui.
Au cœur même de sociétés déchirées, les prophètes de la Bible ont ouvert des espérances. Sur un autre mode, on peut voir dans ce livre une dimension prophétique. Face au péril actuel, Jean Staune ne s’enferme pas dans la perspective d’un effondrement. A partir de l’intelligence collective, il trace une voie de vie. Là aussi, en correspondance, nous pouvons évoquer la théologie de l’espérance dans laquelle Jürgen Moltmann nous invite à regarder vers l’avenir et à percevoir l’expérience de Dieu dans des expériences anticipatrices (14).
Au-delà de ce commentaire personnel, nous pouvons tous reconnaître dans ce livre une dynamique qui ouvre la compréhension, nous introduit dans un mouvement et nous invite à une mobilisation. Un avenir à construire !
J H
- Pierre Lévy. World Philosophie : le marché, le cyberespace, la conscience. Odile Jacob, 2000
- James Surowiecki. The wisdom of crowds. Why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies and nations. Doubleday, 2004
- James Sorowiecki. La sagesse des foules. Jean-Claude Lattès . 2008
- Emile Servan-Scheiber. Supercollectif. La nouvelle puissance de nos intelligences. Fayard, 2018
- Emile Servan-Schreiber. La force de l’intelligence collective. Site : Marketing et innovation : https://visionarymarketing.com/blog/2018/10/intelligence-collective/
- Le rôle des femmes dans l’intelligence collective : https://www.facebook.com/28minutes/videos/2192573717736096/?v=2192573717736096
- Jean Staune. L’intelligence collective, clé du monde de demain. L’Observatoire, 2019
- Le site de Jean Staune : Naviguer dans un monde en mutation : http://www.jeanstaune.fr
- Jean Staune. Les clés du futur. Réinventer ensemble la société, l’économie et la science. Préface de Jacques Attali. Plon, 2015. Mise en perspective sur Vivre et espérer : https://vivreetesperer.com/comprendre-la-mutation-actuelle-de-notre-societe-requiert-une-vision-nouvelle-du-monde/
- Jacques Lecomte. Les entreprises humanistes. Les Arènes, 2016 Mise en perspective sur Vivre et espérer : https://vivreetesperer.com/vers-un-nouveau-climat-de-travail-dans-des-entreprises-humanistes-et-conviviales-un-parcours-de-recherche-avec-jacques-lecomte/
- « Alexandre Gérard : chef d’entreprise, pionnier d’une entreprise libérée » : https://vivreetesperer.com/alexandre-gerard-chef-dentreprise-pionnier-dune-entreprise-liberee/
- Comment Cyril Dion et Emmanuel Macron ont élaboré l’assemblée citoyenne pour le climat : (site Reporterre) : https://reporterre.net/Comment-Cyril-Dion-et-Emmanuel-Macron-ont-elabore-l-assemblee-citoyenne-pour-le-climat?fbclid=IwAR01yBCpZ93dJlt7fLOPYA5RAh_5Z1hgPc1ZmqJtDE0hW4U0qZ15V69LU20
- La pensée théologique de Jürgen Moltmann nous donne des clés pour interpréter le monde d’aujourd’hui et nous la suivons sur ce blog. Jürgen Moltmann. L’Esprit qui donne la vie. Cerf, 1999
- « La force vitale de l’espérance » (p 109-116), dans : Jürgen Moltmann. De commencements en recommencements. Empreinte, 2012
Voir aussi sur ce blog :
Pour une intelligence collective. Eviter des décisions absurdes et promouvoir des choix pertinents. La contribution de Christian Morel : https://vivreetesperer.com/pour-une-intelligence-collective-eviter-les-decisions-absurdes-et-promouvoir-des-choix-pertinents/
Pour des oasis de fraternité
 Pourquoi la fraternité ?
Pourquoi la fraternité ?
Selon Edgar Morin
Edgar Morin vient de publier un petit livre : « La fraternité. Pourquoi ? » (1). C’est une alerte. C’est un appel. C’est, en quelque sorte, un manifeste. Et ce manifeste nous est adressé par un des plus grands penseurs de notre époque (2). Au fil des années, Edgar Morin ne nous rapporte pas seulement une vie militante et créative, mais, sociologue et philosophe, il est également un immense penseur, un penseur encyclopédique, un penseur pionnier, auteur d’une série de livres intitulée : « La Méthode » : apprendre à envisager la globalité et à reconnaître la complexité.
Au cours de décennies de recherche, Edgar Morin a écrit un grand nombre de livres couronnés par une audience internationale, puisque traduits en 28 langues. Alors pourquoi y ajoute-t-il aujourd’hui un livre engagé, en réponse aux inquiétudes suscitées par les tensions et les dérives qui se manifestent dans nos sociétés ?
Face aux périls
Dans une récente vidéo (3), Edgar Morin n’hésite pas à déclarer :
« Le pire est envisageable, mais le meilleur est encore possible ». C’est dire l’importance de l’enjeu, mais quelles sont donc les menaces ?
Si l’individualisme comporte des aspects positifs comme les possibilités ouvertes par l’autonomie personnelle, il entraine également une « dégradation des solidarités » (p 38). De même, la mondialisation a un « effet paradoxal » : « Elle crée une communauté de destin pour toute l’humanité en développant des périls globaux communs : la dégradation de la biosphère, l’incertitude économique et la croissance des inégalités, la multiplication des armes… » (p 41). Et puis, Edgar Morin dénonce également des modes de pensée qui engendrent des effets négatifs. Certes, « La domination d’une pensée qui sépare et compartimente, et qui, elle-même, ne peut accéder aux problèmes fondamentaux et globaux de la société » nous paraît ancienne, mais elle prend force lorsque « le mode de connaissance dominant devient le calcul, qui traduit toutes les réalités humaines en chiffres et ne voit dans les individus-sujets que de objets » (p 39). Ainsi, dans ces conditions, les trois moteurs couplés : sciences-techniques-économies conduisent aux catastrophes écologiques, au péril mortel des armes nucléaires et autres, aux déshumanisations de tous ordres » et, en même temps, aux dangers du transhumanisme » (p 51). En regard, Edgar Morin nous présente un ensemble de propositions. Cette voie nouvelle passe par un « changement de notre façon de connaître et de penser, réductrice, disjonctive, compartimentée pour un mode de pensée complexe qui relie, capable d’appréhender les phénomènes dans leur diversité et leur unité ainsi que leur contextualité » (p 52).
Cependant, si la conflictualité prend des formes nouvelles, elle s’inscrit dans une longue histoire. Il y a bien des maux terribles dans notre passé. La mise en garde vis à vis des périls actuels ne doit pas nous les faire oublier (4). Edgar Morin ne les évoque pas ici, mais il analyse les racines anthropologiques et idéologiques de la conflictualité.
La force de l’entraide
Le grand livre de Darwin, « De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la lutte pour l’existence dans la nature » (1859-1861) a été lu, à une époque, comme « confirmant le développement des plus agressifs et mieux adaptés à un monde conflictuel, et utilisé comme justification pseudo-scientifique du darwinisme social. Le penseur libertaire, Pierre Kropotkine, s’opposa vigoureusement à cette doctrine politique comme à l’interprétation dominante du darwinisme où le « struggle for life » devenait le déterminant de la solution au profit des meilleurs… » (p 17). Edgar Morin nous montre comment le darwinisme social a perdu son emprise. Aujourd’hui, on reconnait l’importance de la symbiose et des relations associatives. Face aux forces de conflit et de destruction, « les forces
d’association et d’union s’activent dans les écosystèmes » (p 21) Aujourd’hui, l’entraide est reconnue comme une force motrice (5).
La fraternité : une grande aspiration
Le fraternité, c’est une nécessité sociale, c’est aussi un besoin intérieur… Ainsi Edgar Morin ne trace pas uniquement un chemin collectif. Il raconte l’histoire de sa vie. Il exprime un ressenti. « De même que je n’ai jamais pu vivre sans amour, je n’ai jamais pu vivre sans fraternité… Il y a les grandes fraternités durables. Mais il y a aussi les fraternités provisoires. Ces fraternités dues à la rencontre, au hasard, à la communion, à l’adhésion enthousiaste, à des je-ne-sais quoi où deux êtres se reconnaissent plus que camarades, sont des moments solaires qui réchauffent nos vies dans leur cheminement dans un monde prosaïque (p 35-36).
Liberté, égalité, fraternité, belle devise (6) mais « la fraternité ne peut pas venir d’une injonction statique, supérieure, elle doit venir de nous (p 9). Elle peut s’appuyer sur une aspiration humaine. Les sources du sentiment qui nous portent vers autrui, collectivement (nous) ou personnellement (tu) sont les sources de la fraternité (p 11).
Mais Edgar Morin sait combien cette fraternité doit être entretenue, car elle est menacée par des forces opposée. Il y a opposition entre tout ce qui pousse à l’union -eros- et, d’autre part, tout ce qui pousse au conflit -polemos- ainsi que ce qui nous pousse à la destruction et à la mort -thanatos- » (p 25). Il y a interaction. Ainsi, « tout ce qui ne régénère pas, dégénère et il en est ainsi de la fraternité »
Des oasis de fraternité
Face à des menaces bien identifiées, Edgar Morin entrevoit « un bouillonnement d’initiatives privées, personnelles, communautaires, associatives qui font germer ici et là les ébauches d’une civilisation vouée à l’épanouissement personnel dans l’insertion communautaire… il y a là comme des oasis… (p 44). On retrouve dans la description d’Edgar Morin un foisonnement d’innovations, des fablabs (laboratoires de fabrication collaboratifs) à toute la gamme des initiatives écologiques et sociales. A cet égard, le film : « Demain » nous avait bien montré le sens de ce mouvement (7) . Ce blog rapporte des innovations de ce genre (8).
« Nous devons tout faire pour sauvegarder et développer la fraternité des oasis. Le déferlement des forces négatives en notre époque de régressions éthiques et politiques généralisées, rend de plus en plus nécessaire la constitution de ces oasis. Nous devons créer des ilots de vie autre, nous devons multiplier ces ilots, car, ou bien les choses vont continuer à régresser et les oasis seront des ilots de résistance de la fraternité, ou bien, il y aura des possibilités positives et ce seront les points de départ d’une fraternité plus généralisée dans une civilisation réformée » (p 36).
Montée d’une prise de conscience
Il apparaît de plus en plus aujourd’hui que le rationalité technique et scientifique ne suffit pas. La relation humaine est essentielle dans toutes ses dimensions éthiques : care, empathie, fraternité. C’est un mouvement général qui s’exprime également sur le plan spirituel. Si, de par son histoire personnelle et le cheminement de sa réflexion, agnostique, Edgar Morin n’entre pas dans la dimension religieuse, son éloge de la fraternité rejoint les croyants engagés en ce sens.
L’amour partagé est au cœur de l’Évangile. Il a cheminé parfois en sous-main dans des moments peu avenants de la chrétienté. Michel Clévenot a pu écrire une histoire de la pratique chrétienne sous le titre : « Les hommes de la fraternité » (9). Et, dans son grand livre : « Le Phénomène humain » (10), Pierre Teilhard de Chardin voit dans l’amour, le cœur du vécu chrétien : « L’amour chrétien, chose incompréhensible pour ceux qui n’y ont pas gouté. Que l’infini et l’intangible puissent être aimable ; que le cœur humain puisse battre pour son prochain d’une charité véritable : ceci paraît à bien des gens que je connais tout simplement impossible… Et cependant, que fondé ou non sur une illusion, ce sentiment existe, et qu’il est même anormalement puissant, comment en douter – rien qu’à enregistrer brutalement les résultats qu’il ne cesse de produire autour de nous… Et n’est-ce pas un fait enfin, celui là, je le garantis, que si l’amour de Dieu venait à s’éteindre dans l’âme des fidèles, l’énorme édifice de rites, de hiérarchie et de doctrines que représente l’Eglise retournerait instantanément dans la poussière dont il est sorti » (écrit en 1938-1940). Aujourd’hui, à travers la pensée théologique de Jürgen Moltmann (11), nous apprenons à reconnaître l’inspiration de l’Esprit dans la manifestation de la fraternité où qu’elle soit, souvent dans des espaces où la référence religieuse s’en est allée.
Sur ce blog, un précédent article annonçait la recherche actuelle de fraternité : « Appel à la fraternité ». Ce livre d’Edgar Morin, accessible à tous est la contribution d’un grand penseur à cette quête. L’engagement d’un homme de savoir dans cette cause nous paraît hautement significatif.
J H
- Edgar Morin. La Fraternité. Pourquoi ? Actes Sud, 2019
- Edgar Morin Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
- Entretien avec Edgar Morin 28 mars 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=RghwWsPihs0
- Ne pas oublier l’âge dur dont nous sommes sortis depuis quelques décennies : Michel Serres Darwin, Bonaparte et le samaritain. Une philosophie de l’histoire : https://vivreetesperer.com/une-philosophie-de-lhistoire-par-michel-serres/
- Face à la violence, l’entraide : le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle : https://vivreetesperer.com/face-a-la-violence-lentraide-puissance-de-vie-dans-la-nature-et-dans-lhumanite/
- Une vision de la liberté, selon Jürgen Moltmann : https://vivreetesperer.com/une-vision-de-la-liberte/
- Le film « Demain » : https://vivreetesperer.com/le-film-demain/
- Le mouvement collaboratif, qui se développe actuellement, présente des facettes différentes : des communautés fraternelles, mais aussi des entreprises solidaires. Peu présent dans ce livre sur la fraternité, cet aspect économique doit être mis en valeur. La convergence est manifeste dans le livre d’Isabelle Delannoy : « L’économie symbiotique » . La présentation de ce livre est accompagnée de la mention des initiatives analysées sur ce blog : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
- Michel Clévenot. Les hommes de la fraternité en 12 volumes « Les hommes de la fraternité. Une histoire post-moderne du christianisme » : https://www.religiologiques.uqam.ca/no9/cleve.pdf
- Pierre Teilhard de Chardin. Le phénomène Humain. Seuil (Points Sagesse) Citation : p 297-298
- Jürgen Moltmann. L’Esprit qui donne la vie. Cerf, 1999 « Un Esprit sans frontières » : https://vivreetesperer.com/un-esprit-sans-frontieres/
- Sur ce blog : « Appel à la fraternité » avril 2015 : https://vivreetesperer.com/appel-a-la-fraternite/
L’imprimante 3D
Vers un nouveau paysage industriel, économique, social

Peter est ingénieur dans une entreprise de haute technologie.
« En recherche d’un nouveau champ d’activité pour son entreprise, il a été amené à travailler sur une innovation en rupture : l’imprimante 3D ». En répondant à nos questions, il nous ouvre un horizon : l’apparition d’un nouveau paysage industriel, économique et social.
Emergence d’un nouveau mode de production
« L’imprimante 3D n’est pas une nouveauté. Elle existe depuis plus de 30 ans. La vraie nouveauté, c’est de l’utiliser dans une phase industrielle. C’est de faire de la « mass production » . Il y a trente ans, on s’en servait pour faire des prototypes, par exemple des concepts de voiture, de moteur. On s’en servait aussi pour faire de la recherche afin de bien comprendre et d’améliorer le fonctionnement et le potentiel de cette imprimante à des fins de réaliser des produits de qualité. Aujourd’hui, on entre dans la phase d’industrialisation pour faire des pièces de qualité qui soient équivalentes à la production classique.
Qu’est-ce que l’imprimante 3D ? Dans la fabrication traditionnelle, on part d’un bloc de matière. On retire de la matière pour réaliser une pièce . Dans l’imprimante 3D, on part de rien. On part d’une poudre et, pour réaliser une pièce, on va agglomérer cette poudre, couche après couche. On peut avoir différents types de matière initiale : polymère, métal, céramique, bois, béton. Ce qui domine, ce sont les polymères et le métal. Aujourd’hui, l’imprimante 3D est utilisée dans trois domaines principaux : l’aérospatial, le médical, la défense.
Vers une économie décentralisée et écologique
Les conséquence sont significatives parce qu’on va développer l’économie locale. L’imprimante 3D permet d’éviter les transports. On envoie le modèle 3D par internet dans les lieux de fabrication. On y dispose de la matière. La production s’effectue dans des micro-usines à partir de quelques imprimantes 3D. Les produits sont fabriqués localement. On n’a plus besoin d’importer des produits de pays lointains. La production pourra à nouveau se développer dans des pays, dits développés, en Europe, en Amérique, et aussi dans des pays pauvres, jusqu’ici peu industrialisés. Cependant, il y a besoin de compétence. Il n’y a plus de dépendance par rapport à des lieux jusque là privilégiés. On pourra de plus en plus travailler en dehors des métropoles et des zones industrielles et réindustrialiser des régions aujourd’hui dépourvues.
Cette transformation va permettre également une personnalisation des produits, une adaptation aux clients. De même, les produits pourront être réparés. Les pièces pourront être changées. L’imprimante 3D favorise le remplacement des pièces. C’est une entrée dans le mouvement de l’économie circulaire qui est une des composantes de l’économie écologique. Moins de transport, moins de consommation d’énergie, tout cela va dans le sens de la transition écologique.
L’imprimante 3D : un développement rapide
Aujourd’hui, l’imprimante 3D est très développée aux Etats-Unis. Initialement, ce fut une innovation française, mais elle a été reprise et développée aux Etats-Unis à partir des années 1990. Elle est également très développée en Asie : Japon, Corée, Chine. Et maintenant, elle se développe en Europe. En France, nous sommes encore très en retard : 3% du marché contre 6% en Angleterre, 9% en Allemagne… et 40% aux Etats-Unis. Nous avons besoin d’une aide de l’Etat pour une démocratisation de l’imprimante 3D. Il y a besoin d’un immense effort d’information, de formation et de conseil. Pour une approche prospective, on peut déjà envisager l’imprimante 4D qui permet de donner mouvement aux objets. Entre autres, l’imprimante 4D permettra de reconstituer les tissus humains de grands brulés.
Dans la transformation en cours, il y a encore en France un temps d’inertie. Mais on peut envisager que la France entre pleinement dans ce processus d’ici cinq ans.
L’imprimante 3D, ce n’est pas seulement une innovation technologique, c’est également un changement de société ».
Interview de Peter recueillie par J H
Sur ce blog, on pourra lire aussi :
« La troisième révolution industrielle » (Jérémie Rifkin) : https://vivreetesperer.com/face-a-la-crise-un-avenir-pour-l’economie/
« Un monde en changement accéléré » (Thomas Friedman) : https://vivreetesperer.com/un-monde-en-changement-accelere/
« Pourquoi et comment innover face au changement accéléré du monde » (Thomas Friedman) : https://vivreetesperer.com/pourquoi-et-comment-innover-face-au-changement-accelere-du-monde/
« Comprendre la mutation actuelle de notre société requiert une vision nouvelle du monde » (Jean Staune)
https://vivreetesperer.com/comprendre-la-mutation-actuelle-de-notre-societe-requiert-une-vision-nouvelle-du-monde/
« Vers une économie symbiotique » (Isabelle Delannoy)
https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
Vers une personnalité unifiée
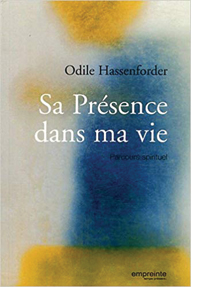 De plus en plus, quelque soient les tempêtes, nous percevons un mouvement d’unification dans le monde d’aujourd’hui (1) et, en abaissant les barrières entre les disciplines académique, ce mouvement affecte également notre usage du savoir (2). De plus en plus, l’être humain est envisagé dans une perspective globale, holistique. Le corps et l’esprit communique et interfère réciproquement comme le montre Denis Janssen dans son livre : « la guérison intérieure » (3). Dans le même mouvement, la médecine est appelée à reconnaître les interrelations entre les différents composants, les différents niveaux du corps et à s’engager dans une perspective intégrative (4). La spiritualité est, elle aussi, concernée au premier chef. On a pu la définir récemment comme une « conscience relationnelle », comme une relation avec soi-même, avec les autres, avec la nature et avec Dieu (5). La focalisation sur l’âme se détournant du corps, la méconnaissance de celui-ci, sont en train de s’éloigner. Tout est perçu en terme de relation. Comme le souligne Jürgen Moltmann dans sa théologie trinitaire, Dieu lui-même est communion d’amour, un amour qui se répand (6). La présence de Dieu se manifeste (7).
De plus en plus, quelque soient les tempêtes, nous percevons un mouvement d’unification dans le monde d’aujourd’hui (1) et, en abaissant les barrières entre les disciplines académique, ce mouvement affecte également notre usage du savoir (2). De plus en plus, l’être humain est envisagé dans une perspective globale, holistique. Le corps et l’esprit communique et interfère réciproquement comme le montre Denis Janssen dans son livre : « la guérison intérieure » (3). Dans le même mouvement, la médecine est appelée à reconnaître les interrelations entre les différents composants, les différents niveaux du corps et à s’engager dans une perspective intégrative (4). La spiritualité est, elle aussi, concernée au premier chef. On a pu la définir récemment comme une « conscience relationnelle », comme une relation avec soi-même, avec les autres, avec la nature et avec Dieu (5). La focalisation sur l’âme se détournant du corps, la méconnaissance de celui-ci, sont en train de s’éloigner. Tout est perçu en terme de relation. Comme le souligne Jürgen Moltmann dans sa théologie trinitaire, Dieu lui-même est communion d’amour, un amour qui se répand (6). La présence de Dieu se manifeste (7).
Cependant, dans ce monde en mutation, nous vivons en tension. Les représentations du passé sont encore là et font souvent barrage. Des attractions nouvelles nous bousculent parfois et nous dispersent. Les vicissitudes de la vie, les menaces concernant la santé sont toujours là avec les inquiétudes qu’elles génèrent. Nous avons toujours, et même de plus en plus, besoin de vivre en relation avec une présence, la Présence divine, source de confiance et de vie. Ainsi, ce texte d’Odile Hassenforder : « Vers une personnalité unifiée », écrit, il y a une dizaine d’années, nous paraît toujours innovant. Il vient nous éclairer dans nos cheminements de vie. C’est un texte de réflexion qui a demandé à Odile un effort de synthèse. Et c’est aussi un témoignage, car Odile a écrit ce texte tout en étant confrontée à une dure maladie. Aussi bien, nous savons qu’à l’époque, elle en avait parlé à son médecin, pour elle, un ami.
Ce texte est paru en 2006 sur le site de l’association à laquelle Odile participait activement : Témoins (8). Il a été ensuite publié dans le livre : « Sa présence dans ma vie » (9). Ici, Odile exprime une vision globale d’un être humain en marche vers une personnalité unifiée, dans une perspective de plénitude (en anglais : wholeness) (11) , en Christ ressuscité, promise et offerte par Dieu.
J H
- Une prise de conscience de la globalisation qui remonte à la conception de la « Noosphère » selon Teilhard de Chardin : https://fr.wikipedia.org/wiki/Noosphère
- Michel Serres. Petite Poucette. Une nouvelle manière d’être et de connaître. Vers un nouvel usage et un nouveau visage du savoir : https://vivreetesperer.com/une-nouvelle-maniere-detre-et-de-connaitre-3-vers-un-nouvel-usage-et-un-nouveau-visage-du-savoir/
- Vers une nouvelle médecine du corps et de l’esprit : https://www.temoins.com/vers-une-nouvelle-medecine-du-corps-et-de-lesprit/
- Médecine d’avenir. Médecine d’espoir : https://vivreetesperer.com/medecine-d’avenir-medecine-d’espoir/
- La vie spirituelle comme une « conscience relationnelle ». la recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
- Dieu, communion d’amour : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
- Jürgen Moltmann. Reconnaître la présence de Dieu à travers l’expérience : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-la-presence-de-dieu-a-travers-lexperience/ Richard Rohr. La danse divine (The divine dance) : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/ Une nouvelle manière de croire (Diana Butler Bass) : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/
- Sur le site de Témoins : Vers une personnalité unifiée : https://www.temoins.com/vers-une-personnalite-unifiee/
- Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Parcours spirituel. Empreinte, 2011 (p 207-211) Voir sur ce blog : Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Un témoignage vivant : https://vivreetesperer.com/odile-hassenforder-sa-presence-dans-ma-vie-un-temoignage-vivant/
Vers une personnalité unifiée
Les besoins, à différents niveaux, sont si nombreux que les multiples facettes de la relation d’aide sont toutes utiles. Pour ma part, depuis une trentaine d’années, j’ai fait bien du chemin. Dans les milieux charismatiques ou évangéliques, j’ai vu les merveilles de l’amour de Dieu, des miracles. J’ai aussi constaté qu’après amélioration, certaines personnes retombaient dans les mêmes ornières, malgré leur confiance en Dieu. Assistante sociale de profession, j’étais habituée à l’écoute et à la recherche de solutions, sociales bien sûr, mais aussi psychologiques.
Découvertes psychologiques.
Peu à peu, tout en m’imprégnant de la Parole de Dieu, j’ai cherché à approfondir mes connaissances psychologiques en suivant diverses formations, en lisant des livres spécialisés ou en consultant des personnes compétentes. J’en ai tiré une importante leçon de vie. Quelle grande espérance de savoir que la découverte des racines de ses dysfonctionnements permet de reconstruire sa personnalité selon ses désirs profonds. De même, quelle libération de pouvoir mettre à jour ses projections ou les déviations d’une mentalité parfois marquées par un héritage ancestral… qui déforment la réalité, court-circuitent la communication et faussent la relation. Et, parallèlement, l’introduction de nouvelles représentations suscite un meilleur équilibre. C’est toujours une joie profonde de voir une personne prendre peu à peu sa vie en main.
Une approche du corps.
Observant l’influence du psychisme sur le corps, je me suis attachée, ces derniers temps, à creuser davantage mes connaissances physiologiques. Ainsi j’ai découvert que la maladie pouvait être une interpellation positive lorsqu’elle nous permettait d’aller plus loin dans la compréhension des racines de notre mal-être. Découvrir les causes permet de mieux remédier au mal. Le corps est heureusement doté de capacités de régénération et de mécanismes d’auto-défense. Cependant, ces phénomènes peuvent céder face à de trop fortes agressions. La médecine globale, telle qu’elle se développe actuellement, cherche à remettre en ordre l’équilibre général: les circuits qui relient les différents organes à l’image de vases communicants. Tout se tient. Il y a un lien entre les glandes endocrines , les hormones, les réseaux nerveux, le flux sanguin et même les ondes énergétiques… La guérison devient alors la remise en ordre de l’harmonie corporelle. Le traitement médical intervient comme un soutien positif pour remédier aux dysfonctionnements. Il ne s’agit plus de supprimer simplement les symptômes, mais de les considérer comme des panneaux de signalisation. Je loue le Créateur pour cette merveille qu’est notre corps dans sa complexité et dans ses potentialités (Ps .139).
La Vie circule.
Aujourd’hui, en essayant de faire une synthèse de mes découvertes, je réalise combien il y a interrelation entre les différents registres de notre être , du physique au spirituel en passant par les divers aspects de la vie psychique, de l’émotionnel au cognitif.
En lisant la Bible, j’y découvre une vision dynamique qui éclaire cette compréhension. Dans les Proverbes, par exemple, n’est-il pas indiqué que « D’aimables paroles sont bienfaisantes pour le corps (Pr. 16.24). Le cœur joyeux est un excellent remède (Pr. 17.22). La langue du sage apporte la guérison (Pr.12.18) ».
Ma pensée s’est peu à peu imprégnée d’une vision herméneutique et systémique : interprétation personnelle de chaque phénomène en le situant dans un ensemble au sein d’un système en mouvement et en évolution. Tout se tient. Avec émerveillement, je me rends compte que les textes bibliques font écho à ma manière de voir toute chose. Dieu Trinitaire nous a créés à son image pour devenir à sa ressemblance: une personne en relation. Par ailleurs, comme le montre les comparaisons employées par Jésus : l’eau vive, la sève, la lumière…la vie divine circule à tous les niveaux. Lorsque nous n’y mettons pas d’obstacles, nous pouvons en percevoir les effets bénéfiques. Le pardon des péchés fait tomber les barrières. Dieu agit. Dieu régénère. Dieu guérit. Comme le dit l’Evangile en parlant de Jésus : « Une force sortait de Lui et les guérissait tous » (Luc 6.19, 8.46).
Notre participation à la création.
J’ai été secouée au plus profond de mon être, le jour ou j’ai réalisé que Dieu m’appelait à participer à la gérance de sa création, à commencer par ma personnalité. Qui suis-je pour être ainsi « collaboratrice » du Créateur (Ps.8) ? Dieu continue à créer avec chacun de nous et avec moi. Le Père Céleste agit sans cesse, dit Jésus, et Il m’invite à participer à la nouvelle création mise en route dans sa résurrection. En peu de mots ici, je voudrais dire comment je comprends le dernier verset des Psaumes comme une apothéose : « Que tout ce qui respire loue l’Eternel ! ». Toutes les expressions qui se traduisent par des mouvements, des énergies, des ondes… ne participent-elles pas à cette respiration ?
Une motivation forte.
Cette expression d’une vie qui nous dépasse et à laquelle nous participons, m’aide à accompagner positivement les personnes en difficulté. En effet, pouvoir imaginer que notre cheminement à chacun peut nous conduire vers une vie plus pleine et plus libre, est une forte motivation qui fait avancer. Ainsi une épreuve devient un tremplin pour rebondir dans l’espérance (Rom. 5.54), une invitation à faire le point pour réajuster sa vie, l’occasion d’accueillir la force divine (I Cor. 10.13) pour traverser cette crise et en sortir. En Christ ressuscité, la vie est plus forte que le mal qui a perdu son pouvoir de destruction absolue (I Cor. 15). Le but poursuivi est de guider le cheminement de guérison vers l’harmonie de l’être tout entier en utilisant des approches différentes selon la personne intéressée, à sa mesure, en fonction de sa situation et de sa culture. Ce travail intérieur peut parfois se traduire par une transformation profonde du mode de vie (Rom. 12.1). Ainsi la vie porte davantage de fruits (Jean 15).
Une nouvelle dynamique.
Ainsi concrètement, il me paraît important d’apprendre à voir au quotidien ce qui est beau et bon autour de soi et en soi en développant ce que Paul appelle les fruits de l’Esprit (Gal. 5.23, Eph. 5.9, Col. 3.12…). Exprimer ses observations positives en les partageant avec d’autres, bénir en toutes circonstances (Mat. 5.45), voilà des attitudes qui développent en nous paix et joie, sentiment de plénitude dans la présence de Dieu (Rom. 14.17). Bien sûr, il serait mal venu d’imposer mes représentations, y compris par l’intermédiaire de versets bibliques. Chacun doit pouvoir exprimer ses souffrances comme son mal de vivre, mais à partir de là, il est possible de découvrir tout ce qui est positif dans sa vie et favoriser ainsi une dynamique nouvelle qui va avoir une influence bénéfique sur le psychisme et sur le corps. Ainsi j’encourage mon interlocuteur à manifester ses désirs profonds, et, ainsi à découvrir et à développer ses potentialités. C’est de cette façon qu’il pourra reconstruire librement sa vraie personnalité : « corps, âme, esprit » (I Th. 5.23). J’adhère à ce commentaire trouvé dans l’édition du Semeur de la Bible: Il s’agit de l’être humain, non en trois dimensions superposées, mais dans une globalité de la personne dans ses trois dimensions, pour vivre en contact, en relation: le corps dans sa présence au monde, l’âme, l’être intérieur dans sa relation au monde, l’esprit, l’être intérieur dans sa relation avec Dieu.
En marche.
Dans les limites de ce texte, il n’est pas possible d’illustrer, par des exemples concrets, ce panorama ou bien des nuances doivent être apportées. J’aime partager cette vision qui m’habite et suscite en moi un élan de vie. C’est le fruit d’une mise en place progressive de ma vie dans le projet d’un Dieu qui veut mon bonheur. Même dans les temps ou il me faut traverser la vallée de l’ombre, Il se tient à mes cotés et me reçoit à sa table en « invitée d’honneur » (Ps. 23). Sans ambition, ni prétention, simplement à ma mesure, je cherche à tenir ma place dans cette marche humaine que nous sommes appelés à effectuer ensemble en Eglise selon le projet divin (Eph. ch 1) . Cette vision, qui inspire ma vie, me permet d’affirmer à toute personne rencontrée que la vie vaut la peine d’être vécue.
Odile Hassenforder.
Voir aussi :
Médecine d’avenir. Médecine d’espoir : https://vivreetesperer.com/medecine-d’avenir-medecine-d’espoir/
Les progrès de la psychologie. Un grand potentiel de guérison : https://vivreetesperer.com/les-progres-de-la-psychologie-un-grand-potentiel-de-guerison/
La prière, selon Agnès Sanford, une pionnière de la prière de guérison : https://vivreetesperer.com/la-priere-selon-agnes-sanford-une-pionniere-de-la-priere-de-guerison/
De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin

Un manifeste de Cynthia Fleury : « Le soin est un humanisme ».
 Plus ou moins, nous ressentons notre fragilité. Si nous sommes tous des êtres vulnérables, nous pouvons ressentir cette vulnérabilité comme une charge, comme un poids, comme une épreuve. L’aide réside dans un environnement relationnel. Et cette relation est évoquée dans différents contextes. En christianisme, par exemple, c’est l’aide que vient apporter le « bon samaritain », dans la parabole du même nom. C’est l’aide qui se trouve dans la relation avec Dieu, telle qu’elle est annoncée dans la Parole biblique dans une multitude de passages.
Plus ou moins, nous ressentons notre fragilité. Si nous sommes tous des êtres vulnérables, nous pouvons ressentir cette vulnérabilité comme une charge, comme un poids, comme une épreuve. L’aide réside dans un environnement relationnel. Et cette relation est évoquée dans différents contextes. En christianisme, par exemple, c’est l’aide que vient apporter le « bon samaritain », dans la parabole du même nom. C’est l’aide qui se trouve dans la relation avec Dieu, telle qu’elle est annoncée dans la Parole biblique dans une multitude de passages.
Si la compassion est également enseignée dans d’autres traditions, les références chrétiennes ont inspiré un mouvement qui va bien au delà du christianisme et nous permettent d’y reconnaître l’œuvre de l’Esprit. Michel Serres, dans son livre : « Une philosophie de l’histoire » (1), nous parle de la venue d’un âge doux par rapport à un âge d’oppression qui a duré pendant des siècles en pression de la violence et de la maladie. Effectivement, dans les dernières décennies, il y a bien des signes qui traduisent une profonde transformation des mentalités dans une expression croissante d’empathie et de sollicitude. C’est, entre autres, le mouvement du Care qui est apparu aux Etats-Unis au début des années 1980, un courant de pensée et de pratique initié par Carol Gilligan (2).
Philosophe et psychanalyste, Cynthia Fleury (3) intervient aujourd’hui en France dans le champ du soin et de la santé. Elle a fondé la première chaire de philosophie dans un hôpital français, l’hôpital Sainte Anne. Elle est professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers, dans une chaire : Humanités et santé et s’emploie à promouvoir une pensée humanisante dans le système médical français. A une époque de grandes mutations sociales et technologiques, cette pensée humanisante est bien exprimée dans son récent livret : « Le soin est un humanisme » (4). Elle nous y parle de la vulnérabilité humaine et de la sollicitude que celle-ci appelle en regard. Quelques citations ici rapportées nous éclairent sur la démarche de Cynthia Fleury et nous encouragent à entrer dans une lecture approfondie de ce livret.
Reconnaître la vulnérabilité
Cynthia Fleury met en évidence la vulnérabilité humaine comme un point de départ de l’approche humanisante du soin .
« La vulnérabilité est consubstantielle à tout homme et finalement assez peu spécifique ». « La vulnérabilité invite l’homme à inventer un « éthos », à produire un geste soucieux de la différence de l’autre. Elle fait naitre chez nous une préoccupation, une attention, une qualité inédite de pensée au monde et aux autres » (p 8).
« Reconnaître nos limites, c’est faire quelque chose, bâtir une société qui ne soit pas celle du ressentiment, et un être humain, qui ne soit pas, lui non plus l’objet – ou le sujet – de pulsions mortifères » ( p 7). « Il faut, dès lors, se soucier de rendre « capacitaires » les individus, c’est à dire leur redonner aptitude et souveraineté dans ce qu’ils sont ». ( p 7). C’est prendre en charge la vulnérabilité sans s’y enfermer et sans y enfermer les autres, au contraire en ouvrant des voies de libération. « Je souhaite porter et promouvoir une vision de la vulnérabilité qui ne soit pas définitive, mais, tout au contraire, inséparable d’une nouvelle puissance régénératrice des principes et des usages. La vulnérabilité est une combinaison d’hypercontraintes qui sont souvent, d’emblée, dévalorisées, stigmatisées par la société comme étant non performantes, invalidantes et créatrices de dépendances. Mais elle nous invite, nous, les « autres », à mettre en place des manières d’être et de se conduire, précisément autres, aptes à faire face à cette fragilité pour ne pas la renforcer, voire pour la préserver au sens où cette fragilité peut être affaire de rareté, de beauté, de sensibilité extrême » ( p 7-8).
La dignité de l’être humain, c’est d’être irremplaçable.
Cynthia Fleury se fonde sur une vision de « l’exceptionnalité de l’homme », selon elle, « la seule manière d’imaginer et de maintenir l’humanisme du genre humain » ( p 6).
C’est dans cette perspective que Cynthia Fleury s’est engagée dans le domaine du soin. « La notion d’humanités fait le lien avec le premier territoire de recherche qui a été le mien : la Renaissance, les Lumières et bien au delà. Poser les humanités au cœur de la santé, c’est se rattacher à cette histoire par laquelle l’homme ne demeure humain qu’à condition de refuser de se dessaisir de sa propre faculté de jugement » ( p 9).
Cynthia Fleury s’inquiète de la démission de la personne, de la démission du patient et veut l’aider à y échapper. « Je pense être devenu psychanalyste sur le tard pour me tenir au plus près de cette volonté flirtant avec l’appel à l’aide et la tentation de la disparition » ( p 9).
Si l’humain ne se sent plus reconnu dans sa valeur propre, alors, il perd le goût de la vie. « Quant à la notion d’irremplaçabilité, je l’ai expérimenté par défaut, en clinique, avec mes patients. Les individus qui ont un sentiment de remplaçabilité tombent malades et peuvent opérer des passages à l’acte contre eux-mêmes ou autrui… Il y a comme une détérioration du sujet en eux… » (p 10).
Le soin, une fonction en partage
Un soin véritable requiert une relation, un dialogue, un partage. Ce ne peut être une pratique imposée d’en haut sans consensus.
« Le soin n’appartient pas à une caste de soignants qui distribueraient leurs soins comme d’autres de bonnes paroles, à des patients incapables d’être actifs dans la démarche du soin. Le soin est une fonction en partage relevant de l’alliance dialectique, créative, des soignants et des soignés qui ensemble font éclore une dynamique, notamment tissée grâce à la spécificité des sujets qu’ils sont .
Si le soin est central pour le sujet… le sujet est également central pour le soin – au sens où « le colloque singulier » ou encore la qualité des relations intersubjectives entre soignés et soignants, entre soignants eux-mêmes, sont déterminants, tout comme la reconnaissance subjective réciproque entre patients et soignants » ( p 20-21).
Sollicitude et patience des soignants
Une attitude empathique et relationnelle joue un rôle essentiel dans la réussite du soin. C’est « une sollicitude et une patience de la part des soignants » . Voilà qui permet de développer une dynamique de vie.
« Veiller, dans la santé, à construire une « vérité capacitaire » qui donne au malade les moyens physiques et psychiques de dépasser sa maladie est un fait de toute importance pour le médecin. Dire la vérité au malade est certes nécessaire. Cependant, la nécessité de veiller à ce que cette vérité n’affaiblisse pas le sujet et les aidants, mais au contraire les renforce dans leur quête de traitement et de guérison est tout aussi décisive, d’autant que le régime d’incertitude dans lequel évolue la médecine invite à quelque humilité par rapport à la perception de ce qui est la vérité » ( p 23).
« Sollicitude et prudence, articulées à des savoir-être et des savoir-faire spécifiques sont déterminants pour créer l’optimisation du soin, les conditions d’acceptabilité du traitement et son observance comme les conditions qui peuvent en découler » ( p 23).
La technicisation croissante de la médecine peut engendrer une impression d’impuissance chez le patient et une angoisse vis à vis de mécanismes dominateurs. « Dans un univers de soin de plus en plus technicisé, le sentiment de déshumanisation peut être fort et le sentiment d’abandon renforcé chez le patient. L’accompagnement humain pour une meilleure appropriation de la technicité des soins et des traitements est donc essentiel pour éviter chez le patient, un sentiment de chosification ou tout simplement de perte d’autonomie ou la perception d’un consentement bafoué, car non suffisamment informé ». (p 24-25)
Des institutions à humaniser
On sait combien l’environnement a une influence sur ceux qui y participent. C’est dire l’importance de l’ambiance dans les hôpitaux.
« La conception d’une fonction soignante en partage invite à étudier les organisations institutionnelles sociales et sanitaires et à vérifier qu’elles soient compatibles avec une éthique de soin » (p 26)
Maladies chroniques et continuité des soins
Au cours des dernières années, nous sommes entré dans une période nouvelle. « la définition de la maladie a profondément changé. La maladie n’a pas basculé du côté de la mort, mais du côté de la vie. Etre malade signifie désormais plus souvent vivre avec un mal qu’y succomber directement, voire vivre mal avec un mal qui vit » (p 29).
Que faire aujourd’hui par rapport à cette omniprésence des maladies chroniques ? Elle pose question, non seulement au corps médical, mais à ceux qui y sont confrontés et cherchent une nouvelle approche. « Comment mieux soigner cela et accompagner ces sujets ? Là encore, il convient de se remémorer qu’il n’y a pas de maladie, mais seulement des sujets qui tombent malade et que la reconnaissance de cette subjectivité est la seule opérationnelle pour la production du soin …Tout est là pour complexifier le rapport
à la santé et à la guérison, et pour montrer qu’un soin demain réellement efficace pour le patient saura concilier guérison et rétablissement » ( p 30).
De même, le tournant ambulatoire de l’hôpital requiert un changement d’attitude vis à vis des patients. On doit reconnaître celui-ci « en tant que sujet et porteur d’un savoir spécifique nécessaire à la compréhension de son mal. Si le patient n’est pas considéré comme un « agent », un acteur de son traitement, le tournant tournera court » (p 31).
Une voie ouverte
Cynthia Fleury se fonde sur l’exceptionnalité de l’humain. « Je considère pour ma part que la défense de l’exceptionnalité de l’homme reste la seule manière d’imaginer et de maintenir l’humanisme du genre humain » (p 6). Dans un autre langage, la vision chrétienne proclame que le vie humaine est sacrée. « Toute personne est une histoire sacrée », tel est le titre d’un livre emblématique de Jean Vanier (5), le fondateur de l’Arche, une œuvre ou les plus vulnérables, des déficient mentaux sont reconnus comme des personnes à part entière (6). Le discours de Cynthia Fleury s’inscrit sur le seul registre de la philosophie. Il procède d’une approche existentialiste. « L’homme se fait. Il est ce qu’il fait. Se faire, c’est se former. C’est prendre soin de. Et le travail ne se résume pas à une tâche de gestionnaire. Il est préalablement – et devrait être en dernière instance – un mode d’attention aux choses et aux usages » (p 6). Dans ce livret, Cynthia Fleury nous expose son parcours de philosophe et de psychanalyste dans les chaires où elle expose les rapports entre les humanités et la santé (p 14-16). Sa vision du soin s’inscrit dans une perspective de société. « s’informer, (se) former,, (se) transformer, voilà ce que l’épistémologie de la démocratie enseigne à la politique. Et c’est ce qu’il y a derrière le grand continuum du soin : l’attention aux idées, à la connaissance, et l’attention aux êtres et au monde » (p 32).
Dans ce livret, Cynthia Fleury nous communique la dynamique de sa pensée. Certaines de ses expressions nous paraissent signifiantes et éclairantes. Et ainsi, elles nous permettent de mesurer la réalité à laquelle nous sommes tous confrontés, et, dans cette conscience, de mieux influer et de mieux intervenir dans cette réalité.
Et, parce qu’elle met en valeur de bonnes pratiques visant à « donner au malade les moyens physiques et psychiques de dépasser sa maladie » et ce que cela requiert en terme d’encouragement et d’accompagnement, monte en nous le désir de participer à cette tâche de soutien dans les limites de notre condition, et s’éveille en nous la mémoire de soignants que nous avons rencontrés ou rencontrons dans nos vies, et auxquels nous devons tant.
J H
- Michel Serres. darwin, bonaparte et le samaritain. Une philosophie de l’histoire. Le pommier, 2016 https://vivreetesperer.com/une-philosophie-de-lhistoire-par-michel-serres/
- Ethics of care : https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_of_care
- Vie et œuvre de Cynthia Fleury : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cynthia_Fleury
- Cynthia Fleury. Le soin est un humanisme. Tracts Gallimard N° 6, mai 2019 Un podcast de France Culture : « Eduquer, soigner sont les gestes paradigmatiques de la société » : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/cynthia-fleury?fbclid=IwAR3PxZuELDtmP5BxHCiCdAKPSq0vyHRAGDGCu67pcoItk9tt2SpaCZgmKnY
- Jean Vanier. Toute personne est une histoire sacrée, 1994 Voir aussi sur ce blog : « Devenir plus humain » : https://vivreetesperer.com/devenir-plus-humain/
- L’Arche : https://www.larche.org/fr/web/guest/accueil?gclid=CjwKCAjwuqfoBRAEEiwAZErCsk0rwpWzj48z-j9y32algHh0dwOrTYw9qDcJ2lwhUzSykZTySKUcBhoCqcsQAvD_BwE
Voir aussi :
« Médecine d’avenir, médecine d’espoir. « La médecine personnalisée », d’après Jean-Claude Lapraz » : https://vivreetesperer.com/medecine-d’avenir-medecine-d’espoir/
« Les plantes médicinales au cœur d’une nouvelle approche médicale. Phytothérapie clinique intégrative et médecine endobiogénique » . https://vivreetesperer.com/les-plantes-medicinales-au-coeur-dune-nouvelle-approche-medicale-phytotherapie-clinique-integrative-et-medecine-endobiogenique/
« Les progrès de la psychologie. Un grand potentiel de guérison ». https://vivreetesperer.com/les-progres-de-la-psychologie-un-grand-potentiel-de-guerison/
Un matin tôt, sur la route vers le travail…
Éblouie pour la clarté du soleil qui sort la tête de la brume, les champs et les arbres sont encore endormis…
J’arrête ma voiture pour immortaliser ce moment où je ressens la présence de Dieu dans toute cette beauté qui s’éveille !
Un nouveau jour qui commence, dans sa présence.
le monde tient par sa main, et parfois la beauté est telle que mon cœur brûle de reconnaissance et d’amour pour celui qui a tout créé !
« Mon Dieu, mon Roi,
sois attentif à mes appels,
C’est à toi que j’adresse ma prière
Dès le matin, Seigneur.
Entends-moi.
Dès le matin je me prépare
à être reçu chez toi, et j’attends ».
Tiré du psaume 5 (Bible en français courant)
CJ
Comment entendre les principes de la vie cosmique pour entrer en harmonie
Diversité, essence et communion
Nous vivons dans un univers en évolution, dans un monde vivant. Avons-nous conscience d’en faire partie ou bien nous en détachons-nous pour le dominer, pour nous replier sur nous ou pour nous en évader ? Si nous entendons les principes de la vie cosmique, les lois de la vie, alors nous participerons à la vie qui nous est donnée et nous pourrons vivre en harmonie. Comment comprendre le rapport entre diversité et unité ? Comment participer au grand mouvement d’interconnexion et de reliance constamment à l’œuvre ? Comprendre le monde, c’est nous comprendre nous-mêmes. Nous comprendre, c’est comprendre le monde et y participer. C’est une vision où s’allie la science et la spiritualité.
Aujourd’hui, les menaces qui mettent en danger les équilibres du vivant sur notre planète engendrent une prise de conscience écologique. Cette prise de conscience n’appelle pas seulement une transformation majeure de la vie économique, un changement de la production et de la consommation, mais aussi, dans le même mouvement, une transformation de notre genre de vie (1). Et donc, ce qui nous est demandé, c’est une nouvelle manière d’envisager la vie dans son essence même.
Dans l’Occident chrétien, à partir de la renaissance, en phase avec une certaine conception de Dieu, la nature a été soumise à une gouvernance autoritaire (2). Si, dans le même temps, le matérialisme s’est répandu, face à ces errements, à la fin du XXè siècle, des théologiens se sont dressés et nous ont proposé une nouvelle vision de Dieu et du monde. Ainsi, en 1985, Jürgen Moltmann, déjà reconnu comme le théologien de l’espérance, publie un livre : « Dieu dans la création » , qui porte déjà comme sous-titre, « Traité écologique de la création ». (3). Aux Etats-Unis, Thomas Berry (4), prêtre catholique engagé dans une intime compréhension des grandes cultures religieuses, de la Chine et l’Inde jusqu’aux traditions des peuples premiers, disciple de la pensée de Teilhard de Chardin, s’affirme comme un chercheur passionné à l’étude de la terre, comme un « écothéologien ». Un peu plus tard, en 2015, paraît « Laudato Si’ », la lettre encyclique du Pape François sur la sauvegarde de la maison commune (5).
La sœur franciscaine, Joan Brown (6), participe à l’inspiration de Thomas Berry et collabore avec Richard Rohr, fondateur et responsable du « Center for action and contemplation » à Albuquerque (New Mexico) (7). Elle participe à des mouvements alliant écologie et spiritualité comme les « sœurs de la terre » (« Sisters of earth ») (8). Dans l’Etat américain du Nouveau Mexique, elle anime et dirige un centre écologique et interconfessionnel : « New Mexico Interfaith Power and Light » (9). Le centre appuie les églises engagées dans la transformation écologique et participe à des actions environnementales. Dans le cadre d’un cycle de méditations : « Unité et diversité » publié du 2 au 8 juin dans le cadre des méditations quotidiennes diffusées par le « Center for action and contemplation », Joan Brown a écrit une contribution : « Diversité, essence et communion » (10).
Diversité, essence et communion
« Nous tous qui vivons, respirons et marchons sur cette Mère Terre, magnifique et sainte, nous tous, sommes appelés à comprendre les principes inhérents à l’énergie interdépendante et dynamique qui vibre dans chaque élément de la vie ».
Joan Brown distingue en effet trois mouvements qui ont émergé dès la première apparition de la vie, il y a 13,8 milliards d’années.
Ces mouvements, ces énergies, ces principes sont :
« la différenciation ou la diversité
La subjectivité, l’intériorité ou l’essence
La communion, la communauté et l’interconnexion ».
« Comprendre ces principes d’action est essentiel dans les temps critiques où nous vivons, là où la diversité engendre des conflits, où la vie se déroule à un niveau souvent superficiel et où l’individualisme est rampant ». Ainsi, Joan Brown nous décrit ses principes d’action.
D’abord, chacun de nous – chaque être humain, chaque goutte d’eau, chaque molécule, chaque oiseau, chaque grain de sable, chaque montagne – est distinct ou différent. Chacun, chacune est une manifestation distincte de l’énergie du Divin Amour. L’univers prospère et ne peut exister sans cette diversité. Ces différences même que nous évitons ou même détruisons, sont nécessaires à la vie pour qu’elle se poursuive dans une multitude de formes magnifiques.
Joan Brown exprime ensuite un second principe cosmique, « plus facilement accessible aux gens de toute tradition religieuse ». Ce principe, c’est « l’intériorité ou l’essence ». Chaque créature est sainte. Chaque brin d’herbe, chaque sauterelle, chaque enfant est saint. La dégradation écologique, le racisme, la discrimination, la haine, le manque d’intérêt pour œuvrer en faveur de la justice et de l’amour, tout cela évoque un manque de respect, une incapacité d’honorer ce qui se tient devant moi… Pour aider les gens à gérer le changement climatique et à s’y adapter, ce qui est le sujet le plus critique de notre époque, je crois que nous devons nous mettre en contact avec l’essence sacrée de chaque chose qui existe, de chaque existence.
Le troisième principe cosmique est assez évident. « La communion ou la communauté est intimement liée à la diversité/différenciation et à l’intériorité/essence. Joan Brown évoque une citation attribuée à un moine bouddhiste, Thich Nhat Hanh : « Nous sommes ici pour nous éveiller, sortir de l’illusion de la séparation ». « La force gravitationnelle de l’amour entraine chaque être vivant et chaque chose à entrer en relation et en communion ».
Nous avons besoin d’une prise de conscience. « Si nous ne pouvons pas aimer notre prochain comme nous-même, c’est parce que nous ne nous représentons pas notre prochain comme nous-même », écrit Béatrice Bruteau, elle aussi « écospirituelle ». « Si nous sommes incapables de voir que nous sommes en communion avec l’autre, nous ne réaliserons pas que ce que nous faisons à nous-même, nous le faisons à l’autre et à la terre. De même, nous ne réalisons pas qu’en fin de compte, notre manque de compréhension se retourne contre nous en violence, que ce soit la peur des autres races et de la diversité ou la destruction de la terre parce que nous voyons le monde naturel comme un objet plutôt que comme un sujet avec une intériorité ».
C’est un appel à voir plus profond , plus grand. « Nous sommes appelé à être plus grand que ce que nous pouvons imaginer être en ce moment. Les principes cosmiques sont une nouvelle manière de comprendre, de voir et d’agir dans un monde qui parait déchiré par une mécompréhension de la beauté de la diversité, de la sainteté de l’essence et de la force évolutionnaire de la communion ».
Nous ne attarderons pas sur l’arrière plan dans lequel nous voyons cette réflexion : la création en marche « souffrant des douleurs de l’enfantement » (Rom 8.22) et la dynamique victorieuse de la libération divine en Christ ressuscité. Comme l’écrit Jürgen Moltmann, « le Christ ressuscité est le Christ cosmique. Il est présent en toutes choses. Finalement, il est aussi celui qui vient et qui remplira le ciel et le terre de sa justice ».
La nouvelle spiritualité de la terre éveille une « humilité cosmique ». Elle suscite également un amour cosmique tel que le staretz Sosima l’exprime dans le roman de Dostoevski : « les frères Karamazov » : « Aime toute la création, l’ensemble et chaque petit grain de sable. Aime les animaux, les plantes, chaque petite chose. Si tu aimes chaque petite chose, alors le mystère de Dieu en elle, te sera révélé. Une fois qu’il t’est révélé, alors tu le percevras de plus en plus chaque jour. Et, à la fin, tu aimeras l’univers entier d’un amour sans limites » (11)
Dans ce contexte, combien le regard de Joan Brown nous éclaire et nous apporte une manière nouvelle, une manière constructive de comprendre, de voir et d’agir dans ce monde.
J H
- « Vers une économie symbiotique » : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/
- « Vivre en harmonie avec la nature » : https://vivreetesperer.com/vivre-en-harmonie-avec-la-nature/
- Jürgen Moltmann. Dieu dans la création. Traité écologique de la création. Cerf, 1988 Voir aussi : « Dieu dans la création » : https://lire-moltmann.com/dieu-dans-la-creation/
- Vie et œuvre de Thomas Berry : https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Berry http://encyclopedie.homovivens.org/documents/thomas_berry
- « Convergences théologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, Pape François et Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
- Sister Joan Brown : https://www.globalsistersreport.org/authors/joan-brown
- Center for action and contemplation : https://cac.org/about-cac/
- Sisters of the earth : https://www.sisters-of-earth.net
- New Mexico Interfaith Power and Light : https://www.nm-ipl.org
- « Diversity, Essence and communion » : https://cac.org/diversity-essence-and-communion-2019-06-07/
- Jürgen Moltmann. The living God and the fullness of life.World council of churches, 2016 « In the fellowship of the earth » p 80-85 https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/
Voir aussi sur ce blog :
La danse divine (The Divine Dance) par Richard Rohr : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/
Face à la violence, l’entraide, puissance de vie dans la et dans l’humanité : https://vivreetesperer.com/face-a-la-violence-lentraide-puissance-de-vie-dans-la-nature-et-dans-lhumanite/
L’homme, la nature et Dieu. Tous interconnectés dans une communauté de la création : https://vivreetesperer.com/lhomme-la-nature-et-dieu/
Aux couleurs du printemps avec les sites Flickr
« La nature porte toujours les couleurs de l’esprit »
Ralph Waldo Emerson
Les sites de photo regroupés dans le réseau Flickr (1) nous offre une multitude de merveilles pour réjouir nos yeux et nourrir notre esprit. C’est comme un grand jardin où nous pouvons nous promener. Et nous pouvons y découvrir les beaux paysages de ce vaste monde.
En phase avec telle ou telle image, notre regard s’y arrête et nous admirons. C’est le temps de l’admiration. C’est le temps du regard.
Bertrand Vergely, philosophe et théologien, nous en parle. : « Comme son étymologie l’indique, « admirer veut dire : « mirer avec », autrement dit tourner son regard afin de regarder » (2a). Aimer regarder, apprendre à regarder, c’est abandonner les choses futiles. C’est aller à l’essentiel . C’est savoir reconnaître la beauté. Ce peut être une impression forte : « Devant l’œuvre belle, nous naissons à la plénitude sans qu’il soit possible de dire autre chose », nous rapporte Marie-Magdeleine Davy de la pensée de Simone Weil (3). Bertrand Vergely nous parle ainsi de la beauté du monde : « Beauté du monde. Les anciens voyaient la nature comme « Logos ». L’émerveillement nous fait remonter à cette intention première, source de toute vitalité. On ne vit pas dans un univers vide et mort, on vit parce que l’univers est saisissant » (2b) . Ainsi, ces images de la nature porte un renouveau. Comme nous le dit Paula W, en citant Emerson, à propos de l’une de ces photos : « La nature porte toujours les couleurs de l’esprit ». Avec reconnaissance pour tous ceux qui prennent ces photos ou participent en les commentant ou les partageant, goûtons la beauté de la nature au printemps
J H
Pour découvrir l’œuvre de chaque auteur, merci de cliquer sur les images.
- Présentation du réseau Flickr sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Flickr
- Bertrand Vergely. Retour à l’émerveillement. Albin Michel, 2010 (espaces libres) 2a p 201 2b p 10
- Marie-Magdeleine Davy. Simone Weil, 1956
Aux couleurs du printemps
« Wallflower »
« Nature always wear the colors of the spirit » Ralph Rando Emerson « Le nature porte toujours les couleurs de l’esprit »
Photo de Paula W Angleterre 25 avril 2019
« Everything you can imagine is real » Pablo Picasso
Une tulipe. « Tout ce que vous pouvez imaginer est réel »
Photo de johnshlau Hong kong 15 mars 2019
« Belle et douce glycine »
Photo de josettegoyer 17 avril 2019
« El viejo olivo » Le vieil olivier
Photo de gloria castro Province de Valencia Espagne 3 avril 2019
« New life » Vie nouvelle
Photo de Sandra Bartocha Postdam Allemagne 3 avril 2019
« Don’t worry Be happy » Ne vous inquiétez pas Soyez heureux
Photo de hitohira 6 avril 2019
https://www.flickr.com/photos/tanioto/
« Delicious color tulip » Couleur délicieuse de la tulipe
Photo de Tomo M 21 avril 2019
Voir aussi sur ce blog :
« Un regard lumineux dans un pays lumineux »
(le site Flickr de Gloria Castro)
https://vivreetesperer.com/un-regard-lumineux-dans-un-pays-lumineux/
« Le jardin de Paula »
(le site Flickr de Paula W)
https://vivreetesperer.com/le-jardin-de-paula/
« Effets de lumière dans une campagne bocagère »
(Le site Flickr de Julie Falk)
https://vivreetesperer.com/effets-de-lumiere-dans-une-campagne-bocagere/
Jean Jaurès : mystique et politique d’un combattant républicain, selon Eric Vinson et Sophie Viguier-Vinson
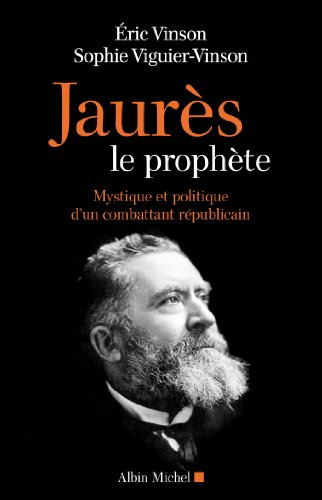 Une vision spirituelle, dans et pour le monde
Une vision spirituelle, dans et pour le monde
A certains moments dans l’histoire, de grandes personnalités émergent. Elles portent une cause et vivent un idéal. Ce fut le cas de Mandela et de Gandhi (1). En France, ce fut le cas de Jean Jaurès. Eric Vinson et Sophie Viguier-Vinson ont écrit à leur sujet. Et nous revenons ici sur un de leurs livres : « Jaurès le prophète. Mystique et politique d’un combattant républicain » (2). « Tout le monde croit connaître Jean Jaurès, icône républicaine qui demeure encore dans les mémoires, cent ans après sa mort (en 1914), le père du socialisme français, le fondateur de « l’Humanité », l’historien de la Révolution Française, l’inlassable combattant dreyfusard, le champion parlementaire de la séparation des Eglises et de l’Etat, le pacifiste assassiné à la veille de la Grande Guerre (3). Mais d’où lui venait ce souffle qui l’habitait, quel était le fondement de son élan humaniste et en quoi croyait-il ? » (2a). Eric et Sophie Vinson décrivent et analysent ici la pensée philosophique, métaphysique de Jean Jaurès dans le contexte de son époque.
Voilà une recherche qui nous concerne. A certains moments de l’histoire, dans telle conjoncture, l’accès à une inspiration religieuse peut être entravé parce que l’institution correspondante s’enferme, s’éloigne de la vie, adopte une posture dominatrice . Au XIXè siècle, l’Eglise catholique s’érigea en pouvoir hostile aux acquis de la Révolution Française. Ce fut « la guerre des deux France ». Mais alors comment le christianisme pouvait-il être vécu, lui, qui, en France, avait été associé, pour une part importante, au catholicisme ? Comment l’inspiration évangélique allait elle contribuer à irriguer la société française ? Lorsque l’eau vive se heurte à un barrage, elle prend de nouveaux chemins. Dans notre humanité, il nous faut explorer et reconnaître les formes nouvelles qui viennent compenser un manque. Aujourd’hui, au cours des dernières décennies, un écart s’est creusé entre les institutions religieuses, accusé pour certaines, moindre pour d’autres, et une nouvelle manière de vivre et de penser. Aujourd’hui encore des scandales apparaissent qui témoignent de l’inadéquation et de la faillite de tel système religieux Alors, pour que l’inspiration spirituelle, l’inspiration évangélique, puissent continuer à irriguer notre société, il est important que des pensée et des formes nouvelles apparaissent en apportant, dans toute sa diversité, une offre renouvelée. La question s’est posée à la fin du XIXè siècle. Dans une autre contexte, elle se pose aujourd’hui.
Voilà pourquoi, le livre d’Eric et de Sophie Vinson nous paraît important, car il nous montre, entre autres, comment, à cette époque, Jean Jaurès a fondé son action politique et sociale sur une vision spirituelle. Cette vision s’est exprimée dans une dimension philosophique. « Jean Jaurès est non seulement un philosophe, normalien, agrégé, un auteur rivalisant avec Bergson, mais aussi un authentique spirituel. Si l’on néglige sa thèse sur « la réalité du monde sensible », si l’on passe à côté de sa spiritualité- qui s’oppose au pouvoir temporel de l’Eglise catholique, mais reconnaît en l’homme la présence du divin-, on ignore les principes mêmes qui ont guidé toute son action » (2a).
La réalité du monde sensible
Eric et Sophie Vinson nous exposent la pensée de Jaurès telle qu’elle se déploie dans sa thèse principale de philosophie : « De la réalité du monde sensible » éditée en 1891 et rééditée quasiment à l’identique en 1902. « Nous voulons », disent-ils, « présenter cette philosophie en elle- même, à partir de sa dimension spirituelle ». Dans ce bref article, nous ne pouvons suivre le fil du raisonnement qui nous est décrit dans ce livre auquel on se reportera. Nous nous bornerons à quelques notations.
En affirmant la « réalité du monde sensible », Jaurès s’oppose d’une part au « subjectivisme qui réduit le monde sensible, matériel, au sujet », et, d’autre part, « au matérialisme qui réduit le sujet au monde matériel » (p 68). Et il dépasse « le divorce du sujet et de l’objet, grâce à la notion d’être, ce grand « englobant » métaphysique injustement oublié par les deux courants rivaux : subjectivisme et matérialisme (p 55).
Ce qu’affirme Jaurès, c’est « l’unité dynamique de tout ce qui est » (p 64). « Nous constatons qu’il y a dans toutes les consciences individuelles , une conscience absolue et indépendante de tout organisme étroit et éphémère, qu’elle est présente partout sans être enchainée nulle part, qu’elle n’a d’autre sens que l’infini lui-même, et qu’ainsi toutes les manifestations de l’infini, l’espace, la lumière, le son, trouvent en elle, leur centre de ralliement et une garantie d’éternelle réalité » ( p 57). Et c’est dans cette perspective que Jaurès envisage la divinité : « Dieu ne doit pas être pensé sur notre modèle, seulement plus grand. Il est la réalité elle-même… ». « La conscience absolue n’est pas un moi comme les autres, elle est le moi de tous les mois, la conscience de toutes les consciences… » ( p 65). Les auteurs nous expliquent les ressorts de cette pensée. « Ce Dieu-conscience absolue » semble être en quelque sorte l’« intériorité » profonde – autrement dit le « cœur » – des mois particuliers, des consciences individuelles comme des vérités rationnelles. Présent en eux au tréfonds, Il ne se réduit pas à eux et les dépasse qualitativement de manière infinie. Mais Il les rassemble aussi par Sa seule présence, « unité de toutes les unités ». Actif au cœur de toutes les réalités finies, Lui, l’infini divin, il les contient ainsi toutes d’un certain point de vue…Et cela constitue l’ ordre ordinaire des choses simples, simplement incompris et même inaperçu par la plupart ». A deux reprises, Jaurès cite textuellement le discours de Paul devant l’aéropage (Actes 17. 28) : « En la Divinité, nous avons la vie, le mouvement et l’être » (p 64).
A la suite de ce raisonnement, la conclusion de la thèse vient nous éclairer en rejoignant notre expérience quotidienne : « Précisément parce que c’est la conscience absolue qui fait la réalité du monde, tous les individus, toutes les forces du monde gardent leur réalité familière et leurs devoirs familiers . Dieu, en se mêlant au monde, n’y répand pas seulement la vie et la joie, mais aussi la modestie et le bon sens… Dans la conscience absolue et divine, ce n’est pas seulement le ciel grandiose et étoilé qui trouve sa justification, mais aussi la modeste maison où, outre la table de famille et le foyer, l’homme, avec ses humbles outils, gagne pour lui et les siens, le pain de chaque jour » (p 66) .
Dans un chapitre : « Du panthéisme à la « Philosophia Perennis », les auteurs s’emploient à situer la pensée de Jaurès parmi les grandes tendances philosophiques. Nous retiendrons ceci : « Dieu et le monde sont un de point de vue de l’immanence divine… mais du point de vue de la transcendance divine, Dieu et le monde sont également distincts et dans un rapport « hiérarchique » puisque Dieu ne se limite pas au monde… C’est un point de vue qui peut être reconnu comme panenthéiste » : Dieu est partout, en tout et tout est en Dieu… mais tout n’est pas Dieu au sens où la réalité divine excède infiniment la réalité perceptible qu’il habite néanmoins intimement et qui ne saurait être sans Lui » (p 75). Dans le mouvement de la théologie chrétienne, Jürgen Moltmann vient aujourd’hui éclairer cette dimension panenthéiste dans sa théologie de la création (4) .
Reliance spirituelle à travers l’histoire
En cette fin du XIXè siècle, l’institution catholique s’oppose au mouvement des idées et s’enferme dans la défense d’un système dominateur . Et, à l’opposé, s’affirme une conception athée et matérialiste. Dans ce contexte, nous avons vu combien Jean Jaurès exprime une vision spirituelle. Eric et Sophie Vinson nous montre qu’il n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un courant de pensée, vaste et diversifié. C’est dire que, face aux enfermements, il y a là beaucoup de chercheurs qui oeuvrent pour une ouverture spirituelle. L’inspiration chrétienne peut y trouver sa place.
« Comme l’a montré Paul Bénichou, dans sa monumentale étude sur les « Romantismes français », l’intelligence et les lettres françaises sont travaillées par une question fondamentale : après l’ouragan de la Révolution, le catholicisme peut-il encore incarner l’autorité spirituelle ? Au prix de quelles adaptations ? Et si l’Eglise doit perdre le mandat du Ciel » en même temps que la monarchie, par quoi, par qui et comment la remplacer ? » ( p 109) ?
Les auteurs évoquent ensuite de nombreuses personnalités, parmi lesquelles nous retiendrons ici : « Edgar Quinet qui espérait « protestantiser » la France pour établir durablement la démocratie, Alexis de Tocqueville qui initia une longue « tradition sociologique » de recherche sur l’impact de la problématique religieuse en matière de transformation sociale et de transformation du lien social, Lamennais, Lacordaire et Ozanam, pionniers de la question sociale venus du catholicisme, Pierre Leroux et Philippe Buchez, porteurs d’un « socialisme chrétien ». Ils évoquent de nombreux courants : « les effusions politico-religieuses de 1848, la montée des idéaux démocratiques et sociaux dans la franc-maçonnerie, le « socialisme utopique » français, un ésotérisme, le courant occultiste, Victor Hugo, « le plus grand poète français, conscience morale de la République naissante, prophète d’un avenir démocratique et social » sans compter presque tous les grands écrivains français d’alors (Balzac, Stendhal, Flaubert, Georges Sand etc) chez lesquels on peut trouver des passages ou des livres entiers, en rapport avec le spirituel et l’ésotérisme » (p 103-105).
On ne doit pas seulement envisager le mouvement des idées à l’échelle française, mais plus largement à l’échelle européenne. Et, à cet égard, Jean Jaurès s’est également inspiré de la pensée germanique, en particulier de la « Naturphilosophie » (p 106). Les auteurs citent un article de Jaurès sur le poème de Victor Hugo, intitulé « Dieu » : « Si tout est nature, il faut comprendre la nature dans sa profondeur et dans son mystère et, comprise à fond, elle révèle Dieu, ou plutôt, elle est l’expression même de Dieu… La nature est embrasée d’esprit et l’esprit, sans sortir de l’ordre naturel et de ses lois, peut prétendre à de prodigieux développements » ( p 107-108). Cette vision du monde se traduit en action. « Si Dieu est, c’est à dire qu’il y a un foyer idéal et réel tout ensemble de nature et de la conscience, nous pouvons sans contradiction tenter d’élever la nature et toutes les consciences à l’unité à l’ordre, à la justice, à la joie. En ce sens aussi, Dieu est agissant… Je vous assure qu’il se fait en ce moment dans les esprits un travail immense pour retrouver Dieu dans la nature et l’idéal dans le réel. En même temps que les foules souffrantes aspirent vers le juste, les âmes pensantes font effort vers le vrai et vers le divin. Il y a dans le socialisme aussi des ferments mystiques : les hommes qui ont le sens de l’éternel comme Hugo, sont les seuls qui aient vraiment le sens de leur temps » ( p 108-109). Si ce texte date de la fin du XIXè siècle, on peut penser qu’il éveille un écho dans notre société en recherche de sens, d’un nouveau rapport avec la nature et d’une dimension écologique.
La spiritualité de Jaurès fut, à l’époque, méconnue par ceux qui ne voulaient pas la voir. Et aujourd’hui, il en est de même. Selon les auteurs, le terme de « Dieu » serait devenu « pesant et incongru à la fois, en tout cas hors d’un contexte confessionnel » . Cependant dans le mouvement écologique qui se développe aujourd’hui, une vision nouvelle de la nature apparaît . Certains y reconnaissent la présence du divin . Une théologie de la création se manifeste. Des articles parus sur ce blog témoignent de cette évolution (5). En 1988, paraît en France un livre pionnier de Jürgen Moltmann : « Dieu dans la création », intitulé, dès cctte époque : Traité écologique de la création » (4). L’œuvre de l’Esprit y est mise en évidence : « Le Dieu trinitaire inspire sans cesse toute sa création. Tout ce qui est, existe et vit grâce à l’affluence permanente des énergies et des possibilités de l’Esprit cosmique. C’est pourquoi, il faut comprendre toute réalité créée de façon énergétique, comme possibilité réalisée de l’Esprit divin. Grâce aux possibilités et énergies de l’Esprit, le Créateur lui-même est présent dans sa création . Il ne s’oppose pas à elle par sa transcendance, mais entre en elle et lui demeure en même temps immanent » (p 22-23). En se reportant à la pensée de Jean Jaurès dans sa thèse : « De la réalité du monde sensible », il y a une proximité dans les deux approches.
Une inspiration pour notre temps
Dans leur livre sur Jean Jaurès, Eric et Sophie Vinson expriment « l’urgence démocratique actuelle de trouver une voie – d’entendre une voix – pour relier, dynamiser, concrétiser la quête de sens individuelle et collective, en pleine faillite du désordre établi » (p 24). « Leur essai propose, textes sources à l’appui, un fil conducteur stimulant, original dans le dédale de cette existence remarquable. Ce fil conducteur ? Le spirituel suivi à travers les principales facettes – de faits inséparables et quasi simultanés – de cet homme-fleuve. Un fil conducteur spirituel qui pourrait, en outre, avoir quelque utilité pour nous, qui errons dans un monde sans repères en plein bouleversement. Revisiter l’ouverture jaurésienne, c’est se poser les questions des rapports entre spiritualité et démocratie, entre mystique et politique, entre métaphysique et socialisme, entre éthique et pouvoir, entre conviction et responsabilité… » (p 25-26). On peut ajouter la pertinence de cette pensée dans notre avancée écologique.
Conscients de ce besoin de sens et d’inspiration, Eric et Sophie Vinson envisagent la personnalité de Jean Jaurès parmi d’autres figures historiques qui leur paraissent présenter des ressemblances. C’est ce qu’ils appellent « la famille des « spirituels engagés » ou des « mystiques militants » parmi lesquels ils rangent M K Gandhi, Nelson Mandela (1), Martin Luther King, le Dalaï Lama pour ne citer que les plus connus. « Et si l’étude de ces spirituels engagés, à commencer par Jaurès si typiquement français, nous permettait d’entrevoir l’aube d’un nouvel humanisme en politique… » ( p 26).
Cependant cette aspiration s’inscrit dans une durée historique. A travers le temps, nous voyons ainsi un fil conducteur dans la vision d’un monde qui n’est pas abandonné à une destinée aveugle, mais habité par la présence du divin. C’est l’approche de Jean Jaurès dans sa thèse sur « la réalité du monde sensible ». Aujourd’hui, c’est aussi celle de Jürgen Moltmann dans sa théologie de l’espérance. Une nouvelle vision de la création émerge et accompagne la prise de conscience écologique. Ainsi, on peut redire avec Jean Jaurès : « Si Dieu est, c’est à dire qu’il y a un foyer idéal et réel tout ensemble de la nature et de la conscience, nous pouvons sans contradiction tenter d’élever la nature et toutes les consciences à l’unité, à l’ordre, à la justice, à la joie » ( p 108).
J H
- Eric Vinson. Sophie Viguier-Vison. Mandela et Gandhi. La sagesse peut-elle changer le monde ? Albin Michel, 2018 Mise en perspective : « Non violence. Une démarche spirituelle et politique » : https://vivreetesperer.com/non-violence-une-demarche-spirituelle-et-politique/
- Eric Vinson. Sophie Viguier-Vinson. Jaurès le prophète. Mystique et politique d’un combattant républicain, Albin Michel, 2014 2a quatrième de couverture Nous n’avons abordé ici qu’une partie limitée de ce livre remarquable qui couvre tous les aspects de la vie de Jean Jaurès, ce « prophète ». C’est une lecture particulièrement fructueuse.
- Un fait marquant dans la lutte de Jaurès pour la paix : « Un été pas comme les autres. Le début de la grande guerre et l’assassinat de Jaurès. Un édito vidéo d’Antoine Nouis dans Réforme » : https://www.temoins.com/un-ete-pas-comme-les-autres-le-debut-de-la-grande-guerre-et-lassassinat-de-jean-jaures-un-edito-video-dantoine-nouis-dans-reforme/
- Jürgen Moltmann. Dieu dans la création. Traité écologique de la création. Cerf, 1998 « Si on comprend le créateur, la création et son but de façon trinitaire, alors le créateur habite par son Esprit dans l’ensemble de la création et dans chacune de ses créatures et il les maintient ensemble et en vie par la force de son Esprit » ( p 8)
- « Le Dieu vivant et la plénitude de vie » : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/ « Un Esprit sans frontières » : https://vivreetesperer.com/un-esprit-sans-frontieres/ « Convergences écologiques : « Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, Pape François et Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/ La publication de l’encyclique Laudato Si’ par le Pape François est un moment important dans la montée d’une théologie écologique.
Jean Jaurès : mystique et politique d’un combattant républicain, selon Eric Vinson et Sophie Viguier-Vinson
 Une vision spirituelle, dans et pour le monde
Une vision spirituelle, dans et pour le monde
A certains moments dans l’histoire, de grandes personnalités émergent. Elles portent une cause et vivent un idéal. Ce fut le cas de Mandela et de Gandhi (1). En France, ce fut le cas de Jean Jaurès. Eric Vinson et Sophie Viguier-Vinson ont écrit à leur sujet. Et nous revenons ici sur un de leurs livres : « Jaurès le prophète. Mystique et politique d’un combattant républicain » (2). « Tout le monde croit connaître Jean Jaurès, icône républicaine qui demeure encore dans les mémoires, cent ans après sa mort (en 1914), le père du socialisme français, le fondateur de « l’Humanité », l’historien de la Révolution Française, l’inlassable combattant dreyfusard, le champion parlementaire de la séparation des Eglises et de l’Etat, le pacifiste assassiné à la veille de la Grande Guerre (3). Mais d’où lui venait ce souffle qui l’habitait, quel était le fondement de son élan humaniste et en quoi croyait-il ? » (2a). Eric et Sophie Vinson décrivent et analysent ici la pensée philosophique, métaphysique de Jean Jaurès dans le contexte de son époque.
Voilà une recherche qui nous concerne. A certains moments de l’histoire, dans telle conjoncture, l’accès à une inspiration religieuse peut être entravé parce que l’institution correspondante s’enferme, s’éloigne de la vie, adopte une posture dominatrice . Au XIXè siècle, l’Eglise catholique s’érigea en pouvoir hostile aux acquis de la Révolution Française. Ce fut « la guerre des deux France ». Mais alors comment le christianisme pouvait-il être vécu, lui, qui, en France, avait été associé, pour une part importante, au catholicisme ? Comment l’inspiration évangélique allait elle contribuer à irriguer la société française ? Lorsque l’eau vive se heurte à un barrage, elle prend de nouveaux chemins. Dans notre humanité, il nous faut explorer et reconnaître les formes nouvelles qui viennent compenser un manque. Aujourd’hui, au cours des dernières décennies, un écart s’est creusé entre les institutions religieuses, accusé pour certaines, moindre pour d’autres, et une nouvelle manière de vivre et de penser. Aujourd’hui encore des scandales apparaissent qui témoignent de l’inadéquation et de la faillite de tel système religieux Alors, pour que l’inspiration spirituelle, l’inspiration évangélique, puissent continuer à irriguer notre société, il est important que des pensée et des formes nouvelles apparaissent en apportant, dans toute sa diversité, une offre renouvelée. La question s’est posée à la fin du XIXè siècle. Dans une autre contexte, elle se pose aujourd’hui.
Voilà pourquoi, le livre d’Eric et de Sophie Vinson nous paraît important, car il nous montre, entre autres, comment, à cette époque, Jean Jaurès a fondé son action politique et sociale sur une vision spirituelle. Cette vision s’est exprimée dans une dimension philosophique. « Jean Jaurès est non seulement un philosophe, normalien, agrégé, un auteur rivalisant avec Bergson, mais aussi un authentique spirituel. Si l’on néglige sa thèse sur « la réalité du monde sensible », si l’on passe à côté de sa spiritualité- qui s’oppose au pouvoir temporel de l’Eglise catholique, mais reconnaît en l’homme la présence du divin-, on ignore les principes mêmes qui ont guidé toute son action » (2a).
La réalité du monde sensible
Eric et Sophie Vinson nous exposent la pensée de Jaurès telle qu’elle se déploie dans sa thèse principale de philosophie : « De la réalité du monde sensible » éditée en 1891 et rééditée quasiment à l’identique en 1902. « Nous voulons », disent-ils, « présenter cette philosophie en elle- même, à partir de sa dimension spirituelle ». Dans ce bref article, nous ne pouvons suivre le fil du raisonnement qui nous est décrit dans ce livre auquel on se reportera. Nous nous bornerons à quelques notations.
En affirmant la « réalité du monde sensible », Jaurès s’oppose d’une part au « subjectivisme qui réduit le monde sensible, matériel, au sujet », et, d’autre part, « au matérialisme qui réduit le sujet au monde matériel » (p 68). Et il dépasse « le divorce du sujet et de l’objet, grâce à la notion d’être, ce grand « englobant » métaphysique injustement oublié par les deux courants rivaux : subjectivisme et matérialisme (p 55).
Ce qu’affirme Jaurès, c’est « l’unité dynamique de tout ce qui est » (p 64). « Nous constatons qu’il y a dans toutes les consciences individuelles , une conscience absolue et indépendante de tout organisme étroit et éphémère, qu’elle est présente partout sans être enchainée nulle part, qu’elle n’a d’autre sens que l’infini lui-même, et qu’ainsi toutes les manifestations de l’infini, l’espace, la lumière, le son, trouvent en elle, leur centre de ralliement et une garantie d’éternelle réalité » ( p 57). Et c’est dans cette perspective que Jaurès envisage la divinité : « Dieu ne doit pas être pensé sur notre modèle, seulement plus grand. Il est la réalité elle-même… ». « La conscience absolue n’est pas un moi comme les autres, elle est le moi de tous les mois, la conscience de toutes les consciences… » ( p 65). Les auteurs nous expliquent les ressorts de cette pensée. « Ce Dieu-conscience absolue » semble être en quelque sorte l’« intériorité » profonde – autrement dit le « cœur » – des mois particuliers, des consciences individuelles comme des vérités rationnelles. Présent en eux au tréfonds, Il ne se réduit pas à eux et les dépasse qualitativement de manière infinie. Mais Il les rassemble aussi par Sa seule présence, « unité de toutes les unités ». Actif au cœur de toutes les réalités finies, Lui, l’infini divin, il les contient ainsi toutes d’un certain point de vue…Et cela constitue l’ ordre ordinaire des choses simples, simplement incompris et même inaperçu par la plupart ». A deux reprises, Jaurès cite textuellement le discours de Paul devant l’aéropage (Actes 17. 28) : « En la Divinité, nous avons la vie, le mouvement et l’être » (p 64).
A la suite de ce raisonnement, la conclusion de la thèse vient nous éclairer en rejoignant notre expérience quotidienne : « Précisément parce que c’est la conscience absolue qui fait la réalité du monde, tous les individus, toutes les forces du monde gardent leur réalité familière et leurs devoirs familiers . Dieu, en se mêlant au monde, n’y répand pas seulement la vie et la joie, mais aussi la modestie et le bon sens… Dans la conscience absolue et divine, ce n’est pas seulement le ciel grandiose et étoilé qui trouve sa justification, mais aussi la modeste maison où, outre la table de famille et le foyer, l’homme, avec ses humbles outils, gagne pour lui et les siens, le pain de chaque jour » (p 66) .
Dans un chapitre : « Du panthéisme à la « Philosophia Perennis », les auteurs s’emploient à situer la pensée de Jaurès parmi les grandes tendances philosophiques. Nous retiendrons ceci : « Dieu et le monde sont un de point de vue de l’immanence divine… mais du point de vue de la transcendance divine, Dieu et le monde sont également distincts et dans un rapport « hiérarchique » puisque Dieu ne se limite pas au monde… C’est un point de vue qui peut être reconnu comme panenthéiste » : Dieu est partout, en tout et tout est en Dieu… mais tout n’est pas Dieu au sens où la réalité divine excède infiniment la réalité perceptible qu’il habite néanmoins intimement et qui ne saurait être sans Lui » (p 75). Dans le mouvement de la théologie chrétienne, Jürgen Moltmann vient aujourd’hui éclairer cette dimension panenthéiste dans sa théologie de la création (4) .
Reliance spirituelle à travers l’histoire
En cette fin du XIXè siècle, l’institution catholique s’oppose au mouvement des idées et s’enferme dans la défense d’un système dominateur . Et, à l’opposé, s’affirme une conception athée et matérialiste. Dans ce contexte, nous avons vu combien Jean Jaurès exprime une vision spirituelle. Eric et Sophie Vinson nous montre qu’il n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un courant de pensée, vaste et diversifié. C’est dire que, face aux enfermements, il y a là beaucoup de chercheurs qui oeuvrent pour une ouverture spirituelle. L’inspiration chrétienne peut y trouver sa place.
« Comme l’a montré Paul Bénichou, dans sa monumentale étude sur les « Romantismes français », l’intelligence et les lettres françaises sont travaillées par une question fondamentale : après l’ouragan de la Révolution, le catholicisme peut-il encore incarner l’autorité spirituelle ? Au prix de quelles adaptations ? Et si l’Eglise doit perdre le mandat du Ciel » en même temps que la monarchie, par quoi, par qui et comment la remplacer ? » ( p 109) ?
Les auteurs évoquent ensuite de nombreuses personnalités, parmi lesquelles nous retiendrons ici : « Edgar Quinet qui espérait « protestantiser » la France pour établir durablement la démocratie, Alexis de Tocqueville qui initia une longue « tradition sociologique » de recherche sur l’impact de la problématique religieuse en matière de transformation sociale et de transformation du lien social, Lamennais, Lacordaire et Ozanam, pionniers de la question sociale venus du catholicisme, Pierre Leroux et Philippe Buchez, porteurs d’un « socialisme chrétien ». Ils évoquent de nombreux courants : « les effusions politico-religieuses de 1848, la montée des idéaux démocratiques et sociaux dans la franc-maçonnerie, le « socialisme utopique » français, un ésotérisme, le courant occultiste, Victor Hugo, « le plus grand poète français, conscience morale de la République naissante, prophète d’un avenir démocratique et social » sans compter presque tous les grands écrivains français d’alors (Balzac, Stendhal, Flaubert, Georges Sand etc) chez lesquels on peut trouver des passages ou des livres entiers, en rapport avec le spirituel et l’ésotérisme » (p 103-105).
On ne doit pas seulement envisager le mouvement des idées à l’échelle française, mais plus largement à l’échelle européenne. Et, à cet égard, Jean Jaurès s’est également inspiré de la pensée germanique, en particulier de la « Naturphilosophie » (p 106). Les auteurs citent un article de Jaurès sur le poème de Victor Hugo, intitulé « Dieu » : « Si tout est nature, il faut comprendre la nature dans sa profondeur et dans son mystère et, comprise à fond, elle révèle Dieu, ou plutôt, elle est l’expression même de Dieu… La nature est embrasée d’esprit et l’esprit, sans sortir de l’ordre naturel et de ses lois, peut prétendre à de prodigieux développements » ( p 107-108). Cette vision du monde se traduit en action. « Si Dieu est, c’est à dire qu’il y a un foyer idéal et réel tout ensemble de nature et de la conscience, nous pouvons sans contradiction tenter d’élever la nature et toutes les consciences à l’unité à l’ordre, à la justice, à la joie. En ce sens aussi, Dieu est agissant… Je vous assure qu’il se fait en ce moment dans les esprits un travail immense pour retrouver Dieu dans la nature et l’idéal dans le réel. En même temps que les foules souffrantes aspirent vers le juste, les âmes pensantes font effort vers le vrai et vers le divin. Il y a dans le socialisme aussi des ferments mystiques : les hommes qui ont le sens de l’éternel comme Hugo, sont les seuls qui aient vraiment le sens de leur temps » ( p 108-109). Si ce texte date de la fin du XIXè siècle, on peut penser qu’il éveille un écho dans notre société en recherche de sens, d’un nouveau rapport avec la nature et d’une dimension écologique.
La spiritualité de Jaurès fut, à l’époque, méconnue par ceux qui ne voulaient pas la voir. Et aujourd’hui, il en est de même. Selon les auteurs, le terme de « Dieu » serait devenu « pesant et incongru à la fois, en tout cas hors d’un contexte confessionnel » . Cependant dans le mouvement écologique qui se développe aujourd’hui, une vision nouvelle de la nature apparaît . Certains y reconnaissent la présence du divin . Une théologie de la création se manifeste. Des articles parus sur ce blog témoignent de cette évolution (5). En 1988, paraît en France un livre pionnier de Jürgen Moltmann : « Dieu dans la création », intitulé, dès cctte époque : Traité écologique de la création » (4). L’œuvre de l’Esprit y est mise en évidence : « Le Dieu trinitaire inspire sans cesse toute sa création. Tout ce qui est, existe et vit grâce à l’affluence permanente des énergies et des possibilités de l’Esprit cosmique. C’est pourquoi, il faut comprendre toute réalité créée de façon énergétique, comme possibilité réalisée de l’Esprit divin. Grâce aux possibilités et énergies de l’Esprit, le Créateur lui-même est présent dans sa création . Il ne s’oppose pas à elle par sa transcendance, mais entre en elle et lui demeure en même temps immanent » (p 22-23). En se reportant à la pensée de Jean Jaurès dans sa thèse : « De la réalité du monde sensible », il y a une proximité dans les deux approches.
Une inspiration pour notre temps
Dans leur livre sur Jean Jaurès, Eric et Sophie Vinson expriment « l’urgence démocratique actuelle de trouver une voie – d’entendre une voix – pour relier, dynamiser, concrétiser la quête de sens individuelle et collective, en pleine faillite du désordre établi » (p 24). « Leur essai propose, textes sources à l’appui, un fil conducteur stimulant, original dans le dédale de cette existence remarquable. Ce fil conducteur ? Le spirituel suivi à travers les principales facettes – de faits inséparables et quasi simultanés – de cet homme-fleuve. Un fil conducteur spirituel qui pourrait, en outre, avoir quelque utilité pour nous, qui errons dans un monde sans repères en plein bouleversement. Revisiter l’ouverture jaurésienne, c’est se poser les questions des rapports entre spiritualité et démocratie, entre mystique et politique, entre métaphysique et socialisme, entre éthique et pouvoir, entre conviction et responsabilité… » (p 25-26). On peut ajouter la pertinence de cette pensée dans notre avancée écologique.
Conscients de ce besoin de sens et d’inspiration, Eric et Sophie Vinson envisagent la personnalité de Jean Jaurès parmi d’autres figures historiques qui leur paraissent présenter des ressemblances. C’est ce qu’ils appellent « la famille des « spirituels engagés » ou des « mystiques militants » parmi lesquels ils rangent M K Gandhi, Nelson Mandela (1), Martin Luther King, le Dalaï Lama pour ne citer que les plus connus. « Et si l’étude de ces spirituels engagés, à commencer par Jaurès si typiquement français, nous permettait d’entrevoir l’aube d’un nouvel humanisme en politique… » ( p 26).
Cependant cette aspiration s’inscrit dans une durée historique. A travers le temps, nous voyons ainsi un fil conducteur dans la vision d’un monde qui n’est pas abandonné à une destinée aveugle, mais habité par la présence du divin. C’est l’approche de Jean Jaurès dans sa thèse sur « la réalité du monde sensible ». Aujourd’hui, c’est aussi celle de Jürgen Moltmann dans sa théologie de l’espérance. Une nouvelle vision de la création émerge et accompagne la prise de conscience écologique. Ainsi, on peut redire avec Jean Jaurès : « Si Dieu est, c’est à dire qu’il y a un foyer idéal et réel tout ensemble de la nature et de la conscience, nous pouvons sans contradiction tenter d’élever la nature et toutes les consciences à l’unité, à l’ordre, à la justice, à la joie » ( p 108).
J H
- Eric Vinson. Sophie Viguier-Vison. Mandela et Gandhi. La sagesse peut-elle changer le monde ? Albin Michel, 2018 Mise en perspective : « Non violence. Une démarche spirituelle et politique » : https://vivreetesperer.com/non-violence-une-demarche-spirituelle-et-politique/
- Eric Vinson. Sophie Viguier-Vinson. Jaurès le prophète. Mystique et politique d’un combattant républicain, Albin Michel, 2014 2a quatrième de couverture Nous n’avons abordé ici qu’une partie limitée de ce livre remarquable qui couvre tous les aspects de la vie de Jean Jaurès, ce « prophète ». C’est une lecture particulièrement fructueuse.
- Un fait marquant dans la lutte de Jaurès pour la paix : « Un été pas comme les autres. Le début de la grande guerre et l’assassinat de Jaurès. Un édito vidéo d’Antoine Nouis dans Réforme » : https://www.temoins.com/un-ete-pas-comme-les-autres-le-debut-de-la-grande-guerre-et-lassassinat-de-jean-jaures-un-edito-video-dantoine-nouis-dans-reforme/
- Jürgen Moltmann. Dieu dans la création. Traité écologique de la création. Cerf, 1998 « Si on comprend le créateur, la création et son but de façon trinitaire, alors le créateur habite par son Esprit dans l’ensemble de la création et dans chacune de ses créatures et il les maintient ensemble et en vie par la force de son Esprit » ( p 8)
- « Le Dieu vivant et la plénitude de vie » : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/ « Un Esprit sans frontières » : https://vivreetesperer.com/un-esprit-sans-frontieres/ « Convergences écologiques : « Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, Pape François et Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/ La publication de l’encyclique Laudato Si’ par le Pape François est un moment important dans la montée d’une théologie écologique.
Vivre la découverte théologique à l’échelle du monde
L’anniversaire de Jürgen Moltmann célébré en Chine
Aujourd’hui, à travers les nouveaux moyens de communication, nous sommes de plus en plus proches les uns des autres. Ce rapprochement s’accélère. C’est une magnifique opportunité pour davantage de collaboration. Mais cela peut engendrer aussi confrontation et conflictualité. Ainsi, à l’échelle internationale, nous avons de plus en plus besoin de nous comprendre. A partir des différentes cultures, des différents contextes nationaux, les cheminements de pensée varient. Mais dans le grand brassage des hommes et des idées, face à des problèmes communs de plus en plus prégnants, ces cheminements sont de plus en plus appelés à se rapprocher. Et c’est bien déjà le cas dans certains domaines, par exemple dans le champ des sciences.
Sur le plan religieux, si les grandes religions se sont longtemps installées dans telle ou telle aire géographique, elles ont cependant été toujours en mouvement, dans des conjonctures d’expansion. Aujourd’hui, des formes d’expression et de pratique se manifestent dans des courants qui traversent les frontières des religions existantes (1). Et, par ailleurs, les différentes religions sont également confrontées aux transformations culturelles et aux problèmes sociaux et politiques. Et, par exemple, elles sont toutes interpellées par la prise de conscience écologique (2). On peut observer ces divers mouvements dans le monde chrétien et dans ses divers composantes confessionnelles. Ici donc, la théologie est appelée à éclairer les questions nouvelles qui apparaissent en fonction des transformations de mentalité et des environnements culturels et sociaux qui forgent ces transformations. A cet égard, un théologien, aujourd’hui reconnu parmi les plus grands et les plus innovants, Jürgen Moltmann, nous paraît apporter une contribution majeure. Ainsi, ce blog recourt-il fréquemment à ses éclairages (3).
Jürgen Moltmann vient d’avoir 93 ans. Une vidéo réalisée en Chine célèbre son anniversaire. C’est un signe remarquable de la reconnaissance et de l’audience de sa théologie à l’échelle du monde.
Effectivement, si cette théologie suscite un écho dans différentes parties du monde, de l’Europe dont elle est issue, jusqu’aux Amériques et en Afrique, elle est particulièrement appréciée en Extrême-Orient : Corée, Japon, Chine… C’est peut-être parce que Jürgen Moltmann apporte à la fois une double signification : une orientation dans le monde d’aujourd’hui à travers une théologie de l’espérance (4) et, dans les civilisations d’Extrême-Orient attentive à l’unité de la création et aux énergies qui l’animent, une reconnaissance de la présence de Dieu dans l’immanence à travers une théologie de l’Esprit, cet « Esprit qui donne la vie » (5).
Dans cette émergence d’une culture mondiale, où des questions apparaissent et convergent, la théologie de Moltmann est une théologie pour notre temps.
Cette vidéo témoigne de la reconnaissance de la théologie de Moltmann en Chine. En consultant les informations sur les institutions représentées par les intervenants, on en perçoit la diversité et donc la vaste dimension de l’audience qui est accordée à cette pensée. Nous rapportons donc ici le message de la vidéo (6).
Joyeux anniversaire au professeur Moltmann.
Bénédictions de Chine
Professeur Zhang Xu. Renmin China University. Pékin
J’espère que je pourrais vous rencontrer dans l’avenir et écouter votre enseignement
Professeur You Bin. Minzu university of China. Pékin
Qu’il soit béni ! Une vie pleine de vitalité et qui porte beaucoup de fruits. Son influence ne s’étend pas seulement à l’aspect académique du christianisme. Ses œuvres jaillissent de son cœur dans la contemplation de la marche du monde. Alors elles touchent tous ceux qui cherchent la vérité honnêtement. Je le félicite profondément pour son oeuvre formidable et je lui souhaite une bonne santé et une bonne longévité.
Professeure Song Xuhong Minzu University of China Pékin
Dans une perspective chinoise, être âgé de 93 ans, c’est entrer dans un âge de bonheur et de longévité, mais je préfère l’envisager selon la personnalité et le charme du professeur Moltmann. Je souhaite que professeur Moltmann puisse rester jeune et actif pour qu’il puisse toujours habiter dans ses pensées inspirées et nous guider par sa profonde sagesse
Professeur Hsuch Hsin Chow China Evangelical Seminary
Je bénis le professeur Moltmann, ce géant qui est utilisé constamment par Dieu comme une voix qui s’adresse aux Eglises partout dans le monde. Par une inspiration particulière, il peut continuer à aider les églises chinoises. Que Dieu le bénisse abondamment !
Docteur Wang Wenfeng Fondateur du Consensus d’Oxford
Le docteur Wenfeng déploie une calligraphie qui exprime ses pensées de bénédiction pour la vie du professeur Moltmann
Docteure Yang Huaming Chinese Academy of Social science
Joyeux anniversaire et une vie toujours jeune
Cette vidéo met en évidence l’importance et la pertinence de la vision de Moltmann dans le contexte de la culture chinoise. Mais elle est aussi un hommage du cœur avec une émouvante délicatesse. Et, comme les intervenants sont issus de différentes institutions, c’est le produit d’une belle collaboration. Elle exprime remarquablement l’amitié envers Jürgen Moltmann avec une expression de tendresse et une grande justesse de ton. Elle témoigne d’une harmonie. Elle éveille une émotion. Dans cet anniversaire, l’Esprit divin se manifeste dans l’amour et la bénédiction. Une lumière nous vient de Chine.
J H
- « Dynamique culturelle et vivre ensemble dans un monde globalisé. « La guerre des civilisations n’aura pas lieu » de Raphaël Liogier » : https://vivreetesperer.com/dynamique-culturelle-et-vivre-ensemble-dans-un-monde-globalise/
- « Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, Pape François et Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/
- Pour une vue d’ensemble sur la vie et la pensée de Jürgen Moltmann : « Une théologie pour notre temps. L’autobiographie de Jürgen Moltmann » : https://www.temoins.com/une-theologie-pour-notre-temps-lautobiographie-de-juergen-moltmann/ Quelques articles sur : Vivre et espérer : « Le Dieu Vivant et la plénitude de la vie » : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie-2/ « Le Dieu vivant et la plénitude de vie. Eclairages apportés par la pensée de Jürgen Moltmann » : https://vivreetesperer.com/le-dieu-vivant-et-la-plenitude-de-vie/
- La réception de la théologie de l’espérance à travers un colloque organisé à New York en 1988 : https://vivreetesperer.com/quelle-vision-de-dieu-du-monde-de-lhumanite-en-phase-avec-les-aspirations-et-les-questionnements-de-notre-epoque/
- « Un Esprit sans frontières. Reconnaître la présence et l’œuvre de l’Esprit » : https://vivreetesperer.com/un-esprit-sans-frontieres/
- https://www.youtube.com/watch?v=9z4nzf–7E0&fbclid=IwAR020hV7ceZZmGe2JhUNfdl_L_zw5fXSLROcYpq9G0Qv0b6juEcnQoFLYoY
Une parabole qui parle au cœur
 Le père généreux, selon Christine Pedotti
Le père généreux, selon Christine Pedotti
Qui n’a pas lu ou entendu, une fois au moins, et, pour beaucoup, maintes et maintes fois, la parabole dite du « fils prodigue », et qui, comme l’indique Wikipedia (1), a reçu bien d’autres appellations. Cette parabole fait partie des textes fondateurs qui irriguent notre culture (2). Elle a été répétée, commentée d’innombrables fois dans les églises, même si ce qu’elle dit d’un père aimant, n’a pas toujours produit ses effets.
Ainsi, il est bon d’y revenir puisque nous y recevons une parole qui sait faire passer le message d’un amour infini et libérateur. Dans nos chemins, nous avons besoin de ces ressources qui viennent répondre à nos questions et à nos aspirations. Lorsqu’il s’en présente sur le web, alors c’est une joie de les partager et de les faire connaître. Cette vidéo portant sur la parabole du fils prodigue (3), apparaît sur « Campus protestant » (4), dans une série de commentaires du dimanche. Il nous est présenté dans la forme d’une conversation entre Antoine Nouis et Christine Pedotti. Bien connu par ailleurs pour la qualité de ses publications, Antoine Nouis (5) interroge Christine Pedotti sur sa compréhension de la parabole. Et c’est là qu’apparaît chez celle-ci une expérience de vie qui lui permet de commenter cette histoire avec une grande sensibilité. La biographie de Christine Pedotti (6) nous l’apprend, elle est à la fois, à l’écoute des êtres et à la découverte de Dieu, comme en témoigne des livres nombreux et variés : livres pour les enfants, ouvrages de spiritualité et, tout récemment, en co-animation, une encyclopédie sur Jésus. (7).
Alors, dans le commentaire de cette parabole, Christine Pedotti nous en montre la portée. Si les péripéties du fils prodigue attirent notre attention, elles mettent en valeur les attitudes du père qui peut être reconnu comme le personnage principal, un « père prodigue », un père généreux, avance Christine Pedotti. Elle sait montrer, en sa personne, la générosité, la surabondance, la bonté inépuisable de Dieu . « Le Dieu auquel je crois est le Dieu de la surabondance, de la prodigalité. C’est un emballement du bien ».
En l’image du père, la parabole, d’un bout à l’autre, nous montre un Dieu constant dans un amour respectueux et miséricordieux. C’est la même bienveillance inconditionnelle que nous rapporte Lytta Basset (8) en décrivant la vie de Jésus. C’est la bonté incommensurable qui nous est rappelée par Michèle Jeunet lorsqu’elle évoque la fondatrice de sa congrégation. « Thérèse Couderc disait de Dieu : « Il est bon. Il est plus que bon. Il est la bonté » (9).
Ce Dieu là n’est pas un Dieu sévère qui épie les péchés et inspire la crainte. Il n’est pas non plus un Dieu lointain. Bien sûr, la vie de Jésus en témoigne. Cette parabole nous montre, à travers le père, un Dieu relationnel, constamment en désir de relation, toujours à l’œuvre pour l’entretenir et pour la réparer. Ainsi, la grâce est là. Richard Rohr évoque ainsi un flux divin, un flux d’amour constamment à l’œuvre. Jürgen Moltmann perçoit la création comme un tissu de relations (10). Ces deux théologiens évoquent Dieu en terme d’une communion trinitaire (11). « Il n’y a pas en Dieu de façon unilatérale, domination et soumission…. Dans le Dieu trinitaire, il y a la réciprocité et l’éclairage de l’amour » (12).
Si les chrétiens reçoivent le texte biblique comme support d’une vision du monde qui leur est communiquée, à travers l’histoire, on constate que cette réception ne se fait pas sans trouble et sans comporter des dérives où l’on s’éloigne d’un esprit d’amour et de paix. Des textes comme la parabole du fils du prodigue ou celle du bon samaritain (13) nous rappellent l’essence même de la révélation divine, ce que Jésus résume en terme d’amour. Ces paraboles peuvent être lues par tous. Elles parlent directement au cœur. Une pensée traverse le temps et vient nous rencontrer. Comme nous y invite Christine Pedotti, nous pouvons gouter la générosité, la surabondance, la bonté inépuisable de Dieu.
J H
- Fils prodigue : un article sur wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fils_prodigue
- Textes fondateurs présents au programme des classes de français : le fils prodigue : http://crdp.ac-paris.fr/parcours/fondateurs/index.php/category/le-fils-prodigue
- Evangile du dimanche : le fils perdu et retrouvé. Vidéo sur Campus protestant : https://www.youtube.com/watch?v=z6wzMNXCsh8&feature=share
- Campus protestant est une plateforme de réflexion prenant appui sur la pensée et la culture protestante à travers principalement des contenus vidéos. Ces vidéos constituent une ressource importante pour les cheminements chrétiens au delà des confessions : https://campusprotestant.com
- Antoine Nouis, exégète, pasteur et conseiller théologique à l’hebdomadaire protestant Réforme qu’il a dirigé pendant six ans, est l’auteur d’un commentaire intégral du Nouveau Testament : « Au commencement était la méditation » : http://www.temoins.com/au-commencement-etait-la-meditation/
- Biographie de Christine Pedotti, écrivain et journaliste : https://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_Pedotti
- Jésus. L’encyclopédie Joseph Doré Albin Michel https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Jesus-Lencyclopedie-Mgr-Joseph-Dore-2017-10-20-1200885814
- Bienveillance humaine. Bienveillance divine. Une harmonie qui se répand : Lytta Basset. Oser la bienveillance : https://vivreetesperer.com/bienveillance-humaine-bienveillance-divine-une-harmonie-qui-se-repand/
- Développer la bonté en nous, un « habitus » de bonté. Michèle Jeunet commente la parabole du bon grain et de l’ivraie : https://vivreetesperer.com/developper-la-bonte-en-nous-un-habitus-de-bonte/
- Jürgen Moltmann. Dieu dans la création. Cerf, 1988 « Rien dans le monde n’existe, ne vit et ne se meut par soi. Tout existe, vit et se meut dans l’autre, l’un dans l’autre, l’un avec l’autre » (p 29).
- Richard Rohr. With Mike Morell. The divine dance. The Trinity and your transformation. SPCK , 2016 : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/ Jürgen Moltman. Trinité et royaume de Dieu. Cerf, 1984
- « Il n’y a pas en Dieu, de façon unilatérale, domination et soumission, commandement et obéissance, comme l’affirmait Karl Barth dans sa doctrine de la souveraineté… Dans le Dieu trinitaire, il y a la réciprocité et l’échange de l’amour… Il n’y a pas de vie isolée.. Le concept de vie trinitaire, d’interpénétration est déterminant dans le traité écologique de la création.. ». Jürgen Moltmann. Dieu dans la création. (p 30-32)
- Michel Serres . Darwin, Bonaparte et le samaritain. Une philosophie de l’histoire. La parabole du bon samaritain est conviée par Michel Serres dans une philosophie de l’histoire. https://vivreetesperer.com/une-philosophie-de-lhistoire-par-michel-serres/
Partager une communion spirituelle en petit groupe Skype : un nouveau moyen de communication
 Aujourd’hui, la recherche spirituelle s’accompagne d’un besoin de partager parce qu’on a besoin d’admirer et de s’émerveiller avec d’autres, de mettre en commun nos découvertes, et de vérifier la pertinence de notre orientation. En analysant la manière dont la quête spirituelle s’exerce dans la société d’aujourd’hui, la sociologue Danièle Hervieu-Léger met en évidence l’importance des échanges : « Pour construire un récit, les gens ont besoin de rencontrer des personnes qui leur disent : « Cela fait sens pour toi. Cela fait sens aussi pour moi ». Ils ont besoin d’une relation de reconnaissance. D’ailleurs, n’est ce pas à travers la reconnaissance que l’on peut se construire comme être humain ? » (1).
Aujourd’hui, la recherche spirituelle s’accompagne d’un besoin de partager parce qu’on a besoin d’admirer et de s’émerveiller avec d’autres, de mettre en commun nos découvertes, et de vérifier la pertinence de notre orientation. En analysant la manière dont la quête spirituelle s’exerce dans la société d’aujourd’hui, la sociologue Danièle Hervieu-Léger met en évidence l’importance des échanges : « Pour construire un récit, les gens ont besoin de rencontrer des personnes qui leur disent : « Cela fait sens pour toi. Cela fait sens aussi pour moi ». Ils ont besoin d’une relation de reconnaissance. D’ailleurs, n’est ce pas à travers la reconnaissance que l’on peut se construire comme être humain ? » (1).
Dans le partage de la bonne nouvelle de l’Evangile, le Nouveau Testament nous apprend le rôle majeur de petites communautés. Et, par exemple, la rencontre d’Emmaüs ne peut-elle pas être envisagée dans ce même processus de recherche et de reconnaissance partagée, décrite par Danièle Hervieu-Léger. Clairement, Jésus met en valeur les petits groupes lorsqu’il déclare : « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18.20).
On peut entendre que, dans les petits groupes, les effets de pouvoir sont plus réduits et que la confiance peut s’établir dans une relation interpersonnelle. Dans son livre : « the divine dance », Richard Rohr nous introduit dans la vie du Dieu Trinitaire qui est communion. Lorsque trois s’entendent, il en résulte une vraie communauté. « Il faut une personne pour être un individu. Il faut deux personnes pour faire un couple. il faut au moins trois personnes pour faire une communauté. Trois (« trey ») crée la possibilité pour les gens d’aller au delà de leur intérêt personnel. C’est le commencement d’un bien commun, d’un projet commun au delà de ce qui correspond aux intérêts personnels. Parce que la réalité ultime de l’univers révélée dans la Trinité est une communauté de personnes en relation les unes avec les autres, nous savons que trois (« trey ») est la seule possibilité pour les gens de se relier les uns aux autre avec l’individualité de chacun, la réciprocité de deux, la stabilité, objectivité et subjectivité de trois » (2).
Il y a vingt ans déjà, la sociologue Danièle Hervieu-Léger évoquait la crise des grandes institutions religieuses : « Les grandes églises ne sont (plus) en mesure de fournir des canaux, des dispositifs d’organisation des croyances…. Fondamentalement, ce qui est jugé important, c’est l’engagement personnel du croyant, c’est la manière dont il met en œuvre une quête de sens spirituel… » (1). En 2016, une journée d’étude organisée par Témoins a porté sur « les parcours de foi en marge des cadres institutionnels » (3).
Cette crise des institutions religieuses engendre un recours croissant à de nouvelles formes de vie spirituelle. Ce peut être des rassemblements épisodiques dans des lieux hospitaliers (4). Aujourd’hui, Taizé en est sans doute la meilleure illustration. C’est aussi, et depuis longtemps un tissu de petits groupes. En voici un témoignage personnel qui date des années 1970, mais reste significatif. Dans ces années là, certains commençaient à ne plus se reconnaître dans ce qui était perçu au niveau des paroisses comme des formes imposées, répétitives et impersonnelles. Déjà, les réunions en petit groupe était le mode de rencontre privilégié dans les mouvements. A l’époque, quelques amis ont donc décidé de se réunir chaque mois pour partager leurs joies, leurs problèmes et leurs questions en s’appuyant sur une lecture biblique et sur la prière. Ils trouvèrent un lieu hospitalier auprès d’une petite communauté religieuse dans la Beauce. Diversifié dans ses origines, ce petit groupe découvrit de nouvelles sources de vie spirituelle, en l’occurrence différents courants charismatiques. Ce fut la source d’une grande bénédiction qui est rapportée dans le livre d’Odile Hassenforder : « Sa présence dans ma vie », très présente sur ce blog (5). Et, par ailleurs, ce petit groupe garda son indépendance et déboucha sur un groupe de prière chrétien et interconfessionnel. Ce fut ensuite la rencontre avec un autre petit groupe chrétien né dans un lycée : le Comité d’Action Chrétienne qui aboutit à la création de l’association : Témoins.
Ce n’est là qu’une histoire parmi beaucoup d’autres. Parce qu’elle entretient l’entraide fraternelle et un partage authentique, la rencontre en petit groupe est une forme spirituelle privilégiée qui apparaît dans des cadres très divers depuis les groupes de maison organisés par certaines églises jusqu’à des formes très informelles. C’est là que la recherche spirituelle se déploie et qu’une recomposition chrétienne peut s’esquisser.
Aujourd’hui, le changement spectaculaire introduit par internet dans la communication permet une extension des rencontres en petits groupes, leur développement dans un tissu interconnecté en réseau. Bornons-nous ici à évoquer le potentiel de skype qui permet une rencontre visuelle des personnes à travers l’écran
Nous pouvons rapporter ici deux expériences récentes.
La première nous est racontée par Hélène dans un article sur le site de Témoins : « L’apport de la culture numérique à un parcours de foi en marge des cadres institutionnels » (6). Avec de chers amis, Hélène, « à partir de l’automne 2014, a initié un rendez-vous hebdomadaire qui perdure encore aujourd’hui. Chaque mercredi, Timothée depuis Londres, Emilie et Clément depuis Toulouse, et moi depuis Lyon, nous nous retrouvons sur skype. Nous partageons nos joies, nos peines, nos questionnements, nous prions, nous louons Dieu ensemble. Il n’y pas de schéma établi, de contenu décidé à l’avance….. Il faudrait un article dédié pour raconter tout ce que nous avons découvert, vécu et expérimenté ensemble et avec Dieu au cours de ces quatre dernières années …».
Tout récemment, Michel, nous a raconté la vie d’un petit groupe de prière qui se réunit sur skype. « Aujourd’hui, on se réunit tous les lundi soir à 20h 30 par l’intermédiaire de skype et aussi du téléphone. Nous sommes quatre couples et une célibataire ayant en commun une relation familiale. Les participants se connaissent bien. C’est une réunion de prière-intercession. A tour de rôle, on donne des sujets de reconnaissance et de prière. Puis on prie et on termine par un chant commun. Ce groupe a été créé à l’initiative des participants en octobre 2017. C’est un groupe de maison qui permet d’avoir un suivi. Comme on se connaît bien en même temps, appartenant à une grande famille (parents et enfants), nous pouvons partager ensemble des sujets très personnels. Nous sommes reconnaissants pour les exaucements. Il se trouve que nous avons également la possibilité un autre jour de regarder un culte sur internet. La nouveauté de skype : être rassemblés malgré la distance : Antony, La Ferrière aux champs, La Rochelle, Thann, et, en même temps, très présents les uns avec les autres ».
Nous savons bien combien les formes du passé, et notamment, des rassemblements imposés et répétitifs s’effritent aujourd’hui. Nous savons combien l’individualisme peut engendrer l’isolement et l’égocentrisme. En regard, il est important d’entrevoir les voies nouvelles qui s’esquissent aujourd’hui et les potentialités qui les favorisent. Les petits groupes sont aujourd’hui un mode de rencontre privilégié. Un outil nouveau est à leur disposition : la communication par internet, et entre autres, par skype. C’est une opportunité pour la vie spirituelle, un bienfait pour la vie chrétienne.
J H
- « L’autonomie croyante. Questions pour les Eglises » : http://www.temoins.com/jean-hassenforder-lautonomie-croyante-questions-pour-les-eglises/
- Reconnaître et vivre la présence d’un Dieu relationnel. Extraits du livre de Richard Rohr : The divine dance : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-et-vivre-la-presence-dun-dieu-relationnel/
- http://www.temoins.com/26-novembre-2016-rencontre-temoins-theme-parcours-de-foi-aux-marges-cadres-institutionnels/
- Danièle Hervieu-Léger. Mutations de la société catholique en France. Etudes, février 2019, p 67-78
- Odile Hassenforder : « Sa présence dans ma vie ». Un témoignage vivant : https://vivreetesperer.com/odile-hassenforder-sa-presence-dans-ma-vie-un-temoignage-vivant/
- Témoignage. L’apport de la culture numérique en marge des cadres institutionnels : http://www.temoins.com/lapport-de-la-culture-numerique-a-un-parcours-de-foi-en-marge-des-cadres-instituptionnels/
Voir aussi
« Partager le bon et le beau » : https://vivreetesperer.com/partager-le-bon-et-le-beau/
Les progrès de la psychologie – Un grand potentiel de guérison
 Interview de France Dandrel, psychopraticienne
Interview de France Dandrel, psychopraticienne
France Dandrel est psychopraticienne. Elle commence à s’engager dans la pratique psychologique dans les années 1970. Et elle a suivi successivement différentes formations en vue de répondre à des besoins diversifiés.
Elle a commencé par un apprentissage de la méthode Vittoz, une méthode de relaxation basée sur l’utilisation de la relation sensorielle. Cependant, cette méthode à une particularité : la lecture des ondes cérébrales alpha et thêta. Cette méthode permet de voir si le cerveau est relaxé ou non. On peut faire cette lecture à partir du corps de la personne ou à distance. France Dandrel a évolué dans sa pratique, mais elle se sert toujours aujourd’hui de cette lecture des ondes cérébrales parce que celle-ci lui permet de voir, ce qui, dans la psychothérapie, a une influence positive ou non, quelque soit la pratique par ailleurs. Par exemple, la sophrologie est une méthode d’induction à partir d’images. Ce n’est pas toujours efficace parce que les ondes cérébrales ne sont pas vérifiées .
France Dandrel s’est rendu compte des limites de la méthode Vittoz. Elle a donc recherché d’autres méthodes. En premier lieu, elle s’est formée à la thérapie primale, c’est à dire une méthode qui permet d’exprimer les émotions au sens large par une expression corporelle : pleurs, colère, et aussi ce qui lui a donné son nom, un cri, le cri primal. Cette approche permet de réduire le blocage des émotions, mais, ensuite, une limite apparaît : cette approche ne transforme pas nécessairement les émotions considérées comme négatives en émotions positives.
France Dandrel s’est donc engagée ensuite dans une pratique appelée analyse psycho-organique qui a pour but de transformer l’énergie négative en énergie positive. On se répare en changeant les images intérieures. Par exemple, telle personne a subi la maltraitance d’un professeur ou en a été le témoin. Elle va être complètement coincée dans ses apprentissages scolaires. A travers l’analyse psycho-organique, tel jeune garçon, bloqué par une maltraitance scolaire, a pu être libéré du blocage et, au final, entrer dans une grande école. Le processus réside dans un changement d’image. Qu’est-ce que j’ai subi? Qu’est-ce que j’aurais aimé vivre à la place ? France Dandrel contrôle la visualisation à travers l’usage des ondes Vittoz.
Par la suite, France Dandrel a ajouté à ses compétences, une approche systémique. Cette approche permet d’examiner les relations pour voir, si, dans une approche mutuelle, la relation est positive ou négative. A partir de là, on peut transformer le regard qu’on a, sur soi et sur l’autre, en valorisant le positif.
Dans la poursuite de sa formation et de sa pratique, France Dandrel s’est engagée dans la thérapie générationnelle. On regarde l’histoire familiale sur plusieurs générations et on observe les souffrances qui ont pu advenir dans les générations précédentes et qui peuvent avoir des incidences néfastes sur le présent. Par exemple, chez un homme qui avait la phobie du métro, on a découvert qu’un de ses aïeux avait fait la guerre de 1914 et avait beaucoup souffert dans les tranchées. La thérapie a permis à cet homme de revivre la terreur de l’aïeul. Et, la fois suivante, cet homme n’avait plus de phobie. Une autre personne avait peur d’être poignardée dans le dos. C’était une conséquence d’un trauma de la guerre de 1914. Elle a revécu ce trauma et elle a été guérie.
Dans la thérapie de couple et la thérapie familiale, France Dandrel utilise le jeu de rôle . En jouant le rôle du personnage négatif ayant vécu dans l’environnement familial, une libération peut se produire.
Une nouvelle technique, inventée aux Etats-Unis par Francine Shapiro, basée sur le mouvement des yeux, mais valables aussi dans des mouvements sensoriels alternatifs droite-gauche et inversement, rebranche les deux cerveaux droite et gauche. Le cerveau entier est aux commandes et, dans cet état, il est capable de se réparer. C’est L’EMDR (eye movement desensibilisation reprocessing). Cette méthode a été importée en France par David Servan-Schreiber. France Dandrel a eu l’opportunité d’être formée par lui à cette approche. Cette méthode est remarquablement efficace à condition d’être sur la bonne cible. Francine Shapiro donne cet exemple : une femme était terrorisée par les boites de conserve parce qu’elle avait vécu une tempête où des boites de conserve lui étaient tombé dessus. La séance de EMDR a traité le trauma de la tempête. Les problèmes de beaucoup de gens résultent d’un réveil de trauma. En traitant par EMDR un trauma bien ciblé, on coupe les racines des réflexes conditionnés. Cette méthode a été élaborée pour aider les soldats ayant fait la guerre du Vietnam à retrouver une vie normale. France Dandrel a traité un homme ayant fait la guerre d’Algérie, et qui, dans son couple, disait le soir au conjoint : « Tais-toi ! ». Durant cette guerre, en patrouille, les soldats se mettaient en danger lorsqu’ils parlaient. C’était un souvenir traumatisant. Ce problème a été réglé en une seule séance de EMDR. Chez une personne ayant peur du bruit des voitures, on a découvert qu’elle associait à ce bruit celui d’un tremblement de terre vécu avec effroi. En une séance de EMDR bien ciblée sur cette origine : le tremblement de terre, la peur du bruit des voitures a disparu.
Le ciblage repose sur l’écoute de l’histoire de la personne. France Dandrel a appris l’écoute dans l’inspiration Rogerienne (Carl Rogers) au tout début de sa formation parallèlement à la méthode Vittoz. L’écoute favorise et requiert l’authenticité. Ainsi, en écoutant, on ressent des sensations et il est important d’écouter ces sensations corporelles. Lorsqu’on est sur la bonne piste, l’énergie intérieure circule . Ce signe vaut à la fois pour la thérapeute et pour la personne. En cas de blocage, le thérapeute exprime sa réaction, le blocage physiologique qu’elle ressent. La personne écoutée se rend compte qu’il y a un blocage. Il y a quelque chose qu’elle n’identifie pas ou qu’elle n’exprime pas. Elle reprend le fil de son histoire. Le courant passe.
A un moment de son parcours, France Dandrel a ajouté un autre outil : une approche psycho-spirituelle. Dans ce contexte, elle a appris à recevoir des images qu’elle peut soumettre à la personne. C’est le champ de la guérison intérieure.
A travers toutes ces approches qui se sont ajoutées au fil des années, France Dandrel a découvert le champ très large des blessures qui peuvent être guéries, mais aussi une vaste panoplie d’outils permettant de guérir ces blessures. Comment peut-on comparer les ressources d’aujourd’hui à celles d’autrefois ? Dans les années 1970, il n’y avait pas grand chose. Il y avait l’analyse, l’hypnose et la méthode Vittoz. L’analyse, c’est regarder l’histoire de la personne et comment elle s’est construite à travers son histoire. Elle a fait des choix, des « contrats » qui ont pu être adéquats au moment où elle les as fait, mais qui, pour la suite, peuvent se révéler inadéquats. Si une personne a été maltraitée en famille, elle va penser qu’il vaut mieux ne jamais vivre en famille ou elle va dysfonctionner en famille. Une limite de l’EMDR, c’est que, tout en étant efficace dans la réparation des blessures, par contre, elle ne prend pas obligatoirement en compte l’histoire de la personne, et, du coup, il peut y avoir des maillons qui ne sont pas pris en charge. S’il n’y a pas une approche globale de la personne, cela peut compromettre la progression de celle-ci. Dans l’analyse, la personne découvre son histoire, mais cela ne cicatrise pas, ne répare pas l’origine du traumatisme. Dans les années 1970, on abordait l’histoire, on la comprenait, mais on ne pouvait pas intervenir pour réparer. En cinquante ans, on a développé le transformationnel. La transformation est très guérissante. Elle mobilise l’énergie globale de la personne. Tout le potentiel de guérison est mis en œuvre . Cette approche de la transformation a été particulièrement développée par l’école des Boyesen : l’approche psycho-organique. Ils se sont appuyés sur le corps, d’une part au niveau du massage, puis au niveau de la transformation. La personne développe ainsi son énergie positive. En EMDR, ce qui est ajouté, c’est le fait de relier l’ensemble du cerveau et donc de réparer les blessures. L’EMDR permet au circuit neuronal de refonctionner. Par rapport aux années 1970, aujourd’hui, les ressources sont bien plus vastes. C’est incomparable.
France Dandrel nous rapporte même qu’elle a pu sortir une personne de l’hôpital psychiatrique. Cette personne ainsi condamnée à l’hospitalisation a pu non seulement sortir de l’hôpital, mais reprendre une vie normale. La personne a pu récupérer en identifiant le moment de sa vie ou elle avait été traumatisée, et, en traitant cet épisode, la personne a pu récupérer. Le potentiel humain est très vaste. Chaque outil thérapeutique va éclairer une partir du champ. Les différentes approches sont complémentaires et leur conjonction permet d’améliorer considérablement la qualité de la vie humaine.
Interview de France Dandrel rapportée ici à la suite d’une prise de notes.
J H
L’enfant : une personne à respecter
Savoir demander pardon !
Un adulte qui demande pardon à un enfant : savez-vous que cela peut exister ? Cette attitude n’est pas courante dans la société actuelle. Voilà pourquoi j’ai admiré mon amie Virginie. Elle est enseignante dans le primaire. Les enfants sont durs et ils ont le don de mettre les nerfs de leurs enseignants à bout, m’a-t-elle raconté. Et ce jour-là, le petit (appelons-le) Martin l’a particulièrement énervée. Elle, habituellement si placide, a perdu patience et l’a rudement admonesté. La journée a passé, les nerfs à fleur de peau. Bien sûr, Virginie n’était pas trop contente d’elle. La réaction habituelle est, bien souvent, de refouler ce malaise intérieur. Virginie, au contraire, s’est remémorée la situation et a pensé à l’enfant, m’a-t-elle dit. « Je n’aime pas penser qu’un enfant vienne à l’école, la peur au ventre, dans la crainte de se voir à nouveau rejeté dans ses réactions ». Et, geste que j’ai trouvé admirable, elle a demandé pardon à l’enfant devant sa maman. Celle-ci a été choquée que cette maîtresse « s’abaisse » ainsi devant un enfant. Elle n’avait pas compris que ce n’était pas perdre son autorité que de reconnaître ses torts et de montrer que l’adulte n’est pas parfait. Au contraire, l’enfant se sent d’autant plus en confiance qu’il n’est pas soumis à une pression autoritaire. Tout enfant est sensible à la justice et il reconnaît la vraie autorité. Reconnaître ses erreurs est une attitude de force et non de faiblesse. Cette maman, sans le formuler ainsi, a dû le ressentir, car, d’après mon amie Virginie, elle est partie contente. S’est-elle, elle-même, sentie valorisée à travers son enfant ? C’est probable.
J’ai connu un père qui demandait ainsi pardon à son fils lorsqu’il s’énervait ou se trompait. J’ai constaté qu’un grand courant de confiance et d’affection passait entre eux. Et j’ai apprécié ce sentiment de joie chez l’enfant, déjà adolescent, le jour où il s’est exclamé : « C’est bien de se disputer. Après on est content de se réconcilier ». Une sorte de connivence s’était établie entre eux.
Tout geste positif entraîne d’abondantes bénédictions. Cela me rappelle la recommandation de Paul aux chrétiens de Galates (6.1..). « Frères, si quelqu’un s’est laissé surprendre par une faute , vous, qui vous laissez conduire par l’Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec affection et douceur, en évitant tout sentiment de supériorité. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas tomber toi-même dans l’erreur. ». Jésus a montré beaucoup de sollicitude et de respect pour les enfants. Les mots bibliques de douceur et humilité sont peu employés de nos jours dans la vie courante. Par contre, le respect est fréquemment invoqué et il est souvent réclamé par des jeunes et des moins jeunes. N’est-ce pas là une attitude préalable à toute relation vraie et à un véritable amour pour le prochain ?
Cette histoire a été pour moi une source de réflexion que je partage ici, comme un éveil à la beauté qui se dégage d’une relation vécue dans l’amour et la vérité. Merci, Virginie, de m’avoir raconté ta mésaventure avec tant de simplicité.
Odile Hassenforder
Dix ans après son départ en mars 2009, ce blog continue à s’inspirer de la pensée d’Odile et de son livre : « Sa présence dans ma vie » dont des extraits sont régulièrement publiés sur ce site : https://vivreetesperer.com/odile-hassenforder-sa-presence-dans-ma-vie-un-temoignage-vivant/
Cet article, mis en ligne en mars 2007 sur le site : Témoins, avait échappé à la recension du livre, et nous le publions ici. Dans sa version initiale, il est suivi par le témoignage de Virginie auquel on pourra se reporter : http://www.temoins.com/lenfant-une-personne-a-respecter-une-institutrice-temoigne/
Ce récit nous « éveille à la beauté qui se dégage d’une relation vécue dans l’amour et la vérité ». Mais il appelle aussi au respect de l ‘enfant. On peut se réjouir que cette conscience s’étende et s’affirme aujourd’hui. C’est le cas dans l’approche Montessorienne qui se diffuse aujourd’hui sur différents modes et notamment dans l’expérience et la pensée de Céline Alvarez : « Pour une éducation nouvelle, vague après vague » : https://vivreetesperer.com/pour-une-education-nouvelle-vague-apres-vague/
C’est aussi le cas dans l’éducation bienveillante qui peut s’appuyer sur la Communication Non Violente (CNV) . A cet égard, on pourra consulter le blog de Coralie Garnier :les6doigtsdelamain, qui nous présente une approche de « parentalité positive ». On pourra y lire le récit de l’entretien de Coralie avec le professeur de sa fille qui avait injustement rabroué celle-ci. Dans une inspiration de communication non violente, une finesse et sa compréhension qui engendrent la réussite du dialogue, l’attitude de Coralie et la description de la conversation nous paraissent exemplaires. Respect de l’enfant, respect de l’adulte : « Mon entretien délicat avec le professeur de ma fille » : https://les6doigtsdelamain.com/mon-entretien-delicat-avec-la-professeur-de-ma-fille/
Avoir de la gratitude
 Un éclairage de Bertrand Vergely
Un éclairage de Bertrand Vergely
Et si nous reconnaissions aujourd’hui tout ce que nous avons reçu des autres et qui fait que nous sommes vivant
Et si nous exprimions cette reconnaissance dans un mouvement de vie bienfaisante à la fois pour ceux à qui nous l’exprimons, mais aussi pour nous-même.
Car, au cœur de ce mouvement, il y a une dynamique à la fois personnelle et collective où nous pouvons percevoir l’inspiration de l’Esprit
C’est dire comme il est bon d’entendre parler de gratitude, et d’en découvrir la portée et les effets.
Ainsi avons nous accueilli avec reconnaissance une intervention de Florence Servan-Schreiber à Ted X Paris sur « le pouvoir de la gratitude » (1). Cet exposé est remarquable parce qu’il allie une compétence de psychologue ayant accès aux meilleures sources et une démarche personnelle exprimée dans un esprit de recherche, de dialogue, de conviction et d’authenticité. Dans son livre : « Retour à l’émerveillement » (2), Bertrand Vergely aborde le même sujet dans une approche complémentaire, une approche philosophique, spirituelle, théologique (3). Il nous donne à voir le sens profond de ce mouvement.
Merci
Quoi de plus naturel que de dire : « merci » ! Et si on peut le dire souvent, il y a comme une joie qui s’épanche, un élan de reconnaissance et de sympathie. C’est une expression de la vie quotidienne. Et c’est effectivement dans ce contexte que Bertrand Vergely nous en montre l’importance. Ce n’est pas seulement une expression du cœur, c’est aussi un mouvement qui s’inscrit dans la vie sociale, l’embellit et la pacifie. « Il est beau de dire merci. Cela permet de clore quelque chose et d’ouvrir autre chose. Dans le monde de la violence, on ne dit pas merci. Pire, on ne se fait grâce de rien, on est « sans merci ». On se poursuit sans répit, on se persécute, on ne s’épargne rien. Cela révèle la profondeur du merci. Prononcer ce mot, c’est passer de la guerre à la paix, de la haine à la réconciliation, de l’inimitié à la relation. On pourrait poursuivre la lutte, la haine, la persécution. On décide de ne pas le faire et de revenir à la logique des échanges et du don ».
Les « mercis » ponctuent une vie quotidienne dans laquelle on reçoit et on donne, on donne et on reçoit. C’est en quelque sorte un marqueur de civilité, une expression de vie civilisée. « Logique dans laquelle on se salue réciproquement. On donne et on reçoit. On offre et on dit merci. Il s’agit là d’une révolution obéissant à un constat lucide. Ou l’on persiste à vivre dans la violence, ou on y renonce et on vit… ».
Dire merci s’inscrit ainsi dans une vie sociale ou le partage se réalise dans une relation réciproque. « C’est le « pacte de réciprocité » inséparable d’un pacte de non violence ainsi que le rappelle Marcel Mauss dans son « Essai sur le don ». « La relation réciproque annule la violence. Personne ne prenant sans donner et ne donnant sans prendre. Il n’y a ni dominant, ni dominé. Le remerciement prend sa source dans une telle logique et donne la logique de l’invitation sue laquelle repose la vie sociale. On a été invité. On invite à son tour… Cette politesse fait en sorte que personne ne sacrifie l’autre ou ne soit sacrifié par lui… Profondeur du merci. Il raconte ce qui perd l’humanité. Il raconte ce qui la sauve. Nous mourrons de ne jamais dire « merci », nous ressuscitons en le disant ».
Gratitude
Mais l’expression de notre reconnaissance dépasse de beaucoup l’ordinaire de la vie quotidienne.
« La gratitude va plus loin que le merci. Comme montre l’expérience, on est dans la gratitude quand on fait plus que remercier quelqu’un. On est dans un tel état parce que l’on a reçu quelque chose d’exceptionnel. Quand quelqu’un nous a sauvé la vie, nous éprouvons de la gratitude, une profonde, une extrême gratitude. On se situe là dans la plus grande profondeur qui soit… Notre cœur est rempli de gratitude. Nous rendons grâce. Nous avons conscience du miracle en nous sentant petit devant l’immense… L’existence est un miracle permanent. Nous ne nous en rendons pas assez compte ».
Cette gratitude a une portée sociale. Elle a aussi une dimension spirituelle. « Quand il n’est pas déprimé, l’homme moderne rouspète. Il est mécontent, indigné, révolté et il le fait savoir. Jamais il ne dit merci. Il pense que tout lui est du ». Bertrand Vergely voit là un manque profond, jusqu’à un drame spirituel. « Il y a une ingratitude profonde dans le cœur humain. Au lieu de remercier, l’ingrat proteste. Il poursuit Dieu de sa vindicte en lui reprochant non seulement d’avoir raté, mais créé le monde. L’existence de l’humanité est pour lui un crime de lèse-humanité.
On va loin quand on a un moment de gratitude en remerciant le Ciel d’exister. On touche au drame inconscient de l’humanité. Celle-ci a un compte à régler avec Dieu comme avec elle-même. Elle n’est pas heureuse d’exister. On sort de cette logique meurtrière en ayant un peu de gratitude et en ouvrant les yeux. Oui, il est miraculeux de vivre (4). L’univers, la vie, l’humanité sont des miracles permanents. Nous-mêmes, nous sommes des miracles vivants. Nous devrions être morts cent fois, nous sommes encore là. Nous sommes des miraculés. Sans que nous le sachions, sans nous en rendre compte, nous avons été sauvés cent fois ».
Bertrand Vergely nous entraine plus loin encore dans une dimension métaphysique. « Si le mot « merci » permet de mettre fin à la guerre qui fait rage entre les hommes sur terre, le mot « gratitude » permet de mettre fin à celle qui fait rage entre les hommes et le Ciel. Il est courant de penser que la métaphysique est inutile et que nous n’en avons pas besoin pour vivre. Il s’agit d’une erreur profonde : elle est indispensable et l’on vit mal quand on s’en passe . L’être humain est un arbre qui relie le Ciel et la Terre. Privons-le de la Terre, il s’écroule. Privons-le du Ciel, il étouffe.
La gratitude est vitale. Elle signifie la paix avec le Ciel. et avec celle-ci, la liberté. Il est beau de voir le monde avec gratitude… Tout étant un miracle, tout vit. Tout se met à vivre. On a alors envie de vivre et de se réjouir de l’existence de l’humanité ».
Dire merci, exprimer de la gratitude témoignent du même esprit, de la même sensibilité et s’inscrivent dans une démarche commune. Si Bertrand Vergely les distingue, ce n’est pas seulement en fonction de l’intensité de ces deux expressions, c’est parce qu’il les situe dans un contexte plus large. Nous sommes de plus en plus nombreux à partager une vision de la société comme un tissu de relations. « Si l’Esprit est répandu sur toute la création, il fait de toutes les créatures avec Dieu et entres elles, cette communauté de la création dans laquelle toutes les créatures communiquent, chacune à sa manière entre elles et avec Dieu » déclare le théologien Jürgen Moltmann qui cite Martin Buber : « Au commencement était la relation » (5). Bertrand Vergely montre l’importance de la gratitude dans le plein déroulement des relations. Et comme Jürgen Moltmann, Richard Rohr (6) ou d’autres, il se fonde sur une théologie trinitaire et met en évidence le rôle de l’incarnation. « La vie est relation… Cela veut dire que le Ciel et la Terre sont liés. Dieu a crée l’univers et l’homme pour s’unir à eux… il a créé pour transmettre, pour rayonner, pour diffuser. Il a bâti un pont entre lui et son autre, en l’occurrence l’univers et l’homme… Qui s’applique, bâtit des ponts, il reprend le geste divin de la création » ( p 253-254). La gratitude, comme la louange sur laquelle elle débouche, participent à cette œuvre.
Il est temps maintenant d’apporter un témoignage concret de la manière dont la gratitude accompagne une vie pleine malgré les épreuves. C’est le témoignage d’Odile Hassenforder dans son livre : « Sa présence dans ma vie » (7) : « Que c’est bon d’exister pour admirer, m’émerveiller, adorer. C’est gratuit. Je n’ai qu’à recevoir, en profiter, goûter sans culpabilité, sans besoin de me justifier (Justifier quoi ? de vivre ?). D’un sentiment de reconnaissance jaillit une louange joyeuse, une adoration au créateur de l’univers dont je fais partie, au Dieu qui veut le bonheur de ses créatures. Alors mon ego n’est plus au centre de ma vie. Il tient tout simplement sa place, relié à un « tout » sans prétention (Psaume 131). Je respire le courant de la vie qui me traverse et poursuit son chemin. Comme il est écrit dans un psaume : « Cette journée est pour moi un sujet de joie… Une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel auprès de toi, mon Dieu… Louez l’Eternel, car il est bon. Son amour est infini (Psaume 16.118) ». Expression personnelle, la gratitude nous invite au dépassement, à une participation à plus grand que nous, à la reconnaissance de la présence divine. Comme l’écrit Bertrand Vergely : « Il est beau de voir le monde avec gratitude. Tout étant miracle, tout vit, tout se met à vivre. On a alors envie de vivre et de se réjouir de l’existence de l’humanité ».
Jean Hassenforder
- « Le pouvoir de la gratitude. D’après les propos de Florence Servan-Schreiber » : https://vivreetesperer.com/la-gratitude-un-mouvement-de-vie/
- Bertrand Vergely . Retour à l’émerveillement. Albin Michel, 2010 (Espaces libres) (format de poche 2017) Interview de Bertrand Vergely sur son livre où il déclare notamment « Je ne vis pas tant par courage que par gratitude… » : https://www.youtube.com/watch?v=_XY5_3oD7lA
- « Avoir de la gratitude » p 219-222, dans : Bertrand Vergely. Retour à l’émerveillement
- « Le miracle de l’existence. Eclairage de Bertrand Vergely » : https://vivreetesperer.com/le-miracle-de-lexistence/
- Jürgen Moltmann. Dieu dans la création. Traité écologique de la création. Cerf, 1988 ( p 24-25)
- « La danse divine (The divine dance) par Richard Rohr : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/
- Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Un parcours spirituel. Empreinte temps présent, 2011. Extrait publié ici : « J’accueille la vie » p 179-180. Présentation du livre : « Sa présence dans ma vie. Un témoignage vivant » : https://vivreetesperer.com/odile-hassenforder-sa-presence-dans-ma-vie-un-temoignage-vivant/
Ecouter les paroles des plus fragiles, c’est aussi entrer dans un changement personnel
Guy Aurenche, ancien président de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) et du CCFD-Terre solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le Développement), a été invité dans une communauté chrétienne qui affronte des problèmes de fragilité et de marginalité. A partir de son expérience personnelle, associative et ecclésiale, il a répondu à la question qui lui était posée : « Comment la parole des plus fragiles m’a changé et me change encore aujourd’hui ? ».
En réponse, Guy Aurenche propose cinq pistes.
« Très tôt, à travers l’ACAT, j’ai rencontré les réalités épouvantables de la torture. J’ai été bouleversé par tant de capacités destructrices. Cependant, le message que j’ai reçu a été celui de notre capacité à rejoindre les victimes dans leur drame et à briser la solitude imposée pour les détruire. Par les actions, les protestations et la prière, j’ai découvert que je pouvais devenir un modeste sauveteur, un briseur de solitude. Alors les victimes se déclaraient sauvées car elles n’étaient plus seules pour affronter leurs souffrances. La parole des plus fragiles a fait de moi un briseur de solitude, une source de vie.
La parole des plus fragiles nous met sur le chemin de la fraternité. A travers les partenariats noués par le CCFD-Terre solidaire avec des associations combattant les injustices, j’ai rencontré non pas des pauvres et des malheureux, mais des frères et des sœurs avec lesquels je pouvais agir. Cette fraternité, parfois déconcertante, m’a permis de cheminer et de découvrir que l’autre était frère.
La parole des plus fragiles a fait de moi un « porteur de parole ». a travers le métier d’avocat, les plus fragiles m’ont demandé de dire leur parole dans le cadre de la justice. Ils étaient alors reconnus dans leur dignité quelque soit les fautes qu’on leur reprochait, alors qu’ils n’étaient pas capables de se faire entendre. J’ai parfois rencontré des problèmes de conscience lorsque la parole qu’il m’était demandé de porter, ne me semblait pas conforme à la vérité. Cependant, après réflexion, j’ai défendu leur parole, car le juge avait besoin de l’entendre avant de se prononcer. Les plus fragiles m’ont appris le lien entre la reconnaissance de la dignité d’une personne et l’écoute de sa parole.
La parole des plus fragiles a fait de moi un acteur de transformation sociale pour découvrir peu à peu qu’il ne suffisait pas d’entendre leur cri, mais de les rejoindre dans le combat social, économique pour s’attaquer aux causes des injustices. Cette action de transformation sociale devait se faire non pas seulement à travers mes propres idées, mais en accueillant la capacité inventive de ceux avec lesquels j’intervenais. La parole des plus fragiles m’a aidé et m’aide à donner tout son sens à l’engagement politique.
La parole des plus fragiles m’a aidé et m’aide à découvrir les profondeurs de la pauvreté. Nous nous faisons une idée restreinte de la pauvreté en la limitant à une approche matérielle. Par ailleurs, nous risquons toujours d’avoir « nos pauvres » selon nos critères philosophiques ou confessionnels. Ce sont souvent les plus fragiles qui m’ont fait découvrir qu’à coté d’eux, il y avait encore des plus pauvres et je ne l’avais pas vu. La parole des plus fragiles m’aide aujourd’hui à repérer les situations de pauvreté qui m’entourent.
C’est une bonne nouvelle que de découvrir que je suis capable de briser des solitudes, que j’appartiens à une fraternité agissante, qu’en portant sa parole, je peux aider l’autre à être reconnu, qu’en agissant ensemble, nous pouvons nous attaquer aux causes des injustices et que mes yeux comme mon cœur doivent rester à l’affut de toutes les pauvretés qui se cachent autour de moi ».
Interview de Guy Aurenche
Sur ce blog, voir aussi : « Justice sur la terre comme au ciel » : un livre de Guy Aurenche : https://vivreetesperer.com/dans-un-monde-difficile-un-temoignage-porteur-de-joie-et-desperance/
Présence d’un petit Rouge-gorge…
Vous êtes-vous déjà senti seul (e), préoccupé (e) ?
Peut-être comme moi êtes-vous allez faire un peu de jardinage pour vous changer les idées ?
Là, sans bruit, un petit être magnifique, un Rouge-gorge vient s’installer juste à côté de vous, il ne bouge pas, il semble écouter… ou peut-être a-t-il juste senti votre tristesse ?
Sa présence est réconfortante, vous sentez comme la présence de Dieu auprès de vous.
Cette expérience se renouvelle régulièrement, dès que mon mari et moi sommes dans le jardin, « notre » petit rouge-gorge s’invite et renouvelle en nous la chaleur de la présence de Dieu.
Présence de Dieu dans la nature !
CJ
Dynamisme de vie dans un monde qui se construit
Toutes les informations affluent pour nous dire que nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté, une mondialisation qui se poursuit à vive allure. Et la Chine fait désormais partie de cet univers. Cependant, pour certains, elle peut paraître encore lointaine, un peu étrange selon la représentation de notre histoire. Et même parfois, cette évocation peut engendrer une certaine crainte. La même crainte apparaît vis à vis de la mondialisation. Et si la crainte l’emporte sur la conscience que nous participons à une aventure qui peut se révéler positive pour nous tous, alors on entre dans la défense et le repli. Nous y sommes. C’est le moment où les populismes s’accompagnent de réflexes nationalistes. Alors, en regard, il nous faut poursuivre et amplifier le grand récit de ce qui unit, de ce qui est en train de se construire partout dans le monde, un monde qui doit faire face à des défis communs, de la misère au saccage de la nature.
De belles histoires nous sont déjà familières. Cependant, en fréquentant internet, on découvre des personnalités jusque là ignorées. Ainsi, à travers des vidéos, nous avons fait connaissance de Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, la grande entreprise de distribution chinoise à l’égale d’Amazon. A priori, qu’est ce qui pouvait nous intéresser dans cette manifestation d’un capitalisme étranger ? Or nous nous nous sommes sentis concernés et encouragés par l’histoire de Jack Ma. En effet, c’est l’histoire d’un homme qui, ayant grandi en terre chinoise, s’est ouvert à la culture internationale, en dépassant les enfermements et en créant dans son pays une dynamique économique.
Sa biographie est aujourd’hui bien accessible (1).
Jack Ma a appris l’anglais en fréquentant et en accompagnant des touristes . Il est devenu professeur d’anglais. Cette familiarisation avec la culture anglophone lui a permis d’effectuer un séjour aux Etats-Unis où il a découvert le potentiel d’internet. Dès lors, dans les années 1990, il s’engage dans la création d’entreprises fondées sur l’utilisation d’internet. Ce parcours débouche finalement sur la création d’Alibaba qui connaît un immense succès en transformant les conditions de la distribution commerciale en Chine.
Cependant, lorsqu’on entend Jack Ma nous raconter son parcours, on voit combien la réussite n’était pas acquise d’avance. Au contraire, Jack Ma nous rapporte la longue série des refus qui ont été opposés à ses candidatures à différents emplois, les nombreux échecs qu’il a rencontrés. C’est dire l’obstination et la persévérance dont il a fait preuve. Toujours attentif aux situations, aux besoins , il a su saisir les opportunités. Ce chemin, il l’a parcouru avec d’autres, dans un esprit de collaboration et une capacité de leadership. Il a été porté par une inspiration toujours positive : ne pas se plaindre, tirer parti des échecs, partir à nouveau. Cet homme sympathique est appelé aujourd’hui à s’exprimer dans des vidéos en vue de former et d’encourager des entrepreneurs (2)
Mais si cette histoire nous interpelle, ce n’est pas d’abord en raison des qualités entrepreneuriales de Jack Ma, c’est parce que sa conduite et son discours témoignent également d’un humanisme qu’il est bon de pouvoir reconnaître et apprécier dans un univers qui ne nous est pas familier. Jack Ma a conscience de la finalité de service de son entreprise. Il met en évidence les qualités des femmes dans ce travail et le rôle majeur qu’elles jouent dans ce domaine. C’est un engagement ferme en faveur de la promotion féminine. Jack Ma travaille avec de nombreuses petites entreprises et il soutient et encourage les petits entrepreneurs. Jack n’oublie pas les premières années où il a été un professeur d’anglais très apprécié par les étudiants. Il encourage les jeunes. C’est une autre illustration de son sens de la relation. Ainsi accorde-il une grande importance à l’éducation. Et son approche est humaniste. Ainsi, reconnaissant le rôle de plus en plus grand qui va être joué par les machines, il nous dit qu’il appartient à l’éducation de contribuer au développement de ce qui est proprement humain : « les valeurs, le croire, la pensée indépendante, le travail en équipe, le soin porté aux autres ». Et, en cc sens, quelles disciplines privilégier ? « Les sports, la musique, la peinture, les arts… » (3).
Face à l’agitation qui nous entraine, à un appétit effréné de consommation, il nous appelle à la sagesse (4). « Chaque désastre environnemental est un reflet de l’âme humaine Parce qu’on a besoin de trop de choses, on détruit beaucoup de choses. Tout ce que l’on veut, c’est avoir plus. On en veut toujours plus : aller sur la lune, aller sur Mars.. etc. On regarde toujours vers l’extérieur. Nous les êtres humains, on ne regarde jamais vers l’intérieur. Si vous ne faites pas d’introspection, vous ne serez jamais sage. Si vous n’êtes pas sage, vous ne savez pas ce que vous avez envie. Aujourd’hui, les êtres humains disposent de bien plus de ce qu’ils peuvent s’attendre à recevoir. Alors la pollution, tout ce qui arrive, c’est parce que les êtres humains deviennent cupides et arrogants. C’est pour cela que la technologie des big data essaie maintenant de percevoir à l’intérieur de l’être humain. Croyez-moi ! la machine vous connaitra mieux que vous ne vous connaissez vous-même.. Donc, selon moi, dans une période de datas, dans les cent prochaines années, les êtres humains doivent essayer de faire preuve d’introspection. On verra beaucoup de choses horribles en nous. Quand la connaissance est tournée vers l’extérieur, on voit de mauvaises choses chez les autres alors qu’on peut voir les belles choses si on regarde à l’intérieur. C’est la philosophie chinoise ».
Dans un monde inquiet et tourmenté où les menaces abondent, il est important de nous rassembler dans une inspiration constructive. Nous avons besoin d’entendre qu’il y aujourd’hui un grand nombre d’initiatives positives. Certaines, comme les organisations humanitaires, sont bien connues. Partout, dans le monde, des hommes de bonne volonté sont à l’œuvre (5). Nous pouvons également percevoir des évolutions dans les mentalités, des émergences qui adviennent ou se préparent. Ce récit de vie du fondateur d’une grande entreprise chinoise apparait dans ce contexte. Pour certains, il n’est pas attendu dans ce que nous percevons de ces innovations positives, mais, de fait, il nous apporte un éclairage complémentaire et convergent. Nous avons bien ce qui peut être redouté et redoutable dans le contexte chinois. Nous savons aussi qu’à partir d’une immense pauvreté, la Chine a pu engendrer une classe moyenne qui compte plusieurs centaines de millions de personnes.
Si le récit de Jack Ma nous parait si important, c’est justement parce qu’il intervient dans un univers que, pour beaucoup d’entre nous, nous connaissons mal. Il nous dit qu’à travers le commerce, des relations nouvelles s’ouvrent à l’échelle du monde. Il nous dit que des réalités nouvelles peuvent apparaître dans de contextes inattendus. Dans le contexte d’une grande et dynamique entreprise, le récit de Jack Ma témoigne d’un humanisme qui se dit aussi en d’autres points de la planète .
J H
(1) Une biographie de Jack Ma est accessible sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Ma Au World Economic Forum, Jack Ma, interviewé par Abi Ramanan, au regard de son parcours et son expérience de la dynamique d’Alibaba, expose sa vision de la transformation du monde et sa conception de la vie(Sous-titré) : https://www.youtube.com/watch?v=V9ENp2BQ8lE Sur Alibaba : Duncan Clark. Alibaba The house that Jack Ma built. Harpercollins. Un article récent sur Alibaba paru en France : https://www.capital.fr/entreprises-marches/jack-ma-son-alibaba-detronera-t-il-amazon-1322604
(2) « De la motivation à la réussite » ArgEntrepreneur. Présenté par Sonny Court. Interview traduit en français : https://www.youtube.com/watch?v=Bp6EUCr3du8
(3) Jack Ma on the future of education : https://www.youtube.com/watch?v=rHt-5-RyrJk
(4) La philosophie de la vie selon Jack Ma : https://www.youtube.com/watch?v=bM0vNSE8yeI
(5) Partager les solutions. Propager les innovations. C’est changer le monde. http://www.vivreetesperer.com/partager-les-solutions-propager-les-innovations-cest-changer-le-monde/
Un regard lumineux dans un pays lumineux
Automne 2018 en pays de Valence (Valencia. Espagne)
D’après les photos de Gloria Castro
Il y a des sites de photos où on s’arrête et où on revient parce qu’il y a entre eux et nous une affinité comme un gout et un regard partagé. Y venir, y revenir, c’est à chaque fois un émerveillement parce qu’à chaque entrée, on y découvre des photos admirables. Et ces moments de bonheur, on désire les partager avec d’autres, par exemple en les mettant en ligne à travers un journal facebook.
Le site de Gloria Castro
Le site Flickr de Gloria Castro (1) a commencé en 2005. Il est donc très abondant dans une diversité de genre : une grande variété de paysages : ciel, mer, eaux, campagnes, fleurs, oiseaux… jusqu’à de belles personnes, de beaux visages. Gloria Castro voyage de temps à autre, mais son lieu est un sujet constant d’émerveillement. C’est la province de Valencia (2) dans le sud-est de l’Espagne avec ses plages, ses campagnes méditerranéennes, ses collines et ses montagnes, une profusion de nature. Le site de Gloria Castro est bien connu et il est très fréquenté. Ses photos sont partagées par centaines en « favoris », c’est à dire exposées sur d’autres sites. Et les commentaires, en d’heureuses appréciations et exclamations, affluent et expriment un émerveillement partagé.
Un regard lumineux dans un paysage lumineux
En pays méditerranéen, la lumière est présente. Mais la sensibilité à la lumière la rend plus présente encore. Et nous voyons sur ce site un regard qui saisit toutes les formes de lumière. C’est un regard lumineux dans un paysage lumineux. Nous avons trouvé dans le livre de Bertrand Vergely : « Retour à l’émerveillement » (3), un texte qui convient à cette situation : « Il y a des moments où la lumière pense » dit Gilles Deleuze. Les Anciens voyaient la nature comme Logos. L’émerveillement nous fait remonter à cette intuition première, source de toute vitalité, on ne vit pas dans un univers vide et muet, on vit parce que l’univers est saisissant. Eric Sablé en rend bien compte dans son « Petit manuel d’émerveillement lorsqu’il écrit : « J’ai plein mes tiroirs de mots expliquant la vie, le temps, l’espace, la formation de l’univers, mais le mystère est là dans le paysage d’automne qui se fane et se froisse avant la grande immobilité de l’hiver ». S’émerveiller, c’est être là, face au monde, comme au premier jour, comme au premier instant, pur, neuf, nu, et regarder jusqu’au moment où les apparences basculent. Alors on est foudroyé par ce simple fait : il y a de l’être, j’existe, je suis…La vie a un sens, plus que du sens. Nous ne sommes pas là pour rien, nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Un rôle lié à la beauté, un rôle de témoins d’une vie venue de la beauté pour la beauté ».
Automne en pays de Valencia
Pour présenter le site de Gloria Castro, il fallait bien choisir un point de vue. A la vue des dernières photos, nous avons tout simplement retenu le thème de l’automne par ailleurs souvent évoqué en tant que tel par Gloria . Dans un pays méditerranéen, tout au sud, de l’Europe, l’automne ne nous apparaît pas comme « un froissement avant la grande immobilité de l’hiver », mais plus comme un passage bruissant des migrations d’oiseaux, des élans du soleil, et des murmures de la végétation. A grand peine, nous avons retenu seulement 6 photos de Gloria durant cet automne 2018. On pourra se hâter de voir toutes les autres !
J H
- Site de Gloria Castro : https://www.flickr.com/photos/glorinhabum/
- Province de Valencia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_(Espagne)
- Bertrand Vergely. Retour à l’émerveillement. Albin Michel (Espaces libres). Citation p 10-12
D’autres sites de photos sur ce blog
Le jardin de Paula
https://vivreetesperer.com/le-jardin-de-paula/
Couleurs et formes : merveilles en macrophotographie
https://vivreetesperer.com/couleurs-et-formes-merveilles-en-macrophotographie/
Effets de lumière dans une campagne bocagère
https://vivreetesperer.com/couleurs-et-formes-merveilles-en-macrophotographie/
Comme les oiseaux du ciel
https://vivreetesperer.com/comme-les-oiseaux-du-ciel/
A la découverte des grands espaces américains
https://vivreetesperer.com/comme-les-oiseaux-du-ciel/
La lumière du matin
https://vivreetesperer.com/la-lumiere-du-matin/
Reconnaître le miracle dans nos vies
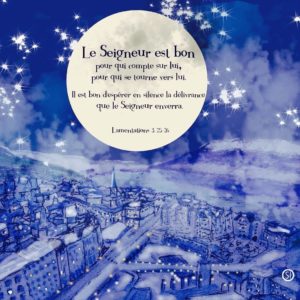 Rodolphe Gozegba, pasteur dans une paroisse alsacienne, avait été invité à participer à une réunion organisée par une paroissienne qui avait invité des amis chez elle. Il y avait donc onze personnes dans ce petit groupe. Elles n’appartenaient pas toutes à la paroisse. Elles avaient été invitées pour qu’elles puissent faire connaissance avec le nouveau pasteur de la paroisse. C’était donc une rencontre conviviale et amicale.
Rodolphe Gozegba, pasteur dans une paroisse alsacienne, avait été invité à participer à une réunion organisée par une paroissienne qui avait invité des amis chez elle. Il y avait donc onze personnes dans ce petit groupe. Elles n’appartenaient pas toutes à la paroisse. Elles avaient été invitées pour qu’elles puissent faire connaissance avec le nouveau pasteur de la paroisse. C’était donc une rencontre conviviale et amicale.
Au début de la réunion, chacun s’est présenté. Après cette présentation, chacun s’est retrouvé autour d’une table avec gâteaux et café. Pendant qu’on mangeait ensemble, les gens parlaient seulement à leurs voisins. Pour permettre une conversation en commun, Rodolphe a eu une idée : poser une question qui permettrait à chacun de s’exprimer en mobilisant l’attention de tous sur un thème commun. Et, il a donc suggéré la question suivante : « Je sais que Dieu a fait des miracles dans nos vies et que nous sommes sans doute marqués par un de ces miracles. Est-ce que nous pourrions témoigner de ce miracle en peu de mots ? ». Tout le monde a trouvé que c’était une excellente idée. Et donc, chacun s’est exprimé à tour de rôle.
La voisine de Rodolphe, une femme d’origine syrienne, accompagnée par sa sœur, a témoigné pour elles deux. Elles ont connu une guerre terrible en Syrie et aussi des persécutions envers les chrétiens. Pour elles, le miracle a été la persévérance des chrétiens malgré la persécution. Aucun n’a abandonné la foi. Dieu merci, elles sont aujourd’hui vivantes en France.
La deuxième personne qui s’est exprimée nous a dit : « Mon miracle, c’est que je viens d’être guérie de mon cancer ».
Une veuve nous a ensuite parlé de la vie qu’elle a eue avec son mari. Au départ, elle avait hésité à l’épouser. Et puis, elle a trouvé ensuite en lui un homme admirable. C’est « l’homme de sa vie ».
Une autre personne, un homme, a témoigné qu’après le décès de sa première femme, il a rencontré, il y a vingt-cinq ans, une femme d’origine américaine, avec laquelle il s’est marié et se trouve heureux aujourd’hui. Cette femme était là avec lui et elle a aussi témoigné. Ayant quitté les Etats-Unis, elle était allé en Allemagne et ensuite, elle est arrivée en Alsace où elle a rencontré son mari avec lequel elle est très heureuse aujourd’hui. Ainsi nous a-t-elle dit : « J’ai fait tout un périple pour finalement trouver l’homme de ma vie ». Cet amour est pour elle le grand miracle de Dieu.
Nous avons entendu ensuite le témoignage du mari de la femme qui a été guéri du cancer. Cet homme a beaucoup parlé. Un jour, nous a-t-il dit, il a entendu un pasteur déclarer dans sa prédication qu’il ne croyait pas à la résurrection de Jésus. Il a été profondément choqué et particulièrement scandalisé. Il a quitté l’église. « La foi chrétienne, vidée de la résurrection, n’est plus la foi chrétienne ». Dieu est au coeur de sa vie et sa raison d’être. « Sans Lui, je ne suis rien ».
La paroissienne qui nous a accueilli, a raconté que, lorsqu’elle était plus jeune, elle voyageait beaucoup. Et, comme elle n’avait pas beaucoup d’argent, elle prenait des avions avec plusieurs escales. Un jour, en allant au Japon, son mari et elle, ont fait une escale en Irak. Elle était enceinte d’un garçon et a fait une fausse couche. Par la suite, en Alsace, elle a enseigné le français à un jeune immigré irakien. Une relation forte s’est créée et celui-ci s’est mis à la considérer comme sa mère. Ce couple a une grande fille, mais il n’avait pas de garçon. Ils ont adopté le jeune irakien. Elle, qui avait perdu un garçon, en a retrouvé un. Ils ont désormais une grande fille et ce fils adopté. C’est le miracle de leur vie.
Ce tour de table s’est terminé par le témoignage de Rodolphe. Pour lui, le miracle, c’est que Dieu a fait de lui son serviteur, pasteur dans l’Eglise.
Comment Rodolphe a-t-il ressenti ce partage ?
Les participants étaient des chrétiens avec des sensibilités différentes. Par exemple, les deux syriennes étaient orthodoxes. Le couple franco-américain était mennonite… Nous étions en communion.
C’est la première fois que Rodolphe posait cette question : quel est le miracle qui a marqué votre vie ? Or, nous dit-il, « On envisage généralement le miracle comme une intervention extraordinaire de Dieu. Moi-même, je m’attendais à des témoignages de ce genre . Mais, dans ce groupe là, j’ai découvert que chaque personne a sa conception du miracle. Le miracle n’est pas forcément une manifestation soudaine et extraordinaire de Dieu. Le miracle, ce peut être aussi une merveilleuse rencontre. Ce peut-être une bonne amitié qui débouche sur une belle relation. Ce peut être la conscience affirmée d’une relation avec Dieu. Ici, dans ce groupe, le miracle était reconnu dans une manifestation de Dieu au quotidien. Nous avons appris à la reconnaître. C’est un sujet de joie et de reconnaissance ».
Récit et témoignage de Rodolphe Gozegba rapporté par Jean Hassenforder
Voir aussi sur ce blog : « Le miracle de l’existence. Un éclairage de Bertrand Vergely » : https://vivreetesperer.com/?p=2890
Une vie pleine, c’est une vie qui a du sens
 La vie aspire à plus qu’au bonheur
La vie aspire à plus qu’au bonheur
« There is more to life than being happy »
Selon Emily Esfahani Smith
Quelle vie voulons-nous avoir ? Qu’est-ce que nous recherchons en premier dans notre vie ? Quelle est notre représentation de la vie bonne, de la vie pleine ? Incidemment, ce questionnement transparait dans les vœux que nous faisons à nos proches et à nos amis au nouvel an ou lors d’un anniversaire. Le mot bonheur vient alors à notre esprit. Mais comment envisageons-nous le bonheur ? Sans doute, nous ne donnons pas tous la même signification à ce terme. Une jeune psychologue américaine, Emily Esfahani Smith nous appelle à réfléchir à cette question dans un entretien vidéo TED : « There is more to life than being happy » (1).
De fait, il s’agit là d’une question existentielle, une question qui implique toute notre existence. Et si Emily l’aborde aujourd’hui en psychologue, c’est parce qu’elle se l’est posée d’abord dans sa première jeunesse, dans sa vie d’étudiante. Ce questionnement a débouché sur une recherche qui s’est inscrite dans le champ de la psychologie, une psychologie elle-même en quête aujourd’hui dans ce domaine. Et, comme on le verra, ce mouvement n’est pas une particularité américaine. Il est aujourd’hui international.
Déjà, après la seconde guerre mondiale, un psychiatre, Viktor Frankl (2), en sortant de camps de concentration, avait mis en évidence l’importance vitale du sens qui donne à notre vie une capacité de résister aux épreuves et une force dans la vie. Dans une autre conjoncture, à un autre moment de l’histoire, Emily a été conduite également à se poser la question du sens, car elle s’est rendu compte que la recherche d’un bonheur superficiel, en terme de satisfaction individualiste et passagère, débouchait sur une impasse. Ainsi nous dit-elle : « Avant, je pensais que le but de la vie était la poursuite du bonheur. Tout le monde disait que le chemin du bonheur était la réussite, alors j’ai cherché ce travail idéal, ce petit ami idéal, ce bel appartement. Mais, au lieu de me sentir satisfaite, je me sentais anxieuse et à la dérive. Je n’étais pas seule. Mes amis aussi rencontraient des difficultés ». Et, en suivant des cours de psychologie positive à l’université, Emily a découvert qu’il y avait bien un malaise largement répandu dans la société. Si la poursuite du bonheur est aujourd’hui une motivation courante, elle s’avère manifestement défaillante. « Ce qui m’a vraiment frappé est ceci : Le taux de suicide est en augmentation à travers le monde et en Amérique, il a récemment atteint son point le plus haut en trente ans. Même si objectivement les conditions de vie s’améliorent… plus de gens se sentent désespérés, déprimés et seuls. Il y a un vide qui ronge les gens et il ne faut pas forcément être en dépression clinique pour le ressentir. Tôt ou tard, nous nous demandons tous : Est-ce là tout ? ».
On doit aller plus loin dans la compréhension de la vie. « De nombreux psychologues définissent le bonheur comme un état de confort et d’aisance, se sentir bien dans l’instant ». Cependant, comme l’indique en France le psychologue Jacques Lecomte, le bien–être ne suffit pas. Nous avons besoin également d’une motivation, d’une inspiration qui nous sont apportées par le sens que nous donnons à notre vie (3). Ainsi Emily a choisi d’entrer dans la voie du sens. « Notre culture est obsédée par le bonheur, mais j’ai découvert que chercher du sens est la voie la plus épanouissante. Les études montrent que les gens qui trouvent du sens à leur vie sont plus résilients, s’en sortent mieux à l’école et vivent plus longtemps ». Parce que cette question lui paraissait essentielle, Emily s’est engagée dans la recherche. Pendant cinq ans, « elle a interviewé des centaines de gens et lu des milliers de pages de psychologie, de neuroscience et de philosophie ». Elle a publié un livre : « The power of meaning crafting a life that matters » qui vient d’être traduit en français sous le titre : « Je donne du sens à ma vie. Les quatre piliers essentiels pour vivre pleinement » (4).
Les quatre piliers essentiels pour vivre pleinement.
Emily distingue quatre piliers pour vivre pleinement : l’appartenance, la raison d’être, la transcendance, la mise en récit.
« Le premier pilier est l’appartenance. L’appartenance découle du fait d’être dans des relations ou vous êtes estimé pour qui vous êtes intrinsèquement et où vous estimez également les autres ». Cependant, l’appartenance n’est pas une panacée, car tout dépend de la qualité du groupe auquel on appartient. « La vraie appartenance émane de l’amour. Elle existe dans de moments partagés entre deux personnes ». Nous savons combien les relations ont une importance vitale (5). Emily donne un exemple : Lorsque son ami Jonathan achète régulièrement son journal au même vendeur de rue à New York, il se crée là aussi une relation qui induit une reconnaissance réciproque, un climat de confiance Elle évoque un incident où cette confiance a été ébréchée. Il est important de veiller à la qualité de nos relations. « Je passe devant une personne que je connais sans la reconnaître. Je regarde mon téléphone quand quelqu’un me parle. Ces actions dévaluent les autres. Il les font se sentir invisibles et sans valeur. Quand vous avancez avec amour, vous créez un lien qui nous tire tous vers le haut ».
Pour beaucoup, l’appartenance est la source essentielle de sens dans la vie. Pour d’autres, la clé du sens est la poursuite d’un but qui donne une raison d’être. C’est le second pilier. « Trouver un but dans la vie n’est pas la même chose que de trouver un travail qui vous rend heureux ». Avoir un but dans la vie pour le bien des autres est une motivation qui engendre orientation et mobilisation de la vie. « Un agent hospitalier m’a dit que son but était de guérir les malades. Beaucoup de parents me disent que leur but est d’élever leurs enfants. La clé du but dans la vie est d’utiliser nos forces pour servir les autres . Bien sur, beaucoup d’entre nous le font à travers leur travail. C’est ainsi que nous contribuons et nous sentons utiles. Cela signifie aussi que des problèmes tels que le désengagement au travail, le chômage, un faible taux de participation à la vie professionnelle ne sont pas que des problèmes économiques, ce sont des problèmes existentiels. En n’ayant pas quelque chose de louable à faire, les gens sont perdus ».
Il y a une troisième manière d’accéder à un sens dans sa vie. C’est la transcendance. La transcendance se manifeste dans des contextes différents, par exemple dans la vie en église ou dans des communautés religieuses. Elle apparaît également dans des expériences spirituelles (6). « Les états de transcendance sont ces rares moments où vous vous élevez au dessus de l’agitation quotidienne. Votre conscience de vous même s’estompe et vous vous sentez connectés à une réalité supérieure. Pour moi, en tant qu’écrivain, cela se produit à travers l’écriture. Parfois cela m’emporte tellement que je perd tout sens de l’espace-temps. Ces expériences transcendantes peuvent nous changer. Dans une recherche, on a demandé à des étudiants de regarder un eucalyptus de 60 mètres de haut pendant une minute. Après cela, ils se sont sentis moins égocentriques et se sont comportés plus généreusement quand ils avaient l’opportunité d’aider quelqu’un ».
A l’appartenance, la raison d’être à travers la poursuite d’un but, la transcendance, Emily ajoute « un quatrième pilier du sens ». C’est « la narration, l’histoire que vous racontez à votre propos. Créer un récit à partir des évènements de votre vie apporte de la clarté. Cela aide à comprendre comment vous êtes devenus vous-même. Nous ne réalisons pas toujours que nous sommes l’auteur et que nous pouvons changer notre façon de raconter. Notre vie n’est pas uniquement une liste d’évènements. Vous pouvez éditer, interpréter et raconter votre histoire, même en étant contraint par les faits ».
En exemple, Emily nous raconte le parcours d’Emeka, un jeune homme paralysé après avoir joué au football. Il a su adopter une attitude positive et l’affirmer dans son histoire de vie. « Le psychologue Dan Mc Adams appelle cela « une histoire rédemptrice » où le mauvais est racheté par le bon. Les gens ayant une vie pleine de sens racontent l’histoire de leur vie à travers la rédemption, la croissance et l’amour ».
Emily accorde ainsi une grande importance au récit personnel au point de l’inclure parmi les quatre grands piliers sur lesquels repose une vie qui a du sens. L’histoire de vie est effectivement une voie privilégiée pour découvrir, exprimer et affirmer le sens de notre existence. C’est aussi ce qu’exprime le témoignage dans le contexte de milieux chrétiens.
Le parcours d’Emily : une expérience de vie et une vision
Emily a grandi dans une famille qui s’inscrivait dans une culture spirituelle de l’Islam : la culture soufi. Elle a pu vivre des valeurs fortes qui sont effectivement porteuses de sens : une solidarité, une expérience spirituelle partagée et chaleureuse. « Quand je suis partie à l’université et sans l’encrage soufi quotidien dans ma vie, je me sentais larguée. J’ai commencé à chercher ces choses qui font que la vie en vaut la peine. C’est ce qui m’a conduite à ce voyage. En y repensant, je me rend compte que la maison soufie avait une vraie culture du sens de la vie. Les piliers faisaient partie de l’architecture et la présence des piliers nous aidait à vivre plus profondément ». Et d’ailleurs, en terminant cet entretien, Emily raconte comment son père, en passe de subir une grave opération, a été soutenu par la pensée d’amour qu’il portait à ses enfants. « Mon père est menuisier et soufi. C’est une vie humble, mais une bonne vie. Son sens d’appartenance à une famille, son but en tant que père, sa méditation transcendante, la répétition de nos noms, il dit que ce sont les raisons pour lesquelles il a survécu . C’est l’histoire qu’il raconte. C’est le pouvoir du sens dans la vie. Le bonheur va et vient. Mais quand la vie est vraiment belle, si les choses tournent très mal, avoir un sens à sa vie vous donne une chose à laquelle vous pouvez vous accrocher ».
Un éclairage pour nos vies
L’approche d’Emily Esfahani Smith sur la manière de donner du sens à notre vie nous parait particulièrement utile et précieuse. En effet, c’est à partir de son expérience personnelle en lien avec celle d’une jeune génération qu’Emily s’est engagée dans une recherche de long cours pour répondre aux questions existentielles qui prennent aujourd’hui une importance croissante. Et elle apporte des réponses qui prennent en compte la diversité des situations et des parcours.
Nous savons par expérience combien la question du sens a une importance vitale. C’est bien à cette question qu’Odile Hassenforder, très présente sur ce blog, a répondu dans son livre : « Sa présence dans ma vie » (7) à travers une expérience du don de Dieu et un vécu de fraternité et de spiritualité chrétienne. Et, sur ce blog, notre intention est bien d’ouvrir des pistes et réaliser des outils de compréhension pour des chercheurs de sens en faisant appel à des récits, des réflexions et des recherches. C’est notre motivation. Ainsi nous nous trouvons en affinité avec la démarche d’Emily.
Son livre : « Je donne du sens à ma vie » (4) prolonge son entretien en vidéo dans un texte abondamment documenté. Nous pouvons reprendre ici sa conclusion. Elle y reprend une affirmation de Viktor Frankl (2): « l’amour est le plus grand bien auquel l’homme peut aspirer. L’être humain trouve son salut à travers et dans l’amour ». Et elle poursuit : « L’amour est bien évidemment au cœur d’une vie pleine de sens. C’est un ingrédient indissociable des quatre piliers du sens qui apparaît de façon récurrente dans les histoires de personnes que j’ai relatées »… « L’acte d’amour commence par la définition même du sens. Il commence par le fait de sortir de sa coquille pour se connecter aux autres et contribuer à quelque chose ou à quelqu’un plutôt qu’à soi. « Plus quelqu’un s’oublie lui-même et se dévoue à une cause ou à quelqu’un d’autre, plus il est humain », écrit Viktor Frankl. C’est le pouvoir du sens… C’est prendre le temps de s’arrêter pour saluer le marchand de journaux ou pour réconforter un collègue qui parait déprimé. C’est aider les gens à être en meilleure santé, à être un bon parent ou un bon tuteur pour un enfant. C’est contempler avec émerveillement le ciel étoilé et assister aux complies avec des amis. C’est écouter attentivement l’histoire d’un proche. C’est prendre soin d’une plante. Ce sont des actes humbles en soi. Mais ensemble, ils illuminent le monde » (p 276-278).
J H
- « There is more to life than being happy ». Emily Esfahani Smith at Ted 2017. Vidéo avec transcription en français de Morgane Quilfen Nous avons repris des extraits de cette traduction. https://www.ted.com/talks/emily_esfahani_smith_there_s_more_to_life_than_being_happy/transcript
- Vie et œuvre de Viktor Frankl sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl On pourra lire son livre : « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie » : https://www.amazon.fr/Viktor-Frankl-Livres/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A301061%2Ck%3AViktor%20Frankl
- Jacques Lecomte est un pionnier de la psychologie positive en France. Nous renvoyons ici à une de ses vidéos consacrée à une réflexion sur le bonheur : https://www.youtube.com/watch?v=vHrmghCgYoA Par ailleurs, nous avons présenté plusieurs livres de Jacques Lecomte sur ce blog, et notamment son livre sur la bonté humaine : https://vivreetesperer.com/?p=674
- Emily Esfahani Smith. Je donne du sens à ma vie. Les quatre piliers essentiels pour vivre pleinement (Trad. Danièle Lafarge). Editions Leduc, 2017
- « Une belle vie se construit avec de belles relations. Un message de Robert Waldinger, directeur de la « Harvard study of adult development » : https://vivreetesperer.com/?p=2491
- « Expériences de plénitude » : https://vivreetesperer.com/?p=231
- Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Parcours spirituel. Empreinte Temps présent, 2011 On trouvera sur ce blog de nombreux articles inspirés par ce livre. Une présentation : https://vivreetesperer.com/?p=2345
Une nouvelle manière de croire
 Selon Diana Butler Bass dans son livre : « Grounded »
Selon Diana Butler Bass dans son livre : « Grounded »
Beaucoup de gens s’éloignent des églises classiques et entrent en recherche. Est-ce à dire qu’on croit de moins en moins ou bien la foi change-t-elle de forme ? On peut observer ce mouvement dans la plupart des pays occidentaux. Et les Etats-Unis, longtemps caractérisés par une forte pratique religieuse, commencent à participer à cette évolution. C’est une question qui nous intéresse tous à titre collectif, mais aussi à titre personnel. Diana Butler Bass, historienne et théologienne américaine, nous apporte une réponse dans son livre : « Grounded. God in the world. A spiritual revolution » (1). Dans un précédent article, nous avons présenté cet ouvrage en terme de convergence entre la pensée de Diana Butler Bass et celle de Jürgen Moltmann, un grand théologien innovant (2). Nous envisageons ici plus particulièrement comment Diana Butler Bass perçoit un changement dans la manière de croire. Mais rappelons d’abord la démarche de cet ouvrage (3).
« Chaque année, davantage d’américains laissent derrière eux la religion organisée : les gens se désaffilient et comme la nation devient de plus en plus diverse religieusement (4). Diana Butler Bass, éminente commentatrice dans le champ de la religion et de la culture, poursuit son livre fort apprécié : « Christianity after religion » (5) en argumentant que ce qui apparaît comme un déclin indique en réalité une transformation majeure dans la manière où les gens se représentent Dieu et en font l’expérience. Du Dieu distant de la religion conventionnelle, on passe à un sens plus intime du sacré qui emplit le monde. Ce mouvement, d’un Dieu vertical à un Dieu qui s’inscrit dans la nature et dans la communauté humaine, est au cœur de la révolution spirituelle qui nous environne, et cela interpelle non seulement les institutions religieuses, mais aussi les institutions politiques et sociales. « Grounded » explore ce nouvel environnement culturel comme Diana Butler Bass nous révèle ici la manière dont les gens trouvent un nouvel environnement spirituel (« new spiritual ground ») dans un Dieu qui réside avec nous dans le monde : dans le sol, l’eau, le ciel, dans nos maisons et nos voisinages et dans nos espaces communs. Les gens se connectent avec Dieu dans l’environnement dans lequel nous vivons ». Avec Diana, entrons dans son livre à travers son introduction. « Ce dont nous avons besoin est là », nous propose-t-elle à travers une citation de Wendell Berry (p 1).
Où est Dieu ?
« Où est Dieu ? » est une des questions les plus importantes de tous les temps. Les gens croient, mais ils croient différemment de la manière dont ils ont cru. Le sol de la théologie est en mouvement. Une révolution spirituelle est en route ».
Diana Butler Bass évoque un univers religieux qui lui paraît appartenir au passé. « Il n’y a pas longtemps, les croyants affirmaient que Dieu résidait au Ciel, un endroit lointain où les fidèles trouveraient une récompense éternelle. Nous occupions un univers à trois étages avec au dessus le Ciel où Dieu vivait, le monde au dessous où nous vivions, et un monde des bas-fonds (« underworld ») où nous redoutions de pouvoir aller après la mort. L’Eglise intervenait comme médiatrice entre le ciel et la terre, agissant comme une espèce d’ascenseur céleste où Dieu envoyait des directives divines, et, si nous obéissions à ses directives, nous pouvions monter éventuellement vivre au Ciel pour toujours et éviter les terreurs d’en bas » (p 4). Cet ordre à trois étages a vacillé au siècle dernier. Et puis, il est apparu de plus en plus évident que nous ne pouvions plus revivre cette représentation de Dieu dans une société qui n’existait plus. « Le théisme conventionnel est au cœur du fondamentalisme et correspond à cet univers à trois étages » ( p 6).
Mais nous savons aujourd’hui que l’enfer existe sur terre. Et pourquoi pas le paradis ? Diana Butler Bass évoque une fusillade tragique dans une école américaine. Cet épisode tragique a suscité beaucoup de questions existentielles. « La réponse la plus répétée et apparemment la plus réconfortante était que Dieu était « avec les victimes ». Dieu « avec » les victimes ? « Avec nous ? ».
Aujourd’hui, nous vivons une époque tragique d’anxiété et de peur. Où est Dieu ? L’image ancienne de Dieu ne répond plus à nos questions. On observe une montée de l’incroyance. « Pourtant, tandis que certains ont conclu que les hommes sont seuls, d’autres regardent aux mêmes évènements et suggèrent une possibilité spirituelle bien différente : « Dieu est avec nous ». En regard de tous ces malheurs, Diana Butler Bass évoque la réponse de Bonhoeffer : « Seul un Dieu souffrant peut aider ». « Dieu est avec nous, dans et à travers ces terribles évènements » ( p 8). Un chercheur juif : Abraham Heschel voyait en Dieu : « Celui qui aime le monde profondément, ressent ce que vit sa création et participe à sa vie ». « Cela signifie naturellement que Dieu est avec nous non seulement dans les temps de misère et d’angoisse. Dieu est avec nous au milieu de notre joie et dans les expériences les plus séculières de la vie… Depuis les années où Heschel écrivait, un langage culturel de la proximité divine est venu nous entourer : on peut trouver Dieu au bord de la mer, dans un coucher de soleil, dans le jardin que nous plantons, dans les histoires qui nous réjouissent, dans la bonne nourriture, dans la convivialité… » (p 9). Ainsi, « si certains adorent Dieu dans une distante majesté et si d’autres rejettent l’existence divine, des millions de nos contemporains font l’expérience de Dieu d’une manière beaucoup plus personnelle et accessible que jamais auparavant » (p 9). Et ce changement intervient dans le monde entier, sur toute la planète. « Dieu est accessible sans médiation, local, animant le monde naturel et l’activité humaine dans des modes profondément intimes. De fait, cela a toujours été la voie des mystiques. Mais maintenant, ce mode personnel, mystique, immédiat et intime émerge comme une voie majeure pour notre relation avec le divin » (p 9).
Ce changement profond dans la manière de concevoir la relation avec Dieu interpelle les églises et les religions. « Les institutions religieuses servaient de structures médiatrices entre ce qui était saint et ce qui était séculier. Les questions recherchant des information sur le « qui ? » et le « quoi ? » avec demande d’une réponse d’autorité, sont remplacées par des questions relatives à des questions existentielles et ouvertes relatives au « où ? » et au « comment ? ». Non seulement les questions ont changé, mais la manière dont nous les posons a changé. Nous ne vivons plus isolés par des barrières d’ethnicité, de race et de religion. Nous sommes connectés dans une communauté globale.
Nous cherchons des réponses dans internet. Nous posons des questions à nos voisins bouddhistes ou hindous. Nous ouvrons nos textes saints et les textes des autres. Nous écoutons les prédicateurs des religions du monde… Ce mouvement dans la conscience religieuse est un phénomène mondial, une sorte de toile spirituelle dans laquelle nous nous inscrivons… » ( p 10). Quelque soient les résistances des incroyants, ce changement est un réenchantement du monde, une révolution spirituelle d’une étonnante ampleur. Et ce changement est en cours aujourd’hui dans de nombreuses cultures.
Dieu avec (dans) le monde
Comme beaucoup d’autres, raconte Diana, j’ai été formée dans une théologie verticale : « Dieu existe loin du monde et fait une faveur à l’humanité en s’en rapprochant. Les prédications déclaraient que la sainteté de Dieu nous était étrangère et que le péché nous séparait de Dieu » (p 12). Cependant, Diana a vécu des expériences qui impliquaient une vision différente. Ainsi, raconte-t-elle une expérience vécue dans sa toute petite enfance. Et elle nous rapporte d’autres expériences très diverses. Plus jeune, elle n’osait pas en parler dans son église, mais maintenant, elle sait que ce ne sont pas des expériences rares ou extraordinaires. Il y a aujourd’hui toute une littérature relative à l’expérience spirituelle depuis les comptes rendus d’expériences proches de la mort jusqu’à de profondes rencontres en rapport avec la nature, le service aux autres ou une émotion artistique. « La moitié des américains adultes, dont même quelques uns qui se déclarent athées ou non croyants, rapportent avoir eu une telle expérience au moins une fois dans leur vie » ( p 13).
« Nous voilà conduits vers une théologie alternative mettant l’accent sur la connexion et sur l’intimité. Dans la tradition chrétienne, Jésus parle ce langage quand il proclame : « Le Père et moi, nous sommes un » (Jean 16.30) et quand il souffle sur les disciples en leur envoyant le Saint Esprit ( Jean 20.22). C’est le témoignage de l’apôtre Paul au sujet de sa rencontre mystique avec Christ. Quand la Bible est lue dans la perspective de la proximité divine, il devient clair que la plupart des prophètes, des poètes et des prédicateurs sont particulièrement en porte à faux (« worried ») avec les institutions et les pratiques religieuses qui perpétuent le fossé entre Dieu et l’humanité. La narration biblique est celle d’un Dieu qui s’approche, poussé par un désir pressant d’amener le ciel sur la terre et de remplir les cœurs humains » (p 13). Cette expérience d’intimité spirituelle apparait également dans d’autres religions. Aujourd’hui, les institutions et les philosophies de haut en bas s’affaiblissent et cela concerne également les religions. « Les gens mènent leur propre révolution théologique et découvrent que l’Esprit est bien plus avec le monde que l’on nous l’avait précédemment enseigné » ( p 15). « Il y a une conscience de plus en plus répandue que Dieu est avec nous au sein de la création, de la culture et du cosmos… Ce changement de ton apparaît dans les prédications de personnalités bien connues comme Desmond Tutu, le Dalaï Lama et le pape François.. ».
Diana Butler Bass est historienne. On peut donc l’entendre lorsqu’elle écrit : « Le fait le plus significatif dans l’histoire des religions aujourd’hui n’est pas le déclin de la religion occidentale, le rejet des institutions religieuses ou ma montée de l’extrémisme religieux, c’est un changement dans la représentation de Dieu, une renaissance de la foi montant des profondeurs » (p 16).
Une révolution spirituelle
« Le Dieu conventionnel existait en dehors de l’espace et du temps, un être qui vivait aux cieux sans être affecté par les limites humaines. Ainsi la théologie occidentale a développé un langage que les théologiens appellent les « omnis » : Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, tout puissant… Mais aujourd’hui, Dieu est de plus en plus perçu comme un Dieu en relation avec l’espace et le temps, comme un Dieu qui connecte et crée toute chose… les « omnis » ne parviennent pas à décrire cela. A la place, nous pouvons penser à Dieu en terme d’ « inter », le fil spirituel entre l’espace et le temps, « intra « à l’intérieur de l’espace et du temps et « infra » qui tient l’espace et le temps. Dieu n’est pas au dessus et au delà, mais intégralement dans l’ensemble de sa création, entrelacé avec l’écologie sacrée de l’univers » ( p 25).
La révolution spirituelle concerne à la fois Dieu et le monde. Elle concerne Dieu, mais elle ne l’aborde pas comme un extra-terrestre. Elle concerne le monde, mais elle n’engendre pas la sécularisation. C’est une révolution au milieu du terrain (« middle ground revolution ») dans laquelle des millions de gens naviguent dans un espace entre le théisme conventionnel et un monde sécularisé. Ils tracent un chemin qui enveloppe le séculier et le sacré en trouvant un Dieu qui est « un mystère gracieux toujours plus grand, toujours plus près, à travers une conscience nouvelle de la terre et dans la vie de leurs prochains » (p 25-26). Cette révolution repose sur une vision. « Dieu est le sol sur lequel nous nous fondons et qui nous fonde (« God is the ground, the grounding which ground us »). Nous en faisons l’expérience lorsque nous comprenons que le sol est sacré, que l’eau donne la vie, que le ciel ouvre l’imagination, que nos racines importent, que notre foyer est un lieu divin et que nos vies sont liées à celles de nos voisins et avec celles de tous le humains autour du monde » ( p 26).
Ainsi, c’est à un changement de regard que nous invite Diane Butler Bass et que tout son livre illustre par la suite. « Grounded guide les lecteurs à travers notre habitat spirituel contemporain en portant attention aux manières selon lesquelles les gens font l’expérience d’un Dieu qui anime la création et la communauté ».
Elle nous présente également une analyse des changements en cours dans les pratiques religieuses et spirituelles. Sa description de l’univers traditionnel est percutante. On pourrait dire cependant qu’au XXè siècle, des formes nouvelles faisant place à l’expérience étaient déjà apparues. Elle ne s’attarde pas au déclin des églises classiques ou au progrès de l’agnosticisme, mais elle en recherche les causes et elle met en évidence la montée d’un spiritualité nouvelle. En d’autres lieux et selon d’autres problématiques, certains pourront contester l’amplitude et la durée de ce changement. Mais l’analyse de Diana Butler Bass s’appuie sur une culture historique et sur une collecte d’informations bien au delà des Etats-Unis. Et sur le plan théologique, sa vision d’un Dieu proche dont on peut reconnaître la présence, peut trouver appui dans l’œuvre de théologiens auprès desquels nous cherchons un éclairage, Richard Rohr (6) et tout particulièrement Jürgen Moltmann (7).
J H
- Diana Butler Bass. Grounded. Finding God in the world. A spiritual revolution. Harper Collins, 2015
- Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient. Deux approches convergentes : Jürgen Moltmann et Diana Butler Bass. https://vivreetesperer.com/?p=2267
- Présentation du livre par l’éditeur
- The religious typology. A new way to categorize Americans by religion. Pew Research center 29 august 2018. http://www.pewforum.org/2018/08/29/the-religious-typology/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=d7b55ed6af-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_30_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-d7b55ed6af-400564905
- Christianity after religion : mise en perspective sur le site de Témoins : http://www.temoins.com/la-montee-dune-nouvelle-conscience-spirituelle-dapres-le-livre-de-diana-butler-bass-l-christianity-after-religion-r/
- La danse divine (The divine dance) par Richard Rohr : https://vivreetesperer.com/?p=2758 Extraits du livre de Richard Rohr. La danse divine : https://vivreetesperer.com/?p=2807
- Le Dieu vivant et la plénitude de vie (The living God and the fullness of life) : https://vivreetesperer.com/?p=2697 Extraits du livre : the living God and the fullness of life : https://vivreetesperer.com/?p=2413 Un Esprit sans frontières ( L’Esprit qui donne la vie) : https://vivreetesperer.com/?p=2751
Voir aussi :
Dieu vivant : rencontrer une présence. Selon Bertrand Vergely : prier, une philosophie : https://vivreetesperer.com/?p=2767
Dynamique culturelle dans un monde globalisé. (Raphaël Liogier. La guerre des civilisations n’aura pas lieu) : https://vivreetesperer.com/?p=2296
La guérison du monde, selon Frédéric Lenoir : https://vivreetesperer.com/?p=1048
Le miracle de l’existence
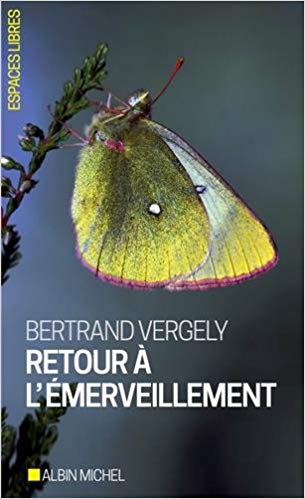 Un éclairage de Bertrand Vergely
Un éclairage de Bertrand Vergely
Se peut-il que nous soyons entrainé par la routine des affaires courantes, l’emprise exercée par le flot des évènements au point d’oublier ce qui nous fonde : notre propre expérience ? Se peut-il que dans le tourbillon du quotidien nous n’y prêtions pas attention, nous ne percevions pas le flux de la vie qui nous est donnée sans compter, et, dans le même mouvement, notre participation au monde des vivants ?
Lorsque cette conscience d’exister survient, elle peut être décrite comme une expérience fondatrice. C’est donc un dévoilement de sens, c’est une joie libératrice. Ce peut être une expérience bouleversante.
Dans son livre : « Sa présence dans ma vie », Odile Hassenforder nous raconte comment, face à l’adversité, elle a vécu cette expérience.
« Au fond de mon lit, en pleine aplasie due à une chimio trop forte, j’ai reçu la joie de l’existence. Un cadeau gratuit donné à tout humain par Dieu… ». « Epuisée, au fond de mon lit, incapable de toute activité… là, inutile, je soupire : « qui suis-je ? ». Là, d’une seconde à l’autre, je réalise cette chose extraordinaire : « j’existe ». C’est gratuit. Cela m’est donné gratuitement. Je suis partie intégrante de la création : une étoile dans le firmament, une pâquerette dans la prairie, peu importe. Etoile ou pâquerette, j’existe ». « Une joie immense m’envahit au plus profond de moi-même comme une louange à notre Dieu. Il est grand, il est beau. Il est bon… » (1).
Le miracle d’exister
Ainsi, cette expérience traduit un émerveillement. Bertrand Vergely, philosophe et théologien orthodoxe (2), a écrit un livre ; « Retour à l’émerveillement » (3). Et, dans ce livre, il magnifie la conscience de l’existence. Tout se tient. La conscience de notre existence est associée à la conscience de celle des êtres et des choses.
« Les êtres, les choses ne sont pas des abstractions. Ils existent en chair et en os. Ils sont palpables, tangibles, et ils sont là parce qu’ils sont porteurs du fait inouï de l’existence. Ils auraient pu ne pas être, mais ils sont et leur existence s’exprime par leur réalité concrète, tangible, charnelle. L’existence parle de transcendance et la transcendance parle du miracle d’exister. Tout existe parce que tout est miraculeux. Ayant conscience du miracle de l’existence, on a conscience de l’existence. On existe. On fait exister les autres et le monde autour de soi » ( p 44-45).
Nous émerveiller de l’existence des autres. Un appel au respect et à la considération
Cette conscience du miracle de l’existence n’induit pas seulement une transformation et une libération personnelle. Elle fonde une harmonie sociale. « Il aurait pu ne rien y avoir. Il y a quelque chose et non rien. Miracle. Les autres qui existent, les animaux, les plantes, l’univers nous parlent de ce miracle. Ils nous parlent de notre miracle. Nous sommes aussi miraculeux qu’eux. Prenons en conscience. Nous rentrons dans la considération des autres et de l’univers. Nous devenons attentifs, respectueux. Parfois, nous avons envie d’aimer l’humanité « ( p 43).
Ce respect, cette attention fonde la vie morale. « On est moral lorsqu’on est saisi dans le tréfonds de soi-même par un sentiment d’infini respect pour l’existence, pour les hommes, pour la vie… La morale nous met directement en relation avec le principe transcendant et miraculeux de l’existence, ce principe s’exprimant dans tout ce qu’elle peut avoir de charnel. C’est ce que dit fort bien Simone Weil : « Il est donné à peu d’êtres de découvrir que les êtres et les choses existent ». Elle parle de la conscience morale et explique que celle-ci passe par une expérience charnelle » (p 44).
L’existence fonde la pensée.
Bertrand Vergely met également en évidence un lien entre la conscience d’exister et la pensée.
Ainsi, évoque-t-il Pascal, le philosophe. « Il a compris ce qu’est la pensée. Celle-ci est une affaire de conscience et non de raisonnement. On pense quand on a conscience du miracle de l’univers. Nous ne sommes rien dans l’univers ou quasiment rien. Nous devrions ne pas exister, un rien suffit pour nous anéantir. Or nous existons. Il y a là un miracle. Quelque chose qui vient d’ailleurs, d’au delà de nous, nous permet d’exister . On s’en rend compte en faisant justement l’expérience d’exister (p 46).
Nous ne sommes pas englouti par le vide abyssal. « Face au vide, il y a le fait d’exister malgré un tel vide, fait quelque part plus immense encore que l’immense… Plus vaste que l’infini spatial, il y a l’infini d’existence. Il faut qu’il y ait de l’existence pour qu’il y ait de l’espace… En ayant conscience d’exister, nous comprenons tout, même l’espace. Nous prenons alors la bonne mesure des choses… Le réel n’est pas une chose et encore moins un vide, c’est une existence et, mieux encore, un infini d’existence auquel seule la conscience a accès.. On pense quand on parvient à un tel niveau… On dévoile la profondeur du réel ainsi que des êtres humains. On se met à avoir une relation juste à ceux-ci » ( p 47).
La pensée juste est celle de l’homme vivant
La pensée peut-elle s’exercer positivement en dehors des contingences de l’existence ? Y a-t-il une raison pure ? Le philosophe Kant répond à cette question dans « la critique de la raison pure ». Il comprend qu’il faut replacer la pensée dans le cadre de l’homme vivant. En finir avec ces pensées qui prétendent tout penser une fois pour toutes. Cesser donc de faire, par exemple, de Dieu une pensée qui prétend tout penser afin de faire de lui une pensée vivante qui fait progresser. Remplacer le Dieu de l’idéologie par le Dieu qui fait avancer et vivre » (p 53).
Bertrand Vergely met en scène les dérives du dogmatisme et du scepticisme qui se répondent et s’engendrent mutuellement dans le champ de la religion et de la philosophie. A l’opposé de ces discours systématiques, il y a une pensée en phase avec l’existence.
« Quand la pensée vit, quand elle est la pensée d’un homme existentiel, elle est au cœur d’un croisement entre le ciel et la terre, elle est la rencontre entre l’esprit et la réalité concrète, incarnée. Ici, pas besoin de dogmatisme pour affirmer l’esprit, ni de scepticisme pour corriger le dogmatisme afin de revenir dans la réalité… L’esprit rend témoignage de la réalité concrète comme la réalité concrète rend témoignage de l’esprit. Rien ne s’oppose, tout se croise » (p 52).
Une pensée féconde et équilibrée s’enracine dans l’existence. « Kant a vu, comme Pascal, que la pensée est en proie à un conflit entre dogmatisme et scepticisme. Ce conflit vient de ce que la pensée est vécue de façon passionnelle. Cette approche passionnelle vient de ce que l’on ne la vit pas. On n’a pas de relation avec celle-ci. On ne la vit pas…Qui est vivant noue des relations au monde en confrontant sans cesse ce qu’il pense et ce qu’il vit, ce qu’il vit et ce qu’il pense. Quand tel est le cas, fini les illusions de la raison pure. Fini donc le scepticisme pour corriger une telle façon de penser » (p 52).
Il y a des expériences où la prise de conscience d’exister transforme notre regard sur la vie. Nous avons rapporté l’expérience d’Odile. Comme l’écrit Bertrand Vergely, prendre conscience de son existence, c’est aussi prendre conscience de celle des autres et, au delà, d’un rapport avec la nature et avec Dieu. C’est ce que David Hay, dans son livre majeur : « Something there » met également en évidence en définissant la spiritualité comme « une conscience relationnelle » (4). Et la recherche montre que les expériences spirituelles témoignent d’une activation du sens relationnel, d’une manifestation de la transcendance et d’un profond et immense émerveillement (4).
Dans son livre, Bertrand Vergely nous entraine dans l’émerveillement. Comme dans ces quelques pages concernant le miracle de l’existence, il nous apprend à en voir toutes les dimensions. Il dévoile le miraculeux qu’on peut entrevoir dans le quotidien. C’est le mot d’Einstein : « Il y a deux façons de voir la vie. L’une, comme si rien n’était un miracle. L’autre comme si tout était miraculeux » .
Si la conscience d’exister est source d’émerveillement et ouvre notre regard, l’existence de l’homme est, elle aussi, extraordinaire. « L’homme a des sources extraordinaires. Sophocle, dans Antigone, n’hésite pas à le dire : « Entre tant de merveilles au monde, la grande merveille, c’est l’homme ». L’homme n’est pas rien. Il vient de loin. Il est appelé à aller loin. Il est porteur de grandes choses » (p 51).
J H
- Sur ce blog : « La grâce d’exister » : https://vivreetesperer.com/?p=50 Voir aussi : « Odile Hassenforder : Sa présence dans ma vie » : un témoignage vivant » : https://vivreetesperer.com/?p=2345
- Bertrand Vergely, philosophe et théologien orthodoxe, est l’auteur de nombreux ouvrages : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Vergely Sur ce blog, nous avons présenté un de ses livres : Prier, une philosophie. Carnetsnord, 2017 : « Dieu vivant : rencontrer une présence » : https://vivreetesperer.com/?p=2767
- Bertrand Vergely. Retour à l’émerveillement. Albin Michel, 2010 (format de poche, 2017). Ce livre nous ouvre à un autre regard sur le monde. La quatrième partie est consacrée à « un éloge du miracle ». Une courte présentation sur ce blog : https://vivreetesperer.com/?p=17
- « La vie spirituelle comme « une conscience relationnelle ». Une recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui » : http://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/ Sur ce blog, voir aussi : « Expériences de plénitude » : http://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/
Partager les solutions. Propager les innovations. C’est changer le monde
Entretien entre Christian de Boisredon et Pierre Chevelle
Comme l’écrit Jürgen Moltmann, un théologien de l’espérance, « Pour agir, nous avons besoin de croire que notre action peut s’exercer avec profit. Nous devenons actifs pour autant que nous puisions entrevoir des possibilités futures. Nous entreprenons ce que nous pensons être possible » (1). Ainsi, nous pouvons nous demander quelles sont les incidences de l’information qui nous parvient constamment à travers les médias. Si l’accent est mis sur les mauvaises nouvelles, jugées plus spectaculaires, si le ton se fait constamment critique, il en résulte un pessimisme qui entraine le repli et la démobilisation . Si, au contraire, à travers l’analyse des évènements, l’énoncé des problèmes et des menaces s’accompagne d’une recherche de voies nouvelles et de la mise en évidence des initiatives et des innovations déjà en cours pour faire face, alors une mobilisation pourra s’opérer. C’est tout le mérite du journalisme des solutions de contribuer à cet état d’esprit. Ne pas délivrer l’information, comme si elle nous conduisait fatalement dans une impasse, mais rechercher les issues et mettre en évidence les solutions à travers les multiples initiatives, innovations et découvertes déjà en route. Aujourd’hui, il y a bien un courant d’action qui œuvre pour nous apporter une information à partir de laquelle nous puissions construire.
Christian de Boisredon fait partie des innovateurs qui ont introduit en France ce nouvel état d’esprit comme en témoignent ces quelques jalons dans son parcours (2). En 1998, à l’âge de 24 ans, avec deux amis, Christian entreprend un tour du monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie à la rencontre des gens « qui font avancer le monde ». A la suite de cette aventure, il écrit un livre : « L’espérance autour du monde » (3) qui devient un best-seller et est traduit en plusieurs langues. « Ce projet a été le premier tour du monde de ce type et il a lancé la vogue des tours du monde engagés dans cet esprit ». Christian de Boisredon initie et fonde ensuite l’association : « Reporters d’espoir » qu’il préside et dirige jusqu’en 2007. En 2011, Christian fonde « Sparknews », une entreprise sociale qui a pour mission de partager les projets qui proposent des solutions innovantes aux problèmes de société. Sparknews travaille à l’échelle internationale en collaboration avec les grands journaux de référence des quatre continents. (4)
L’exemple de Christian est un exemple pour une jeune génération qui s’engage dans le même sens. Ainsi, Pierre Chevelle (5), diplômé de l’Ecole de commerce ESCP Europe, se consacre aujourd’hui à la promotion de l’innovation sociale et solidaire. Intervenant sur You Tube, conférencier, il est aussi l’auteur d’un livre : « Changer le monde en deux heures ». Une interview de Christian de Boisredon par Pierre Chevelle est donc particulièrement éclairante (6). C’est une conversation entre deux innovateurs autour de l’information comme vecteur de changement.
Sparknews (6)
Pierre Chevelle nous dit comment il a découvert l’entreprenariat social en travaillant à Sparknews, agence d’information fondée par Christian de Boisredon.
Mais quelles sont au juste les objectifs de Sparknews ? Christian répond en ce sens : « L’idée, c’est de repérer les plus beaux projets qui existent dans le monde entier, les faire connaître notamment avec les médias, les connecter avec les entreprises pour qu’ils travaillent ensemble et qu’ensemble nous changions le monde ». Pierre demande à Christian d’expliquer en quoi consistent les opérations que Sparknews réalise avec certains journaux. « On a convaincu 60 journaux dans le Monde, parmi les plus grands : Times, Die Welt, El Pais, Figaro. On leur a proposé d’écrire deux articles sur les plus beaux projets innovants qu’il y avait dans leur pays. Ensuite, on a tout mis en commun. Le même jour, ils ont publié des articles en provenance de tout le monde. Au total, le lectorat de ces tous ces médias, ce sont 120 millions de lecteurs.
Quand les journaux ne parlent que des problèmes, les gens se disent : je suis au courant. Mais qu’est-ce que je peux faire avec cela ? et donc, c’est totalement déprimant. Notre idée, ce n’est pas d’annoncer de bonnes nouvelles. En regard des problèmes, c’est de parler aussi des solutions ».
Faire connaître les initiatives à impact positif
Pierre : « Peux-tu nous donner des exemples d’initiatives concrètes que vous avez relayées dans les médias ? ».
Christian : « Par exemple, c’est une entreprise au Maroc : « Go Energyless », une entreprise sociale. Ils ont fabriqué une sorte de réfrigérateur pour les endroits où il n’y a pas d’électricité, un système de double pot où on met du sable entre les deux pots avec de l’eau, et, de fait, l’évaporation de l’eau fait refroidir la température à l’intérieur des pots. Ce qui permet de conserver beaucoup plus longtemps fruits et légumes, mais aussi l’insuline pour les diabétiques dans les endroits où il n’y a pas d’électricité, donc pas de frigidaires. Ce projet a été médiatisé dans tous les journaux lors de « l’impact journalism day » et ces entrepreneurs ont été contactés par quatre ou cinq pays. Ils sont en train de travailler ensemble pour répliquer le projet. L’impact des médias est vraiment colossal. Il peut être parfois négatif, mais il peut être aussi très positif. Il y a des informations qui peuvent changer notre vie. Ce peut être un petit article ou bien une page de livre de Pierre (« Changer le monde en deux heures »)
Christian rapporte d’autres exemples : « Quand j’avais quatorze ans, mon frère, avec un de ses amis, était au Chili . La semaine, il travaillait dans une banque, et, le week-end, il faisait du bénévolat. Il se demandait : « Qu’est-ce qu’on peut faire vraiment pour aider les gens dans les bidonvilles ? » C’était dans les années 80. Un jour, il tombe sur un article qui parle de Mohammed Yunus au Bangladesh qui avait inventé la première banque de microcrédit. Là bas, à l’époque, personne ne connaissait. C’était un des tous premiers articles. Ils se disent : « C’est génial. Une banque pour les pauvres. Si cela a marché là bas, il n’y a pas de raison que cela ne marche pas au Chili. Et donc, ils ont créé la première banque de microcrédit au Chili et, trente ans plus tard, cette banque a permis la création de près de 30000 micro entreprises. Cent mille personnes ont ainsi changer de vie. Un jour, je me suis dit : Ce qui est fou, c’est que si un journaliste n’avait pas écrit l’article que mon frère et son copain ont lu, la vie de 100000 personnes n’aurait pas été changée.
Voici un autre exemple. Tristan Lecomte est celui qui a créé Alter eco. qui a vraiment démocratisé le commerce équitable en France, qui l’a introduit dans les grandes surfaces chez Monoprix. Tristan me racontait qu’auparavant il travaillait dans le marketing. Voilà. C’était passionnant. Mais cela ne lui suffisait pas. Et puis, un jour, sa sœur lui avait découpé un article qui parlait du commerce équitable à une époque où personne ne connaissait vraiment. Cet article, il ne l’avait vraiment pas lu. Il l’avait mis dans un coin, et puis, un an plus tard, en rangeant ses affaires, il est tombé dessus. Et il s’est dit : c’est cela que je veux faire et c’est comme cela qu’il a eu autant d’impact.
Avec nos opérations, on touche 120 millions de personnes, mais en plus, on donne envie aux médias de continuer, de parler plus souvent de ces sujets. Par exemple, le rédacteur du Tages Anzeiger, qui est le plus grand journal suisse, nous a dit : On a rarement un impact de retours aussi positifs des lecteurs, et, du coup, la rédaction s’est dit : Comment peut-on parler plus souvent de ces sujets ? Ils ont commencé par faire une chronique hebdo sur les solutions ».
Pierre : « J’avais parlé de vous dans mon premier livre : « Changer le monde en deux heures ». Comment les gens qui regardent cette vidéo peuvent-ils vous aider ? ».
Christian : « La meilleure façon de nous aider, c’est de nous signaler les projets innovants que vous connaissez. Je me souviens par exemple d’une personne qui nous avait envoyé une vidéo sur un projet absolument génial. C’est une école de langues au Brésil qui s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup d’élèves qui ne pouvaient aller apprendre l’anglais aux Etats-Unis. Ils se sont rendu compte qu’aux Etats-Unis, il y avait des maisons de retraite où les vieux s’ennuyaient toute la journée. Donc, ils ont créé un système un peu comme Skype. Cela s’appelle : « Speaking exchange ». Ce sont des conversations qui se passent entre de jeunes brésiliens et des retraités américains. Cette vidéo est bouleversante parce que c’est plus d’humanité. Tout le monde est gagnant. Les jeunes apprennent l’anglais et les vieux ont du lien social et se sentent utiles. Nous avons médiatisé le projet : « Speaking exchange » dans plus de soixante journaux dans lesquels nous travaillons ».
Pierre : « La partie émergée de Sparknews, c’est votre site qui est un peu le You Tube des solutions. Si vous déprimez un peu, vous pouvez aller vous balader sur le site ». Christian : « Effectivement, sur le site, il y a plus de 3000 vidéos qui montrent qu’on peut trouver des solutions. Face à tous les problèmes, quelqu’un me disait que tous les dimanches, il regarde une vidéo avec ses enfants Pour lui, c’est une façon de leur monter autre chose que ce qu’ils voient tous les jours à la télé ».
Avec qui peut-on collaborer ?
Pierre : « Vous travaillez beaucoup avec Axa et Total. Qu’est-ce qu’on peut répondre aux gens qui trouvent que cela pose un problème éthique ? Christian : « Nous avons une autre stratégie. Si on les met sur les bancs des accusés en leur disant : « Vous êtes des méchants », finalement, ils n’ont aucun intérêt à évoluer, alors on leur dit : « Oui, vous faites partie des problèmes, mais on peut peut-être réfléchir ensemble comment vous pouvez faire partie des solutions ». On leur amène des innovations positives dans le domaine de l’énergie qui peuvent potentiellement être le « busines model » du domaine. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain : vous allez arrêter le pétrole. Cela prend du temps de gérer cette transition. Après, si on constate qu’ils n’en ont rien à faire, on arrête de travailler avec eux, mais ce n’est pas du tout ce qui s’est passé ».
Entreprendre : Entreprenariat social et micro engagement
Pierre : « Et si on parlait de toi ? La moyenne d’âge des entrepreneurs sociaux est souvent assez jeune. Toi, tu as un peu plus d’expérience. Tu as fait un tour du monde. Tu as réalisé Reporters d’espoir, maintenant Sparknews et surement plein d’autres projets. Quel regard portes-tu sur la carrière d’entrepreneur social ? »
Christian : Je me souviens qu’à trente ans, au fond de moi, j’avais envie d’être entrepreneur social, mais je pensais que je n’étais pas capable de l’être. Un jour, il y a quelqu’un qui m’a dit : « Mais, en fait, tu es un entrepreneur ». C’est quelqu’un qui avait dix ans de plus que moi, qui avait monté sa boite. En fait, c’est le plus grand compliment qu’on ait pu me faire parce que j’ai réalisé qu’on n’avait pas besoin d’être parfait pour être entrepreneur ».
Pierre : « Le micro engagement, qu’est-ce que cela évoque pour toi ? ». Christian : « Pierre, je trouve cela super que tu aies fait ce bouquin : « Changer le monde en deux heures », parce que je m’en souviens très bien : Quand j’avais 23-24 ans, il y avait des jeunes qui partaient une semaine, un mois dans une association et des gens leur disaient : « C’est pour te donner bonne conscience. Cela ne sert à rien ». Quand j’ai fait le tour du monde, on s’est arrêté quelques jours dans un mouroir de Mère Térésa. En principe, n’importe qui peut passer la porte des soeurs et aider pour une demie journée, pour quelques heures. Il y avait un homme qui venait d’arriver, que des gens venaient d’apporter parce qu’il n’arrivait plus à marcher, un indien rachitique visiblement en train de mourir. Et là, il y a un américain qui arrive, un touriste et qui dit : « Est- ce que je peux aider ? Une bonne sœur lui passe une bouteille d’huile et lui dit : « tu vas masser l’homme qui est là ». L’américain se met à le masser pendant une heure, deux heures. Au début de la matinée, cet homme était totalement terrorisé et au fur à mesure que le jeune américain prenait soin de lui, le regardait dans les yeux, il ne pouvait pas parler, mais il y avait une humanité. Ce vieil homme indien est mort au bout de deux heures. Il est vrai que ce jeune américain n’a passé que deux heures. C’est peu, mais c’est sans doute les deux heures les plus importantes de la vie de cet homme. Bien sûr, c’est un cas un peu extrême, mais je pense qu’on a toujours la tentation de se dire : cela ne sert à rien. Il faudrait que je donne ma vie. Il faudrait que je m’engage complètement et, du coup, on ne fait pas les petites choses qu’on pourrait faire ».
Pierre : « Aurais-tu des conseils à donner à des personnes, et notamment aux jeunes, comme il y en a plein sur You tube, qui ont envie d’agir, mais qui ne savent pas par où commencer ? »
Christian : « Partez de vos passions et regardez ce qui vous plait. Cela peut être le cheval, cela peut être les jeux vidéo, cela peut être n’importe quoi… et regardez ce qui se fait dans ces domaines. Par exemple, les jeux vidéos ont un impact social, sensibilisent. Partez de vos passions et partez de ce qui vous provoque, de ce qui vous choque parce que c’est cela qui vous donnera le moteur et l’énergie… »
Muhammad Yunus et le microcrédit
Pierre : « Quels sont les gens qui t’inspirent aujourd’hui ? »
Christian : « Celui qui m’a le plus inspiré, c’est Muhammad Yunus. Muhammad Yunus a été le premier grand entrepreneur social. Ce que je trouve incroyable, c’est qu’il n’était pas du tout destiné à cela. C’est simplement parce qu’un jour il s’est dit : j’enseigne des théories mathématiques économiques qui ne sont même plus capables de résoudre les problèmes de la famine, et donc, avec ses étudiants, il est allé dans un village pour comprendre ce qui se passait et, c’est comme cela qu’il a compris le problème des pauvres et qu’en prêtant quelques dollars, il pouvait changer leur vie. Ensuite, il est allé voir les banquiers en disant : « Tiens, vous devriez le faire puisque c’est votre job ». et puis, comme ils n’ont pas compris ou ils n’ont pas voulu le faire, il l’a fait lui-même. Et, à chaque fois qu’il y avait un problème, il est arrivé à le contourner. Je me souviens par exemple qu’au Bangladesh, il y a les mollahs puisque c’est un pays musulman. Ils lui disaient : « Vous n’avez pas le droit de prêter aux femmes ». il leur dit : « Je vais vous raconter l’histoire d’une femme entrepreneur ». Donc, il leur raconte l’histoire de cette femme entrepreneur. En fait, cette femme, c’était une des femmes de Mahomet… Donc, cela prouve bien que, si Mohammed l’a épousé, c’était très bien qu’elle soit une femme entrepreneur ».
Changer le monde
Pierre : « Tu penses qu’on peut changer le monde ? »
Christian : « Oui, je suis convaincu qu’on peut changer le monde.
Je suis croyant, donc je ne peux pas croire que Dieu se soit amusé de nous mettre dans un monde où les clés étaient pipées d’emblée. Après, on peut croire ce que l’on veut, mais je ne peux pas croire dans un monde où il n’y a pas des clés pour qu’on y arrive. C’est sûr que c’est compliqué, mais, en fait, il suffit parfois de changer quelques paramètres et cela change tellement de choses qu’on peut vraiment inverser la tendance. C’est se rappeler que rien n’est impossible . Cela ne veut pas dire qu’on peut tout réussir, mais, en tout cas, c’est possible qu’on réussisse. Quand je suis sorti de l’Ecole, l’entreprenariat social, cela n’existait pas . Les formations supérieures autour de l’entreprenariat social n’existaient pas. Quand j’ai fait mon tour du monde de l’espérance en 1998, j’avais 24 ans. On a trouvé des projets super, mais ces projets étaient des projets ridicules par rapport à ce qu’on trouve aujourd’hui. Non seulement il y en avait beaucoup moins, mais ils étaient dix mille fois moins innovants. Aujourd’hui, comme le dit Olivier Kayser, le laboratoire d’innovations positives est rempli. Maintenant, il faut créer des usines pour changer d’échelle ».
Pierre : « Pour toi, changer le monde, cela veut dire quoi ? »
Christian : Cela veut dire que tout le monde puisse être heureux. Cela ne veut pas dire forcément être riche, mais que tout le monde puisse être heureux ».
Dans cette mutation profonde dans laquelle l’humanité est engagée depuis plusieurs décennies, vague après vague, nous sommes nombreux à participer à ce mouvement pour un changement positif. A cet égard, cette conversation entre Christian de Boisredon et Pierre Chevelle nous paraît exemplaire, car elle met en évidence une même orientation entre deux personnes dont le positionnement varie quelque peu selon l’âge. Et le questionnement de Pierre Chevelle est particulièrement précieux parce qu’il traduit également les aspirations et les attentes d’une jeune génération.
Christian de Boisredon, à travers de multiples exemples, corrobore notre conviction que les représentations ont un rôle majeur et que c’est à travers des représentations positives que les comportement peuvent évoluer favorablement et contribuer à un changement social pour une vie meilleure. Et, en tout cela, nous avons besoin d’une vision animée par l’espérance (1). Ainsi Christian de Boisredon a-t-il intitulé « l’espérance autour du monde », le livre qui rapporte son projet pionnier. Aujourd’hui encore, c’est le même esprit qui nous anime. Dans la tourmente, gardons cette boussole.
J H
(1) « Agir et espérer. Espérer et agir. Selon Jürgen Moltmann » https://vivreetesperer.com/?p=2720
(2) Présentation de Christian de Boisredon sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_de_Boisredon Témoignage de Christian de Boisredon à TED x Saint Sauveur Square (You Tube) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_de_Boisredon
(3) Christian de Boisredon.Nicolas de Faugeroux. Loïc de Rosando. L’espérance autour du monde. Préface de Dominique Lapierre. Presses de la renaissance, 2000
(4) Sparknews « Pour construire un monde meilleur, commencer par le raconter autrement et valoriser les initiatives à impact positif pour retrouver la confiance et donner envie d’agir » : https://www.sparknews.com
(5) Le site de Pierre Chevelle : Changer le monde en deux heures : https://www.en2heures.fr
(6) Interview de Christian de Boisredon par Pierre Chevelle : « il inspire 120 millions de personnes. Christian de Boisredon. Sparknews. » Sur You tube : https://www.youtube.com/watch?v=9F9d6VS6EoU
Au fil des années, Vivre et espérer participe à la mise en valeur des projets innovants et des initiatives à impact positif. Quelques exemples en rappel :
« Vers une économie symbiotique » : https://vivreetesperer.com/?p=2165
« Le film : Demain » : https://vivreetesperer.com/?p=2422
« Vers un nouveau climat de travail dans des entreprises humanistes et conviviales. Un parcours de recherche avec Jacques Lecomte » : https://vivreetesperer.com/?p=2318
« Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez, selon Jacques Lecomte » : https://vivreetesperer.com/?p=2604
« Alexandre Gérard : chef d’entreprise, pionnier d’une »entreprise libérée » : https://vivreetesperer.com/?p=2746
« Pour une éducation nouvelle, vague après vague . L’expérimentation de Céline Alvarez dans une classe maternelle de Gennevilliers » : https://vivreetesperer.com/?p=2497
« Sugata Mitra : Un avenir pédagogique prometteur à partir d’une expérience d’auto apprentissage d’enfants indiens en contact avec un ordinateur » : https://vivreetesperer.com/?p=2165
« Médiation animale » : https://vivreetesperer.com/?p=2785
« Pourquoi et comment innover face au changement accéléré du monde » : https://vivreetesperer.com/?p=2624
« Cultiver la terre en harmonie acec la nature. La permaculture : une vision holistique du monde » : https://vivreetesperer.com/?p=2405
« Les plantes médicinales au cœur d’une nouvelle approche médicale : phytothérapie clinique intégrative et médecine endobiogénique » : https://vivreetesperer.com/?p=2687
« Génération Y : une nouvelle vague pour une nouvelle manière de vivre » : https://vivreetesperer.com/?p=2652
Lumière et espérance en temps d’orage
Il y a toujours des jardins avec des roses (1)
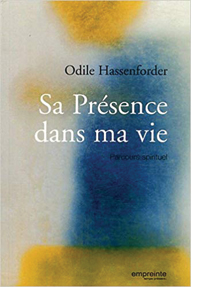 Dernièrement, je visitais une exposition dans une ancienne grange-relais de diligence du temps jadis. J’ai été frappée par le regard lumineux de notre hôtesse. Elle nous expliqua comment, avec son mari, elle avait réparé et parfois reconstruit le bâtiment. Elle nous raconta l’histoire de quelques poutres. Celle-ci était arrivée et avait trouvé sa place au moment voulu ; celle-là avait pris place à la bonne dimension. Une troisième, provenant de la destruction d’une maison ancienne, avait été mise de côté pour être utilisée au bon moment.
Dernièrement, je visitais une exposition dans une ancienne grange-relais de diligence du temps jadis. J’ai été frappée par le regard lumineux de notre hôtesse. Elle nous expliqua comment, avec son mari, elle avait réparé et parfois reconstruit le bâtiment. Elle nous raconta l’histoire de quelques poutres. Celle-ci était arrivée et avait trouvé sa place au moment voulu ; celle-là avait pris place à la bonne dimension. Une troisième, provenant de la destruction d’une maison ancienne, avait été mise de côté pour être utilisée au bon moment.
Ainsi au long des années, ce magnifique bâtiment avait pris forme. Toute cette aventure avait été et est encore pour elle source de joie. Elle nous exprima cette joie débordante avec une profonde reconnaissance pour les bienfaits qu’elle avait reçus . Elle témoignait, sans la nommer, d’une présence supérieure. Au cours des années, tout s’était mis en place à travers des événements appropriés. C’était un mouvement de vie dans lequel elle s’inscrivait.
Dans le même état d’esprit, en traversant son jardin, elle nous partagea son émerveillement devant tel splendide rosier qu’elle avait changé de place parce qu’il végétait. Plus loin, un rosier grimpant prenait racine dans un sol de briques : il avait du trouver le chemin d’un interstice pour pénétrer dans une terre fertile.
Au fur et à mesure de la visite, je me laissais imprégner par la joie profonde que suscite la reconnaissance pour l’harmonie de la vie perçue par-delà le visible. Comment nommer cette harmonie de vie ? Le mot : « Providence » me vient à l’esprit. Ce mot est peu employé aujourd’hui, et, pour certains, il a un caractère désuet. Selon le dictionnaire, il vient d’un mot latin qui signifie : « pourvoir ». « Il s’agit de la sage conduite de Dieu dans la création et les évènements ». Par extension, « Etre la providence de quelqu’un, c’est être la cause de son bonheur, combler ses désirs, veiller sur elle avec sollicitude ». Dans la Bible, Dieu pourvoit à tous les besoins de ceux qui se confient en Lui (2).
Ainsi je peux vivre la présence de Dieu non seulement en constatant son œuvre, mais aussi plus profondément en y collaborant. Etre attentive, accueillir ce qui m’est offert ou proposé, me laisser inspirer pour trouver la place juste au moment voulu… Une telle attitude suscite une joie qui dilate le cœur aux dimensions de l’univers que Dieu tient dans sa main avec sollicitude et bonté. « En Lui, j’ai la vie, le mouvement et l’être » (3).
Bien sûr, il y a bien des malheurs dans ce monde, mais il y a toujours des jardins avec des roses. Ces jardins sont une porte vers la Vie.
Odile Hassenforder
(1) Cette visite remonte à une excursion en Beauce en juin 2004. Ce texte d’Odile a été publié dans son livre : Sa présence dans ma vie (Empreinte temps présent, 2011) (p 217-218). Cet article s’inscrit parmi d’autres textes d’Odile publié sur ce blog : https://vivreetesperer.com/?s=Odile+Hassenforder
(2) Epitre aux Philippiens. Chap. 4 v 19
(3) Livre des Actes. Chap. 17 v 28
Le jardin de Paula
En fréquentant les sites flickr (1), on rencontre des photos qui suscitent l’émerveillement. On peut ainsi constituer une collection à laquelle on revient souvent pour admirer et méditer. Et il y a des sites qui attirent particulièrement notre attention. Pour moi, c’est le cas du site de Paula W (2). Paula y présente des photos de fleurs ou de scènes naturelles. A travers son appareil de photo, son regard nous montre la beauté de la campagne anglaise et les merveilles de son jardin. Ses commentaires entretiennent une convivialité amicale. Nous renvoyons ici à quelques unes de ses photos
J H (1)
Flickr d’après wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Flickr (2)
Site flickr de Paula W : https://www.flickr.com/photos/137207784@N04/with/44734286252/
Etre en attention
Chrétienne, épouse, maman, fille, sœur, ami(e)s… en relation.
A travers la vie, un réseau qui se construit. Mes occasions de relation : fêtes de famille, fêtes chrétiennes, vie quotidienne, loisirs, réseaux sociaux…Des liens d’amitié, coups de cœur humains qui perdurent depuis la jeunesse jusqu’à maintenant.
Le lien humain, c’est comme une structure intérieure qui nous tient en éveil, en essence, à la vie. Le lien peut être fluctuant et changeant. Mais si le lien est tangible, il perdure avec une communication sous-jacente ou explicite. Un bonheur qui peut se traduire par la rencontre d’une personne qu’on n’a pas vu depuis des années. On en arrive à se dire que l’on est reconnue, que l’on reconnaît autrui dans un lien complice et aimant. Le lien a perduré. Quel bonheur !
Au quotidien, bon nombre de personnes que je porte en moi me donne le dynamisme pour aller toujours plus de l’avant. Dans ce dynamisme, je trouve la motivation pour être en partage et en soutien avec l’Ami auquel je souhaite une foule de sentiments positifs.
L’intuition que l’on peut avoir nous donne souvent les clefs pour être en lien, en partage à distance. Un exemple : recevoir un appel téléphonique alors que l’on pense justement à la personne en question.
Effectivement une sensibilité accrue confirme souvent ce genre de réalité. Mon entourage me l’exprime souvent avec amour
J’envisage l’existence essentiellement en étant en attention avec les gens, le monde et ce qui m’environne.
H L



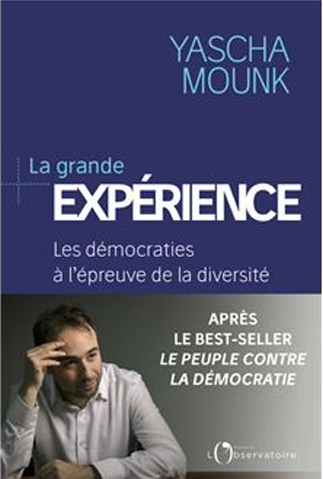
![Écospiritualité par [Michel Maxime Egger]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Jb8kFKNVL.jpg)